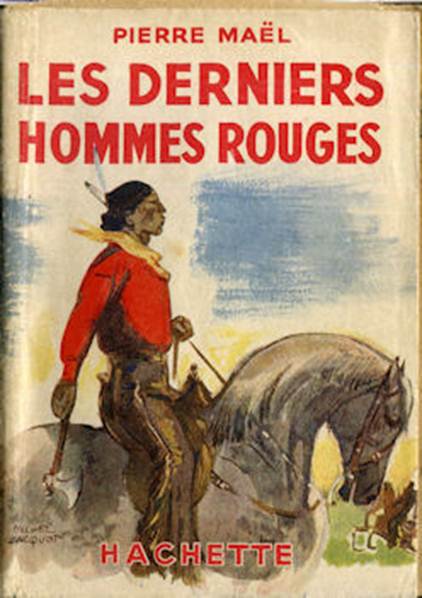
Pierre Maël
LES DERNIERS HOMMES ROUGES
(1895)
Table des matières
XIV LE DERNIER EXPLOIT DE SOURBIN
À propos de cette édition électronique
I
LE BISON NOIR
La plaine immense s’étendait, bordée au nord, au sud et à l’ouest par un rideau de verdure. Nulle route n’y pouvait guider les pas des voyageurs, car on ne pouvait donner le nom de route à l’espèce de sentier tracé à travers la prairie par les pieds des hommes et les sabots des chevaux. Au-dessus des têtes, le ciel d’un bleu intense gardait le rayonnement des derniers beaux jours de l’été. Sur la parure encore intacte des arbres de l’année vieillissante mettait des taches d’ocre et de safran. Les approches de l’automne se laissaient deviner.
Deux cavaliers suivaient au pas le sentier. Leurs montures auraient, en tout pays, attiré l’attention des connaisseurs. C’étaient d’admirables bêtes au poil fin, l’un gris pommelé, l’autre alezan, aux têtes d’une pureté de lignes rappelant le cheval arabe, auquel les deux superbes animaux ne le cédaient ni en vigueur, ni en élégance.
Les deux cavaliers étaient plus remarquables encore que leurs montures.
L’un d’eux était un jeune homme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, aux traits d’une distinction souveraine, aux cheveux et à la moustache blonds, aux yeux bleus largement fendus. Son corps avait les proportions harmonieuses et puissantes que la légende se plaît à accorder aux paladins. – L’autre, d’une stature égale, était presque un vieillard.
Il formait un étrange contraste avec son jeune compagnon, par la différence de la race et du type.
Il appartenait, en effet, à cette race rouge du nord de l’Amérique dont la sève, sans cesse appauvrie par le contact des civilisations blanches, ne laissera bientôt plus de représentants sous le ciel.
Aussi grand que le jeune blanc, d’une carrure aussi athlétique, l’Indien portait avec une sorte de majesté naturelle un costume à la fois sauvage et civilisé. De longs pantalons de drap fin, terminés par des basanes de cuir fauve, garnies d’une frange flottante, des mocassins de cuir protégeaient ses pieds et ses jambes. Le haut du corps était vêtu d’une sorte de chemise de flanelle rouge, brodée de dessins multicolores. Une large ceinture, également rouge, soutenait un revolver à six coups, un coutelas et un tomahawk dont le fer, du plus pur acier, était enfermé dans une gaine de cuir. Une carabine Winchester du plus parfait modèle pendait à son épaule droite, tandis que la hanche gauche du cavalier soutenait une cartouchière bien remplie.
La tête de cet homme méritait l’attention de l’observateur et l’étude du psychologue.
Elle avait le front haut et bombé, l’œil profondément enchâssé sous l’arcade sourcilière, le nez aquilin un peu fort à la base, mais singulièrement délicat, les pommettes saillantes, la bouche grande, le menton accusé. Une forêt de cheveux noirs parmi lesquels ne se montrait aucun fil blanc, se mêlaient sur son crâne à une étrange coiffure faite de plumes entrelacées et dont l’extrémité flottait sur le dos du cavalier et jusque sur la croupe de sa monture. Et ce pittoresque ornement donnait à toute la physionomie de l’homme rouge une expression saisissante de force, de noblesse et de grandeur.
Les deux cavaliers se laissaient aller au pas lent de leurs bêtes, échangeant des réflexions, tantôt en langue française, tantôt dans le dialecte particulier, qui appartenait à la famille des Pawnies.
– Ainsi, Waghna, – dit le jeune homme, – vous avez entrepris seul et mené seul à bonne fin cette noble et féconde entreprise ? Savez-vous que bien peu d’hommes, dans l’histoire, ont fait œuvre aussi utile-en même temps qu’aussi grandiose ?
– Je ne sais si elle est grandiose, ou si elle le sera, – répondit mélancoliquement l’Indien. – Utile, elle l’a déjà été ; elle le sera plus encore, si ceux qui la continueront se conforment au plan que je me suis tracé et que je leur laisserai comme un testament.
– Comme un testament ? – se récria gaiement le jeune homme. – Voilà un mot hors de saison dans votre bouche !
L’Indien sourit et poursuivit avec cet accent calme, un peu traînant, qui appartient à la race.
– Vous me flattez, mon cher Georges. J’ai cinquante-sept ans ; je touche aux portes de la vieillesse, et, vous le savez, pour ceux de ma couleur, les portes de la vieillesse sont celles de la mort, car nous ne dépassons guère les dix ou douze lustres, nous, qui sommes, peut-être, les aînés de l’humanité.
Il prononça ces mots avec une sorte de tristesse, mais de tristesse sereine et grave, avec le ton qui convient à un sage.
Puis, d’un geste large, il embrassa l’horizon verdoyant dont l’allure de leurs chevaux les rapprochait peu à peu.
– Voyez ces forêts, mon cher enfant, – dit-il. – Elles sont encore pleines de sève et de vigueur. L’homme ne les a point encore souillées de son industrie profanatrice. Encore quinze ou vingt ans, et ceux que vous nommez les pionniers de la civilisation les auront envahies, dégradées, mutilées.
Autrefois, elles couvraient toute la face de ce continent, le nouveau par rapport à l’Europe, et pourtant, la vieille, la sainte patrie des hommes rouges. Elles étaient notre domaine propre, l’asile de notre primitive innocence, au temps où la postérité de Caïn n’avait point enseigné la haine et les armes au reste de l’humanité. Les armes, nous ne nous en servions que pour pourvoir aux besoins de l’existence, pour la défendre contre les fauves, contre les autres créatures de Dieu, devenues les ennemis de l’homme après la grande malédiction.
Il s’interrompit et fixa un regard défiant sur les yeux clairs et francs de son compagnon.
– Peut-être vous, étonnez-vous de m’entendre parler ainsi, mon cher Georges, moi, un Indien, moi qui devrais sans doute me conformer aux traditions de vos conteurs blancs, et ne prononcer que des noms vagues, des termes voisins d’une mythologie mystique : le Grand-Esprit, le Manitou suprême, – que sais-je encore, ainsi que parlent mes ancêtres dans les livres de Fenimore Cooper et des autres romanciers ?
Et l’Indien sourit derechef, avec une teinte de scepticisme ironique dans son sourire.
Mais le jeune Européen n’avait point souri, lui. Tout au contraire, il prêtait l’oreille aux paroles de son voisin de marche avec déférence et conviction. Ce que voyant, celui-ci continua :
– Il ne faut pas vous en étonner. Les jours sont loin où mes pareils, ceux de mon sang, usaient encore d’une terminologie religieuse voisine de la superstition ou du fanatisme. Entre autres bienfaits que nous a apportés la civilisation européenne, il faut compter au premier rang l’incroyance qui est à l’âme ce que le whisky est au corps. Rares, très rares, sont ceux qui, comme moi, ont pu combler avec le haut et pur enseignement du Christianisme le vide laissé en nos esprits par la ruine de notre première et fruste religion.
Il parlait avec une lenteur pondérée, et fréquemment ses regards se perdaient dans le vague, en une sorte de rêverie comme s’ils eussent cherché quelque mystérieux au delà.
Cependant, les chevaux avaient pris insensiblement une allure plus rapide. Leur trot relevé les emportait à travers l’interminable prairie, et il devenait plus difficile d’entretenir la conversation. D’ailleurs, le jour déclinait, l’astre descendait sur l’horizon. On le voyait maintenant effleurer du bord extrême de son disque les cimes feuillues du sud-ouest, dont s’éloignaient les voyageurs, tandis que la bordure des forêts, au nord, semblait se rapprocher.
– Ho ! ho ! dit brusquement l’Indien, j’oublie le temps à bavarder, et ne fais pas attention que vous devez avoir grand’faim. Il nous faut hâter le pas, si nous voulons arriver avant la fin du jour.
Sa main flatta l’encolure du mustang, qui prit un temps de galop. Son compagnon l’imita, et tous deux s’élancèrent à travers la plaine herbue et verte.
Ils étaient dans cette partie du Dominion Canadien qui avoisine les territoires des États-Unis, au nord de l’État de Dakotah. Ils avaient laissé sur leur droite les vastes territoires forestiers du Manitoba où se porte de nos jours l’émigration française, et ils couraient en ligne oblique, à l’ouest du Petit-Winnipeg, dans la direction de la rivière Saskatchewan, l’un des plus grands cours d’eau de l’Amérique du Nord.
C’étaient vraiment d’admirables chevaux qui portaient les deux voyageurs.
Ils coururent ainsi deux heures sans modérer leur allure. Tout à coup, l’horizon du Nord qui, de loin, semblait clos par la ligne verte des arbres, parut reculer encore. Mais les premiers arbres, clairsemés, se montrèrent tels qu’un rideau feuillu masquant le lit de la rivière :
– Le beau fleuve ! s’écria Georges avec un élan de sincère admiration.
– Oui, répondit Wagha-na, le beau fleuve, et surtout le bon fleuve, fertilisant, giboyeux, poissonneux, qui nous fournit la nourriture et qui arrose nos pâturages. Hélas ! un jour viendra sans doute où ce fleuve ne sera plus que l’artère de quelque grande agglomération d’hommes, l’égout collecteur des immondices de la civilisation.
Ils avaient atteint les berges du cours d’eau, berges peu élevées, s’abaissant en pente douce jusqu’à la nappe paisible, large de plus d’un kilomètre en cet endroit. L’Indien expliqua à son jeune compagnon qu’à dix milles à l’ouest se trouvait le confluent des deux Saskatchewan qui unissent leurs noms comme leurs eaux.
À quoi le jeune Français répondit avec la gaieté de sa race :
– Alors, c’est un mariage de cousins ; ça ne sort pas de la famille !
Le Pawnie daigna sourire de cette boutade.
– Vous autres, Français, dit-il, vous avez, entre autres qualités, celle de l’esprit. C’est peut-être même cette qualité qui vous fait le mieux venir des autres peuples, mais qui vous suscite le plus de jaloux. Vous êtes les prodigues, les enfants perdus de l’histoire et de l’humanité, les seuls qui n’ayez point été durs envers notre race.
Une fois encore, il interrompit ses réflexions attristées.
À cinquante brasses de la côte, un bateau ponté, une sorte de brick-goëlette, se laissait bercer par le courant, fort rapide. Un canot s’en détacha, monté par deux hommes qui se mirent à nager vers la rive.
– Est-ce pour nous que l’on vient ? demanda le jeune homme.
– Oui, mon cher enfant, c’est pour nous. Est-ce que cela vous étonne ?
– Non. Seulement, je me pose une question assez embarrassante. Qu’allons-nous faire de nos chevaux ?
Cette fois, l’Indien se mit à rire de bon cœur. Il était certain que ce problème devait se présenter à l’esprit de Georges.
– Nos chevaux ? C’est juste. Mais, heureusement, le cas est prévu depuis longtemps. Vous allez voir.
Ce disant, il avait mis à pied à terre, exemple que le Français s’empressa de suivre. Alors, en un tour de main, il défit la sangle et enleva au cheval la selle et le filet léger qui lui tenait lieu de mors. Georges copia fidèlement tous les gestes de son compagnon.
Le canot avait abordé. Deux hommes le montaient. Des deux hommes, l’un était un blanc vieilli dans la prairie, une sorte de trappeur aux proportions herculéennes, l’autre un Indien du même sang que Wagha-na.
Celui-ci leur serra la main, et Georges, après lui, reçut le vigoureux shake hands des deux hommes. Ils s’embarquèrent vivement. À peiné dans le bateau, le Pawnie se tourna vers les chevaux, demeurés paisibles sur la rivé, et leur cria :
– Hips, Gola, à votre choix. L’eau ou la prairie.
Les intelligentes bêtes redressèrent leurs têtes fines, pointèrent les oreilles, et regardèrent vers l’occident où le ciel, décoloré par le haut, ressemblait, à la lisière des bois, à la gueule d’un four incandescent. Ils jugèrent sans doute l’heure trop avancée pour faire la route à pieds, car, sans hésiter, ils entrèrent dans la rivière et se mirent à nager vigoureusement vers le brick, à la suite du canot qu’emportaient les avirons.
Georges ne revenait pas de sa surprise. Il était littéralement émerveillé.
– Ainsi, – demanda-t-il à son guide, – voilà tout votre procédé à l’égard de vos chevaux ?
Vous les laissez libres de prendre la route qu’ils préfèrent ? Mais, si vous avez loin à aller, je n’imagine pas qu’ils vous arrivent ainsi à la nage.
Wagha-na et ses deux acolytes se reprirent à rire de la réflexion.
– Non, assurément, – répondit le Pawnie. – Nous les hissons à bord.
– À bord ? – interrogea le Français. – Je veux bien vous croire. Mais ce n’est pas petite besogne de hisser des chevaux ?
La réponse à la question ne se fit pas attendre.
Tandis que l’embarcation rangeait l’échelle du brick, on vit descendre du pont une façon de filet à mailles très fortes muni de poids qui l’entraînèrent au fond, tandis que ses bords s’ouvraient largement.
Le premier des deux chevaux, Hips, nagea vers le filet au milieu duquel il se plaça. La seconde d’après, les palans se relevaient en grinçant, et le cheval, uniformément soutenu sous le ventre, les jambes pendantes, fut délicatement déposé sur le pont, à l’avant du bateau. La même opération, renouvelée avec les mêmes précautions, amena Gola à côté de son compagnon de route. Ni l’un ni l’autre des deux animaux ne paraissait surpris de cette manœuvre.
– Ah ! par exemple ! – s’écria Georges, – vous pouvez vous vanter d’avoir des chevaux intelligents en ce pays !
– Oui, – répondit Wagha-na, – je reconnais que leur intelligence nous, a grandement aidés au début de ce petit exercice.
Aujourd’hui les huit cents bêtes du ranch sont toutes plus ou moins aptes à faire ce que viennent de faire Hips et Gola.
– Soit ! Mais vous leur laissiez le choix tout à l’heure, m’a-t-il semblé ?
– Vous avez bien vu. Nous leur laissons toujours le choix. Le cheval est une bête nerveuse, partant ombrageuse, qui agit toujours par impulsion. Il ne faut donc pas le contrarier. En conséquence, nous donnons à nos chevaux toute liberté de s’embarquer avec nous ou de franchir à la course les quinze lieues qui nous séparent encore du ranch.
Cette explication satisfit pleinement le jeune homme, bien qu’elle le laissât rêveur.
– Mais voici qu’il se fait nuit, reprit l’Indien, et votre estomac doit réclamer une nourriture plus substantielle qu’une dissertation sur les mœurs particulières des mustangs canadiens. Souffrez donc que je vous conduise à la salle à manger et vous présente au personnel de L’Homme libre.
– Vous dites ?… questionna Georges, surpris.
– Je dis : L’Homme libre. C’est le nom de notre cher brick.
Il s’engagea le premier dans l’étroit escalier qui descendait dans la coursive et introduisit son hôte dans une salle à manger meublée avec cette entente parfaite du confortable qui caractérise le goût anglais.
– Bonjour, père ! s’écria une voix fraîche et rieuse, en bon français, mais avec un accent qui rappelait l’intonation chantante des Normands et des Picards.
Une grande et belle jeune fille, aux yeux et aux cheveux noirs, aux traits d’une idéale pureté s’avança et tendit son front mat et blanc au baiser de Wagha-na.
Et, comme Georges s’inclinait, laissant lire une véritable stupeur sur ses traits, l’Indien le présenta à la jeune fille, dont il énonça ensuite brièvement les noms et qualités.
– Mademoiselle Maddalen-Kerlo, ma fille. Les Goddem disent Miss Madge.
La jeune fille, elle aussi, avait ressenti une sorte de trouble en face du nouveau venu.
Son nom de Georges Vernant avait éveillé en sa mémoire une lointaine et confuse réminiscence.
– Mettons-nous à table, fit l’Indien, interrompant ce muet tête-à-tête ; nous y serons mieux pour causer.
Et, avant de s’asseoir, il acheva les présentations.
– Joe O’Connor, dit-il en désignant le trappeur, Marc Cheen-buck, et il montrait l’Indien.
Puis il prononça deux noms encore et montra deux hommes au teint très brun, aux yeux brillants comme des charbons. C’étaient des métis de blancs et d’Indiens, de ceux que, dans le pays, on appelle « Bois brûlés », anciens compagnons de Riel dans sa lutte contre le gouvernement du Dominion.
Le dîner fut servi par des domestiques nègres, fort bien traités, d’ailleurs, par leurs maîtres. Mlle Maddalen, ou mieux Madeleine, avait surveillé la cuisine en fille habituée à ne rien négliger des soucis du ménage et qui ne s’en croit pas amoindrie.
La conversation fut vive, enjouée. Wagha-na était un gentleman dans toute la force de ce terme anglais qui manque à la langue française. Les bons vins et les bons plats ne l’effarouchaient point et lui rendaient la gaieté qui semblait ne lui être point habituelle en tout autre état. Il en fit lui-même la remarque à son hôte :
– Peut-être, mon cher Georges, vous étonnez-vous du changement de mon humeur ? Je puis vous l’expliquer en disant que ma tristesse n’est pas uniforme. Il me faut bien oublier que notre race s’en va, à peine de lui en donner moi-même l’exemple par trop de morosité. Un peu de verve devant une bonne table n’a jamais empêché le cœur de garder le deuil de ce qu’il aime. Il vaut mieux prendre la vie comme elle vient, et la fêter inter pocula.
Il s’exprimait avec une aisance parfaite et une profonde connaissance de la langue française. Et comme Georges Vernant paraissait ne point sortir des surprises, l’Indien s’expliqua :
– Vous ignorez, sans doute, que je ne suis point un sauvage comme un autre. J’ai voyagé non seulement en Amérique, mais sur le vieux continent, en Allemagne, en Angleterre, en France. C’est même en ce dernier pays que j’ai été élevé. J’en ai rapporté le goût très vif des choses de la poésie et de l’art. Aussi rien ne m’a-t-il été plus agréable que de retrouver des Français dans cette partie du Canada où je suis venu me réfugier à la suite de notre échec dans les États-Unis.
Alors Wagha-na raconta sa jeunesse. Élevé, ainsi qu’il venait de le dire, en France, par les soins d’un prêtre catholique qui l’avait baptisé, il y avait fait de fortes et brillantes études. Ses maîtres avaient même espéré un moment qu’il entrerait dans les ordres, ce qui donnerait à l’Église un apôtre du même sang que les peuples auxquels il porterait l’Évangile. Cet espoir avait été déçu. Wagha-na, que le baptême chrétien avait nommé Jean, ne s’était pas plutôt retrouvé sur le sol de ses pères qu’il avait accepté le commandement d’un parti d’Indiens en révolte contre les lois de l’Union. Une lutte formidable s’en était suivie. Les Rouges avaient été héroïques ; mais, finalement, après trois ans d’une guerre acharnée, ils avaient subi la loi de la conquête. Plusieurs avaient fait leur soumission et accepté le régime des « black hills » et des « réserves ». Le Bison noir, tel était le titre de Wagha-na, réduit à se cacher, avait reçu l’hospitalité d’un colon français du Minner sotah, Paul Vernant, le père de Georges. Celui-ci l’avait aidé à franchir la frontière canadienne, et, pendant trois nouvelles années, le chef indien avait été l’hôte et l’ami du Breton Yves Kerlo. Ensemble, ils avaient mené dans les solitudes du Manitoba la grande vie libre de trappeurs et d’éleveurs. À quarante ans, Yves Kerlo avait épousé une jeune métisse Bois brûlé. Il en avait eu une fille, la petite Madeleine, aujourd’hui âgée de dix-huit ans. La mère n’avait guère survécu à la naissance de cette enfant, et lorsque, trois ans plus tard, Kerlo était tombé mystérieusement frappé par une balle, il avait confié l’enfant à son ami l’Indien avec ces paroles d’obsécration :
– Wagha-na, je pardonne à mon meurtrier. Mais n’oublie pas que je suis victime d’un attentat qui avait pour but d’assurer ma succession à un misérable, mon seul parent, mon unique héritier, si Madeleine venait à disparaître. Veille donc sur l’enfant et garde-la comme si elle était ta propre fille.
Lui-même, par un testament en règle, avait institué son ami légataire universel d’une fortune déjà respectable que Wagha-na, avec autant d’intelligence que de bonheur, avait prodigieusement accrue. Aujourd’hui l’Indien se trouvait à la tête d’une opulence qui se chiffrait par millions.
Son premier acte avait été de conduire l’orpheline à Montréal où il l’avait confiée aux religieuses du Saint-Esprit, en ayant soin, pour plus de précautions, de la recommander à la supérieure sous les noms de Marie-Madeleine Jean. Puis il était revenu dans les forêts et les plaines de la Saskatchewan et de l’Assiniboine pour y mettre en vigueur tout un système d’exploitation et d’organisation que sa tête puissante avait depuis longtemps conçu.
Ce système était fort simple. Il consistait à défricher par avance, au goût des émigrants, de vastes espaces de terres, qu’il cédait ensuite au gouvernement canadien pour les concessions que celui-ci voulait faire aux colons venus de l’Ancien Monde, plus spécialement de France et d’Irlande. Car Wagha-na avait voué toute son affection aux races qu’il estimait les plus voisines de la sienne par leurs mœurs, leurs tendances et leur caractère.
Toutefois l’Indien avait soin de ne point aliéner la totalité de ses possessions territoriales. Il s’y réservait de vastes espaces consacrés soit à la culture, soit à l’élevage, et d’autres plus restreints sur lesquels il établissait, ainsi que sur de véritables fiefs, des familles soigneusement choisies dans le contingent français ou irlandais que lui envoyait l’émigration. Il créait pour les Indiens de véritables postes de ralliement, des stations fort bien aménagées au point de vue du confortable, et n’exigeait, en retour, que des prestations volontaires pour le service du ranch qu’il entretenait, et l’engagement formel, sous peine de dépossession immédiate, de : ne laisser aucun débit de boissons s’installer sur leurs terres, sans son autorisation expresse. Il combattait ainsi l’ivrognerie, ce fléau des races rouges et aussi des Irlandais. Les uns et les autres avaient un délai de trente ans pour se rendre acquéreurs des portions de terres concédées, et force leur était ainsi de se créer une famille pour continuer leur établissement. Quant à Wagha-na, il poussait alors sa course plus avant dans l’ouest ou le nord, acquérait de nouvelles terres et en ouvrait les voies à de nouvelles colonies.
– Oui, dit-il, en étendant son poing fermé dans la direction du sud, c’est là ma vengeance. Je jette la semence d’un peuple qui, tôt ou tard, dévorera cet agrégat cosmopolite et industriel qui se nomme les États-Unis.
Le brick voguait maintenant en pleines ténèbres. Soudain la lune brilla au ciel et éclaira de ses rayons une nappe d’argent sans bornes, sur laquelle quelques feux brillaient de loin en loin.
– Le lac Winnipeg, dit l’Indien, répondant à la muette question des yeux de Georges Vernant.
II
MADELEINE
La fille d’Yves Kerlo était une étrange et séduisante créature.
Peut-être n’aurait-elle pas rempli exactement le programme des qualités requises pour faire ce que nous nommons, en France, « une jeune fille accomplie ». Elle n’avait point encore les grâces alanguies de la femme, elle n’avait jamais eu les subtiles coquetteries de quelques échantillons assez désagréables du sexe féminin. Mais la femme française revivait en elle par ses qualités de vivacité spirituelle, de haut bon sens, de dévouement à la hauteur de toutes les épreuves.
En même temps, elle tenait de son origine sauvage, quoique déjà lointaine, un charme mystérieux et captivant. Sa beauté même avait la saveur des fruits exotiques. On pouvait lire dans ses yeux une volonté impétueuse, un courage que n’effrayait aucun obstacle.
Grande, élégante et souple, elle était écuyère consommée en même temps que rompue à tous les exercices. Aussi Wagha-na, en lui faisant faire plus ample connaissance avec Georges Vernant, souligna-t-il ses éloges d’une parole qui, chez nous, n’eût pas été précisément un compliment :
– C’est un garçon manqué que cette fille-là.
Dans la bouche de l’Indien, ce n’était là qu’un éloge.
Mais l’éloge ne nuisait aucunement aux qualités de séduction de la jeune fille.
Sous la forêt de ses cheveux noirs, son teint blanc et mat, que coloraient à peine, sous le coup d’une excitation ou d’une émotion, quelques fugitives rougeurs, faisait mieux ressortir l’éclat de ses prunelles sombres.
Quoique toujours élégamment vêtue dans l’intérieur de la maison, et toujours avec le goût pur qu’avaient su affiner en elle les religieuses françaises dont elle avait été l’élève à Montréal, elle revêtait pour ses courses au dehors un costume de chasse qui lui assurait mieux la liberté de ses mouvements.
Ici encore l’élégance s’était rencontrée naturellement, sans, recherche. De larges pantalons à la zouave, ou une courte jupe, descendant jusqu’aux genoux, étaient accompagnés de guêtres de peau tannées à la manière indienne et rejoignant des mocassins également de cuir. Une sorte de justaucorps de cuir protégeait le buste, un chapeau de feutre à larges bords pour l’été, une toque de fourrure en hiver, complétaient ce costume simple et pittoresque.
Il n’était pas jusqu’aux armes qui ne fussent appropriées aux forces et au goût de la jeune fille.
Un ceinturon brodé par elle soutenait une cartouchière, un revolver à six coups, une dague à la lame large et solide. Sur son épaule, elle jetait une carabine légère que Wagha-na avait fait faire tout exprès pour sa fille, une arme admirable, ciselée et damasquinée, d’une portée et d’une justesse égale à celles des fusils de guerre. L’Indien y avait mis le prix. Ce chef-d’œuvre avait coûté mille dollars, – un prix exorbitant en Europe où les plus belles armes ne dépassent pas le chiffre de quatre mille francs.
Ce fut en cet équipement que Maddalen se montra à Georges Vernant le lendemain matin de son arrivée à la station de Doggerty, nom irlandais donné par ses premiers habitants à l’embryon de ville où ils s’étaient assemblés provisoirement, d’abord, et bientôt définitivement fixés.
Doggerty n’était encore qu’un village de soixante feux, construit sur la rive orientale du lac Winnipeg.
Au simple point de vue de ses origines, cette ébauche d’agglomération urbaine méritait d’être étudiée de près.
Des soixante familles qui la constituaient, vingt étaient purement indiennes. Quatorze autres étaient de race métisse. Six représentaient l’élément français, et plus spécialement breton, auquel Wagha-na avait voué une affection particulière. Les vingt autres étaient irlandaises. Et, bien qu’inférieures en nombre, les familles blanches l’emportaient par le chiffre des vivants. En effet, elles mettaient en ligne cent cinquante-six individus des deux sexes, tandis que les vingt familles indiennes n’offraient que soixante-quinze membres et les quatorze métisses soixante.
Wagha-na, qui présidait aux destinées de ces organisations commençantes, s’attachait à leur imposer dès le début un régime quasi-militaire. Chaque cité ainsi fondée avait sa milice à laquelle on était astreint de vingt à quarante-cinq ans, ce qui n’empêchait pas les hommes plus âgés de se constituer en réserve.
Présentement, Doggerty avait une armée active de cinquante-deux soldats volontaires, parmi lesquels vingt-six Irlandais, douze Français, huit Indiens et six « Bois brûlés », et une réserve de trente hommes dont Joë O’Connor était le chef indiscuté. Il était, à vrai dire, le généralissime de ces quatre-vingt-deux combattants, et disait avec fierté, en montrant de la main l’ensemble des demeures, à moitié voilées par les arbres :
– Si l’on appelait les jeunes gens à partir de quinze ans, je commanderais à une véritable compagnie de cent deux hommes.
– Cent trois quand je suis là, – disait gaiement Miss Madge, en embrassent le vieux trappeur sur les deux joues.
– Oui, quand vous êtes là, – répliquait Joë. – Mais, voilà, petite Miss. Quand y êtes-vous ?
Et Madeleine de répondre avec un imperturbable sérieux :
– Tu sais bien que j’y suis toujours, capitaine Joë O’Connor.
Cette réponse amenait un sourire sur les lèvres de l’Irlandais, et ses yeux se fixaient, humides, pleins de tendresse sur la belle jeune fille qui lui parlait avec cette familiarité touchante.
C’est que Madeleine était à la fois l’enfant et la reine, presque la fée des vingt-deux stations fondées par Jean Wagha-na. Elle leur servait de lien familial. Tous aimaient le noble et grand Indien qui s’était fait le bienfaiteur et l’ami de ses frères sans distinction de couleur et d’origine. Mais cette affection était tempérée par le respect et même par un peu de crainte. Jean Wagha-na avait eu, au début de ses créations, quelques sévérités à l’égard de certaines velléités de discorde. De mauvais esprits, de faux frères, avaient subi l’effet de sa justice. Il avait même été contraint, en une circonstance, de brûler la cervelle à un Yankee venu sur ses terres beaucoup plus en espion qu’en colonisateur.
Ces souvenirs lui avaient fait une légende, un renom d’implacable justice que mille actes de bonté et de mansuétude n’avaient pu détruire. Aussi bien ne nuisait-elle aucunement à son prestige.
Mais, autour de Madeleine, cette même légende n’était plus qu’une auréole de poésie, fondant tous les cœurs en une seule tendresse, en un attachement fanatique qui lui assurait le dévouement sans réserve des dix mille habitants de la nouvelle colonie et lui donnait pour armée, pour gardes attentifs et jaloux, les trois mille six cents volontaires qui formaient la milice du petit État.
Elles étaient ravissantes, les histoires que racontaient les mères et les filles sur le passage de la fée, histoires empreintes de la poésie des forêts et des solitudes, histoires vraies, au demeurant, qui toutes se rattachaient à de bonnes actions ou à de vaillantes prouesses accomplies par la jeune fille.
Oui, c’était bien vraiment une fée que l’on voyait passer sur sa jument alezane emportée d’une course folle à travers la prairie, chassant devant elle les troupeaux de chevaux sauvages ou de bœufs aux immenses cornes, franchissant ravins et torrents comme si le merveilleux coursier qui la portait avait eu des ailes, affrontant les bandes de bisons encore errantes dans les plaines ou les hardes de wapitis, n’ayant aucun souci des panthères de la forêt ou des terribles grizzlis de la montagne.
Mais c’était plus encore une fée, cette douce et belle jeune fille que l’on voyait toujours apparaître au moment des détresses, au chevet des malades ou des mourants, portant aux uns l’argent ou les armes nécessaires, aux autres le remède efficace ou simplement apaisant, à tous le bienfait de sa parole et de son sourire.
Les Pères qui dirigeaient les consciences de ce jeune peuple, les religieuses qui leur versaient le baume des soins pieux et de l’enseignement chrétien, disaient d’elle en la regardant :
– C’est notre fille et notre sœur. Ce sera la première sainte du Manitoba.
Aussi était-ce fête en chaque station dès qu’on signalait sa venue. Celles qui possédaient quelques instruments de musique lui préparaient une réception triomphale. On lui dressait des arcs de triomphe, et la milice en armes, précédée du clergé et des écoles, suivie du reste de la population, se portait en grande pompe au-devant d’elle.
Alors la pieuse Madeleine s’humiliait. Elle se défendait de ces honneurs qu’elle jugeait immérités, et, du plus loin qu’elle voyait les bannières de la paroisse et la croix portée par les enfants de chœur, elle mettait pied à terre et s’avançait, les mains jointes, s’agenouillant pour recevoir la bénédiction du prêtre.
De toutes les stations de la colonie, Doggerty était celle qui obtenait les préférences de Madeleine.
Elle avait pour cela plusieurs raisons. C’était à Doggerty qu’elle était née, qu’elle avait passé les premières années de son enfance, qu’elle avait, plus tard, après sa sortie du couvent vu naître et croître, sous sa jeune influence, les belles et bonnes œuvres qui s’y épanouissaient. Doggerty était, en quelque sorte, son apanage, son bien propre. Les habitants se flattaient de la posséder entre tous, à eux, bien à eux, et peut-être la charmante fille encourageait-elle un peu la naïve vanité qu’ils en tiraient.
Or, ce matin-là, entre autres, elle était attendue avec impatience. Le conseil de la station s’était réuni et avait décidé de soumettre à son jugement, en dernier ressort, une question embarrassante.
Il s’agissait d’une demande de séjour adressée aux autorités par deux étrangers venus du Sud. Bien que se disant catholiques et d’origine française, les nouveaux venus n’avaient pas eu l’heur de plaire aux habitants de la colonie. La grande majorité du conseil, – six contre un, – avait conclu au rejet de la demande.
Cela n’avait point empêché d’exercer à leur égard les devoirs d’une hospitalité bienveillante.
On les avait logés et nourris pendant trois jours. Mais les règlements étaient formels : ils prescrivaient que, dans la semaine, le conseil eût à statuer sur l’admission définitive des voyageurs à la résidence perpétuelle. Or c’était là le point du conflit. Malgré leur instinctive répulsion à rencontre des deux personnages, les chefs de la station n’auraient pas voulu rejeter la demande qui leur était faite, sans en référer à celle qui, à leurs yeux, représentait toute la sagesse unie à toute la bonté.
Ils avaient donc attendu la venue de la « fée » pour lui exposer le délicat problème. En outre, la présence de Wagha-na leur assurait le concours d’un jugement très sûr, d’une sagacité éprouvée.
Aussi, lorsque Georges Vernant, à son lever, fut descendu dans la salle à manger de la maison que les colons de Doggerty avaient bâtie en belle pierre pour leur jeune souveraine, vit-il celle-ci se présenter à lui en simple et claire toilette de femme du monde qui n’a plus qu’à mettre son chapeau sur sa tête.
Il s’inclina devant la matineuse jeune fille, s’étonnant un peu qu’elle fût levée d’aussi bonne heure. Le jour, en effet, venait à peine de paraître, et le lac était couvert de brumes blanches, moutonnant comme des flocons de laine sur le dos d’un troupeau de moutons.
– Vous vous préparez donc à sortir, Mademoiselle ? demanda-t-il gaiement à Madeleine.
– Oui, Monsieur, répondit-elle, et pour affaires graves.
Et elle lui exposa le cas difficile que l’on soumettait à sa compétence.
– Vous le voyez, dit-elle, j’ai grand besoin que la sagesse divine m’assiste en cette occasion. Mes chers concitoyens me font juge d’un cas auprès duquel celui qu’eut à trancher le grand roi Salomon n’était qu’un jeu d’enfants au berceau.
– Vous ne pouviez mieux dire, Mademoiselle, répliqua Georges, riant du mot de la jeune fille.
Il ne pouvait se défendre d’une véritable surprise en face de cette simplicité des âges primitifs, qui remettait à l’intuition, presque à l’instinct de cœur d’une femme à peine entrée dans la vie la solution d’un problème qui tenait en suspens la prudence de plusieurs hommes mûrs.
Madeleine n’était pas sans s’être aperçue de cet étonnement de son hôte, et peut-être allait-elle s’en expliquer avec lui, lorsque son père d’adoption entra à son tour dans la salle à manger.
Tous trois s’assirent alors autour d’une table sur laquelle une servante Indienne avait placé des œufs, du beurre, du chocolat préparé avec une entente parfaite de ce breuvage hygiénique et fortifiant.
La conversation se généralisa. En quelques paroles, Wagha-na expliqua à Georges toute la gravité du problème qui s’agitait devant ce conseil d’hommes simples et quelque peu frustes.
– Mon cher enfant, dit-il, vous venez des cités industrieuses et policées de l’Union et de la vieille Europe. Vous n’êtes point encore au courant de nos mœurs et de nos usages. Et pourtant, vous n’en êtes pas si éloigné que vous en avez l’air et que vous pourriez le croire vous-même. N’êtes-vous donc point le fils de mon vieil ami Paul Vernant, l’un des plus robustes et des plus hardis colons du Minnesotah ? Il ne peut donc exister en vous aucune répulsion, aucune répugnance contre notre mode de vie par trop agreste.
Georges protesta vivement contre une telle hypothèse.
– Répugnance, répulsion ? Quels mots employez-vous donc là ? Ils n’ont aucune signification dans le sujet actuel de notre entretien. Ne savez-vous donc pas que les années passées par moi, soit dans les grandes cités industrielles et commerçantes des États-Unis, soit même dans la douce et chère France, notre première patrie, au sein de cette ville admirable, unique au monde, qui se nomme Paris, ne m’ont laissé aucun regret, et qu’elles étaient toujours hantées par le désir de revenir aux lieux de mon enfance ?
– En ce cas, vos vœux sont réalisés, mon cher Georges, puisque votre père renonce à l’idée de vous établir dans un grand centre comme New York ou Chicago, et consent à vous garder près de lui.
– Mieux encore, mon excellent ami, – répondit Georges. – Mon père va au-delà de mes désirs. Il met en vente toutes ses propriétés du Minnesotah pour passer la frontière et s’établir ici. Il a le désir de finir ses jours auprès de vous et de ses compatriotes. Le Canada n’est-il pas destiné à devenir une seconde France ?
– Quoi ! – s’écria joyeusement l’Indien, – votre père se souvient à ce point de notre vieille amitié ! Il réalise le plus cher de mes vœux. Ah ! vous pouvez m’en croire, aucune nouvelle ne pouvait être plus douce à mon cœur.
Et, se levant, il ouvrit ses bras au jeune Vernant et le serra étroitement sur sa poitrine. Madeleine fit une adorable moue.
– Oh ! Monsieur Vernant, fit-elle, vous êtes ingénieur, m’a dit mon père. N’allez pas, je vous en supplie, nous apporter votre abominable progrès à la vapeur, cette atroce science dont le siècle est si fier, et que je considère, moi, comme le bourreau de la nature !
Georges rassura en souriant la jeune fille trop promptement alarmée.
– Tranquillisez-vous, Mademoiselle. Oui, je suis ingénieur, mais sans professer pour la science l’aversion que vous semblez ressentir à son endroit, je puis vous assurer, que j’ai tout autant que vous l’horreur d’un progrès dont le luxe est toute la raison d’être et le mercantilisme l’essence. Je ne veux faire de la science que l’auxiliaire de la nature, la propagatrice des bienfaits que l’homme est en droit d’attendre d’elle, qu’il doit lui réclamer au besoin. Sous la garantie de cette déclaration, j’espère que vous ne me refuserez pas la faveur de m’établir sur votre domaine, aux côtés de mon père, et de prendre ma part de l’œuvre grandiose que le vôtre a si heureusement entreprise.
Madeleine rougit et, souriant à son tour, tendit la main au jeune homme.
– Non, fit-elle, à Dieu ne plaise que je refuse un aussi précieux concours. Je le réclame même au besoin.
Ils ne purent continuer leur dialogue sur ce sujet. La porte venait de s’ouvrir et l’Indien Cheen-buck était entré.
– Petite Reine, dit-il, le Conseil est assemblé et n’attend plus que vous.
Mlle Kerlo se leva. Elle jeta sur sa tête une sorte de cape de toile blanche et, donnant l’exemple, elle sortit la première, en criant gaiement à Georges :
– Allons, Monsieur. Vernant, s’il vous plaît d’assister à une séance délibérative du Comté de Doggerty, vous n’avez qu’à me suivre. Elle s’était servie de l’expression « Comté » pour traduire le mot anglais « Shire » qui correspond à une division territoriale inconnue aux Français et qu’elle appliquait arbitrairement aux terres non classées du Dominion.
Elle conduisit son père d’adoption et l’hôte de celui-ci dans le local des séances du Conseil. Ce local servait à tous les pouvoirs, militaire, administratif et judiciaire. Dans une haute et vaste salle, aux murs et aux planchers de bois, des chaises rangées sur trois des faces étaient réservées aux spectateurs. Sur une estrade plus élevée d’un pied et demi était placée la large table en bois de chêne couverte de trois peaux de bisons merveilleusement préparées, autour de laquelle, sur d’imposants fauteuils, s’asseyaient les conseillers de la station, le juge Etienne Briant, un Français, et les officiers de la milice qui y tenaient hebdomadairement leurs réunions.
Au moment où Madeleine, escortée de Wagha-na et de Georges, pénétra dans la salle, les sept membres, parmi lesquels se trouvait l’Indien Marc Cheen-buck, qui était allé la prévenir, se levèrent respectueusement, et Joë O’Connor, traduisant les sentiments de l’assistance, lui offrit le fauteuil de la présidence.
– Comme en Angleterre, dit le vieil Irlandais, nous avons, nous aussi, notre gracieuse reine.
– Et, dit le juge Etienne Briant, en riant, la loi Salique n’existe point en ce pays.
Mlle Kerlo refusa gentiment d’un geste de la main. Puis, afin de bien montrer à ses amis qu’elle ne se désintéressait aucunement de leurs préoccupations administratives, elle prit vivement une chaise le long du mur et, la plaçant sur l’estrade, s’assit sans façons à côté du président O’Connor, un peu en arrière. Etienne Briant résuma et présenta la question en quelques mots. C’était lui qui, seul, avait émis un avis favorable à l’autorisation à donner aux deux étrangers qui sollicitaient le droit de domicile. Il crut devoir s’en expliquer.
– Je dirai donc à notre chère Reine, comme je l’ai dit à mes excellents collègues, que je me suis cru tenu, par ce caractère même de juge dont m’a revêtu la confiance de mes concitoyens, à accorder à deux nouveaux venus la faveur de s’établir loyalement sur notre territoire. Mais j’ajoute que je n’y vois aucun avantage.
Madeleine écouta ces paroles, et les raisons contraires de chacun des conseillers, avec une petite moue passablement moqueuse.
– Est-il possible, demanda-t-elle, de voir, ces solliciteurs face à face ?
– Rien n’est plus facile, répondit Cheen-buck. Ils attendent derrière la maison commune, sous un chêne.
– Bien ! Qu’on les fasse venir ! Je crois que cela vaudra mieux.
Madeleine prononça ces mots d’un ton net et tranchant, qui marquait une grande force de volonté.
Cheen-buck, qui était, sans doute, l’appariteur en chef ou le préfet de police de la petite commune, se leva et, ouvrant une porte dans le fond de la salle, jeta un ordre bref à un beau garçon de vingt ans, coiffé d’un large chapeau de feutre, chaussé de bottes molles, et qui, par-dessus son justaucorps de peau, portait une large ceinture de laine rouge à laquelle étaient pendus un sabre de cavalerie et un revolver d’arçon dans sa gaine de peau de martre zibeline.
Le jeune milicien traversa la salle et sortit. Mais ce ne fut que pour rentrer au bout de trois minutes escortant les deux pétitionnaires.
On vit alors apparaître deux individus aussi dissemblables par l’allure que par les signes extérieurs du corps.
Le premier était un homme de taille moyenne, bien pris dans ses formes, et paraissant âgé de quarante à quarante-cinq ans. Sa figure, très brune, soulignée par une barbe en collier, passablement longue sous le menton, avait tous les caractères à l’aide desquels on trace si aisément la caricature du Yankee démocrate. Rien de haut ou de grand ne se voyait sur cette physionomie têtue et revêche, qui n’était pas dépourvue, cependant, d’une certaine fierté, due à la bonne opinion que le personnage avait de lui-même. Il déclara se nommer Ulphilas Pitch, d’origine norvégienne, mais, depuis trois générations, citoyen de la libre Amérique.
Le second, de très grande taille, de proportions herculéennes, répondait aux noms de Gisber Schulmann. Il parlait correctement le français, mais avec un accent tudesque auquel il était impossible de se méprendre. Quand on lui demanda sa nationalité, il répondit qu’il était Alsacien, et fit voir divers papiers portant la marque des autorités françaises de Belfort.
En ce moment, Wagha-na, qui s’était assis au rang des spectateurs, éleva la voix et prononça avec la plus pure intonation parisienne, ces mots qui firent tressaillir le nommé Schulmann.
– Rien ne ressemble plus à un honnête homme qu’un coquin, et à un alsacien qu’un allemand.
Le solliciteur répliqua avec impertinence.
– Je parle au chef de cette station et non à ce Peau-Rouge qui n’a rien à voir dans cette affaire.
Georges Vernant put voir Wagha-na frémir. Mais l’Indien fut suffisamment maître de lui. Il ne proféra plus une parole.
Quelqu’un parla pour lui ; ce fut Madeleine.
La jeune fille s’était levée. Ses yeux noirs lançaient des éclairs. Elle, si douce à l’ordinaire, semblait agitée d’une violente colère. Elle regarda bien en face les deux hommes et, les apostrophant durement :
– J’atteste, dit-elle, que j’étais venue ici avec de bonnes intentions à votre égard. Mais puisque votre premier acte est de manquer de respect à mon père, le bienfaiteur de ce pays, que tous aiment et vénèrent…
– Oui, oui, bien parlé, Reine ! – s’exclamèrent les membres du Conseil. – Vous n’avez pas besoin d’en dire davantage. Notre résolution est prise. Que ces mécréants aillent se faire pendre ailleurs. Le Dominion est vaste.
Ulphilas Pitch adressa un rapide reproche à son compagnon. Confus de sa maladresse, Gisber Schulmann essaya de la réparer au moyen d’une autre maladresse.
– J’ignorais, dit-il, que cet homme fût le respecté John Wagha-na.
– Cheen-buck, prononça Joë O’Connor, tu feras manger ces deux hommes, après quoi on les reconduira aux limites de la station. Le Conseil n’a pas de terres à leur concéder.
III
UN COMPLOT
L’instinct des membres du Conseil de la station avait été aussi sûr que celui des animaux, et le petit incident d’audience qui s’était produit n’avait fait que jeter le poids additionnel qui avait fait pencher la balance dans le sens de l’expulsion.
Tout le monde fut satisfait de ce jugement, tout le monde, sauf peut-être Marc Cheen-buck qui, méfiant comme tous ceux de sa race, adressa ces paroles à Wagha-na au sortir de la salle :
– Chef, tu t’es fait deux ennemis mortels, et la fée pourrait bien s’en repentir.
Le Pawnie avait froncé le sourcil. Il affecta pourtant la plus tranquille confiance et répondit :
– Tu te trompes, Marc. Je ne me suis pas fait de ces deux hommes des ennemis pour l’excellente raison qu’ils le sont depuis longtemps. Tu peux même être assuré d’une chose, c’est qu’ils ne sont venus ici que dans l’intention bien arrêtée de nous nuire. Seulement, voici où commencent mes incertitudes. Viennent-ils spontanément, ou bien sont-ils envoyés par quelqu’un ?
– Que veux-tu dire ? Questionna Cheen-buck, surpris et même alarmé.
– Chut ! – et le Chef mit un doigt sur sa bouche, – nous reparlerons de tout ceci plus tard. Il importe que l’enfant ne sache rien, et, en ce moment, elle est trop près de nous. Viens ce soir me rejoindre en compagnie de Joë et du juge Etienne Briant. Nous tiendrons conseil entre nous.
Il quitta son compagnon et vint vers Madeleine qui s’entretenait gaiement avec Georges.
Or, pendant ce temps, les deux personnages expulsés étaient conduits par le jeune milicien de garde vers l’hôtel un peu rustique où ils étaient eux-mêmes descendus. L’hôtesse, une métisse, mère de quatre enfants, leur offrit un dîner copieux, et lorsqu’ils portèrent la main à leurs poches pour régler l’addition, la brave femme les remercia d’un geste. Comme ils s’étonnaient, elle ajouta :
– Nos lois particulières sont précises sur ce point. Du moment que l’on ne vous garde pas à Dogherty, vous n’avez rien à nous payer. Prenez donc vos chevaux à l’écurie ; ils ne paient pas plus que vous.
Les voyageurs, quoique surpris de ces mœurs patriarcales, n’en furent pas autrement touchés. Ils remontèrent sur leurs bêtes et reprirent, assez maussades, le chemin de la prairie.
– Eh bien, Gisber, je vous avais prévenu, fit le Yankee, qui n’avait pas encore dominé sa mauvaise humeur, votre langue nous a desservis une fois de plus. Sans votre insolence envers l’Indien, nous serions à cette heure citoyens de l’État de Dogherty.
Il avait ironiquement appuyé sur ces mots « l’État de Dogherty ».
– Voilà un honneur dont je me passe aisément ! ricana le Germain avec sa grossièreté habituelle.
– Eh ! reprit l’autre, toujours grondeur, qui parle de l’honneur qu’on en peut acquérir. Je n’envisage que l’avantage que nous en pouvions retirer au point de vue de nos projets.
– Et quel est donc cet avantage que vous regrettez si fort, Ulphilas ?
– Stupid fellow ! grommela l’Américain entre les dents. Et, répondant à son compagnon, il poursuivit :
– Comment ne voyez-vous pas de quel avantage il eût été pour nous de nous trouver sur le terrain même que nous convoitons. Ici, nous aurions pu suivre jour par jour, heure par heure, l’existence et les faits de cette riche héritière, car il n’y a pas l’ombre d’un doute à conserver : l’identité de Madeleine Jean avec la fille d’Yves Kerlo est indéniable. Tandis que, proscrits et éloignés comme nous le sommes maintenant, il nous est bien difficile de la surveiller et de nous tenir prêts pour une bonne occasion. – Sans compter que voilà tous ces gens-là prévenus et, désormais, ils vont avoir l’œil sur nous.
Gisber Schulmann avait baissé la tête. Il ne sentait que trop la vérité des reproches de son compagnon.
Tous deux pressaient l’allure de leurs bêtes en gens nerveux et mécontents.
Au bout de quelques kilomètres parcourus sans mot dire, l’Allemand releva la tête.
– Ulphilas ! demanda-t-il presque timidement.
– Qu’y a-t-il ? questionna le Yankee toujours aussi bourru.
– Savez-vous que tout ce que vous me dites-là me donne beaucoup à réfléchir ?
L’Américain éclata d’un rire singulier qui ressemblait beaucoup à un grognement.
– Allons ! fit-il, je prévois la suite de votre discours.
– Vous prévoyez ?… Ah ! Et, voyons un peu ce que vous prévoyez, mon digne maître ?
Pitch ralentit l’allure de son cheval et, relevant, sur son front les lunettes d’or qui lui donnaient un faux air de vieux savant ou de pasteur en retraite, il regarda son camarade du coin de l’œil, avec un sourire goguenard :
– Je vous connais depuis trop longtemps, my dear, pour ne point savoir à quoi m’en tenir sur l’ensemble de vos vertus, en y comprenant celle de courage.
– Vous me persiflez, Ulphy, et vous avez tort ! gronda Gisber avec une colère contenue.
– Non, mon cher. Dire la vérité, ce n’est point persifler. Je vous dis que je vous connais.
Ce que vous allez me dire peut se résumer ainsi : « L’entreprise est hasardeuse, pleine de périls. Si nous l’abandonnions ! »
L’Allemand ne parut point se blesser de l’ironie de ces paroles. Il paya d’audace.
– Eh bien, mon cher, vous avez vu clair, et telle est, en effet, ma pensée. Je n’ai aucune honte de le confesser.
– À la bonne heure, mon cher, répliqua le Yankee railleur. Entre nous, vous faites bien d’être sincère, car cela me met à l’aise avec vous. Je vous dirai donc que, moi aussi, je trouve cette aventure extrêmement dangereuse. Mais, au contraire de vous, c’est là, selon moi, une raison de plus pour que nous nous y acharnions.
– Je ne vous comprends pas.
– Vous allez me comprendre, si, toutefois, vous voulez bien me prêter un peu plus d’attention que vous n’en apportez, d’ordinaire, aux choses sérieuses qui demandent un effort de la volonté et une tension de l’esprit.
Gisber Schulmann parut agacé de cet exorde qui servait d’introduction à une confidence. Il contint néanmoins son caractère naturellement irascible, et répondit, avec un frémissement d’impatience :
– Ulphy, au lieu de me morigéner sans cesse, vous feriez mieux de m’ouvrir l’esprit. Vous perdez du temps à me trouver l’intellect lent et, surtout, à me le dire à tout propos. Mieux vaudrait me faire entrer vos idées dans la tête. Vous savez, en effet, que dès que ma cervelle a reçu une idée, elle la retient imperturbablement, et qu’alors toute mon énergie s’emploie à l’exécuter.
L’Américain cessa de plaisanter son compagnon et reprit, avec une sincérité d’apparence.
– Oui, mon cher Gisber, je vous sais fidèle et dévoué, tenace en vos résolutions, « homme de main », pour tout dire, selon l’expression des anciens. Et, c’est parce que je me plais à reconnaître en vous ces qualités, que je n’hésite pas plus longtemps à vous faire connaître le résultat de mes propres méditations.
– Trêve de compliments, Ulphy. Vous y mêlez trop de vinaigre. Venez au fait.
Ulphilas Pitch s’expliqua alors.
Ces deux hommes qu’un instinct de prudence, servi par la concordance des faits, avait fait reconnaître comme deux coquins par les habitants de Dogherty, étaient, en effet, les pires bandits qu’il fût possible de s’imaginer. Dans combien d’actions criminelles avaient-ils déjà trempé, il eût été peut-être très difficile de le dire. Présentement ils mûrissaient entre eux un odieux complot, celui de faire disparaître par tous les moyens l’adorable jeune fille héritière de la colossale fortune d’Yves Kerlo, son père selon le sang, et, probablement aussi, légataire universelle des biens de Jean Wagha-na, son père adoptif.
Il va sans dire qu’en cette affaire les deux misérables n’agissaient point pour leur compte, mais pour celui d’un tiers, le personnage intéressé à la disparition de Madeleine, un certain Léopold Sourbin, cousin de l’orpheline, neveu d’Yves Kerlo et, par conséquent, seul héritier, après elle, de l’opulence qu’elle possédait.
Ce Léopold Sourbin avait-il été vraiment le meurtrier de son oncle ? Le crime remontait déjà très haut, à une époque où lui-même n’avait guère plus de dix-huit ans. À cette date, Sourbin avait son père encore vivant, marié à une sœur de Kerlo, et, à maintes reprises, le Breton, par tendresse pour sa sœur, la plus malheureuse des épouses et des mères, avait secouru de ses deniers, en lui assurant mieux que de l’aisance, son indigne beau-frère.
Mais ce Sourbin était un homme d’une perversité raffinée. Tant que sa femme avait vécu, il avait ménagé les susceptibilités d’Yves Kerlo, sachant bien qu’il le tenait par là. À la mort de la pauvre créature, il avait essayé d’apitoyer le Breton sur le sort de son neveu Léopold, enfant de dix ans à peine. Yves, qui connaissait le père et ne lui pardonnait point les tortures qu’il avait infligées à sa femme, lui avait répondu en constituant une rente de dix mille francs payable au jeune homme lorsqu’il aurait atteint sa majorité. En même temps, il avait rompu toutes relations avec son beau-frère et s’était lui-même marié.
Demeuré veuf après un an de mariage, il avait voulu se consacrer à l’éducation de sa fille. Le coup de feu qui l’avait frappé n’avait point été si prompt qu’il l’eût empêché de reconnaître son meurtrier. C’était alors qu’il avait institué Wagha-na son légataire en lui confiant la petite Madeleine.
L’Indien avait fidèlement, pieusement rempli son mandat.
Mais, avec un implacable sentiment de la justice, dernière survivance en lui des instincts sauvages de sa race, le Biron Noir avait cherché à atteindre l’assassin. Traqué comme une bête fauve, devinant la poursuite acharnée du Pawnie, frustré, d’ailleurs, dans ses espérances, Sourbin n’avait éprouvé aucun désir de faire casser en justice le testament de son parent. Il soupçonnait, d’ailleurs, que Wagha-na devait avoir quelque moyen en réserve, et, plus que tout le reste, il redoutait de la part de son adversaire soit quelque accusation capitale devant les juges, soit, ce qui était vraisemblable, un coup de hache ou de poignard à l’heure où il s’y attendrait le moins.
Il avait donc quitté l’Amérique, avec le remords d’un meurtre inutile et l’appréhension d’une vengeance désormais acharnée à sa perte.
Cette crainte et ce remords avaient-ils abrégé ses jours ? Peut-être ? Il n’avait guère survécu que sept ans à sa victime, et avait eu, pour dernier châtiment en ce monde, l’ingratitude filiale. Léopold, en effet, n’avait pas plutôt été maître des deux cent cinquante mille francs laissés par son oncle, qu’il s’était empressé de refuser tout subside à son père, et le misérable assassin avait fini par expirer dans le fossé des fortifications de Paris, une nuit d’hiver, sans que le médecin, qui examina le cadavre et conclut à une congestion cérébrale, pût affirmer que cette congestion était due au froid plutôt qu’à l’alcool.
« Tel père, tel fils, » – dit le proverbe. En cette circonstance, le père valait encore mieux que le fils, ainsi que l’événement devait le prouver. Ce dernier, en effet, débutait par une façon de parricide. Aussi criminel que le brillant auteur de ses jours, Léopold Sourbin l’emportait sur lui en prudence, en dissimulation.
Les deux cent mille francs de son capital ne furent point dissipés en prodigalités.
Non. Ce modèle des fils était, en même temps, le plus sagace des coupe-jarrets. Il avait étudié le droit au point de vue des félonies qu’un habile homme peut commettre en ayant soin de prendre la loi pour complice, – et le commerce avec l’esprit de recherche tourné vers les innovations générales dans l’art de la fraude.
Aussi, en huit ans, était-il parvenu à quintupler son capital.
D’aucuns trouveront que Léopold Sourbin aurait pu se tenir pour satisfait. Un million, aussi rapidement que frauduleusement gagné, est un denier dont le plus grand nombre des hommes s’estiment contents.
Tel n’était point le sentiment du cousin de Madeleine Kerlo.
Avec un million, il se jugeait pauvre, d’autant que, pour stimuler ses convoitises, revenait sans cesse à son esprit la pensée de l’immense héritage de son oncle passé aux mains d’un étranger, et cela depuis de longues années.
Toute sa cupidité en souffrait, et il était mûr pour le crime à commettre, à la condition, cependant, que ce crime pût être fructueux. Or, jusqu’au milieu de sa trente-quatrième année, Léopold, qui avait négligé de se renseigner auprès de son père, avait ignoré l’existence possible, probable même, de sa cousine.
Un voyage qu’il fit en Amérique le mit en rapports avec le nommé Pitch, une espèce de sollicitor, ou plus exactement, d’agent d’affaires véreux, qui, tout de suite, flaira une piste à suivre. Il se rendit à Québec et à Montréal, prit ses informations, s’enquit minutieusement et revint avec la preuve, non seulement de l’existence de Madeleine Kerlo, mais aussi de l’énorme fortune dont elle était héritière.
Tout de suite, il mit Léopold Sourbin au courant de la situation, et un plan à double fin fut ourdi par eux.
La meilleure, mais non la plus facile des solutions, était celle d’un mariage possible entre le Français et sa cousine.
Les deux complices étudièrent cette combinaison. Elle ne leur parut point chimérique au premier abord. Mais comme Léopold ne tenait aucunement à se montrer avant l’heure, ne voulant paraître que pour cueillir le fruit à point nommé, il laissa à son bon ami et compère Ulphilas le soin de diriger cette délicate entreprise.
De son côté, Pitch, ne se fiant pas outre mesure au succès éventuel d’une tentative à laquelle la personnalité de son client n’apportait que de médiocres chances, résolut de préparer en même temps la seconde ressource, celle-là plus sûre à son avis, puisqu’on n’a jamais besoin du consentement d’un individu pour le supprimer.
Ce fut dans ce but qu’il s’adjoignit pour bras droit l’Allemand Gisber Schulmann, homme de sac et de corde, celui-là, prêt à tous les mauvais coups, pourvu qu’il y trouvât une occasion de gagner de l’argent.
Or l’occasion se présentait, cette fois, souverainement tentante pour des coquins.
À leur tour, ils s’étaient rapidement concertés et, pour première décision, s’étaient résolus à porter le siège de leurs opérations au cœur même du territoire ennemi.
Ils venaient d’en être expulsés d’une manière tout à fait humiliante, et la rage qui bouillonnait dans l’âme ulcérée de Schulmann l’emportait déjà aux pires résolutions. Mais Pitch, beaucoup plus calme par tempérament, instruit par de nombreuses et cruelles expériences, avait cette philosophie spéciale qui consiste à savoir accepter l’inévitable. Il se disait qu’on ne violente pas la fortune et que toute l’habileté du sage réside dans la clairvoyance avec laquelle il doit regarder venir la fantasque déité sur la roue perpétuellement en mouvement.
Il ne se décourageait donc jamais, et, battu sur un point, portait immédiatement sur un autre l’effort de son intelligence jamais lassée, sans cesse en éveil. Et, ce faisant, il mettait en pratique l’aphorisme de son illustre compatriote Benjamin Franklin.
– « Patience et persévérance sont le secret de bien des fortunes. »
Il n’insista donc pas fort longtemps sur le chapitre des reproches à adresser à son brutal compagnon. Et comme celui-ci le pressait de questions au sujet du nouveau parti qu’il comptait prendre, Ulphilas répondit :
– Pour le moment, nous n’avons point autre chose à faire que de redescendre jusqu’à Montréal afin d’y cueillir quelques renseignements qui me sont encore indispensables. Je verrai là-bas ce qu’il nous faudra faire.
Cette, parole ne renseignait guère Schulmann. Mais comme, malgré ses violences, il avait l’habitude de tenir son complice pour l’homme le mieux avisé de sa connaissance, il s’empressa d’accepter sans discussion cette manière d’injonction que formulait le Yankee.
Tous deux poussèrent donc leurs bêtes le long des rives du lac et, sans perdre de temps à échanger des réflexions nouvelles, prirent à franc étrier le chemin de l’est.
Le pays qu’ils parcouraient était déjà livré à l’exploitation et les défrichements le convertissaient rapidement en une plaine rase, en partie cultivée, en partie abandonnée à l’élevage. Des agglomérations de plus en plus nombreuses, de plus en plus pressées, révélaient l’approche rapide de la civilisation, de cette civilisation à la vapeur qui dégrade la face de la terre et qui inspirait à Wagha-na de si violentes imprécations.
Les deux voyageurs mirent toute une journée à sortir de la zone encore dépendante des concessions de Kerlo et de Wagha-na. Au delà c’étaient les terres déjà cédées par le gouvernement aux émigrants de l’intérieur ou de l’étranger. La nuit était déjà fort avancée lorsque Pitch et Schulmann arrêtèrent leurs bêtes à l’entrée d’une véritable ville, bâtie en pierres et en briques plus encore qu’en bois, avec des rues rectilignes, des angles droits, des becs de gaz et même, çà et là, des lampes électriques.
Ainsi marche le progrès au Nouveau-Monde. Il n’y a pas d’étapes entre la sauvagerie et les raffinements de la civilisation.
La maison devant laquelle ils mirent pied à terre était un hôtel pourvu de tout le confortable que les Anglais seuls savent comprendre et organiser. Les deux voyageurs n’eurent donc qu’à jeter les brides de leurs chevaux aux valets d’écurie empressés à leur rencontre, et à se laisser conduire jusqu’au dining-room, lisez salle à manger, du caravansérail.
Une chose cependant leur fit faire la grimace au moment où l’hôtesse vint les saluer.
Mlle Jacquemart était Française, en effet. C’était une belle et fraîche Normande que son mari, un Canadien d’Ottawa, était allé chercher dans le pays de Caux et avait emmenée dans le Manitoba pour y ouvrir avec lui l’hôtel, florissant dès ses premières heures, du Bon Roi Henri.
Mais ils n’eurent pas le loisir de laisser voir leur contrariété en quittant la maison. Un homme qu’ils n’avaient point remarqué et qui, depuis leur entrée, les dévisageait d’un coin plus obscur du réfectoire, se leva brusquement et, les mains tendues, la face hilare, vint à leur rencontre en s’écriant :
– Ah ! mon cher Pitch, je ne m’attendais guère à vous voir aujourd’hui !
Ulphilas dissimula une seconde grimace. Le personnage s’était, lui aussi, exprimé en langue française.
Mais ce n’était point là le motif de la contrariété éprouvée par l’agent d’affaires. Cette contrariété avait une cause bien autrement grave. Elle venait de ce fait que dans l’hôte nouveau du Bon Roi Henri le Yankee venait de reconnaître Léopold Sourbin, le cousin de Madeleine Kerlo, celui pour le compte duquel il travaillait avec le secret espoir de travailler plus encore pour lui-même.
Elle était fâcheuse, cette rencontre. Elle se produisait trop tôt.
Aussi maître qu’il fût de lui, l’Américain n’en laissa pas moins percer son dépit. Toutefois, afin de se donner une meilleure contenance en face de son client, il lui présenta le nommé Gisber Schulmann que Sourbin ne connaissait pas encore.
Le Français n’avait pas été sans s’apercevoir du mécontentement de son mandataire. Il n’en tint pas compte, bien qu’une telle découverte eût fait naître en lui des soupçons. Mais pressé de savoir, il questionna Pitch avec insistance.
– Eh bien ! mon digne ami, comment vont nos affaires ?
Ulphilas ne crut pas devoir dissimuler. De quel profit lui aurait-il été de taire ce que l’autre ne tarderait point à apprendre ?
Il répondit donc, accentuant de ses sourcils froncés et de sa mine revêche les mauvaises nouvelles de sa parole :
– Mal, cher Monsieur, très mal.
Sourbin s’alarma. Mais chez ce malandrin retors il y avait du Gascon, prompt à se l’assurer lui-même. Il se dit que, très certainement, Pitch exagérait. En quoi les « affaires » pouvaient-elles « aller mal », puisque, jusqu’à ce moment, on n’avait, pour ainsi dire, rien entrepris de sérieux ?
Il se fit expliquer les paroles de l’ancien solliciter ; et quand celui-ci lui eut raconté tout au long l’histoire de leur échec dans la station de Dogherty, le Français se sentit complètement rassuré.
– N’est-ce que cela, mon cher monsieur Pitch ? fit-il. C’est un bien petit malheur. Allons, je vois que j’ai bien fait de ne point attendre une lettre de vous pour revenir. Je puis encore réparer ce qu’il y a de compromis.
Et, en effet, Léopold Sourbin ne s’alarmait aucunement. Même, il n’était pas éloigné de se réjouir de l’échec subi par ses associés en félonie. Cela liquidait la situation et lui permettait de se débarrasser d’acolytes maladroits et gênants.
Mais cette bonne pensée n’eût certainement pas fait le compte des deux flibustiers qu’il s’était adjoints et qui n’entendaient point se laisser remercier de la sorte sans toucher leurs gages et, surtout, sans palper la part de dividendes qu’ils espéraient de « l’affaire ». Aussi, Pitch, le dîner fini, envoya-t-il l’épais Gisber se coucher et, demeuré seul en face du cousin de Madeleine, lui tint-il ce discours aussi laconique que significatif.
– My good fellow, il est convenu que, quelle que soit l’issue de notre entreprise, nous la poursuivons en commun, et que ma part dans les bénéfices sera de trente-trois pour cent. Je ne vous rappelle ces choses que pour le cas, d’ailleurs invraisemblable, où vous auriez eu à souffrir de quelque trouble de la mémoire.
IV
MONSIEUR SOURBIN
Le cousin de Madeleine Kerlo fut un instant décontenancé.
Était-il donc sorcier, ce misérable Américain, pour avoir lu si clairement dans sa pensée ?
Car c’était là la chose la plus surprenante qu’il eût formulé avec une netteté mathématique les conditions du contrat passé entre lui et son complice, au moment précis où ce dernier songeait au moyen qu’il pourrait prendre pour se délivrer d’une collaboration gênante, sinon nuisible.
Une telle clairvoyance de la part de son complice n’était pas pour rassurer le Français. À son tour, il comprit qu’il fallait rivaliser de dissimulation. Aussi s’empressa-t-il de rassurer Pitch le mieux qu’il put et lui renouvela-t-il l’assurance de sa bonne foi.
Après quoi il se fit raconter par le menu les incidents de la démarche des deux coquins auprès du Conseil de Dogherty, de leur échec ignominieux et des soupçons que, bien certainement, leur attitude avait dû inspirer.
Allons, allons ! pensa-t-il, il n’est que temps de réparer toutes ces bévues et de devenir, le plus tôt possible, le mari de ma charmante cousine.
Alors, changeant de ton, il feignit un vif mécontentement, reprocha au Yankee sa maladresse en termes fort amers et lui déclara tout net qu’avant de suspecter sa bonne foi à l’endroit des engagements pris, il eût mieux fait de baser ses réclamations sur des services rendus.
– J’entends agir désormais à ma guise, – fit-il ; – et, si je réussis à obtenir la main de miss Madge, soyez assuré que vous n’aurez pas à me rappeler l’exécution de mes promesses.
C’était peu dire, et Ulphilas avait tout lieu d’être mécontent en voyant ses affaires prendre une semblable tournure. Mais il n’avait pas le droit de se plaindre. Force lui fut donc de dévorer son ressentiment, mais sans abdiquer la prétention qu’il avait de terminer l’entreprise à son avantage.
Un double danger menaçait donc maintenant la douce Madeleine. Son indigne cousin allait chercher à s’emparer de sa fortune au moyen d’un mariage, tandis que les deux scélérats, écartés par la méfiance de leur associé, s’efforceraient de contraindre celui-ci par un crime abominable.
Le plus sûr, le plus rapide moyen de réaliser des bénéfices était, pour eux, de faire tomber la succession de Jean Kerlo aux mains de son neveu Léopold Sourbin. Par là même, Ulphilas Pitch et Gisber Schulmann avaient condamné à mort la fille adoptive de Wagha-na.
Il y a, par bonheur, d’invisibles Providences qui veillent sur les jours de chaque homme. Une heureuse chance avait conduit les trois misérables à l’hôtel du Bon Roi Henri, dont les patrons, M. et Mme Jacquemart, comptaient parmi les plus fidèles amis de l’Indien et de ses compagnons.
Mme Jacquemart surtout était une fine commère qui n’était pas pour rien du pays de la pomme et des hautes coiffes de dentelles. Son œil perçant, habitué à lire sur les visages, avait tout de suite scruté les physionomies de ses trois nouveaux hôtes, et à peine avait-elle pu échanger quelques réflexions avec son mari, qu’elle s’était empressée de lui dire avec cet accent qui porte tout de suite la conviction au plus intime de la conscience :
– Pour lors, Pierre, mon ami, m’est avis que ces gens-là, ça n’est pas des paroissiens bien recommandables. Je gagerais même qu’ils ne sont ici que pour préparer un mauvais coup.
Et Pierre de répondre avec ce même accent du Cotentin et de la vallée d’Auge qu’un siècle écoulé n’a point fait perdre aux Canadiens séparés de la mère-patrie :
– Tout de même, femme, que tu pourrais bien avoir raison. Faudra les tenir à l’œil.
Le lendemain de ce jour, Pitch et Schulmann, masquant leur jeu et, d’ailleurs, résolus à mener leur campagne en dehors de Sourbin quittèrent l’hôtel pour reprendre la ligne de Montréal.
Ils avaient laissé de faux noms à l’hôtel.
Sourbin n’avait pas cru devoir taire le sien.
Dès qu’il se vit seul, son visage revêtit un aspect hilare. Il s’enquit auprès de ses hôtes de la situation de Wagha-na, du succès de ses entreprises, demanda quelle était cette « Madeleine Jean » qui passait pour la fille adoptive du Bison Noir, et laissa voir une curiosité si étrange que le ménage Jacquemart en conçut des soupçons plus vifs encore. Dès qu’ils se retrouvèrent seuls, le mari et la femme décidèrent de prévenir l’Indien et les amis, afin que, si, comme tout le faisait craindre, quelque odieux complot s’ourdissait contre eux, ils pussent, du moins, se tenir sur leurs gardes.
– En conséquence, Pierre s’empressa de se rendre au désir de Léopold Sourbin qui désirait être mis au plus tôt en rapports avec Wagha-na. Il s’offrit même à lui servir de guide auprès du chef Pawnie. Mais, en même temps, il appelait à lui l’un de ses garçons, homme de confiance, dont le dévouement envers l’Indien égalait celui de ses patrons et, lui remettant une lettre pour le père adoptif de Madeleine, lui donnait la mission suivante :
– Tu vas prendre le meilleur cheval de l’écurie. Tu partiras dès l’aube, à franc étrier pour Dogherty. Quand tu auras rejoint Wagha-na, tu lui donneras cette lettre. Si, par hasard, il était parti pour quelque autre station, tu confierais la lettre à Cheen-buck ou à Joë, en leur recommandant de l’envoyer le plus tôt possible au chef. Il y a urgence.
Cette mission, Pierre Jacquemart le savait, allait être fidèlement remplie.
Le lendemain de ce jour, dès que l’émissaire eut pris une avance assez considérable pour pouvoir avertir à temps le chef indien, Pierre Jacquemart, à son tour, accompagné de Léopold Sourbin, s’élança sur le chemin de la station de Dogherty.
Ni Wagha-na, ni Madeleine n’avaient encore quitté la ville naissante.
L’Indien reçut courtoisement le nouveau venu. Il le présenta à Madeleine en termes polis, mais sans aucune note de bienveillance. La conversation fut banale et l’on ne précisa aucun détail.
Si bien que le Français s’alarma de cette réserve. Il voulut, sur-le-champ, en avoir le cœur net.
Il demanda donc au Bison Noir un entretien particulier. Comme Wagha-na n’avait aucune raison de lui refuser cet entretien, il le lui accorda sur l’heure. Laissant donc Madeleine et Georges Vernant à la station, l’Indien offrit à son visiteur une promenade sur le lac. Ils y pourraient mieux converser, à l’abri d’oreilles indiscrètes, car il était facile de prévoir que le débat allait être grave.
Lorsque les deux hommes se furent assis dans une élégante baleinière, l’Indien au gouvernail et tenant l’écoute de la voile, le dialogue s’engagea sur le ton de la plus parfaite urbanité.
– Je vous écoute, Monsieur, commença Jean.
– Monsieur Wagha-na, répondit Sourbin, qu’intimidaient l’affabilité, la distinction et l’aisance de manières de son interlocuteur, j’éprouve quelque embarras à aborder le sujet.
– N’en ayez aucun, répliqua galamment l’Indien, je suis homme à tout entendre.
Alors le neveu de Kerlo s’expliqua :
– Monsieur, tout à l’heure, au moment où j’ai abordé pour la première fois mademoiselle Madeleine Kerlo, j’ai éprouvé une réelle surprise de ne point m’entendre présenter à elle sous le titre qui m’eût assuré de sa part le meilleur accueil, j’ose le croire.
Wagha-na joua la surprise avec une étonnante perfection.
– Et, ce titre, Monsieur, quel est-il, s’il vous plaît ?
Ce fut au tour de Sourbin de s’étonner.
– Mais… celui de cousin, Monsieur. Je suppose, en effet, Monsieur, que vous n’ignorez point ma parenté avec mademoiselle Madeleine Kerlo ?
L’Indien répliqua avec une imperturbable bonhomie.
– Je n’étais pas tenu de le savoir, Monsieur. Les Sourbin ne doivent pas manquer dans le monde, j’imagine, et, en dépit de votre nom, vous ne portez point, écrits sur votre visage, les signes de votre parenté.
– Elle n’est pourtant pas douteuse, Monsieur, je vous prie de le croire, fit Léopold sur un ton aigre-doux.
Cette fois l’Indien garda un assez long silence. Puis, changeant de ton et d’attitude, il regarda son interlocuteur bien en face.
– Monsieur Sourbin, dit-il froidement, vous venez d’invoquer un titre qui ne peut guère vous servir. Je dois vous en prévenir tout de suite, afin que vous sachiez en faire votre profit. Nous ne sommes point en France, Monsieur. Madeleine Kerlo se nomme Madeleine Jean auprès de tous ceux qui l’ont connue. Elle est héritière de grands biens, mais non comme vous pourriez le croire. La fortune de mon ami Kerlo est revenue tout entière entre mes mains, en vertu d’un acte régulier, et c’est ma propre succession qui assurera la fortune de ma fille adoptive.
– Ah ! proféra Léopold Sourbin, d’un accent qui traduisit son dépit.
– Et, continua Wagha-na sans se déconcerter, je ne suis point encore à la limite de l’âge et je n’entends point me laisser mourir sans opposer une vigoureuse résistance aux années et aux décrépitudes qu’elles apportent avec elles.
C’était un maître-diplomate, ce Bison Noir. Il n’avait parlé de la sorte que pour mettre à couvert les espérances de sa pupille et défendre sa vie contre les attentats éventuels qu’il devinait dans l’ombre. On avait assassiné le père, on pouvait aussi bien assassiner l’enfant. Il fallait que ce crime, par son inutilité même, devînt impossible. Avant de frapper Madeleine, il faudrait frapper l’Indien, et celui-ci n’était pas homme, il venait de le dire, à se laisser tuer sans se défendre.
Léopold Sourbin éprouva pendant quelques minutes une humiliante confusion.
Le peu que venait de lui dire l’Indien lui prouvait qu’il était deviné. Le regard aigu de cet homme de bronze, aux prunelles claires et sagaces comme celles d’un oiseau de proie, avait pénétré en lui, disséquant sa pensée. Il ne pouvait rien celer à la clairvoyance du Pawnie. Et, cependant, jouant le tout pour le tout, il essaya de violenter la situation :
– Monsieur, reprit-il, vous venez de me dire que j’avais eu tort d’invoquer le lien de parenté qui m’unit à mademoiselle Kerlo. Laissez-moi m’étonner qu’un homme de votre valeur puisse faire cas de préjugés dignes d’un autre âge, qui font le fils responsable des erreurs du père. Le mien a, en effet, pâti d’un mauvais renom, pire que la vérité. S’il a eu des torts envers quelqu’un, ce ne peut être qu’envers moi. Je les ai oubliés. Il est mort.
– Ah ! – fit à son tour Wagha-na, qui ignorait la fin malheureuse du père de Léopold.
– Oui, continua celui-ci. Mon père est mort, et si j’ai fait le voyage d’Amérique, c’est…
Il hésita. Le reste du discours ne lui venait pas aisément. De plus, le regard du Bison Noir le gênait.
– C’est, poursuivit-il, s’enhardissant, parce que j’ai voulu effacer jusqu’à la trace des dissentiments du passé, dont j’ai toujours ignoré, d’ailleurs, la nature et la cause, et mettre au service de ma cousine, avec la plus tendre affection, le dévouement le plus désintéressé.
Un sourire passablement ironique glissa sur les lèvres de Wagha-na.
– Monsieur, répondit-il, je vous sais un gré infini de cette affection spontanée pour votre cousine, affection d’autant plus méritoire que vous ne connaissiez point Madeleine et que vous l’avez vue hier pour la première fois. Mais permettez-moi de vous dire qu’en ces matières, je laisse à ma pupille toute sa liberté, et que d’elle seule dépendra le succès de la candidature que vous comptez poser auprès de son cœur. Dès à présent, toutefois, et sans vouloir vous décourager, je dois vous prévenir que la fille de Jean Kerlo est d’un goût difficile, d’un jugement très sûr, d’une sagacité très rare. Elle a l’énergie d’un homme et la pénétration d’un policier.
Léopold Sourbin se mordit les lèvres. Cet encouragement de l’Indien n’était rien moins qu’encourageant.
Il eut le tort de vouloir demander davantage.
– Mais, vous-même, Monsieur Wagha-na, vous aurai-je pour allié ou pour ennemi en ces circonstances ?
Ni l’un, ni l’autre, Monsieur, répliqua l’Indien. Je n’ai pas l’habitude de préjuger de questions aussi délicates. Je ne demande pas mieux que de vous croire digne de votre cousine, bien que, dès à présent, vous ayez à lutter dans mon esprit contre certains souvenirs, certaines préventions de l’ordre le plus grave, mais dont je ne vous parlerai que si le besoin s’en impose. Faites-vous donc agréer par Madeleine, et il est probable que vous n’aurez aucun obstacle à craindre de ma part.
Ces paroles n’étaient pas pour rassurer l’aigrefin.
Le Bison Noir, parlant ainsi, ramenait la barque vers le rivage. Il était manifeste que cet entretien ne se prolongerait point et que l’Indien n’entendait pas se laisser interroger davantage.
– Allons ! se dit Léopold, il me faut m’aider moi-même, si je veux que le proverbe s’accomplisse.
Tout au fond de lui-même, sa conscience lui disait bien que la besogne qu’il allait entreprendre n’était point de celles auxquelles « le Ciel » accorde sa protection.
Il ne devait donc compter que sur lui-même et les circonstances favorables.
Une chose l’avait tout de suite alarmé. Il avait pris ombrage de la présence à Dogherty de Georges Vernant. Ce jeune homme à l’œil ouvert, au visage fier et loyal, pouvait être un rival redoutable, et il était visible que Wagha-na le protégeait. De plus, le reste de la colonie lui était ouvertement sympathique.
Il fallait donc évincer ce concurrent dangereux et, pour ce faire, conquérir les bonnes grâces des amis de l’Indien, collaborateurs et associés de l’œuvre spécialement philanthropique que celui-ci avait commencée.
Pour obtenir ce résultat, le Français se mit à étudier les goûts et les préférences des acolytes de Wagha-na.
Il se rapprocha d’abord de Joë O’Connor.
Le vieil Irlandais avait un faible prononcé pour le tabac d’Europe, et plus spécialement pour le tabac français. Il se trouvait que Léopold Sourbin en avait, à tous risques, emporté une bonne provision. Il le mit très volontiers à la disposition du vieux trappeur, qui put, de la sorte, fumer quelques bonnes pipes.
C’était procéder tout à fait à la manière indienne, en allumant le « calumet de paix ».
Mais, le lendemain même de ce jour, Léopold éprouva une surprise.
Pis qu’une surprise, car l’incident lui parut caractéristique d’une véritable méfiance.
En effet, l’Irlandais vint à lui, le visage changé, et lui dit sans préambule :
– Monsieur Sourbin, avez-vous encore beaucoup de tabac comme celui que vous m’avez donné hier ?
– Mais certainement, cher Monsieur, répliqua le cousin de Madeleine, et toujours à votre disposition.
Mais Joë ne l’entendait point de cette manière. Il tira de sa poche une large bourse en peau de renard, de laquelle il fit sortir quelques pièces d’argent.
– Eh ! que voulez-vous faire ? réclama Sourbin. Je n’entends pas être payé.
– Et moi, j’entends, au contraire, que vous le soyez, même pour celui que je vous ai pris hier. Sinon, je ne vous en prendrai plus. Nous ne sommes pas d’assez vieux amis pour que je me permette d’accepter ainsi de vous, sans façons, un cadeau de cette importance. Nous sommes en Amérique, Monsieur, et, en Amérique, tout se paye.
– Comme vous voudrez, cher Monsieur, riposta Léopold, qui souriait de travers, bien que j’eusse préféré vous voir accepter de bon cœur ce que je vous ai offert de bon cœur.
– Hum ! pensa-t-il, voilà un homme retourné. Le maudit Peau-rouge est passé par là.
Il se rabattit sur Cheen-buck.
Mais, de ce côté, il n’y avait rien à attendre. L’Indien, par ses origines autant que par son caractère, tenait de trop près à Wagha-na. Les avances de Sourbin furent donc en pure perte.
L’aventurier fut bientôt à même d’apprécier le sentiment public à l’égard des étrangers en général et de lui-même en particulier. Le soir de ce jour, le second qu’il passait à la station, après le dîner, et comme les hommes fumaient en commun sur la vérandah élevée en face de la maison, Wagha-na mit sur le tapis le passage d’Ulphilas Pitch et de Gisber Schulmann. Les divers convives du chef firent des gorges chaudes à ce propos, et les défauts des deux vilains personnages furent vigoureusement critiqués.
Au moment où les noms du Yankee et de son compagnon furent prononcés, Sourbin laissa échapper une exclamation.
Les yeux pénétrants du Bison Noir ne l’avaient pas quitté. Le chef indien demanda :
– Est-ce que vous connaissez ces deux hommes, monsieur Sourbin ?
Léopold comprit qu’une dénégation serait non seulement inutile, mais dangereuse, qu’au lieu de les dissiper, elle ne ferait que corroborer les soupçons. Il paya donc d’audace et répondit d’un ton dégagé :
– Assurément, je les connais. Je viens de les retrouver à l’hôtel du Bon Roi Henry. Mais j’avais déjà fait leur connaissance à New-York. En vérité, je n’aurais jamais cru que ce fussent des gens aussi suspects que vous le dites.
Madeleine intervint de sa douce voix.
– Très sincèrement, nous devons reconnaître que nous les avons surtout jugés sur leurs mines, qui ne sont pas attirantes. Pour moi, j’ai été outrée de l’insolence de ce Germain à l’égard de mon père. C’était fort imprudent de la part de gens qui voulaient se concilier la bienveillance.
– C’était surtout une preuve de grossièreté évidente, fit remarquer Georges Vernant.
La jeune fille sourit, et, toujours bonne en ses appréciations, ajouta :
– Sans doute, mais ce n’est pas une raison pour en faire des coquins. En français, il y a loin des mots « homme malhonnête » aux mots « malhonnête homme ».
Cette ingénieuse réflexion de Madeleine, coupa court à l’entretien sur ce sujet gênant pour Léopold. Mais la conversation lui avait permis de s’assurer qu’il était au milieu de gens observateurs et prudents. À la réflexion, il reconnut que Wagha-na n’avait prononcé les noms des deux misérables, qu’afin de savoir s’ils étaient en relations suivies avec son hôte. Maintenant l’épreuve était faite, le père adoptif de Madge était renseigné.
Aussi, en récapitulant les événements de ces deux jours, Sourbin dut-il s’avouer qu’il n’avait pas fait preuve d’une très grande habileté et que, pour confiant qu’il fût en sa propre supériorité, il avait agi en simple écolier en venant se remettre à la merci de ceux qu’il aurait à combattre.
Dès lors les idées les plus perverses hantèrent son cerveau.
Peu s’en fallut qu’il ne revînt au plan primitif de Pitch et ne s’arrêtât aux pires résolutions. L’instinct paternel, l’atavisme du crime, se réveilla en lui. Il se mit à chercher une combinaison qui lui permît de conquérir, sinon la main, du moins la fortune de sa cousine. Il ne recula plus devant l’hypothèse d’un attentat.
L’occasion allait, d’ailleurs, lui en être offerte. À lui d’être assez adroit pour ne point la laisser échapper.
– Monsieur Sourbin, lui demanda Madeleine, qui n’avait fait encore aucune allusion à leurs liens de parenté, allez-vous être des nôtres pendant notre grande excursion dans l’ouest ?
– Ah ! questionna-t-il au lieu de répondre, et de quel côté allez-vous diriger votre course ?
– C’est juste, fit-elle, vous n’êtes, point au courant. Sachez donc que nous entreprenons en automne une expédition dans les régions du lac de l’Esclave. C’est le moment du passage des bœufs sauvages qui descendent du Nord.
– Ce doit être intéressant, et je ne demande pas mieux que d’y assister.
– En ce cas, vous partirez avec nous demain. Les chemins de fer sont encore à créer dans cette partie de notre continent, bien que le Canada soit à la veille de construire une grande ligne, rivale de celle des États-Unis, et allant du Saint-Laurent jusqu’à Vancouver.
Léopold n’avait pas beaucoup d’apprêts à faire. Wagha-na mettait toutes choses à sa disposition : armes, chevaux, vivres et couvert. Il eut moins de scrupules à accepter les générosités de son hôte que n’en avait montrés Joë O’Connor à lui prendre son tabac.
– Décidément, se dit-il, l’hospitalité de ces sauvages est aussi large que leur territoire, aussi vaste que leurs horizons. J’aurais grand tort de n’en point profiter. D’autant plus que, si je deviens le mari de Madeleine, c’est de mon propre bien que je me serai servi.
Sur cette réflexion dégagée de toute gratitude, le Français alla dormir d’un sommeil qui se prolongea fort avant dans la matinée. Quand il se leva, tout le monde était prêt à partir : on n’attendait que lui.
Les voyageurs se mirent tout aussitôt en route. Wagha-na et Georges Vernant avaient repris leurs chevaux du premier parcours : Hips et Gola. Joë O’Connor et Cheen-buck venaient ensuite, escortant Madeleine à la tête d’une douzaine de blancs, de métis et d’Indiens de la station. Une trentaine d’autres chevaux, entièrement libres, suivaient docilement la petite troupe, trottant et galopant à ses côtés.
– Ce sont nos montures de rechange, dit Madeleine à son cousin, dont elle avait remarqué l’étonnement. Quand les nôtres seront fatigués de nous porter, nous ne ferons que passer leurs harnais à d’autres. Ce n’est pas plus difficile que cela.
V
LA CHASSE AUX BISONS
C’était un pittoresque voyage, que celui de la caravane. À mesure qu’elle s’avançait dans les plaines du nord-ouest, les forêts s’éclaircissaient peu à peu, et la succession même des essences, par leur gradation régulière, annonçait la disparition progressive des grandes végétations, cédant la place aux arbustes qui peuvent seuls soutenir la rigueur des hivers. Aux chênes et aux peupliers succédaient les trembles et les bouleaux, puis à ceux-ci les sapins, les séquoias, les pins maritimes, les cyprès.
Enfin, on atteignit des zones dénudées, où, l’hiver, l’aquilon devait se donner carrière. C’étaient d’immenses espaces, à peine coupés, çà et là, par des bouquets de sapins, des haies naturelles de genévriers, et de houx, de genêts presque arborescents. De loin en loin, on voyait, au travers des herbes encore hautes et qui ondulaient à la manière des flots, scintiller une nappe d’argent, et alors Wagha-na, qui conduisait la colonne, ou Madeleine, flanquée de ses gardes du corps, expliquaient à Georges Vernant ou à Léopold Sourbin que c’étaient là des infiltrations des grands lacs ou l’étang passagèrement formé par la stagnation de quelque rivière destinée, au printemps suivant, à grossir les grands cours d’eau tels que les deux branches de la Saskatchewan.
La prairie devenait bien telle qu’il le fallait pour ces grandes chasses. L’herbe, tantôt molle et veloutée, tantôt épineuse et tranchante, atteignait de telles proportions qu’il était nécessaire de s’y ouvrir parfois un chemin, la serpe ou la faux à la main, afin d’éviter les fondrières et les marécages qu’elles dissimulent.
Hommes et chevaux disparaissaient dans cette mer verdoyante et il fallait se tenir groupés pour ne point courir le risque de se perdre ou, ce qui eût été plus grave, de se laisser surprendre par les faunes de la prairie.
– Comment ? s’écria Léopold qui ne put s’empêcher de frissonner, à cette révélation, je m’étais laissé conter qu’à part les serpents à sonnettes, l’Amérique septentrionale n’avait plus d’animaux féroces.
– On vous avait trompé, cher, Monsieur, répliqua d’un ton passablement gouailleur Joë O’Connor, auquel le Français avait cru devoir communiquer cette réflexion. – Nous possédons encore quelques variétés de félins dangereux : le couguar, que, dans l’Amérique du Sud, on nomme puma, ou lion sans crinière, une espèce de panthère de taille inférieure à celle du jaguar, des loups redoutables en bandes, et, dans le voisinage des montagnes, tous les genres d’ours, et surtout le terrible grizzly.
Il ajouta : – Et, puisque vous parlez de serpents, sachez que le crotale est encore assez répandu dans nos régions. Il a pour compères plusieurs sortes de trigonocéphales, analogues à ceux de Panama, et de la Colombie, et même quelques pythons de belle venue. Je ne vous parle pas du serpent-fouet, que nous aurons l’occasion de rencontrer.
Ces explications, données d’une voix extrêmement calme, n’étaient pas faites pour mettre la confiance dans l’esprit de Sourbin. Il lui arriva de regretter de s’être embarqué en pareille aventure.
Il fut bientôt à même de joindre aux renseignements fournis par ses compagnons de route, les fruits de sa propre expérience, et ce dans des circonstances particulièrement émouvantes.
La colonne venait de sortir momentanément des grandes herbes et s’était engagée sur un sol pierreux que couvrait à peine un gazon rare. Sous les rayons obliques du soleil d’automne, cette plaine immense dégageait une chaleur énorme. Les chevaux, lassés, sentaient peser sur eux la fatigue de cette orageuse journée et s’en allaient, le cou pendant, sans que leurs cavaliers songeassent à activer leur allure.
Seul, le nommé Sourbin, peut-être afin de donner à ses compagnons une haute idée de ses moyens hippiques, tracassait sa monture, s’efforçant de l’entraîner à quelque longue course, de la faire caracoler.
Brusquement, l’animal, harassé, exaspéré, fut pris de colère. Il pointa ses oreilles, et partit à fond de train à travers la plaine, sans s’inquiéter autrement de Léopold qui, fou de terreur, bondissait de la croupe à l’encolure et qui, finalement, sans autre souci de sa dignité d’écuyer, avait lâché la bride pour se mieux accrocher, à la crinière du cheval.
Cet attachement du cavalier pour sa monture n’empêcha point la séparation violente et définitive. Un dernier écart du mustang désarçonna l’aventureux Sourbin et l’envoya fort rudement mesurer de toute sa longueur le sol rugueux et caillouteux sur lequel il venait de fournir cette course périlleuse.
Le malheureux demeura quelques instants sans connaissance. Puis il se releva, meurtri, courbé en deux, s’efforçant de regagner la caravane, de laquelle deux hommes s’étaient détachés à toute bride pour lui porter, secours.
Mais, hélas ! ce n’était là qu’une partie des épreuves de Léopold.
Il était exposé à un danger bien autrement redoutable.
Ce qui avait effrayé le cheval, l’arrêtant court au point de déterminer le choc inattendu qui avait fait vider les arçons au cousin de Madeleine, c’était la vue, à quelque deux cents mètres en avant de lui, d’un reptile de grande taille, long de trois mètres cinquante, au corps d’un gris rougeâtre, qui, ramassé sur lui-même, se balançait sur ses derniers anneaux, tel qu’un ressort tout prêt à se détendre.
C’était précisément un de ces serpents-fouets dont il venait d’être parlé, et dont Joë O’Connor avait annoncé la rencontre. Le terrible ophidien est compté parmi les plus venimeux de son ordre, et sa morsure tue un homme ou un cheval en moins de deux heures.
L’infortuné Sourbin avait eu pourtant cette chance de tomber à point nommé.
Car le reptile ne s’était levé que pour résister à une attaque. En effet, le serpent-fouet, qui emprunte son nom à la faculté redoutable, qu’il possède de bondir sur son adversaire, est, par bonheur, rarement agressif. Celui-ci avait vu venir le cheval emporté et, tout de suite, s’était mis en état de défense. Si bien que, la bête écartée et Léopold à terre, le serpent avait repris sa course à travers la prairie, sans songer aucunement à une mauvaise action.
Malheureusement pour lui, en cette occurrence, Léopold avait recouvré ses sens trop tôt.
Le fouet n’était plus qu’à une centaine de mètres du Français lorsque celui-ci, se relevant péniblement, essaya de battre en retraite vers ses compagnons de route.
Le reptile vit ce mouvement et s’en alarma. Il prit sur-le-champ l’offensive et se mit à ramper de toute sa vitesse vers son ennemi supposé. En quelques minutes, il eut réduit de moitié la distance qui le séparait de lui.
C’en était fait de Sourbin qui, né soupçonnant aucun danger, ne se hâtait guère de fuir. Comment l’aurait-il pu, d’ailleurs, après la violente commotion qui avait suivi, cette chute tout à fait inattendue ?
Déjà le hideux serpent dressait sa tête oblongue, aux yeux sanglants, placée, au bout d’un cou long et frêle, et poussait des sifflements de colère, lorsque ces sifflements mêmes et la forte odeur de musc qu’il répandait avertirent Léopold Sourbin du menaçant voisinage qu’il subissait.
Le cousin de Madeleine, pris d’une terreur irraisonnée, se mit à fuir aussi vite que le lui permirent ses jambes endolories et courbaturée. Malheureusement, il ne pouvait l’emporter sur son formidable adversaire qui, d’une seule détente de sa queue, bandée comme un arc, franchissait cinq ou six mètres.
Sourbin était donc perdu, et rien ne l’eût arraché au danger, si les deux cavaliers détachés de la colonne n’eussent gagné de vitesse. Déjà le reptile n’était plus qu’à dix pas de lui, lorsque l’un des hardis écuyers, enlevant sa bête d’un élan furieux, malgré ses résistances, passa comme en un vol entre le fuyard et le serpent. Son bras s’allongea armé du fouet à manche court qui sert aux cow-boys des prairies. La corde siffla, mordante et tranchante. Elle vint s’enrouler au cou du reptile, dont elle brisa net la colonne vertébrale.
Le monstre se tordit vainement, tandis que l’élan forcené du cheval traînait pendant quelque cent pas encore son corps détendu et flasque comme une courroie dépliée.
Alors Georges Vernant, car c’était lui, revint vers Sourbin et lui dit, en riant :
– Çà, mon cher compatriote, vous pouvez remercier Dieu ; vous l’avez échappé belle.
– Je vous dois aussi quelques remerciements à vous-même, répliqua Léopold, moins reconnaissant du service rendu que dépité du rire avec lequel l’avait abordé son sauveur. – Morbleu ! Quelle poigne et quelle adresse ! Tuer un serpent boa avec une ficelle. Ça ne se voit pas tous les jours, et, pour ma part…
– Peuh ! répondit Vernant, c’est un exercice qui nous est familier au Mexique, d’où je viens. Et puis, ce n’est point un boa, ce serpent, c’est un fouet. De plus, ma ficelle est une bonne arme, car c’est aussi un fouet. Si bien que nous avons un dicton qui énonce cette particularité. Nous disons : « Il faut combattre le fouet par le fouet ».
Tout en parlant, Georges avait mis pied à terre et, très complaisamment, mettait son cheval à la disposition de Léopold pour le ramener vers la caravane, lorsqu’ils virent revenir Cheen-buck, le second des deux cavaliers, ramenant par la bride la monture trop fringante qui avait si malencontreusement désarçonné son cavalier.
Sourbin se remit en selle tant bien que mal. Mais, en vérité, il n’avait pas brillante mine ainsi monté.
Personne cependant ne railla sa mésaventure. Il n’entendit guère que ce propos goguenard de Joë O’Connor :
– Eh bien ! Monsieur, quand je vous disais que nous ferions connaissance avec les bêtes de-la prairie ?
Ce fut la seule allusion faite à ce déplorable accident.
Aussi bien, ne marcha-t-on pas fort longtemps ce jour-là.
Wagha-na avait donné l’ordre de tout préparer pour le prochain campement.
Ce campement, il était là, tout dressé au milieu de la plaine, attendant les voyageurs derrière un bouquet de bouleaux et de sapins, le seul qu’on rencontrât dans un rayon de dix-huit milles. À peine l’eût-on dépassé, que les cavaliers se trouvèrent en face d’un véritable village de bois, à carcasse de fer, dont chaque maison était surélevée sur une façon de pilotis formée de colonnes de fer creuses, afin de les isoler d’un sol dont Sourbin avait pu apprécier par lui-même le désagréable contact.
À peine la colonne se fut-elle démasquée que, brusquement, toutes les demeures s’animèrent. Des hommes, des femmes, des enfants s’élancèrent hors des toits de ce village factice et vinrent, en courant, souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Madeleine expliqua à Georges, à Sourbin, l’origine de cet établissement.
C’était un titre de plus à la reconnaissance des Canadiens envers Wagha-na, un de ces nombreux bienfaits qu’il avait généreusement prodigués au pays tout entier.
Ce lieu était un ancien rendez-vous de chasse, autrefois désert et dépourvu de ressources. L’idée était venue au Bison Noir d’y établir une tribu de ses compatriotes, ne leur donnant, d’ailleurs, d’autre obligation que celle de tenir le campement toujours prêt pour les chasseurs qui venaient tous les ans, de grandes distances, poursuivre le bœuf sauvage ou le cerf wapiti dans ces solitudes. Il leur avait imposé le même devoir envers les trappeurs et les agents de la compagnie de la Baie d’Hudson, si souvent exposés, pendant les grands froids des hivers du Pôle, à mourir de misère et d’inanition dans ces régions désolées.
– C’est décidément un homme fort ingénieux que vôtre père d’adoption chère cousine, dit Léopold Sourbin.
– C’est surtout un grand homme de bien, riposta presque sévèrement la jeune fille.
Et, tournant sans façons le dos au déplaisant personnage, elle rejoignit au petit trot Wagha-na, déjà en conférence avec les habitants du village improvisé.
Tout était disposé. Les voyageurs n’avaient plus qu’à prendre possession de leurs appartements. Et ce fut une cause nouvelle d’émerveillement que de voir avec quel ordre, quelle admirable propreté était tenu ce caravansérail vraiment philanthropique.
Avant d’y descendre, le Bison Noir entraîna son jeune compagnon en un temps de galop sur le front du village.
Cent vingt-deux maisons, toutes construites sur le même modèle, s’alignaient en deux rues bordées de jardins potagers et coupées par deux places au centre desquelles deux puits savamment creusés donnaient une eau aussi salubre qu’abondante. Chaque maison pouvait recevoir cent quarante locataires faisant leur cuisine en commun.
Wagha-na ne put s’empêcher de rire devant la surprise, presque l’ahurissement de ses hôtes, quand il leur dit :
– Indépendamment de nous, qui occupons une maison spéciale, le village compte deux cents habitants qui y séjournent six mois, au bout desquels ils cèdent la place à de nouveaux occupants. Les deux cents actuels sont des Sioux, autrefois les ennemis nés des Pawnies. La religion et la pratique d’un bien-être égalitaire les ont amenés au point de douceur et d’hospitalité fraternelle où vous les voyez. Ils attendent pour demain un fort contingent de l’ouest, deux mille chasseurs environ.
– Deux mille ? s’écria Sourbin qui avait rejoint Vernant. Et tous vont chasser ici ?
– Trouvez-vous que la place manque pour deux mille hommes ? demanda plaisamment Wagha-na.
Et son bras, d’un geste large, mesurait l’immense horizon, qui paraissait s’allonger, se distendre encore sous les derniers feux du couchant, comme bordé par la bleuâtre dentelure des monts farouches qui commencent à l’Amérique Russe pour se prolonger à travers tout le nouveau Continent, d’un pôle à l’autre, et finir dans les volcans de la Terre de feu.
– Monsieur Wagha-na, fit encore Léopold, – vous avez fait venir sans doute ces maisonnettes d’Europe ?
Le Bison Noir se contenta de sourire discrètement, ce qui contrasta avec l’éclat de rire homérique de Cheen Buck et de Joë.
– D’Europe, Monsieur Sourbin ? Pourquoi d’Europe ? Pensez-vous que nous ne puissions nous suffire ? Sachez donc que nous n’avons rien emprunté à autrui, pas même à nos industrieux voisins des États-Unis. Ce sont nos mines et nos ingénieurs qui ont fourni et agencé ces armatures de fer ; ce sont nos bois qui ont donné les planches, les toitures, les meubles. Vous le voyez, nous ne devons rien à personne. Le Yankee n’a rien à faire chez nous. En revanche, l’Indien s’y retrouve parmi ses frères, et puisque vous me demandiez tout à l’heure si deux mille hommes allaient chasser ici, je vous répondrai : non. Ils ne le peuvent pas, non que la place leur manque, mais parce que nos règlements s’y opposent. Il s’agit, en effet, de laisser du gibier pour les années suivantes. Aussi, parmi les diverses familles que vous verrez demain, chacune suivra son itinéraire particulier. Les Chactas resteront avec nous pour le bison. Les Cheyennes iront à l’ouest chercher l’ours ; les Apaches et les Comanches au nord, à la poursuite des loups, des isatis et des margalis. Dieu nous enseigne à modérer notre désir et à faire la part de chaque besoin.
Il prononça ces paroles avec un noble orgueil, mais aussi avec un sentiment de foi profonde.
– Fort bien, insista encore Sourbin, je vois bien l’hôtel et le couvert mis ; je ne vois pas les plats.
– Vous êtes trop pressé, Monsieur le Français ; les plats marchent encore, ricana Joë O’Connor.
– Oui, ajouta Cheen-Buck, tout aussi gouailleur, ici c’est comme à Chicago : le gibier vient se mettre lui-même dans la machine.
Il n’avait pas achevé sa plaisanterie qu’une série de sons bizarres éclatèrent, poussés par des cornes gigantesques.
– Oh ! oh ! Qu’est-ce que c’est que ça ? s’exclama l’inconvainquable Léopold.
– Ça, c’est le rappel de la cuisine, comme je vous le disais.
Et Wagha-na, enchérissant sur la plaisanterie de Chen-Buck, ajouta :
– Un peu comme en Suisse. Seulement, ici, nous l’appelons le Ranz des porcs.
Il lit monter ses hôtes dans la maison qu’il s’était réservée, et, du haut du balcon qui la ceinturait, ceux-ci purent assister à un fort curieux spectacle, auquel ils ne s’étaient point attendus.
De tous les points cardinaux surgirent dans la plaine d’innombrables troupeaux de porcs gris, vêtus d’une fourrure infiniment plus soyeuse et plus épaisse que celle de leurs congénères d’Europe. Poussés par de robustes chiens et suivis par des valets de ferme indiens, armés de fouets interminables, les Suiliens accoururent en bandes régulières et dociles et se distribuèrent en groupes qui, tous, allèrent s’enfermer derrière les palissades de kraals destinés à les recevoir.
Léopold Sourbin n’épuisait point ses étonnements. Il n’était pas au bout de ses questions :
– Mais, savez-vous, Monsieur Wagha-na, que tous ces animaux doivent être d’un entretien difficile ? Avec quoi les nourrissez-vous ?
L’Indien, cette fois, n’y put tenir. Il se mit à rire de bon cœur.
– Ah ! çà, Monsieur Sourbin, vous figurez-vous, par hasard, que c’est pour l’unique agrément de les promener que nous les lâchons dans la campagne tous les matins, et que nous les ramenons tous les soirs ?
– Alors, vous les traitez comme de vulgaires moutons ? Vous les envoyez paître, tout simplement ?
– Comme vous dites : nous les envoyons paître. Ils se nourrissent eux-mêmes, au petit bonheur. Dame ! comme disent les Bretons, ils ne font pas de la graisse à ce régime ; mais ils trouvent encore à manger, ne serait-ce que les serpents qui pullulent en ce pays et dont vous avez pu voir de si près un si vilain échantillon.
– Pouah ! se récria le cousin de Madeleine, vos cochons mangent des serpents ?
– Mais oui, et c’est tout profit pour nous, puisque nous mangeons les cochons qui nous débarrassent des serpents.
On conversa de la sorte jusqu’à l’heure peu avancée où les voyageurs goûtèrent la joie du repos sur de forts bons lits, n’ayant point eu, depuis six jours, l’usage de ce meuble essentiellement utile.
De même qu’on s’était couché de bonne heure, on se leva de grand matin.
On assista de la sorte à l’exode des troupeaux de porcs. Puis d’autres sons de cornes et de trompettes annoncèrent l’approche des tribus indiennes qui venaient camper au village pour quarante-huit ou soixante-douze heures.
Ce fut vraiment un coup d’œil magnifique à contempler.
Les Indiens arrivaient, tous à cheval, ayant déjà revêtu leurs manteaux et leurs fourrures d’hiver. Quelques-uns néanmoins restaient nus jusqu’à la ceinture, peints de couleurs diverses allant du rouge sang au chrome clair, du vert Véronèse au bleu de cobalt. Et ce fantastique défilé d’hommes peints, emportés au galop de chevaux de race, offrait un spectacle unique dans le cadre de cette plaine immense, sous l’irradiation de ce couchant de pourpre et d’or.
À cheval lui-même devant le front du village, ayant près de lui Cheen-Buck, O’Connor et Madeleine, Wagha-na recevait, tel qu’un roi, les hommages enthousiastes des arrivants.
N’était-il donc pas le roi de ces peuplades proscrites et chassées de leurs terres familiales, ce grand Peau-Rouge dont le noble génie avait conçu l’audacieuse pensée de rassembler en un seul faisceau tous les fils de sa race, de leur rendre avec la liberté l’exercice de leurs droits, de les appeler à un plus fier avenir, à de plus hautes destinées ? N’était-il pas leur roi, cet homme que l’intelligence et la volonté, aidées de la fortune créée par elles, avaient fait l’aîné de leur sang, presque leur père ?
En son honneur, toutes les tribus, jadis hostiles, exécutèrent une triple cavalcade, une fantasia comparable à celles des Arabes du nord de l’Afrique. Ce fut un jeu de cirque merveilleux qui, pendant près de deux heures, se développa sous les yeux fascinés des spectateurs.
Puis, lorsqu’il eut pris fin, les chefs d’abord, les simples cavaliers ensuite, vinrent, à tour de rôle, saluer le Bison Noir. Il serra toutes les mains, distribua des compliments, finalement retint à dîner les quarante principaux caciques.
Le repas se donna hors des maisons, sur la place, battue et nivelée comme une aire de ferme. Tout autour de la table centrale, soixante autres tables furent dressées et servies par les occupants actuels de la station.
Léopold Sourbin, qui avait paru assez disposé à mépriser cette cuisine indienne, s’en pourlécha les babines, ce qui lui valut une apostrophe piquante de Joë O’Connor.
– Eh bien ! monsieur le Français, railla le trappeur, revenez-vous un peu de votre mauvaise opinion sur notre compte ? Pour des Sauvages, nous ne nous tirons pas trop mal d’affaire, n’est-il pas vrai ?
Il eût été difficile au personnage de ne point le reconnaître.
L’hospitalité de Wagha-na s’exerçait, en effet, sur un pied de générosité très large. Non seulement les mets servis sur la table des chefs étaient apprêtés avec un art consommé, ce qui ne surprit plus personne lorsque l’on sut que Cheen-Buck, qui en avait surveillé l’apprêt, en qualité d’économe de l’expédition, avait poussé son amour de l’art culinaire jusqu’à passer huit années dans les principales villes d’Europe, et spécialement de France et d’Italie, où, comme Pierre le Grand en Hollande, il avait voulu se former lui-même par la pratique ; – non seulement l’apparition de vins de Bordeaux, de Bourgogne, de Chianti, de Marsala, de Madère, de Porto, d’Australie souleva des transports d’enthousiasme, mais cet enthousiasme alla jusqu’au délire lorsqu’on plaça sur la table douze bouteilles dont les goulots argentés disaient assez la provenance.
– Mes chers hôtes, s’écria Wagha-na en se levant, c’est aujourd’hui l’anniversaire de ma fille Madeleine. J’ai tenu à le fêter avec vous. Buvons à sa santé !
Toutes les flûtes à champagne, – car ce détail même n’avait point été négligé, – répondirent à ce toast. Ce fut une vraie joie pour tous ces hommes à la nature fruste, mais généreuse, de s’unir au vœu de leur chef. Et Léopold Sourbin, pour la première fois de sa vie ressentit quelque chose qui ressemblait à un remords, en songeant que, naguère encore, il formait l’abominable projet d’assassiner cette belle jeune fille assise en face de lui.
– À demain pour le premier passage des bisons ! conclut Joë O’Connor.
VI
UNE MARÉE VIVANTE
On s’éveilla comme la veille, au son des cornes. Mais cette fois, elles ne faisaient que répondre à de lointains appels, venus des extrémités de la plaine. En un instant tout le monde fut sur pied, et lorsque Wagha-na souhaita le bonjour à ses amis, son premier mot fut pour leur dire :
– À cheval, Messieurs. Les bœufs ne viendront pas nous rejoindre ici. C’est à nous d’aller à leur rencontre.
– À quelle distance environ ? questionna Georges Vernant.
À deux lieues à peu près, un peu plus, un peu moins. Las chasseurs de l’autre côté nous avertissent.
On se sépara sur l’heure des tribus qui remontaient au nord et à l’est. Puis, la carabine au dos, le couteau de chasse à la ceinture, le lasso enroulé sur l’arçon, on s’élança vers les horizons de l’ouest.
Wagha-na ne s’était pas trompé. À un peu plus de cinq milles du campement, on rencontra les premiers éclaireurs de la peuplade qui chassait. Ils firent connaître qu’un troupeau de six cents têtes environ avait passé la veille à quarante milles au nord, et que son approche était signalée depuis les premières heures de l’aube.
Toutefois une difficulté se présentait sur laquelle on n’avait pas compté.
L’énorme armée des bisons venait directement sur la plaine. Si elle s’y engageait, il fallait considérer la chasse comme perdue, car, sur cet immense espace pierreux et découvert, il serait impossible aux chasseurs de dissimuler leur présence. Les bœufs ne se laisseraient point approcher.
Dès lors, il ne resterait à leurs adversaires que la maigre ressource d’abattre à coups de fusils quelques individus isolés, – pauvre consolation qui n’allait point elle-même sans offrir de nombreux périls.
L’effort des traqueurs tendait donc à faire dévier la marche du troupeau vers les prairies herbeuses dans lesquelles il devenait beaucoup plus facile aux chasseurs de se cacher. Si l’on n’y pouvait entraîner la masse entière, du moins essaierait-on d’en détourner un groupe, une importante fraction.
– Combien êtes-vous ? – demanda Wagha-na au chef Sioux qui menait la colonne.
– Cinq cent vingt, pas un de plus, – répondit celui-ci.
– En effet, remarqua le Bison Noir, cinq cent soixante-dix avec les cinquante que nous sommes. C’est vraiment peu pour huit cents bœufs sauvages !
Ils n’eurent ni le temps ni le loisir de fournir un plus long entretien.
Une rumeur sourde, continué, profonde, venait de s’élever au nord-ouest.
C’était comme le bruit des grandes eaux perçu par un jour de tempête, ou comme les clameurs d’une foule à une grande distance. Bientôt, à ces sons confus succéda une sorte de long ronflement analogue à celui du vent ; une nuée épaisse de poussière soulevée annonça l’approche du troupeau, précédée elle-même par une longue trépidation de l’air et du sol.
Et c’était vraiment une sensation étrange, troublante, se résolvant en un sentiment de terreur mal défini.
Soudain des mugissements, d’abord confus, puis nets et distincts, des beuglements mêlés ou isolés, remplirent tous les échos de l’immense plaine, et l’on put voir, à travers la poussière, déchirée çà et là, comme un opaque rideau, une ligne noire s’avançant pleine de cris et de tumulte. L’Indien se tourna vers ses compagnons.
– Un temps de galop, Messieurs, cria-t-il. Il ne faut pas nous trouver sur le passage du troupeau.
En effet, ce n’était point là un danger qu’on eût le droit de braver.
Sur cette plaine dénudée où ils ne pouvaient se laisser attarder par aucune pâture, les bœufs allaient passer comme un ouragan, renversant, écrasant tout sur leur passage. Il était donc urgent de prévenir leur course et de se mettre au plus tôt à l’abri de quelque futaie, ou même de quelque prairie herbeuse.
Tout le monde suivit le conseil donné par Wagha-na. On lâcha les brides, et les chevaux, qui n’avaient pas besoin d’ailleurs, d’autre stimulant que la peur qu’ils ressentaient, partirent ventre à terre dans la direction du sud-ouest.
Quel était le développement du front de la ligne occupée par le troupeau ?
C’était ce qu’on ne pouvait dire dès à présent. Mais Wagha-na, depuis longtemps versé dans la connaissance des choses du désert, avait fait prendre cette direction à la colonne, parce qu’il savait qu’à trois milles environ plus au sud on rencontrerait un bois de sapins suffisant pour entraver la charge furieuse des bisons.
L’essentiel était de l’atteindre avant que la première vague de cette marée vivante ne déferlât sur le point de la plaine où l’on se trouvait.
Aussi Wagha-na donnait-il l’exemple comme il avait donné le conseil.
Penché sur le cou de son cheval Gola, il l’animait par des paroles encourageantes, tantôt le flattant de la paume, tantôt le fouaillant avec l’extrémité du bridon qu’il tenait dans sa main gauche.
Et, tout en courant, il se retournait sur sa selle et jetait de nouveaux encouragements à sa troupe.
– Hardi, vous autres, hardi ! Poussez vos bêtes ! Il n’y a pas une minute à perdre.
C’était véritablement effrayant, cette course à travers la prairie aride.
À ses côtés, l’Indien retrouvait Madeleine, écuyère consommée et infatigable. Tout auprès d’elle, Georges Vernant, Cheen-Buck, Joë O’Connor, allaient de la même allure rapide et sûre. Puis venait le peloton des cavaliers venus de Dogherty et des environs, escorté par quelques-uns des habitants du campement. Enfin, fermant la marche, emporté par le galop vertigineux de son cheval, le même qui, l’avant-veille, l’avait si lestement désarçonné, Léopold Sourbin suivait fiévreusement et péniblement la colonne.
Il n’était que temps. Le troupeau arrivait en longue ligne, pareille à une armée en bataille. On la voyait maintenant onduler, se fermer, s’ouvrir, fléchir sur un point, se rompre et gagner sur un autre, selon que le terrain, médiocrement accidenté pourtant, offrait à l’immense front un obstacle ou une déclivité.
Et il semblait que cette ligne allât se perdre aux bornes mêmes de l’horizon.
Le danger était si grand que Wagha-na, inquiet pour ses compagnons, en semblait perdre son sang-froid ordinaire. Il s’oubliait au point de mêler, dans ses exclamations en langue indienne ou française, des mots de langue anglaise.
– Well, well ! criait-il, piquez, piquez ferme ! All is lost !
Oui, tout était perdu, si l’on ne gagnait pas, avant de subir le choc du troupeau, la bande verdoyante des sapins que l’on voyait couper le ciel à moitié d’un demi-mille maintenant.
Tout à coup, en avant du gros de la troupe, une avant-garde surgit, à peiné séparée par deux ou trois cents mètres du peloton des cavaliers.
Il y avait là vingt ou vingt-cinq mâles, des taureaux de grande taille dont l’œil brillait, farouche et terrible, sous l’épaisse toison qui couvrait leur encolure et leurs épaules puissantes.
Avec un beuglement féroce, ils sortirent d’un pli de terrain et se ruèrent en avant, les cornes basses.
– Aux éperons ! cria Wagha-na, en français cette fois.
Les mollettes d’acier touchèrent les flancs des bêtes, dont la course exaspérée se précipita haletante éperdue.
Mais les taureaux chassaient à vue, et l’on sait que le bison américain peut soutenir une lutte de vitesse contre le cheval.
En cette circonstance, le péril était d’autant plus redoutable que, maintenant, pour gagner le couvert, il fallait courir parallèlement à la ligne assaillante et, par conséquent, perdre l’avance que l’on avait sur elle.
N’importe ! C’était là un péril prévu et qui n’arrêtait point les vaillants Canadiens.
– Encore un quart de mille, et nous sommes sauvés ! cria Wagha-na.
Un quart de mille !
Et les taureaux n’étaient plus qu’à cent cinquante pas de la troupe !
Un instant, le chef eut la pensée de faire arrêter la colonne et de fusiller à bout portant les terribles ruminants.
Mais, qu’y aurait-on gagné ? S’arrêter, c’était donner le temps au front de bataille de gagner son avant-garde, et, en supposant que celle-ci fût tout entière foudroyée par la décharge, ce qui n’était rien moins que certain, c’était permettre à l’aile droite du troupeau de fermer les issues, en débordant le bois de sapins.
La fuite se fit donc plus rapide, plus accélérée. Les chevaux, justifiaient la métaphore vulgaire. Ils dévoraient l’espace.
Enfin, les Sioux, les premiers, franchirent la lisière du bois et s’enfoncèrent sous les arbres.
Wagha-na, Madeleine, Georges Vernant, sûrs maintenant d’atteindre l’abri, avaient modéré leur allure.
Tout le monde se trouva sous les branches avant que l’avant-garde des bisons ne vint se briser contre cet obstacle.
Seul, l’infortuné Léopold, malgré l’énergie que déployait sa monture, restait en retard d’une vingtaine de mètres.
Juste en ce moment, l’un des taureaux, une bête monstrueuse, au vaste front, armé de cornes courtes, mais acérées, se détacha du groupe et fondit à l’improviste sur le malencontreux cavalier.
Le Français se sentit perdu.
Il eut l’envie bizarre, maladive, de lâcher la bride et les étriers pour se laisser choir hors des atteintes de l’effroyable ruminant.
Mais, avant qu’il pût mettre ce projet morbide à exécution, une lueur rapide s’alluma sous son regard hébété, tandis qu’une détonation éclatait à quelques pas de lui, emplissant ses oreilles bourdonnantes.
Le bison frappé entre les deux yeux par une balle à pointe d’acier, tomba raide mort, capotant en avant.
En même temps, une main nerveuse saisit Léopold sous le bras et le remit en selle, en équilibre.
– Eh bien, mon cousin, dit une voix douce, un peu railleuse, vous voyez que je suis encore bonne à quelque chose, et qu’il eût été maladroit de me tuer.
Malgré le trouble de ses esprits, Sourbin éprouva une commotion en entendant ces paroles.
Il se retourna. Madeleine chevauchait à son côté. Un énigmatique sourire se jouait sur ses lèvres.
Il n’osa l’interroger, tout plein de gratitude en même temps que de confusion.
C’était la première fois que la jeune fille se servait de ces mots « mon cousin », en lui parlant.
Cette anomalie, par elle-même, était déjà suffisamment instructive. Mais si l’on y joignait les paroles prononcées, la leçon prenait une signification bien autrement grave.
Sourbin voulut parler, répondre quelque chose. Aucun mot ne vint à ses lèvres.
Il attacha sur sa compagne un regard vague, maladif, qui, mieux que tout autre signe, donna à Madeleine l’intuition de l’état d’âme de son peu intéressant « cousin ».
Au reste, ni l’un ni l’autre n’avait le temps de faire à loisir des réflexions de morale ou de philosophie.
Ce n’était pas tout que d’avoir gagné le bois. Il ne pouvait, en effet, leur offrir qu’une protection essentiellement provisoire. Rien n’empêchait les bœufs sauvages de l’envahir pour y poursuivre les chasseurs. Mais, là, du moins, ils ne pouvaient attaquer qu’isolément, et l’avantage restait à leurs ennemis dans cette rencontre en tirailleurs.
Cependant l’avant-garde du troupeau, fidèle à sa consigne, bien qu’un instant décontenancée par le fracas de l’arme à feu et la chute d’un de ses mâles, n’en continuait pas moins sa course à travers la plaine. Ce n’était plus son affaire de relancer les chasseurs. Les taureaux s’en tenaient à leur rôle d’éclaireurs.
Les cavaliers eurent donc le temps de gagner l’intérieur des sapins, où ils se tinrent en arrêt, attendant le passage de la troupe.
Elle passa sans rompre sa ligne, et, pendant un moment, ce fut un effrayant vacarme de mugissements, tandis que la terre tremblait sous les pieds fourchus des redoutables bêtes. On voyait les taureaux guider la masse par escouades régulières, comme auraient pu le faire des sous-officiers de l’espèce bovine. Derrière eux se pressaient les vaches, alourdies par leurs mamelles gonflées de lait, et les veaux bondissant, sans s’écarter de la communauté familiale.
Ce fut comme le mascaret de quelque fleuve soudainement gonflé par le flux.
Mais cette première vague dont le choc eût tout broyé, si on l’eût subi de front, ne causa aucun dommage sur ses flancs. Il était visible que les bœufs avaient hâte de gagner les pâturages ou, tout au moins, de traverser cette plaine nue qui leur paraissait sans doute à eux-mêmes semée de périls et d’embûches.
– Ah ! fit, Joë, exprimant un regret, voilà le troupeau passé ! Voilà une belle occasion perdue !
L’un des éclaireurs Sioux répondit, en entendant cette plainte :
– Nos frères Sioux ont du rabattre une partie du troupeau. Il y en avait plus que cela hier matin.
– Es-tu sûr de ce que tu dis là ? – demanda Wagha-na.
– Oui, parfaitement sûr. D’ailleurs tu ne vas pas tarder à t’en apercevoir toi-même.
Il disait vrai.
Une demi-heure environ s’écoula, au bout de laquelle de nouveaux mugissements, de nouvelles trépidations ébranlèrent l’atmosphère, Seulement le bruit et le frémissement étaient bien moindres. En outre, des clameurs confuses, des sons de trompes, des aboiements de chiens s’y mêlaient, attestant, la présence des chasseurs auprès du troupeau traqué.
– Attention ! cria Cheen-Buck, je les vois venir. Nos frères Sioux ne savent pas que nous sommes ici. Ils dirigent le troupeau sur nous.
– Qu’allons-nous faire ? demanda d’une voix étranglée Sourbin, que tant d’émotions réitérées commençaient à remplir d’épouvante.
– Monsieur le Français, répliqua Joë O’Connor, nous allons tout bonnement remonter à cheval et charger cette bande, afin de l’empêcher de nous charger elle-même.
Cela ne faisait pas précisément le compte de Léopold qui, en fait de chasses au buffle, estimait qu’il en avait assez vu jusqu’ici et ne demandait pas mieux que de se remettre à des occupations moins champêtres.
Cependant, il fit contre fortune bon cœur et, quoique légèrement endommagé par les galops effrénés de ces derniers jours, enfourcha de nouveau sa bête avec une résignation mélancolique que celle-ci semblait partager.
Cela inspira même à Joë un mot pittoresque, quoique assez méchant :
– Vous avez là un assez joli poulet d’Inde, fit-il en caressant le cheval : Il commence à se faire à votre méthode.
Sourbin n’eut pas le loisir de relever, cette épigramme.
La colonne du Bison Noir sortait du bois, prête à donner la main aux chasseurs Sioux.
– Venez avec nous, mon cousin, dit Madeleine, sans aucune malice cette fois dans le ton. Il vous est permis de faire usage de la carabine.
– N’en faites-vous donc pas usage vous-même ? – questionna l’aventurier.
– Non, répondit-elle en riant, ce ne serait pas absolument correct.
– Il me semblé pourtant que tout à l’heure…
– Tout à l’heure, nous ne chassions pas. C’est nous qui étions chassés. Et puis, vu la position critique où vous vous trouviez, j’ai cru pouvoir déroger aux règles ordinaires de la chasse aux buffles.
Elle riait en disant cela, mais ce rire parut à Sourbin moins cruel que le persiflage d’O’Connor.
– À propos, fit-il, et ce bœuf que vous avez tué ? Est-ce que nous n’allons pas le ramasser ?
– Rassurez-vous. Nous le ramasserons tout à l’heure, avec les autres.
Et la gracieuse amazone, rendant la bride à sa monture, s’élança à la rencontre des cavaliers indiens qui accouraient brandissant le lasso ou les bolas, deux boules de fer creux reliées entre elles par une courroie d’une solidité à toute épreuve.
Le troupeau détourné était de cent cinquante têtes environ, parmi lesquelles une dizaine de mâles tout au plus. Le reste, vaches et veaux, affolés par la vue des assaillants, s’enfuyaient dans toutes les directions, pêle-mêle, n’ayant plus rien de la superbe ordonnance du gros de la troupe.
La chasse ne commençait guère qu’en ce moment. Trois ou quatre des moindres animaux, tout au plus, avaient été déjà capturés à la manière accoutumée. Par déférence pour Wagha-na, et aussi par une émulation légitime, les Indiens ne voulaient accomplir leurs véritables exploits que sous les yeux de l’homme illustre qu’ils tenaient à juste titre pour le restaurateur de leur indépendance, qu’ils nommaient avec reconnaissance le « Père » de leur race.
Alors commencèrent devant les yeux : émerveillés du Bison Noir ces prouesses superbes qui font de la chasse aux bœufs sauvages l’un des spectacles les plus émouvants que l’œil humain puisse contempler.
Les Indiens s’étaient divisés en une vingtaine de groupes dont l’effort convergent tendait à rompre le faisceau des ruminants et à disperser ceux-ci, en les poussant par bandes séparées vers le bois de sapins.
Comme s’ils avaient eu conscience du piège que couvrait cette manœuvre, les animaux se pressaient les uns sur les autres, non sans perdre en chemin un des leurs demeuré en retard et qui était tout aussitôt circonvenu par les chasseurs.
Celui-ci fuyait au hasard, poursuivi à grands cris par les Indiens. Puis, au moment où, perdant toute prudence, la bête fonçait sur l’un de ses persécuteurs, celui-ci se dérobait adroitement, tandis que plusieurs autres accouraient de toute la vitesse de leurs chevaux.
Alors le plus rapproché déployait le lasso et après l’avoir fait tourner deux ou trois fois au-dessus de sa tête, lançait au loin le cercle à nœud coulant. Il venait s’abattre sur la crinière de l’animal et, resserré sur-le-champ par l’élan furieux du cheval, donnait au bison une secousse si brusque que celui-ci généralement s’abattait à moitié étranglé.
Avant qu’il n’eût le temps de se relever, un autre chasseur était sur lui et, d’un seul coup de tomahawk, lui tranchait les tendons des jambes postérieures, le réduisant ainsi à l’impuissance de se mouvoir.
Une vingtaine de bêtes furent prises ainsi en quelques minutes.
Mais le chiffre convenu d’avance, celui qui devait fournir aux Sioux leur provision de viande pour l’hiver, était de cent têtes, sans parler des jeunes bovidés que l’on emmènerait captifs aux campements, afin de renouveler le troupeau captif des vaches laitières. On avait donc encore beaucoup à faire pour achever le nombre.
Le noyau central, encore gros de cent trente bêtes, refusait de se disperser, et les Indiens, emportés par leur audace excessive, se voyaient fréquemment contraints de se dérober à une charge inattendue du troupeau.
Tout à coup, celui-ci, pris d’une panique imprévue, après avoir fourni dans la plaine une course effrénée, fit tête sur queue et, servant trop bien cette fois les intentions des chasseurs, se mit à fuir en masse dans la direction du bois.
Trop bien, en effet, car si, sous le couvert, les bœufs ne pouvaient se mouvoir aussi aisément que dans la plaine, il y devenait également plus difficile aux Indiens d’y manœuvrer à cheval.
Et, cependant, les audacieux Sioux n’hésitèrent pas à s’engager sous les sapins, à la suite de leur proie qui fuyait.
Encore une vingtaine de vaches et six ou sept veaux furent pris dans cette poursuite.
Mais, dès lors, la chasse était manquée, à moins que l’on ne s’acharnât derrière le troupeau.
Or, celui-ci avait pris la direction du sud-ouest, une direction dangereuse, d’abord parce que les fuyards pouvaient entraîner fort loin les chasseurs, ensuite parce qu’elle les rapprochait des montagnes où les fauves étaient à redouter.
Wagha-na rassembla sur l’heure le conseil des chefs, et le tint sans faire halte, au grand trot des chevaux.
Il lança tout un escadron de cent vingt hommes pour tourner le bois et tâcher de rabattre le troupeau, s’il en était temps encore. Devant la menace de perte, on décida qu’exceptionnellement il serait fait usage des armes à feu.
Hélas ! Toutes ces mesures ne donnèrent que de piètres résultats.
Lorsque, à cinq heures du soir ; la nuit étant déjà presque faite, on releva les corps gisant dans la plaine, on n’en compta que quarante-neuf, en y comprenant le taureau abattu par Madeleine Kerlo. On avait pris, en outre, treize veaux de tout âge.
C’était misérable. C’était pour la pauvre tribu la menace d’un hiver cruel, réduit a la ration, et cela précisément en une année où, par une protection visible de Dieu, la population s’était légèrement accrue.
– Non, s’écria vivement Wagha-na, il ne sera pas dit que nous abandonnons ainsi la poursuite. Faisons halte un instant. Les bœufs ne peuvent pousser bien avant. Nous allons dormir jusqu’à trois heures du matin et, à ce moment-là, nous reprendrons notre course jusqu’à ce que nous ayons retrouvé nos fuyards. On obéit à la lettre à cette sage prescription. Les tentes furent dressées. Madeleine et son père adoptif reçurent leurs amis habituels autour d’un thé accompagné de punch. Puis on alluma un brasero que l’on garnit de charbon emporté de Dogherty par le toujours précautionneux Cheen-Buck. Alors la conversation s’engagea sur le pied de l’intimité, car Léopold Sourbin, harassé de fatigue, avait demandé la permission de ne point perdre un instant de sommeil. Depuis dix jours qu’il était le commensal de Wagha-na, il avait vu ses forces et son courage soumis à de formidables épreuves.
– Chef, interrogea brusquement Joë O’Connor, les Indiens viennent de m’apprendre une chose qui m’inquiète un peu.
– Quoi donc ? répondit indifféremment le Bison Noir.
– Ils ont rencontré, en passant au campement, deux voyageurs à cheval qui paraissaient nous suivre. Au signalement qu’ils en donnent, j’ai cru reconnaître les deux vilains oiseaux que nous avons mis à la porte de Dogherty.
Wagha-na se mit à rire.
– Toujours soupçonneux, vieux Joë. Que veux-tu que ces faces de Yankees viennent faire dans nos solitudes du nord-ouest ?
– C’est précisément parce, qu’ils n’y ont rien à faire que je me méfie de leur présence, répliqua l’Irlandais.
L’Indien parut un instant soucieux. Ses sourcils se rapprochèrent violemment et il s’abandonna à une sombre méditation.
Puis, jugeant peut-être qu’il n’y avait pas lieu de prêter plus d’attention aux propos de Joë, il murmura :
– Bah ! Qu’avons-nous à faire avec ces hommes ? Laisse-les venir, et s’ils, nous ennuient, eh bien !…
Il n’acheva pas. S’enveloppant d’un large manteau de fourrure, il donna le premier l’exemple du sommeil.
VII
LES MONTS ROCHEUX
Il faut croire que les bœufs poursuivis par Wagha-na et ses chasseurs étaient des bêtes endiablées, car, pendant huit jours encore, ils entraînèrent les chasseurs dans les prairies du sud-ouest. Si bien, que l’on atteignit en même temps le pied des montagnes Rocheuses et les frontières de la Californie.
Par bonheur, cette poursuite n’avait point été infructueuse. Les Sioux avaient pu parfaire le chiffre d’animaux, tant tués que pris, qu’ils avaient jugé nécessaire à leur consommation hivernale.
Aussi le jour où le centième buffle eut été abattu, leurs chefs, d’accord avec Wagha-na, arrêtèrent sur l’heure la marche en avant. On dressa les tentes. Un banquet de fête réunit tous les membres de l’expédition et l’on décida que, dès le lendemain, à l’aube, on prendrait le chemin du retour.
Aussi bien l’automne froid et brumeux s’annonçait-il menaçant. Les chaînons les plus bas se montraient déjà couverts de neiges précoces. Il fallait redouter le déchaînement des vents du nord qui, dès la fin d’octobre, glacent les campagnes et répandant au loin leur souffle mortel.
Mais ce n’était là que le moindre des motifs. Il en était un plus grave qui déterminait Wagha-na.
On touchait à la frontière américaine, et, outre la haine implacable que le cœur de l’Indien nourrissait contre les oppresseurs de sa race, il détestait plus spécialement cette population mêlée, bâtarde, qui occupe surtout les États nouveaux de l’Union : Texas, Colorado, Sacramento, les districts de la Californie et du Montana, population qui joint à la dureté du Saxon la férocité native des descendants des conquérants espagnols.
Il savait que ces frontières sont insuffisamment gardées, sur leur immense ligne de développement, par les faibles garnisons qu’y placent, en des forts mal reliés entre eux, les autorités canadiennes. Il savait que, pour éviter à la mère-patrie des conflits incessants, celles-ci ferment trop souvent les yeux sur les quotidiennes violations du territoire britannique par les bandes armées des chercheurs d’or et des émigrants américains.
Or, plusieurs motifs justifiaient les appréhensions de l’Indien et lui dictaient une marche rétrograde.
Le lendemain même du jour où Joë O’Connor avait exprimé ses craintes au sujet de la réapparition des deux inquiétants personnages, Ulphilas Pitch et Gisber Schulmann se montrèrent sur les derrières des chasseurs.
Ce retour s’expliquait aisément.
Les deux coquins, en quittant Sourbin, avaient rejoint par le plus court les tronçons de voies ferrées, qui reliaient entre elles les cités du Bas-Canada. Une seule journée leur avait suffi pour s’assurer que Madeleine Jean était bien la fille du Breton Kerlo. Il ne s’agissait donc que de supprimer celle-ci pour faire retomber son héritage aux mains de Léopold Sourbin, et il est à croire que Pitch avait acquis sur ce dernier des droits suffisamment précis pour ne lui laisser aucun doute sur l’issue de l’entreprise au sujet de ses propres intérêts.
Une fois munis du document nécessaire, les deux coquins étaient revenus sur leurs pas.
À Dogherty, où ils ne demandaient plus le séjour, on n’avait fait aucune difficulté de leur apprendre que Wagha-na et ses hôtes avaient pris le chemin du nord-ouest. Là, encore, après avoir doublé les étapes, ils avaient dû changer leur itinéraire et suivre les chasseurs du côté des frontières californiennes.
Car il leur fallait, au plus tôt, rattraper Léopold Sourbin.
Ils avaient, en effet, le soupçon que celui-ci travaillait de plus en plus pour son seul compte, qu’il cherchait à s’affranchir d’une complicité dangereuse et inutilement compromettante.
Moins que jamais Pitch et Schulmann entendaient rendre à Sourbin sa liberté.
Sourbin, en effet, était l’auxiliaire indispensable. Il pouvait se passer d’eux, non eux de lui. Leur effort se fut dépensé en pure perte, si ce précieux intermédiaire entre eux et les millions de Madeleine leur eût fait défaut.
Or Pitch et Schulmann avaient joué leur va-tout sur ce coup de dés.
Leurs chevaux étaient surmenés et ils voyaient approcher le moment où leurs bourses seraient vides.
Il y avait donc urgence absolue à atteindre leur complice, devenu leur instrument.
D’ailleurs Schulmann, l’homme des actions rapides, était décidé à ne point traîner les choses en longueur. Puisqu’on se trouvait en plein désert, les occasions ne pouvaient manquer d’en finir avec les difficultés de la situation. Le coup de fusil d’un maladroit peut tuer aussi aisément un homme qu’un animal.
L’essentiel était de se faire admettre au nombre des chasseurs, ou, du moins, de s’y faufiler, à titre de chasseurs indépendants, afin de mettre à profit la première occurrence qui mettrait Madeleine à portée de sa carabine.
Ulphilas, à vrai dire, blâmait cet empressement opiniâtre.
– Vous avez tort, ne cessait-il de répéter à l’Allemand, de mettre tant de confiance en vos forces. Outre qu’il peut se rencontrer parmi ces sauvages des hommes d’une vigueur égale, sinon supérieure à la vôtre, ils possèdent sur vous l’avantage d’être rompus à des exercices violents auxquels, permettez-moi de vous le dire, Gisber, vous me paraissez à peu près étranger. En sorte que, si votre balle s’égare en chemin, les leurs ne suivront pas la même voie. Et je ne parle pas d’autres armes non moins dangereuses, mais beaucoup plus sûres que le fusil.
– Quelles armes ? demanda Schulmann, affectant la plus hautaine indifférence.
– Hé ! mon cher, répliqua Pitch, qui se mit à persifler, vous n’attendez pas, j’imagine, que je vous en fasse une nomenclature détaillée. Vous les connaissez mieux que moi et n’avez que l’embarras du choix entre ces instruments, plus désagréables les uns que les autres : flèches, lances, poignards, tomahawks.
L’inconvainquable Gisber se borna à hausser les épaules dédaigneusement.
Ce fut avec ces dispositions également hostiles, mais peu d’accord sur le choix des moyens et leur opportunité, que les deux bandits rejoignirent la colonne des chasseurs de bisons.
Ils ne s’étaient point attendus à en trouver un pareil nombre.
Ce leur fut une première déception qui leur fit faire la grimace.
Leur second ennui fut de se voir reconnus à la première rencontre.
Wagha-na s’approcha d’eux avec un sourire ironique et, après avoir pris des nouvelles de leur santé, leur demanda s’ils étaient venus dans l’intention de prendre part à la chasse. Sur leur réponse affirmative, il ajouta :
– Eh bien ! Messieurs, la terre est grande et la prairie aussi. Il y a place pour tout le monde sous le soleil. Je vous souhaite une promenade agréable et d’heureux coups de fusils.
C’était, en termes polis, leur signifier-leur congé.
Gisber Schulmann dut avaler sa rage avec sa salive. L’occasion semblait lui échapper.
D’autant plus qu’il fallait à tout prix informer Léopold Sourbin. Celui-ci, à la vue de ses complices, était devenu, tout à tour, très rouge et très pâle, et ces aspects de son visage n’avaient point échappé aux yeux sagaces qui le surveillaient.
Ulphilas joua sa dernière carte :
– Gentlemen, demanda-t-il, n’y a-t-il pas, parmi vous, un Français du nom de Sourbin ?
C’était là, assurément, une souveraine maladresse. Le Yankee aurait dû supposer que ceux qu’il s’efforçait de tromper étaient déjà plus ou moins au courant des visées du Français, surtout si celui-ci avait fait connaître ses intentions au sujet d’un mariage possible avec sa cousine.
Mais le but que visait Pitch n’était point tant d’en imposer à Wagha-na que de faire connaître à Léopold lui-même qu’on ne le perdait point de vue et, conséquemment, que, s’il cherchait à se dérober à ses engagements envers ses deux ex-associés, on saurait lui rappeler cet importun souvenir.
À cette question ainsi posée, le Bison Noir répondit sérieusement en rappelant ledit Léopold :
– Monsieur Sourbin, dit-il, voici deux Messieurs qui paraissent vous connaître et qui désirent vous parler.
Très troublé, le cousin de Madeleine sortit, à contrecœur et les sourcils froncés, des rangs de ses hôtes et s’avança vers les deux aventuriers sans celer sa mauvaise humeur.
Il était dans l’obligation de se montrer froid envers eux, sous peine de donner prise aux soupçons.
Il toucha donc à peine le bord de son chapeau de feutre mou en abordant Pitch. Quant à Schulmann que, d’ailleurs, il connaissait à peine, il affecta de ne point le voir.
L’Allemand n’avait point à se plaindre de ce manque d’égard, étant lui-même le plus malotru des hommes.
Quant à Ulphilas, il prit la chose avec son ordinaire placidité :
– All right ! Monsieur Sourbin. Je trouve très bien que vous feigniez de nous être étranger. Comme cela, personne ne pourra croire que nous nous entendons pour poursuivre un bénéfice commun.
La phrase était habilement faite. Elle ramenait tout de suite le Français à la mémoire de son pacte. Mais elle eut le don de porter violemment sur les nerfs de celui-ci.
– Hé ! monsieur Pitch, réclama-t-il, vous en parlez trop souvent et surtout trop à l’aise de ce bénéfice commun.
Engagée sur ce ton, la conversation ne pouvait être aimable.
L’Américain, dès qu’il se vit en tête, répliqua avec non moins d’aigreur. Ce que voyant, Léopold poussa son cheval et s’éloigna du gros des chasseurs, afin que le bruit des paroles échangées ne pût parvenir jusqu’à eux.
Mais s’il évita leurs oreilles, il ne parvint pas à éluder leurs regards.
Ces yeux d’hommes des grandes plaines peuvent rivaliser avec ceux des faucons et des aigles. Ils suivirent donc à distance l’expression mimique des gestes, et s’ils n’en pénétrèrent pas tout le sens, du moins comprirent-ils qu’entre ces trois blancs venus de régions différentes, les relations étaient plus étroites qu’ils ne voulaient l’avouer.
Wagha-na appela à lui Cheen-Buck et O’Connor.
– Vieux Joë, dit-il, si je ne t’ai pas répondu l’autre soir dans la tente, ce n’était pas que je blâmasse tes soupçons. Mais je ne voulais point alarmer inconsidérément Madeleine. Maintenant, je sais ce que je voulais savoir. Nous pouvons donc causer à notre aise.
Et, comme les deux compagnons tendaient l’oreille, il poursuivit :
– Désormais, jusqu’à la fin de la chasse, vous emmènerez Madeleine à l’autre extrémité de la colonne. Vous vous tiendrez sans cesse à ses côtés. Vous veillerez à ce qu’elle ne se trouve jamais à proximité de ces deux coquins, pas même à portée de fusil.
Une véritable stupeur se peignit sur les traits des deux hommes.
Le Bison Noir comprit qu’il devait entièrement s’ouvrir à ses amis de ses craintes et de ses projets.
Alors, il leur rappela le crime accompli vingt ans plus tôt par le père de ce même Léopold Sourbin, et leur expliqua le danger qui menaçait la jeune fille. Elle disparue, c’était au fils de l’assassin que revenait la fortune.
Joë et l’Indien n’étaient pas gens à s’embarrasser de casuistique.
Wagha-na le vit bien dès leurs premières paroles.
– Jean, dit tranquillement O’Connor, parlant avec la familiarité d’une vieille affection, à votre place, je n’aurais pas tant de scrupules. Puisque ces hommes sont trois coquins, je les tuerais tous les trois.
– Hum ! fit Wagha-na, qui ne put s’empêcher de rire, le moyen est radical, mais un peu vif.
– Je partage l’avis de Joë, appuya Cheen-Buck.
Le chef fit alors connaître à ses auditeurs les raisons pour lesquelles il ne professait pas leurs sentiments. Certes, il n’avait aucune confiance dans le Yankee, pas plus qu’en son compère l’Allemand. Mais il jugeait Léopold meilleur que son père et ses associés, sans que, pourtant, cette opinion plus favorable allât jusqu’à l’estime du personnage. Il suffisait donc d’écarter ce dernier, de lui signifier son congé, sans qu’il fût nécessaire de le supprimer.
Lorsque Wagha-na fit connaître les prétentions de Sourbin à la main de Madeleine, c’est-à-dire à son héritage, un rire convulsif secoua ses deux interlocuteurs. O’Connor éclata :
– En vérité, j’aimerais mieux, à mon âge, contracter mariage avec la plus laide squaw du pays des Apaches que de laisser ce polisson entrer dans la tente de notre fée.
– Et moi, ajouta Cheen-Buck, je consens à faire toute ma vie la cuisine pour les Yankees, si notre fée accorde seulement un regard d’attention à cet affreux drôle.
Wagha-na partagea leur hilarité et leur confia de nouveau la mission de veiller sur Madeleine. D’ailleurs, il avait pris le soin d’en informer la jeune fille qui ne mit aucun obstacle à cette mesure de précaution.
– Une balle de carabine est vite venue, – avait dit sentencieusement l’Indien.
Il était donc naturel que, proche la frontière américaine, Wagha-na redoublât de prudence et se tint sur le qui-vive.
Or, le lendemain du jour où le dernier buffle avait été abattu, on s’aperçut, au camp, que les deux compagnons Ulphilas Pitch et Gisber Schulmann qui, jusque-là, s’étaient laissé voir chaque jour, avaient définitivement disparu.
– Qu’augurez-vous de cela ? demanda le Bison Noir à ses conseillers habituels.
– Je n’en augure rien de bon, répliqua Joë O’Connor.
– Ils ont sans doute passé la frontière, ajouta Cheen-Buck.
Wagha-na hocha la tête.
– Oui, ils ont passé la frontière, et c’est là justement qu’est le danger. Il existe, si je ne me trompe, un règlement particulier des États de l’Ouest qui interdit aux Indiens réfractaires de s’approcher à plus de trois milles des limites. Or, nous n’en sommes pas à un mille. Je gagerais que ces coquins sont allés prévenir la garnison de quelque poste et que nous allons avoir sur les bras toute une compagnie de volunteers Riflemen.
– Ils passeraient la frontière eux-mêmes, en ce cas, s’écria Vernant, présent à l’entretien. Ce serait une violation flagrante de territoire.
– Oh ! ce n’est pas ce qui les gêne ! ricana Cheen-Buck.
– Mais nous serions dans le cas de légitime défense ?
– Cela ne nous empêcherait pas de recevoir leurs balles, mon cher enfant, fit tristement Wagha-na. Et nous n’en aurions aucun profit. Le gouvernement du Dominion se garderait bien de faire droit à notre plainte. Le Canada n’est point encore assez fort pour lutter contre ses puissants voisins, et l’Union suscite toutes les occasions de conflit pour agrandir son territoire au détriment du nôtre.
Et, avec un soupir, il ajouta :
– D’ailleurs, nous sommes Indiens et, en majeure partie, catholiques. Nous n’avons pour nous que la population d’origine française, qui s’accroît beaucoup trop vite pour ne point porter ombrage au Saxon jaloux. Or, celui-ci est partout le même, et peu importe qu’il habite en deçà ou au delà du Saint-Laurent et des lacs.
Tout le monde se rendit à la justesse de ces remarques, et l’ordre de retraite immédiate fut aussitôt donné.
Toutefois, comme la contrée, était sillonnée par le passage d’innombrables gibiers à poil et à plumes regagnant les régions plus chaudes du midi, Wagha-na consentit à ce que la retraite s’opérât par les montagnes.
On s’engagea donc sur la montée de la chaîne.
Les monts Rocheux, qui commencent au Mexique pour se terminer à l’archipel fragmenté des Aléoutiennes, ainsi que les vertèbres d’une immense épine dorsale, ne sont que la continuation le long du Pacifique, et à travers le continent Nord-Américain, de la puissante chaîne des Andes. De même que les Cordillères soutiennent tout le triangle méridional, les montagnes Rocheuses, avec leurs divers noms espagnols qu’elles ont conservés, malgré la conquête Anglo-Saxonne, supportent à l’est l’immense développement de plaines qui durent émerger des eaux le jour où l’Atlantide, célébrée par Platon, disparut dans les gouffres glauques.
Elles comptent, au nombre de leurs pics, de moyenne hauteur, des volcans en pleine activité dont un seul, le mont Saint-Élie, appartient à l’Amérique Russe, aujourd’hui rachetée par les États-Unis, et les autres, Chimborazo, Jorullo, Popocatepeltl, se trouvent disséminés sur les contreforts californiens et mexicains.
Le reste de la chaîne, à peu près inexploré, possède, çà et là, quelques orifices ignivomes et de nombreuses sources d’eau chaude, des geysers, des puits de naphte et de bitume. Le royaume du feu n’est guère éloigné de la croûte terrestre en cet endroit.
Celle-ci justifie le nom qui a été donné à la longue extumescence des roches pyrogènes.
La chaîne, en effet, est la plus sinistre, la plus tourmentée qui se puisse voir.
Nulle part ailleurs, les secousses du globe n’ont amoncelé pareil chaos de ruines plutoniennes. Ce ne sont que blocs géants, entassés pêle-mêle en d’invraisemblables équilibres, que cassures vives et tranchantes, que déchirures béantes.
Ce fut dans ce dédale de blocs éboulés que s’engagea la colonne.
– Du moins, – avait dit Wagha-na, – si la fantaisie vient aux Yankees de nous attaquer sur notre propre territoire, serons-nous en mesure de nous défendre.
Il donna donc le conseil aux Sioux de renvoyer en avant la majeure partie de leur troupe.
Ce conseil fut ponctuellement suivi. Il ne resta guère que cent ou cent dix hommes autour des quarante compagnons du Bison Noir, et ceux-ci s’élancèrent en avant sur les versants de la montagne.
On monta sans arrêt jusqu’à un niveau de deux mille mètres, à travers d’âpres vallées, de sombres gorges qu’éclairait, de temps à autre, la brusque apparition d’un site plein de verdure lumineuse. On franchit des torrents impétueux, des chutes pleines de fracas et d’épouvantes. On atteignit ainsi une sorte de ligne de faîte sur laquelle bêtes et gens purent enfin assurer leurs pas.
Et, chemin faisant, ainsi qu’on l’avait prévu, il y eut de beaux coups de fusil.
Dans une seule matinée, Vernant, O’Connor, Sheen-Buck et une vingtaine d’Indiens, rapportèrent au campement provisoire plus de quatre-vingt-dix hérons ou grues couronnées, ce qui fournit à la colonne deux succulents repas. Le lendemain, les mêmes carabines, chargées à plomb, cela va sans dire, abattirent deux cent cinquante têtes de canards sauvages, surpris dans les joncs d’un lac aux eaux glacées. Le troisième jour, ce fut un véritable massacre de perdrix grises, de cailles, de vanneaux, et Léopold Sourbin, qui s’était mis de la partie, compta trente-deux pièces pour son propre compte.
Le cousin de Madeleine ne s’était jamais vu à pareille fête.
Aussi insista-t-il avec les Indiens auprès de Wagha-na, afin que l’on prolongeât de quelques heures le séjour en cette terre de promission.
Le Bison Noir fit d’abord un assez froid accueil à cette demande. Tout lui conseillait la prudence, et, si l’on s’était rejeté plus à l’ouest dans la montagne, on n’était point encore sorti de la limite de trois milles assignée aux courses Indiennes par les conventions internationales.
Il avait donc hâte de se mettre entièrement sous le couvert de la plus stricte légalité.
Mais les prières des Indiens furent si pressantes qu’il se laissa ébranler dans sa méfiance.
De plus, ses yeux, en interrogeant le visage de Sourbin, n’y démêlèrent aucune arrière-pensée. S’il y avait un complot ourdi par les deux coquins Pitch et Schulmann, il était patent que le cousin de Madeleine n’y entrait pour aucune part.
Wagha-na permit donc de prolonger d’un jour l’étape dans la montagne, mais à la condition qu’on se porterait, dès ce délai écoulé, d’un mille de plus au nord du point où l’on venait de s’arrêter.
Les chasseurs, joyeux, s’élancèrent dans toutes les directions.
Madeleine, emportée par son ardeur de chasseresse, réclama à son père adoptif l’usage de sa liberté.
Après quelques instants de résistance, Wagha-na céda sur ce point comme il avait cédé sur l’autre, mais en renouvelant à Joë et à Sheen-Buck ses recommandations des jours précédents.
Lui-même, accompagné de Georges Vernant, suivit de très près la colonne à laquelle s’était jointe Madeleine.
Celle-ci était composée des plus braves ou, pour mieux dire, des plus aventureux parmi les Indiens.
Elle s’élevait au chiffre restreint d’une dizaine de chasseurs, que la présence de Madeleine, de Sheen-Buck et d’O’Connor portait à treize, nombre de mauvais augure, ainsi que le fit remarquer Léopold Sourbin en personne.
– Eh bien ! – dit Wagha-na, en riant, – joignez-vous à eux ; vous serez quatorzième.
Depuis quelques jours, en effet, les sentiments de l’Indien à l’égard de Léopold avaient changé.
Depuis longtemps il l’observait et il était arrivé à cette conclusion que le fils de l’assassin d’Yves Kerlo n’était point une nature foncièrement perverse. En outre, soutenu par l’espoir d’épouser sa cousine, l’aventurier était le premier intéressé à la conservation de celle-ci. Nul gardien ne pouvait donc être plus vigilant que lui.
Mais, pour répondre au regard étonné que lui adressa Vernant, il lui expliqua les motifs de sa conduite.
Il ajouta :
– Au surplus, le proverbe français ne dit-il pas : « Deux sûretés valent mieux qu’une » ? Pour nous y conformer, mon cher Georges, nous allons surveiller nous-mêmes ce surveillant intéressé.
Et, suivi du jeune homme, il se rapprocha vivement du groupe des chasseurs.
Ceux-ci, après avoir gravi une pente fort raide, s’étaient rassemblés sur une sorte de plateau, après lequel commençait une longue descente plus raide encore, longue d’un mille environ, au bout de laquelle, dans le creux d’une exquise vallée, scintillait un lac aux eaux bleues et limpides.
Sur les bords de ce lac, un véritable troupeau d’antilopes pâturait à son aise.
Attirés par ce spectacle, les chasseurs, Madeleine en tête, avaient descendu la pente au galop.
Soudain, comme ils atteignaient à leur tour le plateau, Wagha-na et Georges les virent revenir sur leurs pas, donnant les signes d’une vive terreur.
VIII
LES GRIZZLYS
Que se passait-il donc de l’autre côté du versant ?
Ni Georges, ni le Bison Noir n’eurent la patience d’attendre qu’on les rejoignît.
Poussant vivement leurs chevaux, ils atteignirent les fuyards. D’un mouvement nerveux, Wagha-na saisit par la bride le cheval le plus rapproché et, interrogeant le cavalier avec une sorte de violence :
– Que se passé-t-il donc ? – demanda-t-il. – Êtes-vous tous des lâches, où avez-vous, été pris d’une folie soudaine ?
L’Indien, honteux, mais tout tremblant d’émotion, trouve à peine la force de répondre :
– Grizzlys.
Ce mot, si plein d’une signification terrible, suffisait à expliquer la panique.
Sans en entendre davantage, Wagha-na et Georges continuèrent à descendre l’effroyable pente.
Ce qu’ils virent alors aurait dû les glacer d’effroi si leurs cœurs eussent été capables de crainte.
Le dangereux sentier du versant, presque au point où il débouchait dans la vallée, s’engageait entre des roches éboulées formant de chaque côté comme une muraille, haute de six à sept mètres. C’était là un véritable défilé, long de deux cents toises, la plus naturelle et la mieux disposée des embuscades et qui, par un temps de guerre, eût pu fournir à des soldats, retranchés derrière ces parapets, la plus inexpugnable des défenses.
Or, sur les pierres de ce double rempart, apparaissaient, descendant avec précautions de roche en roche, six ours gris de taille gigantesque, qui n’étaient peut-être, eux-mêmes, que l’avant-garde d’une armée.
Ils s’étaient évidemment embusqués sur ce point afin d’y surprendre les antilopes.
L’arrivée des cavaliers, en troublant leur embûche savamment ourdie, les avait mis en fureur, et, maintenant, c’était à ces fâcheux inattendus que s’en prenait leur rage.
La situation était vraiment terrible.
Les Indiens qui escortaient Madeleine avaient, pour la plupart, aperçu le danger avant de s’engager dans l’étroit corridor des roches. Ils avaient donc arrêté leurs bêtes et rétrogradé. Leurs cris et leurs signaux étaient parvenus trop tard aux sept qui avaient franchi le périlleux passage.
À cette heure, ceux-ci ne devaient plus songer à battre en retraite par le même chemin.
Six ours grizzlys suffiraient à arrêter une compagnie de voltigeurs. Que pouvaient donc contre eux une poignée de cavaliers qui auraient eu à soutenir un choc presque individuel ?
L’ours gris est, en effet, l’un des animaux les plus redoutables de la création ; et les trappeurs américains le tiennent pour beaucoup plus terrible que le lion ou le tigre. À la vérité, il n’a pas, comme les grands félins de l’Afrique et de l’Asie, le ressort d’acier qui les fait bondir et rend leur choc irrésistible ; il ne peut grimper aux arbres comme le léopard et la panthère. Mais il possède une effroyable vigueur et, debout sur ses pattes de derrière, il peut saisir la tête d’un cheval. On en a vu arrêter des bisons mâles à la course en les étreignant de leurs énormes bras.
Longs et maigres, ils mesurent souvent trois mètres cinquante du museau à la naissance de la queue. Leurs os saillants, leurs larges poitrines, leurs gueules monstrueuses, leurs yeux sanglants ajoutent encore à la terreur qu’ils inspirent.
Ce n’est pas tout. Comme tous les plantigrades, les grizzlys ont « la vie dure ». Quelques-uns ont lutté avec courage bien que percés de plus de dix-huit balles. Et ce qui contribue à rendre plus fâcheuse leur rencontre, c’est la rapidité de leur course. Ils peuvent, en effet, suivre un cheval au trot. Tout homme à pied est perdu, s’il se fie à la vitesse de ses jambes. Plus que contre tout autre fauve, il doit conserver son sang-froid afin de ne point perdre la balle qu’il lui destine et qui ne le tue qu’en frappant entre les yeux ou au défaut de l’épaule.
Tels étaient les effrayants animaux avec lesquels Madeleine et ses compagnons allaient se trouver aux prises.
Encore si, pour revenir, ils avaient trouvé le chemin libre !
Mais, outre que la retraite leur était coupée, le chemin horrible, montueux, glissant, semé de rocailles, n’aurait pas permis aux chevaux d’y soutenir une allure rapide. Il était déjà presque fabuleux que la petite troupe eût pu descendre sans encombre une côte aussi déclive.
Ils ne pouvaient donc que fuir dans l’autre direction, c’est-à-dire vers la vallée et le petit lac où, naguère, s’abreuvaient les cerfs dont la vue avait surexcité leur ardeur cynégétique.
Mais cette vallée elle-même, leur offrait-elle un refuge assuré ?
De la place où ils se trouvaient, Wagha-na et Georges ne pouvaient s’en rendre compte. Et quant à s’engager à leur tour dans le défilé, ils ne devaient point y songer. C’eût été de leur part une bravade aussi inutile que téméraire.
Trois des ours avaient atteint déjà les roches les plus basses. Un autre prenait pied sur le sentier avec un grognement féroce comme pour inviter ses congénères à le rejoindre au plus tôt.
Les cavaliers n’auraient pas franchi trois mètres sans être happés au passage. Wagha-na arrêta son cheval.
– Ne bouge pas, Gola, bonne bête, – lui dit-il. – Tu n’as rien à craindre de cette vermine. Tu sais bien que ton maître ne t’abandonnera pas, bon cheval.
Il lui parlait comme il eût parlé à une créature humaine.
Et, véritablement, le noble, animal parut le comprendre. Bien qu’il tremblât de tous ses membres et qu’une sueur froide glaçât sa belle robe dorée, il demeura immobile, à moins de cent mètres des fauves, comme si ses fins sabots se fussent incrustés dans le roc.
Le Bison Noir mit pied à terre.
– Je vous conseille d’en faire autant, – dit-il à Vernant, surpris.
Lorsque le jeune homme l’eut imité, Wagha-na adressa à Hips un discours analogue à celui qu’il venait de tenir à sa propre monture. Hips se conforma à ce paternel avertissement.
Alors l’Indien décrocha de sa ceinture un cor d’ivoire finement ciselé et en tira trois ou quatre sons perçants.
C’était un appel de ralliement jeté aux Indiens qui chassaient dans la montagne.
Les sept compagnons qui avaient fui, revenus de leur terreur, s’étaient rapprochés de leur chef et avaient suivi son exemple.
Wagha-na expliqua sa pensée.
– Il n’y a qu’une tactique à suivre avec ces brutes : tâcher de les attirer sur nous, afin de permettre aux autres de revenir.
Les neuf hommes marchèrent donc, la carabine au poing, au-devant des féroces plantigrades.
Ceux-ci étaient déjà au nombre de trois sur le chemin. Les trois autres continuaient leur descente.
Au moment où ils avaient entendu les sons du cor de l’Indien, les ours avaient donné quelques signes de terreur. Bientôt, comme sollicités par une bravoure soudaine, ils se retournèrent et vinrent, d’un trot lourd, mais rapide, au-devant de leurs assaillants.
– Attention ! – commanda Wagha-na. Il s’agit de les attirer le plus loin possible sur la montée. Faisons donc retraite sur nos chevaux. Avec eux, nous n’avons rien à craindre.
La manœuvre était fort simple. En voyant reculer leurs ennemis, les Grizzlys s’enhardirent. Puis, pris tout à coup d’une aveugle fureur, ils accélérèrent leur course, avec des grondements si terribles que les chevaux des Indiens, moins aguerris que Hips et Gola, dont ils avaient pourtant imité la courageuse attitude, se mirent à renâcler, à souffler violemment, à se cabrer, ce qui alarma Wagha-na.
– Tenez vos bêtes ! – cria-t-il d’une voix vibrante.
L’ordre était plus facile à donner qu’à exécuter. Les Indiens cependant parvinrent à maîtriser les animaux fous de terreur.
Cependant les ours gagnaient du terrain. Ils n’étaient pas à plus de deux cents pas, lorsque le Bison Noir, saisissant sa carabine, pourvue de balles à pointes d’acier, l’épaula, en criant derechef à ses compagnons :
– Visez bien ! Il s’agit de ne pas perdre une seule charge. Si nous avions ces trois-là du premier coup, le reste ne serait plus qu’un jeu. Allons ! Je le répète : visez bien.
L’étroitesse du chemin ne permettait point malheureusement aux neuf hommes de tirer en même temps.
Les quatre premiers seuls, parmi lesquels se trouvaient Wagha-na et Georges Vernant, firent feu simultanément.
Deux balles atteignirent le premier des animaux, celles du jeune Français et du Bison Noir. Toutes les deux le frappèrent aux bons endroits. Wagha-na avait visé le front.
Frappé au front et au cœur, le monstre tomba foudroyé.
Les deux compagnons ne reçurent que des projectiles de plomb, l’un dans le cou, l’autre à l’une des pattes de devant.
Alors, soit que cette fusillade les eût effrayés, soit que la vue de leur frère mort leur inspirât de salutaires réflexions, les lourdes bêtes se détournèrent brusquement et se mirent à fuir sur la pente précipitée, où les avaient devancés déjà leurs congénères.
– Hardi ! – cria Wagha-na en plaçant de nouvelles cartouches dans le magasin de son arme belge, conforme au modèle français, – hardi, vous autres. Ne les laissez pas échapper.
Les cinq Indiens qui n’avaient point encore tiré firent feu à leur tour.
Peines perdues ! Bien que tous les coups eussent porté, les ours n’étaient atteints que par derrière. Cette décharge ne fit qu’accélérer leur course vers la vallée.
Le Bison Noir fut saisi d’une profonde terreur.
– Je connais l’ours, – dit-il. – Pour que ceux-ci soient pressés de fuir comme ils le font, contre toutes leurs habitudes, c’est qu’évidemment il doit y en avoir d’autres dans la vallée.
– Et Madeleine ! – s’écria Georges étranglé par la douleur.
– Oui, Madeleine, – répondit l’Indien. – Il faut la sauver à tout prix.
D’un geste qui compléta sa pensée il montra au jeune homme le double parapet des roches.
En cet endroit, elles formaient une sorte d’escalier cyclopéen. C’était par cet escalier que les ours étaient descendus.
Georges n’en entendit pas davantage.
D’un bond, il gravit la première marche, immédiatement accompagné par le père adoptif de la jeune fille.
En quelques élans, ils eurent gagné la crête du remblai déroches. De là, leur vue embrassa un assez vaste horizon et ils purent se rendre compte de toute la scène qui se déroulait sous leurs regards.
À leurs pieds se creusait la vallée, longue à peine de deux kilomètres, large au plus de huit cents mètres. Au centre s’étendait le petit lac bleu, ombragé de saules, de cyprès et de platanes. Alentour, les pentes se voilaient d’une végétation superbe, mais que le Nord avait déjà touchée de son haleine glaciale.
Au delà s’ouvrait un second couloir analogue à celui qu’ils venaient de parcourir et qui devait mettre la vallée en communication avec d’autres semblables, car on pouvait, à distance, voir moutonner, par derrière les roches grises qui trouaient l’humus, tout un flot de frondaisons jaunissantes.
Et dans cet étroit espace, six cavaliers groupés ensemble semblaient interroger l’horizon environnant.
Wagha-na ne s’était pas trompé. Il n’avait que trop bien deviné la cause de la retraite des ours.
De l’autre côté de la vallée, cinq nouveaux grizzlys, aussi énormes que les premiers, sortaient du milieu des arbres et s’avançaient au petit trop vers les cavaliers.
– Cinq et cinq font dix ! – prononça le Bison Noir. Et ce truisme ainsi prononcé n’avait rien de ridicule. Il prenait, au contraire, une terrifiante signification en présence de l’attaque des monstrueuses bêtes. D’autant plus qu’avec le même ton de découragement, l’Indien ajouta :
– Ils sont six en tout.
Mais, chez un tel homme, le découragement ne pouvait être de longue durée.
– Peut-être, – dit-il, – aurons-nous le temps d’en abattre un ou deux au sortir du défilé ?
Et, toujours accompagné de Georges Vernant, bondissant de roche en roche, ils parvinrent ainsi aux derniers blocs surplombant la vallée. De là, ils pouvaient être vus par les cavaliers et même échanger quelques paroles avec eux.
– Joë, – appela le Bison Noir.
Le vieux trappeur, qui se tenait aux côtés de Madeleine, se retourna.
– Profitez du passage au moment où il sera libre, – cria Wagha-na, en montant le défilé !
L’Irlandais comprit. Trois des six cavaliers se tournèrent vers l’orifice du défilé, pendant que les trois autres faisaient face aux assaillants de la vallée.
Contre ces derniers, la défense était plus aisée.
Ils ne pouvaient, en effet, venir à l’attaque qu’après avoir contourné le petit lac, ce qui permettait aux assaillis de les fusiller à leur aise, puis de se dérober par le défilé, si le passage en était libre.
Mais là gisait toute la difficulté. Il fallait que ce paysage fût libre.
Déjà Wagha-na et Georges Vernant avaient tourné l’extrémité du détroit rocheux et, descendant le plus bas possible, s’efforçaient d’attirer sur eux l’attention des Grizzlys, afin que, renonçant à la poursuite des cavaliers, ils permissent à ceux-ci la fuite, par le chemin qu’ils venaient de parcourir.
En un clin d’œil les deux hommes se dressèrent, au milieu de l’éboulis, de manière à prendre d’enfilade la longueur du couloir au moment où les fauves apparaîtraient.
Ils n’eurent pas longtemps à attendre. Presque simultanément, trois têtes affreuses se montrèrent.
Les deux coups de feu éclatèrent en même temps.
C’étaient de merveilleux tireurs que Georges Vernant et le Bison Noir. Les balles à pointe d’acier trouvèrent chacune un ours au bout de leurs trajectoires et deux bêtes s’abattirent, l’une, le cœur troué, l’autre le crâne fracassé.
Il en restait deux autres. Joë O’Connor, Sheen-Buck et Léopold Sourbin, très crâne devant ce danger inévitable, les frappèrent à la course.
– Dieu soit loué ! – s’écria Wagha-na – la route est libre maintenant.
Les six cavaliers n’avaient point attendu cette exclamation pour s’élancer vers le défilé.
Il y avait bien encore une difficulté.
Des cinq grizzlys ainsi fusillés, deux n’étaient point tout à fait morts, et leurs grands corps, renversés sur le flanc obstruaient le passage. On les voyait se soulever péniblement, avec de douloureux efforts pour se redresser.
– Il faut passer tout de même, – cria énergiquement Madeleine.
Et, enlevant vigoureusement sa bête, la vaillante jeune fille montra le chemin à ses compagnons.
Mais ceux-ci ne voulurent pas la laisser affronter la première la périlleuse traversée.
Sheen-Buck s’élança en avant, prenant la tête. Cavalier incomparable, il franchit d’un bond le corps du plantigrade le plus rapproché. Après lui passa Léopold, qui avait un peu le droit de se prendre pour un héros. Puis ce fut le tour de l’Indien et de Joë. Madeleine fermait la marche.
Dans le fond de la vallée, les cinq autres grizzlys avaient précipité leur course et atteignaient déjà les bords du lac.
Alors se produisit un incident tout à fait inattendu et qui renouvela toutes les terreurs.
Au moment même où Madeleine, donnant du champ à sa monture, s’apprêtait à franchir l’obstacle à son tour, la jument eut une grande secousse de tout son corps et s’affaissa sur les genoux, comme si elle eût butté des pieds de devant.
Mais la détonation d’un coup de feu ne laissa aucun doute sur la cause de sa chute. Le pauvre animal tombait sous la balle d’un tireur maladroit, balle destinée sans doute à l’ours blessé qui, par un suprême effort, venait de se remettre d’aplomb sur ses pattes et, sanglant, la gueule entr’ouverte, s’avançait vers la jeune fille désarçonnée.
Madeleine était tombée, sans se blesser heureusement. Elle était debout maintenant, épaulant l’arme élégante que son père adoptif avait fait confectionner spécialement pour elle.
La balle ne fit au monstre qu’une blessure insignifiante qui accrut sa rage.
Mais une autre détonation coïncida avec la décharge de la petite carabine.
C’était Wagha-na qui avait tiré.
Chose étrange ! Il n’avait point tiré sur l’ours.
On l’avait vu se tourner vers le mur de roches formant l’épaulement opposé du défilé. Quand la fumée se dissipa, on put voir une silhouette humaine disparaître rapidement derrière les blocs que domina une seconde un bonnet de fourrure.
Ce bonnet de fourrure avait été une révélation pour Wagha-na.
Debout sur une roche et montrant la muraille cyclopéenne qui lui faisait face, il cria :
– Cent livres à qui m’amènera cet homme, mort ou vif.
Les Indiens qui descendaient la pente, abandonnèrent leurs chevaux et se ruèrent à l’assaut de l’escalier titanique.
Cependant, dans la vallée, la situation de Madeleine était devenue critique.
L’ours, quoique grièvement blessé, avait encore assez de forces pour broyer la jeune fille et la déchirer. Il s’avançait, péniblement sans doute et par soubresauts, mais il gagnait du terrain, et la pauvre enfant se trouvait prise entre cet adversaire redoutable et les cinq grizzlys de la vallée qui hâtaient leur course et dont le plus rapproché n’était pas éloigné de plus d’une centaine de mètres.
Elle était donc perdue si quelque prompte intervention ne l’arrachait à cette épouvantable alternative.
Par bonheur, Georges Vernant avait pu juger d’un seul coup d’œil la situation.
S’adossant au pan de rochers, haut, sur ce point, de huit à dix mètres et assez lisse, il se raidit et se laissa couler, les pieds en avant, en élevant sa carabine au-dessus de sa tête.
En touchant le sol de la vallée, il bondit à la rencontre de l’ours.
Il ne fallait pas songer à faire usage d’une arme à feu. Le moindre tremblement de la main pouvait être mortel pour Madeleine elle-même, que la balle aurait pu atteindre, ne fût-ce qu’en ricochant sur la paroi de granit.
Tenant donc sa carabine de la main gauche, Georges brandit de la droite la hache à manche court qui ne quitte jamais l’Indien des prairies et le trappeur des forêts.
Ce fut pour les spectateurs de cette scène émouvante une minute d’indicible angoisse.
Debout, le couteau de chasse à la main, l’intrépide Madeleine attendait le choc du monstre.
Elle vit venir du même œil le péril et le secours.
L’animal était à bout de force. Mais quelque obscur instinct, quelque sombre fureur de vengeance le soutenait encore, sans nul doute. Son attaque n’en devait être que plus terrible.
Essoufflé par la course qu’il venait de faire, Georges Vernant ne put que jeter un mot à la jeune fille.
– À droite !
À droite, c’est-à-dire vers la muraille de granit dans laquelle s’ouvrait un enfoncement suffisant pour permettre à Madeleine, en s’y blottissant, d’échapper à l’étreinte désespérée du grizzly.
Elle entendit l’avis salutaire. D’un seul élan, elle se jeta dans la fente.
Il était temps. Déjà l’ours s’était dressé sur ses pattes de derrière, énorme, aussi haut qu’un cheval. Il retomba avec un rugissement de rage impuissante sur la paroi de granit que rayèrent ses griffes furieuses.
Mais avant qu’il eût touché terre, Vernant s’était rué sur lui.
D’une main sûre et d’une vigueur herculéenne, la hache fut envoyée sur la nuque épaisse de l’animal. Telle fut la force du coup que le fer s’enfonça profondément entre les vertèbres cervicales. Le grizzly s’abattit comme une masse, pareil à un bœuf sous le maillet de l’abattoir.
Alors, saisissant la jeune fille dans ses bras d’athlète, Georges l’emporta comme il eût fait d’un enfant sur la raide montée.
– Madeleine, – lui dit-il en la déposant, – puis-je vous dire aujourd’hui que je vous aime ?
Elle ne répondit pas, mais elle sourit en lui serrant la main.
IX
BLANCS ET ROUGES
Tout le monde était sauf. On n’avait eu à déplorer que la perte d’un cheval. Mais cette perte était fort sensible à Madeleine qui pleura devant le cadavre de sa belle jument, lâchement tuée par une balle qui était peut-être destinée à la jeune fille elle-même.
Bien entendu, à partir de ce moment, la chasse fut abandonnée. On se borna à accueillir à coups de fusils les cinq grizzlys retardataires, lesquels, de leur côté, ne s’obstinèrent point dans une attaque aussi chaudement reçue, et regagnèrent leurs cavernes, emportant quelques balles dans leurs puissantes musculatures.
On les laissa opérer leur retraite sans les inquiéter davantage. On avait hâte de se rassembler dans la plaine, loin de ces dangereux parages, afin d’y commenter les incidents de cette journée féconde en émotions.
Le dépouillement des cadavres retint encore une heure environ les chasseurs sur le théâtre du drame. Après quoi, l’on se mit en quête d’un campement pour la nuit. Heureusement que les divers groupes disséminés dans la montagne rentrèrent chargés de butin et que le repas du soir, déjà assuré par les chasses des jours précédents, fut abondamment pourvu de viande fraîche.
On dressa donc les tentes à portée de fusil des premiers versants. Par mesure de prudence, Wagha-na disposa sa troupe en colonne de guerre, et plaça des sentinelles à toutes les extrémités du camp.
Et comme Georges l’interrogeait sur les motifs qui lui inspiraient ces mesures de prévoyance :
– Mon cher enfant, – répondit le Bison Noir, – il s’est passé aujourd’hui des choses si extraordinaires que la plus méticuleuse prudence s’impose à nous. Nous devons être prêts à tout événement.
– Oui, je sais, – fit Vernant, – vous faites allusion à ce coup de feu maladroit et à ce bonnet de fourrure entrevu par vous ?
– S’il n’y avait là qu’une maladresse, vous ne me verriez point aussi préoccupé, mon cher Georges. Cette balle était celle d’un ennemi. Je ne dis pas que cet ennemi ait voulu tuer Madeleine, mais il la frappait indirectement, puisque, en tuant le cheval, c’est-à-dire en lui ôtant les moyens de fuir, il la livrait aux dents et aux griffes du grizzly.
– Et l’on n’a pas pu s’emparer du misérable ?
– Malheureusement non. L’homme s’est enfui avec une rapidité étonnante. Il a gagné un bouquet de pins sous lesquels il s’est perdu aux regards de ceux qui le poursuivaient.
– Il faudrait pourtant s’en assurer. Qui soupçonnez-vous ?
– Je soupçonne les deux Yankees que vous savez. Ces deux coquins préméditent depuis longtemps un mauvais coup. Hier, ils ont failli l’accomplir. Madeleine morte, sa succession était ouverte, comme jadis celle de son père. Et vous vous expliquez maintenant les causes de cet attentat.
– Oui, je me l’explique, – murmura Vernant, dont la main se crispa sur la poignée de son revolver. – Mais cela ne s’accomplira pas, s’il plaît à Dieu ! J’aurai plutôt la tête de ces deux scélérats.
– Ce n’est pas tout, – continua Wagha-na.
– D’autres indices m’ont frappé. Ces ours…
– Ces ours ? – interrompit le jeune homme.
– Que voulez-vous dire ? Ce n’étaient pas des complices, à coup sûr ?
Le Bison Noir eut un fin sourire.
– Au contraire, mon cher Georges, et beaucoup plus que vous ne pourriez le croire. Complices inconscients, cela va sans dire, mais qui ont joué leur rôle à merveille.
– Je ne vous comprends pas.
– Vous allez me comprendre. L’ours, le grizzly surtout, ne va jamais par bandes. Il est même très rare d’en rencontrer une famille chassant en commun. Il faut donc, pour que nous en ayons trouvé onze assemblés, qu’ils aient obéi à la fois à un mot d’ordre et à une poussée du dehors. Le mot d’ordre, cela va sans dire, a été donné à leurs meneurs. Pour les attirer sur le même point, il faut que, de directions opposées, on les ait rabattus sur nous, en même temps que l’on lançait devant eux le troupeau d’antilopes qui excita la convoitise de nos imprudents chasseurs.
– Ainsi, vous supposez.
– Je suppose, – je dirai même que c’est une certitude en mon esprit, – que cinquante ou soixante rabatteurs, pour le moins, ont envahi la montagne et formé un vaste cercle à dessein de pousser sur nous, les fauves.
Georges Vernant était renseigné. Aussi s’expliqua-t-il que les ordres très rigoureux de Wagha-na fixassent le départ de la colonne pour le lendemain à la première heure du jour.
Agréé par Madeleine en qualité de fiancé, il avait obtenu d’elle et de Wagha-na la faveur de s’attacher aux pas de la jeune fille qu’il entendait ne plus quitter, maintenant qu’il savait de quelle sorte de périls elle était menacée.
À l’aube, on plia les tentes. Puis Wagha-na distribua sa troupe à l’instar d’une petite armée. Cinquante cavaliers Sioux prirent la tête, formant une solide avant-garde ; quatre-vingts fermèrent la marche. Dans la troupe centrale fut placée Madeleine que flanquaient Sheen-Buck et Joë O’Connor, et que Georges Vernant précédait de quatre à cinq pas.
Léopold Sourbin était venu se placer aux côtés du jeune Français Canadien.
Depuis les événements de la veille, Léopold prisait très haut sa propre bravoure. Peu s’en fallait qu’il ne se plaçât sur un pied d’égalité avec l’intrépide jeune homme dont tout le monde avait pu admirer l’héroïsme.
Quelque bonne opinion que Sourbin eût de la constance avec laquelle il avait supporté l’indicible terreur que lui avait causée la présence des ours, il avait cependant une vague conscience de la supériorité physique et morale de Georges Vernant et n’était pas fâché de s’approcher de lui, ne fût-ce que pour profiter des reflets de sa gloire.
Celui-ci éprouvait des sentiments diamétralement opposés à l’égard du cousin de Madeleine, et il ne prenait aucun soin de les lui dissimuler.
Aussi, lorsque l’aventurier eut poussé son cheval botte à botte avec lui, Vernant ne put-il se défendre d’une rudesse que justifiaient les circonstances et surtout les apparences défavorables à Léopold.
– À propos, monsieur Sourbin, – lui dit-il à brûle-pourpoint, – que sont devenus vos amis ?
– Quels amis ? – demanda naïvement l’interpellé, qui n’avait pu s’empêcher de tressaillir.
– Mais ces deux gredins qui nous ont suivis, ces deux Yankees de mauvaise mine ?
– Vous appelez ça mes amis ? – répliqua le Français avec une moue dédaigneuse. – Mais, Monsieur, je n’ai jamais eu que des relations d’affaires avec ces gens-là. Je ne m’enquiers pas de leurs faits et gestes.
– Vous avez tort, – répliqua brutalement Georges. – Vous feriez mieux de vous en enquérir, car ce sont deux misérables coquins, auxquels je casserai la tête à notre première rencontre avec eux.
Pour le coup, cette vigoureuse assurance donnée par Vernant réjouit l’âme de Léopold.
Il éclata d’un rire aigu, qui témoignait d’une satisfaction profonde.
Parbleu ! mon cher Monsieur, – avoua-t-il, – ce n’est pas moi qui les défendrai.
Et, voyant que son interlocuteur attachait sur lui un regard malgré tout surpris, il s’empressa de rectifier ses paroles en ce qu’elles paraissaient révéler d’égoïsme satisfait.
– Si je vous parle ainsi, ce n’est pas que le procédé ne me semble un peu vif. En France, nous nous en remettons à la justice du soin d’exécuter les criminels. Mais je ne doute pas que vous n’ayez de bonnes raisons pour vous guider, et c’est pour cela que, sans vous approuver entièrement, je ne me jetterai pas à la traverse de vos intentions.
– Vous auriez grand tort, en effet, de le faire, – répliqua Georges avec la même rudesse de ton et d’expression. – Vous ne les sauveriez pas et, dans la bagarre, il pourrait vous arriver d’attraper des horions.
La conversation tournait à l’aigre, et force était bien à Léopold de reconnaître que son compagnon de route, jusque-là d’une rare urbanité, était devenu peu liant.
Un incident, imprévu pour tous, sauf peut-être pour Wagha-na, y mit un terme.
On vit revenir tout à coup une dizaine des cavaliers de l’avant-garde.
Le Bison Noir n’attendit pas qu’ils l’eussent rejoint. En un temps de galop, il se porta au-devant d’eux et recueillit les informations qu’ils lui apportaient. Elles n’étaient rien moins que rassurantes.
Le jeune chef Sioux, qui conduisait le détachement, avait vu brusquement surgir de l’horizon de l’ouest, venant d’une gorge des montagnes, une trentaine de cavaliers américains, armés jusqu’aux dents et portant l’uniforme gris et le chapeau de feutre à plumes de la milice des frontières.
Il avait fait halte et attendu l’arrivée des soldats.
Leur chef, un lieutenant, d’aspect rude et grossier, s’était avancé, les interrogeant avec brutalité.
– D’où venaient-ils ? Que faisaient-ils en ces parages ? Quel était leur chef ?
Le jeune Sioux n’était pas d’humeur endurante. Il avait répondu avec vivacité.
Alors, les voix s’étaient grossies avec les expressions. Les soldats de l’Union, inférieurs en nombre et se trouvant en présence d’adversaires bien armés, avaient baissé le ton, tout en déclarant qu’ils s’opposaient au passage de la troupe et qu’ils feraient appel aux garnisons des forts voisins.
Devant cette attitude hostile, le chef sioux n’avait voulu prendre aucune décision.
Il en avait donc immédiatement référé à celui qu’il tenait lui-même pour son supérieur, à Wagha-na.
À ces nouvelles, celui-ci n’hésita pas. Il fit presser l’allure de la troupe et se trouva en moins d’une demi-heure sur le théâtre de la conférence.
À la vue du formidable renfort que recevaient leurs adversaires, les Yankees ne se sentirent point rassurés.
Wagha-na, accompagné de Georges, de Joë et de Sheen-Buck, sortit des rangs des Indiens et s’avança à quelques pas seulement du détachement américain. En anglais très pur, il engagea le dialogue.
– Que nous voulez-vous, Messieurs ? demanda-t-il poliment.
L’officier répondit avec brusquerie qu’il exécutait les ordres donnés à tous les chefs de stations militaires à rencontre de bandes indiennes non soumises qui se rapprochaient de moins de trois milles de la frontière.
– Je vous ferai remarquer, répliqua le Bison Noir, que nous sommes ici à huit milles au moins de cette frontière et que c’est vous, en ce moment, qui violez le territoire de Sa Majesté Britannique.
La remarque était si juste que le lieutenant parut fort embarrassé.
– Vous n’avez donc rien à faire ici, Messieurs, poursuivit le Bison Noir. Toute persistance de votre part serait une véritable déclaration de guerre à l’Angleterre dont nous sommes les loyaux sujets.
– Les Sioux ne sont point sujets de l’Angleterre, voulut rectifier l’officier. Leurs tribus sont établies officiellement et reconnues par le Congrès de l’Union sur les terres du Dacotah.
– Les Sioux n’ont pas tous accepté d’être citoyens des réserves, répondit le jeune chef avec feu.
L’officier le regarda de travers. La rectification était précise. Mais il n’entendait pas recevoir de leçon en présence de ses hommes.
– Ceux qui n’ont point accepté sont des réfractaires, tenus pour des ennemis.
– Fort bien, Monsieur, concéda Wagha-na. Mais votre remarque n’est fondée, tout au plus, que sur le territoire américain. Or, vous êtes ici en terre anglaise.
– C’est la seconde fois que vous me le dites ! s’exclama le lieutenant bourru.
– Afin de vous rappeler que vous n’avez plus rien à faire ici, et que vous aggravez votre situation en prolongeant votre séjour.
Ces derniers mots parurent irriter les soldats. Plusieurs d’entre eux portèrent ostensiblement la main à leurs fontes ou à leurs ceintures, comme pour y prendre leurs pistolets.
Mais Wagha-na, changeant alors de ton, apostropha sévèrement l’officier.
– Lieutenant, dit-il, vous êtes responsable de ce qui pourra arriver. Ceci est un acte d’hostilité au premier chef. Si vous ne le réprimez pas à l’instant, je vous arrête, vous et vos hommes et je ne me tiendrai pour satisfait qu’après vous avoir remis prisonniers aux autorités canadiennes de Vancouver.
Les Yankees ne répondirent que par de sourdes imprécations.
– En voilà assez, conclut le Bison Noir. Vous avez le temps de regagner la frontière au galop. Toute résistance de votre part serait aussi vaine que coupable. Allons, Messieurs, adieu et sans rancune.
Son geste désignait aux trente agresseurs l’escadron nombreux que formaient derrière lui les cavaliers Sioux.
Le lieutenant rassembla ses hommes. Sans une politesse, sans un salut à l’adresse de ses courtois adversaires, il jeta l’ordre du départ, et le détachement prit la route du Sud dans un nuage de poussière.
– Cette fois, je l’espère, fit Georges Vernant, nous en avons fini avec ces désagréables voisins ?
Wagha-na hocha la tête.
– Rien n’est moins sûr. À vrai dire, ils ne se risqueront point eux-mêmes. Mais il n’en faudrait pas augurer qu’ils ne nous susciteront pas d’autres ennuis.
Et, renouvelant ses ordres, il fit presser encore l’allure de la troupe. On ne la ralentit qu’au bout du trentième mille. Cette fois, la plaine paraissait suffisamment vaste et la distance assez grande de la frontière pour n’avoir plus à appréhender de nouveaux contacts avec les Yankees.
Alors seulement, Wagha-na fit connaître à Georges les dernières craintes qu’il avait conçues.
Cette lutte de l’élément rouge contre l’élément blanc atteint parfois à un degré de férocité inouïe. La haine est égale de part et d’autres, et mille causes secondaires viennent s’ajouter au séculaire antagonisme des races pour lui donner un caractère de sauvagerie inconnue en Europe et même chez les peuples orientaux.
La religion elle-même vient aigrir le conflit et rendre les adversaires plus implacables.
Il est un motif, entre autres, que les blancs invoquent pour justifier leurs propres cruautés et qui, en effet, donne à la guerre une apparence odieuse. C’est l’habitude qu’ont malheureusement conservée presque toutes les tribus indiennes, et qui ne semble pas près de disparaître, de scalper l’ennemi abattu. On sait que l’usage du scalp a cette particularité affreuse de ne point toujours entraîner la mort des victimes. Mais il leur laisse une existence souffreteuse, exposée à toutes les douleurs du système nerveux, à tous les accidents cérébraux, sans parler du ridicule amer auquel les expose une calvitie anormale.
De leur côté, les rouges reprochent aux blancs leurs exactions, leurs pillages, la dépossession ininterrompue, que n’a même pas arrêtée cette création des « réserves, » ou garantie de certains territoires libres laissés par la race conquérante à la race conquise.
Et comme la force matérielle, sans cesse accrue par les progrès de la science, donne toute supériorité aux blancs, il en résulte que les Rouges, pour compenser cette infériorité, recourent à toutes les perfidies, à toutes les ruses de la guerre de « sauvages », nom que cette guerre justifie amplement.
De là violences systématiques, extermination par le fer, le feu, le poison, la maladie, la faim.
Il n’est pas jusqu’à la trahison qui ne serve la diplomatie des belligérants.
« Diviser pour régner, » la formule attribuée à la perfide Albion, est aussi celle des autres nations, et plus spécialement de celles qui se réclament d’une origine saxonne.
En vertu de cet aphorisme, les États-Unis poussent à la guerre les unes contre les autres les peuplades sauvages qu’ils ne peuvent s’assimiler. Ces luttes intestines aident mieux aux progrès de leur ennemi commun que toute victoire directe de celui-ci. C’est un moyen aussi ancien que le monde et dont tous les conquérants ont reconnu l’efficacité. Et c’était à ce procédé de victoire déloyale que Wagha-na avait fait allusion, lorsqu’il avait dit à Georges Vernant :
– Il n’en faudrait point augurer qu’ils ne nous susciteront pas d’autres ennuis.
Cependant la colonne, à peu près rassurée, avait résolu de prendre encore pendant quelques heures les distractions de la chasse.
On ne pouvait s’éloigner ainsi de ces régions presque désertes que la saison favorisait merveilleusement sous le rapport de l’abondance autant que de la qualité du gibier.
Mais ces territoires giboyeux attirent les chasseurs de toutes les parties du Continent septentrional.
Aussi, le front de Wagha-na était-il resté soucieux malgré la retraite des Yankees.
Pressé de questions par Georges Vernant, il lui expliqua ses inquiétudes.
– L’effort que je poursuis depuis vingt ans, vous devez le comprendre, n’est pas fait pour plaire à la race conquérante. Songez-y. Qu’adviendrait-il, si j’arrivais à rassembler en corps de nations toutes les tribus errantes de la race Rouge ? Elles comptent encore deux millions et demi d’individus. C’est un chiffre qui serait doublé en trente ans, si un peu plus de bien-être, la pratique d’une sage hygiène, permettaient à nos malheureuses familles de s’affranchir du plus grand nombre des causes de mortalité qui les décime.
Or, une telle reviviscence de races qu’ils n’ont su, jusqu’ici, que détruire, serait de nature à alarmer les blancs. Il paraît que la civilisation exige notre holocauste. – Afin d’entraver une telle action, le Yankee pousse à la rivalité des tribus entre elles et, par malheur, il réussit : auprès de bon nombre d’entre elles. Je compte chez les hommes rouges d’implacables ennemis de mes idées et de mes efforts. Les races du Sud, Apaches et Comanches, plus spécialement, que je n’ai pu encore aborder de front, font une effroyable guerre à tous ceux que j’ai déjà pu rallier sous ma bannière. Nous passons à leurs yeux pour d’abominables traîtres qu’il faut massacrer sans pitié. – Or, c’est précisément en ce moment que ces tribus remontent du Texas, de la Californie, du Mexique même, vers les prairies que nous traversons. Maintenant, vous rendez-vous compté de mon angoisse.
– Oui, répondit Vernant, elles sont dignes d’un grand cœur comme le vôtre, car, dans un conflit de ce genre, c’est toujours la lutte fratricide, le sang indien qui coule.
– Merci, mon cher Georges, de me comprendre si bien. Vos paroles m’apportent une véritable consolation, répondit l’Indien avec une émotion qui fit monter des larmes sous ses paupières.
Les appréhensions de Wagha-na n’étaient, hélas ! que trop fondées.
Lorsque, après vingt-quatre heures de repos à la fois matériel et moral les Sioux reprirent la route du Nord-Est, que l’on ne devait plus interrompre désormais, la vue d’un nuage gris sur l’horizon du Sud alarma le Bison Noir.
– Allons ! – fit-il tristement, – voilà ce que je craignais.
On fut promptement renseigné.
Le nuage n’était que la poussière soulevée par une nombreuse cavalerie.
Quand celle-ci fut à portée de carabines, on ne put se méprendre sur ses intentions, non plus que sur son caractère. Cinq cents Comanches environ, reconnaissables aux teintes sanglantes de leurs peintures et de leurs splendides panaches de plumes, à leurs longues lances barbelées, aux arcs dont beaucoup encore affectent de se servir, en haine de la civilisation européenne, arrivaient à fond de train.
On les voyait, cavaliers sans rivaux, le torse nu, les jambes vêtues du pantalon mexicain fendu, les pieds chaussés de magnifiques mocassins, – une vanité presque nationale – exécuter de merveilleuses voltes sur leurs superbes mustangs qu’ils montaient à crû, n’ayant adopté de leur contact avec les blancs que l’habitude du mors et des éperons d’acier.
Wagha-na ne perdit pas son temps aux réflexions philanthropiques.
Il connaissait ses adversaires pour les avoir trop souvent rencontrés en des heurts de ce genre.
Il fallait donc se mettre en garde sur le champ contre leur première charge, afin de leur imposer le salutaire respect des armes à feu, plus redoutables que les lances. Les Sioux formèrent donc une double colonne, sur deux rangs, s’unissant à l’une des extrémités, de manière à présenter à l’ennemi l’ouverture d’un angle hérissé de canons de carabines en joue. Cette tactique, inventée par Wagha-na, avait pour principal avantage de paralyser la fougue de l’ennemi.
En effet, celui-ci, soit qu’il chargeât en colonne, soit qu’il se déployât en ligne, recevait, tout d’abord, un feu de front terrible. Emporté par son élan, il venait s’engager dans l’ouverture de l’angle qui, se rompant alors, permettait aux deux ailes des Sioux de l’envelopper en le fusillant sur les flancs, pour se rejoindre en arrière et recommencer la même manœuvre. Alors, se retournant vers Georges, le Bison Noir lui demanda.
– Mon cher enfant, voulez-vous vous charger d’une mission de confiance ?
– Oui, répondit Vernant sans hésiter.
X
BATAILLE
La mission dont le Bison Noir chargeait le jeune homme était celle de parlementaire.
Escorté de Sheen-Buck, qui parlait tous les dialectes indiens, le fiancé de Madeleine s’avança donc à la rencontre des Comanches sans avoir mis aucun signe de paix ou de guerre au canon de sa carabine. Il ne fallait point avoir l’air de suspecter les intentions des Comanches, afin de ne leur fournir aucun prétexte à ouvrir les hostilités.
Pour mieux prouver sa confiance, Georges rejeta sa carabine sur son dos et salua en soulevant, son chapeau dès qu’il se trouva à portée de la voix.
Trois Indiens se détachèrent du gros, de la troupe et rendirent le salut en étendant les mains en avant.
Alors Georges parla à voix claire, se servant de la langue anglaise.
– Gentlemen, demanda-t-il, est-ce nous que vous cherchez et avez-vous l’intention de faire route avec nous ?
Celui qui paraissait le chef répondit en fort mauvais anglais :
– C’est vous que nous cherchons, mais non pour cheminer avec vous. La prairie est large, et les hommes de cœur ne font pas leur compagnie des brigands.
– Qui appelez-vous brigands ? demanda Vernant, très calme.
– Ceux qui ne craignent pas d’entrer sur les terres des hommes libres pendant leur absence pour y poursuivre le gibier qui ne saurait leur appartenir.
– En ce cas, le reproche ne nous concerne pas. Nous sommes comme vous des hommes libres, et nous exerçons les droits que nous ont accordés la nature et les lois des peuples.
– Qu’êtes-vous donc venus faire sur nos terres ? Si l’homme blanc se fait l’allié du rouge, c’est pour préparer quelque trahison.
Ici Sheen-Buck intervint.
Il vit bien que le conflit reposait tout entier sur un malentendu habilement exploité par les Yankees.
Il expliqua donc au chef Comanche que ses camarades étaient des Sioux qui, vingt jours plus tôt, s’étaient rassemblés aux campements du lac de l’Esclave et qui relevaient simplement des autorités canadiennes.
Le chef Comanche était d’humeur mauvaise. Il ne cherchait que la querelle.
– Les Sioux sont des chiens, répliqua-t-il violemment. Ils servent les blancs contre leurs frères.
– Je ne suis point un Sioux, répondit dédaigneusement le Pawnie, que la fréquentation des blancs dans leurs propres domaines avait rendu fort indifférent à de telles injures.
Et, haussant les épaules, il reprit silencieusement sa place à côté de Vernant. Celui-ci voulait clore le débat.
– Voyons, dit-il, que nous demandez-vous ? Quel est l’objet de vos réclamations ?
– Que les Sioux et les blancs qui sont avec eux nous livrent dix de leurs chefs, et, parmi eux, Wagha-na, le Bison Noir.
Le jeune homme contint la colère qui commençait à le gagner.
– Et… si nous refusons ? demanda-t-il ?
– Les Comanches sont gens d’honneur. Ils savent tirer vengeance des injures qu’on leur fait.
– Très bien ! répliqua Georges. Ce sera tant pis pour vous s’il vous arrive du désagrément.
Il revint au galop vers Wagha-na auquel il transmit les insolentes exigences de l’ennemi.
– Allons ! fit le Bison Noir, il n’y a pas moyen de l’éviter. Il faut en découdre.
Sur-le-champ, il fit prendre à sa troupe l’ordre de bataille indiqué.
L’ennemi se rendit compte des dispositions de combat. Il n’attendit pas l’attaque.
Les cinq cents Comanches se ruèrent, la lance en avant sur les Sioux.
Une effroyable décharge les accueillit. Cent quatre-vingts carabines avaient fait feu en même temps, renversant soixante cavaliers au moins.
Et, tout aussitôt, l’angle se rompant, les deux ailes des Sioux passèrent à toute bride sur le flanc de la colonne ennemie qu’elles fusillèrent à bout portant.
Tout cela s’était accompli avec la rapidité de la foudre. Une centaine des féroces cavaliers étaient tombés morts ou blessés, sans avoir même pu joindre leurs adversaires.
Les Comanches, déconcertés par cette tactique inconnue, se divisèrent à leur tour en deux colonnes de deux cents hommes environ et, chargeant en ligne de deux côtés à la fois, ripostèrent avec les flèches et le plomb.
Cette riposte fut meurtrière pour les Sioux dont une vingtaine tombèrent, plus ou moins grièvement atteints.
Wagha-na comprit le danger qu’il y aurait à laisser les Comanches multiplier les tentatives de ce genre.
Il réunit donc sous sa main les trente-cinq compagnons qu’il avait emmenés de Dogherty, les massant en une seule colonne derrière laquelle vint se ranger le chef Sioux avec ses meilleurs cavaliers, tandis que les autres se formaient en ailes développées. Et sur un commandement du Bison Noir, tout l’escadron fondit, bride abattue, sur les Comanches.
À cinquante mètres, le premier groupe s’ouvrit et fit feu.
Tous les coups portèrent. Quarante Comanches tombèrent. Et avant qu’ils eussent réparé le désordre de leurs rangs, la colonne entière les troua, les culbuta, sabres, haches ou lances en mains.
Ainsi rompus, ils durent essuyer derechef le feu à bout portant des deux ailes des Sioux.
Alors, frappés d’épouvante, ne pouvant se rejoindre, les deux tiers d’entre eux tournèrent leurs bêtes vers le Sud et se mirent à fuir à travers la prairie.
C’était la victoire pour Wagha-na et les Sioux.
Le combat n’avait pas duré plus de vingt minutes. Les pertes des Comanches étaient énormes. La moitié de leur effectif était mort ou blessé. Le reste, démoralisé, se dérobait à la poursuite de leurs vainqueurs.
Pour ceux-ci, c’était le moment critique.
En effet, malgré les efforts pour les maintenir, Wagha-na put constater avec douleur que l’instinct sauvage reprenait le dessus et qu’il était impossible de maîtriser la furie de ces brutes affolées par la soif du carnage.
Des cent quarante hommes que conduisait le jeune chef, une centaine s’était élancée à la poursuite des fuyards.
Le chef lui-même les y avait entraînés, obéissant autant à la vaine gloriole du commandement qu’aux impulsions ataviques qui le poussaient au massacre. Le reste courait à travers le champ de bataille, s’y livrant à la hideuse besogne de la conquête des chevelures.
– Voilà le moment le plus dangereux, de la journée, dit tout bas le Bison Noir à Georges Vernant. Tant qu’il ne s’est agi que de combattre, j’ai pu tenir mes hommes dans la main. Mais à présent, les voici lâchés. Nous devons à la plus élémentaire prudence de ne point les attendre. Un retour offensif des Comanches nous serait désastreux.
Sur son ordre, on sonna de la trompe pour rallier les Indiens épars dans la plaine. Une vingtaine obéirent à l’appel. Les autres poursuivirent leur odieuse besogne.
Alors, le Bison Noir, pressant la marche de ses cavaliers, s’abandonna à de mornes rêveries.
Des doutes cruels lui venaient sans doute sur l’efficacité de sa mission.
Il avait voulu réunir en un seul faisceau to us les représentants de sa race. Et voilà que cette race elle-même lui paraissait condamnée par Dieu à la destruction. Ce n’était pas seulement les blancs qui travaillaient à hâter l’heure de sa disparition ; eux-mêmes conspiraient à leur ruine. Ils se faisaient les complices de la haine universelle ; ils justifiaient le mépris et les malédictions des peuples civilisés en tournant contre eux-mêmes leurs armes fratricides.
Oui, c’étaient là pour le vaillant chef, d’amers sujets de méditations.
Tout en cheminant, il ne pouvait se défendre de la plainte. Il versait le trop plein de son cœur dans l’âme de Georges Vernant, devenu mieux encore que Madeleine le confident de ses pensées.
C’est qu’en effet sa tendresse toute paternelle envers la jeune fille lui faisait un scrupule de jeter une tristesse dans cette jeune âme, d’assombrir son front et ses lèvres où il n’aurait voulu voir briller que de riantes préoccupations. Et sa propre tristesse prenait souvent les accents et les dehors de la colère.
– Ah ! les misérables ! prononçait-il, les misérables !
Certes, nul ne pouvait se méprendre au sens de ces imprécations.
Elles contenaient bien plus encore la pitié que le ressentiment.
– Il faut leur pardonner, disait plus doucement Georges. Pouvez-vous donc leur en vouloir de ce qu’ils ne pénètrent pas toute la grandeur, toute la noblesse de vos projets sur eux ? S’est-il jamais trouvé un peuple qui ait compris l’œuvre des hommes de génie qui l’ont arraché à la mort ou conduit à la gloire ? L’histoire n’en offre pas d’exemple.
Et, avec de telles paroles, il apaisait cette âme qui avait parfois ses moments de défaillance.
Le soir de ce jour, lorsqu’on dressa les tentes, à vingt milles du champ de bataille, on fut rejoint par le jeune chef Sioux et une partie de son effectif. L’orgueilleux jeune homme montrait atout venant douze scalps saignants pendus aux franges de sa selle.
Wagha-na n’y put tenir. Il éclata devant ce hideux spectacle et sa douleur s’exhala en une formidable allocution. – Chinga-Roa, le Renard avisé, peut être fier de ses exploits, – s’écria-t-il avec une ironique véhémence. – Il a réussi à retrouver en une seule journée la barbarie stupide des temps où l’homme Rouge se faisait exterminer en masses par les Visages Pâles. Vainqueur des Comanches, il s’est égalé à eux en férocité. Et maintenant c’est du sang de ses frères que ses mains sont dégouttantes.
Et cependant, Chinga-Roa, le Renard Avisé, avait juré de ne jamais verser ce sang ; il avait promis à son père Wagha-na de ne combattre que pour défendre sa vie et d’aider de toutes ses forces au relèvement de sa race. Mais Chinga-Roa est comme tous les jeunes hommes à cerveau faible. Il a le cœur du lion et la cervelle du lièvre. Il oublie le soir ce qu’il a juré le matin.
L’apostrophe était rude. Elle fit tressaillir le jeune homme et, à plusieurs reprises, pendant que le Bison Noir parlait, lui-même et ses guerriers laissèrent voir une violente irritation.
Peu s’en fallut qu’une querelle n’éclatât.
Pourtant le chef Sioux fit preuve, en cette circonstance, d’une louable abnégation.
D’une voix qui tremblait un peu, il prononça ces paroles de soumission :
– Mon père Wagha-na a raison, et je reconnais que j’ai agi en homme inconsidéré. Chinga-Roa a manqué à la promesse qu’il avait faite. Il s’est laissé aller à la colère contre les Comanches parce que les Comanches ont dit que les Sioux étaient des chiens. Que mon père Wagha-na oublie la faute commise aujourd’hui. Le Renard Avisé saura se souvenir des conseils de la sagesse. Il n’agira plus qu’après avoir pris l’avis des têtes blanches.
C’était une amende honorable, une loyale confession.
Le Bison Noir s’avança vers le jeune homme et lui posa sa main droite sur le front.
– Chinga-Roa a réparé sa faute, dit-il gravement. Il vient de parler comme devraient le faire tous les hommes de la race Rouge. Qu’il se souvienne de ce jour. Je ne l’oublierai pas.
La réconciliation ainsi faite, Wagha-na emmena l’impétueux Sioux sous sa tente.
– Combien as-tu perdu d’hommes ? demanda-t-il en attachant son œil d’aigle sur les yeux troublés de Chinga-Roâ.
Le Renard avisé baissa le front, confus, en balbutiant :
– Les Comanches sont les plus lâches des hommes. Ils sont revenus en forces quand ils nous ont vus peu nombreux.
Le Pawnie renouvela sa question.
– Dix-sept des nôtres sont morts, avoua-t-il, mais nous avons mis en fuite les Comanches.
Un soupir gonfla la poitrine du Bison Noir. Mais il n’ajouta aucun reproche à ceux qu’il avait déjà adressés. Il avait d’autres soucis.
La fuite des Comanches lui paraissait due moins à une victoire des Sioux qu’à la pratique d’une de ces ruses de guerre dont il savait ses compatriotes coutumiers. Il était à craindre qu’on n’eût, la nuit venue quelque attaque imprévue à subir.
On prit donc toutes les précautions nécessaires. Les abords du camp furent largement éclairés sur une circonférence distante de cent cinquante mètres des tentes, afin que les flèches de l’ennemi ne pussent venir silencieusement assaillir les chasseurs endormis.
L’événement prouva que l’on avait eu raison de se méfier d’une surprise.
En effet, vers trois heures du matin, un sifflement pareil au bruit d’un bâton vivement tourné annonça que les perfides méridionaux étaient revenus à la charge. Une première flèche, dépassant le cercle des torches, vint se ficher en terré à une soixantaine de mètres des premières tentes, prouvant la sagesse des mesures prises par le Bison Noir.
L’ordre qu’il avait donné fut rigoureusement exécuté. Personne ne bougea. Aussi l’ennemi, s’enhardissant, envoya-t-il une seconde volée de flèches. Une trentaine de celles-ci parvinrent dans la zone la plus rapprochée du camp.
Alors seulement Wagha-na fit sortir des tentes une soixantaine d’hommes qui s’avancèrent, en rampant sur les mains et les genoux, jusqu’à la limite atteinte par les flèches. Distribués en quatre groupés principaux, ils firent face aux quatre points cardinaux, conservant la position couchée. Les ordres se donnèrent à voix basse, et recommandation fut faite de tirer au jugé à la hausse de quatre-vingt mètres et au niveau moyen de la ceinture d’un homme.
Puis, tout rentra dans le silence.
Il était convenu que les hommes tireraient au commandement, sur un coup de sifflet. Si l’attaque était simultanée, les quatre groupes feraient feu en même temps devant eux, afin de balayer le terrain. En même temps, la réserve de la troupe, d’un nombre, égal, se tiendrait au centre du camp, prête à charger sur le point le plus menacé.
Wagha-na avait appelé près de lui Joë O’Connor, auquel il avait confié une petite boîte de cuir assez semblable à un appareil photographique, lui enjoignant de n’en faire usage qu’au moment opportun.
Une vingtaine de minutes s’écoulèrent sans qu’aucun signe menaçant se produisît.
Brusquement une rumeur sourde s’éleva aux abords du camp, et une nuée de flèches passa en sifflant.
Elle vint s’abattre à peu près à la même portée que les précédentes. Quelques-unes néanmoins dépassèrent cette portée. L’une d’elles troua une tente, une autre, plus efficace encore, cloua au sol le bras d’un des Sioux.
Mais, en même temps, une dizaine de balles déchirèrent les toiles du campement. Deux Sioux furent, assez grièvement blessés aux jambes. L’ennemi, convaincu que ses adversaires étaient, couchés, avait tiré au ras du sol.
L’attaque avait été générale, sauf du côté d’où les balles étaient venues.
Un coup de sifflet donna le signal de la riposte.
Celle-ci fut terrible.
Soixante coups de feu éclatèrent simultanément et tout aussitôt la plaine s’emplit de cris et de gémissements.
La décharge avait porté sur tous les points. Les tireurs avaient dirigé leur feu en éventail, et l’ennemi imprudent venait d’être fauché par cette foudroyante répliqué. Ils avaient cru surprendre ; c’étaient eux qui étaient surpris.
Alors Joë O’Connor s’avança, porteur de la boîte que lui avait confiée Wagha-na. Sur l’ordre de celui-ci, les quatre pelotons se rassemblèrent, et la réserve sortit à son tour, l’arme chargée, prête à donner au commandement.
Dans la plaine, des bruits divers se faisaient entendre. On percevait des renâclements et des cliquetis de sabots de cheval.
Il était manifeste que, pour débusquer les tireurs aperçus à la lueur d’une décharge qui avait dû leur être excessivement meurtrière, les Comanches allaient charger dans l’obscurité.
On n’avait pas le temps de plier les tentes. Mais les chevaux étaient là. En un clin d’œil tout le monde fut en selle et rassemblé en arrière du camp dont on éteignit toutes les torches. La plaine se trouva donc plongée dans de denses ténèbres.
Mais, au même instant, un faisceau lumineux d’une grande puissance s’épandit sur la prairie, montrant aux Sioux leurs adversaires déjà massés pour la charge. Quatre-vingts fusils étaient déjà prêts. Ils firent feu, et l’ennemi, atteint par cet ouragan de plomb, rompit son ordonnance. C’était Joë O’Connor qui venait d’utiliser son projecteur électrique.
Avec des hurlements de rage et de désespoir, les Comanches se ruèrent sur le camp. On put les voir, dans la blanche nappe d’électricité, s’agiter éperdus, aveuglés, poussant leurs bêtes au hasard, n’ayant plus pour les guider que l’instinct d’une haine affolante.
Ils coururent tout droit aux tentes pareilles à de gigantesques fantômes. Mais, dans leur course désespérée, ils offrirent aux tireurs Sioux une cible trop aisée. De nouveau, une décharge les prit en écharpe et leur tua une vingtaine d’hommes.
Les plus emportés ne purent que planter leurs longues lances dans la toile des tentes ou les hérisser de flèches inutiles.
Mais déjà leurs chefs sonnaient la retraite. Il était évident que la lutte leur avait été funeste, et qu’ils n’entendaient pas continuer à leurs dépens la cruelle expérience qu’ils venaient de faire du génie militaire de Wagha-na.
Les Sioux ne les poursuivirent point.
Ils avaient mieux à faire en s’occupant de leurs blessés. En effet, une quinzaine des leurs avaient été atteints par des flèches perdues ou des balles venues à l’ouverture. Par bonheur, aucune des blessures n’était mortelle.
Le plus grièvement atteint était Georges Vernant qu’une flèche avait frappé au bras gauche, un peu au-dessous de l’épaule. Mais ce qui avait consolé le jeune homme, c’était que, sans sa présence, le trait eût tué Madeleine.
Aussi la fille adoptive du Bison Noir lui avait-elle adressé tout haut ses remerciements.
– Voici deux fois que je vous dois la vie, Georges. La mienne vous appartient, vous le savez.
Cette parole, Léopold Sourbin l’avait entendue. Il en avait frémi de colère.
Un âpre sentiment de jalousie était entré dans son cœur et il avait senti renaître en lui les fiévreux désirs qui en avaient fait l’associé ou plutôt le complice de Pitchet de Schulmann.
Ce n’était point seulement sa cupidité qui était en jeu. Il avait conçu pour sa cousine un amour profond et sincère, et cet amour lui avait inspiré l’horreur de ses premiers calculs et des misérables dont il avait voulu faire les instruments de ses odieux projets. Mais, à cette heure, une haine sourde bouillonnait en lui contre le jeune Canadien.
Cette haine, elle l’étouffait. Il ne pouvait la laisser voir, lui donner cours. Indépendamment de l’affection et de l’estime dont Wagha-na et ses compagnons entouraient Georges Vernant, n’y avait-il pas, désormais à ménager la tendresse dont Madeleine elle-même venait de donner un si précieux gage à son rival ?
Ce n’était pas tout. N’était-il pas lié à Georges par la dette d’une étroite reconnaissance ?
Léopold ne pouvait oublier, en effet, en quelles circonstances critiques celui-ci lui avait sauvé la vie : Sa course éperdue à travers la plaine aride, sa chute de cheval et l’attaque inopinée du serpent-fouet, dont il serait tombé victime, sans la courageuse intervention de celui dont il souhaitait maintenant la mort.
Oui, la mort, car la reconnaissance en son cœur avait cédé la place à la jalousie, implacable, féroce.
Et Léopold Sourbin en était à regretter de n’avoir pas à sa portée les deux misérables auxquels il aurait pu recourir pour qu’ils le délivrassent de la présence d’un rival exécré.
Or, ces complices que regrettait Léopold étaient plus près de lui qu’il ne pouvait le soupçonner.
XI
LE RAPT
Ulphilas Pitch et Gisber Schulmann avaient fini par se mettre d’accord sur les moyens à prendre.
Chose étrange ! C’était la brutalité du second qui avait eu raison des prudences du premier. À la suite d’une explication fort acerbe dans laquelle l’Allemand lui avait reproché l’insuccès de ses machinations et de ses trames ténébreuses, prônant très haut l’emploi des moyens énergiques, le Yankee avait fini par concéder à son complice ses prémisses. Il avait donc été convenu entre les deux hommes que si, au cours de leur voyage aux côtés dès chasseurs de bisons ils ne parvenaient point à déterminer Sourbin à une action décisive, Gisber prendrait à son tour la direction des « opérations ».
L’échéance était arrivée, ou plus exactement le terme de l’épreuve fixé par Pitch lui-même. L’Américain n’avait pas protesté. Il n’avait pas même réclamé une prolongation du délai. Il s’était soumis sans murmure.
Tout aussitôt Schulmann avait entraîné son compagnon au delà de la frontière. Sur son inspiration, qu’il avait, d’ailleurs, approuvée, Ulphilas avait gagné le poste le plus voisin et prévenu les autorités américaines du voisinage dangereux des Sioux en deçà des limites imposées par les traités.
Mais là ne s’était pas bornée l’intervention hostile des deux coquins.
Gisber Schulmann était pressé de mettre lui-même la main à la besogne. Il n’avait suscité l’action armée des Yankees que pour occuper l’attention des Indiens, comptant profiter de leur trouble pour mener à bien son propre projet. Or ce projet, très hardi, ne tendait à rien moins qu’à ravir ou à tuer Madeleine.
Il crut un moment l’occasion propice toute trouvée.
En courant à travers les premiers contreforts de la chaîne, afin de surveiller les agissements de Wagha-na et de sa troupe, Gisber fit la rencontre d’un parti de trappeurs qui, eux-mêmes, lui signalèrent la présence des ours grizzlys.
L’arrivée des Indiens avait mis ces hommes en fureur en éloignant d’eux le gibier auquel ils donnaient la chasse. Il fut donc très facile à Schulmann de les gagner à sa cause, sans leur faire connaître, cela va sans dire, les raisons qui le faisaient agir. Ainsi furent détournés les ours. Puis, en même temps qu’ils poussaient les terribles animaux les uns vers les autres, les trappeurs chassaient devant eux les antilopes jusqu’à l’étroite vallée en entonnoir, point commun et obligé, centre de leur effort aussi bien que des recherches probables des Sioux.
Le Bison Noir avait donc eu raison lorsqu’il avait tenu pour un indice de malveillance la présence des onze grizzlys rassemblés sur un même point. Le coup de fusil qui avait tué la jument de Madeleine n’avait été qu’une maladresse de Schulmann, emporté par la fougue brutale de son caractère.
Tout s’était passé à peu près comme l’avait disposé l’Allemand.
Mais le résultat n’avait pas répondu à son attente. La prudence en même temps que la fermeté de Wagha-na avaient évité un conflit qui aurait certainement amené de dangereuses complications.
Gisber était profondément humilié. Son machiavélisme n’avait rien produit d’efficace.
Ulphilas trouva l’occurrence tout à fait naturelle pour rentrer en scène et reprendre la haute main dans la direction de la commune entreprise. Et comme Schulmann avouait qu’il était, suivant l’expression vulgaire, au bout de son rouleau, Pitch se trouva fort bien servi par les circonstances lorsqu’il suggéra, au lieutenant américain l’idée de se débarrasser des Comanches, voisins toujours désagréables, en les lançant à la poursuite des Sioux.
Le plan réussit à merveille. Les sauvages agréèrent sur-le-champ l’offre de dépouiller leurs frères selon le sang.
Ils y mirent néanmoins une condition : celle d’être accompagnés par deux blancs.
Leur méfiance ne désarmait point. Ils mettaient en pratique la parole que Virgile place dans la bouche de Laocoon : « Je redoute les Grecs jusque dans leurs présents ».
Cela entrait trop bien dans les vues de Pitch et de Schulmann pour qu’ils n’acceptassent point de se faire sur-le-champ les guides et les conseillers des Indiens.
Ils les suivirent donc mêlés à leurs rangs et leur fournissant deux carabines de renfort. Mais ils eurent soin de se dissimuler de manière à n’être pas reconnus d’emblée, ce qui eût été vraiment trop dangereux.
Après le double échec de leurs alliés, ils désespérèrent du succès.
Mais Ulphilas Pitch n’était pas homme à se décourager longtemps. Dès qu’il comprit que l’humiliation des sauvages se tournerait en fureur à rencontre des conseillers malencontreux qui les avaient poussés à une tentative aussi désastreuse, il n’attendit point que l’orage se déchaînât.
Ce fut lui qui prit les devants. Il adressa au chef Comanche les reproches les plus acerbes sur son impétuosité maladroite, l’accusant d’avoir fait preuve d’autant d’incapacité que de jactance. Puis quand il jugea les esprits suffisamment excités, il laissa échapper à dessein cette phrase pleine de provocations :
– Si j’avais seulement cinquante hommes résolus avec moi, je me ferais fort de causer à Wagha-na un dommage sans précédent. Le Bison Noir ne s’en relèverait pas.
De telles paroles étaient faites pour donner aux Indiens un vif désir de connaître le dessein du Yankee. Ils ne manquèrent pas de l’interroger avidement. Et comme Ulphilas refusait dédaigneusement de répondre, le chef, emporté par cette même fougue irraisonnée qui lui avait valu ses deux défaites, s’écria :
– Que le Yanghis dise sa pensée et je m’engage à l’accompagner où il voudra avec cinquante de mes plus braves guerriers.
Alors Pitch consentit à parler. Il expliqua que la meilleure manière de frapper Wagha-na était de surprendre et d’enlever Madeleine. La perte de la « Fée » serait un coup mortel à la fois pour le vieux chef et pour l’association qu’il avait créée, tant était grande la confiance superstitieuse que ses membres plaçaient en la jeune fille.
En s’exprimant de la sorte, Ulphilas disait la vérité.
Le Bison Noir n’avait jamais eu de famille. Le meilleur de son cœur, il l’avait donné à cette enfant, fille de son plus intime ami et dans les veines de laquelle coulait un peu de son propre sang, puisqu’elle était, par sa mère, descendante des métis de race rouge.
Le Comanche applaudit férocement à ce projet et, tout de suite, on arrêta le plan de campagne.
Il consistait, pour Pitch et Schulmann, à se porter en avant sur la route qu’allaient suivre les Sioux, d’y dresser une embuscade puis d’attendre leur passage pour fondre inopinément sur la colonne au moment où l’escorte de Madeleine se montrerait sur le chemin.
Pour ce faire, on sacrifierait au besoin vingt hommes. Mais les plus robustes des agresseurs pousseraient droit à la jeune fille, s’en empareraient et fuiraient à toute vitesse en l’emportant.
Le problème offrait une première difficulté à résoudre.
Quel pourrait être le chemin suivi par les Sioux ?
On ne le saurait qu’en les épiant à distance et de manière à ne point se laisser surprendre.
Ce fut alors qu’Ulphilas se ressouvînt de Léopold Sourbin et forma l’audacieux projet de se mettre à tout prix en rapports avec lui. Bizarre coïncidence ! À la même heure, Sourbin regrettait l’absence de ses complices.
C’est une superstition populaire chez bien des peuples qu’un désir mutuel véhément suffit à rapprocher des êtres éloignés.
En cette circonstance, les adeptes de cette croyance auraient pu triompher à leur aise.
Il arriva qu’au matin qui suivit cette nuit troublée, Léopold Sourbin qui marchait à l’arrière-garde de la troupe et un peu en arrière, entendit brusquement une flèche siffler à son oreille. La flèche vint se planter à deux mètres de lui et le Français crut remarquer une tache blanche sur cette flèche.
Hésitant d’abord, il obéit cependant à la curiosité qui l’entraînait.
Il se baissa, retira le projectile du sol et constata, non sans stupeur, qu’un morceau de papier y était enroulé.
Il le déroula et y lut cet avis qui le fit tressaillir, écrit en langue anglaise. – Si M. L. Sourbin oublie ses amis, ses amis ne l’oublient. Ils se tiennent près lui.
Et c’était signé : Ulphilas Pitch.
Léopold promena autour de lui un regard furtif afin de s’assurer que personne parmi ses compagnons de route n’avait surpris son action.
Les Sioux galopaient au loin sans s’occuper autrement des faits et gestes du Français.
Par contre il sembla à celui-ci que les arbustes bas qui, à sa droite, surgissaient sur la plaine, avaient eu de bizarres mouvements qu’on ne pouvait expliquer par le passage du vent à travers les branches.
Un petit bois de bouleaux et de sapins était à proximité. Sans hésiter, il poussa sa course de ce côté.
Il avait deviné juste. Ulphilas et Schulmann, opérant cette fois avec une habileté merveilleuse, l’avaient épié et suivi. Ils le rejoignirent sous le couvert du bois. L’entretien fut bref, mais concluant.
Ce fut Sourbin qui parla le premier.
– Le marché tient toujours, dit-il brièvement. Mais j’y mets une condition de plus, – Laquelle ? demanda hâtivement le Yankee.
– Il faut que vous me débarrassiez d’un certain Georges Vernant. Il est, en effet, le fiancé de ma cousine et, lui vivant, je ne puis devenir le mari de celle-ci. Il est donc urgent de m’en délivrer.
L’Américain haussa les épaules avec un vague sourire. Si Sourbin eût interprété sagement ce sourire, voici ce qu’il y aurait démêlé : « Il nous importe peu que tu épouses ou n’épouses pas ta cousine, pourvu que tu recueilles sa succession ».
Mais Léopold ne devina point ce sens caché ; il se contenta de la promesse donnée par Ulphilas que, dès le lendemain, il serait délivré de la rivalité de Georges Vernant.
Et, comme les Sioux n’étaient plus visibles à l’horizon, le cousin de Madeleine piqua des deux pour les rejoindre, comprenant que son éloignement prolongé pourrait éveiller des soupçons.
Quand il les rejoignit, il prétexta un accident, une chute qu’il avait faite. La raison était acceptable ; elle avait même toute vraisemblance, les précédentes chevauchées de Sourbin ne lui ayant pas précisément assuré la réputation d’un écuyer sans défauts.
Il ne remarqua point, d’ailleurs, le fauve regard avec lequel l’accueillirent simultanément Wagha-na, Sheen-Buck et le vieil Irlandais Joë O’Connor.
La colonne poursuivit sa marche sans incidents. Elle atteignit ainsi, le lendemain, les bords de la rivière Murray, un des affluents de la Saskatchewan du Sud, cours d’eau rapide, à peine guéable en deux ou trois passes difficiles, et qui se cache sous d’épaisses forêts, propices aux embûches et aux attaques par surprise.
C’était le lieu que Pitch et ses acolytes indiens avaient choisi pour y tenter leur coup de main.
Et, en vérité, ils avaient bien choisi.
Le Murray coulait entre des rives fort escarpées couronnées de bois vivaces. Le chemin que devaient suivre les Sioux pour atteindre le gué de la rivière était lui-même bordé de collines boisées, dont quelques-unes, séparées entre elles par des sentiers que l’on eût dits taillés au pic dans le granit, formaient d’imposantes falaises. Ce chemin, fort étroit, obligeait les chasseurs à s’avancer en colonne de deux ou trois cavaliers de front.
Le Bison Noir donna donc l’ordre au chef Sioux de prendre la tête du défilé et de faire passer au plus tôt la rivière à ses hommes.
Lui-même, observant partout la même discipline, se plaça au centre avec Georges, Madeleine, Léopold Sourbin et ses deux inséparables lieutenants, Joë et Sheen-Buck.
Il se trouva qu’en la circonstance cette disposition était la pire de toutes, puisqu’elle allait faciliter l’attaque des Comanches.
En effet, au moment même où Wagha-na et ses compagnons atteignaient l’angle d’un des chemins tracés par la nature dans l’épaisseur des versants boisés, ils se trouvèrent brusquement séparés de l’avant-garde que Chinga-Roa avait déjà fait passer sur l’autre rive du Murray.
Le guet-apens avait été réglé avec une parfaite entente de cette guerre de ruses.
Pitch et Schulmann, ne tenant point à s’exposer aux coups, s’étaient abrités avec leurs bêtes sous une large anfractuosité des roches. Seuls, le cacique des Comanches et cinq de ses plus robustes compagnons se tenaient, la lance ou la hache à la main, prêts à fondre à l’improviste sur l’escorte qu’ils prendraient ainsi de flanc.
Tout se passa comme le Yankee l’avait ordonné. La malchance voulut que Madeleine, obéissant peut-être à une surexcitation soudaine de sa monture, fût emportée d’une dizaine de mètres en avant de ses compagnons.
Une clameur sauvage éclata. Plus rapide que la pensée, le Comanche se rua sur la jeune fille et, l’arrachant de sa selle, la jeta violemment en travers de la sienne. Puis, sans s’occuper du combat que ses compagnons soutenaient derrière lui contre les amis de Madeleine, revenus de leur stupeur, il se mit à fuir, accompagné de Gisber et d’Ulphilas, par le sentier étroit qui séparait les deux murailles de la falaise.
Wagha-na ne se fut pas plutôt rendu compte de l’agression qu’avec un cri de rage, il se jeta sur les Comanches qui barraient le passage. Trois fois de suite sa hache abattit un adversaire. À ses côtés, Georges, Joë et Sheen-Buck, avaient, eux aussi, accompli de foudroyantes prouesses. Pas un des compagnons du cacique n’avait échappé à leurs terribles coups.
Mais c’étaient là des exploits inutiles. Tandis qu’ils luttaient victorieusement contre les Indiens, le chef de ceux-ci fuyait à toute vitesse, emportant Madeleine évanouie. Car dans le choc qui s’était produit, la tête de la jeune fille avait heurté violemment un des rochers de la falaise. Seule son épaisse chevelure l’avait préservée d’un plus grave accident.
Cependant la place était déblayée, et le Bison Noir avait recouvré sa présence d’esprit.
Tout de suite, il se rendit compte de l’effroyable danger que courait l’orpheline.
Il ne s’expliquait point que les bandits l’eussent enlevée au lieu de la tuer. Une seule hypothèse se présentait à son esprit pour expliquer ce caprice des ennemis. Sans doute, ils comptaient encore sur l’hypothèse d’un mariage entre Madeleine et son cousin, solution infiniment plus pratique que celle d’un meurtre peut-être inutile.
Mais si cette solution satisfaisait Pitch et Schulmann, il n’était pas sûr qu’elle fît le compte du chef comanche.
Celui-là, à coup sûr, n’entrait pour rien dans les combinaisons et les calculs de Sourbin et de ses complices. Il n’avait agi, lui, que pour prendre sa revanche des deux échecs subis, pour satisfaire son désir de haine et de vengeance contre Wagha-na et ses complices ; celui-là réclamerait la mort de l’infortunée jeune fille ; il menacerait ses associés provisoires, et, comme, après tout, ceux-ci pouvaient se contenter de cette terminaison tragique du drame, ils ne feraient qu’une résistance de pure forme aux exigences de l’Indien.
Il fallait donc arracher au plus tôt, et par tous les moyens, Madeleine aux mains du féroce sauvage.
En cet instant critique la décision devait être prompte, l’action la suivre sans retard.
Le puissant esprit du Bison Noir conçut un plan rapide qu’il mit à exécution sur l’heure.
À ses côtés se tenait Léopold Sourbin. L’ahurissement et l’épouvante se lisaient en grosses lettres sur son visage. Il était impossible un seul instant de croire que le coup de main accompli par ses complices eût été prémédité de concert avec lui.
Wagha-na interpella vivement le jeune homme.
– Allons, monsieur Sourbin, lui dit-il le moment est venu de prouver l’attachement dont vous vous êtes vanté pour votre cousine : C’est la seule manière d’obtenir ce que vous sollicitez.
L’étonnement de Léopold parut croître. Il demanda d’une voix tremblante.
– Je suis prêt à tout pour la sauver. Mais que me faut-il faire ? Enseignez-le-moi.
Alors, sans arrêter sa course à travers l’étroit défilé, l’Indien exposa son plan.
– Le rapt a été accompli à l’instigation des deux coquins que vous connaissez. Cela est hors de doute. N’essayez pas de le nier ; vous perdriez votre temps. Mieux vaut pour vos intérêts même leur arracher votre cousine dont ils veulent sans doute se faire un otage contre vous-même et contre nous.
Et, comme Léopold, ébranlé par ce raisonnement fort simple, se prêtait sincèrement à un projet de délivrance, le Pawnie lui fit comprendre le rôle qu’il aurait à tenir pour la réussite de ce projet.
– Les misérables ont une grande avance sur nous. Mais il est certain qu’ils ne peuvent s’éloigner beaucoup, s’ils désirent se mettre en relations avec nous. Car leur tentative serait sans utilité s’ils n’avaient votre concours. Or, il s’agit pour vous de les rejoindre, de vous laisser prendre au besoin. Nous ne vous perdrons pas de vue. Vous nous tiendrez au courant de votre passage eh laissant une trace dans tous les lieux où vous camperez.
– Quelle trace ? questionna le Français, un peu inquiet de la précision de ces paroles.
Wagha-na se fit encore plus précis.
– Un indice tel que vos compagnons ne puissent le remarquer, ni en pénétrer le sens.
Il tira du sac de peau qui pendait à son épaule une poignée de petites baies rougeâtres qu’il versa dans la poche de Sourbin.
– Voici, dit-il, les graines d’une plante totalement inconnue dans nos régions. Elle vient, du Brésil. Dès que vous aurez rejoint les Comanches et leurs complices, vous laisserez tomber, une de ces graines sur le sol de dix en dix mètres. Elles nous serviront de points de repère.
– Quoi ! s’écria Léopold, vous pourrez retrouver sur le sol d’aussi invisibles vestiges ?
– Ne vous inquiétez point de cela, répliqua l’Indien. Nous avons de bons yeux.
Pour la première fois, depuis que Sourbin était son hôte, le Bison Noir lui tendit la main.
– Allons ! dit-il d’une voix émue, il n’y a pas une minute à perdre. Hâtez-vous, et que Dieu vous garde !
– Je ferai de mon mieux, répliqua le cousin de Madeleine d’une voix mal assurée, mais avec une réelle sincérité.
Et, touchant légèrement sa bête, il s’élança dans le chemin étroit qu’avaient pris avant lui les ravisseurs.
Certes, c’était pour Léopold Sourbin un véritable acte de courage qu’il accomplissait à cette heure.
Il s’en allait seul, entièrement seul, dans ce désert qu’il venait de parcourir en nombreuse et vaillante compagnie, et dont il n’avait que trop bien apprécié les périls de toute nature. Il y allait sans guide, sans soutien, livré à la seule direction de son instinct, entouré de périls et d’embûches, ne sachant même pas quel accueil lui réservaient ceux vers lesquels il se dirigeait. Son imagination avait gardé la forte impression des tragiques événements qu’il avait déjà vus se dérouler sous ses yeux. Elle lui montrait des pièges et des ennemis à tous les horizons, dans le creux des roches, sous les troncs pressés des arbres : ours grizzlys, serpents venimeux, bisons aux cornes farouches, Peaux Rouges aux durs visages tatoués et menaçants, s’éclairant parfois d’un rire atroce. Et la pensée que Wagha-na et ses amis l’accompagnaient, invisibles mais prêts à intervenir, suffisait à peine pour l’empêcher de céder à une peur folle, une peur d’enfant.
Une autre cause de trouble venait s’ajouter à celles qui paralysaient à moitié sa volonté.
Il ne s’expliquait point à quel calcul auraient pu obéir Pitch et Schulmann en agissant comme ils venaient de le faire.
Non seulement ils n’auraient point tenu leur promesse en le débarrassant de Georges Vernant, mais encore, en enlevant Madeleine, ils lui étaient, à lui Sourbin, le moyen de réaliser ses fins.
C’était donc avec une âme incertaine et confuse, pleine de terreurs et de remords que le cousin de Madeleine courait à l’aveuglette sur les chemins du désert, à la poursuite de complices qui pouvaient bien n’être que des ennemis.
Et, cependant, ce fut avec un soupir de soulagement qu’il vit finir l’espèce de couloir rocheux qu’il suivait et s’ouvrir devant son regard l’horizon sans bornes des plaines.
XII
MARCHÉ DE SANG
Lorsque Madeleine sortit de évanouissement où l’avaient plongée le saisissement de l’agression et surtout le choc violent qu’elle avait reçu à la tête, elle était étendue sous une hutte de branchages. Deux hommes à figures sinistres la veillaient. Elle n’eut pas de peine à reconnaître en eux les deux aventuriers qui naguère avaient demandé la faveur de s’établir à Dogherty.
Sa fière et vaillante nature se révolta à la pensée qu’elle pouvait être la prisonnière de ces hommes.
Mais tout aussitôt la mémoire lui revint du récent épisode dont elle avait été la victime. Elle revit la face hideuse du chef Comanche qui l’avait désarçonnée pour l’emporter avec lui en travers de sa selle. Et elle se dit que, peut-être, elle jugeait mal ces deux hommes qui l’assistaient, qu’elle leur devait plutôt de la reconnaissance si, ce qui n’était pas improbable, ils l’avaient arrachée à la violence de l’Indien.
Partagée entre la répulsion qu’ils lui inspiraient et le désir de ne point se montrer ingrate, la jeune fille voulut, tout d’abord, se rendre compte de la situation qui lui était faite. D’un brusque mouvement, elle se mit sur son séant, et fit un effort inutile pour se soulever.
Une douleur aiguë traversa son corps, sa tête vacilla, prise de vertiges. Elle sentit qu’elle était trop faible et que ses jambes, entravées par une mince cordelette, lui refusaient leur service. Elle retomba sur le sol, tandis que l’un de ses gardiens, Gisber Schulmann éclatait d’un rire à la fois bestial et féroce.
Elle ne put supporter l’idée qu’elle pût être la prisonnière de ces hommes.
– Messieurs, demanda-t-elle d’une voix que l’émotion troublait, je tiens à savoir où je me trouve, si vous êtes des amis ou des ennemis.
Ce fut Ulphilas Pitch qui répondit avec son ironique bonhomie.
– Oh ! des amis, Miss Madge, bien certainement des amis, et qui ne demandent qu’à vous rendre service.
– En ce cas, reprit la jeune fille, trompée par cette bienveillante perfidie, voulez-vous m’apprendre où je suis et comment, enlevée par un Indien, je me trouve présentement auprès de compatriotes, ou, tout au moins, d’hommes de race blanche.
– Miss, répondit le Yankee, sans se départir de son flegme, il serait peut-être un peu long de vous expliquer le cas tout particulier qui vous concerne. Vous avez été, ainsi que vous le dites fort justement, enlevée par un chef Comanche dont nous sommes un peu les amis. Il paraît que ce bon frère rouge avait une forte dent, sinon contre vous-même, du moins à rencontre de personnes qui vous sont chères. Il a donc cherché à en tirer vengeance, et c’est pour cela que vous vous trouvez présentement en cette demeure peu luxueuse, où nous ne pouvons vous offrir rien du confortable auquel vous êtes habituée, ce que nous regrettons vivement.
Tout cela avait été dit avec ces intonations gouailleuses des gens qu’en France on nomme des « pince sans rire ».
Madeleine en l’écoutant sentait son cœur se serrer et avait l’appréhension de menaces suspendues sur sa tête.
Elle comprenait que cet homme raillait sa détresse.
Pourtant, elle risqua encore une interrogation.
– Puisque vous me voulez tant de bien, Monsieur, veuillez m’expliquer pourquoi vous avez pris soin de me lier les jambes ?
Un gros rire, cette fois, se fit jour à travers la barbe fauve de Gisber Schulmann.
À son tour l’Allemand parla et voulut se montrer spirituel.
– Cela, Mademoiselle, dit-il en un français d’intonation particulière, est une simple précaution que nous avons prise pour le cas où vous chercheriez à vous dérober à notre sollicitude, ce qui serait imprudent, étant donné l’état de faiblesse où vous vous trouvez.
Madeleine n’eut pas besoin d’en entendre davantage.
Ce persiflage continu avait suffi à l’éclairer.
Elle sourit dédaigneusement et, regardant les deux coquins bien en face.
– Allons ! fit-elle, je vous dois des remerciements pour m’avoir délivrée d’une crainte, celle de vous prendre pour d’honnêtes gens.
Je vois que je ne m’étais pas trompée. Vous êtes deux misérables.
Elle s’accouda, leur tournant le dos, pour méditer plus à l’aise sur les événements, soutenue, d’ailleurs, par le légitime espoir de se voir bientôt secourue par Wagha-na et ses amis de Dogherty.
Mais une nouvelle épreuve lui était réservée.
La porte de la hutte s’ouvrit et un nouveau personnage y pénétra, lui donnant une seconde fois la sensation désagréable qu’elle avait éprouvée au moment du rapt. Celui-ci n’était autre que l’Indien qui l’avait enlevée, le chef des Comanches.
Il vint s’asseoir sur le sol, presque à toucher la prisonnière, et, d’un accent où éclatait l’orgueil du triomphe et la satisfaction de la vengeance accomplie, il dit :
– Wagh ! L’Ours Gris est un chef invincible ! Il a vaincu le Bison Noir et les traîtres qui le servent. Il a pris la fille de Wagha-na. L’Ours gris emmènera la femme blanche dans son wigwam. Il fera d’elle l’esclave de ses squaws.
Madeleine comprenait tous les dialectes indiens. Ces paroles la troublèrent profondément. Elle dissimula néanmoins l’angoisse qui l’oppressait, pour ne point ajouter à la joie de son persécuteur. Celui-ci poursuivit :
– Magua a su vaincre ses ennemis, malgré leurs carabines. Il a tué Chinga-Roa, chef des Sioux ; il a pris la chevelure de Wagha-na et des blancs qui étaient ses alliés. Magua est un grand chef.
C’était la seconde fois que le Comanche se vantait de cet exploit.
Madeleine ne s’alarma point outre mesure. Elle connaissait l’habituelle forfanterie des Indiens. C’est chez eux une manière de tourmenter leurs ennemis afin de provoquer en eux une défaillance.
Cette indifférence de la prisonnière eut le don d’exaspérer le chef des pillards du Sud.
– La femme au visage pâle sera la servante du wigwam, prononça-t-il en donnant à ses inflexions aussi bien qu’aux traits de son visage une expression plus méchante. Les squaws de l’Ours Gris la mèneront à coups de corde. Elles lui arracheront ses beaux cheveux et les ongles de ses pieds et de ses mains, et les yeux dont elle est si fière.
Dédaigneuse, Madeleine continua à garder le silence.
Alors l’irritation du chef ne connut plus de bornes. Il se leva et, d’un geste violent, saisissant le bonnet de fourrure qui protégeait la tête de la jeune fille, il la tira par ses longs cheveux dénoués.
La secousse fut si rude, la douleur si atroce que Madeleine s’évanouit pour la seconde fois.
Par bonheur, Pitch et Schulmann intervinrent. Ces brutalités ne faisaient pas leur affaire. Aussi dégradé que soit un homme, il n’aime point à voir souffrir une femme ou un enfant, à moins qu’il ne soit lui-même sous l’empire de l’ivresse ou d’une colère aveuglante. Ils consentaient à tuer leur victime, mais ils ne voulaient point lui faire la mort cruelle.
Ce fut Gisber en personne qui se fit, en cette circonstance, le protecteur de l’orpheline.
Il se jeta sur l’Indien et, grâce à son énorme vigueur, l’eut promptement maîtrisé.
Magua, furieux et grinçant des dents, porta la main à sa ceinture où brillait son tomahawk au fer acéré et luisant.
Mais l’Allemand n’eut qu’à étendre sa main droite pour paralyser le bras de Comanche.
– Hé ! le sauvage, cria-t-il, l’ours blanc, ou grizzly, pas de ça ; ça n’est pas dans nos conventions.
L’argument était d’autant plus solide que la poigne de Gisber l’était davantage. Tout « grand chef » qu’il se proclamât en ses épiques vantardises, l’Ours Gris n’était pas de force à triompher de ses deux adversaires en même temps, alors surtout qu’un seul suffisait à le maintenir.
Il se résigna donc en la circonstance et en passa par les exigences du Teuton.
D’ailleurs, un autre incident vint apporter une heureuse diversion.
La porte venait de s’ouvrir derechef, et un Comanche était rentré essoufflé, porteur de quelque grosse nouvelle.
Il échangea avec son chef quelques mots rapides en langue indienne, et celui-ci, rappelé au sentiment de la prudence, changea complètement de ton pour dire aux deux blancs.
– Il y a un visage pâle qui nous suit. Mes guerriers peuvent le tuer ou le prendre. Que décidez-vous ?
– Qu’ils le prennent, qu’ils le prennent ! s’écria Pitch en se levant précipitamment. Il nous renseignera.
Un quart d’heure plus tard, trois Comanches ramenaient à la hutte un homme étroitement garrotté.
À peine Ulphilas eut-il jeté les yeux sur le captif, qu’un cri de joie jaillit de ses lèvres :
– Tiens ! monsieur Sourbin ! Quelle heureuse rencontre !
– Pas aussi heureuse pour moi, monsieur Pitch, répliqua l’infortuné Léopold, tout meurtri par les liens qui entraient dans les chairs, tout froissé par la manière peu courtoise avec laquelle les Indiens s’étaient emparés de lui.
– Détachez cet homme tout de suite, ordonna l’Américain avec autorité. C’est un ami.
L’ordre fut exécuté sur-le-champ par les Peaux Rouges, bien qu’avec une très visible répugnance. Les sauvages n’eussent pas demandé mieux que d’exercer sur ce blanc les tortures raffinées que n’eût pas manqué de leur suggérer la haine séculaire qu’entretiennent les incessants conflits des deux races.
Mais ils savaient que leur chef était l’associé des deux Yankees et agissait de concert avec eux.
Lorsque Léopold, un peu remis de la secousse, fut entré sous la hutte, la vue de Madeleine évanouie et attachée excita en lui une colère qu’il ne sut pas réprimer. Il en oublia même le sentiment de la prudence et éclata en vifs reproches :
– Misérables, s’écria-t-il, voilà donc de quelle manière vous avez traité cette pauvre enfant !
Gisber Schulmann, tout aussi irascible que Léopold, ne supporta point cette apostrophe. Il répondit rudement :
– Vous devez bien comprendre que nous n’avons pu traiter la demoiselle comme l’aurait fait une femme de chambre. Ce n’est pas notre faute s’il nous a fallu recourir aux grands moyens. À la guerre comme à la guerre. D’ailleurs, le seul qui n’ait pas le droit de s’en plaindre, c’est vous, puisque c’est pour vous que nous travaillons.
– Pour moi ? se récria Sourbin. Ce n’est point là ce que je vous avais demandé, ce que vous m’aviez promis. N’était-il pas convenu que vous deviez me débarrasser de l’autre, de ce godelureau qui se jette en travers de ma route ?
Ulphilas Pitch, qui ne se départait de sa politesse doucereuse que dans les cas désespérés, se mit en devoir de réfuter ces assertions.
– Sans doute, sans doute, monsieur Sourbin, nous vous avions promis cela. Nous vous aurions promis tout ce que vous auriez demandé, pour vous faire plaisir, pour renouer de bonnes relations avec vous.
Mais il y a un proverbe de votre pays, si je ne me trompe, qui dit : « Promettre et tenir sont deux ». Nous nous sommes inspirés de cette parole très sage, et, au lieu de tuer Georges Vernant, nous avons préféré nous emparer de la riche demoiselle.
– C’est-à-dire que vous avez voulu par des menaces ou des tortures lui extorquer quelque grosse somme à vous partager ?
L’ex-Norvégien devenu Américain hocha la tête avec un silencieux ricanement.
– Comment se fait-il, monsieur Sourbin, que vous qui êtes un homme intelligent, vous n’ayez pas mieux compris nos intentions ? Non, nous n’avons pas formé d’aussi noirs projets. Nous nous sommes souvenus simplement de notre contrat : et nous avons craint que si nous vous laissions épouser la demoiselle loin de notre présence, vous oublieriez peut-être de nous inviter à la noce. Alors nous avons pensé qu’il serait plus équitable et plus avantageux pour tous de célébrer ce mariage un peu moins brillamment peut-être, mais avec assez de régularité pour que nul n’en puisse contester la validité. Il n’est pas impossible de trouver dans la prairie quelque bon prêtre catholique, missionnaire, qui vous donne la bénédiction nuptiale. Quant aux témoins, Gisber et moi, nous serons heureux d’en remplir les fonctions, par amour pour vous.
Cet odieux persiflage exposait avec une sinistre clarté le plan odieux dont les deux bandits poursuivaient la réalisation.
Certes, Léopold Sourbin n’était point de ceux que les scrupules gênent aux entournures. Mais, à l’audition de ces cyniques propos il sentit tout ce qui lui restait de délicatesse se révolter. Il voulut protester.
La conscience de sa faiblesse, de son impuissance à agir, lui cloua la parole sur les lèvres.
Il se souvint fort à propos des recommandations que lui avait faites Wagha-na, et son courage lui revint un peu à la pensée que le Bison Noir et ses acolytes le suivaient à distance, épiant l’occasion de se jeter sur la bande pour le délivrer en même temps que Madeleine.
Or, toute cette conversation des trois hommes, la jeune fille l’avait entendue.
Elle avait, en effet, repris ses sens au cours de leur dialogue. Une immense lassitude, paralysant ses membres, l’avait tenue immobile, si bien qu’aucun des trois complices ne s’était aperçu de son retour au sentiment. Et, de la sorte, l’orpheline avait pu entendre et faire son profit des révélations que lui fournissait l’odieux entretien.
Elle eut assez d’empire sur elle-même pour réfréner l’indignation qui faisait bouillonner tout son sang.
Mais lorsque, au bout de quelques instants, Schulmann et Pitch, peut-être afin de mieux connaître les pensées de leur ex-complice, sortirent de la hutte, laissant Sourbin seul auprès de sa cousine, celle-ci ne put dissimuler son profond mépris.
– Les proverbes disent vrai lorsqu’ils assurent qu’on ne juge un homme qu’à ses actes. Je ne vous connaissais guère, monsieur Sourbin. Je vous connais tout à fait aujourd’hui. Rien ne donne de la clairvoyance comme le malheur. Monsieur mon cousin, je ne sais vraiment ce qui l’emporte en vous de la suffisance ou de la lâcheté.
Léopold sentit son front s’empourprer. Une colère le gagna. Mais la vue de Madeleine enchaînée, de ce beau visage pâli, lui inspirèrent une véritable amertume.
– En vérité, ma cousine, dit-il, je ne sais, moi, ce qui m’attire de votre part une aussi virulente apostrophe.
Madeleine, cette fois, ne put contenir son aversion. Elle rappela au jeune homme l’entretien qu’il venait d’avoir avec les deux misérables et le pacte qui les enchaînait à eux. Elle en avait assez appris pour pouvoir préciser elle-même, par un seul effort de son imagination, les détails qui lui échappaient encore, les points qui auraient pu demeurer obscurs devant son esprit. Sourbin fut atterré. Il désespéra de pouvoir convaincre sa cousine de son innocence relative en l’abominable complot qui l’avait livrée aux mains de ses ennemis. Peu s’en fallut que ce découragement ne le poussât à s’associer définitivement aux infâmes projets de Pitch et de Schulmann.
Mais, une fois encore, ces projets furent déjoués par l’intervention des événements.
Brusquement, au milieu du silence et de la solitude des bois, un coup de feu éclata.
Léopold, qui était demeuré muet à la suite de l’apostrophe de Madeleine, tressaillit et se leva en sursaut.
Il ouvrit la porte et se heurta à Pitch qui rentrait, donnant les signes d’une profonde inquiétude.
– Vite, vite, cria le Yankee, en selle. Nous sommes poursuivis. Il est probable que Wagha-na est à nos trousses.
En même temps, le cacique Magua se ruait dans l’intérieur de la cabane, saisissait brutalement la prisonnière par un bras, et, comme elle ne pouvait marcher à cause de l’entrave qui gênait ses pas, la traînait au dehors et la livrait aux bras d’un de ses guerriers, en lui criant :
– Si la femme pâle fait un geste, pousse un seul cri, plonge ton couteau dans sa poitrine.
Léopold n’eut pas le temps de s’élever contre cette violence. Il comprit, d’ailleurs, que résister en pareil moment, ce serait précisément hâter la catastrophe qu’il voulait éviter. Un espoir le ressaisit de vaincre l’antipathie et les dédains de sa cousine, et obéissant, cette fois, plus à l’amour qu’à la cupidité, il enfourcha son propre cheval qu’on lui avait amené, non sans avoir laissé tomber sur le seuil de la hutte l’une des graines rouges que lui avait données le Bison Noir.
Tout en fuyant sous le couvert de la forêt qui les abritait, il put dire à Pitch :
– On m’a pris mes armes. Avec quoi voulez-vous que je me défende, si l’on nous attaque ?
Pitch se rendit compte de la vérité de cette réflexion. Il était sûr de tenir son Sourbin ; il ne vit donc aucun empêchement à lui confier l’un des deux revolvers qui garnissaient ses propres fontes.
C’était une excellente intention qu’avait eue là Léopold.
Il n’avait que trop bien entendu l’ordre donné par le chef Comanche à son subordonné, et comme il savait les sauvages capables de s’emporter à toutes les violences, le cousin de Madeleine avait pris cette précaution. Il galopait maintenant à côté de l’Indien, prêt à lui casser la tête s’il le voyait lever la main sur la prisonnière.
Tous ces événements s’étaient accomplis en moins de vingt-quatre heures. Il y avait un jour à peine que Wagha-na avait confié à Sourbin la mission délicate de guider ses recherches. Une longue et froide nuit s’était écoulée pendant laquelle Madeleine n’avait pas recouvré un seul instant la conscience de ce qui se passait autour d’elle. Mais dans ce délai, les chevaux surmenés des Comanches n’avaient pu fournir une bien longue étape, celui de l’Ours Gris surtout, qui avait à porter une double charge.
Aussi Wagha-na et ses compagnons avaient-ils pu suivre sans trop de difficultés la piste laissée par Sourbin.
Ils étaient même au moment de surprendre le campement provisoire de leurs ennemis, lorsque le hennissement du cheval de Joë O’Connor avait donné l’éveil aux factionnaires disséminés par Magua aux confins de la forêt et de la plaine.
L’un d’eux avait pu ramper jusqu’au voisinage de l’Irlandais et, jugeant l’occasion favorable, avait décoché une flèche qui avait frôlé le crâne du vieux trappeur.
Celui-ci n’était pas patient de son naturel. Juste en ce moment il se tenait appuyé sur sa carabine. La riposte ne s’était pas fait attendre. Joë avait tiré sur une ombre qu’il voyait se mouvoir dans le fourré. Mais comme la balle de Joë était quasiment infaillible, elle avait traversé de part en part le ventre de l’Indien.
C’était le bruit de ce coup, suivi du cri d’agonie du blessé, qui avait averti les Comanches.
Il n’y avait pas à revenir sur l’intempestive vivacité de l’Irlandais. Wagha-na donna donc l’ordre de charger sur-le-champ, à bride abattue. Peut-être parviendrait-on à rejoindre l’ennemi.
Le bois que l’on traversait n’était point aussi étendu qu’il était épais. Au delà la plaine recommençait, permettant la chasse à vue. Or Pitch et Schulmann, aussi bien que l’Ours Gris, savaient désormais à quoi s’en tenir sur le courage et l’opiniâtreté de leurs adversaires. Ils comprenaient que ceux-ci ne se lasseraient pas, et comme ils ignoraient leur nombre, aucune autre ressource qu’une fuite rapide ne s’offrait à eux d’éviter la terrible vengeance que ne manqueraient pas d’exercer les amis de Madeleine.
Dans de telles conditions, Pitch avait conçu des intentions moins cruelles à l’égard de celle-ci.
Il ne s’agissait plus de la tuer maintenant, mais, bien au contraire, de veiller attentivement sur ses jours. N’était-elle pas un otage entre leurs mains, le seul moyen de sauver leurs vies en proposant l’échange au Bison Noir, dont la haine devait être implacable ?
Il était si bien dans ces pensées qu’il ne se montrait pas moins attentif que Sourbin lui-même à surveiller l’Indien qui emportait la jeune fille évanouie.
Mais, d’autre part, autant il était nécessaire d’emmener l’orpheline saine et sauve, autant il fallait empêcher qu’elle ne retombât au pouvoir de ses vaillants libérateurs.
Or, le cheval de l’Indien, bête d’une rare vigueur, avait fourni, depuis plus d’une semaine, d’invraisemblables chevauchées. Il était impossible de lui demander plus qu’il n’avait donné, et déjà sa course saccadée, haletante, montrait une fatigue énorme. Si la bête était fourbue, ou s’abattait sur le chemin, Madeleine serait perdue pour les ravisseurs.
Ces réflexions, Ulphilas Pitch les avait faites tout en éperonnant vigoureusement sa propre monture, laquelle ne valait guère mieux que celle du Comanche. Le Yankee se surpassait. Pour un homme qui avait toujours préféré la diplomatie à la violence, il faisait preuve, depuis quelque temps, de qualités qui eussent fait le plus grand honneur à un écuyer de profession.
XIII
HIPS ET GOLA
Il y avait près d’une heure que les Comanches et leurs trois compagnons de race blanche couraient dans les sentiers naturels qui sillonnaient la forêt. Il avait fallu tous les obstacles qui se dressent dans une course de ce genre pour la prolonger ainsi. Mais, par là même, les bêtes haletantes en avaient subi une fatigue plus grande, contraintes de franchir tour à tour des ruisseaux et des fondrières, des haies et des fourrés épineux.
La lisière du bois apparut enfin, au-delà de laquelle la plaine recommençait, immense, à peine coupée, çà et là, d’autres bois semblables.
Là était le péril pour les ravisseurs, là l’espoir pour les vaillants qui s’étaient élancés à leur poursuite.
À peine le guerrier Comanche, escorté de Pitch et de Sourbin eut-il débouché dans la prairie, que deux autres cavaliers sortirent du couvert, emportés par un galop furieux.
Ceux-là, il était impossible de ne les point reconnaître. Ni Pitch, ni Sourbin ne se trompèrent en les apercevant.
L’un des cavaliers était Georges Vernant, l’autre Wagha-na en personne.
Et derrière eux, deux autres encore apparaissaient, Joë O’Connor et Sheen-Buck, suivis à leur tour par une dizaine des compagnons ordinaires du Bison Noir.
La chasse se donnait en plaine cette fois. C’était à qui gagnerait de vitesse.
Mais, de l’autre côté, l’Ours Gris se montrait, suivi d’une quinzaine de ses plus braves guerriers. Parmi eux se dissimulait du mieux qu’il pouvait l’Allemand Gisber Schulmann.
Pitch sentit son cœur se serrer. Il ne tenait pas absolument à une rencontre.
Et comme il passait à côté de Léopold, il ne put s’empêcher de lui dire, toujours courant :
– Décidément, monsieur Sourbin, il va y avoir bataille. Si vous m’en croyez, gagnons de vitesse. L’occasion peut se retrouver et la vie vaut mieux que l’argent. Je ne me soucie pas de laisser la mienne en ce triste pays.
Il jeta les yeux autour de lui, et ce regard circulaire ne fit que confirmer ses légitimes appréhensions.
Derrière lui, le Comanche faiblissait visiblement. Quoique de race très pure et d’une rare vigueur, le mustang hoquetait et ne courait plus que par soubresauts, par bonds inégaux et désordonnés.
Sourbin lui-même s’attardait. Mais la cause de ce retard était tout autre que ne la supposait le Yankee.
Le cousin de Madeleine, en effet, n’avait rien à craindre pour lui-même d’une bataille, du moins à l’heure présente, puisque les apparences étaient pour lui. Ne se conformait-il pas aux prescriptions de Wagha-na ?
Au lieu donc de presser sa fuite, le Français retenait sa bête, afin de ne point perdre de vue l’Indien qui tenait toujours la pauvre Madeleine renversée en travers de la selle. Le plan de Sourbin était très simple. Il ne voulait pas laisser à Georges, au rival abhorré, le mérite d’avoir sauvé l’orpheline. Ce serait lui-même, Léopold, qui brûlerait la cervelle au Comanche, quand il jugerait le Canadien à bonne portée.
Quant à Georges, il n’arriverait sur le théâtre du combat que pour se trouver aux prises avec Magua et les plus rapprochés de ses guerriers.
Ce n’était vraiment pas trop mal combiné, et Ulphilas Pitch, si fier de son génie diplomatique, n’aurait certainement pas mieux imaginé le moyen de jouer un double jeu.
Tandis que ces machiavéliques réflexions hantaient l’esprit de Léopold Sourbin, Georges Vernant et Wagha-na gagnaient visiblement du terrain sur leurs ennemis. Bientôt même il fut évident que l’un et l’autre des deux hardis cavaliers arriveraient à temps pour sauver l’infortunée jeune fille.
Car ils étaient merveilleusement montés l’un et l’autre. Hips et Gola, que Georges et Wagha-na prenaient à tour de rôle, étaient des bêtes fantastiques, possédant la vitesse et le fond inépuisable des chevaux Arabes. Il n’était pas un seul des mustangs nés sur la terre d’Amérique qui pût rivaliser avec ces coursiers prodigieux, les premiers-nés des haras modèles que le Bison Noir avait installés lui-même au sein de ses domaines.
Chaque élan des superbes animaux les rapprochait davantage de l’Indien qui ne luttait plus que dans l’intention de permettre à son chef de l’atteindre. Une fois, en se retournant sur la selle, il aperçut Georges à moins de cent mètres de lui et l’idée lui vint de faire usage de son arc. Mais gêné dans ses mouvements par le fardeau qu’il emportait, il renonça sur-le-champ à cette tentative de défense.
Un second coup d’œil lui montra le jeune Canadien à quatre-vingts pas en arrière. Il entendit le galop furieux de Hips sur ses talons et la voix puissante du cavalier lui criant :
– Rends-toi, ou je fais feu !
Et il vit Georges debout sur les étriers, épaulant rapidement sa carabine.
En même temps, Madeleine, par un effort désespéré, se redressa et appela :
– À moi, Georges, à moi !
L’Indien se pencha sur sa prisonnière, et, se retournant sur sa selle avec une prodigieuse adresse, présenta la jeune fille à la carabine déjà couchée enjoue.
Vernant redressa l’arme avec un rugissement de rage. C’eût été folie que d’essayer de tirer en une aussi difficile position. Il pouvait tuer la jeune fille en essayant de frapper le ravisseur.
Alors, se penchant sur l’encolure du cheval, il le flatta de la paume, en prononçant de douces paroles, ainsi que le faisait Wagha-na lui-même.
Hips comprit-il ce langage ? Il est certain que l’intelligence assez restreinte du cheval acquiert, dans ses relations avec son cavalier habituel, un accroissement de facultés qui peut paraître invraisemblable à ceux qui ne connaissent que superficiellement les qualités du généreux animal.
En cette circonstance, le coursier que montait Georges Vernant parut, selon l’expression du poète « se conformer » à la pensée de son cavalier. Changeant brusquement d’allure, comme s’il eût deviné que son rival le mustang devait être battu par le fond plus encore que par la vitesse, il prit un trot allongé, aussi soutenu qu’un galop de course, et fonça obliquement sur le Comanche.
De l’autre côté, Gola, calquant ses mouvements sur ceux de Hips, prit comme lui une course oblique de manière à enfermer l’Indien et Sourbin dans un angle aigu.
Les deux cavaliers laissèrent faire leurs bêtes, comprenant qu’en ce moment leur instinct valait mieux que toute direction calculée. Wagha-na et Georges rendirent donc en même temps les rênes, et courbés sur le cou de leurs chevaux, le revolver d’une main, la hache de l’autre, s’apprêtèrent au combat.
Le sauvage détourna une fois encore la tête. Il vit Georges à cinquante pas, Wagha-na à soixante. Alors, il se sentit perdu.
Sur sa droite, l’Ours Gris avait encore plus de deux cents mètres à franchir avant de se retrouver à portée pour le secourir. Les autres Indiens, malgré leur empressement, étaient encore à une très grande distance pour pouvoir soutenir une lutte, d’ailleurs impossible entre leur frère isolé et les deux redoutables champions qui le pressaient.
L’homme pouvait néanmoins se sauver. Il lui suffisait, en effet, de laisser glisser Madeleine sur le sol. C’était à la fois décharger sa bête d’un poids considérable et occuper assez longtemps l’attention de ses ennemis pour s’accorder à lui-même le temps de prendre une sérieuse avance.
Bien plus : il était croyable que le père et le fiancé de l’orpheline borneraient là leur poursuite, n’ayant aucune raison de s’acharner contre un adversaire désormais vaincu. D’ailleurs les soins à donner à la prisonnière les contraindraient à faire retraite immédiatement vers leur campement.
Toutes ces réflexions se présentèrent assurément à l’esprit du féroce Indien, et ne les aurait-il pas conçues spontanément qu’il suffisait, pour les lui suggérer, de l’appel pressant des deux hommes, lui criant :
– Rends-toi, et il ne te sera fait aucun mal. Tu seras libre !
Mais chez ces races demeurées primitives au sein de leur déchéance, les passions sont aussi violentes que le cerveau est obtus et entêté. L’instinct de la conservation ne fut pas le plus fort en cette âme de brute. L’Indien, dominé par la haine de races, pensa que ce serait une mort glorieuse qui le frapperait dans l’accomplissement de sa vengeance, sur le cadavre d’une victime blanche.
Alors la rage du meurtre s’empara de lui, furieuse, irrésistible.
Il porta la main à sa ceinture et en tira son bowie-knife dont la large lame brilla d’un sinistre éclair.
Ni Georges, ni le Bison Noir n’étaient assez rapprochés pour secourir la jeune fille.
Heureusement pour la pauvre enfant, Léopold Sourbin était aux côtés de l’Indien.
Il vit le danger que courait sa cousine et avec une spontanéité de sentiment qui rachetait toutes ses violences passées, il ne songea qu’à l’y arracher. Plus prompte encore que celle de l’Indien, sa main se leva, armée du revolver que lui avait prêté Pitch, et le bras du Comanche retomba brisé. La balle lui avait fracassé le poignet.
Un cri de douleur et de rage jaillit de la poitrine du sauvage. Le couteau s’était échappé de ses doigts inertes.
Pourtant, il ne renonça point à sa vengeance. Sa main gauche s’abattit sur le cou de l’orpheline renversée et s’y serra violemment.
Mais Madeleine, ressaisie par l’espoir de la délivrance, s’était redressée. Elle repoussa convulsivement l’étreinte du misérable Indien qu’elle rejeta sur le dos de sa selle. Une secousse du cheval épuisé la jeta lourdement sur le sol de la prairie, où elle demeura sans mouvement.
En ce moment, Georges arrivait à la hauteur du Comanche. Vivement il tira sur le mors, au risque de se désarçonner lui-même. L’animal s’arrêta court et le cavalier sauta rapidement à terre. Il releva la jeune fille meurtrie et la plaça sur le dos de Hips, fumant et haletant.
Madeleine, par bonheur, n’avait pas perdu connaissance. Bien que fortement contusionnée, elle put se tenir assez droite, pendant que Georges, tenant le cheval par la bride, la carabine au poing, battait en retraite dans la direction du secours amené par Joë et Sheen-Buck.
– Déjà Wagha-na l’avait rejoint et s’informait avec sollicitude auprès de Madeleine des conséquences de sa terrible chevauchée. Elle le rassura d’un sourire et, malgré son extrême lassitude, put affirmer qu’elle n’avait ni blessures ni lésions internes.
Mais ce n’était là qu’une demi-victoire ou, plutôt, un avantage momentané, la première manche seulement d’une effrayante partie que l’ennemi pouvait encore gagner grâce à la supériorité du nombre.
En effet, le Comanche, malgré sa blessure, paraissait disposé à revenir au combat, soutenu par l’Ours Gris et les compagnons. Plus que toute autre cause, la honte de son échec, jointe à la prévision des furieux reproches qu’allait lui adresser son chef, le poussait à cette résolution désespérée, si fort en désaccord avec l’ordinaire prudence de ses pareils.
Cependant Sourbin avait, lui aussi, battu en retraite et recevait maintenant les chaudes félicitations de Georges et de Wagha-na. Ce dernier lui avait même tendu la main, avec ces paroles de haute estime :
– Je vous sais un gré infini de ce que vous avez fait là, Monsieur. Vous avez exécuté à la lettre le programme que je vous avais tracé. Ce n’est point votre faute si nous ne sommes pas arrivés plus tôt.
Madeleine au contraire, la plus intéressée, n’avait fait preuve d’aucun enthousiasme.
Elle avait dit simplement au Français avec une assez dédaigneux accent :
– Je vous remercie, mon cousin. De votre part, cela me touche davantage.
Et cette froideur visible avait impressionné si vivement ses deux amis, qu’ils en étaient devenus subitement silencieux.
Wagha-na se retourna vers la plaine. Il vit l’Ours Gris et ses hommes à moins de cinquante mètres de lui.
– Allons, Messieurs, dit-il, ils sont dix, nous sommes trois. La partie est égale.
C’était le mot héroïque de Changarnier pendant la retraite de Constantine.
– Madeleine, demanda-t-il à la jeune fille, aurais-tu la force de courir jusqu’à la rencontre des nôtres ?
Il montrait Joë O’Connor et Sheen-Buck encore à deux cents mètres d’eux. Elle répondit :
– Pourquoi ne resterais-je pas avec vous ?
– Parce que, répondit Wagha-na, nous allons faire usage de nos fusils. Cela nous permettra d’arrêter ces coquins le temps nécessaire à assurer ta fuite.
Elle comprit et n’insista pas. On lui donna le cheval de Sourbin, le moins bon, parce qu’il faudrait peut-être, dans un instant, recourir aux jambes des deux autres pour emporter Léopold lui-même.
Tout cela s’était accompli en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Les Comanches n’étaient plus qu’à trente mètres.
Wagha-na et Georges s’étaient abrités derrière Hips et Gola, placés tête contre tête. Ils avaient appuyé leurs armes sur les selles, ne voulant perdre aucune balle. Georges visa le Comanche blessé, Wagha-na le chef lui-même.
Un double coup de feu éclata. Le Comanche roula sous son cheval, l’Ours Gris passa par-dessus la tête du sien qui venait de s’abattre, le cœur broyé.
– Encore ! commanda le Bison Noir.
Et, comme les magasins étaient suffisamment garnis, deux nouveaux cavaliers ennemis vidèrent les arçons.
Les six autres jugèrent le péril trop grand. Ils croyaient leur chef tué. Ils se mirent donc à fuir sans nulle honte.
Mais Magua, qui n’était pas même blessé, s’était dégagé des étriers. Il avait saisi la monture d’un de ses guerriers morts ; et, maintenant, avec une incontestable bravoure, il s’avançait, au pas de sa bête, prodiguant d’héroïques défis à ses adversaires.
– Wagha-na est un lâche qui a perdu les mœurs de sa race. Il est né d’une chienne domestiquée par les blancs pour faire la chasse aux Rouges. Il se cache derrière son cheval et il se fie à sa carabine, parce que le plomb des visages pâles va plus loin que les flèches des fils aînés du Grand Esprit. Mais il n’oserait affronter le tomahawk d’un homme libre.
Wagha-na se tourna une fois encore vers les deux extrémités de la plaine.
D’un côté, il vit Madeleine hors de la portée des traits et déjà recueillie par le petit groupe des Sioux qui avaient suivi Sheen-Buck et O’Connor. De l’autre, il aperçut les Comanches immobiles. Ils avaient arrêté leur course et, accompagnés de Pitch et de Schulmann, rejoints par un plus grand nombre des leurs, ils assistaient de loin à la suprême bravade de leur chef.
Le Pawnie mit le pied à l’étrier et mit Gola face à l’Ours Gris.
– Que faites-vous ? demanda Georges Vernant avec stupeur.
Wagha-na sourit :
– Vous le voyez ; je vais répondre aux provocations de ce brave.
Le jeune Canadien ne put se défendre d’un étonnement qui ressemblait à un reproche.
– Vous n’y pensez pas ? s’écria-t-il. Exposer votre vie dans un duel de cette nature, vous, le chef, le créateur, l’inspirateur de la belle œuvre que vous avez jusqu’ici menée à bonne fin ? Permettez-moi de vous le dire : c’est plus que de l’imprudence. C’est une faute que vous commettez.
– Non, mon cher Georges. C’est précisément mon œuvre que j’entends poursuivre et servir en cette circonstance.
En combattant contre cet homme qui, d’ailleurs, mérite mieux qu’un coup de fusil, je joue une belle partie. Je vais lui demander pour enjeu l’obéissance de sa tribu.
– Laissez-moi, au moins, combattre à votre place. Ma vie n’est pas précieuse comme la vôtre.
– Non, encore une fois. À quel titre réclameriez-vous l’obéissance de ces Indiens qui, d’ailleurs, ne vous l’accorderaient pas ? Moi, au contraire, en combattant cet homme à armes égales, à la manière indienne, j’ai le droit d’exiger de lui une mise de jeu. C’est la règle ordinaire des défis et des combats singuliers chez ceux de notre sang.
Il ajouta du même ton paisible, avec le même sourire de sereine confiance :
– Soyez sans inquiétude ! J’ai encore quelque vigueur et j’ai terrassé des ennemis bien autrement redoutables que ce garçon-là qui n’a pour lui que son courage, très réel, mais insuffisant.
Georges Vernant ne s’opposa plus au désir du Bison Noir. Mais, n’ayant pas les mêmes scrupules que son ami, redoutant quelque trahison de la part des assistants, il se remit lui-même en selle, prêt à porter secours au père adoptif de Madeleine.
Celui-ci, remettant son revolver dans les fontes, s’était défait de sa carabine qu’il avait laissée aux mains de Sourbin, spectateur ému du duel épique qui se préparait, et auquel l’émotion ôtait la parole. Il ne conservait que sa hache et le long poignard, armes familières aux Indiens dans leurs combats singuliers.
Cela fait, il poussa Gola à la rencontre du chef Comanche et, arrivé à dix pas de lui, leva la main droite, signe de parlementaire, réclamant ainsi l’attention de ses ennemis pris comme auditeurs.
– Moi, Jean Wagha-na, le Bison Noir, commença-t-il, né de votre sang, car le sang des Hommes Rouges est le même pour toutes les tribus qui se font une guerre impie, je déclare que je n’ai jamais fait la guerre à mes frères, que je les ai soutenus, aidés, défendus, de mon bien et de mon bras contre toutes les exigences injustes, que j’ai essayé de les réunir en un seul peuple, que si j’ai repoussé par la force l’agression des Comanches, c’est parce qu’ils ont refusé de m’entendre et qu’ils m’ont attaqué les premiers.
Je déclare au surplus que, même à l’heure présente, je ne cherche point la querelle, que je n’élève aucune prétention et que j’ai simplement repris à des mains criminelles ma fille que l’on voulait me ravir.
– Les mains criminelles, ce sont les mains de Wagha-na le traître, interrompit Magua en grinçant des dents. Tu n’oses point accepter le combat avec l’homme qui vaut mieux que toi.
Gola fit encore un pas en avant, et le Bison Noir, se dressant sur les étriers, apostropha directement son ennemi.
– Chien, lui cria-t-il, je suis prêt à te châtier de ton insolence. Mais quel gage m’offres-tu de ta bonne foi ? Voici le mien. Pour toi, ordonne à ceux qui te suivent de se soumettre à moi si tu es vaincu dans la lutte.
L’Ours Gris eut un sourd grondement de colère au moment où, joignant l’action à la parole, le Pawnie jeta sur le sol une bourse largement garnie de bank-notes. Il y en avait pour cent milles dollars, ainsi que le fit voir Wagha-na.
– Tu m’estimes au-dessous de ma valeur, rugit le Comanche, dont les yeux brillaient de convoitise.
– Combien t’estimes-tu toi-même ? demanda le Pawnie.
L’autre eut un geste d’orgueilleuse jactance et répondit d’une voix éclatante.
– Deux millions de dollars.
– Allons ! fit Wagha-na, tu n’es brave qu’en paroles et tu veux éviter le combat. Je double la somme.
Et, tirant de son sac de cuir une seconde liasse, il l’envoya rejoindre la première dans l’herbe.
XIV
LE DERNIER EXPLOIT DE SOURBIN
La dernière apostrophe de son ennemi fut l’étincelle qui enflamma la colère de l’Ours Gris.
Avant même que Wagha-na eût prévu l’attaque et se fût mis sur la défensive, le Comanche avait brandi sa hache et, piquant son cheval, s’était rué sur le chef des Peaux Rouges ralliés.
L’arme siffla, lancée par une main exercée à ce genre d’escrime. Elle aurait infailliblement brisé le crâne de Wagha-na si celui-ci, avec la souplesse d’un félin, ne se fût laissé glisser sur l’encolure de sa bête.
La hache ne rencontra que la tête de Gola auquel elle déchira l’oreille droite et vint se planter à moitié dans le pommeau de la selle, non sans avoir ouvert une assez large entaille à la cuisse droite du Bison Noir.
Celui-ci se redressa, rendant la bride à son coursier.
L’animal blessé fit entendre un hennissement de fureur et se rua sur la monture du Comanche.
Ce fut un terrible choc sous lequel le mustang, fléchit. Ses jambes de derrière touchèrent le sol et la main du Bison Noir se tendit, sans arme, pour saisir son adversaire.
Mais un brusque mouvement du cheval ennemi le remit sur ses pieds. Wagha-na ne saisit que le manteau du Comanche.
Déjà celui-ci fuyait, se dérobant à l’étreinte du Pawnie.
Il avait manqué son coup d’attaque et, privé de sa hache, son arme favorite, il cherchait à gagner de vitesse afin de pouvoir la ressaisir au passage, lorsqu’il aurait détourné son adversaire.
Mais le Bison Noir connaissait cette tactique.
Au lieu de poursuivre Magua, il demeura sur place, les pieds de Gola se posant sur le tomahawk qu’ils enfoncèrent dans le sol herbeux et gras.
Pendant ce temps, l’impassible Wagha-na, sans s’occuper de sa propre blessure, ôtait de son sac une bande de toile qu’il employait à panser la plaie faite à l’oreille de son fidèle coursier.
À vingt pas de distance, le Comanche l’invectivait avec la même forfanterie.
Le Bison Noir souriait dédaigneusement.
Quand il eut achevé le pansement de sa monture, il la fit pivoter et se penchant en un effrayant équilibre, il ramassa sur le sol la hache de l’Ours Gris et la lui tendant de la main gauche.
– Viens la prendre ! lui cria-t-il.
C’était un défi insultant qui provoqua chez le Comanche un nouvel accès de fureur.
– Oui, – répliqua-t-il, – je vais la prendre. Les spectateurs de ce drame poignant purent le voir, courbé sur son cheval, lancer celui-ci ventre à terre sur le Pawnie. Le cavalier tenait de la main droite son bowie-knife, tandis que la gauche s’allongeait pour saisir le tomahawk que lui tendait le bras allongé de Wagha-na.
Et il semblait que celui-ci, par une folie de générosité, se livrât lui-même à la merci de son perfide ennemi.
Mais ceux qui jugeaient de la sorte ne connaissaient point la prodigieuse adresse et la redoutable vigueur du Bison Noir. L’homme qui avait soutenu trois ans la lutte contre les Yankees était un héros dans la plus large acception de ce mot glorieux.
Au moment où l’Ours Gris, emporté par la course du mustang, se précipitait sur lui, Wagha-na leva brusquement la hache, et comme le Comanche, obligé de se dresser à son tour pour l’atteindre, levait lui-même son bras gauche, celui du Pawnie, abandonnant le tomahawk, qui retomba sur le sol, se liait comme un lasso de fer à la taille de l’assaillant, l’arrachait à sa propre selle pour le jeter, impuissant et vaincu, sur le cou de Gola.
Il avait fallu pour accomplir ce tour de cirque une force presque surhumaine. Mais cela avait été exécuté avec une telle aisance qu’une longue clameur d’admiration s’éleva des deux côtés de la plaine, aussi bien des bouches ennemies que de celles des compagnons du héros.
Alors, après avoir arraché au vaincu, étourdi par la secousse, son couteau désormais inutile, le Bison Noir s’élança en galopant au-devant des guerriers Comanches frappés de terreur et de respect.
– Vous êtes à moi par les lois du combat, leur cria-t-il. Je ne ferai aucun mal à Magua, je ne prendrai ni sa chevelure ni les vôtres. Que deux d’entre vous aillent vers votre tribu pour raconter la chose aux têtes blanches et leur dire que Wagha-na vous appelle tous à fumer le calumet de paix aux campements du lac Winnipeg.
Interdits, humiliés, mais surpris par cette grandeur d’âme du vainqueur, les guerriers mirent pied à terre et jetèrent leurs armes devant le Pawnie triomphant.
Alors celui-ci desserra l’étreinte de ses doigts qui faisaient un collier de fer à son ennemi, et le posant sans rudesse à terre, lui tint le langage suivant :
– Le Bison Noir n’a pas plus de haine en ce moment qu’il n’en avait tout à l’heure contre son frère Comanche.
L’Ours Gris a combattu en guerrier vaillant. Le sort lui a été contraire. Qu’il reprenne ses armes et qu’il montre son amitié à Wagha-na.
Pour toute réponse, le vaincu s’approcha du héros et prenant son pied droit le baisa avec respect. Puis il dit :
– Aucun homme ne s’est jamais vanté d’avoir vaincu l’Ours Gris. Magua a fait ce qu’il a pu ; il n’a rien à se reprocher.
Et, maintenant, il reconnaît devant ceux de sa tribu et devant le ciel où règne le Grand Esprit que Wagha-na, le Bison Noir, est le plus grand et le meilleur des hommes. Magua prend pour père le Bison Noir.
– À la bonne heure ! s’écria en français le père adoptif de Madeleine. Nous finissons par où nous aurions dû commencer. N’importe ! Que le nom de Dieu soit béni !
Il mit alors pied à terre et fit signe aux siens de se rapprocher.
Joë O’Connor, avant tout autre soin, s’empressa d’aller ramasser dans l’herbe la bourse et les bank-notes qu’y avait jetés le Pawnie, en disant à Sourbin qui paraissait sortir d’un rêve.
– Ça, voyez-vous, Monsieur, ça ne se trouve pas sous les pieds d’un mustang, excepté quand quelqu’un l’y jette, comme aujourd’hui. Il ne faut donc pas le laisser traîner.
Sioux et Comanches échangèrent les présents de l’amitié. Wagha-na tira des fontes l’un des magnifiques revolvers qu’il y avait laissés et le donna à l’Ours Gris avec six paquets de cartouches.
– Voilà le premier cadeau du père à son fils, lui dit-il.
Brusquement son front se rembrunit, ses sourcils se froncèrent.
– Qu’avez-vous fait des deux Yankees qui étaient avec vous ? demanda-t-il presque durement.
Dans les deux camps, on se regarda avec inquiétude et stupéfaction.
C’était vrai, pourtant. On les avait oubliés, ceux-là.
Mais, si les sauvages les avaient négligés, Pitch et Schulmann ne s’étaient point négligés eux-mêmes.
Dès qu’ils avaient vu les chances du combat singulier tourner en faveur du Bison Noir, ils jugèrent, avec raison, que les choses se gâtaient pour eux. Sans en attendre l’issue définitive, ils allèrent tranquillement se ranger derrière les rangs des Comanches. Puis, profitant de l’inattention générale, ils gagnèrent un bouquet d’arbres qui masquait entièrement leur manœuvre.
Il faut croire qu’au moment où Wagha-na se souvint d’eux ils étaient déjà loin, car les cavaliers des deux camps eurent beau fouiller du regard l’horizon et fournir un temps de galop, pour les découvrir dans la plaine, les deux aventuriers demeurèrent introuvables.
– Tout est bien qui finit bien, prononça presque gaiement le chef pawnie en reprenant avec ses hommes le chemin du campement. Au moins, de cette façon, ces deux bandits m’ont épargné l’ennui de les pendre moi-même.
On dut refaire au petit trot tout le chemin fiévreusement parcouru depuis l’avant-veille. L’état de fatigue extrême auquel se trouvait réduite l’orpheline ne permettait point, en effet, une allure plus rapide.
Bientôt même on dut faire halte au bord du Murray. Chinga-Roa et ses Sioux y avaient dressé leurs tentes pour attendre le retour de leurs compagnons lancés à la poursuite. Ceux-ci rencontrèrent même le jeune chef qui, avec quarante cavaliers, s’était porté au-devant d’eux pour les soutenir s’ils en avaient besoin. Leur joie fut aussi profonde que sincère en reconnaissant leurs amis victorieux.
Mais, en arrivant au camp, Madeleine chancela sur sa selle. Aux questions pleines de sollicitude posées par son père adoptif et son fiancé, la jeune fille répondit avec effort, péniblement même, demandant qu’il lui fût permis de se reposer quelques instants.
On dressa donc sous la tente de Wagha-na un lit de camp, sur lequel Madeleine s’étendit avec une satisfaction manifeste. Hélas ! Elle ne s’y délassa guère. Une fièvre ardente, entrecoupée de délire et de coma, s’empara d’elle et, sur-le-champ, les plus graves inquiétudes torturèrent l’esprit de ses amis.
Ce furent de cruelles angoisses, pour tous, mais plus particulièrement pour les deux hommes dont la vie était en quelque sorte consacrée au bonheur de l’orpheline.
Wagha-na et Georges Vernant veillèrent à tour de rôle auprès de la pauvre enfant en proie à tous les assauts d’une congestion cérébrale. Dans ces régions éloignées de tout secours de la science, force est bien aux hardis pionniers qui les parcourent de suppléer eux-mêmes à l’office des médecins et des pharmaciens.
Par bonheur, Wagha-na, dans son long séjour en Europe, aussi bien que depuis son retour en Amérique, avait poussé fort avant des études médicales qui eussent fait honneur à plus d’un praticien renommé de l’ancien continent.
Son sac de voyage renfermait, entre autres choses utiles, une trousse complète et une petite pharmacie tenue au courant de tous les moyens employés par la pharmacopée contemporaine. Il y avait là dedans la farine de moutarde unie aux vésicants les plus énergiques, la quinine et la belladone sous leurs formes les plus diverses et leurs quantités les mieux dosées, les drogues dépuratives ou sédatives, les purgations douces ou violentes.
En un clin d’œil, Madeleine fut couverte de sinapismes et entourée de compresses d’eau glacée.
La lutte contre la maladie vigoureusement engagée, et prise à ses débuts, celle-ci fut heureusement enrayée.
Huit jours entiers, toutefois, la crainte hanta tous les cœurs.
Il n’était point, en effet, un seul des sauvages compagnons du Pawnie qui n’aimât cette belle et douce enfant dont les mains étaient toujours ouvertes pour une bonne action à accomplir.
Chaque matin, au lever du jour, Chinga-Roa, ou l’un de ses guerriers, venait s’asseoir silencieusement à l’entrée de la tente et, malgré le froid, chaque jour plus vif, de l’automne, attendait là, sans bouger, la sortie de Wagha-na ou de Georges pour prendre des nouvelles de la malade.
Ce fut avec une longue et bruyante joie que l’on apprit enfin que tout danger était conjuré.
Bientôt, la malade tint à confirmer elle-même la bonne nouvelle.
On la redressa sur sa couche, on l’adossa à un haut oreiller de laine et d’herbes fraîches, afin qu’elle fût plus à l’aise pour recevoir ses visiteurs. Alors, groupe par groupe, les Sioux entrèrent sous la tente et reçurent les premières paroles de la convalescente.
– Merci, mes amis, leur disait-elle avec un pâle sourire de ses lèvres décolorées, merci de votre sollicitude. Vous êtes tous bons, et je vous aime tous autant que vous m’aimez.
Elle disait cela d’une voix éteinte, brisée par la fièvre, et les farouches guerriers demeuraient silencieux. Beaucoup pleuraient comme des enfants à la vue de cette belle jeune fille devenue si blanche qu’elle en était presque transparente, à la vue de cette tête charmante que d’impitoyables ciseaux avaient dépouillée de sa longue et, luxuriante chevelure. Plusieurs tombaient à genoux devant elle et baisaient ses mains ; d’autres prosternés comme devant une sainte, cachaient leurs fronts dans les plis des couvertures étendues sur ses pieds.
Il n’était pas jusqu’à Léopold Sourbin qui n’eût subi une réelle transformation.
Pendant les premiers jours de la maladie de sa cousine, pris des mêmes terreurs que ses compagnons, il avait voulu, lui aussi s’asseoir à son chevet, veiller auprès de cette couche douloureuse.
Mais, malgré le service éclatant qu’il lui avait rendu, Wagha-na, guidé par une méfiance que le froid accueil de Madeleine avait corroborée, s’était opposé à toute intervention du Français.
Et, comme Léopold, froissé par cette suspicion, laissait voir son mécontentement, le Bison Noir lui avait durement répondu :
– Il est vrai que vous êtes le cousin de Madeleine, mais, moi, je suis son père. Le vôtre a été l’assassin de mon ami Kerlo. Il ne convient pas que la fille de la victime soit gardée par le fils du bourreau, surtout lorsque, en vertu de la loi, il en est le plus proche héritier.
Ces paroles cruelles avaient leur raison d’être. Mais peut-être venaient-elles un peu tard, aujourd’hui que Léopold avait fourni des preuves incontestables de sa bonne foi et de son dévouement.
Il est vrai que Wagha-na s’en tenait au proverbe : « Deux sûretés valent mieux qu’une ».
Ce mépris, bien qu’il lui parût injustifié, avait été d’autant plus sensible à Léopold qu’il se trouvait expliqué par la terrible révélation que l’Indien venait de lui faire.
Il se retira donc à l’écart et s’y abandonna à une très sincère douleur.
Tout lui manquait à la fois : l’espoir d’épouser sa cousine et la confiance passablement présomptueuse qu’il avait eue en lui-même jusqu’alors. Car il était si bien changé par les épreuves des derniers temps qu’à son insu même, il s’était considérablement amélioré.
Il ne songeait plus aujourd’hui à cette, fortune qu’il avait si bassement convoitée.
Il aimait Madeleine, aujourd’hui, d’un amour très pur et très désintéressé.
Et il comprenait bien que la jeune fille, au courant des crimes du passé, au courant de ses propres turpitudes, ne pouvait qu’à grand’peine lui pardonner son abominable conduite.
Une seule pensée maintenant occupait son esprit ; il ne formait plus qu’une ambition, celle de racheter ce passé, de rendre à sa cousine quelque suprême service après lequel il serait impossible à celle-ci de ne lui point pardonner, peut-être même de lui refuser une place dans ses affections.
Et, vraiment, à cette heure, il n’était même plus jaloux de Georges Vernant, dont il confessait l’écrasante supériorité.
Il se réjouit donc comme tout le monde de l’heureuse guérison de la jeune fille, mais, plein du sentiment de son indignité, il n’osa se présenter au chevet de la malade et demander à être reçu par elle.
Ce fut Madeleine elle-même qui remarqua son absence. Elle en parut attristée.
– Où donc est Monsieur Sourbin ? demandât-elle. Lui serait-il arrivé un malheur ?
Wagha-na répondit en riant :
– Non, Monsieur Sourbin est fort bien portant. S’il ne s’est point présenté ici, c’est peut-être parce qu’il me garde rancune de lui avoir interdit ta porte pendant toute la durée de ta maladie. J’ai été dur, j’en conviens, mais je devais l’être.
– Et maintenant, mon cher père, demanda doucement la fée, vous n’avez plus de raisons de l’être, j’imagine. Je serais très heureuse de revoir Monsieur Sourbin.
– Qu’à cela ne tienne ? s’écria gaiement le Bison Noir. Je veux tout ce que veut ma fille.
Quelques minutes plus tard, Sourbin pénétrait sous la tente et s’avançait vers la convalescente.
Il avait le cœur gros et son émotion éclata lorsque Madeleine, se soulevant sur sa couche, lui tendit sa pauvre main amaigrie, en lui disant avec le plus suave de ses sourires :
– Eh bien » mon cousin Léopold, je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Dois-je croire que vous me tenez rigueur pour le maigre remerciement que je vous ai adressé de votre dévouement ? Vous m’avez sauvé la vie, mais j’étais déjà si fort ébranlée, que je n’ai pu rassembler mes idées, ni trouver les mots que j’aurais voulu employer.
Il s’inclina, balbutiant, sur la main qu’il baisa. Les larmes se firent jour sous ses paupières. Il murmura :
– Vous n’aviez pas à me remercier, ma cousine. Ce que j’ai fait, je l’ai fait de grand cœur, vous pouvez le croire, n’eût-ce été que pour réparer ma conduite passée et vous prouver le remords que j’en avais conçu.
Il était impossible d’apporter plus de franchise dans un aveu. Aussi, voyant que Madeleine se laissait gagner, elle aussi, par l’émotion, Wagha-na s’empressa-t-il d’intervenir.
– Allons, Monsieur Sourbin, dit-il, oublions tout cela. Le passé est mort ; il ne renaîtra plus. Vous n’avez désormais que des amis parmi nous, et ces amis ne demandent qu’à vous prouver leur sympathie.
Sa main, noblement ouverte, serra celle du Français. Georges Vernant, présent à cet entretien, scella aussi d’une cordiale étreinte la réconciliation définitive.
Mais Léopold n’était point à moitié converti. Il voulut justifier cette bienveillance.
– Non, Messieurs, dit-il, aussi précieuse que me soit votre amitié, je ne puis l’accepter ainsi, sans chercher à la mériter. Ce que j’ai fait pour ma cousine était naturel. Mais je suis encore en reste avec Monsieur Vernant et avec vous, monsieur Wagha-na. Je vous demande donc de me mettre en mesure de m’acquitter envers vous.
– Rien ne presse, monsieur Sourbin, répondit le Bison Noir. L’occasion s’offrira quelque jour.
Elle s’offrit plus tôt que ne l’attendaient les uns et les autres.
Trois jours plus tard, Madeleine déclara qu’elle était suffisamment forte pour reprendre le chemin de Dogherty. En conséquence, on mit en usage une façon de civière que les sauvages connaissent et emploient fréquemment. De fortes courroies reliant deux chevaux entre eux furent disposées de manière à recevoir une sorte de hamac dans lequel on plaça la jeune fille. On parcourut ainsi, assez rapidement, une soixantaine de milles.
Mais au bout de ce trajet, l’orpheline réclama une monture pour elle-même et, à la joie générale, reparut en écuyère consommée ainsi qu’on était habitué à la voir et à l’admirer.
Hélas ! si la maladie était écartée, la malice humaine veillait encore.
Ulphilas Pitch et Gisbert Schulmann ne renonçaient point à leurs odieux projets.
Les deux misérables avaient commencé par fuir de toute la vitesse de leurs chevaux, se croyant poursuivis par les hommes de Wagha-na et n’ayant qu’une confiance très limitée en la loyauté des Comanches, leurs alliés de naguère. Même ils se figuraient, non sans apparences de raison, que, pour mieux faire leur paix avec le Bison Noir, ceux-ci ne se feraient aucun scrupule de lui livrer leurs inspirateurs et leurs conseillers.
Mais, dès qu’ils furent rassurés sur l’éventualité d’une poursuite, les deux complices modérèrent leur allure et purent à loisir échanger leurs maussades réflexions.
– Vous êtes, décidément, un homme de grand génie, Ulphilas, railla Schulmann, et vos plans ont abouti à de merveilleux résultats. Si vous m’aviez laissé faire, la jeune personne serait morte à l’heure qu’il est, sa succession ouverte, et le Sourbin entre nos mains, aurait fait tout ce que nous aurions voulu. Au lieu de cela, nous voici, après quarante jours de fausses manœuvres, perdus dans le désert, sans un penny et réduits à demander à nos carabines notre vie…
– Ou la vie des autres, interrompit Ulphilas Pitch avec un sinistre ricanement.
Pour le coup, Gisber cessa ses récriminations et demanda à son complice sur le ton du plus sincère étonnement :
– Que voulez-vous dire, Ulphilas ?
Le Norvégien battit d’un geste singulier le magasin de sa carabine et répliqua très nettement, cette fois :
– Je veux dire, mon cher Gisber, que, comme vous, j’en ai assez de maladresses et d’échecs, que quand je ne retirerais d’autre profit d’un coup de fusil bien placé que celui de satisfaire ma vengeance, je tiendrais le diable quitte envers moi. J’en veux à mort à cette petite fille qui nous échappe sans cesse, et surtout à ce coquin de Sourbin, qui mange à tous les râteliers. Il a sauvé sa cousine. Tant pis pour lui. Ce sera son dernier exploit.
Gisber poussa un rugissement de plaisir.
– Hip ! hip ! hurrah ! cria-t-il. Ulph, vous voilà comme je voulais vous voir ; nous allons faire de l’art pour l’art.
Et tous deux tournèrent les têtes de leurs bêtes vers le nord-est où déjà Wagha-na et les Sioux avaient disparu.
XV
LE ROI DES PRAIRIES
Ce fut avec ces mauvaises intentions que les deux Yankees se mirent à suivre la colonne qui ramenait Madeleine. Instruits par l’exemple des sauvages, par l’existence commune de six semaines qu’ils avaient menée dans leurs rangs, ils ne négligèrent aucune des précautions dont ceux-ci s’entourent pour suivre une piste en se dissimulant eux-mêmes aux regards attentifs des Sioux. Et, en vérité, si les Comanches les avaient vus, ils auraient pu se vanter d’avoir formé de bons élèves.
Pas à pas, pendant dix longs jours, sous les nuits glacées, sous les midis encore brûlants, les deux coquins, malgré la fatigue, malgré la faim qui les épuisait, la soif qui les brûlait, marchèrent dans les vestiges de leurs ennemis, n’ayant plus que l’affreuse cupidité du meurtre, le besoin maladif du crime à accomplir. Ils disputèrent ainsi leur misérable existence aux éléments aussi bien qu’aux bêtes nuisibles des forêts et de la plaine.
Un soir, comme on dressait les tentes pour le campement, le ciel, jusque-là très pur, s’assombrit brusquement. De sombres nuages, aux gros ventres renflés et cuivrés, envahirent la voûte bleue, poussés par une brise du nord qui fit frissonner les hommes les plus robustes sous leurs chaudes pelisses de fourrures.
En quelques heures, les bois furent dépouillés de leurs frondaisons jaunies et les ramures se montrèrent, sèches et nues, pareilles à de lugubres squelettes se tordant avec des gémissements dans le vent mortel.
Ainsi procède le froid dans les régions circumpolaires et, malgré la distance qui l’en sépare, le Canada, pays de plaines immenses, de lacs aussi vastes que des mers, et que ne défend aucune chaîne de montagnes, subit les brutales caresses du nord.
En voyant ce firmament lugubre, Wagha-na dit à Georges et à Sourbin :
– Eh bien, Messieurs, vous allez faire connaissance avec l’hiver des septentrions. Ceci n’est que peu de chose, car la saison rigoureuse ne commence vraiment qu’en décembre pour finir au milieu de février. Mais notre automne n’en vaut pas mieux. Ces nuages sont chargés de neige. Demain vous ne reconnaîtrez plus la prairie.
Il donna l’ordre de dresser les tentes en prévision de la neige qui allait tomber. Cette précaution consistait à envelopper chacune d’elles d’une bordure de pieux en palissade, sur laquelle s’arrêterait la neige. Quant à la toiture des tentes, elle fut consolidée à l’aide d’une charpente intérieure en bois, que les Indiens eurent tôt fait de couper aux arbres environnants.
Tout le monde se blottit dans ces huttes essentiellement temporaires. On abrita les chevaux sous des hangars non moins improvisés, faits de longues branches placées obliquement sur le sol et clouées aux troncs des plus gros arbres. Sous cette toiture tout à fait sommaire, les bêtes furent rangées côte à côte, toutes les têtes tournées vers le tronc pris comme pivot de cet étrange cirque. Comme l’on ne pouvait plus compter sur la prairie pour fournir l’herbe du fourrage, on plaça devant les bêtes des brassées entières de genêts rustiques, qui fournissent une pitance, sinon agréable, du moins suffisante dans les jours de disette.
Ainsi que l’avait annoncé Wagha-na, il était impossible, le lendemain, de reconnaître la prairie.
La neige était tombée avec une telle abondance qu’elle couvrait le sol jusqu’à la hauteur de trois pieds, entourant les palissades d’une véritable ceinture formant muraille. Aussi loin que la vue s’étendît, elle ne découvrait qu’une immensité blanche, de laquelle émergeaient les bouquets d’arbres tels qu’ils apparaissent dans les terrés inondées.
Un silence profond régnait dans ce désert glacé. Il s’en dégageait une tristesse morne qui n’ôtait pourtant rien à l’aspect grandiose du tableau. Mais on n’avait pas de temps à perdre en cette contemplation.
Le Bison Noir s’empressa de le rappeler à ses compagnons.
– En route, ordonna-t-il. Il nous faut gagner du terrain tant que le sol est friable, car dès que le vent aura soufflé les difficultés s’accroîtront et le retour ne sera pas sans présenter quelques dangers.
En effet, ces premiers froids sont fréquemment suivis d’une détente de l’atmosphère.
Alors les neiges fondent, les ruisseaux grossissent, les rivières débordent, souvent avec impétuosité, multipliant les ravages, et c’est à travers une prairie inondée, dont ils ne peuvent deviner les niveaux changeants, que les voyageurs sont obligés de se faire une route périlleuse.
C’était là ce que redoutait Wagha-na.
Il connaissait trop bien son pays pour n’avoir point lieu de suspecter ces froids précoces. Bien que le Canada s’étende en partie dans la zone : glaciale, il ne mérite aucunement le mépris qu’affichait Voltaire pour ces « arpents de neige » si glorieusement défendus par Montcalm. C’est une riche et belle terre où l’hiver n’est guère plus rigoureux qu’au nord de l’Allemagne, qu’en Russie, et où il dure beaucoup moins longtemps. La belle saison, au contraire, s’y prolonge, précédée et suivie d’une double période de pluies et de ciels mous.
Dès que l’ordre eut été donné, on fit sortir les chevaux, on replia les tentes, et la colonne s’élança à travers la plaine de l’allure la plus rapide que purent soutenir les chevaux.
On ne fit pas beaucoup de chemin. Si la neige durcie est glissante, la neige fraîche est inconsistante. Les pieds des bêtes s’enfonçaient en d’invisibles crevasses et cela provoquait des chutes souvent pénibles.
Mais le moral de la troupe demeurait excellent. Tous connaissaient ces accidents de la grande vie libre et fière du désert ; ils étaient accoutumés à ces incommodités inhérentes à la nature du pays et à la température de ce ciel qui ne se montre sévère parfois que pour redevenir clément et favorable aux premiers souffles du printemps.
On s’en allait donc gaiement, faisant contre fortune bon cœur, lorsqu’un incident tout à fait imprévu vint jeter un trouble profond dans les esprits et faire renaître les angoisses si récemment éprouvées.
On avait atteint un coude de la rivière Murray où le cours d’eau, parsemé d’îlots boisés, se divise en plusieurs bras de peu de largeur qu’il est aisé de traverser, soit à gué, soit à la nage.
Or, ni l’un ni l’autre de ces moyens ne pouvait être adopté pour le transport de Madeleine qui, à peine relevée de sa maladie, réclamait encore les plus grands ménagements.
Force fut bien de s’arrêter, malgré les instances de la jeune fille pour suivre ses compagnons par la même voie, et de chercher un moyen de locomotion qui écartât tout danger de rechute ou de complication dans la maladie.
Chinga-Roa résolut assez vite le problème.
Le Renard Avisé avait passé la plus grande partie de son enfance sur les bords du lac Supérieur. Il s’y était rompu à tous les exercices du canotage, et, plus tard, dans une course que divers membres de sa tribu avaient poussée à travers les monts Rocheux, jusqu’aux bords du Pacifique, il s’était familiarisé avec l’Océan lui-même.
Il entraîna donc deux ou trois de ses guerriers et, en moins d’une heure, ils eurent confectionné une pirogue creusée dans le tronc d’un bouleau, assez large pour recevoir deux personnes.
Ce fut dans cette embarcation tout à fait primitive que l’on fit monter Madeleine. Une corde fut attachée à l’avant du bateau, permettant aux cavaliers qui nageraient dans le voisinage de la tirer avec eux.
Wagha-na, Georges Vernant, Joë O’Connor, Sheen-Buck et Chinga-Roa s’attelèrent tour à tour à la nacelle, et cinq des bras furent franchis de la sorte sans difficultés.
Restait le sixième, à la fois le plus large et le plus rapide, que creusait un courant plein de remous dangereux.
Quand on en toucha les bords, le Bison Noir ouvrit l’avis que deux guides ne seraient pas de trop pour escorter le frêle esquif.
Léopold Sourbin, dont le tour n’était pas encore venu, s’offrit avec empressement à être l’un des deux nageurs de circonstance. Georges Vernant prit pour la seconde fois sa place à la droite de la pirogue, tandis que Sourbin la flanquait sur la gauche. Résolument, les deux hommes se jetèrent à l’eau et tirèrent le bateau à travers le courant, après l’avoir attaché aux selles des deux montures.
On avait déjà parcouru les deux tiers du lit de la rivière, quand Sourbin, jetant une exclamation, sortit brusquement de l’eau et, se mettant en selle, poussa sa bête en avant de Madeleine, qu’il couvrit de son corps.
En même temps, son bras allongé désignait l’autre rive à Georges et à Wagha-na, en disant :
– Là ! là ! dans le fourré.
Il n’eut pas le temps d’en dire davantage.
On le vit chanceler sur sa selle, tirer violemment la bride, et tourner si rapidement sur lui-même que Georges effrayé n’eut que le temps de le soutenir pour l’empêcher de tomber dans la rivière.
Une détonation venait d’éclater et au point qu’avait désigné le doigt de Léopold, un nuage de fumée blanche s’enlevait au-dessus d’un buisson de houx, de genêts et de buis sauvage.
Il n’en avait pas fallu davantage pour faire comprendre à Wagha-na ce qui venait de se passer.
Un homme, un ennemi, poussé par une haine aveuglante, avait fait feu sur Madeleine. La jeune fille aurait infailliblement péri, si Léopold Sourbin, avec une admirable générosité, ne s’était jeté devant elle. C’était lui qui avait reçu la balle destinée à sa cousine.
L’assassin, Wagha-na, n’avait pas besoin qu’on le lui désignât autrement. Ce ne pouvait être que l’un des deux Yankees qui depuis le début de cette aventureuse campagne, s’acharnaient à poursuivre l’orpheline de leur inexplicable haine.
Le Bison Noir avait déjà pris terre. Sans prononcer une parole, il lança vivement Gola par-dessus les remblais de neige qui ceignaient le buisson, tandis que Joë et Sheen-Buck aidaient Madeleine à débarquer et tiraient à terre le malheureux Sourbin livide et sanglant.
Georges, lui, suivait déjà l’exemple du chef Pawnie et galopait à côté de lui dans la plaine couverte de neige, bientôt suivi de Chinga-Roa et de vingt cavaliers Sioux.
Un second coup de feu éclata et le jeune Canadien sentit le vent d’une balle rasant sa tempe droite.
Il vit devant lui l’Allemand Gisber Schulmann qui venait de tirer.
– Ah ! rugit le jeune homme, je t’aurai, Deutsch maudit, quand bien même le diable, ton père, viendrait à ton secours.
Dès le début de la poursuite, il fut visible que les bêtes épuisées des deux coquins ne pourraient soutenir une lutte de vitesse avec les deux merveilleux coursiers qui avaient nom Hips et Gola.
En effet, au bout de huit cents pas péniblement franchis, la monture de l’Allemand buta contre un tronc d’arbre enfoui dans la neige et tomba, sur ses genoux, le mufle en avant, les naseaux pleins de sang.
Tout aussitôt le Germain mit pied à terre et brandissant par le canon sa carabine qu’il n’avait pas eu le temps de recharger, attendit de pied ferme son impétueux assaillant. Georges accourait sur lui, la main haute, armé d’un large couteau de chasse à servir un wapiti ou un sanglier.
Mais, en voyant son ennemi désarçonné, il ne voulut point profiter de l’avantage que lui assurait son cheval.
D’un bon rapide, il quitta la selle et s’avança contre Gisber toujours railleur.
– Est-ce toi qui as tiré sur Léopold Sourbin ? demanda-t-il.
– Non, répliqua l’Allemand, mais je regrette de ne l’avoir pas fait. D’ailleurs, ce n’était pas à lui que la balle était destinée.
– C’était la Fée, alors, que vous vouliez tuer ?
– Oui, dit encore crânement le misérable.
Un sourire de mépris glissa sur les lèvres de Georges.
– Tu ne vaux pas l’honneur que je te fais en te tuant, cria-t-il. Mais je n’ai pas le choix des moyens. Défends-toi donc, car j’aurais peut-être dû t’écraser ainsi qu’une bête malfaisante.
– Défends-toi toi-même, gronda encore l’Allemand, qui, se ruant sur le jeune homme, abaissa la crosse de son arme comme il eût fait d’une massue.
Un saut de côté préserva Georges. Il mesura d’un coup d’œil la taille du colosse. Schulmann le dépassait de la moitié de la tête. Le Canadien répondit aux insultes de son ennemi par une suprême raillerie.
– On m’avait toujours dit que vos grandes tailles renfermaient de petites âmes. Je vais prendre ta mesure tout à l’heure, quand je l’aurai couché là.
Et, du bout de son coutelas, il montrait au Teuton le tapis de neige de la prairie.
Gisber, dont le premier coup avait porté à faux, grinça des dents, et se précipita derechef, la crosse levée.
Vernant l’avait vu venir. Comme la première fois, il esquiva l’attaque. Mais, avec la souplesse d’un fauve, il bondit à son tour sur le Germain. Un seul coup de poing brisa le poignet gauche du colosse, et la main du Canadien se ferma, comme une tenaille sur le cou énorme. En même temps, d’une secousse qui eût ébranlé un chêne, le jeune homme déracina le géant de sa lourde base et le jeta pesamment sur le sol.
– Allons, plaisanta une fois encore Georges, tu as l’air d’un taureau ; tu n’es qu’un bœuf. Relève-toi. Je ne veux pas t’égorger comme une bête de boucherie.
L’Allemand ne se le fit pas dire deux fois.
Écumant, les yeux hors de l’orbite, il mit, lui aussi, au clair la lame d’un couteau de chasse et se rua sur Vernant.
Le combat ne fut pas de plus longue durée qu’au premier choc. Une simple parade rejeta l’arme de l’assaillant, tandis que celle du Canadien disparaissait jusqu’à la garde entre le cou et l’épaule de Schulmann, au-dessus du thorax.
– Voilà qui est fait ! dit une voix tranquille, tout près de Georges. Il est dommage que ça n’ait pas eu lieu plus tôt.
C’était Wagha-na qui venait de parler. Et, en se retournant Georges put voir le Bison Noir, toujours monté sur Gola, qui lui ramenait Hips par la bride. Derrière lui, deux Sioux conduisaient Ulphilas Pitch, les deux mains attachées derrière le dos, le cou déjà entouré d’un lasso.
– Il ne faut pas faire languir ce gentleman, reprit le Pawnie avec le même flegme. Cette humidité froide pourrait lui devenir préjudiciable. Allons ! camarades, hissez-moi ce Yankee. Nous n’avons point de pasteur sous la main.
L’ordre fut immédiatement exécuté.
Juste au-dessus du bras du Murray que l’on venait de traverser, un séquoia de belles dimensions allongeait de longues et fortes branches. Ce fut à la plus grosse de ces branches que l’on attacha l’extrémité du lasso. Après quoi, l’on poussa le misérable Pitch dans le vide.
Il se balança quelques minutes au-dessus des eaux toutes noires de la rivière. Puis les convulsions suprêmes prirent fin, et le cadavre demeura immobile, accroché par le cou. Déjà, corbeaux et vautours, taches sombres dans le firmament gris, tournoyaient, avec des cris aigus et des battements d’ailes, au-dessus de cette proie qu’on leur offrait si bénévolement. Une sorte d’urubu à crête sanglante avait pris les devants et, de son bec puissant, déchiquetait déjà les chairs de Gisber Schulmann.
Il n’y avait plus rien à faire qu’à soigner, à soulager, tout au moins, l’infortuné Léopold, qu’on avait dû coucher sous une tente dressée à la hâte et plantée tant mal que bien dans la neige déjà fondante.
Hélas ! Le cas était désespéré. Le cousin de Madeleine expiait en une seule fois toutes les vilenies de son passé. Dieu lui accordait, il est vrai, mieux que la mort d’un honnête homme : celle d’un brave dont la dernière action rachetait une existence mal employée.
Sheen-Buck, qui était le chirurgien de la troupe, put renseigner Wagha-na sur la gravité de la blessure dont Sourbin avait été atteint.
Il avait pu sonder la plaie et extraire la balle.
Celle-ci avait frappé le pauvre garçon de haut en bas, sous la clavicule gauche. Trouant un oblique chemin, elle avait traversé le poumon des deux côtés, déchirant le ventricule droit du cœur. C’était la mort imminente, sans arrêt comme sans rémission.
Léopold connaissait son état. Il sourit tristement aux paroles affectueuses que lui adressaient Wagha-na, Georges, Joë et Sheen-Buck, penchés sur le lit provisoire de sa cruelle agonie.
Quant à Madeleine, le chagrin de ce trépas violent lui ôtait la parole. Elle pleurait silencieusement.
Et, la voyant pleurer, le mourant lui adressa de touchantes paroles :
– Ma cousine, proféra-t-il à travers les hoquets de la fin, j’étais parti de France avec le projet de vous dépouiller. Ici, à votre vue, j’ai changé d’intentions ; j’ai osé lever les yeux sur vous et concevoir d’absurdes espérances. Je vous ai pourtant sincèrement aimée, et, aujourd’hui, je puis le dire, je vous aime tous. J’aurais pu être à l’avenir un honnête homme. Dieu ne l’a pas voulu. Il est juste. Je meurs justement châtié.
Un flot de sang jailli de sa bouche lui coupa la voix. Quand il put la recouvrer, il dit encore :
– Je viens de faire une confession publique. J’espère qu’elle me comptera auprès de Dieu et que ma mort rachètera ma vie. S’il vous est possible de faire mettre mon corps en terre sainte, accordez-moi cette faveur. Qu’un prêtre bénisse mes pauvres restes. Et vous tous, oubliez mes fautes et… priez pour moi.
Telles furent ses dernières recommandations à ceux qu’il n’avait connus que pour essayer de leur nuire. On ne se souvint que de son généreux repentir, et tous versèrent des larmes sur cette dépouille purifiée par le pardon, ennoblie par le sacrifice.
On creusa une tombe sous la neige, dans cette terre durcie. On en marqua la place avec une croix.
Puis, toute la colonne reprit le chemin des établissements du Winnipeg.
Elle y rentra dans les premiers jours de décembre. Deux mois s’étaient écoulés depuis le départ. De combien de tragiques événements n’avaient-ils pas été remplis ?
Au printemps suivant furent célébrés, dans la petite église de Dogherty, les noces chrétiennes de Georges Vernant et de Madeleine Kerlp.
Tout le monde aimait le fier et noble jeune homme que Wagha-na avait choisi pour mari de sa fille adoptive. On l’avait vu à l’œuvre ; on connaissait son indomptable courage, la générosité de son âme et la force herculéenne de son bras. Et, de l’avis de tous, nul homme n’était plus digne de continuer un jour l’œuvre du Bison Noir et d’être l’époux heureux et aimé de la Fée.
Celle-ci était belle à miracle. Sous son voile, couronnée de fleurs d’oranger, dans sa robe d’une éblouissante blancheur, elle rappelait plus que jamais les beaux anges qui peuplent de doux rêves le sommeil des hommes vertueux et des vierges sacrées. Elle était la plus pure fleur de ces neiges septentrionales qui couvrent d’un linceul d’argent l’innocence de ces contrées encore intactes, mais s’entr’ouvrent, tous les printemps, pour en laisser sortir les moissons de l’énergie humaine bénie du ciel.
Madeleine n’avait pas voulu recevoir la bénédiction nuptiale avant d’accomplir un pieux devoir.
Aussi, dès que les premiers souffles tièdes avaient chassé les bises glaciales et fait verdir les bourgeons, elle avait voulu accompagner la colonne qui était retournée au désert, là-bas, sur les bords du Murray, pour retirer de sa couche provisoire la dépouille du malheureux Sourbin.
Et, maintenant, Léopold reposait en terre sainte, dans l’humble cimetière de Dogherty, sous un bloc de granit qui ne rappelait à la mémoire des hommes que l’acte de dévouement où il avait perdu la vie.
Lorsque le jeune couple sortit du temple catholique, des salves de mousqueterie, les clameurs d’une foule enthousiaste saluèrent ses premiers pas. Georges et Madeleine marchèrent sur un tapis de fleurs et de verdure des marches de la chapelle au seuil de leur demeure.
Quarante mille assistants de toutes races se pressèrent pendant trois jours dans les rues et les places de Dogherty. Les hôtels étaient pleins ; les maisons des particuliers elles-mêmes ne purent suffire à recevoir la foule. On coucha sous les tentes, dans des baraquements de planches et de feuillage.
Et, ce jour-là, il fallut bien se départir un peu de la sévère prescription qui rationnait les boissons fortes. Punch, whiskey, brandy, cognac de France, genièvre de Hollande, aguardiente du Mexique, coulèrent plus que de raison. Mais la raison conserva son empire. On n’eut ni troubles, ni accidents à déplorer.
Dans le nombre des chefs de tribus admis à la table des noces, on remarqua Magua, l’Ours Gris.
Le chef des Comanches avait tenu sa parole. Désormais, il était le fils dévoué du Bison Noir. Huit cents hommes de sa tribu l’avaient suivi pour s’établir avec lui sur les bords du lac Athabaska.
Ce jour-là on lut le recensement des peuples de race rouge qui avaient adhéré à la noble ligue fondée par Wagha-na. Cent soixante mille Indiens des deux sexes acceptaient la vie commune et dotaient le Dominion du Canada d’une population pleine d’espoir et de foi en ses nouvelles destinées.
Et comme Sheen-Buck avait, une fois de plus, dressé la carte du banquet, les langues se firent prolixes au dessert.
Ce fut Magua qui se leva le premier pour boire à la santé des nouveaux époux.
– Non, répondit Madeleine en haussant sa coupe, le premier vœu doit être pour notre commun père, pour Jean Wagha-na, le Roi de la Prairie.