
Howard Phillips Lovecraft
LE CAUCHEMAR D’INNSMOUTH
The Shadow over Innsmouth, 1931
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières
À propos de cette édition électronique
1
Au cours de l’hiver 1927-1928, des fonctionnaires du gouvernement fédéral menèrent une enquête mystérieuse et confidentielle à propos de certains faits survenus dans l’ancien port de pêche d’Innsmouth, Massachusetts. Le public ne l’apprit qu’en février, à l’occasion d’une importante série de rafles et d’arrestations, suivie de l’incendie volontaire et du dynamitage – avec les précautions qui s’imposaient – d’un nombre considérable de maisons délabrées, vermoulues et qu’on supposait vides, le long du front de mer abandonné. Les esprits peu curieux considérèrent cet événement comme l’un des affrontements les plus graves de la guerre intermittente contre les trafiquants d’alcool.
Néanmoins, les plus attentifs lecteurs de la presse s’étonnèrent du nombre prodigieux des arrestations, des forces de police exceptionnelles qu’on y mobilisa, et du secret qui entourait le sort des prisonniers. Il ne fut pas question de procès, ni même d’accusation précise ; et l’on ne vit par la suite aucun des captifs dans les geôles officielles du pays. Il y eut de vagues déclarations à propos de camps de concentration, de maladie, et plus tard de dispersion dans diverses prisons militaires et navales, mais on ne sut jamais rien de positif. Innsmouth elle-même resta presque dépeuplée, et c’est à peine si elle commence aujourd’hui à donner quelques signes d’une lente renaissance.
Les protestations de nombreuses organisations libérales donnèrent lieu à de longs entretiens tenus secrets, et l’on emmena leurs représentants visiter certains camps et prisons. À la suite de quoi, lesdites organisations devinrent singulièrement passives et réticentes. Les journalistes furent plus difficiles à manier, mais ils finirent par coopérer, pour la plupart, avec le gouvernement. Un seul journal – un petit format toujours suspect d’extravagance – parla d’un sous-marin de grande profondeur qui aurait déchargé des torpilles dans l’abîme situé au-delà du Récif du Diable. Cette nouvelle, recueillie au hasard d’un café de matelots, parut vraiment très invraisemblable puisque le bas et noir récif se trouve à un bon mille et demi du port d’Innsmouth.
Les gens de la campagne et des villes environnantes échangèrent maints propos à voix basse, mais n’en dirent presque rien aux étrangers. Depuis bientôt un siècle qu’ils parlaient de l’agonisante Innsmouth à moitié déserte, rien de nouveau ne pouvait être plus hideux et délirant que ce qu’on avait chuchoté et insinué dans les années passées. Bien des incidents leur avaient appris à se taire, et désormais on aurait en vain tenté de les contraindre. D’ailleurs ils ne savaient pas grand-chose car de vastes marécages, désolés et sans habitants, séparent Innsmouth de l’intérieur des terres.
Mais je vais enfin braver l’interdit qui fait le silence sur cette affaire. Les résultats, j’en suis certain, sont tellement décisifs qu’à part une violente répulsion, on ne risque aucun dommage public à laisser entendre ce qu’ont découvert à Innsmouth ces enquêteurs horrifiés. Du reste, il peut y avoir à ces découvertes plus d’une explication. J’ignore dans quelle mesure on m’a raconté, même à moi, toute l’histoire, et j’ai bien des raisons pour ne pas avoir envie d’approfondir. Car je m’y suis trouvé mêlé plus étroitement qu’aucun autre profane, et j’en ai reçu des impressions qui peuvent encore me mener à des décisions radicales.
C’est moi qui, affolé, me suis enfui d’Innsmouth à l’aube du 16 juillet 1927, et dont les appels épouvantés ont entraîné l’enquête et l’action du gouvernement telles qu’on les a rapportées. J’ai préféré garder le silence tant que l’affaire était incertaine et de fraîche date ; mais maintenant, c’est une vieille histoire qui ne suscite plus la curiosité ni l’intérêt du public, et j’éprouve un étrange désir de dire tout bas les effroyables heures que j’ai passées dans ce lieu malfamé et malchanceux, havre de mort et de monstruosités impies. Le seul fait de raconter m’aide à reprendre confiance en mes propres facultés, en prouvant que je n’ai pas été simplement la première victime d’une hallucination contagieuse et cauchemardesque. Il m’aide aussi à me décider pour le pas terrible que je vais avoir à franchir.
Je n’avais jamais entendu parler d’Innsmouth avant la veille du jour où je la vis pour la première et – jusqu’ici – dernière fois. Je fêtais ma majorité en parcourant la Nouvelle-Angleterre – en touriste, amateur d’antiquités et de généalogie – et j’avais projeté d’aller directement du vieux Newburyport jusqu’à Arkham, d’où venait la famille de ma mère. N’ayant pas de voiture, je voyageais par le train, le tramway et le car, en choisissant toujours le trajet le plus économique. À Newburyport, on me dit que pour Arkham il fallait prendre le train à vapeur ; ce fut seulement au guichet de la gare, où j’hésitais, trouvant le billet trop cher, que j’appris l’existence d’Innsmouth. L’employé, gros homme au visage rusé, dont le langage prouvait qu’il n’était pas du pays, sembla comprendre mes soucis d’économie et me suggéra une solution qu’aucun de mes informateurs ne m’avait proposée.
« Vous pourriez prendre le vieil autobus, je crois, dit-il avec une certaine hésitation, mais on ne l’aime pas beaucoup par ici. Il passe par Innsmouth – vous avez dû en entendre parler – et ça ne plaît pas aux gens. C’est un type d’Innsmouth qui conduit – Joe Sargent – mais j’ai l’impression qu’il ne doit jamais charger aucun client ni ici ni à Arkham. Je me demande comment il fait pour continuer. Les places doivent pas être chères, mais j’y vois jamais plus de deux ou trois personnes – et toujours des gens d’Innsmouth. Il quitte la grand-place – en face de la pharmacie Hammond – à dix heures du matin et à sept heures du soir, à moins qu’il ait changé dernièrement. Ça a l’air d’une terrible guimbarde – j’ai jamais été dedans. »
Ce fut donc la première fois que j’entendis parler de la sombre Innsmouth. Toute mention d’une agglomération ni portée sur les cartes ordinaires ni mentionnée dans les guides récents m’aurait intéressé, mais la manière bizarre dont l’employé y avait fait allusion éveilla une sorte de réelle curiosité. Une ville capable d’inspirer à ses voisins une telle répugnance devait au moins, me dis-je, sortir de l’ordinaire et mériter l’attention d’un touriste. Si elle était avant Arkham, je m’y arrêterais – je priai donc l’employé de m’en parler un peu. Il fut très circonspect, et aborda le sujet d’un air un peu condescendant.
« Innsmouth ? Ma foi, c’est une drôle de ville à l’embouchure du Manuxet. C’était presque une cité – en tout cas un grand port avant la guerre de 1812 – mais tout s’est détraqué dans les cent dernières années à peu près. Plus de chemin de fer – le B. & M.[1] n’y passe jamais, et la ligne secondaire qui venait de Rowley a été abandonnée il y a des années.
« Il reste plus de maisons vides que de gens, je crois, et pour ainsi dire il n’y a plus de commerces sauf la pêche et les parcs à homards. Toutes les affaires se font surtout ici ou à Arkham ou Ipswich. Autrefois, ils avaient quelques fabriques, mais il ne reste rien aujourd’hui qu’un atelier d’affinage d’or qui fonctionne à très petit rendement.
« N’empêche que, dans le temps, c’était une grosse affaire, et le vieux Marsh, son propriétaire, doit être riche comme Crésus. Drôle de type, d’ailleurs, toujours bouclé chez lui. Il aurait attrapé sur le tard une maladie de peau ou une difformité qui l’empêcherait de se montrer. C’est le petit-fils du capitaine Obed Marsh, qui a fondé l’affaire. Sa mère devait être une espèce d’étrangère – on dit une insulaire des mers du Sud –, aussi ça a fait un boucan de tous les diables quand il a épousé une fille d’Ipswich voilà cinquante ans. On est toujours comme ça avec les gens d’Innsmouth, et ceux de par ici qui ont du sang d’Innsmouth essaient toujours de le cacher. Mais les enfants et les petits-enfants de Marsh, pour ce que j’en ai vu, m’ont l’air tout à fait comme tout le monde. Je me les suis fait montrer ici – bien que, maintenant que j’y pense, on n’ait pas vu les aînés ces derniers temps. Le vieux, je l’ai jamais vu.
« Et pourquoi tout le monde en veut comme ça à Innsmouth ? Ma foi, jeune homme, il ne faut pas attacher trop d’importance à ce que disent les gens du pays. Ils sont difficiles à mettre en train, mais quand ils ont démarré, ça n’en finit plus. Ils n’ont fait que raconter des histoires sur Innsmouth – ou plutôt chuchoter – pendant les cent dernières années, je pense, et j’en conclus qu’ils ont peur, surtout. Certaines de ces fables vous feraient rire – comme celle du vieux capitaine Marsh qui aurait conclu un pacte avec le diable et aurait fait venir des diablotins de l’enfer pour les installer à Innsmouth, ou ces espèces de cultes sataniques et de terribles sacrifices dans un endroit près des quais qu’on aurait découvert autour de 1845 – mais je viens de Panton, dans le Vermont, et tout ça ne prend pas avec moi.
« Pourtant, je voudrais que vous entendiez ces vieux à propos du récif noir, un peu à distance de la côte – le Récif du Diable, ils l’appellent. Il est bien au-dessus de l’eau la plupart du temps, et jamais loin sous la surface, mais on peut pas dire que c’est une île. Ils racontent qu’on y voit quelquefois toute une légion de diables – vautrés dessus, ou qui ne font qu’entrer et sortir de cavernes près du sommet. C’est une masse inégale et déchiquetée, à un bon mille du rivage, et vers la fin des années de navigation active, les marins faisaient de grands détours pour l’éviter.
« Je veux dire, les marins qui n’étaient pas d’Innsmouth. Une des choses qu’on reprochait au vieux capitaine Marsh, c’était censément d’y aborder de nuit, parfois, quand la marée le permettait. Il le faisait peut-être, car la nature du rocher est sans doute intéressante, et il est possible aussi qu’il ait cherché un butin de pirates, et même qu’il l’ait trouvé ; mais on prétendait qu’il allait y retrouver des démons. En fait, je crois bien que c’est vraiment le capitaine qui a donné au récif sa mauvaise réputation.
« C’était avant la grande épidémie de 1846, qui a emporté plus de la moitié des gens d’Innsmouth. On n’a jamais su exactement de quoi il retournait ; ça devait être une maladie étrangère rapportée de Chine ou d’ailleurs par les bateaux. En tout cas ça a fait du vilain : il y a eu des émeutes et toutes sortes d’horreurs dont la ville, je crois, n’a jamais été délivrée et elle ne s’en est pas remise. Il ne doit pas y vivre aujourd’hui plus de trois cents ou quatre cents habitants.
« Mais la vraie raison de l’attitude des gens d’ici, c’est simplement un préjugé racial – et je ne peux pas dire que je leur en fasse reproche. Moi-même j’ai horreur de ceux d’Innsmouth et je ne voudrais pas aller chez eux. Vous devez savoir – bien que je voie à votre accent que vous êtes de l’Ouest – que beaucoup de nos bateaux de Nouvelle-Angleterre avaient souvent affaire avec de drôles de ports en Afrique, en Asie, dans les mers du Sud et un peu partout, et qu’ils en ramenaient quelquefois de drôles d’individus. Vous avez sans doute entendu parler du gars de Salem qui est rentré chez lui avec une femme chinoise, et vous savez peut-être qu’il y a encore un tas d’indigènes des îles Fidji dans les parages de Cape Cod.
« Eh bien, il doit y avoir une histoire de ce genre dans le cas des gens d’Innsmouth. La ville a toujours été profondément coupée du reste du pays par les cours d’eau et les marécages, si bien qu’on connaît mal les tenants et les aboutissants de l’affaire ; mais il est plus que probable que le capitaine Marsh a ramené des spécimens bizarres quand il avait trois bateaux en service dans les années 1820 et 1830. Il y a sûrement encore aujourd’hui quelque chose de spécial dans le physique des habitants d’Innsmouth – je sais pas comment l’expliquer, mais ça vous met mal à l’aise. Vous le remarquerez un peu chez Sargent si vous prenez son bus. Certains ont la tête curieusement étroite, le nez plat, des yeux saillants et fixes qu’on ne voit jamais se fermer, et leur peau n’est pas normale. Elle est rêche et couverte de croûtes, toute ridée et plissée sur les côtés du cou. Ils deviennent chauves aussi, de très bonne heure. Les plus vieux sont les pires – en réalité, je ne crois pas en avoir jamais vu de vraiment vieux dans ce genre-là. Ils doivent mourir de saisissement en se voyant dans la glace ! Les animaux les détestent – ils avaient beaucoup d’ennuis avec les chevaux avant l’arrivée des automobiles.
« Personne par ici, ni à Arkham ou Ipswich, ne veut avoir de rapports avec eux, et ils se montrent eux-mêmes distants quand ils viennent en ville ou si quelqu’un essaie de pêcher dans leurs eaux. C’est curieux qu’il y ait toujours des tas de poissons au large d’Innsmouth quand il n’y en a nulle part ailleurs – mais essayez un peu d’aller en pêcher et vous verrez comment on vous fera déguerpir ! Ces gens-là venaient habituellement ici par le train – en allant à pied le prendre à Rowley quand la voie de raccordement a été abandonnée – mais à présent, ils prennent cet autobus.
« Oui, il y a un hôtel à Innsmouth – on l’appelle la Maison Gilman –, je crois qu’il n’est pas bien fameux et je ne vous conseille pas de l’essayer. Vaut mieux rester ici et prendre le bus de dix heures demain matin ; ensuite vous aurez un autobus pour Arkham à huit heures du soir. Il y a deux ans, un inspecteur du travail a couché au Gilman, et il a eu beaucoup à s’en plaindre. Ils ont de drôles de clients, on dirait : il a entendu dans d’autres chambres – bien que la plupart aient été vides – des voix qui lui ont donné la chair de poule. C’était une langue étrangère, à son avis, mais le pire c’était une certaine voix qui parlait de temps à autre. Elle avait un son tellement anormal – comme un clapotement – qu’il a pas osé se déshabiller ni se coucher. Il a veillé jusqu’au matin et il a filé à la première heure. La conversation avait duré presque toute la nuit.
« Ce gars-là – il s’appelait Casey – en avait long à dire sur la méfiance des gens d’Innsmouth qui le surveillaient et avaient un peu l’air de monter la garde. L’entreprise de Marsh lui avait paru bizarre : elle était installée dans un vieux moulin sur les dernières chutes du Manuxet. Ce qu’il disait concordait avec ce que j’avais entendu raconter. Des livres mal tenus, pas de comptes précis pour aucune des différentes transactions. Voyez-vous, on s’est toujours demandé d’où les Marsh tiraient l’or qu’ils apportaient. Ils ont jamais eu l’air d’acheter beaucoup de ct’article-là, et pourtant, voilà bien des années, ils envoyaient par bateaux des quantités de lingots.
« On a beaucoup parlé d’une curieuse espèce de bijoux étrangers que les marins et les ouvriers de l’affinage auraient quelquefois vendus en douce, ou qu’on aurait vus une ou deux fois portés par les femmes chez les Marsh. On supposait que le vieux capitaine Obed avait pu les échanger dans un de ces ports de païens, surtout qu’il commandait toujours des quantités de perles de verre et de babioles comme en emportent les marins pour commercer avec les indigènes. D’autres pensaient, et pensent encore, qu’il avait trouvé une vieille cache de pirate sur le Récif du Diable. Mais il y a quelque chose d’extraordinaire. Le vieux capitaine est mort depuis soixante ans, et aucun bateau de tonnage moyen n’est sorti du port depuis la guerre civile ; or les Marsh continuent comme autrefois à acheter de cette pacotille pour les indigènes – surtout des babioles en verre et en caoutchouc, paraît-il. À croire que les gens d’Innsmouth les trouvent à leur goût eux-mêmes – Dieu sait qu’ils sont tombés aussi bas que les cannibales des mers du Sud et les sauvages de Guinée.
« L’épidémie de 46 a dû emporter les meilleures familles de la ville. En tout cas, il reste maintenant que des gens douteux, et les Marsh comme les autres richards ne valent pas mieux. Comme je vous l’ai dit, il n’y a sûrement pas plus de quatre cents habitants dans toute la ville malgré la quantité de rues qu’ils ont, il paraît. Ils m’ont l’air d’être ce qu’on appelle « les sales Blancs » dans les États du Sud : rusés, sans foi ni loi et agissant en dessous. Ils pèchent beaucoup de poissons et de homards qu’ils exportent par camion. Incroyable comme le poisson grouille chez eux et nulle part ailleurs.
« Personne ne peut jamais surveiller ces gens-là, et les fonctionnaires de l’école publique ou du recensement en voient de dures. Vous vous doutez que les étrangers trop curieux sont mal reçus là-bas. Personnellement, j’ai entendu dire que plus d’un homme d’affaires ou d’un représentant du gouvernement y avaient disparu, et il est question aussi de quelqu’un qui serait devenu fou et se trouverait à présent à l’asile de Denver. Il a dû en avoir une peur bleue.
« C’est pour ça que j’irais pas de nuit, si j’étais vous. Je n’y suis jamais allé et je n’en ai pas envie, mais je pense que vous ne risquez rien en y faisant un tour dans la journée – même si les gens de par ici vous le déconseillent. Si vous venez seulement en touriste pour voir des choses d’autrefois, Innsmouth devrait être un endroit idéal pour vous. »
Je passai donc une partie de la soirée à la bibliothèque municipale de Newburyport à la recherche des documents sur Innsmouth. Quand j’avais essayé d’interroger les habitants dans les boutiques, au restaurant, dans les garages et chez les pompiers, je les avais trouvés encore plus difficiles à mettre en train que ne l’avait prédit l’employé de la gare et je compris que je n’aurais pas le temps de vaincre leurs premières réticences instinctives. Ils avaient une sorte d’obscure méfiance, comme si quiconque s’intéressait trop à Innsmouth leur était un peu suspect. À l’YMCA[2], où je logeais, on me déconseilla absolument de me rendre dans un lieu aussi sinistre et décadent ; les gens à la bibliothèque exprimèrent la même opinion. Manifestement, aux yeux des personnes cultivées, Innsmouth n’était qu’un cas extrême de dégénérescence urbaine.
Parmi les ouvrages de la bibliothèque, les chroniques du comté d’Essex m’apprirent peu de chose, si ce n’est que la ville fut fondée en 1643, célèbre avant la révolution pour la construction navale, centre d’une grande prospérité maritime au début du XIXe siècle, et plus tard d’une industrie mineure utilisant le Manuxet comme force motrice. L’épidémie et les émeutes de 1846 étaient à peine évoquées, comme si elles avaient été une honte pour le comté.
On parlait peu du déclin, mais les textes plus récents étaient significatifs. Après la guerre civile, toute la vie industrielle se résumait à la compagnie d’affinage Marsh, et la vente des lingots d’or restait le seul vestige d’activité commerciale en dehors de la sempiternelle pêche en mer. Celle-ci rapportait de moins en moins à mesure que le prix de la marchandise baissait, et que des sociétés à grande échelle faisaient des offres concurrentes, mais le poisson ne manquait jamais au large du port d’Innsmouth. Les étrangers s’y installaient rarement, et des faits passés sous silence prouvaient que plusieurs Polonais et Portugais, s’y étant risqués, avaient été écartés par les mesures les plus radicales.
Le plus intéressant était une référence indirecte aux bijoux étranges qu’on associait vaguement à Innsmouth. Ils avaient dû laisser une forte impression dans tout le pays car on en signalait des spécimens au musée de l’université de Miskatonic, à Arkham, dans la salle d’exposition de la Société historique de Newburyport. Les descriptions fragmentaires de ces objets, pourtant plates et banales, me suggérèrent la continuité d’une étrangeté sous-jacente. Ce qu’ils avaient pour moi d’insolite et de provocant m’obséda au point que, malgré l’heure assez tardive, je résolus d’aller voir, si c’était encore possible, l’échantillon local – un bijou de grande taille aux proportions singulières, qui représentait de toute évidence une tiare.
Le bibliothécaire me remit un mot d’introduction pour la conservatrice de la Société, une certaine miss Anna Tilton, qui habitait tout près, et, après une brève explication, cette vénérable dame eut la bonté de me faire entrer dans le bâtiment, déjà fermé bien qu’il ne fût pas une heure indue. La collection était vraiment remarquable, mais en l’occurrence je n’avais d’yeux que pour le bizarre objet qui étincelait dans une vitrine d’angle sous la lumière électrique.
Il n’était pas nécessaire d’être particulièrement sensible à la beauté pour rester comme moi littéralement suffoqué devant la splendeur singulière, surnaturelle, de l’œuvre riche, déroutante, fantastique qui reposait là, sur un coussin de velours violet. Aujourd’hui encore, je suis presque incapable de décrire ce que j’ai vu, bien qu’il s’agît nettement d’une sorte de tiare, ainsi que je l’avais lu. Elle était haute sur le devant, très large et d’un contour curieusement irrégulier, tel qu’on l’aurait conçu pour une tête monstrueusement elliptique. L’or semblait y dominer, mais un mystérieux éclat plus lumineux suggérait quelque étrange alliage avec un autre métal magnifique, difficile à identifier. Elle était en parfait état, et l’on aurait passé des heures à étudier les dessins saisissants et d’une originalité déroutante – les uns simplement géométriques, d’autres nettement marins –, ciselés ou modelés en relief sur sa surface avec un art d’une habileté et d’une grâce incroyables.
Plus je la regardais, plus elle me fascinait ; et je percevais dans cet attrait un élément troublant, impossible à définir et à expliquer. J’attribuai d’abord mon malaise au caractère d’outre-monde de cet art étrange. Toutes les autres œuvres que j’avais vues jusqu’alors appartenaient à un courant connu, racial ou national, à moins qu’elles ne soient un défi résolument moderniste à toutes les traditions. Cette tiare n’était ni l’un ni l’autre. Elle relevait évidemment d’une technique accomplie, d’une maturité et d’une perfection infinies, mais radicalement différente de toutes celles – orientales ou occidentales, anciennes ou modernes – que je connaissais de vue ou de réputation. On eût dit que c’était l’œuvre d’une autre planète.
Pourtant je compris bientôt que mon trouble avait une autre origine, peut-être aussi puissante que la première, dans les allusions picturales et mathématiques de ces singuliers dessins. Les formes évoquaient toutes de lointains secrets, d’inconcevables abîmes dans l’espace et le temps, et la nature invariablement aquatique des reliefs devenait presque sinistre. Ils représentaient entre autres des monstres fabuleux d’un grotesque et d’une malignité répugnants – mi-poissons, mi batraciens – que je ne pouvais dissocier d’une obsédante et pénible impression de pseudo-souvenir, comme s’ils faisaient surgir je ne sais quelle image des cellules et des tissus enfouis dont les fonctions de mémorisation sont entièrement primitives et effroyablement ancestrales. Il me semblait parfois que chaque trait de ces maudits poissons-grenouilles répandait l’extrême quintessence d’un mal inconnu qui n’avait rien d’humain.
La courte et banale histoire de la tiare telle que me la raconta miss Tilton faisait un singulier contraste avec son aspect. Elle avait été mise en gage pour une somme ridicule dans une boutique de State Street en 1873, par un ivrogne d’Innsmouth, tué peu après dans une bagarre. La Société l’avait achetée au prêteur sur gages, et lui avait aussitôt donné un cadre digne de sa qualité. On indiquait qu’elle venait probablement d’Indochine ou des Indes orientales, mais cette attribution était franchement provisoire.
Miss Tilton, ayant envisagé toutes les hypothèses concernant son origine et sa présence en Nouvelle-Angleterre, inclinait à croire qu’elle faisait partie du trésor exotique d’un pirate découvert par le vieux capitaine Obed Marsh. Opinion que ne démentirent pas les offres de rachat à un prix élevé que les Marsh firent avec insistance aussitôt qu’ils la surent au musée, et qu’ils avaient répétées jusqu’à ce jour malgré l’invariable refus de la Société.
En me raccompagnant à la porte, la bonne dame me fit comprendre que la théorie du pirate qui aurait fait la fortune des Marsh était très répandue parmi les gens intelligents de la région. Sa propre attitude à l’égard de la ténébreuse Innsmouth – qu’elle n’avait jamais vue – était le dégoût d’une communauté qui glissait au niveau le plus bas de l’échelle culturelle, et elle m’assura que les rumeurs de culte satanique étaient en partie justifiées par l’existence d’une religion secrète singulière qui s’y était développée au point d’anéantir toutes les Églises orthodoxes.
On l’appelait, disait-elle, l’« Ordre ésotérique de Dagon », et il s’agissait sans aucun doute de croyances dégradées, à moitié païennes, importées d’Orient un siècle plus tôt, à l’époque où les pêcheries d’Innsmouth semblaient péricliter. Il était tout naturel qu’elles s’implantent chez des gens à l’esprit simple à la suite du retour soudain et permanent d’inépuisables bancs de poissons, et l’Ordre avait bientôt pris sur la ville une influence prépondérante, détrônant la franc-maçonnerie et installant son quartier général dans le vieux Masonic Hall, sur New Church Green[3].
Tout cela constituait, pour la pieuse miss Tilton, une excellente raison d’éviter la vieille ville en ruine et dépeuplée ; pour moi, ce fut un stimulant supplémentaire. À ce que j’espérais de l’architecture et de l’histoire s’ajoutait maintenant un zèle ardent pour l’anthropologie, et je pus à peine fermer l’œil avant la fin de la nuit dans ma petite chambre à L’Union.
2
Le lendemain matin, un peu avant dix heures, j’étais, une petite valise à la main, devant la pharmacie Hammond sur la place du vieux marché, pour attendre l’autobus d’Innsmouth. À mesure qu’approchait le moment de son arrivée, j’observai un recul général des flâneurs qui remontaient la rue ou traversaient la place jusqu’au restaurant Ideal Lunch. L’employé de la gare n’avait donc pas exagéré l’aversion de la population locale pour Innsmouth et ses habitants. Peu après, un petit car gris sale, extrêmement délabré, dévala State Street à grand bruit, prit le tournant et s’arrêta près de moi au bord du trottoir. Je compris immédiatement que c’était lui ; ce que confirma l’inscription à demi effacée sur le pare-brise – « Arkham-Innsmouth-Newb’port ».
Il n’y avait que trois passagers – bruns, négligés, l’air morose et assez jeunes – qui descendirent maladroitement quand la voiture s’arrêta et remontèrent State Street en silence, presque furtivement. Le chauffeur descendit à son tour et je le vis entrer dans la pharmacie pour y faire quelque achat. Voilà sans doute, me dis-je, ce Joe Sargent dont parlait l’employé de la gare ; et avant même d’avoir remarqué aucun détail, je fus envahi d’une répugnance instinctive que je ne pus ni expliquer ni réprimer. Je trouvai brusquement tout naturel que les gens du pays n’aient pas envie de voyager dans l’autobus de cet homme ni d’être conduits par son propriétaire, ou de fréquenter le moins du monde la résidence d’un tel individu et de ses pareils.
Lorsque le chauffeur sortit du magasin, je le regardai plus attentivement pour tâcher de saisir la cause de ma mauvaise impression. C’était un homme maigre de près de six pieds de haut, aux épaules voûtées, vêtu de vêtements civils bleus et râpés, et portant une casquette de golf grise aux bords effrangés. Il pouvait avoir trente-cinq ans, mais les rides bizarres qui creusaient profondément les côtés de son cou le vieillissaient quand on ne regardait pas son visage morne et sans expression. Il avait une tête étroite, des yeux bleus saillants et humides qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le front et le menton fuyants, et des oreilles singulièrement atrophiées. Sa lèvre supérieure, longue et épaisse, et ses joues grisâtres aux pores dilatés paraissaient presque imberbes, à part des poils jaunes clairsemés qui frisaient en maigres touffes irrégulières ; par places, la peau était rugueuse, comme pelée par une affection cutanée. Ses grandes mains aux veines apparentes étaient d’une teinte gris-bleu très extraordinaire. Les doigts, remarquablement courts en proportion, semblaient avoir tendance à se replier étroitement dans l’énorme paume. Quand il revint vers l’autobus, je remarquai sa démarche traînante et ses pieds démesurés. Plus je les regardais, plus je me demandais comment il pouvait trouver des souliers à sa pointure.
Quelque chose de huileux dans son aspect augmenta mon dégoût. Il travaillait sûrement aux pêcheries ou traînait autour car il était imprégné de leur puanteur caractéristique. Impossible de deviner de quel sang il était. Ses singularités n’étaient certainement ni asiatiques, ni polynésiennes, ni levantines ou négroïdes, cependant je voyais bien pourquoi on lui trouvait l’air étranger. Personnellement, j’aurais plutôt pensé à une dégénérescence biologique.
Je regrettai de constater qu’il n’y aurait pas dans l’autobus d’autres passagers que moi. Il me déplaisait, je ne savais pourquoi, de voyager seul avec ce chauffeur. Mais le moment du départ approchant, je vainquis mes appréhensions, suivis l’homme dans le bus et lui tendis un billet d’un dollar en murmurant seulement : « Innsmouth. » Il me regarda un instant avec curiosité en me rendant quarante cents sans mot dire. Je choisis une place loin derrière lui, mais du même côté de l’autobus, car je souhaitais pouvoir suivre des yeux la côte pendant le trajet. Enfin la voiture délabrée démarra avec une secousse, et roula bruyamment entre les vieux bâtiments de brique de State Street dans un nuage de vapeur qui sortait du pot d’échappement. Jetant un coup d’œil aux passants sur les trottoirs, j’eus l’impression qu’ils évitaient de regarder le bus – ou du moins d’avoir l’air de le regarder. Puis nous tournâmes à gauche dans High Street où l’allure se fit plus régulière ; on dépassa rapidement d’imposantes vieilles demeures des débuts de la République puis des fermes de style colonial plus anciennes encore, on traversa le Lower Green et la Parker River, pour déboucher enfin sur une longue plaine monotone en bordure de la côte.
La journée était chaude et ensoleillée, mais le paysage de sable, de carex et d’arbustes rabougris devenait de plus en plus désolé à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l’eau bleue et le long profil sablonneux de Plum Island, et bientôt nous nous rapprochâmes beaucoup de la grève tandis que notre chemin étroit s’éloignait de la grand-route qui menait à Rowley et Ipswich. Il n’y avait plus de maisons en vue, et je jugeai, d’après l’état de la chaussée, que la circulation était très réduite dans les parages. Les petits poteaux télégraphiques éprouvés par les intempéries ne portaient que deux fils. Nous franchissions de temps en temps des ponts de bois rudimentaires sur des cours d’eau soumis à la marée, qui, remontant très loin à l’intérieur des terres, contribuait à l’isolement de la région.
J’aperçus à plusieurs reprises de vieilles souches et des murs de fondations en ruine émergeant du sable amoncelé par le vent, et je me rappelai que, selon une vieille tradition évoquée dans une des histoires que j’avais lues, cette région avait été jadis fertile et très peuplée. Le changement, disait-on, avait coïncidé avec l’épidémie d’Innsmouth en 1846, et les esprits simples voyaient un rapport obscur avec de mystérieuses puissances maléfiques. En fait, il était dû à des coupes inconsidérées de forêts proches du rivage, qui, privant le sol de sa meilleure protection, avaient ouvert la voie à l’invasion des sables poussés par le vent.
Enfin nous perdîmes de vue Plum Island et sur notre gauche apparut l’immense étendue de l’océan Atlantique. Notre route étroite se mit à monter en pente raide, et j’éprouvai un étrange malaise en regardant devant moi la crête solitaire où le chemin creusé d’ornières rencontrait le ciel. Comme si l’autobus allait poursuivre son ascension, quittant complètement le monde de la raison pour se perdre dans les arcanes inconnus des couches supérieures de l’atmosphère et du ciel indéchiffrables. L’odeur de la mer prit une signification inquiétante, et le chauffeur silencieux, la raideur de son dos voûté, sa tête étroite devinrent de plus en plus détestables. En l’observant je m’aperçus que l’arrière de sa tête était presque aussi chauve que son visage ; quelques rares mèches jaunes éparpillées sur une peau grise et rugueuse.
Arrivés au sommet, nous vîmes la vallée qui se déployait de l’autre côté, à l’endroit où le Manuxet rejoignait la mer au nord de la longue ligne de falaises qui culmine à Kingsport Head, puis oblique en direction de Cape Ann. À l’horizon lointain et brumeux je distinguai à peine le profil vertigineux du sommet, couronné par l’étrange vieille maison sur laquelle on a conté tant de légendes ; mais pour l’instant toute mon attention était retenue par le panorama le plus proche juste au-dessous de moi. J’étais, je le compris, face à face avec Innsmouth, la ville épiée par la rumeur.
Malgré sa grande étendue et la densité de ses constructions, la rareté des signes de vie y était de mauvais augure. Du fouillis des cheminées montait à peine un filet de fumée, et les trois grands clochers se dressaient, austères et dépouillés, sur l’horizon du côté de la mer. L’un d’eux perdait son faîte par morceaux, et ainsi qu’un autre il exhibait des trous noirs béants là où avaient été des cadrans d’horloge. L’accumulation de toits en croupe affaissés et de pignons pointus inspirait avec une désagréable évidence l’idée de ruines vermoulues, et, en approchant à mesure que la route descendait, je vis beaucoup de toits complètement effondrés. Il y avait aussi de grandes maisons carrées de style géorgien[4], avec des toits à arêtes, des lanterneaux et des galeries à balustrade. Elles se trouvaient pour la plupart loin de la mer, et une ou deux étaient en assez bon état. Je vis, s’en éloignant vers l’intérieur des terres, les rails rouillés et envahis par l’herbe du chemin de fer abandonné, avec les poteaux télégraphiques penchés, maintenant dépourvus de fils, et la voie à demi effacée des vieux wagons qui allaient à Rowley et Ipswich.
Le délabrement était pire près des quais, mais en leur centre même, j’aperçus le blanc campanile d’un bâtiment de brique assez bien conservé qui ressemblait à une petite usine. Le port, depuis longtemps ensablé, était protégé par une vieille digue de pierre ; j’y discernai les petites silhouettes de quelques marins assis, et à son extrémité ce qui semblait les fondations d’un phare disparu. Une langue de sable s’était formée à l’intérieur de cette barrière, et l’on y voyait des cabanes branlantes, des doris amarrés et des casiers à homards éparpillés. Il ne semblait y avoir d’eau profonde qu’à l’endroit où la rivière coulait à flots devant le bâtiment au campanile et obliquait vers le sud pour rejoindre l’océan au bout de la digue.
Çà et là les ruines des quais partaient du rivage pour s’achever en méconnaissable pourriture, et les plus éloignés au sud paraissaient les plus dégradés. Au large j’aperçus, malgré la marée haute, une longue ligne noire, presque à fleur d’eau, qui donnait l’impression d’une étrange malignité latente. Ce devait être, je le savais, le Récif du Diable. Tandis que je le regardais, le sentiment subtil, bizarre, qu’il me faisait signe vint s’ajouter à la menace repoussante ; et, curieusement, cette nuance nouvelle me troubla davantage que l’impression première.
Nous ne rencontrâmes personne sur la route, mais bientôt nous passâmes devant des fermes désertes plus ou moins en ruine. Puis je remarquai quelques maisons habitées aux fenêtres brisées bourrées de chiffons, aux cours jonchées de coquillages et de poissons morts. Une ou deux fois je vis des individus à l’air apathique travailler dans des jardins ingrats, ou chercher des clams sur la plage qui empestait le poisson, et des groupes d’enfants sales au visage simiesque qui jouaient devant les seuils envahis de mauvaise herbe. Ces gens semblaient encore plus inquiétants que les bâtiments lugubres car presque tous présentaient des singularités de traits et d’attitude qui m’étaient instinctivement antipathiques sans que je sache les saisir ni les préciser. Je crus un instant que ce physique caractéristique me rappelait une image déjà vue, peut-être dans un livre, en des circonstances particulièrement horribles et attristantes ; mais ce pseudo-souvenir disparut très rapidement.
Comme l’autobus arrivait en terrain plat, je perçus le bruit régulier d’une chute d’eau qui rompait le silence anormal. Les maisons penchées et lépreuses, plus rapprochées, bordaient les deux côtés de la route, et prenaient un caractère plus urbain que celles que nous laissions derrière nous. En avant, la perspective s’était réduite à un décor de rue, où je vis les traces d’un ancien pavage et des bouts de trottoirs de brique. Toutes les maisons paraissaient désertes, et par endroits des brèches révélaient les restes de cheminées et de murs de cave des habitations écroulées. Partout régnait l’odeur de poisson la plus écœurante qu’on puisse imaginer.
Bientôt apparurent des carrefours et des bifurcations ; les rues de gauche menaient vers le rivage aux quartiers sordides non pavés et pourrissants, tandis que celles de droite gardaient encore l’image d’une splendeur défunte. Jusque-là je n’avais vu personne dans cette ville, mais il apparut alors quelques signes d’une population clairsemée – des rideaux aux fenêtres ici et là, une vieille voiture au bord d’un trottoir. Car les trottoirs et les pavés étaient de plus en plus visibles, et même si la plupart des maisons étaient plutôt anciennes – des constructions de bois et de brique du début du XIXe siècle –, elles restaient manifestement habitables. En moi, l’amateur d’antiquités oublia presque le dégoût olfactif comme le sentiment de menace et de répulsion, au milieu de cette riche et immuable survivance du passé.
Mais je ne devais pas atteindre ma destination sans ressentir un choc des plus pénibles. L’autobus était parvenu à une sorte de vaste carrefour ou de place en étoile, avec des églises des deux côtés, et au centre les restes en lambeaux d’une pelouse circulaire, et je regardais à ma droite un grand édifice à colonnes. La peinture autrefois blanche en était à présent grise, écaillée, et l’inscription noir et or sur le fronton était ternie au point que j’eus du mal à déchiffrer les mots « Ordre ésotérique de Dagon ». C’était donc là l’ancienne salle de réunion maçonnique désormais affectée à un culte dégradé. Tandis que je m’efforçais de lire cette inscription, mon attention fut distraite par les sons rauques d’une cloche fêlée qui sonnait de l’autre côté de la rue, et je me retournai vivement pour regarder par la vitre de la voiture tout près de moi.
Le son venait d’une église de pierre au clocher trapu, visiblement plus ancienne que la plupart des maisons, construite dans un style pseudo-gothique et dont le soubassement anormalement haut avait des fenêtres closes. L’horloge que j’apercevais avait perdu ses aiguilles, mais j’entendis la cloche enrouée sonner onze heures. Puis soudain toute idée de temps s’effaça devant une image fulgurante d’une extrême intensité et d’une horreur inexplicable, qui me saisit avant même que j’aie pu l’identifier. La porte du sous-sol était ouverte sur un rectangle de ténèbres. Et au moment où je la regardais, quelque chose passa ou sembla passer sur ce fond obscur, gravant dans mon esprit une impression fugitive de cauchemar d’autant plus affolante que l’analyse n’y pouvait déceler le moindre caractère cauchemardesque.
C’était un être vivant – le premier, à part le chauffeur, que j’aie vu depuis mon entrée dans la ville proprement dite – et si j’avais été plus calme je n’y aurais trouvé absolument rien de terrible. De toute évidence, je le compris un moment plus tard, c’était le pasteur, revêtu des curieux ornements sacerdotaux introduits sans doute depuis que l’Ordre de Dagon avait modifié le rituel des églises locales. Ce qui avait dû frapper mon premier regard inconscient et me pénétrer d’une horreur inexplicable, c’était la haute tiare qu’il portait, réplique presque parfaite de celle que m’avait montrée miss Tilton la veille au soir. Frappant mon imagination, elle avait prêté un caractère sinistre indéfinissable à un visage imprécis et à une silhouette, vêtue d’une robe et traînant les pieds. Je ne tardai pas à conclure que je n’avais eu aucune raison d’éprouver ce frisson pour un néfaste faux souvenir. N’était-il pas naturel qu’une secte locale adopte parmi ses tenues un modèle unique de coiffure familier à la communauté par quelque singularité – peut-être la découverte d’un trésor ?
Çà et là quelques jeunes gens apparurent sur les trottoirs – individus répugnants, seuls ou par petits groupes silencieux de deux ou trois. Le rez-de-chaussée des maisons croulantes abritait parfois de modestes boutiques aux enseignes minables, et je remarquai un ou deux camions arrêtés que nous dépassions bruyamment. Le bruit de chute d’eau devint de plus en plus net, et je vis presque aussitôt devant nous une rivière très encaissée, enjambée par un large pont à balustrade de fer au-delà duquel s’ouvrait une grande place. Pendant que nous le franchissions avec un bruit métallique, je regardai des deux côtés et j’aperçus des bâtiments d’usine sur le bord de l’escarpement herbeux ou un peu plus bas. Tout au fond de la gorge l’eau était très abondante, et je vis deux fortes chutes en amont à ma droite et au moins une en aval à ma gauche. À cet endroit le bruit était assourdissant. Puis nous débouchâmes sur la grande place semi-circulaire de l’autre côté de la rivière et nous nous arrêtâmes à main droite devant une grande bâtisse couronnée d’un belvédère, portant des restes de peinture jaune et une enseigne à demi effacée qui annonçait la Maison Gilman.
Trop heureux de descendre enfin de cet autobus, j’allai immédiatement déposer ma valise dans le hall sordide de l’hôtel. Je n’y trouvai qu’une seule personne – un homme d’un certain âge qui n’avait pas ce que j’avais fini par appeler « le masque d’Innsmouth » – et, me souvenant d’incidents bizarres qu’on avait signalés dans cet hôtel, je résolus de ne lui poser aucune des questions qui me préoccupaient. J’allai plutôt faire un tour sur la place, d’où l’autobus était déjà reparti, pour examiner l’endroit d’un œil attentif et critique.
L’espace libre pavé de pierres rondes était limité d’un côté par la ligne droite de la rivière, de l’autre par un demi-cercle de bâtiments de brique aux toits en pente datant de 1800 environ, d’où rayonnaient plusieurs rues vers le sud-est, le sud et le sud-ouest. Les réverbères étaient désespérément rares et petits – toujours des lampes à incandescence de faible puissance – et je me félicitai d’avoir prévu mon départ avant la nuit, même si je savais qu’il y aurait un beau clair de lune. Les bâtiments étaient tous en bon état et comptaient peut-être une douzaine de boutiques toujours en activité ; l’une d’elles était une épicerie, succursale de la First National, une autre un restaurant lugubre, suivi d’une pharmacie, du bureau d’un poissonnier en gros, et d’une autre encore à l’extrémité est de la place, près de la rivière, les bureaux de la seule industrie de la ville, la Compagnie d’affinage Marsh. Il y avait une dizaine de personnes, quatre ou cinq automobiles et camions arrêtés çà et là. Je me trouvais donc au cœur de la vie sociale d’Innsmouth. J’apercevais à l’est le bleu du port, sur lequel se détachaient les ruines de trois clochers géorgiens, superbes en leur temps. Et vers le littoral, sur l’autre berge de la rivière, le blanc campanile qui surmontait ce que je supposai être l’affinerie Marsh.
Pour une raison ou pour une autre, je commençai à l’épicerie mes premières investigations, le personnel d’une succursale ayant moins de chances d’être du pays. Celui qui s’en occupait seul était un garçon d’environ dix-sept ans, et je constatai avec plaisir l’air accueillant et la vivacité qui promettaient une information réconfortante. Il semblait ravi de parler, et je compris bientôt qu’il n’aimait pas cet endroit, son odeur de poisson ni ses habitants sournois. Quelques mots avec un étranger lui étaient un soulagement. Il venait d’Arkham, logeait chez une famille originaire d’Ipswich, et retournait chez lui chaque fois qu’il avait un moment de liberté. Ses parents regrettaient qu’il travaille à Innsmouth, mais la direction de la chaîne l’avait envoyé là et il ne voulait pas perdre son emploi.
Il n’y avait à Innsmouth, dit-il, ni bibliothèque municipale ni chambre de commerce, mais je saurais probablement m’orienter. La rue par laquelle j’étais arrivé était la Federal. À l’ouest se trouvaient les rues des anciens beaux quartiers – Broad, Washington, Lafayette et Adams Streets – et à l’est les taudis du côté de la mer. C’était là – le long de Main Street – que je trouverais les vieilles églises géorgiennes, mais elles étaient abandonnées depuis longtemps. Mieux valait ne pas se faire trop remarquer dans ces parages – surtout au nord de la rivière – car les gens étaient maussades et hostiles. Quelques étrangers avaient même disparu.
Certains endroits étaient presque territoire interdit, comme il l’avait durement appris à ses dépens. Il ne fallait pas, par exemple, traîner près de l’affinerie Marsh, ni autour d’aucune église encore active ou de la salle à colonnes de l’Ordre de Dagon, à New Church Green. Ces églises très singulières – toutes formellement désavouées ailleurs par leurs confessions respectives – adoptaient, à ce qu’on disait, les rituels et les vêtements sacerdotaux les plus bizarres. Leur credo hétérodoxe et mystérieux faisait entrevoir de prodigieuses métamorphoses qui menaient à une sorte d’immortalité du corps, sur cette terre même. Le pasteur du jeune homme – le Dr Wallace d’Asbury M. E. Church[5] d’Arkham – lui avait solennellement recommandé de ne fréquenter aucune église à Innsmouth.
Quant aux habitants, il ne savait trop qu’en penser. Ils étaient aussi insaisissables et furtifs que les animaux qui vivent dans des terriers, et l’on se demandait bien comment ils pouvaient passer leur temps en dehors de leur activité intermittente de pêcheurs. À en juger par les quantités d’alcool de contrebande qu’ils consommaient, peut-être restaient-ils une bonne partie de la journée plongés dans une hébétude d’ivrogne. Ils semblaient se grouper dans une espèce de solidarité et de morne confrérie – méprisant le reste du monde comme s’ils avaient accès à d’autres sphères d’existence plus enviables. Physiquement, ils étaient vraiment épouvantables – surtout ces yeux fixes qu’on ne voyait jamais fermés – et leur voix faisait horreur. On les entendait avec dégoût psalmodier la nuit dans leurs églises, particulièrement pendant leurs fêtes et cérémonies de « renouveau » qui tombaient deux fois par an, le 30 avril et le 31 octobre.
Ils adoraient l’eau, et nageaient énormément dans la rivière et dans le port. Les courses de natation jusqu’au Récif du Diable étaient très fréquentes, et tous ceux qu’on y voyait semblaient tout à fait capables de prendre part à cette difficile épreuve. À bien y réfléchir, c’étaient plutôt les gens encore jeunes qu’on voyait en public, et parmi eux les aînés étaient le plus sujets aux malformations. Les exceptions, quand il y en avait, étaient en général des personnes sans aucune anomalie comme le vieil employé de l’hôtel. On pouvait se demander ce que devenait la masse des vieilles gens, et si le « masque d’Innsmouth » n’était pas une étrange et insidieuse maladie qui aggravait son emprise à mesure que les années passaient.
Seul un mal peu commun pouvait évidemment provoquer chez un individu d’aussi graves et radicales transformations anatomiques après la maturité – affectant jusqu’à des éléments osseux fondamentaux tels que la forme du crâne – et pourtant, même cette particularité n’était pas plus déconcertante et inouïe que les signes visibles de la maladie dans leur ensemble. Il serait difficile, pensait le jeune homme, d’obtenir des conclusions précises sur ce point car on n’arrivait jamais à connaître personnellement les indigènes même après un long séjour à Innsmouth.
Il était persuadé que beaucoup de spécimens pires encore que les plus hideux qu’on rencontrait étaient tenus sous clé quelque part. On entendait parfois des bruits étranges. Les taudis croulants du front de mer au nord de la rivière communiquaient disait-on par des galeries secrètes, constituant une véritable réserve de monstres invisibles. De quel sang étranger étaient-ils – si c’était du sang ? impossible de le savoir. On cachait quelquefois certains individus particulièrement répugnants quand les représentants du gouvernement ou d’autres personnes du monde extérieur venaient à Innsmouth.
Il serait inutile, dit mon informateur, de poser aux indigènes des questions sur leur cité. Le seul qui consentirait à parler était un homme très âgé mais apparemment normal qui vivait à l’hospice tout en haut du quartier nord et passait son temps à aller et venir ou à flâner près de la caserne des pompiers. Ce personnage chenu, Zadok Allen, avait quatre-vingt-seize ans, perdait un peu la tête, et c’était l’ivrogne de la ville. Un être bizarre aux allures furtives, qui regardait sans cesse par-dessus son épaule comme s’il redoutait quelque chose, et qui refusait absolument, quand il était à jeun, de parler avec des étrangers. Mais aussi, il était incapable de résister à une offre de son poison favori ; et une fois ivre, il prodiguait à voix basse des débris de souvenirs stupéfiants.
Pourtant, on n’en tirait pas grand-chose d’utile ; car ses histoires, allusions folles et sans suite à des horreurs et à des merveilles incroyables, ne pouvaient venir que de sa propre imagination déréglée. Personne ne le croyait jamais, mais les gens de la ville n’aimaient pas le voir boire et parler avec des étrangers ; et il n’était pas toujours sans risque d’être vu en conversation avec lui. Les rumeurs et les chimères populaires les plus délirantes devaient en partie lui être attribuées.
Quelques habitants originaires d’ailleurs prétendaient de temps en temps avoir entr’aperçu des choses monstrueuses, mais entre les histoires du vieux Zadok et les difformités des citoyens, il n’était pas surprenant que naissent de telles illusions. Aucun d’eux ne s’attardait dehors à la tombée de la nuit car il était généralement admis que ce serait une imprudence. D’ailleurs, les rues étaient affreusement sombres.
Quant au commerce, l’abondance du poisson était assurément presque surnaturelle, mais les indigènes en profitaient de moins en moins. En outre, les prix baissaient et la concurrence allait croissant. Évidemment la seule industrie véritable de la ville était l’affinerie, dont les bureaux se trouvaient sur la place, à quelques maisons seulement de l’épicerie où nous étions. Le vieux Marsh ne se montrait jamais, mais il se rendait parfois à son usine dans une voiture fermée aux rideaux tirés.
Beaucoup de bruits couraient sur ce qu’il était devenu. Dans le temps ç’avait été un vrai dandy, et l’on prétendait qu’il portait encore la redingote de l’époque d’Édouard VII, curieusement adaptée à certaines déformations. Ses fils, qui dirigeaient autrefois le bureau sur la place, étaient devenus invisibles depuis longtemps, laissant la charge des affaires à la nouvelle génération. Eux et leurs sœurs avaient pris un air très bizarre, surtout les aînés ; et l’on disait que leur santé déclinait.
L’une des filles Marsh était une femme repoussante, à l’allure reptilienne, qui portait une profusion de bijoux appartenant manifestement à la même tradition exotique que la fameuse tiare. Mon informateur les avait remarqués plusieurs fois, et il avait entendu dire que cela venait d’un trésor secret de pirates ou de démons. Les pasteurs – ou les prêtres, ou quel que soit le nom qu’ils portaient à présent – avaient adopté comme coiffure une parure de ce genre, mais on les apercevait rarement. Le jeune homme n’en avait jamais vu d’autre spécimen, bien qu’il en existât beaucoup à Innsmouth, disait-on.
Les Marsh, comme les trois autres familles bien nées de la ville – les Waites, les Gilman et les Eliot –, vivaient très retirés. Ils habitaient d’immenses demeures le long de Washington Street, et plusieurs étaient soupçonnés d’abriter en cachette certains parents encore vivants à qui leur étrange aspect interdisait de paraître en public, et dont le décès avait été annoncé et enregistré.
M’ayant averti que beaucoup de rues avaient perdu leurs plaques, le jeune homme dessina à mon intention une carte, sommaire mais claire et appliquée, des traits les plus frappants de la ville. Après l’avoir examinée un moment, je sentis qu’elle me serait d’un grand secours, et je l’empochai avec les remerciements les plus vifs. Le seul restaurant que j’avais vu était si minable que j’achetai une bonne provision de biscuits au fromage et de gaufrettes au gingembre qui me tiendraient lieu de déjeuner. Je décidai de parcourir les rues principales, de parler à tous les non-indigènes que je pourrais rencontrer, et de prendre la voiture de huit heures pour Arkham. La ville, je le voyais bien, offrait un exemple extrême et significatif de déchéance collective ; mais n’étant pas sociologue je bornerai mes observations essentielles au domaine de l’architecture.
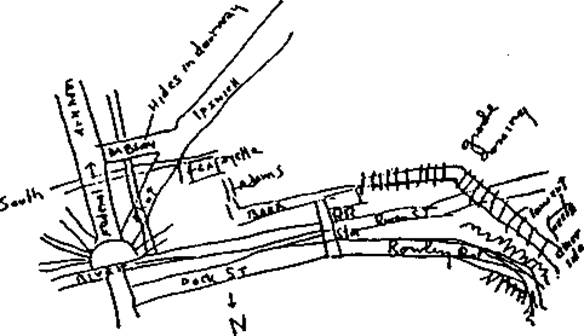
Plan d’Innsmouth, dessiné par H. P. L.
C’est ainsi que je commençai ma visite systématique et assez déconcertante des rues d’Innsmouth, étroites et condamnées à l’ombre. Après avoir traversé le pont et tourné en direction des chutes grondantes de l’aval, je passai tout près de l’affinerie Marsh, singulièrement silencieuse pour un bâtiment industriel. Elle se dressait sur l’escarpement qui dominait la rivière, près du pont et du large carrefour qui devait être l’ancien centre actif, remplacé après la Révolution par l’actuelle Town Square.
Franchissant de nouveau la gorge sur le pont de Main Street, je découvris un quartier tellement désert que j’en eus un frisson. Des groupes croulants de toits à deux pentes se découpaient sur le ciel en une fantastique dentelure, que dominait le sinistre clocher décapité d’une ancienne église. Certaines maisons de Main Street étaient occupées mais la plupart avaient été aveuglées par des planches clouées. Dans les ruelles adjacentes dépourvues de pavés je vis les fenêtres noires et béantes de bicoques abandonnées dont beaucoup penchaient selon des angles incroyables et périlleux par suite de l’écroulement d’une partie des fondations. Devant le regard fixe de ces fenêtres fantomatiques, il fallait du courage pour tourner vers l’est en direction du port. La terreur des maisons désertes croît certainement en progression géométrique et non arithmétique à mesure que ces maisons se multiplient pour former une cité totalement désolée. La vue de ces interminables avenues aussi vides et mortes que des yeux de poisson, la pensée de ces enfilades de compartiments noirs et menaçants voués aux toiles d’araignées, aux souvenirs et au ver vainqueur, réactivent des vestiges de peurs et de dégoûts que ne saurait dissiper la plus robuste philosophie.
Fish Street était aussi déserte que Main Street, mais en revanche elle gardait beaucoup d’entrepôts de brique et de pierre en excellent état. Water Street en était presque la réplique, sauf qu’elle présentait de larges brèches en direction de la mer à la place des quais détruits. Je ne voyais pas un être vivant, à part de rares pêcheurs au loin sur la digue, et je n’entendais pas d’autre bruit que le clapotis de la marée dans le port et le grondement des chutes du Manuxet. La ville agissait de plus en plus sur mes nerfs, et je regardai furtivement derrière moi en rebroussant chemin pour traverser le pont branlant de Water Street. Celui de Fish Street, comme l’indiquait mon plan, était en ruine.
Au nord de la rivière il y avait quelques traces de vie misérable – conserveries de poissons en pleine activité dans Water Street, fumées de cheminées et toits réparés ici et là, bruits de provenance indéterminée, silhouettes au pas traînant dans les rues mornes et les ruelles non pavées – mais cela me semblait encore plus oppressant que l’abandon du quartier sud. D’abord, les gens étaient plus hideux et anormaux que ceux du centre de la ville ; au point que plusieurs fois me revint désagréablement à l’esprit une question absolument invraisemblable dont je ne savais que faire. Sans aucun doute le sang étranger dans la population d’Innsmouth était-il ici plus présent que vers l’intérieur des terres – à moins que le « masque d’Innsmouth » ne soit une maladie plutôt qu’une tare héréditaire, auquel cas ce quartier abritait les lésions les plus graves.
Un détail qui me préoccupait était la répartition des quelques faibles bruits que j’entendais. Ils auraient dû bien sûr tous venir des maisons visiblement habitées, alors qu’en réalité ils étaient souvent plus forts derrière les façades les plus rigoureusement condamnées. Il y avait des craquements, des bruits de pas précipités et des sons rauques incertains ; je songeai avec inquiétude aux souterrains secrets qu’avait évoqués le jeune garçon de l’épicerie. Brusquement, je me surpris à me demander quelles pouvaient être les voix de ces gens. Je n’avais entendu parler personne jusqu’ici dans ce quartier, et sans savoir pourquoi je redoutais vivement de les entendre.
Je ne pris que le temps de regarder deux églises, belles mais en ruine, de Main Street et de Church Street, puis je quittai en hâte ces immondes taudis du front de mer. Logiquement j’aurais dû gagner New Church Green, mais, quelle qu’en fût la raison, je ne pus supporter l’idée de repasser devant l’église où j’avais aperçu la silhouette inexplicablement terrifiante du prêtre ou pasteur bizarrement couronné. D’ailleurs, le jeune homme m’avait dit que les églises, aussi bien que la salle de l’Ordre de Dagon, n’étaient pas des endroits sûrs pour des étrangers.
Je suivis donc Main Street en direction du nord jusqu’à Martin Street, puis, tournant vers l’intérieur des terres, je traversai sans dommage Federal Street au nord du Green, et pénétrai dans l’ancien quartier aristocratique du nord de Broad Street et des rues Washington, Lafayette et Adams. Bien que mal pavées et négligées, ces vieilles avenues ombragées d’ormes n’avaient pas perdu toute leur dignité. Elles sollicitaient l’une après l’autre mon attention ; la plupart étaient délabrées et aveuglées de planches au milieu de parcs à l’abandon, mais une ou deux dans chaque rue paraissaient habitées. Dans Washington Street il en restait quatre ou cinq à la suite en excellent état, entourées de pelouses et de jardins parfaitement entretenus. La plus somptueuse – dont les vastes parterres en terrasses s’étendaient jusqu’à Lafayette Street – appartenait probablement au vieux Marsh, le propriétaire contaminé de l’affinerie.
On ne voyait aucun être vivant dans ces rues, et je m’étonnai de l’absence totale de chats et de chiens à Innsmouth. Autre sujet de perplexité et de trouble, même dans certaines des demeures les mieux conservées, beaucoup de fenêtres du troisième étage et du grenier étaient hermétiquement condamnées. La dissimulation et le mystère semblaient régner universellement dans cette cité étrangère de silence et de mort, et je ne pouvais m’empêcher de me sentir épié de tous côtés par ces yeux fixes et sournois qui ne se fermaient jamais.
Je frissonnai en entendant une cloche fêlée sonner trois heures dans un clocher sur ma gauche. Je ne me rappelais que trop l’église trapue d’où ces sons provenaient. Suivant Washington Street jusqu’à la rivière, je me trouvai de nouveau devant une ancienne zone industrielle et commerciale ; je remarquai les ruines d’une usine en face, puis d’autres, et les restes d’une vieille gare et d’un pont de chemin de fer couvert au-delà, qui enjambait la gorge à ma droite.
Bien que ce pont douteux fût muni d’un panneau dissuasif, je m’y risquai et repassai sur la rive sud où un peu de vie réapparut. Des créatures furtives au pas traînant me jetèrent des regards énigmatiques, et des visages plus normaux m’examinèrent avec froideur et curiosité. Innsmouth devenait rapidement intolérable, et je tournai dans Paine Street en direction de la grand-place dans l’espoir de trouver un véhicule quelconque qui me ramènerait à Arkham avant l’heure de départ encore éloignée du sinistre autobus.
C’est alors que je vis à ma gauche la caserne de pompiers délabrée, et remarquai un vieillard rougeaud, à la barbe hirsute et aux yeux larmoyants, couvert de haillons indescriptibles, qui, assis devant sur un banc, bavardait avec deux pompiers en tenue négligée mais l’air normal. Cela ne pouvait être que Zadok Allen, le nonagénaire alcoolique et à demi fou dont les histoires sur la vieille Innsmouth et son ombre étaient si hideuses et incroyables.
3
C’est sans doute quelque petit démon pervers – ou l’influence sardonique de sources obscures et secrètes – qui me fit ainsi changer mes projets. J’avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture, et je venais même de me précipiter vers la grand-place pour chercher un moyen rapide de quitter cette ville pourrissante de décadence et de mort ; mais la vue du vieux Zadok Allen avait fait prendre un nouveau cours à mon esprit et ralenti mon pas devenu hésitant.
On m’avait affirmé que le vieillard ne pouvait qu’insinuer des légendes extravagantes, décousues et incroyables, et l’on m’avait mis en garde contre le danger d’être vu par les indigènes en train de parler avec lui ; pourtant l’idée de ce vieux témoin du déclin de la ville, avec ses souvenirs qui remontaient aux premiers temps des vaisseaux et des fabriques, avait un attrait auquel toute ma raison ne pouvait résister. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent que des allégories ou des symboles fondés sur des réalités, et le vieux Zadok avait dû assister à tout ce qui s’était passé à Innsmouth au cours des quatre-vingt-dix dernières années. La curiosité m’exalta au mépris de la prudence et du bon sens, et, avec la présomption de la jeunesse, j’imaginais que je saurais dégager un noyau de vérité historique du débordement confus et délirant que je tirerais probablement de lui avec l’aide du whisky.
Je savais qu’il ne fallait pas l’aborder là tout de suite car les pompiers n’auraient pas manqué de s’interposer. Mieux valait commencer, me dis-je, par acheter de l’alcool de contrebande à un endroit où le garçon épicier m’avait dit qu’on en trouvait en quantité. Puis j’irais flâner sans but apparent près de la caserne des pompiers et je rencontrerais le vieux Zadok dès qu’il aurait entrepris une de ses fréquentes balades. Selon le jeune homme, il était très remuant et demeurait rarement assis plus d’une heure ou deux près de la caserne.
Je trouvai aisément, bien qu’au prix fort, une bouteille de whisky dans l’arrière-boutique d’un minable « Prix-unique », juste derrière la grand-place dans Eliot Street. L’individu malpropre qui me servit avait un peu la fixité du « masque d’Innsmouth », mais il fut plutôt poli à sa manière ; peut-être était-il habitué à recevoir des clients étrangers – camionneurs, trafiquants d’or ou autres – comme il en passait de temps en temps en ville.
En regagnant la grand-place, je constatai que la chance était avec moi car j’aperçus bel et bien – émergeant de Paine Street au coin de la Maison Gilman – la haute et maigre silhouette en loques du vieux Zadok Allen lui-même. Comme je l’avais prévu, j’attirai son attention en brandissant la bouteille que je venais d’acheter ; et je m’aperçus bientôt qu’il me suivait d’un pas traînant avec un air d’envie quand je tournai dans Waite Street pour gagner le quartier que je pensais le plus désert.
M’orientant grâce à la carte dessinée à l’épicerie, je me dirigeai vers la partie sud des quais entièrement abandonnée que j’avais déjà visitée. Je n’y avais aperçu que les pêcheurs au loin sur la digue ; et en m’éloignant un peu plus vers le sud je pouvais me mettre hors de leur vue, trouver de quoi m’asseoir sur quelque quai désert et interroger tout à loisir le vieux Zadok sans être observé. Avant d’atteindre Main Street j’entendis derrière moi un faible et poussif « Hé, m’sieur ! », et, me laissant rattraper, je permis au vieil homme de boire à la bouteille de copieuses lampées.
Je commençai à tâter le terrain en suivant Water Street pour tourner vers le sud au milieu d’une totale désolation de ruines vertigineuses, mais je m’aperçus que le vieux ne se laisserait pas délier la langue aussi vite que je l’espérais. Je vis enfin une brèche herbeuse ouverte vers la mer entre des murs de brique croulants, et au-delà l’étendue de maçonnerie et de terre d’un quai envahi de mauvaises herbes. Près de l’eau, des tas de pierres moussues offraient des sièges acceptables, et au nord un entrepôt délabré abritait l’endroit contre tous les regards. C’était à mon avis l’idéal pour un long entretien secret ; je guidai donc mon compagnon vers le passage et le fis asseoir parmi les pierres moussues. L’atmosphère d’abandon et de mort était macabre, et l’odeur de poisson presque intolérable ; mais j’avais décidé que rien ne m’arrêterait.
Il me restait quatre heures pour cette conversation si je voulais prendre l’autobus d’Arkham à huit heures et, tout en avalant mon frugal déjeuner, je commençai à octroyer un peu plus d’alcool au vieux buveur. J’eus soin cependant dans mes largesses de ne pas compromettre mon entreprise, car je n’avais pas envie que la volubilité alcoolique de Zadok s’éteigne dans l’hébétude. Au bout d’une heure, sa morosité sournoise sembla se dissiper, mais à ma vive déception il continua à esquiver mes questions sur Innsmouth et son ténébreux passé. Il bavardait à propos des nouvelles du jour, révélant une connaissance étendue de la presse et une tendance marquée à philosopher d’un ton de villageois sentencieux.
Vers la fin de la seconde heure, je craignis que mon litre de whisky ne soit insuffisant pour obtenir ce que je voulais, et je me demandai s’il ne valait pas mieux laisser là le vieux Zadok pour aller en chercher un autre. Mais à ce moment précis, le hasard fournit l’introduction que mes questions n’avaient su amener ; et le poussif radotage du vieux prit un tour tel que je me penchai vers lui et dressai l’oreille. Je tournais le dos à la mer et à son relent de poisson, mais il lui faisait face, et je ne sais ce qui attira son regard errant vers le profil bas et lointain du Récif du Diable, qui apparaissait nettement, presque fascinant, au-dessus des vagues. Cette vue sembla lui déplaire, car il se mit à égrener à mi-voix des jurons qui s’achevèrent en un murmure confidentiel et un regard entendu. Il se rapprocha de moi, saisit le revers de mon veston, puis émit d’une voix sifflante ces propos sur lesquels on ne pouvait se méprendre :
« C’est là qu’tout a commencé – c’t endroit maudit de toute la malfaisance, là où commence l’eau profonde. La porte d’l’enfer – ça descend à pic jusqu’au fond, y a pas d’ligne de fond qui va jusque-là. C’est l’vieux cap’taine Obed qu’a tout fait – qu’a trouvé dans ces îles d’la mer du Sud des choses qui y ont pas fait d’bien.
« Dans c’temps-là ça allait mal pour tout le monde. L’commerce dégringolait, les usines avaient pus d’travail – même les nouvelles – et pis les meilleurs d’nos gars tués comme corsaires dans la guerre de 1812 ou péris avec le brick Eliza et le Ranger – qu’étaient tous les deux aux Gilman. Obed Marsh, lui, il avait trois bateaux sur l’eau, le brigantin Columbia, l’brick Hetty, et la goélette Sumatra Queen. Y avait qu’lui qui faisait l’commerce avec les Antilles et l’Pacifique, quoique la goélette Malay Pride, qu’était à Esdras Martin, a fait un voyage encore en 28.
« Jamais y a eu personne comme le cap’taine Obed – c’vieux suppôt d’Satan ! Hi, hi ! Je m’souviens comme y parlait des pays d’là-bas, et y traitait tous les gens d’idiots d’aller au culte des chrétiens et d’supporter leur fardeau comme des agneaux bêlants. Y f’raient mieux de s’trouver des dieux comme ceux d’là-bas dans les Antilles – des dieux qui leur donneraient des pêches miraculeuses en échange d’leurs sacrifices, et qui répondraient comme y faut aux prières des gens.
« Matt Eliot, son second, causait pas mal non plus, seulement il était contre toutes ces manigances de païens. Y parlait d’une île à l’est de Tahiti où y avait des tas d’ruines en pierre si vieilles que personne savait rien dessus, pareil que sur Ponape, dans les Carolines, mais avec des figures sculptées comme les grandes statues d’l’île de Pâques. À côté y avait aussi une petite île volcanique où on trouvait d’autres ruines avec des sculptures différentes – des ruines tout usées comme si elles auraient été sous la mer aut’fois, et avec des images de monstres abominables tout partout.
« Eh ben, m’sieur, y disait Matt qu’tous les natifs du coin y-z-avaient tout l’poisson qu’y voulaient, et y portaient des bracelets et des anneaux au-dessus du coude et des couronnes, tout ça fait d’une drôle d’espèce d’or et plein d’images de monstres comme celles qu’étaient dessinées sur les ruines de la petite île – on aurait dit des grenouilles-poissons ou ben des poissons-grenouilles qu’étaient dans toutes les positions pareil que des êtres humains. Personne a jamais pu leur faire dire où y-z-avaient trouvé tout ça, et tous les aut’natifs se demandaient comment y faisaient pour trouver tant d’poisson même quand dans les îles y prenaient presque rien. Matt s’est d’mandé aussi, et l’cap’taine Obed pareil. En plus, Obed a r’marqué qu’un tas de beaux p’tits gars disparaissaient pour de bon d’une année su’l’aut’et qu’on voyait presque pas d’vieux dans l’pays. Et pis il a trouvé qu’y avait des gens qu’avaient l’air bougrement bizarres même pour des Canaques.
« Ben sûr c’est Obed qu’a trouvé la vérité sur ces païens. J’sais pas comment qu’il a fait, mais y s’est mis à faire du troc pour avoir les choses en or qu’y portaient. Y leur a d’mandé d’où qu’a v’naient et si y pouvaient en avoir d’aut’, et pour finir il a tiré les vers du nez à leur vieux chef – Walakea, ils l’appelaient. Personne d’aut’qu’Obed aurait jamais cru c’vieux démon jaune, mais l’cap’taine, y lisait dans les gens comme dans les livres. Hi, hi ! Personne veut jamais m’croire aujourd’hui quand j’dis tout ça, et vous non plus, j’suppose, jeune homme – pourtant à bien vous r’garder, vous avez des yeux qui savent lire, pareil qu’Obed. »
Le chuchotement du vieillard devint plus faible encore, et je me surpris à frissonner devant la terrible solennité et la sincérité de son ton, tout en sachant que son histoire ne pouvait être qu’un délire d’ivrogne.
« Eh ben, m’sieur, Obed il a appris qu’y avait des choses sur c’te terre que presque personne en a jamais entendu causer – et personne voudrait l’croire si on leur racontait. À c’qui paraît, ces Canaques sacrifiaient des tas d’leurs gars et d’leurs filles à des espèces de dieux qu’habitaient sous la mer, et y r’cevaient en échange des tas d’faveurs. Y rencontraient ces créatures sur la p’tite île aux ruines bizarres, et y paraît que ces images abominab’d’monstres grenouilles-poissons, ça s’rait l’portrait d’ces créatures. P’têt ben qu’c’est d’là qu’viennent les histoires de sirènes et tout c’qui s’ensuit. Y-z-auraient toutes sortes de villes au fond d’la mer, et ct’île s’rait sortie d’là. On dit qu’y avait des créatures vivantes dans les bâtiments d’pierre quand l’île est arrivée d’un seul coup à la surface. C’est comme ça qu’les Canaques y s’sont aperçus qu’a vivaient sous l’eau. Sitôt qu’y sont rev’nus d’leur peur, y leur ont causé par signes, et y-z-ont eu vite fait d’arranger un marché.
« Ces dieux-là y-z-aimaient les sacrifices humains. Y-z-en avaient déjà eu aut’fois, mais avec le temps y-z-avaient perdu l’contact avec le monde d’en haut. C’qu’y faisaient des victimes j’pourrais pas vous l’dire, et j’pense qu’Obed a pas été trop curieux là-d’sus. Mais les païens ça leur était bien égal vu qu’y-z-en voyaient de dures et qu’y-z-étaient prêts à tout. Y donneraient un certain nombre de jeunes gens aux créatures de la mer, deux fois l’an – à May-Eve et Hallowe’en[6], recta. Pis aussi des babioles qu’y faisaient en sculpture. Et les créatures étaient d’accord pour donner en échange des tas d’poissons – qu’a ram’naient d’tout partout en mer – et d’temps en temps des choses qu’avaient l’air en or.
« Ben comme ça, les indigènes rencontraient les créatures sur la p’tite île volcanique – y v’naient en pirogues avec les sacrifices et tout ça, et r’partaient avec les bijoux en espèce d’or qui leur rev’naient. Au début les créatures allaient jamais sur l’île principale, mais au bout d’un moment a-z-ont voulu v’nir. Y paraît qu’a-z-avaient envie d’fréquenter les gens pis d’faire des fêtes ensemble dans les grandes occasions – May-Eve et Hallowe’en. Vous voyez, a vivaient aussi ben dans l’eau qu’en dehors – des amphibies qu’on appelle, j’crois. Les Canaques y leur ont dit qu’les gens des aut’z-îles voudraient les nettoyer si y savaient qu’a v’naient comme ça, mais a-z-ont dit qu’a s’en moquaient pasqu’a pouvaient nettoyer toute la race humaine si on voulait les embêter – toute, sauf ceux qu’avaient certains signes comme s’en servaient aut’fois les Anciens disparus. Mais pour pas faire d’histoires, a s’cacheraient quand quelqu’un viendrait visiter l’île.
« Quand on a parlé d’s’accoupler avec eux, ces poissons-crapauds, les Canaques s’sont un peu r’biffés, mais finalement y-z-ont appris quéque chose qui leur a fait changer d’avis. À c’qu’on dit, les humains sont comme qui dirait parents avec ces animaux marins – tout c’qu’est vivant s’rait v’nu d’la mer aut’fois, et y faudrait qu’un p’tit changement pour y r’tourner. Les créatures a-z-ont dit aux Canaques qu’si y mélangeaient leurs sangs, y naîtraient des enfants qu’auraient d’abord l’air humain, mais plus tard y d’viendraient d’plus en plus pareils à elles, pis à la fin y s’mettraient à l’eau pour aller r’joindre les autres au fond. Et l’important, jeune homme, c’est qu’ceux qui s’raient dev’nus des poissons et iraient dans l’eau y mourraient jamais. Ces créatures elles mouraient jamais sauf si on les tuait.
« Eh ben, m’sieur, quand Obed a connu ces gens des îles, y-z-étaient pleins de sang d’poisson des créatures du fond d’l’eau. Quand y prenaient d’l’âge et qu’ça commençait à s’voir, on les cachait jusqu’à c’qu’y-z-aient envie de s’mettre à l’eau et d’s’en aller. Y en avait qu’étaient plus touchés qu’d’aut’, et certains qui changeaient jamais assez pour aller dans l’eau ; mais ça s’passait presque toujours exactement comme les créatures avaient dit. Ceux qui r’semblaient aux créatures en naissant, y changeaient très tôt, mais ceux qu’étaient plus humains y restaient des fois sur l’île jusqu’à des soixante-dix ans, même si y s’essayaient à plonger au fond en attendant. En général, ceux qui s’mettaient à l’eau y r’venaient souvent en visite, c’qui fait qu’souvent un homme pouvait causer avec son cinq-fois-grand-père, qu’avait quitté la terre ferme au moins deux cents ans plus tôt.
« Y-z-avaient tous oublié la mort – sauf dans les guerres de pirogues avec les aut’gens des îles, les sacrifices aux dieux marins des grands fonds, les morsures de serpent, la peste et quéqu’mal aigu et galopant qui les prenait avant qu’y-z-aient pu s’met’à l’eau – y-z-attendaient seulement un changement qu’était dev’nu pas du tout horrible avec le temps. Y trouvaient qu’y-z-avaient ben assez pour c’qu’y donnaient – et j’crois qu’Obed a pensé pareil quand il a eu r’mâché un peu c’que l’vieux Walakea y avait dit. Walakea, lui, c’était un des rares qu’avaient pas une goutte de sang d’poisson, vu qu’il était d’une famille royale qui s’mariait qu’avec les familles royales des aut’îles.
« Il a appris à Obed plein d’rites et d’incantations qu’avaient rapport avec les créatures marines, et il y a fait voir des gens du village qu’avaient quasiment pus forme humaine. Malgré ça, il y a jamais montré un seul d’ces fameux dieux sortis tout dré d’la mer. À la fin y a donné un truc magique en plomb ou j’sais pas quoi, qui censément faisait monter les créatures poissons d’n’importe quel endroit d’la mer où qu’y pouvait y avoir un nid. Y suffisait d’le laisser tomber dans l’eau en disant la prière qu’y fallait. Walakea disait qu’y en avait partout dans le monde, et n’importe qui en cherchant bien pouvait trouver un nid et les faire monter s’y en avait besoin.
« Matt, il aimait pas tout ça, et y voulait empêcher Obed d’aller sur l’île ; mais l’cap’taine était âpre au gain et y voyait qu’y pouvait avoir ces choses dorées si bon marché qu’ça valait la peine d’s’en faire une spécialité. C’trafic-là a continué pendant des années, et Obed a eu assez de c’t’or pour démarrer son affinerie dans la vieille usine en décadence de Waite. Il a pas osé vend’les choses comme a-z-étaient, pasqu’on aurait posé des tas d’questions. Malgré tout, ses ouvriers en prenaient une de temps en temps pour la vendre, bien qu’y-z-aient juré de garder le secret ; et y laissait les femmes de sa famille porter d’ces bijoux un peu plus humains qu’les aut’.
« Ben, vers 38 – j’avais sept ans – Obed s’est aperçu qu’l’île avait été complètement nettoyée depuis son dernier voyage. À c’qui paraît les aut’indigènes avaient eu vent de c’qui s’passait, et y-z-avaient pris les choses en main. Faut croire qu’y d’vaient avoir ces vieux signes magiques qu’les créatures avaient dit qu’c’étaient les seules choses qu’a craignaient. Sans compter qu’ces Canaques doivent avoir des chances d’en attraper quand l’fond d’la mer vomit une île où qu’y a des ruines plus vieilles que l’déluge. Des gars pieux qu’c’était : y-z-avaient rien laissé d’bout ni su la grande île ni su la p’tite volcanique, sauf les ruines qu’étaient trop grosses pour qu’y les renversent. Dans des endroits y avait des petites pierres éparpillées – comme qui dirait des amulettes – avec quéque chose dessus pareil que c’qu’on appelle un svastika aujourd’hui. Sûr que c’étaient les signes des Anciens. Tous les gens nettoyés, pus trace des choses dorées, et pas un Canaque du pays a soufflé mot de c’t’affaire. Y prétendaient même qu’y avait jamais eu personne sur l’île.
« Naturellement, ç’a été un coup dur pour Obed, vu qu’son commerce normal y n’allait pas très fort. C’était dur aussi pour Innsmouth, vu qu’dans c’temps d’la marine, c’qu’était bon pour l’cap’taine du bateau c’était bon pareil pour l’équipage. La plupart des gens d’la ville y-z-ont pris les temps difficiles résignés comme des moutons, mais ça tournait mal pour eux vu qu’la pêche donnait pus grand-chose et qu’les usines marchaient au ralenti.
« C’est là qu’Obed il a commencé à enguirlander les gens pasqu’y étaient trop bêlants et qu’y priaient un dieu chrétien qui leur donnait rien du tout. Il a dit qu’y connaissait des gens qui priaient des dieux qu’leur envoyaient c’qui leur était vraiment utile, et si y avait une bonne équipe de gars qui voulait s’met’avec lui, y pourrait p’têt s’adresser à certaines puissances pour avoir des tas de poissons et pas mal d’or. Ben sûr que ceux qui servaient sur la Sumatra Queen et qu’avaient vu l’île y savaient c’qu’y voulait dire, et y-z-avaient pas envie d’trafiquer avec ces créatures d’la mer comme y-z-avaient entendu raconter, mais ceux qui savaient pas d’quoi y r’tournait s’sont laissé manœuvrer par c’qu’Obed avait dit, et y lui ont d’mandé c’qui pouvait faire pour les m’ner à c’te r’ligion qui leur s’rait si utile. »
Ici le vieillard hésita, marmonna et tomba dans un silence maussade et craintif, jetant des coups d’œil inquiets par-dessus son épaule, puis se retournant pour attacher un regard fasciné sur le récif noir au loin. Il ne répondit pas quand je lui adressai la parole, et je compris qu’il faudrait lui laisser finir la bouteille. L’histoire insensée que j’entendais m’intéressait vivement car je supposais qu’elle contenait une sorte de grossière allégorie fondée sur l’étrangeté d’Innsmouth et élaborée par une imagination à la fois créatrice et pleine de réminiscences de légendes exotiques. Je ne crus pas un instant que le récit pût avoir aucune base réelle ; mais il n’en inspirait pas moins une véritable horreur, peut-être parce qu’il évoquait d’étranges bijoux manifestement identiques à l’abominable tiare que j’avais vue à Newburyport. Il était possible, après tout, que les parures viennent d’une île lointaine ; et qui sait si ces contes extravagants n’étaient pas des mensonges de feu Obed lui-même plutôt que ceux du vieil ivrogne.
Je tendis la bouteille à Zadok et il la vida jusqu’à la dernière goutte. C’était étonnant de le voir avaler tant de whisky, sans le moindre embarras dans sa voix haute et poussive. Il lécha le goulot de la bouteille qu’il glissa dans sa poche, puis se mit à dodeliner de la tête en murmurant doucement pour lui-même. Je me penchai pour essayer de saisir ses paroles, et je crus voir un sourire sardonique derrière sa moustache touffue et jaunie. Oui, il prononçait réellement des mots, et je réussis à en comprendre une bonne partie.
« Pauv Matt – Matt il avait toujours été cont’tout ça – il essayait d’met’les gens d’son côté, et y passait du temps à causer avec les pasteurs – rien à faire : l’pasteur congrégationaliste y l’ont chassé d’la ville, et l’méthodiste il est parti, on n’a jamais r’vu Resolved Babcock, le baptiste – l’Courroux d’Jéhovah – j’étais bougrement p’tiot, mais j’sais ben c’que j’ai vu et entendu – Dagon et Astaroth – Bélial et Belzébuth – l’Veau d’or et les idoles de Canaan et des Philistins – les abominations d’Babylone – Mane, thecel, pharès… »
Il s’interrompit à nouveau, et au regard bleu de ses yeux larmoyants je craignis qu’il ne fût bien près de l’hébétude. Mais comme je lui tapais doucement sur l’épaule, il se tourna vers moi avec une vivacité extraordinaire et lança quelques phrases plus sombres.
« Vous m’croyez pas, hein ? Hi, hi, hi ! – alors dites-moi donc, jeune homme, pourquoi l’cap’taine Obed et une vingtaine de drôles de gens allaient en canot jusqu’au Récif du Diable en plein milieu d’la nuit en chantant si fort qu’on les entendait dans toute la ville quand l’vent était dans l’bon sens ? Dites-moi ça un peu, hein ? Et dites-moi pourquoi Obed y j’tait toujours des choses lourdes dans l’eau profonde d’l’aut’côté du récif, là où ça descend à pic pareil qu’une falaise, si bas qu’on peut pas sonder l’fond ? Dites-moi c’qu’y faisait avec ces drôles de trucs magiques en plomb qu’Walakea y avait donnés ? Hein, mon gars ? Et quoi qu’y braillaient tous à May-Eve et pareil le Hallowe’en suivant ? Et pourquoi qu’les nouveaux pasteurs – des individus qu’étaient plutôt marins – portaient des robes pas ordinaires et mettaient sur eux d’ces choses dorées qu’Obed avait rapportées ? Hein ? »
Les yeux bleus mouillés étaient devenus féroces et fous, la barbe blanche souillée se hérissait, comme électrisée. Le vieux Zadok perçut sans doute mon mouvement de recul, car il se mit à glousser méchamment.
« Hi, hi, hi, hi ! Commencez à comprend’, hein ? P’têt’ben qu’ça vous aurait plu d’êt’à ma place à c’t’époque-là, quand j’voyais tout ça la nuit su’la mer, du belvédère qu’était en haut d’ma maison. Ah, j’peux vous l’dire, les p’tites marmites ont d’grandes oreilles, et j’perdais rien de c’qu’on racontait su’l’cap’taine Obed et ceux qu’allaient au récif ! Hi, hi, hi ! Aussi la nuit j’ai emporté au belvédère la lunette marine de mon p’pa et j’ai vu l’récif tout grouillant d’formes qu’ont vite plongé sitôt qu’la lune s’est l’vée. Obed et les aut’étaient dans un doris, mais ces formes a-z-ont plongé d’l’aut’côté dans l’eau profonde et a sont jamais r’montées… Ça vous aurait-y plu d’êt’un p’tit môme tout seul en haut d’un belvédère en train de r’garder ces formes qu’étaient pas des formes humaines ?… Hein ?… Hi, hi, hi, hi… »
Le vieillard devenait hystérique, et je me mis à frémir, pris d’une inquiétude indéfinissable. Il posa sur mon épaule une griffe noueuse, et il me sembla que son tremblement ne venait pas que de l’hilarité.
« Supposez qu’une nuit vous auriez vu quéque chose de lourd j’té du doris d’Obed d’l’aut’côté du récif, et qu’vous auriez appris, le lendemain, qu’un jeune gars avait disparu d’chez lui ? Hein ? Qui qu’a jamais r’vu Hiram Gilman ? Pas vrai ? Et Nick Pierce, et Luelly Waite, et Adoniram Saouthwick, et Henry Garrison ? Hein ? Hi, hi, hi, hi… Des formes qui causaient par signes avec leurs mains… ceux qu’avaient des vraies mains…
« En ben, m’sieur, c’est là qu’Obed a commencé à r’tomber sur ses pieds. On a vu ses trois filles porter ces choses en espèce d’or qu’personne leur avait vues avant, et la ch’minée d’l’usine s’est r’mise à fumer. Y en a eu d’aut’aussi qu’avaient l’air de prospérer – l’poisson s’est mis à grouiller dans l’port, y avait pus qu’à l’prend’, et Dieu sait les cargaisons qu’on a expédiées à Newb’ryport, Arkham et Boston. C’est à c’moment-là qu’Obed a fait installer l’vieux branchement du ch’min d’fer. Y a des pêcheurs de Kingsport qu’ont entendu causer d’ces prises et y sont v’nus en sloop, mais y-z-ont été perdus corps et biens. Personne les a jamais r’vus. Et juste au même moment nos gens y-z-ont organisé l’Ordre ésotérique de Dagon, et y-z-ont acheté pour ça la salle maçonnique d’la Commanderie du Calvaire… Hi, hi, hi ! Matt Eliot qu’était maçon a essayé d’empêcher la vente, mais il a disparu à c’moment-là.
« R’marquez, j’dis pas qu’Obed voulait qu’tout soit pareil que sur c’t’île canaque. J’crois pas qu’au début y voulait qu’y ait tout c’mélange pour avoir des jeunots qu’iraient à l’eau et d’viendraient poissons pour la vie éternelle. C’qu’y voulait c’étaient ces trucs en or, même si fallait les payer gros, et pendant quéque temps eux aut’y-z-ont pas d’mandé plus…
« Mais v’là qu’en 46 la ville a commencé à y r’garder et à réfléchir d’son côté. Trop d’gens disparus, trop d’sermons d’énergumènes aux assemblées du dimanche, trop d’racontars du fameux récif. J’crois qu’j’y ai été pour quéque chose en racontant à Selectman Mowry c’que j’avais vu du belvédère. Une nuit y-z-ont été tout un groupe à suivre la troupe d’Obed jusqu’au récif, et j’ai entendu des coups d’feu entre les doris. L’lendemain Obed et vingt-deux aut’y-z-étaient en prison, et tout l’monde s’demandait c’qui s’passait au juste et d’quoi on pourrait ben les accuser. Seigneur, si quéqu’un avait pu prévoir… deux s’maines plus tard, quand on avait rien j’té à la mer tout c’temps-là… »
Zadok donnant des signes de frayeur et de lassitude, je le laissai se taire pendant un moment, tout en regardant ma montre avec inquiétude. C’était la marée montante à présent et le bruit des vagues sembla le réveiller. J’étais heureux de ce reflux car avec les hautes eaux l’odeur de poisson serait sans doute moins forte. Je dressai l’oreille à nouveau pour saisir ses chuchotements.
« C’te nuit épouvantab’… j’les ai vus… j’étais en haut dans l’belvédère… y-z-étaient des foules… des essaims… tout partout su’l’récif et y sont r’montés à la nage dans l’port jusque dans l’Manuxet… Seigneur, c’qu’a pu arriver dans les rues d’Innsmouth c’te nuit-là… Y-z-ont s’coué not’porte, mais p’pa a pas voulu ouvrir… Pis y est sorti par la f’nêtre de la cuisine avec son mousquet pour chercher Selectman Mowry et voir c’qu’y pouvait faire… Des tas d’morts et d’mourants… des coups d’feu et des cris… On hurlait sur la vieille place et la grand-place et New Church Green… les portes d’la prison enfoncées… proclamation… trahison… On a dit qu’y avait eu la peste quand les gens sont v’nus et y-z-ont vu qu’y manquait la moitié des habitants… Y restait qu’ceux qu’étaient avec Obed et les créatures ou alors ceux qui s’tenaient tranquilles… jamais pus entendu causer d’mon p’pa… »
Le vieux haletait et suait à grosses gouttes. Son étreinte se resserra sur mon épaule.
« Tout était nettoyé dans la matinée – mais y avait des traces… Obed alors y prend comme qui dirait l’command’ment et y dit qu’ça va changer… Eux aut’y s’ront avec nous aux assemblées, et certaines maisons r’cevront des hôtes… Eux y voulaient qu’on s’mélange comme y-z-avaient fait avec les Canaques, et lui d’abord y s’croyait pas obligé d’les arrêter. Il était allé trop loin, Obed… il l’tait comme un fou pour ça. Y disait qu’y nous apportaient poisson et trésor, et qu’y-z-auraient tout c’qui leur f’rait envie…
« Y aurait rien changé en dehors, seulement y fallait pas broncher avec les étrangers si on comprenait notre intérêt. On a tous été obligés de faire le serment de Dagon, et après il y a eu un deuxième et un troisième serment, et quéques-uns chez nous les ont faits. Ceux qui rendraient des services spéciaux y-z-auraient des récompenses spéciales – d’l’or et des choses comme ça. Pas moyen de r’gimber vu qu’y en avait des millions au fond d’l’eau. Y-z-auraient pas comme ça nettoyé toute l’humanité, mais si y-z-étaient trahis et poussés à bout, y pouvaient faire du dégât. Nous on n’avait pas les vieilles magies pour les faire filer comme les gens de la mer du Sud y faisaient, et les Canaques avaient jamais voulu donner leurs secrets.
« Qu’on leur donne assez d’sacrifices, des babioles de sauvages et qu’on les r’çoive dans la ville quand y voudraient, et y s’tiendraient ben tranquilles. Y f’raient pas d’mal aux étrangers pasqu’y pourraient raconter des histoires à l’extérieur – à moins qu’y les espionnent. Tous ceux d’la troupe des fidèles – d’l’Ordre à Dagon – et les enfants, y mourraient jamais, mais y r’tourn’raient à not’mère Hydra et not’père Dagon d’où qu’on était tous venus aut’fois – lä ! lä ! Cthulhu fhtagn ! Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lhel wgah-nagl fhtagn – »
Le vieux Zadok tombait vite dans le délire et je retins mon souffle. Pauvre vieux, à quels pitoyables abîmes hallucinatoires avait été poussé ce cerveau fécond et imaginatif par son alcool, sa haine de la dégradation, de l’inconnu et de la maladie qui l’entouraient ! Il se mit à gémir, et les larmes coulèrent le long de ses joues ravinées jusque dans les profondeurs de sa barbe.
« Seigneur, c’que j’ai pu voir d’puis mes quinze ans – Mane, mane, thecel, pharès ! – les gens qui disparaissaient, et ceux qui s’tuaient – ceux qui racontaient des choses à Arkham, à Ipswich ou ailleurs, on les traitait d’fous, pareil qu’vous m’traitez d’fou en c’moment – mais Seigneur, c’que j’ai vu ! Y m’auraient tué d’puis longtemps rapport à c’que j’sais, mais j’ai fait l’premier et l’second serment à Dagon avec Obed, aussi j’étais protégé sauf si un jury d’fidèles avait prouvé que j’racontais des choses exprès et en toute connaissance… mais j’aurais pas fait l’troisième – j’s’rais putôt mort que d’faire ça…
« C’est d’venu pire vers le temps d’la guerre civile, quand les enfants nés d’puis 46 ont commencé à grandir – certains, du moins. J’étais trop effrayé – jamais j’ai rien r’gardé depuis ct’horrible nuit, et eux, j’en ai jamais vu d’près de toute ma vie. J’veux dire pas un pur sang. J’suis parti pour la guerre, et si j’avais eu un peu d’cran ou d’jugeote je s’rais jamais rev’nu, mais j’me s’rais établi loin d’ici. Mais les gens m’ont écrit qu’ça allait pas trop mal. J’pense que c’était à cause des troupes du gouvernement qu’étaient dans la ville d’puis 63. Après la guerre ç’a été ben aussi mal qu’avant. Les gens ont commencé à pus rien faire – les usines et les boutiques s’sont fermées – on a pus navigué et l’port s’est ensablé – l’chemin d’fer abandonné – mais eux… y-z-ont pas arrêté d’nager dans la rivière et ailleurs en v’nant de c’maudit récif d’Satan et on a condamné d’plus en plus d’fenêt’d’mansardes, et on a entendu d’plus en plus d’bruits dans les maisons où qu’on pensait qu’y avait personne…
« Les gens d’dehors y racontaient des histoires sur nous – z’avez dû en entendre pas mal, vu les questions qu’vous posez – des histoires sur c’qu’y-z-auraient vu par hasard, et ces drôles de bijoux qui viennent toujours d’on sait pas où et qu’sont pas tous fondus – mais y disent jamais rien d’sûr. Personne croit rien de rien. Y racontent qu’les choses dorées c’est du butin d’pirates, et qu’les gens d’Innsmouth ont du sang étranger ou la maladie ou j’sais pas quoi. Et pis ceux qui vivent ici y mettent à la porte autant d’étrangers qu’y peuvent, et y poussent l’restant à pas s’montrer trop curieux, surtout quand la nuit vient. Les bêtes reculent d’vant les créatures – les ch’vaux pire qu’les mules – mais d’puis qu’y a des autos tout va bien.
« En 46 l’cap’taine Obed il a pris une seconde femme qu’personne en ville a jamais vue – y en a qui disent qu’y voulait pas, mais qu’y a été forcé par ceux-là qu’il avait appelés – il a eu trois enfants avec elle – deux qu’ont disparu tout jeunes, pis une fille qu’avait l’air comme tout l’monde et qu’a été éduquée en Europe. Obed a réussi à la marier par ruse à un gars d’Arkham qui s’est douté de rien. Mais maintenant personne du dehors a pus jamais affaire avec les gens d’Innsmouth. Barnabas Marsh qui dirige l’affinerie à présent – c’est l’petit-fils d’Obed et d’sa première femme – l’fils d’Onesiphorus, son aîné, mais sa mère c’en est encore une qu’on a jamais vue dehors.
« À c’t’heure Barnabas a ben changé. Y peut pus fermer les yeux, et l’est tout déformé. On dit qu’y met encore des habits, mais qu’y va bentôt s’met’à l’eau. P’têt’qu’il a déjà essayé – des fois y descendent par l’fond pour des p’tites magies avant d’y aller pour de bon. On l’a pas vu en public d’puis pas loin d’dix ans. J’me d’mande comment qu’sa pauv’femme a prend ça – elle est d’Ipswich, et les gens y-z-ont failli lyncher Barnabas quand y v’nait y faire sa cour v’là ben cinquante ans d’ça. Obed il est mort en 78, et tous ceux d’la génération d’après y sont partis maintenant – morts les enfants d’la première femme, et l’reste… Dieu sait… »
Le bruit de la marée montante était devenu très présent, et petit à petit il semblait changer l’humeur larmoyante du vieil homme en une crainte vigilante. Il s’arrêtait parfois pour jeter des regards inquiets par-dessus son épaule ou vers le récif, et malgré l’extravagante absurdité de son histoire, je commençai sans pouvoir m’en empêcher à partager sa vague appréhension. Sa voix se fit suraiguë, comme s’il tentait de se donner du courage en haussant le ton.
« Hé, vous, pourquoi qu’vous disez rien ? Ça vous plairait-y d’viv’dans c’te ville où tout est pourri et mourant, avec des monstres enfermés, qui rampent et bêlent, aboient et sautent dans l’noir des caves et des greniers n’importe où qu’vous allez ? Hein ? Ça vous plairait-y d’entend’hurler nuit après nuit dans les églises et la salle de l’Ordre à Dagon, et savoir c’qui s’mélange dans ces hurlements ? Ça vous plairait d’entend’c’qui vient de c’t’affreux récif chaque May-Eve et Hallowmass ? Hein ? L’vieux est fou, pas vrai ? Eh ben, m’sieur, croyez-moi, c’est pas l’pire ! »
Zadok criait vraiment à présent, et la frénésie démente de sa voix me troublait plus que je ne saurais dire.
« L’diab’vous emporte, me r’gardez pas avec ces yeux-là – j’vous dis qu’Obed Marsh est en enfer, et y va y rester ! Hi, hi… en enfer j’vous dis ! Peut pas m’attraper – j’ai rien fait ni rien raconté à personne…
« Oh vous, jeune homme ? Ben, même si j’ai encore rien raconté à personne, j’vais l’faire maintenant ! Bougez pas et écoutez-moi, mon garçon – voilà c’que j’ai jamais raconté à personne… J’ai dit qu’j’avais pus espionné après c’te nuit – mais j’ai trouvé des choses tout de même !
« Vous voulez savoir c’que c’est qu’la véritab’abomination, hein ? Eh ben, voilà – c’est pas c’qu’y-z-ont fait ces diab’de poissons, mais c’est c’qu’y vont faire ! Y-z-apportent des choses d’là d’où y viennent pour met’dans la ville – y font ça d’puis des années, et y ralentissent ces derniers temps. Les maisons au nord d’la rivière entre Water Street et Main Street a-z-en sont pleines – de ces démons et de c’qu’y-z-ont apporté – et quand y s’ront prêts… J’vous dis, quand y s’ront prêts… Z’avez entendu parler d’un shoggoth ?
« Hé, vous m’entendez ? J’vous dis, j’connais ces choses-là – j’les ai vues une nuit quand… EH-AHHHH-AH ! E’YAAHHHH… »
Le cri du vieillard fut d’une soudaineté si atroce et d’une horreur tellement inhumaine que je faillis m’évanouir. Ses yeux, fixés au-delà de moi sur la mer malodorante, lui sortaient positivement de la tête et son visage était un masque d’épouvante digne de la tragédie grecque. Sa griffe osseuse s’enfonça effroyablement dans mon épaule, et il ne fit pas un mouvement quand je tournai la tête pour chercher du regard ce qu’il avait pu apercevoir.
Il n’y avait pour moi rien de visible. Rien que la marée montante, et peut-être une série d’ondulations plus localisées que la longue ligne déferlante des brisants. Mais à présent Zadok me secouait, et je me retournai pour voir ce visage pétrifié par la peur se fondre en un chaos de paupières clignotantes et de mâchoire marmonnante. Presque aussitôt la voix lui revint – encore que ce ne fût qu’un murmure frémissant.
« Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Y nous ont vus – sauvez vot’vie ! Faut pus attend’– y savent maintenant. Sauvez-vous – vite – loin de c’te ville… »
Une autre lourde vague s’écrasa sur la maçonnerie croulante du quai d’autrefois, et changea le chuchotement du vieux fou en un nouveau cri inhumain à vous glacer le sang.
« E-YAAHHHH !… YHAAAAAA !… »
Avant que j’aie pu rassembler mes esprits, il avait relâché son étreinte sur mon épaule pour se précipiter éperdument vers la rue, chancelant en direction du nord, de l’autre côté du mur en ruine de l’entrepôt.
Je jetai un coup d’œil sur la mer, mais il n’y avait rien. Et quand, revenu dans Water Street, je suivis la rue du regard vers le nord, il n’y restait pas trace de Zadok Allen.
4
Je ne saurais décrire l’état d’esprit dans lequel me laissa cet épisode atroce – à la fois fou et navrant, grotesque et terrifiant. Le garçon épicier m’y avait préparé, mais la réalité ne m’en avait pas moins jeté dans le trouble et la confusion. Malgré la puérilité de l’histoire, le sérieux et l’horreur insensés du vieux Zadok m’avaient communiqué une inquiétude grandissante qui s’ajoutait à ma répulsion première pour la ville et l’ombre de son insaisissable fléau.
Plus tard je pourrais analyser le récit et en tirer les éléments de base d’une allégorie historique ; pour l’instant je ne demandais qu’à l’oublier. Il était dangereusement tard – ma montre indiquait 7 h 15, et l’autobus pour Arkham quittait Town Square à huit heures – et je m’efforçai de ramener mes pensées à un souci aussi neutre et pratique que possible, tout en parcourant vivement les rues désertes de toits béants et de maisons chancelantes, pour rejoindre l’hôtel où j’avais laissé ma valise et où je trouverais mon bus.
Malgré la lumière dorée de fin d’après-midi qui donnait aux vieux toits et aux cheminées délabrées un air de paix et un charme mystérieux, je ne pouvais m’empêcher de jeter parfois un coup d’œil par-dessus mon épaule. Je serais vraiment ravi de quitter cette Innsmouth malodorante où régnait la terreur, et j’aurais bien voulu qu’il existe quelque autre véhicule que celui du sinistre Sargent. Pourtant je n’accélérai pas trop l’allure car il se trouvait à tous ces coins de rue silencieux des détails architecturaux dignes d’attention ; et je pouvais aisément, d’après mes calculs, faire le trajet en une demi-heure.
En étudiant la carte du jeune homme de l’épicerie à la recherche d’un itinéraire que je n’aurais pas encore suivi, je choisis Marsh Street au lieu de State Street pour gagner la grand-place. Au coin de Fall Street je commençai à voir çà et là des groupes de chuchoteurs furtifs, et en arrivant enfin sur la place je constatai que presque tous les flâneurs étaient rassemblés devant la porte de la Maison Gilman. J’eus l’impression que beaucoup d’yeux saillants, humides, immobiles me regardaient curieusement quand je demandai ma valise dans le hall, et j’espérai qu’aucun de ces êtres déplaisants ne partagerait la voiture avec moi.
L’autobus, plutôt en avance, arriva à grand bruit avec trois passagers un peu avant huit heures, et un individu à la mine patibulaire adressa sur le trottoir quelques mots inintelligibles au conducteur. Sargent jeta dehors un sac postal et un paquet de journaux, puis entra dans l’hôtel, tandis que les voyageurs – les mêmes que j’avais vus arriver à Newburyport ce matin-là – gagnaient le trottoir d’un pas traînant et échangeaient quelques vagues paroles gutturales avec un badaud dans une langue dont j’aurais juré que ce n’était pas de l’anglais. Je montai dans la voiture vide et pris la même place que j’avais occupée précédemment, mais à peine étais-je installé que Sargent reparut et se mit à marmonner d’une voix de gorge particulièrement répugnante.
Apparemment, je n’avais vraiment pas de chance. Quelque chose s’était détraqué dans le moteur, bien qu’il ait très bien marché depuis Newburyport, et l’autobus ne pourrait pas continuer jusqu’à Arkham. Non, on ne pouvait pas le réparer cette nuit, et il n’y avait pas d’autre moyen de transport à partir d’Innsmouth, pour Arkham ni ailleurs. Sargent était désolé mais je serais obligé de coucher au Gilman. On me ferait certainement un prix à la réception, mais il n’y avait pas d’autre solution. Quasi stupéfait de cet obstacle imprévu, et redoutant vivement la tombée de la nuit dans cette ville pourrissante à peine éclairée, je quittai l’autobus et rentrai dans le hall de l’hôtel où le gardien de nuit à l’air maussade et louche me proposa la chambre 428 à l’avant-dernier étage – grande mais sans eau courante – pour un dollar.
Malgré ce que j’avais entendu dire de cet hôtel à Newburyport, je signai le registre, donnai mon dollar, laissai l’employé prendre ma valise et suivis ce serviteur revêche et solitaire pour monter trois étages de marches grinçantes, en dépassant des couloirs poussiéreux qui semblaient entièrement déserts. Ma chambre, une pièce sombre à l’arrière de l’hôtel, avec deux fenêtres et maigrement pourvue de meubles bon marché, donnait sur une cour lugubre cernée encore par des bâtiments de brique, bas et apparemment abandonnés, et dominait un panorama de toits vétustes qui s’étendaient vers l’ouest en deçà d’une campagne marécageuse. Au bout du couloir se trouvait une salle de bains, décourageante relique avec son antique cuvette de marbre, un tub en fer-blanc, une ampoule électrique très faible, et des boiseries moisies autour des tuyauteries.
Comme il faisait encore jour, je descendis sur la place pour tâcher de trouver à dîner et je remarquai alors les coups d’œil bizarres que me jetaient les flâneurs douteux. L’épicerie étant fermée, je dus me rabattre sur le restaurant que j’avais d’abord évité ; il était tenu par un homme voûté à la tête étroite, aux yeux immobiles et sans expression, et une fille au nez plat et aux mains incroyablement épaisses et maladroites. On ne servait qu’au comptoir, et je fus soulagé en m’apercevant que presque tout venait manifestement de boîtes de conserve et de sachets. Je me contentai d’un bol de soupe aux légumes avec des crackers, et regagnai bientôt ma triste chambre au Gilman, où je pris un journal du soir et un magazine criblé de chiures de mouches auprès de l’employé revêche qui tenait un étalage branlant à côté de son bureau.
Quand le crépuscule s’assombrit, j’allumai la faible ampoule électrique au-dessus du modeste lit de fer, pour essayer autant que possible de continuer la lecture que j’avais commencée. Je jugeais opportun d’occuper sainement mon esprit plutôt que de le laisser ressasser les monstruosités de cette vieille ville en proie à la dégradation, tant que j’étais encore dans ses murs. L’histoire folle que m’avait racontée le vieil ivrogne ne me promettait pas de rêves très agréables, et je sentais qu’il me fallait écarter le plus possible de mon imagination le souvenir de ses yeux larmoyants et hagards.
Je ne devais pas non plus m’appesantir sur ce que l’inspecteur du travail avait dit à l’employé de la gare de Newburyport au sujet de l’hôtel Gilman et des voix de ses occupants nocturnes – ni là-dessus ni sur le visage sous la tiare dans l’entrée obscure de l’église ; ce visage dont ma pensée consciente ne pouvait expliquer l’horreur. Peut-être aurait-il été plus facile de détourner mes réflexions de ces sujets troublants si la chambre n’avait pas autant empesté le moisi. Cette odeur atroce, hideusement mêlée à celle du poisson qui régnait dans la ville, ramenait sans cesse l’imagination à la décomposition et à la mort.
Ce qui m’inquiétait aussi c’était l’absence de verrou à la porte de ma chambre. Il y en avait eu un, comme le prouvaient clairement les traces, mais on l’avait enlevé récemment. Sans doute était-il devenu inutilisable, comme tant d’autres choses dans ce bâtiment délabré. Dans ma nervosité, je me mis à chercher et je découvris sur la penderie un verrou visiblement de la même taille, à en juger par les traces, que celui de la porte. Pour détendre un peu l’atmosphère lourde, je m’occupai de le fixer sur l’emplacement vide à l’aide d’un petit nécessaire de trois pièces, dont un tournevis, que je portais sur mon trousseau de clés. Il s’adaptait parfaitement et je fus assez soulagé de savoir que je pourrais le fermer avant de me coucher. Je ne croyais pas en avoir réellement besoin, mais le moindre symbole de sécurité était le bienvenu dans un pareil endroit. Il y avait aussi des verrous aux portes de communication des deux chambres voisines, et je les poussai aussitôt.
Je ne me déshabillai pas, décidé à lire jusqu’au moment de m’endormir. Je m’allongerais alors après avoir ôté seulement mon veston, mon faux col et mes chaussures. Tirant une lampe électrique de ma valise, je la mis dans ma poche pour pouvoir consulter ma montre si je m’éveillais plus tard dans la nuit. Cependant, le sommeil ne vint pas ; et quand j’analysai mes pensées je m’aperçus non sans inquiétude que je prêtais l’oreille inconsciemment à quelque chose que je redoutais sans pouvoir le définir. L’histoire de l’inspecteur avait marqué mon imagination plus profondément que je ne le croyais. J’essayai à nouveau de lire, mais je dus reconnaître que je n’avançais pas.
Au bout d’un certain temps, je crus entendre craquer l’escalier et les couloirs comme sous des pas, et je supposai que les autres chambres commençaient à se remplir. Pourtant, il n’y avait pas de bruits de voix, et je fus frappé du caractère furtif de ces craquements. Cela me déplut, et je me demandai si je ne ferais pas mieux de ne pas dormir du tout. Cette ville abritait des gens bizarres, et l’on avait incontestablement noté plusieurs disparitions. Était-ce là une de ces auberges où l’on tuait les voyageurs pour voler leur argent ? Je n’avais sûrement pas l’air très fortuné. Ou bien les habitants avaient-ils tant de haine pour les visiteurs curieux ? Mon intérêt évident de touriste, la fréquente consultation de la carte avaient-ils fait mauvaise impression ? Dans quel état nerveux étais-je donc pour échafauder ainsi des hypothèses sur quelques craquements fortuits ? Mais je n’en regrettais pas moins d’être sans arme.
Finalement, éprouvant une fatigue qui n’annonçait pas le sommeil, je tirai le verrou réinstallé sur la porte du couloir, éteignis la lumière, et me jetai sur le lit dur et défoncé – gardant veston, col, chaussures et tout. Dans le noir le moindre bruit nocturne prenait de l’importance, et un flot de pensées doublement désagréables m’envahit. Je regrettais d’avoir éteint la lumière, mais j’étais trop las pour me lever et aller la rallumer. Alors, après un long et lugubre intervalle, et le prélude de nouveaux craquements dans l’escalier et le couloir, vint ce bruit léger, terriblement reconnaissable, qui semblait la funeste justification de toutes mes frayeurs. À n’en pas douter, on essayait une clé – prudemment, furtivement, non sans hésitation – dans la serrure de ma porte.
Mes sensations, en identifiant ce signe d’un danger réel, furent peut-être moins violentes à cause des craintes vagues qui les avaient précédées. Bien que sans motif précis, je m’étais instinctivement tenu sur mes gardes – ce qui allait m’aider dans la nouvelle épreuve véritable, quelle qu’elle puisse être. Néanmoins ce progrès de la menace, d’abord vague prémonition puis réalité concrète, m’impressionna profondément, et je le ressentis comme un choc violent. Il ne me vint pas à l’idée que ce tâtonnement pouvait être une simple erreur. N’envisageant qu’une intention malveillante, je gardai un silence de mort, en attendant ce qu’allait faire l’intrus supposé.
Un moment plus tard, le cliquetis furtif cessa, et j’entendis qu’on pénétrait avec un passe-partout dans la chambre au nord de la mienne. Puis on essaya doucement la serrure de la porte qui donnait dans ma chambre. Le verrou résista, naturellement, et le plancher grinça quand le rôdeur quitta la pièce. Au bout d’un instant, un autre bruit discret m’apprit qu’on entrait dans la chambre au sud de la mienne. Puis nouveau tâtonnement sur le verrou de la porte de communication, et nouveau grincement d’un pas qui bat en retraite. Cette fois il s’éloigna dans le couloir, descendit l’escalier, et je compris que le rôdeur ayant constaté le verrouillage de mes portes renonçait à sa tentative pour un temps plus ou moins long, comme on le verrait plus tard.
La promptitude avec laquelle j’établis un plan d’action prouve que j’avais dû inconsciemment craindre quelque menace et envisager depuis des heures les divers moyens d’y échapper. Dès l’abord je sentis que le tâtonneur invisible représentait un danger qu’il ne fallait ni affronter ni discuter, mais fuir le plus rapidement possible. La seule chose à faire était de quitter cet hôtel vivant, en toute hâte, et par une autre issue que l’escalier et le hall d’entrée.
M’étant levé sans bruit et dirigeant la lumière de ma lampe sur l’interrupteur, j’essayai d’allumer l’ampoule au-dessus du lit pour choisir quelques affaires à mettre dans mes poches avant de fuir sans valise. Mais rien ne se passa ; on avait donc coupé le courant. De toute évidence, un mouvement malfaisant et secret se préparait sur une grande échelle – lequel, au juste, je n’aurais su le dire. Tandis que je réfléchissais, la main sur l’interrupteur inutile, je perçus un craquement étouffé à l’étage au-dessous, et crus distinguer le bruit d’une conversation. Un instant plus tard j’étais moins sûr que ces sons graves fussent des voix, car ces aboiements rauques et ces coassements à peine articulés ressemblaient bien peu à un langage humain connu. Je songeai alors plus que jamais à ce que l’inspecteur du travail avait entendu la nuit dans cette maison moisie et pestilentielle.
Après avoir rempli mes poches à la lumière de ma lampe, je mis mon chapeau et me dirigeai sur la pointe des pieds vers les fenêtres pour examiner les moyens de descendre. En dépit des règlements en vigueur, il n’y avait pas d’échelle d’incendie de ce côté de l’hôtel, et je découvris que mes fenêtres ne donnaient que sur un à-pic de trois étages jusqu’à la cour pavée. À droite et à gauche cependant d’anciens bâtiments industriels en brique étaient contigus à l’hôtel ; leurs toits en pente montaient à une distance raisonnable qui permettait d’y sauter de mon quatrième étage. Pour atteindre l’un ou l’autre, il me faudrait être dans une chambre à deux portes de la mienne – soit au nord, soit au sud selon le cas – et je me mis aussitôt à calculer les chances que j’avais d’effectuer ce transfert.
Je ne pouvais me risquer à sortir dans le couloir ; on y entendrait sûrement le bruit de mes pas, et les difficultés pour entrer dans la chambre voulue seraient insurmontables. Je devrais passer, pour réaliser mon projet, par les portes de communication, de construction plus légère ; il faudrait en forcer les serrures et les verrous en me servant de mon épaule comme d’un bélier chaque fois qu’ils seraient fermés de l’intérieur. Ce qui me paraissait possible étant donné l’état de délabrement de l’hôtel et de ses installations ; mais je ne pourrais le faire sans bruit. Je devais compter uniquement sur ma rapidité, et sur la chance d’atteindre une fenêtre avant que les forces hostiles n’aient le temps de s’organiser pour ouvrir la bonne porte avec un passe-partout. Je barricadai ma porte sur le couloir avec la commode – que je poussai petit à petit pour faire le minimum de bruit.
Je me rendais bien compte que mes chances étaient très minces, et j’étais prêt à un désastre. Même si j’atteignais un toit voisin, le problème ne serait pas résolu, car il resterait à gagner le sol et à m’échapper de la ville. Le seul élément favorable était l’état d’abandon et de ruine des bâtiments contigus, et les nombreuses lucarnes obscures ouvertes sur chacun.
Ayant constaté sur le plan du garçon épicier qu’il valait mieux sortir de la ville par le sud, j’examinai d’abord la porte au sud de la chambre. Elle s’ouvrait dans ma direction, et je vis – après avoir tiré le verrou et trouvé en place d’autres fermetures – qu’elle serait trop difficile à forcer. Je renonçai donc à cette issue et poussai le lit tout contre pour prévenir toute attaque éventuelle venant de la chambre voisine. La porte nord s’ouvrait vers l’extérieur, et – bien que je l’aie trouvée fermée à clé ou au verrou de l’autre côté – c’était par elle que je devais passer. Si j’arrivais à sauter sur les toits des bâtiments de Paine Street et à descendre à terre sans encombre, je pourrais peut-être filer par la cour et les maisons voisines ou celles d’en face jusqu’à Washington ou Bates Street – à moins de sortir dans Paine Street et de tourner vers le sud pour retrouver Washington Street. De toute façon, mon but était de gagner Washington Street et de m’éloigner le plus vite possible des parages de la grand-place. J’aurais préféré éviter Paine Street, à cause de la caserne des pompiers qui restait peut-être ouverte toute la nuit.
En pensant à tout cela, je regardais au-dessous de moi la misérable mer de toits pourrissants, éclairés maintenant par les rayons d’une lune encore presque pleine. À droite la noire entaille de la gorge où coulait la rivière divisait le paysage ; les usines et la gare abandonnée s’y accrochaient de part et d’autre comme des bernacles. Au-delà, les rails rouillés et la route de Rowley traversaient une étendue marécageuse semée d’îlots de terrain plus haut et sec couvert de broussailles. À gauche, dans la campagne plus proche parcourue de cours d’eau, l’étroite route d’Ipswich luisait, blanche sous la lune. De ce côté de l’hôtel je ne pouvais pas voir la route du sud en direction d’Arkham que j’avais décidé de prendre.
Je me demandai, hésitant, si je devais attaquer la porte du sud, et comment le faire sans être entendu, lorsque je remarquai que les vagues bruits d’en dessous avaient fait place à de nouveaux grincements de marches plus marqués. Une lueur vacillante apparut à travers mon imposte, et le plancher du couloir gémit sous un pas pesant. Des sons étouffés, peut-être des voix, se rapprochèrent, et enfin on frappa vigoureusement à ma porte.
D’abord je retins seulement mon souffle et j’attendis. J’eus l’impression qu’il s’écoulait des éternités, et l’écœurante odeur de poisson des alentours s’aggrava soudain de façon alarmante. Puis on frappa de nouveau – sans arrêt et avec une insistance grandissante. Comprenant qu’il était temps d’agir, je tirai le verrou de la porte nord, rassemblant mes forces pour l’enfoncer. À l’extérieur les coups redoublaient, et j’espérai qu’ils couvriraient le bruit de mes efforts. Passant enfin à l’attaque, je me jetai à plusieurs reprises sur le mince panneau, l’épaule gauche en avant, sans souci des chocs ou de la douleur. La porte résista plus que je ne m’y attendais, mais je ne renonçai pas. Et cependant le tumulte au-dehors ne faisait que croître.
La porte de communication finit par céder, mais avec un tel fracas que dans le couloir on dut l’entendre. Immédiatement les coups devinrent un martèlement violent, tandis que des bruits de clés inquiétants résonnaient aux portes des chambres voisines. Me ruant dans celle que je venais d’ouvrir, je réussis à verrouiller la porte du couloir avant qu’on ne puisse l’ouvrir ; mais au même moment j’entendis un passe-partout grincer à la porte extérieure de la troisième chambre – celle dont j’avais espéré emprunter la fenêtre pour atteindre le toit au-dessous.
Je tombai un instant dans un complet désespoir, me voyant prisonnier dans une pièce dont aucune fenêtre ne m’offrait d’issue. Une vague d’horreur presque monstrueuse m’envahit et prêta sous la lumière de ma lampe de poche une terrible bien qu’inexplicable étrangeté aux traces de pas qu’avait laissées dans la poussière l’intrus qui, ici même, essayait tout à l’heure de pénétrer chez moi. Puis, poussé par un automatisme plus fort que le désespoir, je me dirigeai vers la porte de communication, prêt à l’enfoncer et – si je trouvais les fermetures intactes comme dans la seconde chambre – à verrouiller la porte du couloir avant qu’on ne l’ouvre de l’extérieur.
Un vrai hasard providentiel me donna ma revanche – car devant moi la porte n’était pas fermée à clé, mais était même entrouverte. À la seconde je l’avais franchie et bloquais du genou droit et de l’épaule la porte du couloir qui visiblement commençait à s’ouvrir vers l’intérieur. Ma pression prit l’assaillant au dépourvu et le panneau se referma sous mon effort, si bien que je n’eus qu’à faire glisser le verrou comme je l’avais fait avec l’autre porte. Je reprenais souffle lorsque j’entendis faiblir les coups sur les deux portes extérieures, tandis qu’un vacarme confus venait de la porte de communication consolidée par mon lit. De toute évidence, mes agresseurs étaient entrés en masse dans la chambre du sud et se préparaient à une attaque de flanc. Au même instant, un passe-partout pénétrait dans la serrure de la chambre nord contiguë, et je compris qu’un danger plus immédiat me menaçait.
La porte de communication vers le nord était grande ouverte, mais il n’était plus temps de défendre celle du couloir. Je dus me contenter de fermer et de verrouiller la porte restée ouverte et celle qui lui faisait vis-à-vis – poussant un lit contre l’une, une commode contre l’autre, et une table de toilette devant l’entrée du couloir. Je ne pouvais me fier qu’à ces obstacles de fortune pour me protéger jusqu’à ce que je franchisse la fenêtre et gagne le toit du bâtiment de Paine Street. Mais même à ce moment critique mon horreur ne venait pas de la faiblesse de mes moyens de défense. Je frissonnais parce que aucun de mes poursuivants, en dehors de quelques hideux halètements, grognements et de faibles aboiements de temps à autre, n’émettait un son vocal net ou intelligible.
Tandis que je déplaçais les meubles et me ruais vers les fenêtres, j’entendis dans le couloir un bruit terrifiant : des pas précipités en direction de la chambre au nord de la mienne, alors que les coups avaient cessé du côté sud. Manifestement, la plupart de mes adversaires allaient concentrer leurs forces contre la fragile porte de communication dont ils savaient qu’elle menait directement à moi. Dehors, la lune baignait le faîtage du bâtiment au-dessous, et je vis que le saut serait terriblement risqué à cause de la pente abrupte sur laquelle je devais atterrir. Dans ces conditions, je choisis pour m’échapper la plus au sud des deux fenêtres ; je prévoyais de retomber sur le versant intérieur du toit et de gagner la lucarne la plus proche. Une fois dans l’une des constructions de brique délabrées, je devais m’attendre à une poursuite ; mais j’espérais pouvoir descendre et m’esquiver en passant de l’une à l’autre des entrées béantes autour de la cour obscure, rejoindre enfin Washington Street et me glisser hors de la ville en direction du sud.
Le tumulte devant la porte de communication nord était devenu terrifiant, et je vis que le mince panneau commençait à se fendre. Les assiégeants avaient sans doute apporté un objet pesant en guise de bélier. Néanmoins le lit tenait bon ; ce qui me laissait encore une faible chance de réussir mon évasion. En ouvrant la fenêtre, je remarquai qu’elle était flanquée d’un lourd rideau de velours suspendu à une tringle par des anneaux de cuivre, et aussi qu’il y avait à l’extérieur de gros crochets pour attacher les volets. Voyant là un moyen d’éviter un saut dangereux, je tirai d’un coup sec et fis tomber à terre rideau, tringle et le reste ; puis j’accrochai vivement deux des anneaux au crochet du volet et jetai l’étoffe au-dehors. Les lourds plis tombaient largement jusqu’au toit, et je jugeai qu’anneaux et crochet pourraient supporter mon poids. Alors, enjambant la fenêtre et descendant le long de l’échelle de corde improvisée, je laissai à jamais derrière moi la bâtisse malsaine et grouillante d’horreurs de l’hôtel Gilman.
J’atterris sans dommage sur les ardoises disjointes du toit pentu, et réussis à gagner le trou noir de la lucarne sans glisser une seule fois. En levant les yeux vers la fenêtre que je venais de quitter, je vis qu’elle était toujours obscure, mais plus loin au nord, entre les cheminées croulantes, je discernai des lumières de mauvais augure qui brillaient dans la salle de l’Ordre de Dagon, l’église baptiste et celle des congrégationalistes que je me rappelais en frissonnant. Ne voyant personne en bas dans la cour, j’espérai avoir une chance de fuir avant le déclenchement d’une alerte générale. À la lueur de ma lampe électrique, je constatai à travers la lucarne qu’il n’y avait pas de marches pour descendre. La distance n’était pas grande, toutefois, si bien que je grimpai sur le bord et me laissai tomber ; je me retrouvai sur un plancher poussiéreux encombré de caisses et de tonneaux vermoulus.
L’endroit était lugubre, mais je ne me souciais plus de ce genre d’impression et je gagnai aussitôt l’escalier révélé par ma lampe – après un bref coup d’œil à ma montre qui indiquait deux heures du matin. Les marches grinçaient mais paraissaient assez solides et je les descendis quatre à quatre, après un second étage qui avait l’air d’une grange, jusqu’au rez-de-chaussée. C’était le désert complet, et seul l’écho répondit au bruit de mes pas. J’atteignis enfin le couloir inférieur, au bout duquel un rectangle faiblement éclairé indiquait l’entrée en ruine sur Paine Street. Me dirigeant dans le sens opposé, je trouvai la porte de derrière également ouverte et, dégringolant cinq marches de pierre, je me retrouvai sur les pavés herbeux de la cour.
Les rayons de la lune n’arrivaient pas jusque-là, mais j’y voyais juste assez pour me passer de ma lampe. Certaines fenêtres de l’hôtel Gilman étaient maigrement éclairées et je crus entendre des bruits confus à l’intérieur. Avançant en silence du côté de Washington Street, je distinguai plusieurs entrées ouvertes et m’engageai dans la plus proche. Il faisait noir dans le corridor, et quand j’arrivai à l’autre bout je m’aperçus que la porte de la rue était hermétiquement close. Résolu à essayer un autre bâtiment, je revins sur mes pas à tâtons vers la cour, mais je m’arrêtai net tout près de l’entrée.
Par une porte ouverte de l’hôtel Gilman se déversait une énorme foule de silhouettes douteuses – des lanternes dansaient dans les ténèbres, et d’horribles voix coassantes échangeaient des cris étouffés en un langage qui n’avait rien d’anglais. Ces formes se déplaçaient de manière hésitante, et je compris à mon grand soulagement qu’elles ignoraient où j’étais allé ; je n’en ressentis pas moins à leur vue un frisson d’horreur. Leurs traits étaient indiscernables, mais la démarche traînante, ramassée, était affreusement repoussante. Et, pire que tout, je remarquai que l’une d’elles, vêtue d’une robe bizarre, portait à n’en pas douter une haute tiare dont le dessin ne m’était que trop familier. Tandis qu’elles se répandaient dans la cour, je sentis redoubler mes craintes. Et si je ne trouvais aucune issue à ce bâtiment du côté de la rue ? L’odeur de poisson était détestable, et je m’étonnais de pouvoir la supporter sans défaillir. Tâtonnant de nouveau vers la rue, j’ouvris une porte dans le couloir et me trouvai dans une pièce vide aux volets clos mais sans châssis de fenêtres. Guidé par les rayons de ma lampe, je réussis à ouvrir ces volets ; en un instant je sautai dehors et refermai soigneusement l’ouverture comme je l’avais trouvée.
J’étais maintenant dans Washington Street, et je ne vis d’abord âme qui vive ni d’autre clarté que celle de la lune. Pourtant j’entendais au loin, venant de plusieurs directions, le son de voix rauques, de pas, et une curieuse espèce de trottinement très distinct des bruits de pas. Manifestement, je n’avais pas de temps à perdre. Mon orientation était claire et je me réjouis de voir éteints tous les réverbères, comme c’est souvent l’usage les nuits de pleine lune dans les régions rurales défavorisées. Certains des bruits provenaient du sud, et pourtant je persistai à vouloir fuir dans cette direction. Il y aurait sûrement quantité d’entrées désertes pour m’abriter si je rencontrais une personne ou un groupe aux allures de poursuivants.
Je marchais vite, en silence, près des maisons en ruine. Bien que sans chapeau et décoiffé après ma descente laborieuse, je ne paraissais pas spécialement remarquable ; et je pouvais passer inaperçu s’il me fallait par hasard croiser quelqu’un. À la hauteur de Bates Street je m’enfonçai dans un vestibule béant tandis que deux silhouettes au pas traînant traversaient la rue devant moi, mais je me remis bientôt en route vers le grand carrefour où Eliot Street coupe obliquement Washington Street à son intersection avec South Street. Sans avoir jamais vu cet endroit, je l’avais jugé dangereux sur la carte du garçon épicier ; et la lune devait y donner en plein. Il était impossible de l’éviter, car tout autre itinéraire impliquerait des détours, donc d’autres risques de découverte et une perte de temps. Il ne me restait qu’à le traverser hardiment et sans me cacher, en imitant de mon mieux le pas traînant caractéristique des gens d’Innsmouth, et avec l’espoir de ne rencontrer personne, du moins aucun de mes poursuivants.
Dans quelle mesure la poursuite était-elle organisée et en fait quel était exactement son but, je n’en avais aucune idée. Il semblait régner en ville une activité inaccoutumée, mais je pensais que la nouvelle de ma fuite du Gilman ne s’était pas encore répandue. Naturellement il me faudrait bientôt quitter Washington Street pour quelque autre rue en direction du sud car cette bande de l’hôtel ne manquerait pas de se lancer à mes trousses. Je devais avoir laissé des traces dans la poussière du dernier vieux bâtiment, révélant ainsi comment j’avais gagné la rue.
Le carrefour était, et je l’avais prévu, inondé de clarté lunaire ; je vis en son centre les restes d’une pelouse entourée d’une grille de fer. Heureusement, il n’y avait personne alentour, mais un étrange grondement ou bourdonnement s’amplifiait du côté de la grand-place. South Street, très large et légèrement en pente, descendait directement jusqu’aux quais et offrait une vue dégagée sur la mer, et j’espérais que personne ne regarderait de là-bas tandis que je traverserais sous la lune.
J’avançai sans encombre, et aucun nouveau bruit ne me fit supposer qu’on m’avait observé. Jetant un coup d’œil autour de moi, je ralentis involontairement un instant pour admirer au bout de la rue la mer somptueuse dans tout l’éclat du clair de lune. Au-delà de la digue j’aperçus le vague profil noir du Récif du Diable, et je ne pus m’empêcher de penser à toutes les hideuses légendes que j’avais entendues pendant les dernières trente-quatre heures – et qui représentaient ce roc déchiqueté comme une vraie porte vers des mondes d’une horreur insondable et d’une inimaginable monstruosité.
Alors, sans avertissement, se produisit une série d’éclairs sur le lointain récif. Précis et indiscutables, ils éveillèrent dans mon esprit une terreur tout à fait irrationnelle. Mes muscles se tendirent en un réflexe de fuite, que ne retinrent qu’une sorte de prudence inconsciente et une fascination quasi hypnotique. Et pour empirer les choses, jaillissait maintenant, du haut du belvédère de l’hôtel Gilman, qui s’élevait derrière moi au nord-est, une suite de lueurs analogues mais différemment espacées qui ne pouvaient être qu’une réponse au premier signal.
Maîtrisant mes muscles, et me rendant compte à nouveau à quel point j’étais en vue, je repris mon allure vive tout en feignant de traîner les pieds ; et je ne cessai de surveiller l’infernal et menaçant récif tant que South Street m’ouvrait sa perspective sur la mer. Je ne savais que penser de ce que j’avais vu ; à moins qu’il ne s’agît d’un rite étrange lié au Récif du Diable, ou de quelque groupe débarqué d’un bateau sur ce sinistre roc. J’obliquai vers la gauche en contournant l’ancienne pelouse, sans quitter des yeux l’océan qui resplendissait sous la lumière spectrale de la lune d’été, ni le mystérieux spectacle de ces signaux inconnus et inexplicables.
C’est alors que j’éprouvai l’impression la plus horrible de tout ce que j’avais ressenti – celle qui anéantit mon dernier vestige de sang-froid et me lança frénétiquement vers le sud, le long des noires entrées béantes et des fenêtres au regard fixe de poisson, en cette rue déserte de cauchemar. Car, à mieux regarder, je m’aperçus que les eaux éclairées par la lune entre le récif et le rivage étaient loin d’être vides. Elles fourmillaient d’une horde grouillante de formes qui y nageaient en direction de la ville ; même à cette distance et en un seul regard j’avais compris que les têtes qui dansaient sur l’eau et les bras qui battaient l’air étaient étrangers et anormaux au point qu’on pouvait à peine le dire ou le formuler consciemment.
Ma course folle ne me mena pas même au bout du pâté de maisons, car j’entendis à ma gauche quelque chose comme la clameur d’une poursuite organisée : des bruits de pas, des sons gutturaux et un ronflement de moteur suivant Federal Street vers le sud. En une seconde tous mes projets furent entièrement renversés – si la route du sud était bloquée devant moi, il fallait évidemment sortir d’Innsmouth par un autre chemin. Je m’arrêtai et me réfugiai dans une entrée ouverte, me félicitant d’avoir franchi le carrefour éclairé par la lune avant que ces poursuivants n’aient descendu la rue parallèle.
Ma seconde réflexion fut moins rassurante. Puisqu’ils prenaient une autre rue, il était clair qu’ils ne suivaient pas directement mes traces. Ils ne m’avaient pas vu, mais obéissaient à un plan général conçu pour empêcher ma fuite. Ce qui signifiait que toutes les routes partant d’Innsmouth étaient également surveillées, car les habitants n’avaient pu savoir quelle voie je comptais emprunter. Dans ce cas, il me faudrait battre en retraite à travers la campagne en évitant toutes les routes ; mais comment faire dans cette région entièrement marécageuse et sillonnée de cours d’eau ? J’eus un moment le vertige – à la fois de désespoir et à cause d’une brusque recrudescence de l’inévitable odeur de poisson.
Puis je pensai à la ligne de chemin de fer abandonnée pour Rowley, dont la solide voie de terre empierrée et envahie d’herbe s’étendait encore au nord-ouest à partir de la gare en ruine, au bord de la gorge où coulait la rivière. Il restait une chance pour que les gens de la ville n’y aient pas songé ; son état d’abandon, les ronces qui l’obstruaient la rendant presque impraticable, c’était bien le chemin le moins engageant que pût choisir un fugitif. Je l’avais vue distinctement de ma fenêtre à l’hôtel, et je savais où la trouver. Le début de son parcours était malheureusement visible en grande partie depuis la route de Rowley, et des sommets de la ville elle-même ; mais on pouvait peut-être passer inaperçu en rampant à travers les broussailles. De toute façon, c’était ma seule chance de salut, et je n’avais d’autre choix que de l’essayer.
M’enfonçant dans le couloir de mon refuge désert, je consultai une fois de plus la carte du garçon épicier à la lueur de ma lampe électrique. Le problème immédiat était de rejoindre l’ancienne voie ferrée ; et je vis alors que le plus sûr était d’aller tout droit jusqu’à Babson Street, puis à l’ouest vers Lafayette Street – en contournant sans le traverser un espace découvert comme celui que j’avais franchi – et de repartir vers le nord et l’ouest en zigzaguant par les rues Lafayette, Bates, Adams et Bank – cette dernière longeait la gorge de la rivière – pour arriver à la gare abandonnée et croulante que j’avais vue de ma fenêtre. Si j’avais choisi Babson Street, c’est que je ne voulais ni retraverser le premier espace découvert ni commencer mon itinéraire vers l’ouest par un croisement aussi large que celui de South Street.
Repartant de nouveau, je gagnai le trottoir de droite pour me glisser dans Babson Street le plus discrètement possible. Le bruit persistait dans Federal Street, et en jetant un coup d’œil derrière moi je crus voir une lumière près du bâtiment par lequel je m’étais enfui. Impatient de quitter Washington Street, je me mis à trotter, espérant que personne ne m’observait. Presque au coin de Babson Street, je remarquai avec inquiétude qu’une des maisons était habitée, comme en témoignaient les rideaux à la fenêtre ; mais il n’y avait pas de lumière à l’intérieur, et je la dépassai sans catastrophe.
Dans Babson Street, qui coupait Federal Street et pouvait donc me révéler aux patrouilleurs, je rasai les murs des immeubles inégaux et affaissés, m’arrêtant deux fois dans une entrée car la rumeur derrière moi s’amplifiait par moments. Devant, l’espace découvert brillait sous la lune, vaste et désert, mais mon itinéraire ne m’obligeait pas à l’affronter. Lors de ma seconde pause je discernai une nouvelle répartition des bruits confus ; ayant risqué un regard prudent hors de mon abri, je vis une automobile franchir le carrefour à toute vitesse, et remonter Eliot Street, qui à cet endroit coupe à la fois les rues Babson et Lafayette.
Pendant que je guettais, suffoqué par une nouvelle vague de l’odeur de poisson, après une courte accalmie, j’aperçus une troupe de formes grossières et ramassées qui allaient dans la même direction à pas traînants ou bondissants ; je compris qu’elles devaient être chargées de surveiller la route d’Ipswich, qui est un prolongement d’Eliot Street. Deux de ces silhouettes portaient des robes volumineuses, et l’une d’elles un diadème pointu qui miroitait, blanc sous la lune. Sa démarche était si bizarre qu’elle me donna le frisson – car il me sembla qu’elle sautillait.
Je repris ma route dès que la dernière silhouette fut hors de vue, me précipitai pour tourner au coin dans Lafayette Street, et traversai Eliot Street en toute hâte de peur d’y trouver encore des traînards du groupe. J’entendis un vacarme et des coassements au loin du côté de la grand-place, mais je passai sans encombre. Je redoutais plus que tout de retraverser la large South Street toute baignée de lune – avec sa perspective sur la mer – et je dus m’armer de courage pour en venir à bout. Quelqu’un pouvait fort bien m’observer, et s’il restait des attardés dans Eliot Street ils ne manqueraient pas de m’apercevoir d’un côté ou de l’autre. Au dernier moment je jugeai qu’il valait mieux ralentir ma course et franchir l’obstacle, comme auparavant, de la démarche traînante d’une bonne partie des indigènes d’Innsmouth.
Lorsque la mer apparut de nouveau – à ma droite cette fois –, j’étais à peu près décidé à ne pas la regarder du tout. Mais je ne pus résister ; je jetai un coup d’œil de côté en avançant de mon pas emprunté vers des ombres protectrices. Pas de navire en vue, comme je m’y attendais plus ou moins. La première chose qui me sauta aux yeux fut un petit canot qui se dirigeait vers les quais abandonnés, chargé d’un objet volumineux recouvert d’une bâche. Ainsi entrevus, même de loin, ses rameurs semblaient particulièrement repoussants. Il y avait encore plusieurs nageurs, et sur le lointain récif noir, une faible lueur immobile, différente du signal clignotant vu précédemment, et d’une couleur singulière que je ne pouvais identifier. Devant moi, à droite, au-dessus des toits en pente, se dessinait le haut belvédère de l’hôtel Gilman, mais il était complètement sombre. L’odeur de poisson, dissipée un moment par une brise bienfaisante, revenait maintenant avec une insupportable virulence.
Je n’avais pas atteint l’autre côté de la rue quand j’entendis, venant du nord, une bande qui descendait Washington Street en grondant. Comme ils atteignaient le large carrefour où m’avait saisi la première fois le spectacle de la mer sous la lune, je les vis distinctement à quelques maisons de distance – et je fus horrifié des déformations bestiales de leurs visages et de leur allure ramassée de sous-humanité canine. Un homme marchait absolument comme un singe, ses longs bras touchant fréquemment le sol, tandis qu’un autre – en robe et tiare – avait l’air d’avancer à cloche-pied. C’était bien, pensai-je, ceux que j’avais vus dans la cour du Gilman – et qui par conséquent devaient suivre ma piste de plus près. Voyant certaines silhouettes se retourner pour regarder dans ma direction, je fus pétrifié de terreur, et je réussis pourtant à garder avec naturel le pas traînant que j’avais adopté. Aujourd’hui encore, j’ignore s’ils me virent ou non. Si oui, mon stratagème dut les tromper, car ils traversèrent le carrefour baigné de lune sans infléchir leur parcours – toujours coassant et jacassant dans un détestable jargon guttural qui ne me rappelait rien de connu.
Revenu dans l’ombre, je repris mon petit trot paisible le long des maisons penchées et décrépies qui ouvraient sur la nuit leurs yeux vides. Ayant gagné le trottoir ouest, je pris au premier tournant Bates Street, où je serrai de près les bâtiments du côté sud. Je dépassai deux maisons qui paraissaient habitées, l’une faiblement éclairée à l’étage supérieur, mais je ne rencontrai pas d’obstacle. Arrivé dans Adams Street, je me sentis beaucoup plus en sécurité, et ce fut un choc quand un homme sortit en titubant d’une entrée obscure juste en face de moi. Heureusement, il était beaucoup trop ivre pour être une menace ; je parvins donc sain et sauf aux lugubres ruines des entrepôts de Bank Street.
Rien ne bougeait dans cette rue morte près de la gorge de la rivière, et le grondement des chutes couvrait le bruit de mes pas. Il y avait encore une trotte jusqu’à l’ancienne gare, et les grands murs de brique des entrepôts autour de moi semblaient, je ne sais pourquoi, plus effrayants que les façades des maisons privées. Je vis enfin le vieux bâtiment à arcades – ou ce qui en restait – et me dirigeai aussitôt vers les rails, qui partaient de l’autre extrémité de la gare.
Ils étaient intacts sous la rouille, et la moitié à peine des traverses avaient pourri. Il était très difficile de marcher ou de courir sur une surface pareille ; mais je fis de mon mieux, et parvins dans l’ensemble à une allure convenable. Sur une certaine distance la ligne longeait le bord de la gorge, puis je finis par atteindre le long pont couvert où elle franchissait l’abîme à une hauteur vertigineuse. L’état de ce pont déterminerait mon étape suivante. Si c’était humainement possible, je l’utiliserais ; sinon, je risquais d’errer encore dans les rues à la recherche de la plus proche passerelle praticable.
La grande étendue du vieux pont, qui rappelait une grange, baignait dans le clair de lune spectral, et je vis que les traverses étaient saines à l’intérieur, au moins sur quelques pieds. Y pénétrant, j’allumai ma lampe électrique, et je faillis être renversé par une nuée de chauves-souris qui me dépassèrent en battant des ailes. Arrivé à mi-chemin, je craignis d’être arrêté par une brèche dangereuse ; mais finalement je risquai un saut désespéré qui, heureusement, réussit.
Je fus heureux de revoir la lune en sortant du sinistre tunnel. La vieille ligne traversait River Street au niveau du sol, puis tournait dans une région de plus en plus rurale où l’abominable odeur de poisson d’Innsmouth se faisait de moins en moins sentir. Là, l’épaisseur des mauvaises herbes et des ronces me retarda et déchira cruellement mes vêtements, mais je ne m’en plaignis pas car elles m’assuraient une protection en cas de danger. Je savais que la plus grande partie de mon parcours était visible depuis la route de Rowley.
Vinrent très vite les terres marécageuses où passait l’unique voie sur un remblai herbeux aux plantes folles plus clairsemées. Puis une sorte d’île plus élevée, que la ligne franchissait dans une tranchée peu profonde obstruée de ronces et de buissons. Je fus heureux de cet abri momentané, sachant la route de Rowley terriblement proche, comme je l’avais vu de ma fenêtre. Au bout de la tranchée, elle coupait la voie pour s’en éloigner à bonne distance ; en attendant il me fallait être extrêmement prudent. J’avais acquis maintenant l’heureuse certitude que la voie elle-même n’était pas surveillée.
Avant d’aborder la tranchée, je jetai un coup d’œil derrière moi, et n’aperçus aucun poursuivant. Les vieux clochers et les toits de la croulante Innsmouth luisaient, éthérés et pleins de charme sous la lune jaune magicienne, et je songeai à ce qu’ils avaient dû être autrefois avant d’être gagnés par les ténèbres. Puis, comme mon regard s’écartait de la ville vers l’intérieur des terres, un spectacle moins paisible attira mon attention et me tint immobile un instant.
Ce que je vis – ou crus voir – c’était l’inquiétante impression d’un mouvement sinueux, loin vers le sud, qui me donna à penser qu’une immense troupe pouvait se déverser hors de la cité sur la route d’Ipswich. La distance était grande et je ne distinguais aucun détail ; mais cette colonne mouvante me fit horreur. Elle serpentait trop et brillait d’un éclat trop vif sous les rayons de la lune qui maintenant déclinait à l’ouest. On devinait un bruit, aussi, bien que le vent soufflât en sens contraire – comme un grattement bestial et un mugissement pire que le grognement des hordes que j’avais surprises récemment.
Toutes sortes d’hypothèses déplaisantes me traversèrent l’esprit. Je pensais à ces cas extrêmes d’Innsmouth qu’on cachait, disait-on, dans les vieilles tanières croulantes proches du port. Je songeais encore aux nageurs innommables que j’avais entrevus. Si je comptais les groupes aperçus jusqu’ici, et ceux qui surveillaient sans doute les autres routes, mes poursuivants étaient singulièrement nombreux pour une ville aussi dépeuplée qu’Innsmouth.
D’où pouvait venir l’effectif considérable de cette colonne lointaine ? Ces antiques labyrinthes non explorés fourmillaient-ils d’une vie monstrueuse, non répertoriée, insoupçonnée ? Ou quelque navire invisible avait-il réellement débarqué une légion d’étrangers inconnus sur ce récif infernal ? Qui étaient-ils ? Pourquoi étaient-ils là ? Si une troupe pareille gardait la route d’Ipswich, les patrouilles sur les autres routes avaient-elles aussi été renforcées ?
Je m’étais engagé dans la tranchée broussailleuse et je me frayais lentement un chemin lorsque cette maudite odeur de poisson s’imposa de nouveau. Le vent avait-il brusquement tourné à l’est, et soufflait-il de la mer en passant sur la ville ? Sans doute, puisque je commençais à entendre d’affreux murmures gutturaux venant de ce côté jusqu’alors silencieux. Un autre son aussi – une espèce d’énorme sautillement ou trottinement mou – qui me rappelait les plus détestables images, me fit penser contre toute logique à cette colonne odieusement ondulante, là-bas sur la route d’Ipswich.
Alors la puanteur et les bruits grandirent ensemble, au point que je m’arrêtai en tremblant, me félicitant de la protection de la tranchée. C’était là, en effet, que la route de Rowley passait au plus près de la vieille voie avant de la traverser et de s’éloigner vers l’ouest. Quelque chose approchait sur cette route, et il me faudrait faire le mort jusqu’à ce que cela passe et disparaisse au loin. Dieu merci, ces créatures n’employaient pas de chiens pour la traque – peut-être aurait-elle été impossible avec l’odeur de poisson qui régnait dans les parages. Blotti dans les buissons de la brèche sablonneuse, je me sentais à peu près en sécurité, tout en sachant que les patrouilleurs allaient traverser la voie à cent yards à peine devant moi. Je pourrais les voir, mais eux, à moins d’un miracle diabolique, ne soupçonneraient pas ma présence.
Brusquement, je fus pris de crainte à l’idée de les regarder passer. Devant ce lieu tout proche éclairé par la lune où ils allaient déferler, il me vint l’idée singulière qu’il serait irrémédiablement pollué. Ce seraient peut-être les pires de tous les anormaux d’Innsmouth – qui aurait envie de se rappeler une chose pareille ?
La puanteur devenait atroce, et les bruits s’enflaient en un vacarme bestial de coassements, d’aboiements et de hurlements sans le moindre rapport avec la parole humaine. Était-ce vraiment la voix de mes persécuteurs ? Avaient-ils des chiens après tout ? Pourtant je n’avais vu à Innsmouth aucun de ces animaux inférieurs. Ces sauts mous ou ces tapotements étaient monstrueux – je ne supporterais pas la vue des créatures dégénérées qui les produisaient. Je garderais les yeux fermés tant qu’elles n’auraient pas disparu vers l’ouest. La horde était tout près maintenant – elle infectait l’air de ses rauques grognements, le sol tremblait presque au rythme étranger de sa marche. J’en perdais le souffle, et je fis appel à toutes les ressources de ma volonté pour tenir mes paupières baissées.
Aujourd’hui encore je ne saurais dire si ce qui suivit fut une hideuse réalité ou une hallucination de cauchemar. L’action du gouvernement, à la suite de mes appels frénétiques, tendrait à confirmer la monstrueuse vérité ; mais une hallucination n’a-t-elle pu se répéter sous l’influence quasi hypnotique de cette vieille ville hantée et maudite ? De tels lieux ont d’étranges vertus, et l’héritage de légendes démentes pourrait bien avoir affecté plus d’une imagination humaine parmi ces rues mortes et empestées, ces rangs serrés de toits pourrissants et de clochers croulants. N’est-il pas possible que le germe d’une véritable folie contagieuse se cache dans les profondeurs de cette ombre qui plane sur Innsmouth ? Qui peut être sûr de la réalité après avoir entendu des histoires comme celle du vieux Zadok Allen ? Les envoyés du gouvernement n’ont jamais retrouvé le pauvre Zadok, et n’ont aucune idée de ce qu’il a bien pu devenir. Où finit la folie, où commence la réalité ? Ma toute dernière crainte elle-même ne serait-elle qu’une illusion ?
Mais il faut que j’essaie de raconter ce que je crus voir cette nuit-là sous l’ironique lune jaune – ce que je vis déferler en sautillant sur la route de Rowley, en plein devant moi tandis que je me blottissais dans les ronces sauvages de cette tranchée du chemin de fer abandonné. Naturellement, ma résolution de garder les yeux fermés avait échoué. C’était à prévoir – qui aurait pu se tapir en aveugle pendant qu’une légion de monstres aboyants et coassants venus d’on ne sait où clopinait ignoblement cent yards plus loin ?
Je me croyais prêt au pire, et j’aurais dû l’être étant donné tout ce que j’avais déjà vu. Mes autres poursuivants abominablement déformés ne devaient-ils pas me préparer à affronter un redoublement de monstruosité, à considérer des formes qui n’auraient plus rien de normal ? Je n’ouvris les yeux que lorsque la rauque clameur éclata manifestement juste en face de moi. Je compris alors qu’une partie importante de la troupe se trouvait bien en vue là où les flancs de la tranchée s’abaissaient pour laisser la route traverser la voie – et je ne pus m’empêcher plus longtemps de découvrir quelle horreur avait à m’offrir cette lune jaune et provocante.
Ce fut la fin, pour ce qui me reste à vivre sur cette terre, de toute paix, de toute confiance en l’intégrité de la Nature et de l’esprit humain. Rien de ce que j’avais pu imaginer – même en ajoutant foi mot pour mot au récit dément du vieux Zadok – n’était en aucune façon comparable à la réalité démoniaque, impie, que je vis ou que je crus voir. J’ai tenté de suggérer ce qu’elle était pour différer l’horreur de l’écrire sans détour. Se peut-il que cette planète ait vraiment engendré semblables créatures ; que des yeux humains aient vu en chair et en os ce que l’homme n’a connu jusqu’ici que dans les fantasmes de la fièvre et les légendes sans consistance ?
Pourtant je les vis en un flot ininterrompu – clopinant, sautillant, coassant, chevrotant –, houle inhumaine sous le clair de lune spectral, malfaisante sarabande d’un fantastique cauchemar. Certains étaient coiffés de hautes tiares faites de cette espèce d’or blanchâtre inconnu… d’autres vêtus d’étranges robes… et l’un, qui ouvrait la marche, portait une veste noire épouvantablement bossue, un pantalon rayé et un feutre perché sur la chose informe qui lui servait de tête…
Je crois que leur couleur dominante était un vert grisâtre, mais ils avaient le ventre blanc. Ils semblaient en général luisants et lisses, à part une échine écailleuse. Leurs formes rappelaient l’anthropoïde, avec une tête de poisson aux yeux prodigieusement saillants qui ne se fermaient jamais. De chaque côté du cou palpitaient des ouïes, et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur deux pattes, tantôt sur quatre. Je fus plutôt soulagé qu’ils n’aient pas plus de quatre membres. Leurs voix, qui tenaient du coassement et de l’aboi, et qui servaient évidemment de langage articulé, prenaient toutes les sombres nuances de l’expression dont leur face immobile était privée.
À part leur monstruosité ils ne m’étaient pas inconnus. Je ne le savais que trop – le souvenir de la funeste tiare de Newburyport n’était-il pas encore présent ? –, c’étaient là les maudits poissons-grenouilles du motif indescriptible – horribles et bien vivants – et les voyant je comprenais aussi ce que m’avait rappelé si effroyablement le prêtre voûté avec sa tiare dans la sombre crypte de l’église. Combien étaient-ils ? Il me semblait qu’il y en avait des nuées – encore mon coup d’œil rapide n’avait-il pu m’en montrer qu’une toute petite partie. Un instant plus tard tout s’effaçait dans un miséricordieux évanouissement ; le premier de ma vie.
5
Ce fut une douce pluie qui me réveilla en plein jour de ma léthargie dans les broussailles de la tranchée, et quand je gagnai la route en chancelant je ne vis pas trace de pas dans la boue fraîche. L’odeur de poisson aussi avait disparu. Les toits en ruine d’Innsmouth et ses clochers effondrés se dessinaient en gris vers le sud-est, mais je n’aperçus pas un seul être vivant dans l’étendue désolée des marécages salés d’alentour. Ma montre, qui marchait encore, m’apprit qu’il était plus de midi.
La réalité de ce que j’avais vécu était extrêmement douteuse dans mon esprit, mais je sentais au fond de tout cela comme une présence hideuse. Il me fallait échapper à cette ville maudite – et je commençai à mettre à l’épreuve mes facultés de locomotion, plutôt lasses et engourdies. Malgré la faiblesse, la faim, l’horreur et l’hébétude, je me trouvai au bout d’un certain temps capable de marcher ; je m’acheminai donc lentement sur la route de Rowley. Avant le soir j’étais au village, où je pus enfin dîner et me procurer des vêtements convenables. Je pris le train de nuit pour Arkham, et le lendemain je m’entretins longuement et sérieusement avec les autorités ; je fis de même un peu plus tard à Boston. Le public connaît bien à présent le résultat de ces conversations – et je souhaite, pour la sauvegarde de la normalité, qu’il n’y ait plus rien à ajouter. Peut-être est-ce la folie qui me saisit, à moins qu’une horreur plus grande – ou une plus grande merveille – ne me soit réservée.
Comme on peut l’imaginer, je renonçai à presque tout ce que j’avais prévu pour le reste de mon voyage – les passe-temps du tourisme, de l’architecture et de l’étude du passé dont j’attendais tant de plaisir. Je n’osai pas même aller voir l’étrange ouvrage de bijouterie conservé disait-on au musée de l’université de Miskatonic. Je profitai cependant de mon séjour à Arkham pour prendre quelques notes généalogiques que je désirais avoir depuis longtemps ; documents hâtifs et non élaborés, il est vrai, mais qui pourraient m’être utiles plus tard quand j’aurais le temps de les collationner et de les ordonner. Le conservateur de la Société historique locale – Mr E. Lapham Peabody – m’aida très aimablement, et manifesta un exceptionnel intérêt en apprenant que j’étais le petit-fils d’Eliza Orne d’Arkham, née en 1867 et qui avait épousé James Williamson d’Ohio à l’âge de dix-sept ans.
Il se trouvait que l’un de mes oncles maternels était venu bien des années auparavant pour une recherche analogue à la mienne, et que la famille de ma grand-mère était dans le pays l’objet d’une certaine curiosité. Il y avait eu, disait Mr Peabody, de grandes discussions autour du mariage de son père, Benjamin Orne, aussitôt après la guerre civile ; car la parenté de la jeune épouse était singulièrement mystérieuse. On la croyait orpheline d’un Marsh du New Hampshire – un cousin des Marsh du comté d’Essex – mais elle avait été élevée en France et ignorait presque tout de sa famille. Un tuteur avait déposé des fonds dans une banque de Boston pour son entretien et celui de sa gouvernante française ; mais ce tuteur, dont le nom n’était pas familier aux gens d’Arkham, avait fini par disparaître, si bien que la gouvernante assuma son rôle par décision du tribunal. La Française – morte à présent depuis longtemps – était très taciturne, et d’aucuns prétendaient qu’elle aurait pu en dire bien davantage.
Mais le plus déconcertant, c’est que personne ne pouvait situer les prétendus parents de la jeune femme – Enoch et Lydia (Meserve) Marsh – parmi les familles connues du New Hampshire. Beaucoup insinuaient qu’elle était peut-être la fille naturelle de quelque Marsh haut placé – elle avait assurément les yeux des Marsh. On se posa surtout des questions après sa mort prématurée, qui survint à la naissance de ma grand-mère, son unique enfant. Des impressions pénibles s’étant associées pour moi au nom de Marsh, je n’admis pas volontiers qu’il figure dans mon propre arbre généalogique ; et je n’aimai pas non plus entendre Mr Peabody suggérer que j’avais moi aussi les yeux des Marsh. Je lui fus néanmoins reconnaissant pour ces documents qui, je le savais, me seraient précieux ; et je pris d’abondantes notes et des listes de livres de référence concernant la famille Orne aux riches archives.
De Boston, je rentrai directement chez moi à Toledo, et passai plus tard un mois à Maumee pour me remettre de mes épreuves. En septembre je commençai à l’université d’Oberlin ma dernière année d’études, et jusqu’en juin je me consacrai à mon travail et à d’autres occupations salutaires – ne songeant plus à ma terreur passée que lors des visites de certains fonctionnaires, ayant trait à la campagne qu’avaient suscitée mes appels et mon témoignage. Vers la mi-juillet – un an exactement après l’aventure d’Innsmouth – je passai une semaine à Cleveland dans la famille de ma défunte mère ; j’y confrontai mes nouveaux renseignements généalogiques avec les diverses notes, traditions et fragments de souvenirs familiaux qui s’y trouvaient, pour essayer d’en édifier un tableau cohérent.
Cette tâche ne me plut guère, car l’ambiance chez les Williamson m’avait toujours déprimé. On y sentait une tension morbide, et dans mon enfance ma mère ne m’avait jamais encouragé à voir ses parents, bien qu’elle fût toujours heureuse de recevoir son père quand il venait à Toledo. Ma grand-mère d’Arkham me paraissait étrange, presque terrifiante, et je ne crois pas l’avoir regrettée lorsqu’elle disparut. J’avais alors huit ans, et l’on disait qu’elle était morte de chagrin après le suicide de mon oncle Douglas, son fils aîné. Il s’était tiré un coup de revolver à son retour d’une visite en Nouvelle-Angleterre – celle-là même, certainement, qui avait laissé son souvenir à la Société historique d’Arkham.
Cet oncle ressemblait à sa mère, et je ne l’avais jamais aimé non plus. Je ne sais quoi dans leur expression figée, sans un battement de cils, me causait un vague malaise, inexplicable. Ma mère et mon oncle Walter ne leur ressemblaient pas. Ils tenaient de leur père, bien que mon pauvre petit cousin Lawrence – le fils de Walter – ait été la vivante image de sa grand-mère jusqu’au jour où il fallut l’interner à vie dans une maison de santé de Canton. Je ne l’avais pas vu depuis quatre ans, mais mon oncle laissait entendre que son état, autant mental que physique, était déplorable. Ce souci avait été probablement la cause majeure de la mort de sa mère deux ans auparavant.
Mon grand-père et Walter, son fils veuf, vivaient seuls à présent dans la maison de Cleveland, mais les souvenirs d’autrefois y restaient pesants. Elle me déplaisait toujours, et je m’efforçai de mener mes recherches le plus rapidement possible. Mon grand-père me fournit en abondance récits et traditions sur les Williamson ; pour les Orne j’eus recours à mon oncle Walter, qui mit à ma disposition le contenu de tous ses dossiers, y compris notes, lettres, coupures de presse, souvenirs de famille, photographies et miniatures.
Ce fut en parcourant les lettres et les portraits du côté Orne que je me mis à éprouver une sorte de terreur de ma propre ascendance. Je l’ai dit, ma grand-mère et mon oncle Douglas m’avaient toujours inquiété. Maintenant, des années après leur mort, je regardais leurs effigies avec un sentiment nettement aggravé de répulsion et d’éloignement, mais peu à peu une sorte d’horrible comparaison s’imposa à mon subconscient, malgré le refus tenace de mon esprit conscient d’en admettre le moindre soupçon. De toute évidence, l’expression caractéristique de ces visages me suggérait maintenant une chose qu’ils ne sous-entendaient pas avant – une chose qui déclencherait une folle panique si j’y pensais trop franchement.
Le choc fut pire quand mon oncle me montra les bijoux des Orne déposés dans le coffre-fort d’une banque de la ville basse. Certains étaient raffinés et évocateurs, mais il y avait un coffret de vieilles pièces étranges venant de ma mystérieuse arrière-grand-mère, et que mon oncle hésitait à montrer. Les motifs, disait-il, en étaient grotesques, presque répugnants, et, à sa connaissance, ils n’avaient jamais été portés en public ; mais ma grand-mère prenait plaisir à les regarder. De vagues légendes leur attribuaient des propriétés maléfiques, et la gouvernante française de mon arrière-grand-mère disait qu’il ne fallait pas les porter en Nouvelle-Angleterre, tandis qu’en Europe on le pouvait sans risque.
En déballant les objets lentement, à contrecœur, mon oncle me pria instamment de ne pas me laisser impressionner par la bizarrerie et souvent la hideur des dessins. Des artistes et des archéologues qui les avaient vus les jugeaient d’un travail exotique raffiné au plus haut point, mais aucun ne semblait capable d’identifier leur métal ni de les rattacher à une tradition artistique précise. Il y avait deux bracelets, une tiare et une sorte de pectoral ; ce dernier portait en haut relief des figures d’une extravagance presque intolérable.
Pendant cette description j’avais réussi à maîtriser mes émotions, mais mon visage devait trahir ma terreur grandissante. Mon oncle parut soucieux, et s’interrompit pour m’observer. Je lui fis signe de continuer, et il s’exécuta, plus réticent que jamais. Il attendait visiblement ma réaction quand la tiare apparut la première, mais je doute qu’il ait prévu ce qui arriva. Je ne l’avais pas prévu non plus, car je me croyais tout à fait préparé à ce que seraient ces bijoux. Ce qui arriva, c’est que je m’évanouis sans mot dire, comme je l’avais fait dans cette tranchée de voie ferrée obstruée par les broussailles, un an auparavant.
Depuis ce jour ma vie a été un cauchemar de sombres méditations et de craintes, mais je ne sais pas davantage quelle est la part de la folie et celle de la hideuse vérité. Mon arrière-grand-mère était une Marsh d’origine inconnue dont le mari vivait à Arkham – et le vieux Zadok n’avait-il pas dit que la fille d’Obed Marsh née d’une mère monstrueuse avait été mariée par ruse à un homme d’Arkham ! Qu’est-ce que le vieil ivrogne avait marmonné sur la ressemblance de mes yeux et de ceux du capitaine Obed ? À Arkham aussi, le conservateur m’avait dit que j’avais les yeux des Marsh. Obed était-il mon propre arrière-grand-père ? Qui donc, alors – ou quoi – pouvait bien être mon arrière-grand-mère ? Mais peut-être tout cela n’était-il que folie. Ces parures d’or blanchâtre pouvaient avoir été achetées à un marin d’Innsmouth par le père de mon arrière-grand-mère, quel qu’il fût. Ce regard fixe dans le visage de ma grand-mère et de l’oncle suicidé pouvait n’être que pure imagination de ma part – surexcitée par la malédiction d’Innsmouth qui avait si sombrement coloré mes chimères. Mais pourquoi mon oncle s’était-il tué après une recherche généalogique en Nouvelle-Angleterre ?
Pendant plus de deux ans je combattis ces réflexions avec un certain succès. Mon père me procura une situation dans une compagnie d’assurances, et je m’enterrai dans la routine le plus profondément possible. Pourtant, durant l’hiver 1930-1931, les rêves commencèrent. Ils furent d’abord très espacés et insidieux, puis de plus en plus nombreux et frappants au fil des semaines. De grandes étendues liquides s’ouvraient devant moi, et j’errais à travers de gigantesques portiques engloutis et des labyrinthes de murs cyclopéens envahis d’herbes en compagnie de poissons grotesques. Ensuite apparurent les autres formes, qui me remplissaient d’une horreur sans nom lorsque je m’éveillais. Mais au cours des rêves elles ne m’inspiraient aucune crainte – j’étais des leurs ; je portais leurs ornements inhumains, je parcourais leurs routes aquatiques et je récitais de monstrueuses prières dans leurs détestables temples du fond de la mer.
J’en rêvais bien plus que je n’en pouvais retenir, mais même ce que je me rappelais chaque matin suffirait à me faire passer pour un fou ou un génie si j’osais tout écrire. Je sentais qu’une effroyable influence cherchait à m’arracher progressivement au monde raisonnable de la vie normale pour me plonger dans des abîmes innommables de ténèbres et d’inconnu ; tous ces phénomènes m’affectaient durement. Ma santé et ma physionomie se dégradèrent régulièrement, jusqu’au jour où je dus enfin renoncer à ma situation pour adopter la vie immobile et recluse d’un malade. Une bizarre affection nerveuse s’était emparée de moi, et j’étais par moments presque incapable de fermer les yeux.
C’est alors que je commençai à m’examiner devant la glace avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer, mais, dans mon cas, l’altération était plus subtile et plus déconcertante. Mon père parut s’en apercevoir, lui aussi, car il se mit à me regarder curieusement, presque avec effroi. Que m’arrivait-il ? Serait-il possible que j’en vienne à ressembler à ma grand-mère et à mon oncle Douglas ?
Une nuit je fis un rêve terrifiant dans lequel je rencontrais mon aïeule au fond de la mer. Elle habitait un palais phosphorescent aux multiples terrasses, aux jardins d’étranges coraux lépreux et de grotesques efflorescences bractéales, et elle m’accueillit avec une chaleur qui n’allait peut-être pas sans ironie. Elle avait changé – comme changent ceux qui prennent goût à l’eau – et me dit qu’elle n’était jamais morte. Bien mieux, elle était allée en un lieu dont son fils mort avait eu connaissance, et elle avait plongé dans un royaume dont les merveilles l’attendaient lui aussi – mais qu’il avait rejeté d’un coup de pistolet. Ce serait également mon royaume – je ne pouvais y échapper. Je ne mourrais jamais, mais je vivrais avec ceux qui existaient déjà bien avant que l’homme ne foule la terre.
Je rencontrai aussi ce qui avait été sa grand-mère. Pendant quatre-vingt mille ans Pth’thya-l’yi avait vécu dans Y’ha-nthlei, où elle était revenue à la mort d’Obed Marsh. Y’ha-nthlei ne fut pas détruit quand les hommes de la surface de la terre firent exploser dans la mer leurs armes de mort. On n’a jamais pu détruire Ceux des Profondeurs, même si la magie paléogène des Anciens oubliés a pu parfois les tenir en échec. Pour le moment, ils se reposaient ; mais quelque jour, s’ils se souvenaient, ils monteraient à nouveau prélever le tribut que le Grand Cthulhu désirait ardemment. Ce serait la prochaine fois une cité plus importante qu’Innsmouth. Ils avaient projeté de s’étendre et avaient apporté là-haut ce qui les y aiderait ; maintenant il leur fallait attendre une fois de plus. Je devrais faire pénitence pour avoir provoqué la mort des hommes de la surface, mais la peine serait légère. Tel fut le rêve dans lequel je vis un shoggoth pour la première fois, et ce spectacle me réveilla, hurlant d’épouvante. Ce matin-là le miroir m’apprit irrévocablement que j’avais désormais le masque d’Innsmouth.
Jusqu’ici je ne me suis pas tué comme mon oncle Douglas. J’ai acheté un pistolet automatique et j’ai failli sauter le pas, mais certains rêves m’en ont dissuadé. Les pires degrés de l’horreur s’atténuent, et je me sens étrangement attiré par les profondeurs inconnues de la mer au lieu de les craindre. J’entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil puis je m’éveille avec une sorte d’exaltation et non plus de terreur. Je ne crois pas avoir besoin d’attendre la complète métamorphose comme la plupart l’ont fait. Sinon, mon père m’enfermerait probablement dans une maison de santé de la même façon que mon pauvre petit cousin. Des splendeurs inouïes et stupéfiantes m’attendent dans ces profondeurs, et j’irai bientôt à leur recherche. Iä-R’lyeh ! Cthulhu fhtagn ! Iä ! Iä ! Non, je ne me tuerai pas – on ne peut pas m’obliger à me tuer !
Je vais tout préparer pour que mon cousin s’échappe de cet asile de Canton, et nous irons ensemble à Innsmouth dans l’ombre des prodiges. Nous nagerons jusqu’à ce récif qui médite dans la mer, nous plongerons à travers de noirs abîmes jusqu’à la cyclopéenne Y’ha-nthlei aux mille colonnes, dans ce repaire de Ceux des Profondeurs, et nous y vivrons à jamais dans l’émerveillement et la gloire.