
Gustave Le Rouge
LE MYSTÉRIEUX DOCTEUR CORNÉLIUS
TOME III
1912-1913
Paris, Maison du livre moderne
18 volumes
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
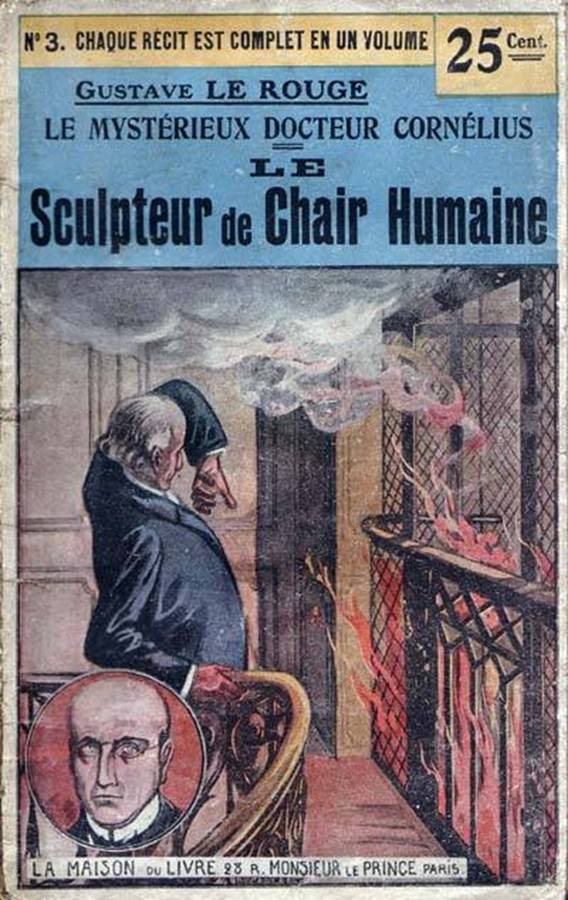
Table des matières
DOUZIÈME ÉPISODE La croisière du Gorill-Club
CHAPITRE II Graves événements à l’île des pendus
TREIZIÈME ÉPISODE La fleur du sommeil
CHAPITRE PREMIER Le voleur invisible
QUATORZIÈME ÉPISODE Le buste aux yeux d’émeraude
CHAPITRE PREMIER Résurrection !
CHAPITRE II Une visite inattendue
CHAPITRE III Le buste aux yeux d’émeraude
CHAPITRE V Le pont de l’Estacade
QUINZIÈME ÉPISODE La dame aux scabieuses
CHAPITRE PREMIER Après le sinistre du pont de l’Estacade
CHAPITRE II « Célérité. – Discrétion !… »
CHAPITRE III La dame aux scabieuses
CHAPITRE IV Une ancienne connaissance
SEIZIÈME ÉPISODE La tour fiévreuse
CHAPITRE II Le trust des escargots
CHAPITRE IV Le crucifix d’étain
DIX-SEPTIÈME ÉPISODE Le dément de la Maison Bleue
CHAPITRE PREMIER Le choix d’un gendre
CHAPITRE III Le dément de la Maison Bleue
DIX-HUITIÈME ÉPISODE Bas les masques !
CHAPITRE PREMIER Un projet d’union
CHAPITRE III Règlement de comptes
CHAPITRE IV Le cauchemar du samedi
CHAPITRE V La coupe empoisonnée
À propos de cette édition électronique
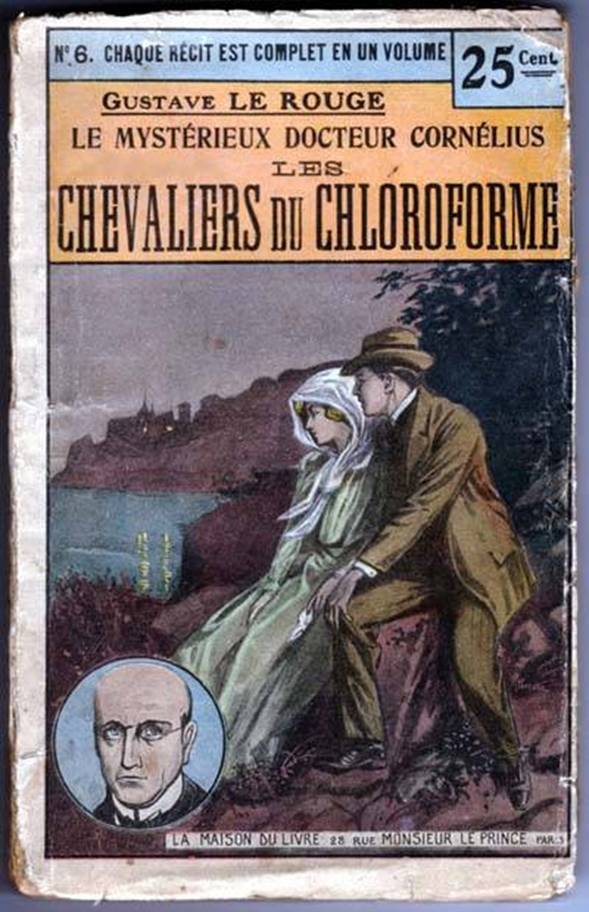
DOUZIÈME ÉPISODE
La croisière du Gorill-Club
CHAPITRE PREMIER
La dynamite
Un petit navire à la carène peinte en noir, aux formes lourdes, à l’arrière duquel flottait le pavillon tricolore du royaume de Hollande, était amarré dans le port de Vladivostok, mais à une distance respectable des autres navires.
Grâce à un plancher mobile, le pont du hollandais était presque de niveau avec le quai, et c’est sur ce plancher, où avaient été disposés des rouleaux, qu’une douzaine de coolies chinois surveillés par une escouade de cosaques, embarquaient avec une extrême lenteur et d’infinies précautions des caisses carrées de dimensions moyennes mais d’un très grand poids.
Sur le pont du navire, le capitaine, un jovial compagnon à longue barbe blonde, veillait en personne à l’arrivage des précieuses caisses.
On s’expliquait que tant de soins eussent été pris, en lisant en grandes lettres noires sur les planches de l’emballage l’inscription suivante, surmontée des armes de la Russie :
MANUFACTURE IMPÉRIALE DE RUSSIE
CARTOUCHES DE DYNAMITE À USAGE DES MINES.
FRAGILE, CRAINT LES CHOCS ET LA CHALEUR.
Le redoutable explosif, que les cosaques avaient amené dans un wagon spécial, était destiné aux chercheurs d’or du Klondike, qui, dans leurs travaux, en font une grande consommation, et les caisses qui le contenaient étaient plombées et scellées du sceau impérial.
Depuis plusieurs mois déjà, le capitaine du vapeur la Belle Dorothéa faisait le voyage de Vladivostok au Klondike et, comme on peut le supposer, il demandait un fret très élevé pour le transport d’une marchandise à ce point dangereuse. Aussi, bien qu’il ne prît jamais qu’un chargement très peu considérable, il avait pu réaliser de sérieux bénéfices sans qu’il lui fût jamais arrivé aucun accident.
D’un tempérament très flegmatique, en bon Hollandais qu’il était, le capitaine Wilhelm Van Blook dormait sur ses deux oreilles, à côté d’une masse de dynamite capable de faire sauter une douzaine de villages, et il ne se privait même pas de fumer sa pipe dans le voisinage des redoutables caisses arrimées à l’avant, le plus loin possible des machines et de la cuisine.
Quand on le félicitait de n’avoir jamais eu d’accident, il ne manquait pas de répondre facétieusement :
– S’il y avait un accident, pensez-vous, ce ne serait pas un petit accident. La Belle Dorothéa sauterait comme une pelure d’oignon ; il n’en resterait pas seulement un morceau de la grosseur de ma pipe.
Il riait à gorge déployée, enchanté de cette plaisanterie qu’il rééditait au moins deux ou trois fois tous les jours.
Malgré cette apparente nonchalance, Wilhelm Van Blook se montrait pourtant très prudent, ne permettant de fumer à personne – sauf à lui-même – et veillant à ce que deux hommes de garde, qui se relayaient de deux heures en deux heures, demeurassent nuit et jour à proximité des précieuses caisses.
Cependant, les coolies avaient terminé leur besogne et, après avoir touché le rouble d’argent par homme qui leur avait été promis, ils s’éloignaient en toute hâte, enchantés d’en avoir fini avec cette dangereuse manipulation.
Wilhelm fit descendre dans sa cabine le sous-officier de cosaques, signa une décharge en bonne forme où étaient mentionnés les numéros de chaque caisse, puis le Russe et le Hollandais burent chacun un verre de genièvre à la santé de leurs souverains respectifs et se séparèrent.
Il était alors un peu plus de midi. Les dix hommes dont se composait l’équipage avaient déjeuné. Wilhelm s’approcha de Karl son second, qu’il traitait plutôt en ami qu’en subordonné et en qui il avait toute confiance.
– Mon vieux Karl, lui dit-il, il va falloir appareiller tout de suite. Complète ce qui te manque comme provisions, pendant que je vais au bureau du port remplir les formalités.
– Je croyais, fit Karl avec surprise, que nous ne partions que demain matin ?
– Oui, répliqua Wilhelm en clignant de l’œil, mais j’ai changé d’avis ; il faut que, dans une heure, une heure et demie tout au plus, nous soyons sortis du port.
– Bien, capitaine, répondit Karl, c’est entendu !
– Surtout, recommanda encore Wilhelm au moment où il allait franchir le plancher mobile qui avait servi à l’embarquement de la dynamite, que l’on fasse bien attention aux caisses.
– Entendu !
Wilhelm s’éloigna de son pas flegmatique dans la direction des bureaux de la marine, pendant que, sous les ordres de Karl, les dix hommes de l’équipage prenaient en hâte les dernières dispositions pour le départ.
Quand le capitaine fut de retour, les chaudières étaient sous pression, les voiles hissées, le plancher mobile avait disparu, et l’on était en train d’amener les ancres.
Wilhelm Van Blook prit lui-même le gouvernail ; c’était un soin qu’il ne laissait à personne pour la sortie et pour l’entrée dans le port de Vladivostok, où il est difficile à un navire d’évoluer au milieu des flottes de paquebots et de voiliers anglais, américains, japonais et allemands.
Comme de coutume, il s’acquitta admirablement de cette tâche, et bientôt la Belle Dorothéa, forçant ses feux et favorisée par un bon vent d’ouest, gagna la haute mer. Le soleil n’était pas encore couché que la côte russe n’apparaissait plus que comme une longue bande de brume à l’horizon oriental.
– Voilà le moment ! murmura Wilhelm à Karl en regardant sa montre. Je crois qu’aujourd’hui j’ai fait une bonne journée.
– Comment cela, capitaine ?
– Tu vas voir ? Prends un ciseau et un marteau et viens avec moi !
Karl, passablement intrigué, suivit son supérieur jusqu’à l’autre extrémité du pont, où quatorze des caisses de dynamite avaient été laissées, sans doute dans une secrète intention, le capitaine ayant défendu qu’elles fussent arrimées dans la cale avec les autres.
Karl remarqua que ces quatorze caisses portaient toutes dans un angle une croix grossièrement tracée à la peinture rouge, et il constata, avec surprise, que les planches en étaient mal jointes, ce qui n’était jamais arrivé dans les envois précédents, dont l’emballage était toujours très soigné.
Wilhelm avait pris le ciseau et le marteau et il commençait à taper de toutes ses forces.
– Qu’allez-vous faire ! s’écria Karl en se reculant avec épouvante.
– Sois tranquille, répondit le capitaine avec son bon sourire, il n’y a pas de danger !
Déjà, sans respect pour le sceau impérial, une des planches avait sauté.
Karl jeta un cri de terreur. Dans l’espace vide laissé par la planche, il venait d’apercevoir un pied humain, un pied nu armé de longs ongles, racornis et pareils à des griffes.
Karl était convaincu, plus que personne, de la douceur et de l’honnêteté de son capitaine ; pourtant, sa première pensée fut qu’il s’était rendu complice de quelque crime. Ses cheveux se hérissèrent d’épouvante sur son front, et il balbutia, en claquant des dents :
– Vous saviez donc, capitaine, qu’il y avait un cadavre dans cette caisse ?
Le capitaine éclata de rire, en homme qui fait une excellente plaisanterie et, gravement, il continua à défaire les autres planches.
Le prétendu cadavre se remuait et prononçait des paroles dans une langue incompréhensible.
– Sortez donc, tarteifle ! s’écria le capitaine.
Et il aida l’habitant de la caisse à se faufiler à quatre pattes par l’étroite ouverture.
Un personnage bizarre apparut ; il avait la barbe et les cheveux longs et gris, de solides lunettes de cuivre sur le nez et un air doctoral ; il ne portait d’autre vêtement qu’une sorte de caleçon et une vieille touloupe de peau de mouton qui lui tenait lieu sans doute de chemise, de pantalon et de gilet : on apercevait son torse couvert d’une toison épaisse et grise, comme celui d’un vieil orang-outang.
Le capitaine et son second rirent d’abord de tout leur cœur à la vue de ce phénomène puis Wilhelm Van Blook – les affaires sont les affaires – tira de sa poche un carnet sur lequel se trouvait une liste de noms, et il dit en russe – langue qu’il avait fini par parler à peu près correctement :
– C’est vous, sans doute, l’honorable docteur Stépan Rominoff, que je suis chargé de transporter en Amérique ?
– Parfaitement !…
– Je suis le capitaine Van Blook.
– Eh bien, capitaine, vous seriez le plus aimable des hommes si vous vouliez bien me faire donner quelque chose à manger. Il y a trente-six heures que je suis dans cette caisse, et non seulement je suis atrocement courbaturé, mais je meurs de faim, car je n’avais emporté avec moi que deux petits pains de seigle et une gourde pleine de thé froid.
Le capitaine trouvait son nouveau passager des plus réjouissants.
– Mon vieux Karl, dit-il à son second, conduis ce brave docteur à la cuisine et fais-lui servir une bonne gamelle de haricots rouges avec une saucisse. Il doit en rester du repas de l’équipage et, quand il sera rassasié, tu chercheras dans ma garde-robe s’il n’y a pas une culotte et une chemise qui puissent lui convenir : il fait frais et, quoiqu’il ait l’estomac plus velu que le dessus d’une vieille malle, il pourrait empoigner une fluxion de poitrine.
– Bien, capitaine !
Mais le docteur était revenu sur ses pas et, avec une gravité que son étrange équipement rendait des plus comiques :
– Capitaine, dit-il, j’accepte volontiers les haricots rouges et le pain, mais je refuse la saucisse, et je n’ai besoin ni de culotte ni de chemise.
– N’ayez pas peur d’être indiscret, dit le Hollandais, mais vous ne pouvez rester en pareil équipage.
– Sachez, capitaine, que je suis patriarche de la nouvelle secte des « vitalistes mystiques » ; nous réduisons les besoins de la vie à leur minimum. Comme la nature nous l’indique, nous marchons aussi nus que possible et notre santé s’en trouve très bien. Nous mangeons de préférence des fruits, des racines, toutes choses qui ne coûtent la vie à aucun animal…
– Vous m’expliquerez cela plus tard, répliqua le capitaine abasourdi, ne discourez pas tant et allez manger !
Le patriarche des vitalistes mystiques disparut dans la direction des cuisines et Wilhelm, que ce début avait mis en appétit de curiosité, commença activement à défaire la seconde caisse.
Il en sortit une dame d’un embonpoint considérable et qui déclara se nommer Ivanovna Rominoff, l’épouse légitime de l’apôtre. Elle était d’ailleurs dans une toilette aussi débraillée et aussi sommaire que son seigneur et maître, dont elle partageait les principes.
– Ah çà ! se dit le capitaine en attaquant la troisième caisse, qu’est-ce que c’est que ces phénomènes-là ! Ça va devenir drôle à bord, s’il y en a beaucoup comme ceux-là ! Après tout, je m’en moque, je suis largement payé par le comité terroriste de Lausanne, pour transporter ces étrangers bipèdes sur le territoire de la libre Amérique, c’est un fret comme un autre.
Tout en monologuant ainsi, Wilhelm Van Blook avait procédé à l’ouverture de la troisième caisse. Cette fois, elle recelait un personnage long, maigre et efflanqué, encore porteur de l’uniforme gris du bagne ; ses traits présentaient le type cosaque le plus accusé. Son nez était épaté, ses pommettes saillantes et ses petits yeux obliques et bridés comme ceux des Chinois. Sa physionomie respirait la naïveté et la candeur.
– Eh bien, demanda le capitaine après l’avoir toisé de la tête aux pieds, est-ce que vous faites aussi partie de la secte des végétariens sans culottes ?
– Non, répliqua le cosaque en faisant le salut militaire, j’aime beaucoup la viande et je ne demande pas mieux que de revêtir un costume autre que celui-ci.
– Bon, fit le capitaine, mais pourquoi étiez-vous au bagne ?
– Pour une peccadille. Un jour que j’avais bu un peu trop de vodka, j’ai jeté un de mes officiers dans les latrines. J’ai failli être fusillé, mais notre petit père le tsar m’a fait grâce et m’a envoyé aux usines de vert-de-gris.
– Tu me fais l’effet d’un bon diable ; comment t’appelles-tu ?
– Ivan Rapopoff !
– C’est bon, va à la cuisine, dit le Hollandais en pointant le nom du cosaque sur son carnet, comme il l’avait déjà fait pour les deux précédents.
À ce moment, un coup de canon retentit dans le lointain, puis un second. Le cosaque regarda le capitaine hollandais avec une certaine émotion.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda ce dernier.
Rapopoff ne répondit pas tout d’abord. Il compta les coups de canon sur ses doigts.
– Treize, dit-il enfin. C’est le signal que l’on fait quand des galériens viennent de s’évader.
– Bah ! fit Wilhelm avec insouciance. On n’aura pas l’idée de me soupçonner. Je suis honorablement connu à Vladivostok : d’ailleurs, il serait bien tard pour me poursuivre, et la nuit vient. Demain, nous serons loin d’ici.
Le cosaque manifesta sa joie par un pied de nez irrévérencieusement adressé au petit père le tsar et aux principaux dignitaires de l’Empire, puis, à son tour, il gagna la cuisine.
Wilhelm, que cette besogne commençait à ennuyer, se fit aider par les matelots pour ouvrir les onze autres caisses qui, comme les trois premières, recelaient chacune un prisonnier.
Les femmes étaient en nombre dominant. En y comptant Mme Rominoff, il y en avait dix en tout, et toutes les dix, affiliées à la secte du prophète vitaliste, étaient dans le même état de négligence et de quasi-nudité.
Leur corps était endurci contre le froid par une longue habitude. Malgré la rigueur de la température, elles prenaient tous les jours un bain glacé sans même contracter un simple coryza.
La plupart étaient de robustes matrones dont la laideur était une sérieuse garantie de vertu ; mais quelques-unes étaient jeunes et jolies. Wanda, Fedorewna, Maslowa, Katinka et Staniska, avant de se convertir aux doctrines vitalistes, qui avaient amené leur emprisonnement, avaient été enfermées dans une « prison » de jeunes filles vicieuses et s’en étaient évadées. Elles conservaient de leur ancienne existence une liberté d’allures et de langage qui faisait un joyeux contraste avec la mine pédantesque et les doctorales paroles du prophète Stépan Rominoff.
Il n’y avait donc, outre le prophète et le cosaque, que deux hommes. L’un d’eux, un petit vieillard à l’air aimable et souriant, aux façons pleines de politesse, n’avait pas son pareil pour fabriquer des bombes à la panclastite, munies d’un mouvement d’horlogerie qui amenait l’explosion à heure fixe ; en dehors de cette manie, qui lui avait valu, à maintes reprises, le fouet et la prison, Serge Danicheff était un homme inoffensif et doux, et c’était un véritable plaisir de l’entendre parler du bonheur de l’humanité future, régénérée par le progrès.
Galitzine, son compagnon, appartenait aussi à la secte des terroristes ; mais il était sombre, silencieux, ne prononçait pas quatre paroles par jour. Il avait été condamné à vingt ans de bagne pour avoir tenté de faire sauter un train dans lequel se trouvait le tsar, et s’il n’avait pas été pendu ou knouté, c’est que l’accusation n’avait pu établir les faits d’une manière suffisante.
Le capitaine Wilhelm Van Blook installa le prophète et ses disciples dans une grande cabine de l’entrepont et ne s’occupa plus d’eux, mais il retint à dîner à sa table le cosaque et les deux terroristes qui lui avaient paru les plus sociables de la bande. Le Hollandais, en leur faisant les honneurs de sa table, ne manqua pas de leur poser une foule de questions au sujet de leur évasion.
Lui-même ne savait rien, ou presque rien ; un matin, un inconnu était venu le voir de la part, disait-il, du comité terroriste de Lausanne, et lui avait expliqué qu’à son prochain voyage quatorze des caisses de dynamite dont il prendrait livraison renfermeraient des prisonniers évadés ; la somme offerte était assez considérable, et Wilhelm ne s’était fait aucun scrupule d’accepter ; bien au contraire, il considérait à juste titre comme une œuvre méritoire le fait d’arracher quelques malheureux aux tortures des bagnes sibériens.
Mais, ce qui le surprenait, c’était le choix même des prisonniers rendus à la liberté ; il s’était attendu à recevoir à son bord de sinistres et mystérieux conspirateurs, et c’étaient un vieux maniaque et une troupe de femmes, plus ou moins détraquées, que l’on arrachait à la captivité à si grands frais.
Serge Danicheff, le fabricant de bombes, ne put s’empêcher de sourire :
– Je vais, fit-il, en remplissant jusqu’au bord son verre de genièvre hollandais, vous donner l’explication de cette anomalie ; une évasion comme la nôtre coûte très cher.
– Dame, interrompit le capitaine, c’est qu’on court des risques ; chacun tient à sa vie et à sa liberté, et on n’aventure des biens aussi précieux que moyennant un bénéfice qui en vaille la peine.
– Je sais cela, parbleu ! Mais, si je dis que les évasions coûtent très cher, c’est pour vous expliquer qu’elles soient si rares. En Russie, avec de l’argent, on fait tout ce qu’on veut ; si les terroristes avaient à leur disposition des capitaux plus considérables, ils ne resteraient pas longtemps sous les verrous.
– Vous êtes donc un gros capitaliste ? demanda le capitaine.
– Pas du tout ; la personne qui a fait les frais de notre évasion est la vieille comtesse Alexandra Basileff, cousine du tsar, et riche à plusieurs millions de roubles. Cette vieille toquée, que la police laisse tranquille à cause de son illustre parenté, est une disciple fanatique du prophète Stépan Rominoff ; elle n’a reculé devant aucune dépense pour le sauver, lui et les femmes.
– Mais vous autres ?
– On nous a emmenés par-dessus le marché, parce qu’il fallait quelques hommes solides pour vider les caisses de dynamite et franchir les murailles du pénitencier. C’est pour cela qu’on nous a mis du complot ; ce n’est pas ces fainéantes et ces poltronnes et leur apôtre – qui, dans son genre, est aussi fainéant et aussi poltron – qui auraient eu le courage de faire ce que nous avons fait. Une fois que nous avons eu franchi les murs, et que nous avons eu trouvé le chemin de la gare, en pleine nuit, il a fallu fracturer la porte du hangar où se trouvait le wagon, ouvrir les caisses au péril de notre vie et aller jeter les cartouches de dynamite dans la rivière. Je vous assure que le prophète Rominoff ne faisait pas le fier, à ce moment-là !
– Je comprends cela, fit le capitaine, mais, une fois entrés chacun dans votre boîte, comment avez-vous fait pour rétablir le cachet impérial ?
– Nous avions pris nos précautions. Il y avait, parmi les employés de la gare, un terroriste qui avait pris à l’avance l’empreinte des cachets avec de la cire. En moins d’une heure tout a été terminé ; nous sommes arrivés juste à temps, la cire était encore chaude quand on a attelé notre wagon à votre train rapide.
– On n’a dû découvrir notre fuite que le matin, dit à son tour le cosaque Raponoff, et je suis bien certain qu’on n’a pas eu l’idée que nous avions pu prendre le train. On a dû perdre beaucoup de temps à battre la steppe et la forêt pour nous chercher.
– Allons, tout va bien ! dit gaiement le capitaine. Cela s’est mieux passé que je n’aurais osé l’espérer ! Je sais comment arranger la chose pour mon propre compte, une fois arrivé au Klondike. Je dirai qu’un commencement d’incendie m’a forcé de jeter à la mer un certain nombre de caisses : c’est un cas prévu dans mon traité avec l’entrepreneur des mines. À votre santé, messieurs les évadés !
On but une dernière rasade, puis tout le monde regagna sa cabine. Les Russes avaient le plus grand besoin de repos. Leur long séjour dans les caisses leur avait courbaturé tous les membres. Ils étaient aussi endoloris que s’ils venaient de recevoir le knout, ou tout au moins une volée de coups de bâton.
Le lendemain et les jours suivants, la Belle Dorothéa fut favorisée par un temps superbe ; laissant derrière elle l’empire du Soleil levant, elle fit route dans la direction du nord-est. Le capitaine Van Blook, pour lequel ce voyage représentait un bénéfice considérable, était d’une humeur charmante, et il se montrait plein d’attentions pour ses bizarres passagers.
Les Russes n’étaient pas moins satisfaits. Le prophète vitaliste et ses adeptes femelles se réjouissaient d’avance de la vie heureuse qu’ils allaient mener en Suisse, dans un beau parc appartenant à la comtesse Basileff et où ils pourraient vivre à l’état de nature, sans que personne songeât à les déranger ; le cosaque et les deux terroristes se proposaient de gagner Paris, où leurs camarades les révolutionnaires étaient en grand nombre et s’ingénieraient à leur dénicher quelque emploi.
Tous, en somme, se dédommageaient de la mauvaise nourriture et des fatigues du bagne en faisant quatre repas par jour et en dormant douze heures sur vingt-quatre.
Le brave cosaque Rapopoff faisait la joie des matelots par le goût déterminé dont il faisait preuve pour les alcools et les corps gras, sous quelque forme qu’ils se présentassent. À plusieurs reprises, on lui fit absorber de l’huile provenant des machines, sous prétexte que c’était un tonique souverain pour la poitrine, et il n’était pas de jour qu’il n’absorbât quelques petits verres d’alcool à brûler, qu’il déclarait excellent et qu’il dégustait en connaisseur.
Commencée de façon si favorable, la traversée s’annonçait comme une des plus heureuses et une des plus rapides que le capitaine Wilhelm Van Blook eût faites depuis longtemps. Six jours s’étaient écoulés ainsi sans qu’il se produisît d’incident digne de remarque.
Un soir, vers dix heures, le capitaine fumait tranquillement sa pipe à l’arrière, lorsque le matelot de vigie cria : « Terre, à bâbord ! »
Le capitaine eut un tel geste de surprise que sa pipe, une superbe pipe de kummer parfaitement culottée, s’échappa de ses lèvres et alla rouler sur le pont où elle se cassa en deux morceaux.
– Terre ? répétait-il. Il n’y a pas de terre dans ces parages-ci ! J’ai encore examiné une carte, il y a une heure. Cet homme est fou, ou bien il a trop bu de genièvre !
Le capitaine avait pris dans sa poche de côté une des ces fortes lunettes marines que l’on appelle lunettes de nuit, et il explorait l’horizon.
Au bout d’une minute, il fut bien forcé de reconnaître que l’homme de vigie n’était ni ivre ni dément. À deux ou trois milles, dans la direction du nord-nord-ouest, il voyait se profiler une terre aux promontoires escarpés. Il pensa d’abord qu’il se mouvait en face d’un vaste iceberg ; mais en continuant avec plus d’attention son examen, il distingua des lumières, et même, à ce qu’il lui sembla, des édifices.
Le capitaine n’en revenait pas. Il descendit à sa cabine où se trouvait la carte où il pointait chaque jour le chemin parcouru par le navire ; cette carte, bien que toute récente, ne portait aucune trace d’île ou de terre quelconque.
– Voilà qui est inouï, se dit-il très intrigué. Je n’ai pourtant commis aucune erreur de route ; le temps s’est maintenu au beau. Je n’y comprends absolument rien !…
Prudemment, il donna l’ordre au mécanicien de ralentir la vitesse et au timonier de gouverner de façon à côtoyer à grande distance la terre inconnue.
La Belle Dorothéa commença donc à contourner les rivages de cette terre mystérieuse ; mais d’assez loin pour éviter les bas-fonds et les écueils.
Bientôt, toutefois, en dépit de ces précautions, le vapeur alla donner de l’avant contre un roc caché sous l’eau, et le navire talonna à plusieurs reprises contre le récif avec un bruit sourd.
On fit machine en arrière ; étant donné la faible vitesse du navire et le peu d’agitation de la mer, la collision n’avait eu aucune conséquence, mais le capitaine n’était plus rassuré. Il comprenait que, pour une raison quelconque, il se trouvait dans des parages non reconnus par les ingénieurs hydrographes et inexactement portés sur les cartes. Il fallait donc agir avec la plus grande circonspection.
Il fit donc mettre à la mer une chaloupe ; deux matelots y descendirent ; ils devaient, la sonde en main, éclairer la marche du vapeur en s’assurant qu’il y avait assez de fond pour un navire de ce tonnage.
C’est dans ces conditions que l’on parcourut encore environ un demi-mille.
Mais, tout à coup, il se produisit une violente détonation, la chaloupe et le vapeur lui-même furent lancés en l’air, élevés au sommet d’une montagne d’eau.
Cramponné à un cordage, le capitaine Wilhelm avait eu le temps de voir la chaloupe réduite en mille pièces par l’explosion.
– Il n’y a qu’une torpille qui puisse faire cela, murmura-t-il, grelottant de peur à la pensée des caisses de dynamite qui se trouvaient dans sa cale.
Dans cette seconde rapide, il entrevit ce qui se serait passé si, au lieu de la chaloupe, c’était le vapeur lui-même qui eût heurté de son avant le détonateur de la torpille.
En cet instant, un choc terrible fit résonner la coque de fer de la Belle Dorothéa dans toutes ses membrures ; la montagne d’eau soulevée par l’explosion avait lancé le vapeur avec une inouïe brutalité sur un groupe de récifs où il demeurait maintenant immobile, légèrement penché sur le côté.
Wilhelm Van Blook essuya la sueur qui ruisselait de son front.
– Nous l’avons échappé belle ! murmura-t-il. C’est un vrai miracle que mon navire n’ait pas éclaté comme une simple fusée.
Cependant les Russes et les matelots se démenaient sur le pont. Les femmes et le patriarche poussaient des cris de terreur.
– Il y a une voie d’eau près de la quille, déclara Karl. Nous coulons. Il y a déjà deux pieds d’eau dans la cale !
– Non, dit le capitaine hollandais, le danger n’est pas si grand que tu crois ! Le vapeur est maintenu entre les rochers comme une pièce de bois entre les deux montants d’un étau, nous ne pouvons pas couler ! Et dans quelques heures, quand il fera jour, nous gagnerons la terre, qui n’est pas éloignée. Personne ne court aucun danger : seulement mon navire est perdu !
– Tenez, capitaine, s’écria tout à coup un des matelots, on dirait que l’on vient à notre secours !
Le bras étendu dans la direction de la terre, il montrait des lumières qui allaient et venaient sur le rivage. Tout à coup, un foyer électrique s’alluma et le triangle d’aveuglante clarté d’un projecteur oscilla quelque temps sur la mer jusqu’à ce qu’il eût rencontré l’endroit où était échoué le vapeur.
À cette clarté inattendue, on distinguait nettement des maisons, puis une foule d’hommes qui couraient en gesticulant sur le rivage.
– Je crois, dit le capitaine, que nous n’aurons même pas à attendre jusqu’à demain. On dirait que ces gens-là font des préparatifs pour venir à notre secours. Mais ce n’est pas une raison pour laisser la mer envahir la cale. Que Karl prenne avec lui deux ou trois hommes et qu’il tâche d’aveugler tant bien que mal les voies d’eau en clouant des toiles goudronnées et suiffées et en vissant, s’il y a moyen, une ou deux plaques de tôle.
Pendant qu’on exécutait ces ordres avec une hâte fébrile, Wilhelm Van Blook, demeuré tout pensif sur le pont, cherchait vainement comment pouvait s’appeler cette île qui ne se trouvait marquée sur aucune carte ; mais, tout en réfléchissant, il ne perdait pas de vue le rivage maintenant éclairé d’une vive lueur. Il vit des hommes, coiffés de vastes chapeaux de feutre, mettre à la mer une yole qui gouverna de manière à venir accoster le vapeur naufragé.
Six rameurs faisaient voler la légère embarcation sur les flots tranquilles, et, à mesure qu’elle approchait, les gens du vapeur remarquaient la tournure spéciale de ces rameurs qui portaient une sorte d’uniforme : chapeaux de feutre à larges bords, relevés sur le côté et décorés d’un insigne rouge, et solides vêtements de cuir noir ; seul celui qui tenait la barre était entièrement vêtu de rouge.
– On dirait des Boers ! fit le capitaine hollandais.
– Non, dit Karl, c’est plutôt l’uniforme de quelque milice canadienne.
– En tout cas, ils n’ont pas l’air d’avoir de mauvaises intentions.
– C’est ce que nous allons voir !
La yole, pendant ce temps, était venue se ranger le long du vapeur, l’homme rouge qui tenait la barre monta seul sur le pont. Il portait la barbe longue et ses traits un peu rudes exprimaient l’énergie et le sang-froid. Aussitôt à bord, il demanda le capitaine et, après l’avoir salué, s’informa des circonstances dans lesquelles avait eu lieu le naufrage.
Wilhelm Van Blook s’empressa de donner les explications nécessaires, en insistant sur la dangereuse présence à bord de caisses de dynamite, mais sans souffler mot des évadés russes. Il termina en demandant quel était le nom de l’île sur les côtes de laquelle ils venaient d’échouer, s’étonnant qu’elle ne figurât pas sur les cartes officielles.
L’homme rouge eut un imperceptible sourire.
– Capitaine, répondit-il, cette île s’appelle l’île Saint-Frédérik ; elle est marquée sur certaines cartes mais ses parages sont si peu fréquentés qu’elle a échappé, il est vrai, à l’attention de pas mal de géographes. Cette île, d’ailleurs, forme un petit État indépendant sous le protectorat des États-Unis d’Amérique.
« En cas de guerre avec le Japon, ce serait une station navale des plus utiles ; elle a été fortifiée par des ingénieurs américains, et, comme vous venez d’en faire l’expérience à vos dépens, elle est protégée par une ceinture de mines sous-marines et de torpilles dormantes.
– Dans ce cas, répliqua le capitaine avec mauvaise humeur, c’est l’administration de votre île qui est fautive. Les règlements maritimes internationaux veulent que, quand il existe des mines sous-marines de ce genre, leur présence soit signalée aux navigateurs par des balises ou des bouées très apparentes.
– C’est possible, mais comme l’île Saint-Frédérik ne se trouve sur la route d’aucun navire, nous n’avions pas jugé utile de prendre cette précaution.
– C’est un tort, et je suis en droit de vous faire un procès.
– Je vous conseille de vous en abstenir, reprit l’homme rouge avec un peu d’ironie, votre procès serait perdu d’avance ; mais je vous propose de vous aider à renflouer votre navire et je vous offre, chez nous, l’hospitalité la plus large et la plus cordiale.
– Nous pourrons nous entendre, à ce que je vois. Je vais profiter de votre offre immédiatement.
– Il serait très imprudent, en effet, à vous de passer même une seule nuit dans un navire chargé de matières détonantes, dont un coup de ressac peut déterminer l’explosion.
Cette conversation avait eu lieu en anglais, et les Russes n’y avaient à peu près rien compris. Ils avaient seulement deviné qu’on allait les conduire à terre et ils en étaient enchantés.
Le transport des naufragés commença immédiatement. Il ne fallut pas faire moins de cinq voyages pour mener à terre l’équipage et les passagers de la Belle Dorothéa.
Le capitaine Wilhelm allait monter le dernier dans la yole, lorsqu’il s’avisa, tout à coup, qu’il n’avait pas aperçu le cosaque Rapopoff ; il supposa que le malheureux avait été enlevé par l’énorme vague soulevée par la torpille et avait été noyé, mais il fallait s’en assurer. On chercha et on finit par trouver le pauvre diable dans sa cabine.
Au moment de l’explosion il avait été jeté hors de sa couchette, si malheureusement qu’il s’était brisé une jambe. On le transporta dans la yole avec toutes sortes de précautions.
– Ce ne sera rien, dit l’homme rouge qui avait repris sa place à la barre du gouvernail, nous avons dans l’île un savant de premier ordre, M. Bondonnat, qui se fera un véritable plaisir de le soigner et de le guérir.
Le capitaine Wilhelm se félicitait déjà d’avoir mis en sûreté son équipage et ses papiers, lorsqu’en levant les yeux il aperçut, à la clarté des globes électriques, un mât à signaux planté au sommet d’une colline. Au haut de ce mât se déployait un large pavillon qui portait, sur champ noir, une main couleur de sang ; ce drapeau, si semblable à celui des pirates et des écumeurs de mer, lui fit froncer le sourcil. Il se tourna vers l’homme rouge qui l’observait d’un air railleur.
– Quel est, lui demanda-t-il, le nom de l’État indépendant qui s’est installé dans cette île ?
– Capitaine, cette île que les géographes allemands appellent l’île Saint-Frédérik, nous l’appelons, nous, l’île des pendus, et elle est la propriété des Lords de la Main Rouge au nom desquels je vous fais prisonniers !
Le capitaine Van Blook jeta un regard autour de lui. De tous côtés il était entouré par des hommes armés. Toute résistance eût été inutile. Bien souvent, au Klondike, il avait entendu parler de cette association de la Main Rouge qui terrifiait toute l’Amérique. Il se demanda avec angoisse ce qui allait advenir de lui et de ses compagnons ; mais Wilhelm était courageux, il ne laissa rien deviner de ses impressions.
– C’est bon, dit-il froidement.
Et, s’adressant directement à l’homme rouge :
– Puis-je savoir quelle est votre qualité dans ce nouvel État ?
– J’exerce, au nom des Lords, les fonctions de gouverneur de l’île et de commandant de la garnison, et je me nomme Job Fancy !
Quelques instants plus tard, les naufragés, rangés deux par deux, étaient entraînés sous bonne escorte dans l’intérieur de l’île.
CHAPITRE II
Graves événements à l’île des
pendus
Le cosaque Rapopoff, à cause de sa blessure, avait été séparé du reste des naufragés. Il passa la nuit dans une petite cahute située près du rivage, où on lui installa un matelas de varech, et, le matin, deux hommes le placèrent sur un brancard et l’emportèrent jusqu’à une maison de bois protégée par un double rempart de palissades qui se trouvait à une certaine distance du lieu de l’atterrissement.
Des sentinelles, vêtues de cet étrange uniforme qui les faisait ressembler à des Boers, montaient la garde devant l’habitation.
On traversa une cour, puis une grande salle entourée d’armoires vitrées qui contenaient des flacons et des objets de métal brillant dont le cosaque ne put deviner l’usage ; enfin on déposa le blessé dans une petite chambre uniquement meublée d’un lit de fer, d’une table et d’une chaise. Elle prenait jour par une fenêtre munie de gros barreaux, d’où le cosaque inféra tout de suite qu’il ne s’était échappé d’une prison que pour entrer dans une autre.
On le laissa seul quelques instants, puis le commandant Job Fancy entra, suivi d’un vieillard à la physionomie pleine de bonté ; son front très haut était ombragé par une chevelure d’un blanc de neige et, quoique son visage fût empreint d’une profonde mélancolie, il y avait dans ses yeux clairs un charme souriant et ses traits, qu’encadraient de vastes favoris, blancs comme les cheveux, respiraient l’intelligence, la sérénité et la bonhomie.
Autant l’homme rouge, dont la face n’exprimait qu’une brutale énergie, était, d’instinct, antipathique à Rapopoff, autant il se sentit de confiance pour le vieillard qui s’avançait vers son lit, vêtu d’une longue blouse de laboratoire et portant sous le bras une trousse de chirurgien.
– Voilà le blessé dont je vous ai parlé, dit le commandant Job. Je suis certain, monsieur Bondonnat, qu’avec votre immense science ce sera pour vous la chose la plus facile du monde que de le remettre sur pied.
– Nous allons voir cela, dit le vieillard.
Et il se mit en devoir d’examiner la jambe blessée.
– Hum, fit-il au bout de cinq minutes, ce n’est pas très grave, une fracture simple du péroné. Nous allons tâcher de la réduire, mais il faudra me procurer des planchettes, du plâtre à modeler et tout ce qui est nécessaire pour poser un appareil.
– On va vous envoyer tout cela, cher maître, dit le commandant d’un ton respectueux ; je laisse donc ce brave moujik confié à vos soins. Il occupera cette chambre qu’habitait avant lui ce coquin de Peau-Rouge, qui nous faussa compagnie en même temps que lord Burydan.
À cette allusion, que M. Bondonnat comprenait parfaitement, le vieux savant soupira mélancoliquement. Le commandant Job s’était déjà retiré. Médecin et malade demeurèrent seuls.
M. Bondonnat demanda, d’abord en anglais, puis en français, au cosaque comment il se nommait et d’où il venait, mais Rapopoff à chaque nouvelle question secouait énergiquement la tête pour faire entendre qu’il ne comprenait pas.
– Suis-je assez étourdi, s’écria le savant, puisque c’est un cosaque, il doit parler russe, que diable !
M. Bondonnat était un remarquable polyglotte ; il lisait ou parlait couramment sept ou huit langues. Il réitéra donc sa question en russe et, cette fois, il eut la satisfaction de voir la physionomie de son malade s’éclairer d’un sourire. Une conversation s’engagea entre eux immédiatement.
Rapopoff raconta avec de minutieux détails toutes les circonstances de son évasion et du naufrage de la Belle Dorothéa.
– Écoutez, mon brave, lui dit M. Bondonnat, quand il eut terminé son récit. Il est tout à fait important que l’on ne sache pas ici que je connais le russe. Chaque fois qu’il y aura ici une autre personne, il faut faire mine de ne pas comprendre ce que je vous dirai.
– Mais pourquoi donc ? demanda le cosaque en ouvrant de grands yeux.
– Parce qu’ici vous êtes dans un repaire de bandits. L’île des pendus n’est habitée que par des meurtriers et des voleurs, et je suis, comme vous, leur prisonnier. Ils m’ont arraché à ma famille et à mes amis pour me voler mes découvertes, et, jusqu’ici, toutes mes tentatives d’évasion ont échoué.
M. Bondonnat raconta ses étranges aventures au cosaque, vers lequel il s’était senti tout de suite entraîné par une sympathie naturelle.
Au bout de huit jours, médecin et malade étaient les meilleurs amis du monde. Rapopoff, dont la jambe était en bonne voie de guérison, commençait à se lever et déjà rendait au vieux savant d’appréciables services en qualité d’aide de laboratoire.
À la grande surprise de M. Bondonnat, le commandant Job n’était plus revenu. C’étaient des bandits subalternes qui apportaient chaque jour la nourriture des deux prisonniers.
Jamais le commandant n’étant resté aussi longtemps sans venir au laboratoire, le vieux savant devina qu’il devait se passer, dans l’île, des événements graves.
Le cosaque semblait avoir été complètement oublié.
D’ailleurs, Rapopoff, avec cette espèce de fatalisme oriental qui fait le fond de l’âme russe, semblait se trouver très heureux de vivre en la compagnie du savant et ne se préoccupait nullement de l’avenir.
Laborieux, exact, docile, il se donnait beaucoup de mal pour se rendre utile dans le laboratoire ; seulement, M. Bondonnat crut remarquer que certaines substances disparaissaient à vue d’œil.
Un matin il eut la clé du mystère. Il trouva Rapopoff en train de déguster une tartine de pain noir enduite d’un corps jaune et brillant. À côté de lui était un flacon d’alcool à brûler.
– Que mangez-vous donc là ? demanda M. Bondonnat tout ébahi.
Rapopoff montra du doigt un bocal qui portait l’inscription « vaseline boriquée » et il ajouta, en se passant la main sur l’estomac avec un sourire de gourmandise :
– Bon, ça, la vaseline, pour petit déjeuner du matin !
M. Bondonnat ne put tenir son sérieux en face de cet appétit barbare.
– Mais, mon pauvre Rapopoff, lui dit-il, vous allez attraper une inflammation d’entrailles. Manger des tartines de vaseline et boire de l’alcool de lampe, il faut que vous ayez un estomac d’autruche, mon ami !
– Alors, c’est mal ce que j’ai fait ? demanda le cosaque consterné.
– Mais non ; moi, ça m’est égal. Seulement à force de goûter des substances que vous ne connaissez pas, vous finirez par vous empoisonner.
Rapopoff jura solennellement par la Vierge de Kazan et les apôtres Pierre et Paul de ne plus toucher à l’alcool et de ne plus manger de vaseline.
Le cosaque tint parole ; mais il se rattrapa sur l’huile de ricin, ce qui causa de grandes inquiétudes à M. Bondonnat, car Rapopoff, entraîné par sa gourmandise, se purgea de façon tellement énergique que le savant le crut un moment atteint du choléra. D’où nouvelle semonce et nouvelle interdiction.
À part ce léger défaut, commun à tous ses compatriotes, qui, de temps immémorial, ont eu un faible pour les chandelles et le trois-six, Rapopoff était le plus fidèle des serviteurs.
Un matin, M. Bondonnat, qui était descendu de bonne heure dans la cour du laboratoire, constata avec une profonde surprise que les sentinelles, qui montaient ordinairement la garde en dehors des palissades, étaient absentes ; c’était la première fois que les geôliers du vieux savant se relâchaient ainsi de leur vigilance. Il devait se passer quelque chose d’extraordinaire.
– Mon brave Rapopoff, dit M. Bondonnat au cosaque, tu vas sortir d’ici et te rendre jusqu’aux maisons que tu aperçois là-bas.
– Bien, petit père.
– Tu vas tâcher de savoir un peu ce qui se passe dans l’île ; essaye de trouver quelques-uns de tes compagnons et, si tu le peux sans éveiller l’attention de la Main Rouge, amène ici le capitaine. En tout cas, dis-lui mon nom et apprends-lui qui je suis ! Je trouverai peut-être moyen, grâce à lui, de faire parvenir une lettre à mes enfants et à mes amis de France.
– C’est entendu, petit père.
– Va, et sois promptement de retour. Je m’en rapporte à ton intelligence.
Rapopoff franchit l’enceinte des palissades, et, sans essayer de se cacher, se dirigea tranquillement vers les maisons, derrière lesquelles M. Bondonnat le perdit de vue.
Une demi-heure ne s’était pas écoulée que le cosaque revenait, la mine consternée.
– Petit père, fit-il, il est arrivé un grand malheur. Le bateau est parti.
– Tu veux parler du navire qui t’a amené ?
– Oui.
– Mais je croyais qu’il était à moitié démoli.
– Les gens de la Main Rouge l’ont réparé ; beaucoup d’entre eux ont quitté l’île avec le capitaine hollandais, et ils ont laissé ici le pauvre cosaque.
Rapopoff avait les larmes aux yeux.
– Ne te désole donc pas, lui dit M. Bondonnat ; cela t’ennuie donc bien de rester avec moi ?
– Petit père, ce n’est pas cela que j’ai voulu dire.
– D’ici peu, je l’espère, nous parviendrons à nous évader ; et je te promets de t’emmener avec moi en France.
Cette promesse sécha les larmes du cosaque qui rendit fidèlement compte de la mission dont on l’avait chargé ; il avait trouvé les habitations situées près de la baie presque entièrement abandonnées. Il n’y restait plus qu’un vieux tramp octogénaire qui lui avait appris le départ des Hollandais.
– Comment se nomme-t-il ? demanda M. Bondonnat.
– Je ne sais pas. Comme il ne parle pas le russe, c’est par signes, en me montrant l’endroit où le navire s’était échoué, qu’il m’a fait comprendre qu’ils étaient tous partis.
– C’est bien. Je vais moi-même aller voir ce vieillard. Si c’est celui que je crois, il me fournira tous les renseignements possibles.
Le savant endossa sa pelisse, se coiffa de sa toque de fourrure et, pour la première fois depuis qu’il habitait l’île des pendus, il s’aventura en dehors de la palissade. Rapopoff l’avait suivi.
M. Bondonnat, prisonnier depuis de longs mois, considérait avec une vive curiosité le paysage qui l’entourait. Devant lui se trouvaient un petit port où quelques canots étaient à l’ancre, et des maisons de bois de chétive apparence d’où partait une route bien empierrée qui s’enfonçait dans l’intérieur en contournant une colline couverte de bouleaux, de sorbiers et de saules d’un aspect chétif et rabougri.
À la porte d’une des maisons, un vieillard à cheveux blancs fumait paisiblement sa pipe, assis sur un escabeau ; il accourut joyeusement au-devant de M. Bondonnat, qui peu de temps auparavant l’avait guéri d’un accès de goutte.
Ce vieillard était le doyen des bandits de la Main Rouge. Il avait quatre-vingt-deux ans passés et, depuis sa plus tendre enfance, il n’avait cessé d’être en lutte avec la société. Il avait été pendu et lynché tant de fois qu’il ne s’en rappelait même plus le nombre exact.
Malgré tant de fatigues et d’aventures, il possédait encore une santé excellente, mangeant avec appétit et, comme il se plaisait à le répéter, trouvant encore que le whisky était une bonne chose.
Il salua respectueusement M. Bondonnat, qui lui demanda des nouvelles de sa santé.
– Je vous remercie. On est toujours solide au poste. Grâce à la bonté de Messieurs les Lords, je jouis d’une vieillesse heureuse et tranquille.
Il allait entamer un de ces longs récits dont il était coutumier, mais M. Bondonnat, impatient d’avoir des nouvelles, l’interrompit, en allant droit au fait :
– Est-il vrai, père Marlyn, que le navire hollandais soit parti ?
– Oui, monsieur, fit le vieillard en poussant un soupir. Ah ! il se passe ici de drôles de choses ! Je ne sais ce que vont dire les Lords de la Main Rouge lors de leur prochain voyage, mais je crains bien que tout cela ne vienne à se gâter !
– Qu’y a-t-il donc ? demanda le savant dont la curiosité était vivement excitée par ce préambule.
– Eh bien, la majeure partie de la garnison a pris la fuite avec les Hollandais, le capitaine Job Fancy en tête.
– Pas possible !
– C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire ! fit le vieux bandit en secouant la tête. Ce Job n’était pas décidément un homme aussi sérieux que ses prédécesseurs, Mr. Slugh, Mr. Sam Porter, auxquels les Lords ont donné de l’avancement. Il ne songeait qu’à boire et à organiser toutes sortes de complots.
M. Bondonnat écoutait de toutes ses oreilles. Il comprenait qu’il allait apprendre des choses de la plus haute importance.
– Oui, reprit le père Marlyn, ils sont pareils ! Vous savez qu’il y a ici une fabrique de bank-notes et de fausse monnaie ; chacun d’eux s’en est pourvu largement, et je crois qu’ils doivent gagner l’Alaska, où ils pensent pouvoir écouler leur marchandise chez les mineurs et les aventuriers de tous pays qui travaillent aux placers.
– Vous n’avez pas eu l’idée d’aller avec eux ?
– Ma foi, non. Je finirai mes jours ici. À mon âge on n’aime pas le changement. D’ailleurs, n’eût-ce pas été montrer la plus noire ingratitude envers les Lords qui ont eu tant de bonté pour moi ?
Ces révélations remplissaient de joie le cœur de M. Bondonnat. Il comprenait que, désormais, il ne serait plus surveillé aussi étroitement, et qu’une évasion deviendrait peut-être possible. Il continua de questionner le vieux tramp.
– Oui, reprit celui-ci, la conduite de Job et de ses hommes est honteuse ; non seulement ils se sont lesté les poches de faux dollars et de fausses bank-notes, mais encore ils ont tout pillé dans l’île avant de s’en aller. Ils ont emporté une quantité considérable de fourrures de phoque, de renard bleu et de plumes d’eider. De plus, ils ont dévalisé les caves, l’arsenal, et raflé tous les objets de valeur qui se trouvaient dans le logement particulier des Lords.
– Ce n’est pas très honnête, fit M. Bondonnat qui tenait à ne pas laisser tomber la conversation.
– C’est ignoble ! Mais cela ne leur portera pas chance. La Main Rouge saura bien les dénicher n’importe où qu’ils soient cachés, et alors, gare à eux ! La vengeance des lords sera terrible !
– En somme, combien reste-t-il à peu près d’hommes dans l’île ?
– Une soixantaine, sans compter les Esquimaux, bien entendu, et les femmes russes.
– Les femmes russes ne sont donc pas parties ?
– Non. Elles sont installées, avec leur prophète, dans une vallée de l’intérieur de l’île, et elles ont pris des amoureux parmi nos gens.
– Encore une question, fit M. Bondonnat, pourquoi vos camarades ne sont-ils pas tous partis avec le Hollandais ?
– C’est que les uns ont peur de désobéir aux Lords. Les autres sont des vétérans comme moi, qui ne demandent pas autre chose que de passer ici tranquillement leurs derniers jours. Puis il y en a qui espèrent que la Main Rouge leur donnera de grandes récompenses pour leur fidélité.
M. Bondonnat prit congé du vieux bandit et, toujours suivi de son fidèle cosaque, s’engagea dans le sentier qui se dirigeait vers l’intérieur.
Il n’avait pas fait une centaine de pas qu’un étrange personnage se dressa devant lui. C’était un homme d’un certain âge, dont les cheveux gris flottaient en désordre sur les épaules ; sa barbe lui descendait jusqu’au milieu de la poitrine, et, sauf une légère ceinture, il était complètement nu ; son nez camard était surmonté de solides besicles de cuivre, et il semblait humble et craintif.
M. Bondonnat se frotta les yeux pour voir s’il n’était pas le jouet de quelque hallucination ; mais le cosaque faisait déjà des signes au nouveau venu, qui lui répondait avec un amical sourire.
– C’est M. Rominoff, expliqua-t-il. Vous savez, le prophète dont je vous ai parlé.
– Ah ! fort bien ! Je suis enchanté de faire sa connaissance ! Il va sans doute nous apprendre, lui aussi, des choses intéressantes.
Le prophète s’était avancé. Rapopoff fit les présentations et, tout aussitôt, la conversation s’engagea en langue russe ; M. Bondonnat, le premier, exposa sa situation et raconta ses aventures ; puis il pria son interlocuteur de lui dire les siennes.
– Ah ! monsieur, dit tristement l’apôtre vitaliste, ce qui m’arrive est inimaginable. J’ai vraiment du malheur, et je suis heureux de rencontrer un homme comme vous, à qui je puisse confier mes peines. Ces bandits de la Main Rouge sont d’infâmes coquins !
– Je m’étonne que vous soyez resté parmi eux, au lieu de continuer votre voyage.
– Cela n’a pas été possible. Ces misérables se sont emparés des jeunes femmes que j’avais converties à ma doctrine, et se les sont appropriées ! Je dois dire, d’ailleurs, qu’elles ne se sont pas fait beaucoup tirer l’oreille pour devenir les compagnes de ces bandits.
– À votre place, je ne m’en serais plus occupé !
– C’est bien ce que je comptais faire ; mais ces drôles ont capturé ma respectable épouse, Mme Rominoff, et l’ont, comme ses compagnes, fait servir à l’assouvissement de leurs passions brutales ; je ne pouvais abandonner ma femme dans une pareille circonstance, je suis donc resté.
– Je vous plains très sincèrement, dit M. Bondonnat qui, malgré la gravité de cette confidence, avait peine à s’empêcher de rire.
– Vous ne connaissez pas toute l’étendue de mon malheur ! Ces misérables, au nombre de vingt-neuf, sont chacun, pendant dix jours, à tour de rôle, les époux d’une de mes élèves ; la seule faveur qu’ils m’aient accordée par amour de l’égalité, c’est de me compter comme trentième, de sorte que je passe dix jours par mois seulement en compagnie de ma malheureuse épouse.
Après avoir reçu le juste tribut de condoléances que M. Bondonnat accorda à sa lamentable situation, le Russe raconta comment les bandits avaient forcé le capitaine Wilhelm, le revolver sur la tempe, à les emmener dans son navire ; puis il ne résista pas au désir d’exposer à un savant aussi distingué que M. Bondonnat les grands traits de sa théorie vitaliste.
– Ce qui rend la vie de l’homme si courte, expliqua-t-il, et ce qui le rend lui-même si malheureux et si pervers, ce sont les raffinements maladifs qu’il a introduits dans sa manière de vivre. Je prêche, moi, le retour à la simplicité ; pas de vêtements inutiles et malsains, pas d’aliments épicés et indigestes, pas de feu, pas de maison, voilà le secret du vrai bonheur ! Ainsi, voyez, moi, je me porte comme un charme !
– Il me semble, objecta timidement M. Bondonnat, qu’il y a quelque exagération dans votre manière de voir.
– Nullement, répéta le prophète avec aigreur. L’homme nu devient d’une force et d’une beauté admirables, et la nature, comme elle le fait pour les autres animaux, ne tarde pas à recouvrir son corps d’un moelleux pelage naturel qui le défend contre la rigueur des saisons. Regardez, cette transformation a déjà commencé pour moi.
Et le prophète Rominoff montra, avec orgueil, sa poitrine velue que le capitaine Wilhelm Van Blook avait comparée au dessus d’une malle.
– De plus, continua-t-il avec véhémence, je couche toujours en plein air. Les maisons et les lits ne sont qu’une mauvaise habitude. J’ai vu, en Sibérie, des Kalmouks dormir dans la neige par un froid de dix degrés, et ils ne s’en portaient pas plus mal, bien au contraire !
« Je n’allume jamais de feu et je ne mange jamais d’aliments cuits. Mon ordinaire se compose de fruits et de racines et, en cas de nécessité, de viande et de poisson crus.
– Et, jusqu’ici, demanda le docteur, aucune de vos adeptes n’est morte de pleurésie, de grippe ou de fluxion de poitrine ?
– Nullement. Elles se portent à merveille, quoiqu’elles ne possèdent pas encore – mais cela ne tardera guère – l’épaisse fourrure dont la nature a doué tous les animaux des pays froids. Il est vrai que le climat de cette île est beaucoup plus tempéré qu’on ne pourrait le croire, étant donné sa latitude.
« Cela doit tenir à l’existence d’un courant marin très chaud venu des régions équatoriales.
« Je vous ferai visiter le vallon où habitent mes dix élèves et leurs vingt-neuf époux ; vous verrez qu’au point de vue de la végétation, aussi bien qu’à d’autres égards, c’est un vrai paradis terrestre.
– J’irai voir cela, oui, mais pas aujourd’hui, et, tenez, il me vient une idée, accompagnez-moi jusqu’à mon laboratoire.
– Pourquoi donc ?
– Je veux vous faire un cadeau. Vous vous êtes plaint tout à l’heure de l’insuffisance du système pileux chez vos adeptes. Je vais vous donner un élixir composé par moi et grâce auquel, en peu de jours, j’en réponds, vos charmantes élèves seront pourvues d’un vêtement naturel aussi chaud et aussi moelleux que celui que possède la chèvre du Tibet ou même l’ours blanc.
Le prophète Stépan Rominoff accepta cette offre avec une vive gratitude, et il quitta le laboratoire chargé d’une bonbonne remplie du précieux élixir capillogène découvert par M. Bondonnat.
Resté seul avec le cosaque, le vieux savant lui déclara qu’il allait profiter du relâchement de la surveillance et commencer le jour même à faire les préparatifs d’une évasion qui devait avoir les plus grandes chances de succès.
CHAPITRE III
Le musée secret
Dès lors, une existence toute nouvelle commença pour M. Bondonnat. Il ne revit aucun tramp en faction devant la porte de son laboratoire. On avait renoncé à le surveiller ; on le négligeait tellement qu’à plusieurs reprises on oublia de lui apporter à manger.
Le vieux savant dut se faire conduire, par le père Marlyn, jusqu’à l’endroit où se trouvait le nouveau commandant, un certain Mongommery, que M. Bondonnat avait eu aussi l’occasion de guérir d’un commencement de delirium tremens.
Mongommery était un personnage insouciant et aussi paresseux qu’il était ivrogne. Sa manière de voir se résumait dans une formule qui répondait à tout, et qu’il répétait cent fois dans le cours de la journée : ne compliquons pas les choses.
– Savez-vous, monsieur Bondonnat, dit-il au savant, que cela fait un grand dérangement d’aller vous porter à manger deux fois par jour !
– Je ne puis pourtant pas mourir de faim. Si je vous embarrasse, rendez-moi la liberté.
– Ça, c’est une autre affaire. Ne compliquons pas les choses. Le cosaque ira deux fois par jour chercher vos vivres à la cantine.
Et Mongommery ajouta, à la grande satisfaction de M. Bondonnat :
– Il y a des camarades qui auraient voulu que je vous boucle plus étroitement, mais à quoi bon ! Ça m’est bien égal que vous connaissiez l’île, puisque vous devez probablement y finir vos jours, et je ne serai pas si bête que mon prédécesseur, Sam Porter, qui avait laissé un aéroplane à votre disposition ! Il ne faut rien compliquer. Je suis bien sûr, moi, que vous ne vous évaderez pas d’ici.
M. Bondonnat se sépara du nouveau commandant, qui voulait à toute force lui faire boire un verre de whisky, dans des termes presque cordiaux ; le savant était enchanté d’avoir reconquis une liberté relative, et il en usa, ce jour-là et les suivants, en entreprenant, en compagnie de son fidèle Rapopoff, d’interminables promenades d’exploration dans l’intérieur de l’île.
Il fut surpris de voir que ce territoire, qu’il avait cru stérile, abondait en richesses de toutes sortes et qu’il était parfaitement outillé, fortifié et organisé.
Dans la région du nord qui comprenait une vaste baie parsemée d’îlots rocheux, se trouvait la colonie des phoques à fourrure, soignés par une centaine d’Esquimaux qui s’occupaient aussi de la pêche et de la préparation des peaux. Leurs cahutes de gazon formaient un pittoresque village au fond de la baie. M. Bondonnat avait soigné quelques-uns de ces pauvres sauvages, aussi l’accueillirent-ils avec enthousiasme.
Plus tard, il visita, au centre de l’île, un véritable village où se trouvaient les casernes des tramps, maintenant presque vides, l’arsenal, les magasins de vêtements, de vivres et de munitions ; il vit aussi, à peu de distance de son laboratoire, le luxueux cottage réservé aux Lords de la Main Rouge, quand ils séjournaient dans l’île.
Il n’y eut que la partie sud qu’il ne put traverser, car c’était là que se trouvait l’atelier des faussaires et les fabriques de bank-notes et de faux dollars ; enfin, il inspecta les batteries de canons dernier modèle installées sur les hauteurs et qui mettaient l’île en état de soutenir un long siège.
Mais ce qui le charma le plus, ce fut la campagne admirablement cultivée et coupée, çà et là, de bois de bouleaux, de sorbiers et de saules, les essences qui résistent le mieux au froid. Le gibier abondait, les rennes, les castors, les renards à fourrure et tous les oiseaux aquatiques pullulaient. Des ruisseaux d’eau vive, qui couraient à travers les prairies, étaient remplis de saumons et de truites. Grâce au bienfaisant courant d’eau chaude, cette île, que l’on eût cru désolée, eût pu passer pour un véritable éden.
Dans ses promenades, M. Bondonnat n’eut garde d’oublier le prophète Rominoff et ses adeptes, campés au grand air dans une clairière bien abritée du vent. Là, il reçut les félicitations de toutes les dames, qui le remercièrent de son élixir capillogène, dont elles commençaient à ressentir les bienfaisants effets.
C’est en quittant le prophète vitaliste que M. Bondonnat et Rapopoff atteignirent une région inculte et désolée, située tout à fait à l’ouest de l’île. Le sol tourmenté était hérissé de blocs de granit et couvert seulement, par endroits, d’un gazon rare.
À certaines places, il y avait des mares stagnantes, bordées de saules nains, où s’ébattait tout un monde d’oiseaux aquatiques, canards sauvages, vanneaux, pilets, sarcelles, pluviers. M. Bondonnat remarqua, même, quelques cygnes et quelques oies sauvages qui s’envolaient à grands battements d’ailes. Il était évident que cette région n’était que rarement visitée par les habitants de l’île, et il en comprit la raison en apercevant, sur un rocher, une main rouge grossièrement tracée avec de la peinture.
– Ce doit être, dit-il, un coin interdit aux bandits et que les Lords se sont réservé.
– Peut-être pour y chasser, petit père ? dit le cosaque.
– Je ne crois pas cela. Cette interdiction doit avoir une cause plus sérieuse, et nous allons tâcher de la deviner.
Ils dépassèrent le rocher sur lequel était peinte la main rouge, et ils s’engagèrent dans un vallon profondément raviné, bordé de falaises de roc où des eiders et des aigles de mer avaient installé leurs nids.
Au fond de ce vallon, il y avait un sentier bien tracé, sur lequel se remarquaient des empreintes de pas et de roues de voiture. Ils le suivirent pendant quelque temps. Ils s’aperçurent bientôt qu’il allait en se rétrécissant, se changeait en une sorte de défilé ou de ravin, que des rochers abrupts enserraient de toutes parts, ne laissant entre eux qu’un étroit passage.
Ils avancèrent encore, mais leur déception fut grande en trouvant le chemin barré par un bloc de granit que cinquante hommes eussent eu de la peine à remuer.
– Voilà qui est singulier, dit M. Bondonnat, ce sentier avait pourtant bien l’air de conduire quelque part.
– Le bloc est peut-être tombé à la suite d’un éboulement ? fit le cosaque.
– Cela ne se peut. On voit, à la couleur grise de la mousse, qu’il y a longtemps, des années peut-être, qu’il occupe la même place.
– Et, pourtant, petit père !… dit Rapopoff, regardez !…
Il montrait des traces de pas nettement coupées par le granit, comme si quelqu’un eût marché à la place où se trouvait maintenant l’énorme bloc.
– Il y a peut-être un passage secret dissimulé dans la pierre, dit le cosaque.
– Je ne le crois pas.
Rapopoff s’était approché du bloc comme s’il eût voulu le déplacer, mais autant aurait valu essayer de remuer une montagne.
– Je crois, dit M. Bondonnat, qu’il vaut mieux retourner sur nos pas !…
Mais, au moment même où il prononçait cette phrase, un dernier effort du cosaque fit virer la gigantesque masse. Le savant poussa une exclamation de surprise. Il lui paraissait impossible matériellement qu’avec ses seules forces Rapopoff eût pu obtenir un pareil résultat. Il eut bientôt l’explication de cette anomalie.
Pareil à ces pierres qui tournent, que l’on voit dans le pays de Galles et en Bretagne, le bloc de granit était en équilibre. Quand on le touchait à un certain endroit, le doigt d’un enfant eût suffit pour le déplacer, c’était cet endroit que la main du cosaque avait enfin trouvé.
En tournant, le bloc avait démasqué une ouverture ténébreuse.
– Entrons ! déclara hardiment M. Bondonnat.
– C’est cela, petit père, entrons !… répéta le fidèle cosaque.
Et, tout en parlant, il glissait quelques galets plats dans l’interstice du rocher, pour empêcher le bloc de reprendre, de lui-même, la place qu’il occupait.
Les deux explorateurs étaient, heureusement, pourvus d’une lampe électrique de poche. Ils l’allumèrent et s’enfoncèrent dans ce trou noir, qui ressemblait au soupirail d’une cave.
Mais ils avaient fait à peine une dizaine de pas dans l’étroit corridor, aux parois scintillantes de salpêtre, qu’ils débouchèrent dans une salle souterraine de forme ronde, entièrement emplie d’armoires vitrées disposées de façon concentrique.
Tout d’abord, ils ne virent pas bien ce que renfermaient ces armoires ; mais, quand ils s’en furent approchés, ils reculèrent avec un frisson de dégoût et d’horreur. Cette salle souterraine, dont le hasard leur avait livré le secret, était un véritable musée anatomique. Il y avait là des centaines d’organes, des corps entiers conservés en apparence dans toute leur fraîcheur par des procédés inconnus.
Immergés dans de vastes bocaux, d’après la méthode du docteur Carrel sans doute, encore perfectionnée, des cœurs palpitaient au milieu d’un liquide incolore, des poumons s’enflaient et se dégonflaient avec un bruit haletant, des masses d’entrailles bleues et vertes se tordaient, encore agitées des mouvements reptiliens qui accompagnent la digestion chez les êtres vivants.
Il y avait encore, dans une grande éprouvette de cristal, des fœtus vivants dont les vaisseaux ombilicaux étaient prolongés par des tubes de caoutchouc qui venaient aboutir à une étrange pompe de cristal, pleine de sang tiède.
Le premier mouvement de stupeur passé, M. Bondonnat se trouva puissamment intéressé par cette effarante collection. Jamais il n’avait vu d’aussi admirables pièces anatomiques.
Il constata là le résultat de découvertes encore complètement inconnues de la science officielle, et il se demanda, tout pensif, quel était le grand savant qui, capable d’opérer d’aussi prodigieuses trouvailles, était en même temps un chef de bandits. Il s’expliquait maintenant qu’on l’eût enlevé, lui, savant, dans le seul but de s’approprier ses découvertes.
– Il fallait, en somme, pensait-il, que ces bandits fussent parfaitement au courant de mes travaux. Mais quel dommage qu’un pareil homme préside à une tourbe d’assassins et n’agisse pas franchement, en travaillant au grand jour !
Plongé dans ses réflexions, M. Bondonnat continuait à examiner les pièces anatomiques. Il était arrivé à une partie de la salle où se trouvaient debout, dans leur cercueil de cristal, des corps admirablement embaumés. La peau avait conservé son coloris, et les membres leurs dimensions exactes ; les visages, aux lèvres rouges, n’étaient ni ternis ni décomposés. On eût dit que tous ces êtres humains vivaient encore d’une vie mystérieuse et n’attendaient qu’un ordre du maître pour quitter leur immobilité pensive.
Rapopoff, pendant tout cet examen, donnait les signes de la plus vive terreur ; ses dents claquaient, et il regardait M. Bondonnat d’un air suppliant, comme pour l’adjurer de sortir au plus vite de cet antre diabolique.
Tout à coup, il se rejeta en arrière, avec un véritable hurlement.
– Petit père ! petit père ! s’écria-t-il, il est là !…
Il montrait du doigt une vitrine dans laquelle M. Bondonnat, stupéfié d’épouvante à son tour, aperçut son exacte ressemblance, son double, un autre Bondonnat en chair et en os, qui, admirablement embaumé, semblait le contempler avec un sourire tranquille.
– Ça, par exemple, s’écria le vieux savant, c’est trop fort ! Je me demande comment l’on a pu truquer un sujet de façon à obtenir une si effarante similitude !
M. Bondonnat et le cosaque demeurèrent cinq bonnes minutes dans un silence profond, littéralement idiotisés de stupeur ; mais brusquement le vieillard se frappa le front avec un cri de triomphe :’
– Le voilà ! s’écria-t-il, le moyen d’évasion sûr, remarquable et pratique !
– Que voulez-vous dire, petit père ?
– Tu verras ! Mais il va faire nuit dans une heure ; nous ne partirons d’ici que quand l’obscurité sera complète.
– J’aimerais mieux m’en aller, protesta Rapopoff avec énergie.
– Non, tu vas me comprendre. Quand nous nous en irons, nous emporterons avec nous l’autre, le Bondonnat que tu vois là dans la vitrine !
Ce ne fut pas sans peine que le cosaque se laissa persuader. Mais enfin, à force d’arguments et de démonstrations, il finit par céder.
Quand tous deux quittèrent le musée anatomique souterrain, dont ils eurent soin de refermer la porte de roc, Rapopoff portait sur ses épaules un lourd fardeau, enveloppé d’une toile grise.
*
* *
Deux jours plus tard, le doyen des tramps, le père Marlyn, entra, comme il le faisait quelquefois, dans le laboratoire, pour prendre des nouvelles de M. Bondonnat.
Trouvant toutes les portes grandes ouvertes, il traversa successivement la salle d’expériences et la bibliothèque, et arriva ainsi à la chambre du savant, mais il s’arrêta sur le seuil, stupéfait et consterné.
M. Bondonnat était mort, et son cadavre, jeté en travers du lit défait, pendait lamentablement la tête en bas.
Le père Marlyn appela :
– Rapopoff, au secours !
Et comme Rapopoff ne venait pas, le vieux tramp se mit, mais vainement, à sa recherche. Le cosaque avait disparu.
Très remué par ce qu’il venait de voir, et même sincèrement affligé – car le vieillard, comme tous les gens de l’île, adorait M. Bondonnat –, le père Marlyn s’empressa d’aller avertir le commandant Mongommery.
Celui-ci sortit de son apathie habituelle et se rendit en hâte au laboratoire pour procéder lui-même à une enquête ; et le premier résultat de ses investigations fut de découvrir, à l’angle de la tempe du cadavre, une blessure assez profonde.
Il était encore occupé de ses macabres investigations lorsqu’un Esquimau, qui le cherchait depuis une heure, vint lui annoncer que deux des meilleurs pêcheurs de la baie avaient disparu la nuit précédente, en emmenant avec eux la plus grande des embarcations.
Personne ne les avait vus partir ; mais il était hors de doute qu’ils s’en étaient allés sans esprit de retour, car ils avaient emporté leurs blouses en peau de phoque, ornées de verroteries, leurs colliers de dents de morse et tout ce qu’ils avaient de plus précieux dans leur case.
Cette révélation fut un trait de lumière pour le commandant Mongommery. Avec une perspicacité dont il s’étonnait lui-même, il venait de reconstruire d’un seul coup le drame dans son cahier.
– Je vois ce qui s’est passé comme si j’y avais assisté, déclarait-il aux tramps qui l’entouraient, c’est le cosaque qui a tué ce pauvre vieux pour le voler, sans nul doute. Et il a dû décider les Esquimaux à l’accompagner dans sa fuite.
– C’est dommage, dit le père Marlyn, qu’on ne puisse tordre le cou à ce gueux de Rapopoff.
– Bah ! fit Mongommery, à quoi bon ? Il doit être loin à l’heure qu’il est. Nous ne savons pas quelle direction il a prise, d’ailleurs, et je ne voudrais pas aventurer une de nos embarcations dans une pareille poursuite.
L’hypothèse de Mongommery se trouva vérifiée par une autre circonstance. On constata qu’un petit meuble, où M. Bondonnat avait serré une liasse de bank-notes que les Lords de la Main Rouge – bien malgré lui, d’ailleurs – lui avaient remises dans un précédent voyage, avait été fracturé et que les bank-notes avaient disparu.
Mongommery était assez embarrassé. Pour son début dans les fonctions de gouverneur, c’était là une désagréable histoire ; mais il ne pouvait laisser passer un tel fait sans en avertir les Lords de la Main Rouge.
Grâce à l’appareil de télégraphie sans fil installé au centre de l’île, il expédia aussitôt une dépêche chiffrée et, une heure après, il en recevait la réponse. Elle était ainsi conçue :
Les Lords de la Main Rouge sont très mécontents de votre négligence, au sujet de laquelle ils se réservent de faire une enquête. Les coupables seront sévèrement punis. En attendant, redoublez de vigilance. Tenez-vous sur le qui-vive. L’île peut être attaquée d’un moment à l’autre.
Mongommery fit la grimace à la lecture de ce message. L’assassinat du vieux savant le plaçait dans une position singulièrement fausse. En effet, lors du départ de Job Fancy, il avait été convenu que les Lords de la Main Rouge ne seraient prévenus de cette désertion que lorsque les fugitifs auraient eu le temps de se mettre en sûreté.
Mongommery avait fidèlement tenu parole ; mais il s’apercevait un peu tard que, faute d’avoir dit la vérité, c’était lui qui allait être rendu responsable non seulement de la mort du vieux savant, mais encore de l’évasion du commandant Job.
Il regagna son logis, furieux, se demandant comment il sortirait de cette ornière ; et, dans sa préoccupation, il oublia même de donner les ordres nécessaires pour qu’on procédât à l’inhumation du vieux savant.
CHAPITRE IV
Phantasmes
La dépêche des Lords de la Main Rouge avait jeté Mongommery dans une grande inquiétude et l’avait arraché à son apathie habituelle ; le lendemain de la découverte du crime et le jour suivant, il déploya une véritable activité.
Les tramps, qui, depuis quelque temps, se laissaient vivre en véritables rentiers et avaient mis de côté toute discipline, furent de nouveau obligés de monter la garde dans toutes les parties de l’île où une surprise était à craindre.
Mongommery plaça des sentinelles dans tous les endroits menacés, et il se levait la nuit pour faire des rondes et s’assurer que tout le monde était bien à son poste ; les canons placés sur les hauteurs furent visités et chargés ; enfin, on s’assura que les torpilles étaient à leur place et qu’aucune d’elles n’avait été entraînée par les courants.
Dans la nuit du troisième jour, le commandant Mongommery eut un rêve. Il se voyait entouré d’une foule hurlante et, comme cela lui était arrivé déjà une fois ou deux dans le cours de son existence, garrotté et entraîné du côté d’un arbre aux branches duquel se balançait une corde ornée d’un nœud coulant de sinistre augure.
On lui montrait le poing, on le bousculait, et, finalement, quelques personnes zélées lui passaient la corde au cou, pendant que d’autres tiraient de toutes leurs forces sur la corde pour hisser le patient dans les airs.
Le commandant se réveilla en sursaut, très effrayé, et porta précipitamment la main à son cou, où il sentait encore la constriction causée par la corde.
Il sourit de ses terreurs, en reconnaissant que la sensation pénible qui l’affectait était due à sa cravate qu’il avait trop serrée. Il reconnut du même coup que, sans doute à la suite d’une absorption de whisky un peu excessive, il était couché tout habillé sur son lit.
Il fut longtemps à se remettre de cette alarme et, constatant qu’il n’avait plus sommeil, il pensa que ce qu’il avait de mieux à faire, c’était de se lever et d’aller faire une ronde de vigilance sur les côtes de l’île.
En un clin d’œil il fut sur pied et, prenant avec lui un tramp nommé Moller, qui lui servait habituellement de garde du corps, il se mit en route, non sans avoir vérifié l’état des deux revolvers qui ne le quittaient jamais.
La nuit était obscure. De grands nuages noirs fuyaient sous un ciel sans étoiles et sans lune et, dans le grand silence, on n’entendait que le bruit monotone du ressac sur les brisants.
Les deux bandits étaient arrivés à peu de distance du laboratoire qu’avait occupé M. Bondonnat, lorsque Mongommery s’arrêta net.
– Dis donc, Moller, fit-il à son compagnon, n’as-tu rien vu, toi ?
– Non, répondit l’autre.
– Je ne sais si c’est un éblouissement, mais j’ai cru apercevoir tout à l’heure une grande lueur dans la direction du large !…
– C’est peut-être un éclair !
– Mais non, le temps n’est pas orageux !
Tous deux demeurèrent quelque temps anxieux et immobiles, essayant de percer l’opacité des ténèbres.
Mais, tout à coup, un même cri s’échappa de leurs poitrines, et ils demeurèrent cloués au sol, hébétés de stupeur par une extraordinaire vision.
Une main de feu, une gigantesque « Main Rouge » venait d’apparaître à l’horizon, sur le fond sombre des nuages, et cette main portait au poignet une chaîne dont les derniers anneaux semblaient se perdre dans la mer.
– Qu’est-ce que c’est que cela ! bégaya Moller, plus mort que vif.
– Je n’en sais rien, répondit Mongommery sur le même ton.
– Allons-nous-en ! J’ai la tremblote ! je ne veux pas rester ici une minute de plus !
– Non, murmura Mongommery avec effort, restons ! Il faut voir !
Malgré lui, ses yeux demeuraient attachés invinciblement à cette main sanglante et gigantesque qui barrait tout le fond du ciel.
Il se demandait avec inquiétude quel était ce terrifiant météore, quand le bruit d’une longue explosion déchira l’air.
– Ça, au moins, grommela Moller, je sais ce que c’est ! C’est une de nos torpilles qui saute !
Mongommery ne put lui répondre. Une seconde, une troisième, une quatrième détonation éclatant presque simultanément faisaient un vacarme assourdissant. On eût dit une salve de coups de canon ; puis les explosions se multiplièrent à l’infini, retentissant, de seconde en seconde, dans un grondement majestueux répercuté par tous les échos.
C’était la double rangée de torpilles dormantes, qui protégeaient les abords du rivage, que des ennemis mystérieux de la Main Rouge étaient en train de détruire. De hautes colonnes d’eau écumante jaillissaient vers le ciel, et l’île était entourée comme d’une ceinture de geysers.
– Je ne sais pas ce que tout cela veut dire, fit Mongommery d’une voix basse et tremblante, mais nous sommes flambés !
Quand la dernière torpille eut détoné et que tout fut rentré dans le silence, la main de feu, dont le reflet sanglant illuminait tout le fond du ciel, s’abaissa vers la mer et disparut.
Cependant, les habitants de l’île, plongés quelques moments dans la consternation et dans la stupeur, en présence de ces phénomènes surnaturels, se mettaient en état d’organiser la résistance contre les ennemis encore invisibles ; de toutes parts, des coups de feu éclataient, des cloches d’alarme tintaient, et les fanaux électriques brusquement allumés… des escouades de tramps accourant au pas de gymnastique, la carabine sur l’épaule et le revolver à la ceinture.
Mais la disparition de la symbolique main rouge dans les flots avait été le signal d’un autre genre de phantasme.
Le ciel se peuplait maintenant de centaines, de milliers de figures diaboliques et hideuses, qui semblaient se balancer sur les nuages en ricanant ; des pendus, des hommes sans tête exécutaient des rondes infernales, en compagnie de monstres aux yeux flamboyants et aux figures d’animaux. Tous ces fantômes s’ébattaient dans une atmosphère phosphorescente pareille à du feu liquide et qui éclairait tout l’horizon comme un immense incendie.
C’est seulement alors que Mongommery aperçut, à une encablure à peine du rivage, un navire qui s’avançait à toute vapeur et qui, lui aussi, semblait entouré d’une éblouissante auréole de clarté. Sa coque, ses agrès et ses mâts étaient dessinés en traits de flamme et, dans les haubans, se jouaient des monstres pareils à ceux qu’on apercevait dans le ciel. Ces êtres étranges glissaient le long des cordages, sautillaient de vergue en vergue, comme si les lois de la pesanteur n’eussent pas existé pour eux.
Moller, qui, en sa qualité d’Irlandais, était superstitieux, sentait ses cheveux se hérisser sur sa tête. Ses dents claquaient, et il se voyait déjà empoigné par les griffes de tous les êtres de cauchemar qui semblaient prêts à s’abattre sur l’île.
– Nous sommes perdus ! s’écria-t-il. Je savais bien, moi, que tout cela finirait mal ! Les Lords de la Main Rouge ont fait un pacte avec le diable !… Et, maintenant, le moment est arrivé où nous allons tous être emportés, et l’île avec nous, dans le fin fond de l’enfer !…
– Imbécile, s’écria Mongommery à qui l’excès même de sa terreur avait rendu le courage, quand même ce serait le diable, je m’en moque et je défendrai l’île tant qu’il me restera une goutte de sang dans les veines !… Je ne crois pas aux diableries, moi ! Allons, oust ! ce n’est pas le moment de rester à pleurnicher !
– Que faut-il faire ?
– Cours vivement jusqu’à la batterie qui domine la baie. Prends avec toi le nombre d’hommes nécessaire, et entame le feu contre ce navire du diable ! Nous allons voir ce qu’ils vont dire quand les shrapnells commenceront à pleuvoir sur leur peau !…
Moller partit à toutes jambes.
Le commandant Mongommery, maintenant entouré d’une vingtaine de tramps, s’empressa d’envoyer également des hommes à la batterie située sur la falaise ; puis, il réunit deux escouades de ses meilleurs tireurs qui allèrent s’embusquer derrière un groupe de rochers qui commandait l’entrée de la baie.
– Camarades, dit-il à ses hommes, j’espère que vous ferez votre devoir. Nous avons des armes et des munitions en abondance ; l’ennemi n’est pas de taille à lutter contre nous ! Que chacun se batte courageusement ! Vous savez que les Lords de la Main Rouge ne se montrent pas avares lorsqu’il s’agit de récompenser les braves !
Ce petit discours, débité d’ailleurs sans conviction, n’eut pas l’effet que Mongommery en attendait ; les tramps étaient démoralisés d’avance, persuadés qu’ils avaient à combattre des êtres surnaturels.
Il n’eut pas le temps de se livrer à de longues réflexions : déjà la bataille s’engageait. La batterie de la falaise et celle de la baie en donnèrent le signal presque en même temps, en tirant à toute volée ; mais Mongommery constata avec désespoir que le diabolique navire ennemi se trouvait maintenant trop près du rivage pour pouvoir être atteint par les canons de la Main Rouge dont les projectiles allaient se perdre dans la haute mer. Tout ce qu’il put faire, ce fut de commander à la troupe embusquée à l’entrée de la baie une fusillade nourrie.
– Est-ce que ce serait un navire de l’État ? se demandait-il anxieusement, tout en se démenant pour donner des ordres. Et, pourtant, non. Si c’était cela, les passagers ne se livreraient pas à de pareilles diableries !
À ce moment, les flancs du navire ennemi se couronnèrent d’un triple éclair. Un tramp, placé à deux pas de Mongommery, eut la tête emportée par un boulet ; un obus avait éclaté au milieu même de la troupe embusquée derrière les rocs. Ce fut une débandade générale.
En même temps, les figures monstrueuses, dans les nuages, grandissaient démesurément, allongeant leurs pattes griffues comme si elles eussent voulu dévorer l’île et ses habitants.
Cette fantasmagorie effrayante ne fit qu’accroître la panique des fuyards. Ce fut un sauve-qui-peut général ; les canons du fantastique navire continuaient à tirer sans relâche. Une bombe au pétrole était tombée sur le toit de la caserne des tramps et le bâtiment, construit en bois résineux, avait pris feu. Il brûlait maintenant avec une grande flamme livide toute droite dans le ciel calme.
Mongommery, éperdu mais non découragé, avait rallié ses hommes dans le petit bois qui dominait la baie. Mais, à ce moment, deux grandes chaloupes que la fumée avait empêché d’apercevoir vinrent atterrir et débarquèrent une soixantaine d’hommes armés de fusils à répétition dont les baïonnettes aiguës luisaient à la clarté des lampes électriques.
Le chef de cette troupe, coiffé d’un casque d’argent, n’avait d’autre arme que son épée. Un léger manteau d’azur, brodé d’or, flottait sur ses épaules. À ses côtés, un chien de forte taille, dont le corps était protégé par une cotte de mailles et qui portait un collier de fer aux pointes acérées, poussait des aboiements furieux comme s’il eût été impatient lui-même d’engager le combat corps à corps.
Tout auprès, un petit bossu à la mine martiale tenait en main un clairon et n’attendait que le signal du chef pour sonner la charge.
Du petit bois où il concentrait ses hommes, Mongommery vit la compagnie de débarquement se ranger en bataille pour s’apprêter à tenter l’assaut des hauteurs.
Mongommery constata avec une certaine émotion que tous les vieux tramps, les vétérans de la Main Rouge, étaient réunis autour de lui : pas un seul ne manquait à l’appel. Le père Marlyn, l’octogénaire, le doyen des bandits ; le vieux Jackson, agité d’un tremblement nerveux depuis qu’il avait été électrocuté ; le superstitieux Moller, dont le cou était demeuré de travers depuis qu’il avait été pendu au Canada ; Berwai, amputé d’un bras après avoir été grillé au pétrole par des lyncheurs, tous étaient là, impassibles, prêts à donner leur vie, sans phrases, pour la Main Rouge, qui était leur seule patrie et leur seule famille.
Ils s’étaient formés en carré, n’espérant pas la victoire, mais décidés à vendre chèrement leur vie. Les autres tramps, plus jeunes, électrisés par un si noble exemple, étaient remplis d’enthousiasme.
– Rien n’est encore perdu, déclara Mongommery d’une voix vibrante, nous avons l’avantage de la position ; que tout le monde se couche à plat ventre dans les buissons et se tienne prêt à tirer à mon commandement !
Des cris terribles s’élevèrent alors dans l’épaisseur du bois : c’étaient les Esquimaux de l’établissement de pêche qui, devenus à peu près fous à la vue des apparitions, s’enfuyaient en hurlant et cherchaient quelque caverne où se cacher.
– Je connais le chef des ennemis, dit rapidement le père Marlyn à l’oreille de Mongommery, c’est ce lord Burydan qui s’est évadé en compagnie d’un Peau-Rouge, que j’aperçois d’ailleurs, lui aussi, parmi nos ennemis !…
– Tant mieux ! Cela prouve deux choses qui doivent nous rassurer. D’abord, c’est que nous n’avons pas affaire à un navire de l’État et, aussi, que toutes ces fantasmagories n’ont rien de surnaturel…
Il n’acheva pas sa phrase. Sa voix fut couverte par le tintamarre des clairons et des tambours ; puis, au milieu d’un profond silence, la voix de lord Burydan commanda :
– Feu à répétition ! En avant, à la baïonnette !
Le crépitement de la fusillade domina, en cet instant, tous les autres bruits, même la voix des canons du bord qui continuaient à lancer des bombes au pétrole et des shrapnells sur les points les plus éloignés de l’île ; une trombe de balles faucha les branchages du petit bois où se tenaient embusqués les tramps.
Mais, comme ils étaient couchés à plat ventre, pas un d’eux ne fut atteint et pas un d’eux ne bougea.
Maintenant, le clairon sonnait la charge, et les soldats de lord Burydan gravissaient, au pas accéléré, la pente escarpée de la colline.
Ils avaient franchi à peu près la moitié de la distance, lorsque, à son tour, Mongommery commanda le feu.
Une avalanche de balles balaya le sentier, fauchant les soldats de Burydan qui battirent en retraite en désordre.
– Courage ! criait Mongommery. La victoire est à nous ! Nous les exterminerons jusqu’au dernier ! Mais surtout ne quittez pas vos abris ! Laissons-les essayer d’une seconde attaque.
Lord Burydan, en effet, ne tarda pas à rallier ses hommes.
– Cette fois, leur dit-il, ne nous laissons pas arrêter par le feu de l’ennemi. Il faut atteindre, coûte que coûte, le sommet de la hauteur et débusquer les tramps de leur position.
Deux fois l’attaque fut renouvelée sans succès. Lord Burydan avait été blessé à l’épaule. Le petit bossu continuait à sonner de son clairon tordu par les balles.
Enfin, à la troisième attaque, une douzaine d’étranges combattants, que Mongommery prit pour des singes, décidèrent de la victoire. Simplement armés d’une hache d’abordage, ils franchissaient d’un seul bond un espace de plusieurs mètres ; ils semblaient passer invulnérables à travers la pluie des projectiles.
Arrivés les premiers sur la hauteur, ils tombèrent comme des furieux sur les vétérans de la Main Rouge et en firent un carnage épouvantable.
Oscar Tournesol, le clairon bossu, qui avait suivi de près ses amis sur le champ de bataille, se conduisit, lui aussi, héroïquement, communiquant à tous l’enthousiaste bravoure dont il était animé.
– Bravo, Romulus ! criait-il, bravo, Robertson !… Tape dessus, mon vieux Makoko ! Un homme pour Goliath !
Ce Goliath était une espèce de géant qui, dédaignant de se servir d’une autre arme, assommait les tramps avec son poing. Sous ses coups, on les voyait tomber comme des bœufs à l’abattoir, la cervelle broyée, un jet de sang aux narines.
Silencieux et rapide, le Peau-Rouge Kloum, armé d’un sabre bien affilé, faisait voler autour de lui les têtes des ennemis avec une dextérité et une vigueur surprenantes.
Bientôt la victoire de lord Burydan fut complète. Seul Mongommery, entouré d’une douzaine de vétérans, se battait encore comme un lion et refusait de se rendre. À ses côtés, le père Marlyn déchargeait méthodiquement son revolver, tout en poussant de temps en temps de sa voix fêlée, des cris de : « Vive la Main Rouge ! Vivent les Lords ! »
Astor Burydan fut touché de tant de bravoure.
– Rendez-vous, dit-il à Mongommery.
– Jamais ! répliqua celui-ci.
Mais au même moment, il tombait, assommé sous le formidable poing du géant Goliath. Cernés de tous côtés, les vétérans furent désarmés, garrottés et confiés à la garde des clowns Makoko et Kambo.
La victoire de lord Burydan était complète, éclatante, définitive.
Il voulut lui-même abattre de ses propres mains l’étendard de la Main Rouge qui flottait en haut d’un mât élevé au point culminant de l’île des pendus.
CHAPITRE V
Une ronde de nuit
Les canaux électriques de l’île et les projecteurs du yacht l’Ariel, toujours ancré dans la baie, éclairaient le champ de bataille couvert de morts et de blessés. Lord Astor Burydan s’était assis, pour se reposer un instant, sur un banc de gazon, et, à ses côtés, se tenaient le Peau-Rouge Kloum et le petit bossu Oscar Tournesol ; tous trois étaient couverts de sang et de poussière, haletant de sueur. Un des marins de l’équipage leur apporta un bidon rempli de café froid, dont ils burent quelques gorgées avec délice.
Lord Burydan était radieux, malgré sa fatigue.
– Voilà, s’écria-t-il, ce qui s’appelle une vraie bataille. Si j’avais souvent des journées comme celle-ci, je crois que le spleen, ou, pour être plus moderne, la neurasthénie qui me tourmente, aurait vite fait de disparaître.
Lord Burydan fut interrompu par des aboiements furieux. C’était le chien Pistolet qui, après avoir vaillamment combattu pour sa part, arrivait à toute vitesse, toujours revêtu de sa cuirasse et de son collier à pointes de fer.
Oscar flatta l’animal ; mais Pistolet continuait à aboyer avec fureur.
– Il veut peut-être, fit lord Burydan, que nous le débarrassions de son harnachement de guerre.
– Non, dit Kloum sentencieusement.
– Non ! s’écria à son tour le petit bossu. Pistolet nous montre notre devoir. Il nous fait comprendre, à sa façon, que nous n’avons même pas le droit de prendre une minute de repos avant d’avoir délivré M. Bondonnat.
– C’est juste ! dit lord Burydan en se levant impétueusement. Courons vite au laboratoire ; dans le désarroi qu’a causé notre venue, il est probable que les sentinelles qui le gardent habituellement ont pris la fuite.
– Il faut tout prévoir, répliqua le bossu. Emmenons avec nous quatre hommes solides et bien armés !
D’un geste, il fit signe à l’hercule Goliath, à l’homme-projectile Romulus et aux frères Robertson de les accompagner.
Le laboratoire n’était distant du petit bois que d’un quart d’heure de marche, la petite troupe y arriva bientôt ; comme l’avait prévu lord Burydan, il n’y avait aucune sentinelle dans le chemin de ronde, et les portes extérieures étaient grandes ouvertes.
– M. Bondonnat, dit Oscar, a peut-être profité de la bataille pour prendre le large.
– Nous allons voir, fit lord Burydan, qui tout de suite avait trouvé le commutateur électrique.
Une vive lumière brilla. Le laboratoire apparut tout en désordre ; le plancher n’avait pas été balayé et portait de nombreuses traces de pas. Les bocaux et les vitrines étaient recouverts de poussière.
– On dirait, fit lord Burydan avec inquiétude, que le laboratoire a été abandonné depuis longtemps. Si M. Bondonnat était encore ici, il serait déjà venu à notre rencontre.
– Cherchons, fit Kloum.
Le Peau-Rouge, parfaitement au courant des aîtres, ouvrit la porte des pièces adjacentes qui avaient servi d’habitation au savant et où il avait logé lui-même pendant sa captivité.
Mais, arrivé à la porte de la chambre de M. Bondonnat, il s’arrêta net et, avec un geste de désolation et d’épouvante, il montra le cadavre du savant gisant en travers du lit.
– Ils l’ont tué, murmura-t-il avec une profonde tristesse, nous sommes arrivés trop tard !
Lord Burydan et Oscar échangèrent un regard navré. Ainsi donc, tout le courage, toute l’ingéniosité, toute la science déployés au cours de l’expédition n’avaient servi de rien. Les bandits de la Main Rouge avaient lâchement assassiné le vieillard après l’avoir dépouillé de ses découvertes ! Ils demeuraient silencieux et consternés.
– Croyez-vous, demanda lord Burydan avec agitation, qu’il y ait longtemps que les bandits ont assassiné M. Bondonnat ?
Oscar, qui s’occupait précisément à remettre sur le lit le corps à demi tombé, poussa une exclamation :
– Oui ! s’écria-t-il, il y a longtemps qu’ils l’ont tué !
– Qui vous fait dire cela ?
– M. Bondonnat a été embaumé !
– C’est incroyable !
Lord Burydan dut se rendre à l’évidence. Le corps du vénérable savant exhalait un parfum puissamment balsamique ; il était hors de doute qu’il n’eût été soumis à un procédé de conservation extrêmement savant, puisqu’il laissait aux chairs toute leur souplesse et au visage toute son expression et tout son coloris.
Tous trois s’étaient agenouillés près du corps de leur ami et le contemplaient en silence.
Pistolet, lui, aboyait à la mort, et, chose singulière, loin de lécher les mains de son maître défunt, comme beaucoup de chiens eussent fait en pareil cas, il tournait autour du laboratoire et des chambres avec de sourds aboiements de menace. Puis, tout à coup, il s’élança au-dehors et disparut.
– Le chagrin a rendu ce pauvre chien absolument fou, dit Oscar. Il n’a plus pour ainsi dire sa tête à lui.
– Ne nous en occupons pas ! s’écria lord Burydan. Nous devons, avant toutes choses, rendre honneur à la dépouille mortelle du grand savant que fut M. Bondonnat en la mettant à l’abri de toute profanation. Quatre hommes monteront la garde près du corps nuit et jour, jusqu’à ce que le charpentier du bord ait confectionné un cercueil de chêne, car je pense que Mlle Frédérique tiendra à ce que les restes de son père reposent en terre de France.
Sur l’ordre du lord, Goliath et ses trois compagnons demeurèrent dans le laboratoire.
Lord Burydan se retira, avec Oscar et Kloum, pour prendre les dispositions exigées par la situation. Tous trois étaient profondément soucieux. En prononçant le nom de Frédérique, l’excentrique avait réveillé leurs inquiétudes.
– Il est pourtant singulier, dit Oscar, que la Revanche ne se soit pas trouvée au rendez-vous assigné, et surtout que nos amis n’aient pas répondu aux nombreux marconigrammes que nous avons lancés.
– Je n’y comprends rien, répondit lord Burydan dont le front s’était rembruni. Il est vrai, ajouta-t-il, que ce retard peut s’expliquer d’une façon toute naturelle. Il suffit, par exemple, qu’ils aient eu une avarie à leurs machines, ou, qui sait ? que la présence d’un yacht de la Main Rouge les ait forcés à fuir beaucoup plus au sud.
– Mais, ce yacht, nous l’aurions rencontré ?
– C’est juste !
– Tout cela ne nous donne pas la raison qui les a empêchés de répondre à nos messages.
– Je suis, comme vous, très inquiet. Aussi, dès demain, l’Ariel va reprendre la mer et croisera dans les parages de l’île ; puis – ce que nous avons peut-être eu tort de ne pas faire jusqu’ici – nous enverrons un message à Chicago, à Fred Jorgell, pour le mettre au courant de la situation.
– Funèbre et inutile victoire que la nôtre ! soupira le petit bossu.
Tous trois continuèrent à cheminer silencieusement dans la direction du champ de bataille ; mais pendant leur absence, l’équipage de l’Ariel n’était pas demeuré inactif.
Une tente avait été dressée dans une clairière et munie de couchettes de paille, sur lesquelles étaient déposés les morts et les blessés ; les tramps valides, soigneusement garrottés, étaient conduits dans une des habitations situées près de la baie.
Au milieu de cette scène de désolation, la gentille écuyère, miss Régine Bombridge, vêtue de la simple blouse de grosse toile des infirmières, se multipliait pour secourir les blessés, partageant ses soins sans distinction entre les tramps et les marins de l’équipage.
Toute la tristesse d’Oscar s’évanouit à la vue de la jeune fille.
– Mademoiselle, lui dit-il en lui serrant la main avec effusion, vous êtes admirable !
– Il faut bien, murmura-t-elle en rougissant, que je me rende utile à quelque chose.
– Voulez-vous que je vous aide ?
– Bien volontiers… Mais quelle épouvantable chose que la guerre !…
– Lord Burydan, répliqua Oscar, pourra, grâce à son immense fortune, atténuer en partie les désastres causés par cette bataille ! Il a promis de pensionner largement les veuves et les mères des marins tués, aussi bien que les blessés. Personne n’aura à se plaindre de lui, à cet égard.
Lord Burydan, lui-même, s’approchait en ce moment.
– Tous mes compliments, mademoiselle, dit-il courtoisement. Mais avez-vous besoin d’Oscar ?
– Oui, répondit la jeune fille. Je sais qu’il s’entend très bien à faire les pansements.
– En ce cas, je ne veux pas vous en priver, fit le lord en souriant.
– Où vouliez-vous donc m’emmener ? demanda le bossu.
– Oh ! tout simplement faire une ronde avec une vingtaine d’hommes pour inspecter l’intérieur de l’île et mettre la main sur ceux des bandits qui ont pu nous échapper.
– Si vous croyez qu’il soit utile que je vous accompagne ?
– Nullement. Vous êtes fort bien avec miss Régine, restez-y. Je prendrai avec moi les deux clowns Makoko et Kambo, le prestidigitateur Matalobos, le jongleur chinois et quelques matelots.
Peu de temps après, la petite troupe, forte d’une vingtaine d’hommes, se mettait en route munie de lanternes électriques à l’aide desquelles les moindres recoins étaient soigneusement explorés ; cette précaution n’était pas inutile, et on ne tarda pas à s’en apercevoir, car c’est grâce aux fanaux électriques que l’on put capturer une dizaine de tramps qui, les uns blessés, les autres pris de panique, avaient cherché un refuge dans les bois et dans les cultures.
La petite troupe était arrivée au centre de l’île, dans une clairière abritée contre les vents du large et qui renfermait d’assez beaux arbres, lorsque Makoko et Kambo, les deux clowns qui marchaient à l’avant-garde, crurent apercevoir des ombres suspectes juchées dans les branches. Ils se replièrent immédiatement vers le centre de la colonne et les fanaux électriques furent immédiatement dirigés du côté indiqué par les deux clowns.
À la stupeur générale, on aperçut alors une douzaine d’êtres velus, assez pareils à des orangs-outangs, qui, grimpés dans les branches, poussaient des cris d’épouvante en baragouinant un langage incompréhensible et en faisant de grands gestes suppliants.
– Serions-nous tombés, dit Kambo en riant, au milieu d’une succursale du Gorill-Club ?
– Voilà qui serait amusant. Mais ce ne sont pas des singes. Ces êtres bizarres ont de longs cheveux flottants sur les épaules. On dirait plutôt des femmes à fourrure.
– Nous sommes peut-être, déclara lord Burydan, sur la trace d’une découverte scientifique de la plus haute importance. Il faut à tout prix capturer vivant un de ces animaux velus.
– Je tire assez bien, dit Kambo, je vais essayer de blesser un de ces monstres avec ma carabine.
Il allait mettre ce projet à exécution et tenait déjà en joue le plus beau des prétendus singes lorsqu’un être, plus velu et plus barbu à lui seul que tous les autres – sans doute le patriarche de la bande –, se précipita vers lord Burydan en agitant un haillon de mouchoir blanc en signe de paix.
Lord Burydan, qui croyait avoir affaire à quelque sauvage d’une espèce nouvelle, lui fit comprendre par signes qu’il n’avait rien à craindre, et les autres animaux velus, également rassurés par cette pantomime pacifique, descendirent de leur perchoir aérien.
Lord Burydan et ses amis eurent bientôt l’explication de ce mystère.
– Je suis Stépan Rominoff, prophète du vitalisme mystique, déclara le patriarche à la longue barbe.
Comme presque tous les Russes d’une certaine éducation, il parlait très bien le français, et il avait eu tout à coup l’idée de s’exprimer en cette langue que par bonheur lord Burydan, qui avait fait un long séjour à Paris, comprenait parfaitement.
Tout d’une traite, il raconta ses aventures et celles des dix femmes qu’il avait converties à sa doctrine, et il expliqua que c’était M. Bondonnat lui-même qui lui avait fait cadeau d’un élixir pilogène d’une énergie telle que toutes celles qui en avaient fait usage avaient été en peu de temps couvertes d’une véritable toison au milieu de laquelle la bouche et les yeux demeuraient à peine visibles.
Le prophète s’applaudissait, d’ailleurs, de ce résultat, qu’il se proposait d’expérimenter en grand sur des milliers de personnes dès qu’il serait de retour dans les pays civilisés. Il voyait déjà, dans un avenir proche, une humanité plus vigoureuse et pour toujours débarrassée des tailleurs, des chemisiers et même des bonnetiers.
Après s’être diverti quelque temps de ce singulier maniaque, lord Burydan lui assura qu’il n’avait rien à craindre et qu’au contraire, les tramps étant réduits à l’impuissance, il serait heureux de le rapatrier, ainsi que ses compagnes.
Il prit ensuite congé des Russes. Mais il avait obtenu d’eux certains renseignements intéressants. Rominoff lui avait raconté l’exode d’une partie des tramps sur le navire hollandais où s’étaient embarqués également les deux nihilistes ; il connut aussi tous les détails de l’assassinat de M. Bondonnat par le cosaque Rapopoff, ce qui disposa l’excentrique à plus de mansuétude envers les tramps, desquels il avait résolu tout d’abord de tirer une vengeance exemplaire-.
La nuit tirait à sa fin, et l’aube pâle semblait se dégager péniblement des brumes quand on atteignit le village des Esquimaux. Là, l’Indien Kloum retrouva le chien Pistolet, qui continuait à aboyer lamentablement en errant sur le rivage comme une âme en peine. À force de caresses et de bonnes paroles, il finit par le calmer.
Grâce à un tramp qui parlait un peu leur langue, lord Burydan fit comprendre à ces pauvres gens, dont la plupart étaient revenus au gîte après avoir erré dans toute l’île, qu’ils n’auraient rien à craindre de lui et qu’il les prenait sous sa protection.
Ce dernier coin de l’île des pendus une fois visité, lord Burydan croyait en avoir fini avec les fatigues de la nuit.
– Je vais, dit-il aux deux membres du Gorill-Club qui l’avaient accompagné, me reposer quelques heures. Je crois que vous et moi l’avons bien mérité. Nous n’avons pas entièrement visité la partie nord de l’île, c’est une chose que nous ferons cet après-midi. Les quelques ennemis qui peuvent rester encore en liberté ne sont pas à craindre.
On reprit donc le chemin du yacht. Mais, tout à coup, lord Burydan vit accourir au-devant de lui Oscar Tournesol, qui paraissait dans un état d’agitation extraordinaire.
– Que se passe-t-il donc ? demanda le lord avec impatience.
– Grave nouvelle ! répliqua le petit bossu. Nous savons où est la Revanche ! Je viens de recevoir un message grâce à l’appareil de télégraphie sans fil installé dans l’île.
– Voilà une grande inquiétude de moins ! s’écria l’excentrique. Maintenant, nous voilà rassurés sur le sort de nos amis !
– Ne vous hâtez pas de vous réjouir, murmura tristement le jeune homme. La Revanche est tombée entre les mains des bandits de la Main Rouge !…
Lord Burydan était devenu pâle.
– Mais, balbutia-t-il, savez-vous si Mlles Andrée et Frédérique sont en sûreté, ainsi que leurs fiancés et mon brave Agénor ?
– Tous sont prisonniers. Et le yacht fait en ce moment-ci voile vers l’île. Tenez, voici le texte même du marconigramme que je viens d’enregistrer. Quand vous l’aurez lu, vous serez renseigné aussi bien que moi.
Il tendait au lord un bout de papier où il avait crayonné en hâte les phrases que voici :
Suis maître du yacht la Revanche, malgré révolte à bord. Serai ici dans quelques heures avec prisonniers français. Que cinquante hommes en armes soient prêts à m’assister au moment du débarquement.
CAPITAINE SLUGH
– Que faut-il répondre ? demanda le bossu lorsque Burydan eut terminé la lecture.
– Ceci seulement, dit ce dernier, après un instant de réflexion :
Venez. Tout est prêt pour vous recevoir.
Le bossu repartit en courant dans la direction du poste de télégraphie sans fil, pendant que lord Burydan remontait à bord de l’Ariel et faisait lever l’ancre immédiatement.
Il était urgent que les bandits qui s’étaient emparés de la Revanche ne s’aperçussent pas qu’il y avait un autre navire dans l’île ; le yacht alla donc prendre position derrière la falaise située à l’est, où il était impossible de l’apercevoir en venant dans la direction de la baie.
En même temps, il ordonna que le pavillon de la Main Rouge fût hissé de nouveau au mât qui dominait l’île.
D’autres dispositions furent encore prises. Tous les hommes valides, acrobates et marins, revêtirent les costumes enlevés aux tramps et se coiffèrent des chapeaux à larges bords, ornés d’une main rouge : ainsi déguisés, ils étaient méconnaissables.
On s’occupa aussi de faire disparaître les traces du combat, de façon à ce que le signataire de la dépêche n’aperçût rien de suspect lorsqu’il arriverait en vue de l’île.
Toutes ces précautions prises, et les hommes s’étant placés aux postes que leur avait assignés lord Burydan, on attendit.
Il était près de midi quand la vigie, placée au point le plus élevé de l’île, signala, dans la direction de l’est, un navire de fort tonnage ; le pavillon noir, orné d’une main rouge, se déployait majestueusement à sa corne d’artimon.
Quand le navire fut en vue de la baie, il tira une salve de treize coups de canon, à laquelle les batteries de l’île répondirent coup pour coup.
CHAPITRE VI
La « Revanche »
Mlle Andrée de Maubreuil, son amie Frédérique, leurs fiancés l’ingénieur Paganot, le naturaliste Ravenel et le poète Agénor, faits prisonniers par Slugh à la suite de l’incendie allumé par celui-ci, ne pouvaient sortir des cabines qui leur avaient été assignées.
Sans l’intervention de la danseuse Dorypha, la gitane, il est hors de doute qu’ils eussent été tous massacrés, mais elle avait pris courageusement leur défense, puissamment secondée en cela par son amant, le Belge Pierre Gilkin, et les partisans de ce dernier.
Les Français, réunis dans la même cabine, se confiaient mutuellement l’inquiétude à laquelle ils étaient en proie. Ils avaient entendu les coups de canon tirés par ordre de Slugh. Ils voyaient de loin la côte se préciser de minute en minute à leurs regards ; ils se demandaient anxieusement quel allait être leur sort.
Allait-on, ainsi que l’avait vaguement promis Slugh au Flamand Gilkin, déposer les prisonniers à terre et les laisser libres d’aller où bon leur semblerait ?
Ils se l’étaient figuré un instant ; mais, quand ils avaient vu qu’en face de cette terre inconnue Slugh arborait fièrement le pavillon noir à la main sanglante, qu’ils avaient vu les habitants répondre à la salve de coups de canon de la Revanche par une autre salve, ils étaient devenus mortellement anxieux.
C’est à ce moment que Dorypha fit irruption dans la cabine, le visage bouleversé et les cheveux épars.
– Nous sommes perdus ! s’écria-t-elle. Ce misérable Slugh nous a menés à l’île des pendus. C’est le pavillon de la Main Rouge que je viens de voir flotter au-dessus de cette terre maudite !
Le silence de la consternation accueillit ces paroles.
– Il ne nous reste, dit l’ingénieur, en échangeant avec Roger Ravenel un coup d’œil de désespoir, qu’à vendre notre vie le plus chèrement possible !
– Je vous en supplie, mon cher Roger, s’écria Frédérique, tuez-moi plutôt que de me laisser tomber vivante entre les mains de ces bandits !
– Oui, tuez-nous, murmura mélancoliquement Andrée de Maubreuil.
La gitane tira de son corsage une lunette marine qu’elle avait subtilisée dans la cabine de Slugh, et, la tendant à Agénor :
– Regardez, dit-elle, rendez-vous compte par vous-même de la vérité.
Le poète approcha l’instrument de ses yeux et le mit au point. Mais il avait à peine eu le temps de jeter un regard sur la côte qu’il poussa un cri de joie et de triomphe.
– Nous sommes sauvés ! balbutia-t-il éperdu, savez-vous qui je viens d’apercevoir, admirablement déguisé en tramp ? Je vous le donne en mille !
– Ne nous faites pas languir ! s’écria Frédérique.
– Mon excellent ami, lord Burydan lui-même !
– Ce qui signifie ? demanda la gitane, tout étonnée de ce brusque revirement.
– Que l’île des pendus est maintenant au pouvoir de nos amis ! Mais pas un mot de ce que je viens de vous dire ! Si Slugh se doutait d’une pareille chose, il serait capable de nous massacrer tous !
– J’ai toutes les raisons possibles d’être discrète, mais j’espère que vous n’oublierez pas ce que mon brave ami Pierre Gilkin a fait pour vous !
– Soyez tranquille ! Mais ne dites rien à personne, même à Pierre Gilkin ; seulement, faites en sorte que lui et les siens, dans leur propre intérêt, se séparent de nous le moins possible !
Quelques minutes plus tard, Slugh en personne pénétrait dans la cabine des Français. Il avait l’air à la fois ironique et menaçant.
– Maintenant, dit-il brutalement, la plaisanterie a assez duré. Vous allez obéir à mes ordres, et cela sans faire la moindre observation ! À présent, messieurs et mesdames, vous êtes sur les domaines de la Main Rouge, et là, vos protecteurs ne vous serviront de rien ! Allons, dépêchons-nous de monter sur le pont, tous !
Il ajouta avec un rire goguenard :
– Vous vouliez aller à terre, eh bien, soit ! Je vais vous y faire descendre ! Je suis un homme de parole, moi !
À la grande surprise du bandit, aucun des prisonniers ne fit la moindre observation. Tous montèrent sur le pont et, de là, descendirent dans la grande chaloupe où se tenaient déjà sept ou huit tramps.
Dorypha avait pris place à côté d’eux. Pierre Gilkin et les plus dévoués de ses partisans l’y rejoignirent. Slugh ne fit rien pour les en empêcher. Il se disait qu’une fois à terre tous seraient absolument à sa merci. Dorypha avait eu le temps de dire quelques mots à l’oreille du Belge, qui, très calme, attendait silencieusement les événements.
Slugh, qui s’était embarqué le dernier et avait pris place à la barre, demeurait silencieux lui aussi. Mais son visage exprimait un triomphe insolent.
La chaloupe vint se ranger contre le quai, et ceux qui y avaient pris place débarquèrent dans l’ordre suivant :
D’abord, un groupe composé des partisans de Slugh, puis les prisonniers, enfin Dorypha, Gilkin et leurs amis.
Slugh fermait la marche.
Les hommes de lord Burydan, rangés à droite et à gauche, formaient la haie, la carabine sur l’épaule et le revolver à la ceinture.
Slugh les dévisagea d’un regard perçant et, ne reconnaissant pas les barbes touffues qui faisaient pour ainsi dire partie de l’uniforme des tramps, le rusé bandit eut un vague soupçon.
Sous prétexte d’amarrer la chaloupe à un anneau, il demeura un peu en arrière du groupe.
Bien lui en prit. Ses compagnons avaient à peine fait quelques pas qu’ils se trouvèrent entourés, cernés et désarmés.
Les partisans de Pierre Gilkin allaient subir le même sort si Paganot n’était intervenu. Les bandits, solidement garrottés, furent jetés à terre aux pieds des deux jeunes filles, tellement émues de ce coup de théâtre qu’elles demeuraient sans parole.
Slugh, lui, en avait assez vu. D’un regard il avait jugé la situation. Tout d’un coup, il se jeta à la mer, plongea et se mit à nager vigoureusement.
– Tirez donc ! ordonna l’ingénieur, c’est un des chefs de la Main Rouge. Il faut le prendre mort ou vif !…
Slugh, excellent nageur, avait plongé de nouveau pour reparaître dix mètres plus loin. Quelques balles sifflèrent à son oreille. Mais on finit par le perdre de vue.
Avec sa rapidité de décision habituelle, il avait compris qu’il eût été imprudent pour lui de revenir à bord de la Revanche, qui, ancrée sous le feu des canons de l’île, ne pouvait songer à regagner le large.
Après avoir nagé pendant un quart d’heure entre les récifs, il prit terre dans une baie isolée, et, se cachant le long des buissons comme un lièvre poursuivi par les chasseurs, il s’enfonça dans l’intérieur de l’île, qu’il connaissait admirablement, et atteignit bientôt le musée souterrain où se trouvait l’étrange collection de pièces anatomiques, visitée auparavant par M. Bondonnat.
Après avoir constaté que personne ne l’avait suivi, il fit jouer la pierre de l’entrée et s’introduisit dans la caverne.
Deux hommes, les seuls avec lui à connaître les secrets de cette retraite, l’y attendaient déjà : c’étaient Julian et Johnie, les deux graveurs en faux billets, dont l’un, on le sait, ressemblait trait pour trait au docteur Cornélius, tandis que le second offrait la physionomie exacte de Fritz Kramm.
La pierre une fois remise en place, ils l’assujettirent inférieurement avec une lourde barre de fer. Ils étaient sûrs désormais que personne n’irait les chercher dans cette cachette.
*
* *
Pendant ce temps, lord Burydan et Oscar s’étaient jetés dans les bras de leurs amis. L’excentrique commença par prévenir discrètement l’ingénieur Paganot de la mort de M. Bondonnat, et le jeune homme et son ami Ravenel attirèrent à l’écart les deux jeunes filles pour les préparer doucement à la terrible nouvelle.
En même temps, lord Burydan racontait à Agénor les péripéties de la prise de l’île. Il lui expliquait comment, par un procédé très employé par les agences de publicité américaines, il avait cinématographiquement projeté, en se servant des nuages en guise d’écran, les apparitions qui avaient tant épouvanté les tramps. Les gambades des clowns dans la mâture et la peinture phosphorescente dont le yacht avait été enduit avaient complété l’effet de cette mise en scène fantasmagorique. Enfin, c’était le clown nageur qui avait, au péril de sa vie, fait exploser les torpilles.
Une heure après, les bandits qui occupaient la Revanche, démoralisés par la perte de leur chef, se rendirent à discrétion.
La Main Rouge était vaincue, battue pour ainsi dire avec ses propres armes. Les Français allaient donc pouvoir infliger aux bandits un sévère châtiment, récompenser, comme ils le méritaient, Dorypha et ses amis, enfin accorder un juste tribut de larmes à la mémoire du malheureux savant assassiné par les bandits.
TREIZIÈME ÉPISODE
La fleur du sommeil
CHAPITRE PREMIER
Le voleur invisible
Les quais du petit port de Basan présentaient ce matin-là une vive animation. Des coolies japonais, tagals, chinois et malais s’occupaient activement à décharger une grande jonque à la poupe dorée, aux voiles de bambou tressé, dont la cargaison se composait de porcelaines venues de la grande île de Nippon, de nids d’hirondelles récoltés dans les cavernes de Sumatra, d’holothuries, de confiture de gingembre, de pousses de bambou confites dans du vinaigre et d’autres aliments exclusivement asiatiques.
L’arrivée de la jonque, qui mettait en émoi tous les négociants de la petite ville, n’était pas la seule cause qui excitât la curiosité des badauds.
Peu de temps après la jonque, une grande barque de pêche était entrée dans le port. Elle était montée par quatre hommes : deux Esquimaux, un cosaque – ou un Kalmouk, au type tartare très accusé –, enfin, un Européen, que l’on supposait être anglais ou français, et dont la physionomie, encadrée par de longs cheveux d’un blanc de neige et de larges favoris, exprimait la douceur et l’intelligence.
Ce vieillard – sans nul doute le propriétaire de l’embarcation – était luxueusement vêtu d’une pelisse doublée de renard bleu et coiffé d’une toque de la même fourrure. Il avait avec lui de nombreux bagages, que ses trois serviteurs se hâtèrent de tirer hors de la barque et de déposer sur le quai.
Ils avaient à peine terminé lorsque le gouverneur du port – un Japonais nommé Noghi – s’avança, au milieu d’une grande affluence de curieux, pour demander des explications à l’étranger.
M. Noghi, prétentieusement vêtu d’un complet à carreaux de fabrication américaine, parlait très couramment l’anglais. C’est dans cette langue que la conversation s’engagea.
Le nouvel arrivant, d’ailleurs, lui fournit immédiatement les explications les plus satisfaisantes.
Il se nommait Prosper Bondonnat. C’était un savant français connu dans le monde entier par ses travaux sur la météorologie et aussi sur la botanique et la médecine.
Il déclara qu’en se rendant de San Francisco à Vancouver il avait été victime d’un naufrage, dont il n’avait pu sauver que ses papiers les plus précieux, quelques appareils de physique et une certaine somme d’argent.
À la demande du Japonais, M. Bondonnat exhiba diverses pièces qui ne laissaient aucun doute sur son identité.
Une fois fixé sur ce point, le gouverneur se mit obligeamment à la disposition du vieux savant pour tous les renseignements dont il pouvait avoir besoin.
– L’île de Basan, expliqua-t-il, est celle des possessions japonaises qui est située le plus au sud. Complètement isolée dans le Pacifique, elle se trouve à des centaines de lieues de toute terre habitée, entre les Philippines et le groupe des îles Hawaii.
– Voilà qui est regrettable, dit M. Bondonnat. Comme vous devez le supposer, mon plus vif désir serait de rentrer en France aussitôt que possible.
– Vous n’aurez pas trop longtemps à attendre. Dans trois semaines, vous pourrez prendre le paquebot américain qui fait le service régulier entre Shanghai et San Francisco.
– Voilà qui me rassure un peu. Je vais immédiatement télégraphier à mes enfants, qui doivent être très inquiets à mon sujet.
Le Japonais eut un sourire ambigu qui découvrit ses dents pointues et releva l’angle de ses sourcils obliques.
– Malheureusement, fit-il, l’île de Basan n’est pas encore reliée au Japon par un câble électrique.
– Tant pis ! murmura le savant dont la physionomie exprima un vif désappointement. Puisqu’il en est ainsi, monsieur le gouverneur, je compte sur votre obligeance pour m’indiquer les moyens de me loger confortablement.
– Pour cela, rien de plus facile. Il y a précisément à louer, dans la banlieue de notre petite capitale, plusieurs villas toutes meublées et entourées de beaux jardins.
– Je ne regarderai pas au prix, pourvu que l’habitation soit convenable ; car je ne vous cacherai pas qu’après les émotions d’un naufrage, plusieurs nuits passées en pleine mer, j’ai besoin de me reposer : je ne suis plus jeune, hélas !
– Vous verrez que vous serez très bien. Et cette villégiature forcée vous permettra de visiter notre pays qui, très peu connu certainement en Europe, mérite, par beaucoup de points, d’attirer l’attention d’un savant tel que vous. La faune et la flore sont très variées et n’ont guère été, jusqu’ici, beaucoup étudiées. Enfin, vous trouverez partout de pittoresques points de vue et, dans l’intérieur, des ruines de temples bouddhiques qui sont, dans leur genre, de vraies merveilles.
M. Bondonnat, qui s’était attendu à ne rencontrer dans cette île perdue que des espèces de sauvages, se déclara enchanté de la courtoisie du gouverneur. Au bout d’une demi-heure, ils étaient les meilleurs amis du monde et, au bout d’une heure, le savant était devenu, moyennant la somme de vingt-cinq dollars, locataire d’une délicieuse habitation entourée d’un vaste jardin.
Cette affaire une fois conclue, il revint jusqu’au quai où était amarrée l’embarcation, et, sur son ordre, le cosaque et les Esquimaux chargèrent les bagages sur leurs épaules afin de les transporter à la nouvelle demeure.
Tous quatre traversaient les rues étroites de la petite ville, toujours accompagnés du gouverneur Noghi, qui s’était constitué l’obligeant cicérone du Français.
– L’île de Basan, expliquait-il, est, grâce à sa situation toute spéciale entre l’Asie et l’Océanie, habitée par une population extrêmement variée. Il y a ici sept ou huit races différentes : d’abord les Japonais qui sont les maîtres du pays et occupent les fonctions publiques, puis les anciens habitants qui appartiennent à la race malaise ou chinoise, enfin des émigrants venus de tous les points de l’Océanie : Canaques, Tahitiens, Papous, Maoris et Fidjiens.
– Il ne manquait plus, dit M. Bondonnat, que moi et mes serviteurs pour compléter cette collection ethnologique !
Leur conversation fut brusquement interrompue par une série de gémissements et de cris plaintifs qui s’élevaient à l’autre extrémité de l’étroite rue qu’ils étaient en train de traverser.
Ils pressèrent le pas et se trouvèrent tout à coup en présence d’un Océanien déjà vieux, et qui tenait entre ses bras, presque inanimée, une jeune fille au teint cuivré, son enfant, sans doute.
C’était lui qui poussait les gémissements lamentables qu’ils venaient d’entendre.
– Que se passe-t-il donc ? demanda vivement le gouverneur japonais à l’indigène.
L’homme leva les bras au ciel avec désespoir.
– Ma fille, s’écria-t-il, ma chère Hatôuara !… morte ! perdue !… Elle vient d’être piquée par une vipère à crête rouge ! Il n’y a pas de remède !
M. Bondonnat s’était avancé.
– Ma venue est vraiment providentielle ! dit-il. Par une chance extraordinaire, j’ai précisément dans mon bagage quelques flacons du sérum du docteur Yersin contre la morsure des serpents !
Et se tournant vers le cosaque :
– Vite, Rapopoff ! ordonna-t-il en langue russe, ma trousse et la boîte numéro 17 où se trouvent les sérums.
Le cosaque s’empressa d’obéir.
– Sauvez ma fille, murmurait l’indigène, et tout ce que j’ai vous appartient !
Sans lui répondre, M. Bondonnat se mit immédiatement à l’œuvre.
À l’aide de la seringue de Pravaz, il pratiqua plusieurs injections de sérum ; puis il agrandit la blessure du bras – c’était là que la jeune fille avait été piquée – en pratiquant avec le scalpel une incision cruciale. Il fit saigner la plaie, puis la cautérisa avec quelques gouttes d’hypochlorite de chaux.
Il avait pratiqué toutes ces opérations avec une prestesse qu’on n’eût jamais soupçonnée d’un homme de son âge.
– Oui ! fit-il, maintenant, je crois que l’on peut considérer cette charmante enfant comme à peu près hors de danger… Y a-t-il longtemps qu’elle a été piquée ?’
– Dix minutes à peine, monsieur le docteur, répondit en mauvais anglais l’indigène, tellement éperdu de joie qu’il en demeurait stupide.
– Au revoir, mon ami, dit M. Bondonnat, vous coucherez la malade et lui ferez prendre des infusions chaudes et, à moins que mon sérum ne soit éventé – ce qui arrive malheureusement quelquefois –, je crois qu’elle en réchappera.
Laissant les deux indigènes encore sous le coup de la violente émotion qu’ils venaient d’éprouver, M. Bondonnat continua son chemin avec le gouverneur Noghi, qui tint à l’accompagner jusqu’au seuil de sa demeure et qui, chemin faisant, le remercia chaudement de son obligeance et de sa présence d’esprit.
Tous deux se séparèrent enchantés l’un de l’autre.
Les maisons des Japonais ne sont généralement construites que de bambous et de planches légères, et les cloisons intérieures sont ordinairement formées par des feuilles de papier tendues sur des châssis. Il n’y existe, d’ailleurs, aucun moyen de chauffage sérieux.
La maison que venait de louer M. Bondonnat était heureusement plus solide. Elle avait été bâtie quelques années auparavant par un Anglais et les murailles en étaient de briques solides. Le toit était couvert de tuiles vertes et jaunes, d’un effet très pittoresque, et, ce qui fit grand plaisir à M. Bondonnat, elle était munie de portes fermant à clé.
Elle ne comprenait que quatre pièces, deux au rez-de-chaussée, séparées par un couloir qui aboutissait au jardin, et deux au premier étage.
L’ameublement était demeuré tel que l’avait laissé son premier propriétaire. Les sièges, très commodes, étaient de bambou et de rotin. Les gros meubles, de ce bois de camphrier rose qui est abondant dans ces parages. Enfin, la chambre à coucher, munie d’un cabinet de toilette avec un appareil à douches, offrait un lit de fer et de cuivre protégé par une moustiquaire.
En somme, M. Bondonnat ne pouvait espérer trouver mieux.
Le jardin, surtout, l’enchanta, avec sa luxuriante végétation qu’entourait une solide palissade de bambou.
Il y avait là de belles collections de lis et de chrysanthèmes, des cycas et des bananiers, des cerisiers en fleurs, des palmiers, des orangers et de superbes cocotiers chargés de fruits.
Au centre, un bassin, orné de rocailles, était rempli de dorades de la Chine et de poissons aux gueules monstrueuses, dont quelques-uns portaient de petits anneaux d’argent passés dans les ouïes.
M. Bondonnat s’installa joyeusement. Il rangea ses papiers dans le petit meuble de camphrier à tiroirs qui se trouvait dans sa chambre à coucher. C’est là aussi qu’il déposa un appareil qui servait à constater la présence des radiations ultraviolettes, et qu’il avait inventé pendant son séjour à l’île des pendus. Cet appareil, d’une excessive sensibilité, était renfermé dans un écrin.
Sans l’impatience qu’il éprouvait à la pensée de passer encore trois semaines sans donner de ses nouvelles à sa fille, le vieux savant eût été parfaitement satisfait.
Il se proposait, d’ailleurs, de rapporter de son séjour dans cette île de Basan, qui n’avait été étudiée par aucun savant, les documents les plus curieux et peut-être, qui sait ? une plante ou un animal inconnu. Après avoir fait, comme on dit, le tour du propriétaire, M. Bondonnat appela le cosaque Rapopoff et le chargea d’aller aux provisions.
Rapopoff s’empressa d’obéir, emmenant avec lui les deux Esquimaux. Il ne revint qu’au bout d’une heure, pliant sous le poids de victuailles de toutes sortes : les négociants japonais et tagals avaient abusé de la naïveté du cosaque pour lui faire acheter toutes sortes de comestibles hétéroclites.
Il rapportait des mets si bizarres que M. Bondonnat lui-même en demeura rêveur ; il y avait des ailerons de requin confits dans la saumure, des pots de grès qui renfermaient des jeunes chiens mort-nés préparés au miel – ce qui est considéré par les mandarins comme un manger fort délicat –, du vin de riz dans des bouteilles entourées de soie violette, des cocons de vers à soie dont on fait, paraît-il, des crèmes délicieuses, enfin des vers de terre salés, de l’alcool de Kawa dans une calebasse et de la confiture d’algues marines.
Nous allions oublier des conserves de bœuf de Chicago, des salaisons allemandes et une foule d’autres articles d’épicerie européenne dont l’énumération serait interminable.
Heureusement, M. Bondonnat aperçut, dans tout ce fatras indigeste, une belle langouste et des fruits magnifiques : ananas, goyaves, nèfles du japon, noix de coco, mangues, pommes-crèmes, et jusqu’à deux des fruits volumineux de l’arbre à pain, qu’il suffit de mettre au four quelques instants pour avoir un délicieux gâteau.
– Que de choses ! s’écria le savant, mais tu es fou, mon pauvre Rapopoff, il y a presque de quoi monter une boutique. Jamais nous ne pourrons manger tout cela !
– Ceux-là s’en chargeront, petit père, répondit le cosaque en montrant d’un geste éloquent les Esquimaux qui riaient d’un rire béat, la bouche fendue jusqu’aux oreilles.
M. Bondonnat était, ce jour-là, de si belle humeur qu’il ne songea pas à gronder Rapopoff.
– Tu as raison, lui dit-il, ces deux braves Esquimaux, grâce auxquels, somme toute, nous devons notre liberté, reprennent la mer demain pour regagner l’île des pendus. Il est juste qu’on leur fasse fête avant de leur dire adieu !
Le cosaque était devenu tout à coup pensif.
– J’aime mieux, fit-il, qu’ils y retournent que moi, dans cette île maudite. Je suis sûr qu’ils y seront très mal accueillis.
– Non, dit M. Bondonnat, si je croyais qu’il leur arrivât quelque désagrément, je les garderais avec moi, mais il n’en sera pas ainsi ; lorsqu’ils vont à la pêche, ils restent parfois plusieurs jours en mer, pour peu qu’ils soient entraînés par un vent contraire. Puis, comme on aura trouvé mon prétendu cadavre, on n’aura pas la pensée de les inquiéter.
Les Esquimaux dépassèrent les espérances de M. Bondonnat. Ils trouvaient tout délicieux, petits chiens, vers de terre, ailerons de requin, ils dévorèrent tout. On voyait leur panse s’arrondir à vue d’œil et M. Bondonnat redoutait, à part lui, qu’ils ne vinssent à éclater.
Il n’en fut rien, heureusement. Les deux pêcheurs, dont l’estomac était sans doute aussi robuste que celui des serpents boas, passèrent une nuit paisible et le lendemain matin, frais et dispos, ils se présentèrent devant le savant pour lui faire leurs adieux.
M. Bondonnat leur permit d’emporter les restes du dîner oriental en guise de provisions de voyage et, ce qui leur fit encore plus plaisir, il leur remit à chacun cent dollars en bonne monnaie d’argent.
Rapopoff alla les reconduire jusqu’à leur embarcation et revint d’un air satisfait apprendre à son maître que les Esquimaux avaient repris la mer, favorisés par une excellente brise du sud-ouest qui devait les mener rapidement à bon port.
Le lendemain et les jours suivants furent employés par le naturaliste à s’installer dans sa villa, dont il se montrait de plus en plus content, puis il visita la ville, une incohérente petite cité où les palais de brique coloriée faisaient vis-à-vis à des cahutes couvertes de feuilles de palmier et à des maisonnettes de bambou et de papier, jolies et frêles comme des jouets.
D’ailleurs, le vieillard n’excitait plus la curiosité de personne. Depuis qu’on savait qu’il était en bons termes avec le gouverneur Noghi, chacun lui montrait la plus aimable prévenance.
Au cours de ses promenades, le savant put se convaincre que M. Noghi n’avait pas exagéré en parlant du pittoresque de l’île. Placé en dehors des grands chemins de la civilisation, ce coin de terre avait gardé toute son originalité, toute sa couleur propre ; de plus, le climat, très chaud mais tempéré par la brise du Pacifique, en faisait un véritable Éden où poussaient à la fois toutes les plantes du Japon et une grande partie de celles de Java et des îles polynésiennes.
L’air était délicieusement embaumé d’un parfum léger et subtil où se combinaient le musc, l’ambre et les fleurs du citronnier. Dans cette atmosphère enchantée, le seul fait d’exister était un véritable bonheur.
M. Bondonnat, amolli par ce climat perfide, perdait de son énergie, se laissait aller à de longues rêveries, à des heures entières de paresse, dans son jardin touffu comme une clairière, ou sur le rivage où retentissait l’éternelle et bruissante chanson du vent dans le feuillage des filaos et des grands cocotiers.
Le savant, en allant faire une visite au gouverneur Noghi, avait appris avec plaisir que la petite indigène Hatôuara se portait aussi bien que possible, mais il n’avait plus entendu parler d’elle ni de son père.
Huit jours s’écoulèrent ainsi sans que le vieux savant s’ennuyât une minute. Il fut agréablement surpris un matin en voyant entrer chez lui sa gentille malade accompagnée de son père, qui, pour cette visite importante, avait jugé bon de revêtir un complet à grands carreaux de couleur voyante qui semblait emprunté à la garde-robe d’un clown ; un chapeau de fibres de cocotier, imitant le panama, complétait ce déguisement mondain.
Hatôuara, elle, soit par bon goût naturel, soit par impossibilité pécuniaire, n’avait pas jugé à propos de faire appel aux modes européennes pour sa parure ; ses cheveux, un peu crépus et d’un noir bleuâtre, étaient relevés à la mode japonaise et retenus par des épingles de corail, et elle n’avait pour tout vêtement qu’un léger kimono de soie où couraient des arabesques de feuillage et de fleurs et qui lui laissait les bras nus jusqu’aux coudes.
La jeune fille avait le teint couleur de cuivre clair, le nez droit et délicatement modelé. Ses lèvres un peu fortes et ses langoureux yeux noirs lui donnaient une grâce sauvage dont rien, parmi nos pâles beautés, ne peut donner une idée.
Hatôuara était admirablement faîte ; et dans toute sa personne, de ses seins menus qui pointaient sous l’étoffe légère jusqu’à ses hanches déjà opulentes, un sculpteur n’eût rien trouvé à critiquer. Ce beau corps avait la pureté de dessin d’un vase grec ou d’une svelte fleur.
Puis il y avait en elle une vivacité de mouvements, une franchise de regards et de gestes d’un charme presque animal qui ajoutaient encore à ses autres séductions.
Hatôuara était chargée d’un filet de raphia tressé rempli des fruits les plus magnifiques. C’était un présent qu’elle venait apporter à son sauveur et qu’elle promettait de renouveler très souvent.
Rapopoff disposa dans une corbeille ce savoureux cadeau, dont la salle à manger se trouva tout embaumée. M. Bondonnat régala ses visiteurs d’une tasse d’excellent thé jaune, accompagné de confitures et de gâteaux secs, et l’on causa.
Amalu, le père de Hatôuara, avait amassé une certaine fortune en faisant le trafic dans les îles polynésiennes sur une petite goélette dont il était le propriétaire. Maintenant, ses économies solidement placées à la succursale de la banque d’Yokohama, il vivait paisiblement de ses rentes, et son seul souci était de trouver à sa fille un époux digne d’elle.
Il accabla M. Bondonnat de questions sur l’Europe, sur la France et sur Paris, et le vieux savant le renseigna avec sa patience et sa bonté accoutumées. Quant à Hatôuara, elle se tenait silencieuse, contemplant avec admiration le mobilier de la salle à manger ; puis elle alla visiter le jardin, et elle revint au moment où Amalu voulait à toute force faire accepter au docteur, à titre d’honoraires, plusieurs pièces d’or anglaises. M. Bondonnat refusa énergiquement, au grand chagrin du brave homme.
– Que pourrais-je donc faire pour vous être agréable ? demanda-t-il au savant.
– Eh bien, tenez, au moment où vous êtes entré, je me préparais justement à aller à la pêche. Venez avec moi ! Vous me montrerez les bons endroits.
– Je vais vous laisser ma petite Hatôuara. C’est une pêcheuse fort habile et elle sera très heureuse de vous accompagner.
– J’accepte avec grand plaisir. Allons, Rapopoff, apporte les lignes et le panier.
Dix minutes après, tous trois descendaient sur le rivage, qui n’était qu’à quelques pas de la clôture du jardin, et l’on s’installait dans une petite anse que Hatôuara déclara très poissonneuse. Le ciel et la mer étaient d’un azur admirable et les vagues venaient presque caresser la racine des cocotiers et des tamariniers au feuillage d’un vert éclatant.
L’eau était si calme qu’on apercevait dans les profondeurs les broussailles blanches des coraux, au-dessus desquelles se balançaient les méduses étincelantes de toutes les couleurs du prisme. De temps en temps, des vols de poissons roses, lilas, jaune d’or filaient entre les grandes algues, au pied desquelles s’attachaient les holothuries azurées et les oursins vert et violet.
C’était, sous le cristal de l’onde transparente, une série de fantastiques paysages d’une richesse de tons et d’un éclat presque irréels.
M. Bondonnat jeta sa ligne armée de quelques vermisseaux marins, et bientôt il eut ramené des trigles d’un rouge vif et une murène au corps de velours noir constellé de taches d’or.
Hatôuara le regardait faire avec un sourire de pitié.
– Vraiment, songeait-elle, ce vénérable étranger qui lui avait sauvé la vie n’entendait rien à la pêche, il fallait lui donner une leçon.
Sans rien dire, elle avait pris l’épuisette – article anglais trouvé par Rapopoff dans un magasin de la ville – et elle capturait de tout petits poissons qu’elle déposait dans un creux du rocher à côté d’elle. Quand elle en eut assez, elle les mit dans sa bouche ; puis, rejetant d’un seul geste son pyjama, elle plongea hardiment dans la mer.
M. Bondonnat, quelque peu estomaqué, la vit filer comme une sirène entre les coraux et les varechs polycolores.
Elle reparut bientôt à la surface, souriante et tenant dans la main deux grosses dorades au ventre d’argent.
– Je suis une petite sauvage, moi, expliqua-t-elle dans son mauvais anglais. Tout enfant, j’ai appris à pêcher de la sorte !
– Comment fais-tu ? demanda M. Bondonnat très amusé.
– Ce n’est pas difficile. Je laisse aller un à un les petits poissons et, quand il s’en approche un gros, je le tue d’un coup de dent sur le haut de la tête.
– J’avoue, dit M. Bondonnat avec un paternel sourire, que je serais bien incapable d’en faire autant. Ma ligne me suffit.
Maintenant qu’elle avait montré ses talents au docteur, Hatôuara, sans honte comme sans coquetterie, s’était étendue sur le roc pour sécher son beau corps. Elle allait et venait, vive et pétulante comme un oiseau, cueillant des fleurs, ramassant des cocos tombés des arbres ou courant après les papillons et les insectes.
M. Bondonnat était enchanté de la gentillesse de sa petite camarade, et, quand ils se séparèrent, il la força d’accepter la moitié des poissons qu’ils avaient pris ensemble.
Elle promit de revenir le lendemain à la villa avec de nouveaux présents.
Dès lors il ne se passa pas un seul jour sans que M. Bondonnat reçût sa visite ; tantôt elle apportait des fruits, tantôt de beaux coquillages ou des poissons péchés par elle.
Occupé d’études et de promenades, le vieux savant voyait s’écouler les journées sans ressentir le moindre ennui. Et il se promettait plus tard de revenir avec ses deux enfants, sa fille Frédérique et sa fille adoptive Andrée, pour leur faire visiter cette île enchanteresse. Basan était décidément un pays sans défaut. Les habitants mêmes, presque tous bouddhistes, y étaient très doux, très bons et très serviables. Le gouverneur Noghi avait bien prévenu M. Bondonnat que les voleurs étaient nombreux dans l’île et d’une habileté stupéfiante, mais jusqu’ici le savant n’avait eu à se plaindre de personne ; cependant, par mesure de prudence, il faisait coucher le fidèle Rapopoff sur une natte en travers de la porte de sa chambre et, cette précaution prise, il dormait aussi paisiblement dans son lit de cuivre que s’il ne se fût pas trouvé dans une île perdue, à deux ou trois mille lieues de son pays natal.
Un matin, M. Bondonnat constata avec la plus vive surprise que les tiroirs du petit meuble de camphrier étaient demeurés entrouverts, et il s’aperçut bientôt que ses papiers avaient été fouillés, bouleversés comme par une main impatiente.
– Voilà qui est étrange ! s’écria-t-il.
Et s’approchant de Rapopoff, fort occupé en ce moment à épousseter :
– Tu n’es pas sorti cette nuit ?
– Non, petit père.
– Tu n’as pas quitté ta place ?
– Je n’ai pas bougé du seuil de la porte. Je n’ai fait qu’un somme.
– Tu n’es pas somnambule ?
Le cosaque ouvrit de grands yeux. Il fallut un quart d’heure pour lui expliquer ce qu’est un somnambule, et, quand il eut compris, il déclara qu’il était absolument indemne de cette singulière infirmité.
– Voilà qui est extraordinaire. C’est peut-être moi, après tout, qui suis somnambule !
M. Bondonnat se plaisantait lui-même, car il avait les nerfs parfaitement équilibrés et n’avait jamais eu à en souffrir.
Un peu préoccupé, il remit en ordre ses notes et ses paperasses. Il n’avait pas encore terminé quand le cosaque lui demanda de l’argent pour aller aux provisions.
M. Bondonnat prit la petite clé qui ouvrait un des tiroirs du meuble, celui qu’il avait fermé lui-même la veille au soir, et il constata avec une stupeur profonde que ce tiroir, lui aussi, était ouvert.
Le portefeuille qui contenait les bank-notes était bien à sa place, mais il paraissait considérablement désenflé.
Très intrigué, il fit son compte. Dix billets de banque manquaient à la liasse qui lui avait été jadis remise par les Lords de la Main Rouge.
Il était profondément stupéfait. Cette fois, sa perspicacité était en défaut. Il était impossible que quelqu’un fût entré sans réveiller le cosaque et, d’un autre côté, il ne pouvait soupçonner ce brave Rapopoff, qui lui avait donné tant de preuves de dévouement et qui, d’ailleurs, avait toujours professé un profond mépris de l’argent.
M. Bondonnat examina la fenêtre. C’était une de ces fenêtres dites à guillotine, qui s’ouvrent de haut en bas et qui sont usitées dans toutes les colonies anglaises. Le verrou intérieur était poussé et ce n’était pas par cette voie qu’avait pu passer le voleur !
Il en était de même des fenêtres du rez-de-chaussée, et, quant aux deux portes, celle qui donnait sur la route et celle qui aboutissait au jardin, le savant les retrouva dans l’état où elles étaient la veille au soir, c’est-à-dire fermées à clé.
C’était à n’y rien comprendre.
M. Bondonnat se livra aux suppositions les plus folles, sans en trouver une qui fût vraisemblable.
En désespoir de cause, il alla jusqu’à sonder les murailles à coups de marteau pour voir si elles ne recelaient pas une issue secrète ; partout, les murailles sonnaient le plein et, d’ailleurs, elles étaient trop peu épaisses pour pouvoir dissimuler une trappe quelconque.
Le vieux savant passa une partie de la matinée à essayer de deviner cette énigme, il ne put y parvenir ; il finit par y renoncer, en essayant de se persuader à lui-même qu’il avait été le jouet d’une hallucination ou la victime d’une crise subite d’amnésie.
Mais il était loin d’être convaincu.
– Décidément, fit-il en hochant la tête, je crois plutôt que j’ai eu affaire à un voleur invisible.
CHAPITRE II
Le pied nu
M. Bondonnat déjeuna ce jour-là dans son jardin, au milieu de ces fleurs et de ces plantes exotiques qui étaient pour lui comme des amies et dont il connaissait, à point nommé, toutes les espèces et toutes les variétés.
– Ma foi, se dit-il philosophiquement, après avoir pris son café, je ne veux pas me faire de bile au sujet de ce vol ! Ceux qui l’ont commis doivent se tenir pour satisfaits et ne reviendront sans doute plus. D’ailleurs, il faut qu’ils soient relativement honnêtes ! Ils auraient pu tout prendre. Ne pensons plus à cela et allons faire une promenade.
Le savant mit aussitôt ce projet à exécution. Il se coiffa d’un léger chapeau de rotin, se munit d’un grand parasol en papier et descendit jusqu’au rivage, s’arrêtant de temps en temps pour contempler les jeux des mouettes et des cormorans, ou pour examiner quelque fleur ou quelque pierre.
Il allait lentement, en flâneur, côtoyant le rivage, à l’ombre de superbes cocotiers où s’ébattaient des écureuils et des rats palmistes.
Puis il suivit un sentier qui le mena sur la plage même, et il marcha sur le sable couvert d’une profusion de coquillages nacrés.
Jamais il n’avait senti avec autant de bonheur les charmes de la promenade et de la méditation. Comme il lui était doux de flâner ainsi, au milieu d’un des plus beaux paysages du monde, après tant de mois d’une si dure captivité !
Bercé par sa rêverie, M. Bondonnat ne s’apercevait pas qu’il avait fait beaucoup de chemin ; enfin il se trouva au milieu d’un site véritablement grandiose, mais qui lui était tout à fait inconnu ; il ne s’était pas encore aventuré si loin de sa maison.
Au-dessus d’une forêt où se mélangeaient toutes les essences propres aux contrées tropicales, il apercevait des coupoles dorées, de sveltes tourelles ; toute une architecture compliquée et élégante, qui le fit songer à ces châteaux habités par des génies que l’on trouve à chaque page des contes arabes.
Il eût bien voulu visiter ce magnifique édifice ; mais il en était séparé par d’inextricables fourrés de plantes épineuses, au milieu desquels il n’eût été ni facile ni prudent de se risquer, car ils devaient servir d’asile à tout un monde de reptiles.
Le naturaliste se résigna donc à continuer à suivre le rivage, et il déboucha bientôt dans une baie profonde, une sorte de fjord qui s’avançait jusqu’au milieu de la forêt.
Au fond de cette baie, que bordait une falaise abrupte, se trouvaient de nombreuses cavernes produites par l’incessant et patient travail des flots.
Il marcha de ce côté, mais il poussa tout à coup un cri de surprise en se trouvant inopinément en présence d’un homme misérablement vêtu, à la barbe hirsute, qui, assis sur le sable, à l’ombre de la falaise, déjeunait de quelques coquilles bivalves, dans le genre de nos clovisses, les ouvrant avec un couteau et en rejetant ensuite au loin les coquilles.
En s’approchant, M. Bondonnat remarqua avec surprise que cet homme à la mine égarée était un Blanc, sans doute un Européen, peut-être même un Français comme lui, car ses cheveux et sa barbe en désordre étaient d’un blond ardent.
Le savant pensa tout de suite qu’il se trouvait en présence de quelque matelot déserteur, et il s’approcha, mû par la curiosité et aussi par la pitié, car ce pauvre être paraissait dans un état lamentable.
À la vue de M. Bondonnat, le solitaire fit un geste pour s’enfuir ; mais, en reconnaissant qu’il avait affaire à un homme de sa race, il demeura et une sorte de sourire se dessina sur sa face chagrine.
M. Bondonnat crut utile d’engager la conversation en demandant quelques renseignements sur la route à suivre pour regagner le port de Basan.
Sans y songer, M. Bondonnat s’était exprimé en français. Ce fut avec un plaisir inexprimable qu’il entendit l’inconnu lui répondre dans la même langue :
– Monsieur, vous n’avez qu’à suivre le rivage. Il est impossible que vous vous égariez. Il y a bien un sentier plus court qui coupe à travers le bois, en passant devant le temple bouddhiste, mais vous pourriez vous perdre ; il est plus prudent de longer la mer.
– Je vois avec plaisir que je me trouve en présence d’un compatriote. Vous êtes français ?
– Oui, répondit l’homme d’un air sombre.
– Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ?
– Je ne sais plus au juste… un mois… peut-être plus !
M. Bondonnat s’aperçut que ses questions déplaisaient à l’homme, dont les traits avaient repris leur expression farouche.
– Si je vous interroge ainsi, reprit-il, ce n’est pas, croyez-le, pour satisfaire une vaine curiosité. C’est pour savoir si je ne pourrais pas vous être utile de quelque manière !
– Je n’ai besoin de rien.
– Pourtant, vous ne me semblez pas très heureux. Si une somme d’argent quelconque…
– Je ne veux rien, répliqua l’homme avec une sourde colère. Je me trouve bien comme je suis. Je ne veux pas qu’on s’intéresse à moi ni qu’on s’occupe de moi !
M. Bondonnat était profondément ému.
– Vous devez avoir éprouvé de bien grands malheurs, dit-il ; mais il y en a bien peu qui soient complètement irréparables !
Comme l’homme gardait le silence, les suppositions du naturaliste prirent une autre orientation.
– Auriez-vous été victime de quelque entraînement ? Auriez-vous commis quelque faute, quelque crime ? demanda-t-il.
Cette hypothèse eut pour résultat de tirer l’inconnu de son apathie.
– Monsieur, répondit-il, je ne vous connais pas, mais vous me paraissez rempli de bienveillance à mon égard et je ne voudrais pas que vous me preniez pour un malfaiteur…
– Je me nomme Prosper Bondonnat.
– Le célèbre naturaliste ?
– Lui-même.
– Mon cher compatriote, je vais vous raconter mon histoire en deux mots. Mais vous verrez que la catastrophe dont j’ai été victime est irréparable, et qu’il vaut mieux que vous me laissiez à mon chagrin et à ma tristesse.
– Je vous écoute, dit le savant en s’asseyant sur le sable.
– Je me nomme Louis Grivard, reprit le jeune homme, et mon nom ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu, car j’ai, à plusieurs reprises, organisé, en France et en Amérique, des expositions de peinture qui ont eu un certain succès !… C’est à New York que j’ai connu celle qui devait devenir ma femme, ma chère Lorenza…
À ce nom, l’artiste fondit en larmes, et ce ne fut qu’au bout de quelques minutes qu’il put continuer son récit.
– Nous étions parfaitement heureux. Nous nous étions aimés dès le premier jour que nous nous vîmes. Il y avait entre nous deux une si merveilleuse union, une harmonie si parfaite, que jamais, même sans nous être donné le mot, nous n’avons été d’un avis différent sur aucune question ! D’un seul regard, nous nous comprenions. C’était un bonheur au-dessus de celui de la simple humanité, et il n’est pas extraordinaire qu’il n’ait pas duré et qu’il ait fini de façon aussi tragique.
« Nous étions mariés depuis quelques semaines à peine lorsqu’on nous fit une proposition très avantageuse. Il faut vous dire que ma chère Lorenza possédait l’étrange pouvoir de rendre aux perles mortes tout leur éclat et tout leur orient. Plusieurs fois même, des souverains la firent appeler pour lui confier leurs joyaux.
– En effet, j’ai entendu parler de cela, dit M. Bondonnat.
– C’est vous dire que la pauvre Lorenza se connaissait admirablement en perles. Un marchand de pierres, dont nous avions fait la connaissance, cherchait une personne de confiance pour aller à Ceylan, à Timor, en Océanie, acheter des quantités considérables de perles. Il pensa que Lorenza était toute désignée pour cette délicate mission ; et il nous proposa d’entreprendre, à ses frais, dans les conditions les plus agréables, un voyage autour du monde. Comme j’hésitais, il fit valoir à mes yeux les facilités que j’aurais, en contemplant des paysages exotiques, de trouver dans mon art une note nouvelle et puissamment originale ; Paul Gauguin n’est-il pas allé à Tahiti, et Besnard aux Indes ? Puis n’était-ce pas le plus merveilleux des voyages de noces ?
« Nous nous laissâmes convaincre et nous partîmes. Les premières semaines de notre excursion furent idéales. Je puis presque mourir après avoir été aussi heureux que je le fus pendant ces quelques jours.
« D’ailleurs, nos affaires marchaient à souhait. À Ceylan, à Timor nous conclûmes, pour le compte de notre mandataire, des marchés très avantageux. C’est alors que j’eus la fatale idée de passer quelque temps dans cette île de Basan, dont le charme perfide m’avait séduit, et qui est le rendez-vous d’un grand nombre de pêcheurs et de trafiquants de nacre.
« Nous louâmes une maisonnette dans la banlieue de la ville et, sans négliger le côté sérieux de notre mission, nous commençâmes nos excursions à travers ces paysages merveilleux.
« C’est alors qu’une première catastrophe vint s’abattre sur nous, au milieu de cette tranquillité et de ce bonheur, comme la foudre éclatant dans un ciel serein.
« Un matin, nous nous aperçûmes que toutes nos perles, qui étaient la propriété de notre mandataire et qui représentaient une somme énorme, avaient disparu ; le coffret de fer qui les renfermait n’avait même pas été forcé ; c’était pour nous la ruine et même le déshonneur, car personne ne croirait jamais que nous nous soyons laissé voler aussi naïvement.
« Je me plaignis à Noghi, le gouverneur. Avec beaucoup de zèle, du moins en apparence, il commença une enquête ; cette enquête ne donna aucun résultat, et, quoique je n’en sois pas sûr, j’ai toujours pensé que ce rusé Japonais était complice de mes voleurs.
« Pourtant, nous ne perdîmes pas courage. Je passe pour avoir du talent ; Lorenza, de son côté, gagnait beaucoup d’argent, grâce à la merveilleuse faculté qu’elle possède ; nous résolûmes de nous mettre au travail et d’amasser une somme suffisante pour rembourser le prix des perles. Notre amour nous tenait lieu de tout ; nous nous aimions tellement qu’aucun malheur n’était capable de nous abattre.
« Est-il besoin de vous dire que nous avions résolu de quitter le plus tôt possible cette île de malédiction… c’est alors qu’éclata la suprême catastrophe !…
Ici l’artiste se mit à trembler, un sanglot l’étreignit à la gorge.
– Deux jours avant notre départ, bégaya-t-il, Lorenza disparut de la même façon mystérieuse que les perles !… Oui, monsieur, c’est épouvantable, mais c’est ainsi. Un matin, en me réveillant, je ne la trouvai plus à mes côtés. Et, ce qu’il y a de plus désespérant, nulle trace d’effraction, nul vestige, nul indice !… J’étais désespéré !…
« Je retournai chez le gouverneur, je priai, je suppliai, je menaçai. Comme la première fois il feignit de se rendre à mes instances ; il fit même arrêter quelques habitants sur lesquels pesaient des soupçons ; mais, finalement, il n’obtint aucun résultat, et, petit à petit, ne s’occupa plus de l’affaire.
M. Bondonnat était profondément troublé. En songeant au vol dont il avait été victime la veille, il se demandait à quels malfaiteurs mystérieux il pouvait avoir affaire. C’étaient les mêmes, sans nul doute, qui s’étaient emparés des perles et qui avaient enlevé Lorenza.
– Continuez, dit-il à l’artiste, qui, maintenant, semblait retomber dans son abattement. Il est nécessaire que je connaisse cette aventure dans les moindres détails.
– Je vous ai raconté l’essentiel, reprit l’artiste. J’ai été fou pendant plusieurs jours, errant dans les bois et le long de la mer sans vouloir prendre aucune nourriture. Je cherchais Lorenza ; c’était mon idée fixe. Je la cherche toujours, j’ai la conviction qu’elle est encore vivante. Pourquoi l’aurait-on tuée ? Si j’avais la certitude qu’elle fût morte, je ne lui survivrais pas d’une minute. L’espoir de la retrouver est la seule chose qui me donne le courage de ne pas mourir…
– Voilà, certes, une étrange histoire, murmura M. Bondonnat sincèrement apitoyé. Mais pourquoi n’avez-vous pas regagné le Japon, adressé une plainte en règle au consulat de France ? Il me semble qu’à votre place c’est ce que j’aurais fait.
Louis Grivard eut un rire amer.
– Vous oubliez, mon cher compatriote, que j’étais sans argent, complètement ruiné, mes bagages vendus pour payer le loyer de notre maison et les frais des premières et inutiles recherches !… Mais ce n’est pas encore la vraie raison. J’aurais peut-être pu, en m’engageant comme matelot, regagner Yokohama, mais la seule pensée de quitter le pays où se trouve encore certainement ma Lorenza me bouleversait. D’ailleurs, ne suis-je pas mieux ici ? Aux yeux de mon mandataire, aux yeux de la loi française ne suis-je pas un voleur ?… Peut-être qu’en mettant le pied sur le quai de quelque port civilisé, des policemen me prendraient au collet ! mon signalement doit avoir été envoyé partout…
M. Bondonnat prit la main du malheureux artiste et l’étreignit avec effusion.
– Mon pauvre ami, lui dit-il, ce n’est pas en vain que vous m’avez raconté votre histoire. Je vous le promets, je ferai tout ce qui est humainement possible pour éclaircir cet affreux mystère et pour retrouver votre femme. Mais j’ai, moi aussi, bien des choses à vous raconter.
M. Bondonnat narra son séjour à l’île des pendus, sa captivité chez les bandits de la Main Rouge et la façon extraordinaire dont il s’en était évadé. Il termina son récit en expliquant de quelle façon lui-même, la nuit précédente, avait été victime d’un vol dont les circonstances rappelaient exactement celui grâce auquel l’artiste avait été dépouillé.
– Ce sont, évidemment, les mêmes bandits, répondit Louis Grivard, et je tremble qu’il ne vous arrive à vous aussi quelque malheur.
– Soyez tranquille, répondit M. Bondonnat avec énergie, je vais prendre des précautions ; puis je ne vous cacherai pas que ce mystère me passionne ! J’y mets, mon amour-propre de savant.
L’artiste hocha la tête avec tristesse.
– Je doute fort que vous réussissiez ! fit-il.
– J’ai cependant découvert des choses plus difficiles, que diable ! Laissez-moi réfléchir, trouver un plan, un stratagème, et vous verrez… Mais quittons cela pour l’instant ; vous n’allez pas, je suppose, continuer à vivre en lycanthrope, sous ces haillons. Je vous emmène avec moi, il y a une place pour vous dans ma maisonnette.
– Je suis sincèrement touché de votre bonté, mais je refuse… Je ne pourrais dormir sous un toit, dans une pièce close de tous côtés. Je me réveillerais en sursaut toutes les cinq minutes, en croyant sentir près de moi les invisibles malfaiteurs. Venez avec moi, je vais vous montrer où je loge.
Louis Grivard alla jusqu’à l’entrée d’une des cavernes, au fond de la baie, sous la haute voûte d’origine madréporique. M. Bondonnat aperçut un lit de feuilles de palmier et de grands coquillages qui servaient de vases à boire au solitaire, une petite source tombait de la falaise et allait se perdre dans les sables.
Au-dessus du roc c’était la forêt avec ses lianes inextricables et ses verdures majestueuses.
– Voilà mon antre, dit Louis Grivard avec un mélancolique sourire. C’est là que je dors pendant une grande partie de la journée, ne sortant que pour me procurer des fruits et des coquillages ; mais, la nuit, je la passe tout entière à errer dans l’île, je rôde par les rues de la ville, écoutant les conversations, regardant et observant tout.
Le malheureux ajouta avec un regard morne :
– Qui sait ? Il suffira peut-être d’un mot pour me mettre sur la bonne piste !… Au matin, je rentre brisé de fatigue, et je dors : voilà ma vie !
Malgré toute l’insistance de M. Bondonnat, Louis Grivard refusa énergiquement d’aller habiter la villa ; mais il fut convenu que le savant le visiterait fréquemment et le tiendrait au courant de tout ce qui pourrait arriver d’intéressant.
Au moment de se retirer, le naturaliste remarqua que les parois de la grotte étaient sculptées d’idoles monstrueuses, aux longs yeux en amande, aux grosses lèvres souriantes ; et il pensa que cet endroit avait peut-être été, avant l’apparition du bouddhisme dans cette île, un temple consacré aux idoles, à ces mauvais génies à l’existence desquels croient tous les sauvages océaniens.
Ce qui le fortifia dans son opinion, c’est qu’à cinq ou six mètres de l’entrée la caverne était barrée par des éboulements, et il se rappela avoir vu autrefois dans l’Inde des cryptes pareillement ornées de statues gigantesques.
M. Bondonnat revint lentement chez lui, en proie à une vive préoccupation. La confidence de Louis Grivard le forçait de s’occuper de nouveau du vol de la nuit précédente. Il s’était juré qu’il arracherait ce malheureux à sa triste situation. Mais il avait beau chercher, se creuser la tête, il n’arrivait pas à découvrir la ruse victorieuse, la bonne idée qui lui permettrait de mettre la main sur les invisibles malfaiteurs.
Ce soir-là, il ne mangea que du bout des dents. Il avait le cœur serré et le cosaque Rapopoff lui-même fut frappé de sa tristesse. Il regagna sa chambre tout soucieux. Mais, avant de se coucher, il ordonna à Rapopoff d’étendre, depuis la porte de la pièce jusqu’au petit meuble de camphrier qui se trouvait à l’autre extrémité, une longue natte de rotin ; il se fit apporter de la farine de riz et, à l’aide d’un tamis, il en répandit une couche parfaitement égale sur toute la surface de la natte.
– Comme cela, fit-il, si mes dévaliseurs ne sont pas tout à fait de purs esprits, ils seront forcés de laisser quelques traces de leur passage, en admettant qu’ils reviennent. Ce que je ne crois guère.
Il prit encore une autre précaution, ce fut de placer sous son chevet le portefeuille qui contenait le reste de ses bank-notes. Puis, satisfait de cette idée, il se mit au lit.
Fatigué par sa longue excursion, M. Bondonnat, presque aussitôt couché, tomba dans un profond sommeil et dormit tout d’une traite jusqu’au matin.
En sautant à bas de son lit, son premier soin fut de regarder la natte ; la farine de riz portait les traces parfaitement nettes d’un tout petit pied nu, un pied de femme ou d’enfant.
M. Bondonnat regarda autour de lui. De même que la première fois, tous les meubles avaient été bouleversés, les papiers demeuraient en désordre dans les tiroirs entrouverts.
– Cette fois, par exemple, s’écria le savant, c’est trop fort !
Il glissa la main sous son oreiller. Le portefeuille s’y trouvait bien, mais il avait encore diminué de volume. Les voleurs, enhardis par un premier succès, avaient enlevé vingt bank-notes de mille dollars chacune.
Jamais – même lorsqu’un hasard l’avait mis sur la voie de découvertes étonnantes – M. Bondonnat n’avait été aussi stupéfié. Il tiraillait ses favoris blancs pour bien se constater à lui-même qu’il ne dormait pas.
– Voyons, répétait-il, mais c’est insensé ! Ces indigènes ne sont pourtant pas sorciers, que diable nous ne sommes plus au Moyen Âge !
Il ouvrit la porte de sa chambre, qu’il trouva fermée à clé comme la veille, et il réveilla Rapopoff, qui, étendu sur sa natte en travers du seuil, dormait encore, en ronflant comme un tuyau d’orgue.
De même que son maître, le cosaque avait dormi tout d’une traite et n’avait été réveillé par aucun bruit suspect.
L’énigme demeurait insoluble.
– Pourtant, se répétait M. Bondonnat profondément intrigué, je voudrais bien savoir à qui appartient ce joli pied nu !
CHAPITRE III
L’apparition
Le reste de la matinée, M. Bondonnat fut en proie à un étrange malaise moral ; il avait l’impression d’être comme happé entre les roues d’un engrenage invisible. Toutes ses lectures sur les cas de suggestion et de hantise lui revenaient en mémoire et il avait maintenant la certitude que les mystérieux cambrioleurs ne s’en tiendraient pas là.
Enfin, il devinait que les événements incompréhensibles dont sa demeure était le théâtre continueraient à se dérouler avec une logique inflexible et bizarre.
Il fut un peu distrait de ses soucis par la visite de la gentille Hatôuara, toute fière d’une robe de soie bleue toute neuve, de jolies babouches brodées d’or et d’un beau collier de corail, dont son père lui avait fait présent le matin même. Elle apportait un panier de crabes épineux et fantasques dans leurs formes comme des monstres japonais, et de ces grosses crevettes des mers tropicales que l’on appelle des « caraques » et qui sont longues comme la main.
– Je vous apporte une bonne nouvelle, docteur, baragouina-t-elle dans son mauvais anglais, le paquebot américain que l’on n’attendait que dans une douzaine de jours sera ici ce soir.
– Qui t’a dit cela ?
– Tout le monde sur le quai. Le vapeur a été aperçu au large par les pêcheurs.
– Je te remercie, mon enfant, murmura le savant devenu brusquement tout songeur.
– Alors, vous allez nous quitter ? fit Hatôuara avec l’expression d’une réelle tristesse dans la voix.
– Je ne sais pas encore, répondit-il. Mais va donc jouer dans le jardin avec Rapopoff, j’ai besoin de réfléchir.
M. Bondonnat était perplexe. Malgré son vif désir de se rembarquer pour la France, il lui en coûtait énormément de quitter l’île de Basan sans avoir découvert les voleurs. Il avait le cœur gros à la pensée d’abandonner à son désespoir le malheureux Grivard, auquel, entraîné par sa générosité naturelle, il avait fait, peut-être un peu imprudemment, de si belles promesses.
– Je crois, songea-t-il, qu’il faudra que je reste encore quelque temps dans cette île diabolique. Je sais qu’il y aura un autre vapeur dans une quinzaine. Le retard n’est pas énorme, et je pourrai toujours charger quelqu’un du paquebot d’un télégramme destiné à ma fille, afin de la rassurer… Et pourtant ai-je bien le droit de faire attendre ainsi ma pauvre Frédérique ?
M. Bondonnat était en proie à la plus cruelle indécision. Il ne put se décider à prendre une résolution, quelle qu’elle fût, et il conclut que le mieux était de se laisser guider par les événements. Il se promettait, d’ailleurs, de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour hâter la solution de l’énigme et le dénouement du drame ; mais plus il réfléchissait, plus il constatait que ce qu’il pouvait se bornait à bien peu de chose.
Nerveux et indécis, agité et mécontent, le savant ne sortit pas ce jour-là. Il passa tout l’après-midi assis dans son jardin, à l’ombre d’un cycas, à réfléchir et à feuilleter quelques livres anglais, qu’il avait trouvés chez un papetier japonais de Basan.
Hatôuara ne l’avait pas trompé. Un peu avant le coucher du soleil, Rapopoff vint annoncer qu’un grand navire à vapeur était mouillé dans la rade. D’une des fenêtres du premier étage, M. Bondonnat put voir la coque allongée d’un steamer de moyen tonnage, ancré à environ deux kilomètres de la côte et qu’entouraient déjà la foule des jonques, des sampans et des barques chargés de fruits et de marchandises locales.
Le vieux savant, décidément, avait perdu l’appétit ; ce soir-là, de même que la veille, c’est à peine s’il toucha à l’excellent repas que lui avait apprêté son cosaque.
Comme ce dernier était occupé à desservir, M. Bondonnat l’interpella brusquement.
– Rapopoff, lui dit-il, tu sais que l’on me vole presque toutes les nuits ?
– Oui, petit père !
– Eh bien, il faut que tu m’aides à découvrir les voleurs. Cette nuit tu te coucheras sur ta natte, mais tu ne dormiras pas ; et, si quelqu’un vient, tu l’empoigneras et tu m’appelleras !
Dressé dès l’enfance à l’obéissance passive, le cosaque ne fit pas la moindre objection à ce plan. Il s’étendit, comme chaque soir, sur sa natte, en travers de la porte, avec la ferme résolution de ne pas fermer l’œil de la nuit.
Sur le conseil de M. Bondonnat, il avait placé à côté de lui, à portée de sa main, un grand sabre japonais et un revolver.
Le naturaliste, une fois dans sa chambre, souffla sa lampe, s’étendit tout habillé sur son lit, après avoir eu soin de serrer son portefeuille dans la poche intérieure de son veston. Il était, lui aussi, bien résolu à rester éveillé jusqu’aux premiers rayons du jour.
La nuit était très chaude ; l’air était embaumé par la voluptueuse haleine des jardins et des bois. M. Bondonnat entrouvrit légèrement sa fenêtre ; il aspira avec délice cette brise chargée de langoureux arômes.
Peu à peu, il lui sembla que jamais le vent du soir n’avait été chargé d’odeurs aussi enivrantes. Il n’avait qu’à fermer à demi les yeux pour se croire transporté dans un champ de tubéreuses et de narcisses, d’où montaient des senteurs d’une volupté accablante.
Bientôt ses yeux se fermèrent tout à fait et il s’endormit.
Il faisait grand jour quand il se réveilla ; et, tout d’abord, il eut beaucoup de peine à mettre de l’ordre dans ses idées. Ce ne fut qu’après plusieurs minutes d’efforts qu’il se rappela qu’il s’était promis de ne pas se laisser aller au sommeil ; mais il prit vite son parti de cette négligence.
– Bah ! se dit-il, j’ai mangé la consigne. C’est tant pis ! Rapopoff aura sans doute été plus vigilant que moi !
Il sauta en bas de son lit, et son premier soin fut de jeter un coup d’œil sur la natte couverte de farine de riz qu’il avait eu la précaution de disposer de la même façon que la première fois.
La trace des petits pas nus s’y étalait en évidence.
– Par exemple ! s’écria le naturaliste, voilà qui dépasse la permission ! C’est se moquer du monde ! Et cet imbécile de Rapopoff qui s’est endormi, malgré ma défense ! Je vais lui dire un peu son fait !
Tout en monologuant ainsi d’un ton fort mécontent, M. Bondonnat avait machinalement porté la main à la poche où se trouvait son portefeuille. Il fut plus irrité que surpris, en constatant que, cette fois encore, on l’avait allégé d’une vingtaine de billets.
Sur les cent bank-notes que lui avaient remis autrefois les Lords de la Main Rouge, il n’en restait plus guère qu’une quarantaine.
Du coup, M. Bondonnat était véritablement en colère.
– Cela devient insupportable, s’écria-t-il, c’est stupide !… Puis c’est énervant, cette façon de procéder, de n’enlever, à chaque expédition, qu’un petit paquet ! J’aimerais presque autant qu’ils eussent tout pris d’un coup, au moins je n’aurais pas à y penser !
Véritablement exaspéré, le savant ouvrit la porte de la chambre, bien décidé à tancer d’importance la négligence et la paresse du cosaque.
Rapopoff avait disparu !
Ses bottes, son bonnet de fourrure, son sabre japonais et son revolver se trouvaient bien à leur place à côté de la natte, mais leur propriétaire n’était plus là !
C’est en vain que M. Bondonnat le chercha dans le jardin et dans les différentes pièces de la villa, Rapopoff s’était éclipsé sans laisser de traces, avait été escamoté comme une muscade.
Cette fois, l’aventure était stupéfiante, pour ne pas dire terrifiante. Tout autre à la place de M. Bondonnat eût été pris de panique et se fût sans nul doute réfugié à bord du vapeur américain, bien décidé à ne pas demeurer une minute de plus dans une île où il se passait de pareilles choses.
Le naturaliste n’eut pas un instant la pensée de céder la place à ses invisibles ennemis. La disparition – ou peut-être l’assassinat – de son fidèle cosaque l’irritait et le peinait profondément. Il ne prit que le temps de faire sa toilette et courut chez le gouverneur Noghi.
Le cauteleux Japonais le reçut, comme à son ordinaire, très aimablement. Il écouta son récit sans broncher, déplora avec lui que de pareils attentats fussent possibles dans un pays civilisé dépendant du sceptre du mikado, et, finalement, lui donna l’assurance formelle qu’il allait mettre en campagne tous les hommes de la police locale.
– Je suis désolé de ce qui vous arrive, conclut-il ; mais, comme je vous l’ai dit lors de votre arrivée, ces vols inexplicables sont très fréquents dans l’île de Basan, et, jusqu’ici, il nous a été impossible d’en découvrir les auteurs. Enfin, je vous promets que nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir.
M. Bondonnat se retira, ne conservant que peu d’espoir de retrouver le malheureux cosaque. Il se rendait compte que cette île était le siège d’une puissance occulte contre laquelle il n’y avait rien à faire. Il était furieux, désemparé, ne voyant nullement à quelle résolution il pourrait s’arrêter, enfin profondément humilié par la constatation de son impuissance.
Il rentra chez lui, mangea à la hâte quelques fruits en guise de déjeuner ; puis il eut l’idée d’aller conter ses malheurs à Louis Grivard. Il alla donc jusqu’à la caverne qui servait de demeure à l’artiste ; il ne trouva personne.
Décidément, tout se tournait contre lui.
Il passa le reste de la journée en proie à une agitation fébrile, allant et venant d’une pièce à l’autre de la villa et, sans qu’il se l’avouât à lui-même, pénétré d’une secrète terreur à la pensée de la nuit qui approchait.
Il songea d’abord à aller chercher Amalu et à se procurer, par l’intermédiaire de l’indigène, quelques hommes robustes pour le garder ; mais, après beaucoup d’hésitation, il y renonça. Il lui répugnait un peu de mettre qui que ce soit dans la confidence de ses frayeurs ; puis il se disait que le moyen de découvrir le mystère n’était pas de mettre en fuite les singuliers malfaiteurs qui le dévalisaient.
Le résultat de ces réflexions fut celui-ci : il n’appellerait personne, et il monterait la garde lui-même.
Il prit toutes ses mesures pour n’être pas surpris par le sommeil, il absorba plusieurs tasses de café très fort, se munit de son revolver et, laissant entrouverte la porte du jardin, il s’assit sous un massif de bambous, se levant de temps à autre pour ne pas se laisser engourdir par la délicieuse atmosphère qui s’échappait des feuillages mouillés de rosée.
L’air était d’une pureté cristalline. Des centaines de rossignols s’égosillaient dans les jardins du voisinage, et les grandes chauves-souris vampires passaient silencieusement devant la lune, sur leurs ailes de velours.
Mais M. Bondonnat était insensible au prestige de la nature tropicale. Il n’avait qu’une idée fixe. Prendre son voleur en flagrant délit, et par l’entrebâillement de la porte du jardin il surveillait l’autre porte, celle qui donnait sur la rue et qui se trouvait à l’extrémité du corridor du rez-de-chaussée.
Il était près d’une heure du matin, et le naturaliste commençait à se dépiter, lorsqu’il crut entendre un léger grincement à la serrure de la porte extérieure.
Bientôt la porte s’ouvrit silencieusement ; une forme se profila dans la pénombre du couloir et, de sa cachette, M. Bondonnat aperçut une étrange apparition.
C’était une jeune fille entièrement nue, sauf un lambeau d’étoffe qui lui couvrait à peine les reins et auquel était suspendu un petit sac de soie ; mais, ce qui l’intrigua au dernier point, c’est que la jeune fille, dont un rayon de lune montra le svelte torse cuivré, avait la tête couverte d’un de ces anciens casques japonais qui font aujourd’hui la joie des antiquaires et qui sont faits de lamelles d’écaillé ou de corne.
Détail stupéfiant, ce casque n’avait pas de trous à la place des yeux ; deux épaisses plaques de corne les bouchaient complètement. Il fallait que celle qui le portait fût aveugle.
L’apparition, qui tenait à la main droite un gros bouquet de fleurs pâles, d’une pénétrante odeur qui rappelait à la fois la tubéreuse et le narcisse, s’arrêta court en face de la porte du jardin et se mit à monter l’escalier qui conduisait au premier étage.
M. Bondonnat éprouva une violente émotion. Il sentait qu’il tenait enfin le premier anneau de la chaîne qui le conduirait à la découverte de la vérité.
– Évidemment, se dit-il, cette espèce de fantôme va encore me dévaliser, mais tant pis ! J’ai mes bank-notes dans ma poche. Elle ne les prendra toujours pas. Elle ne tardera sans doute pas à redescendre. Alors nous verrons !
Il ne s’était pas trompé. Au bout de cinq minutes, la jeune fille au casque reparut. Elle tenait toujours son bouquet qu’elle agitait d’un geste machinal ; mais M. Bondonnat aperçut, passés dans sa ceinture, une liasse de papiers et l’écrin où se trouvait renfermé l’appareil destiné à mesurer l’intensité des rayons ultraviolets, qu’il avait soigneusement enfermé, la veille, dans le petit meuble de camphrier.
Le naturaliste était prodigieusement intéressé par ce qu’il voyait. Toutes ses suppositions se trouvaient dépassées ; il lui semblait être au seuil d’un monde étrange, et il ne put réprimer un léger frisson en songeant à ce qu’il allait sans doute découvrir.
Glissant presque sans bruit sur le dallage du corridor, l’apparition était arrivée à la porte de la rue. Elle l’ouvrit avec une clé qu’elle prit dans le petit sac de soie pendu à sa ceinture, et elle sortit, laissant derrière elle, comme un sillage parfumé, la pénétrante odeur de son bouquet.
M. Bondonnat sortit une minute après elle, et, le cœur palpitant, lui emboîta le pas.
À sa grande surprise, elle ne se dirigea pas du côté de la ville de Basan, en ce moment plongée dans le sommeil. Elle prit le sentier qui s’enfonçait dans la forêt.
Du même pas égal, ses pieds nus foulaient la mousse épaisse et douce comme du velours. Des mouches phosphorescentes étaient venues se poser sur son casque noir et ajoutaient encore au fantastique de sa silhouette.
M. Bondonnat ne put s’empêcher de se comparer lui-même à un vieux magicien attiré par un démon femelle vers quelque gouffre infernal.
Un quart d’heure, une demi-heure se passèrent, ils marchaient toujours à travers le bois plein de rumeurs nocturnes : branches mortes qui se cassent, soupirs de bêtes en rut, rampements de couleuvres, bruissements d’insectes ou d’oiseaux dans leurs nids. Il semblait aussi au naturaliste que des voix chuchotaient à son oreille, lui criaient de retourner en arrière.
M. Bondonnat était brave. Pourtant, il se sentait petit à petit gagné par un étrange émoi. Son sang-froid l’abandonnait peu à peu, et, deux fois, il buta contre des racines tordues qui barraient le sentier, pareilles à une nichée de serpents entrelacés.
Enfin, il respira. Toujours sur les pas de son guide mystérieux, il venait d’entrer dans une large avenue bordée de platanes géants, aux troncs d’un gris pâle sous les rayons de la lune. Leur feuillage formait une voûte majestueuse et paisible, du haut de laquelle des lianes légères retombaient, en se balançant au moindre souffle de la brise.
À l’extrémité de l’avenue il y avait une haute muraille, au-dessus de laquelle apparaissaient les arbres d’un jardin. Au-delà des arbres, c’étaient les coupoles chatoyantes du temple bouddhique.
Tout ce paysage semblait peint sur un fond d’argent, avec des roses, des gris pâles, des bleus et des violets d’une ineffable douceur. C’était un vrai décor de songe ! M. Bondonnat, malgré ses préoccupations, ne put s’empêcher de l’admirer.
Soudain, l’apparition obliqua vers la gauche, s’engagea dans une avenue un peu moins large que la première, mais beaucoup plus obscure. Là, les feuillages étaient si épais que les rayons de la lune ne parvenaient pas à les traverser.
Bientôt, le vieux savant constata que l’avenue allait en se rétrécissant. Un moment vint où ce n’était plus qu’un sentier à peine suffisant pour le passage d’une seule personne ; ce sentier descendait par une pente rapide, et, des arbustes épineux le bordant à droite et à gauche, il fallait faire grande attention pour ne pas être déchiré au passage.
L’apparition ne semblait pas se soucier de ces obstacles ; elle allait toujours du même pas égal et rapide. M. Bondonnat avait grand-peine à la suivre, et, plusieurs fois, ses doigts s’ensanglantèrent, dans les ténèbres, aux épines acérées des végétaux.
Ils descendirent ainsi pendant un quart d’heure, puis ils remontèrent. Le sentier s’élargit graduellement, et M. Bondonnat eut la surprise de se trouver transporté de l’autre côté des murs du jardin ; cette haie épineuse, qui devait se continuer dans un passage souterrain, était une invention bien digne des complications d’une cervelle chinoise ou japonaise.
Le naturaliste regarda autour de lui. À une assez grande distance, il apercevait les majestueux bâtiments du monastère vivement éclairés par la lune. Devant lui s’étendait un jardin japonais aussi compliqué qu’un labyrinthe, avec ses allées tortueuses, ses petits ponts de rocaille, ses pièces d’eau et ses arbres torturés et difformes.
Au centre un grand Bouddha de pierre dominait tout le paysage de son bienveillant sourire et de son auréole dorée.
Ce jardin devait être rempli de fleurs magnifiques, et M. Bondonnat aspira voluptueusement le parfum qu’elles exhalaient. Il n’en avait jamais connu de plus troublant ; et, en essayant de l’analyser, il y retrouvait ces mêmes senteurs de tubéreuse et de narcisse qui avaient frappé ses narines lorsque l’apparition était passée à côté de lui.
– C’est, évidemment, dans ce jardin, se dit-il, qu’elle a dû cueillir son bouquet !
Il avait ralenti le pas. Il se remit à marcher plus vite en voyant que son guide se dirigeait du côté de la statue du Bouddha. Mais, tout à coup, elle disparut à ses yeux, aussi rapidement que si elle se fût évanouie en fumée.
Le naturaliste était profondément désappointé. Inutilement, il alla jusqu’au piédestal du dieu, puis il revint sur ses pas, s’égara dans le lacis compliqué des allées et des massifs. Il essaya de reconnaître l’endroit par où il était venu. Ce fut impossible.
Enfin, il se retrouva près d’un parterre de grandes fleurs pâles aux larges corolles – les mêmes fleurs que celles du bouquet – et il en respira de nouveau le parfum avec plaisir ; mais une demi-heure ne s’était pas écoulée qu’il sentait la tête lui tourner, ses idées chavirer dans le noir. Il ferma les yeux et roula à terre inanimé, presque aussi subitement atteint que s’il eût été frappé d’une balle en plein cœur.
Au-dessus du fantastique jardin, le Bouddha à l’auréole d’or souriait de son énigmatique sourire.
CHAPITRE IV
Un coin du voile
Amalu et sa fille Hatôuara s’étaient levés de bonne heure pour apporter à M. Bondonnat de beaux ananas et des pastèques. Ils furent fort étonnés, en arrivant à la villa, de trouver la porte ouverte et la maison vide.
– Le docteur n’est peut-être pas encore levé, dit la petite indigène. Montons jusqu’à sa chambre ; il ne nous en voudra pas de l’avoir réveillé.
Amalu trouva cette proposition toute naturelle. Avec cette naïveté et cette simplicité de mœurs qui font le charme de certaines peuplades océaniennes, ni le père ni la fille ne croyaient commettre une indiscrétion en allant souhaiter le bonjour à leur ami dans sa chambre.
Ils montèrent l’escalier, très surpris de ne pas rencontrer Rapopoff. La porte de la chambre à coucher était ouverte. M. Bondonnat était étendu sur son lit, tout habillé ; mais il était d’une telle pâleur qu’Amalu et Hatôuara le crurent mort.
– Comme il est pâle ! s’écria la jeune fille en se précipitant vers le corps inanimé du vieux savant. Son cœur ne bat plus !
La pauvre enfant avait les yeux humides de larmes.
– Tu te trompes, dit Amalu après un examen plus attentif, le cœur bat encore, bien faiblement… Mais, quelle étrange odeur règne dans cette chambre !…
Il s’empressa d’ouvrir la fenêtre.
Comme il revenait près du lit, son pied glissa sur quelque chose, et il trébucha.
– Qu’est-ce que c’est que cela ? fit-il en se baissant pour ramasser l’objet qui avait failli le faire tomber.
Il tenait entre ses doigts le pétale d’une fleur. Il l’approcha de ses narines pour le rejeter aussitôt avec une sorte d’horreur.
Hatôuara l’avait regardée faire avec surprise.
– Je sais maintenant, dit Amalu, pourquoi le docteur est malade. On a voulu l’empoisonner. Il est heureux que j’aie eu l’idée de venir le voir ce matin, car je suis peut-être le seul, dans l’île de Basan, à connaître le remède à son mal.
– Il m’a sauvée, s’écria l’adolescente. Comme je suis heureuse que nous puissions lui rendre le même service ! Crois-tu, père, que nous le guérirons ?
– Oui, ma chérie. Mais il n’y a pas de temps à perdre.
Amalu courut en hâte dans le jardin. Il cueillit une demi-douzaine de fleurs et de racines différentes, les pulvérisa avec une râpe, qu’il prit dans la cuisine, et en exprima le jus dans un verre qu’il acheva de remplir avec de l’eau pure. Secondé par Hatôuara, il parvint, avec son couteau, à desserrer les dents du malade, et, lui relevant la tête, il le força d’absorber à petits coups tout le contenu du verre.
L’effet de cette médication fut immédiat. M. Bondonnat ouvrit les yeux, ses joues se colorèrent légèrement, il jeta autour de lui des regards effarés.
– Oui, bégaya-t-il d’une voix faible, le Bouddha… avec son auréole d’or… le jardin… Je suis pourtant chez moi… Et la fille au casque noir, qu’est-elle devenue ?…
Amalu et sa fille comprirent que le vieillard avait le délire. Mais il ne tarda pas à reprendre possession de ses facultés, il reconnut ses amis et leur souhaita le bonjour.
– Je suis bien heureux de vous voir ! murmura-t-il. Depuis l’autre jour, il m’est arrivé d’étranges, de terribles choses…
Amalu l’interrompit.
– Va jouer dans le jardin, ordonna-t-il à sa fille. J’ai à parler sérieusement à monsieur le docteur.
Hatôuara obéit à l’injonction paternelle, mais non sans une petite moue qui prouvait combien elle était déçue de sa curiosité. Dès qu’elle fut sortie, l’indigène dit en baissant la voix :
– Vous avez failli mourir, monsieur le docteur. Je suis parvenu à vous réveiller ; mais il était temps ! Il faut éviter le retour d’un pareil malheur. Et, d’abord, je vais vous demander de me raconter très franchement ce qui vous est arrivé… Je pense que vous avez confiance en moi ?
– Entièrement. Vous allez tout savoir.
M. Bondonnat fit le récit très exact, d’abord des vols successifs dont il avait été victime, puis de son expédition dans les jardins du temple bouddhique. Son récit s’arrêtait naturellement à l’instant où il avait perdu connaissance. Toutefois, il ne pouvait s’expliquer comment il se retrouvait étendu sur son lit, chez lui, dans sa maison ; et il en venait à se demander s’il n’avait pas été victime de quelque hallucination.
– Tout ce que vous avez vu est réellement arrivé, dit gravement Amalu. Ce sont les bonzes qui vous ont rapporté chez vous. Votre qualité d’Européen leur a fait sans doute craindre quelques représailles, étant donné surtout que ce n’est pas la première histoire de ce genre qui leur arrive…
– Mais, demanda anxieusement le naturaliste, comment se fait-il que je sois tombé ainsi brusquement ?
– Vous avez respiré la fleur du sommeil.
– La fleur du sommeil ? demanda le savant avec surprise. Ce serait donc cette fleur aux grandes corolles blanches, dont le parfum est si délicieux ?
– Oui, dit Amalu en regardant autour de lui avec précaution comme s’il eût craint d’être entendu. Ce parfum est si pénétrant qu’il endort tous ceux qui le respirent et, s’ils le respirent trop longtemps, c’est la mort. Autrefois, avant l’occupation japonaise, beaucoup de crimes étaient commis grâce à cette fleur ! Les Japonais, en arrivant ici, ont fait détruire toutes les plantes qui la produisent et, s’il en reste quelques pieds, ce ne peut être qu’au milieu des forêts vierges. C’est, du moins, la version officielle.
– Mais, répliqua M. Bondonnat avec vivacité, j’en ai vu moi-même dans le jardin du temple bouddhique des parterres entiers, presque des champs !
– Vous avez raison, sans nul doute ; mais il ne serait pas prudent de proclamer trop haut cette découverte.
– Évidemment. Je m’en rends compte maintenant, les bonzes se sont réservé le monopole de ces attentats mystérieux qui restent toujours impunis… Pourtant, continua M. Bondonnat avec indignation, si le gouverneur savait qu’ils cultivent en si grande quantité ces plantes vénéneuses…
– Il le sait probablement aussi bien que vous et moi ; mais il n’oserait ni ne voudrait leur ordonner de les détruire. On ne peut pas supposer qu’un prêtre de Bouddha puisse commettre une mauvaise action.
Le vieil indigène ajouta, avec un soupir :
– Ah ! nos idoles d’autrefois valaient bien leur Bouddha !
M. Bondonnat demeurait silencieux. Au fond il était très satisfait. Le hasard et, aussi, son courage lui avaient permis de soulever un coin du voile du mystère. Il ne tarderait pas à connaître le secret tout entier.
– Enfin, demanda-t-il brusquement, vous connaissez le contrepoison de la fleur du sommeil, mon brave Amalu ?
– Je vous indiquerai bien volontiers les plantes qui servent à composer le breuvage que je vous ai fait absorber. C’est une recette qu’avec d’autres du même genre je tiens de mon père qui, lui-même, la tenait de son aïeul ; mais ce n’est pas celle-là qu’il faudrait connaître, elle est tout au plus utile, comme dans votre cas, pour rappeler à la vie ceux qui ont respiré de trop près la fleur mortelle.
– Que voulez-vous dire ?
– Ceci simplement. Les bonzes doivent posséder un moyen de résister aux effets de l’asphyxiant parfum.
– Sans doute, s’écria le savant pour qui cette réponse fut un trait de lumière, la jeune voleuse qui m’a dépouillé connaissait ce moyen !…
« J’y suis ! C’est dans le casque ! C’est là que devait se trouver l’antidote !
– Peut-être, fit Amalu ; mais pourquoi les yeux étaient-ils bouchés ?
– Cela n’est pas plus difficile à expliquer. La jeune fille qui s’est introduite chez moi devait être plongée dans le sommeil hypnotique ; probablement même qu’elle ignore le rôle qu’elle a joué. On l’a endormie, on lui a donné des ordres ; elle a obéi. Je commence à y voir clair dans cette affaire ; quelques fausses clés, qu’il a été facile de fabriquer, ont fait le reste.
– C’est peut-être plus compliqué que vous ne le pensez, dit Amalu dont le visage exprimait une vive préoccupation.
M. Bondonnat ne l’écoutait pas, suivant l’enchaînement de ses idées.
– Je reconstitue très bien les faits, dit-il. Rapopoff, endormi le premier, n’a pu empêcher qu’on ouvrît la porte de ma chambre, et, moi-même, j’ai été tout de suite victime du subtil parfum, qui doit être beaucoup plus actif dans un espace enfermé comme l’est une chambre.
– La puissance de la fleur est si grande que les insectes tombent engourdis au fond de sa corolle, en forme de coupe, et que les oiseaux qui s’en approchent de trop près battent des ailes et tombent. On a trouvé souvent des serpents morts parce qu’ils avaient eu l’imprudence de s’enrouler autour de sa racine.
– Il faudra qu’à tout prix je me procure quelques exemplaires de ce bizarre végétal, s’écria M. Bondonnat.
Puis, passant subitement à une autre idée :
– Mon cher Amalu, demanda-t-il, que croyez-vous qu’ils aient fait du pauvre Rapopoff ? J’espère qu’ils ne l’ont pas tué ?
– Non. Les bouddhistes ont horreur du sang. Il est presque sans exemple qu’ils commettent un assassinat, ou, quand cela arrive, c’est d’une façon tout à fait détournée.
– Comme dans mon cas, par exemple ?
– Précisément. Le cosaque doit être enfermé dans quelque crypte. Je ne serais pas étonné, d’ailleurs, qu’ainsi que beaucoup de ses compatriotes il n’appartînt ou n’ait appartenu à la religion bouddhiste.
À ce moment, Hatôuara fit irruption dans la chambre, avec sa vivacité habituelle.
– Eh bien ! s’écria-t-elle, est-ce fini, tous ces mystères ?
– Oui, mon enfant, dit Amalu.
M. Bondonnat demeurait silencieux. Ses yeux ne quittaient pas la petite indigène qui, insoucieuse à son ordinaire, avait laissé dans le jardin ses belles babouches brodées et venait de sauter à pieds joints sur la natte, encore couverte de farine de riz.
Le vieillard était suffoqué par la découverte qu’il venait de faire.
– Retourne encore un peu jouer dans le jardin, dit-il à la jeune fille d’une voix toute changée.
Hatôuara obéit, mais avec un sourire boudeur.
– Qu’y a-t-il donc ? demanda Amalu qui avait saisi le regard étonné du savant.
– Dois-je vous le dire ?… C’est cette pauvre petite Hatôuara qui a servi d’instrument aux bonzes.
Le visage bruni d’Amalu devint d’une couleur gris de cendre. Le pauvre diable était consterné.
– Ah ! monsieur le docteur, bégaya-t-il, si je croyais jamais que ma fille…
– Rassurez-vous… Je ne l’accuse pas. Elle ignore certainement tout ce qu’elle a fait. Elle ne s’est introduite chez moi que plongée dans ce sommeil maladif dont je vous ai expliqué les causes et le résultat.
– Mais comment avez-vous pu voir cela ?
– Regardez !…
M. Bondonnat fit voir au père d’Hatôuara l’identité des empreintes anciennement laissées sur la natte et de celles, toutes récentes, qu’avait tracées dans la farine de riz le petit pied de la jeune fille.
– C’est effrayant ! murmura l’indigène sincèrement consterné. Mais je vais appeler ma fille !…
– Gardez-vous bien de lui dire un seul mot de ce que je viens de vous confier ! Il faut qu’elle ignore tout ! Vous lui feriez du chagrin, sans que cela nous avance à rien. La pauvre petite m’aime beaucoup, je le sais !
– Que me conseillez-vous ?
– Gardez le silence. Et, cette nuit, si Hatôuara se lève, il faut la suivre. Je suis sûr, moi, qu’elle viendra directement ici !
– Je vous obéirai, dit Amalu en s’inclinant respectueusement. Mais, je vous en prie, ne gardez pas rancune à la pauvre petite du mal qu’elle vous a causé.
– Au contraire, dit M. Bondonnat qui avait reconquis sa belle humeur. Elle m’aura rendu un très grand service. Je suis sur la piste d’une découverte des plus curieuses, et c’est moi qui vous devrai de la reconnaissance.
Après de dernières et minutieuses recommandations, M. Bondonnat prit congé du père et de la fille, non sans les avoir régalés de gâteaux secs et d’un verre de son vin de riz.
Le savant était radieux.
– Décidément, murmura-t-il en aparté, tout va bien ! Aussi eût-ce été trop bête, à un homme comme moi, de se laisser rouler par des sauvages !
M. Bondonnat, après cette réflexion qui prouvait un certain amour-propre déjeuna avec un appétit formidable ; ce qui lui donna à penser qu’en outre de sa vertu dormitive la fleur du sommeil possédait aussi peut-être des propriétés apéritives. Maintenant qu’il croyait que Rapopoff n’avait pas été assassiné, il se sentait allégé d’un poids immense.
Sitôt qu’il eut pris son café, qu’il confectionna lui-même, le savant s’arma de son parasol de papier, et se mit en route pour la caverne de son ami Grivard. Mais, cette fois, au lieu de suivre le rivage, il passa par le bois. Le chemin qu’il avait pris l’amena devant la façade du temple bouddhique. L’aspect en était majestueux. Un escalier monumental, orné d’admirables monstres de bronze aux corps de reptile et aux têtes de chien, aboutissait à un péristyle soutenu par d’élégantes colonnes de granit cerclées de cuivre.
En avant, s’étendait une cour en hémicycle, où étaient installées des cabanes de bambou où l’on vendait des bâtons de parfum, des petites idoles d’ivoire et toutes sortes de curiosités et d’articles religieux.
M. Bondonnat s’arrêta longtemps à l’entrée de cette cour. Mais il ne fit pas qu’admirer exclusivement l’œuvre d’art, il tâcha de se faire une idée exacte de l’ensemble des bâtiments et de la manière dont ils étaient disposés. La façade qu’il voyait – il le comprit – devait être située à l’extrémité des jardins où il avait pénétré la nuit précédente, et c’était là un point de repère important.
Bien reposé par cette halte, M. Bondonnat continua son chemin. Il arriva bientôt à la baie qui servait de retraite à Louis Grivard. L’artiste était en train de déjeuner avec des noix de coco, dont il suçait d’abord le lait et dont il brisait ensuite la coque pour en extraire l’amande.
– Vous ne savez pas, dit Louis Grivard, comme votre visite m’a fait du bien. Je suis tout à fait guéri de ma mélancolie. J’ai reconquis toute mon énergie, et je suis sûr maintenant que je retrouverai Lorenza !
– J’ai, de mon côté, des choses intéressantes à vous raconter.
Pour la seconde fois, M. Bondonnat fit le récit de ses fabuleuses aventures de la nuit précédente.
L’artiste l’écouta jusqu’au bout, le regard brillant de fièvre, les traits crispés.
Le récit terminé, il se leva brusquement :
– Mon cher ami, dit-il, je vous promets que c’est moi, demain, qui aurai du nouveau à vous apprendre.
– Quels sont vos projets ?
– Je ne puis rien vous dire. Je ne vous demande qu’une chose, c’est de me prêter une barre de fer et un bon revolver. Cela m’est indispensable pour ce que j’ai résolu.
– J’ai, à la villa, ce que vous me demandez. Vous pourrez les prendre quand vous voudrez.
– Tout à l’heure !… Mais, comme je ne tiens pas à être vu, nous passerons par le rivage.
M. Bondonnat était passablement intrigué. Toutefois, il comprit qu’il était inutile de questionner Louis Grivard. Tous deux se mirent donc en route, paisiblement, en suivant la plage et en causant de choses indifférentes.
CHAPITRE V
L’idole vivante
M. Bondonnat employa le reste de la journée à écrire une longue lettre à sa fille et à rédiger un télégramme qui lui était également destiné. Après bien des tergiversations, il s’était décidé à laisser partir le paquebot sans y prendre passage.
Avec l’entêtement particulier aux savants, il ne voulait pas quitter l’île de Basan avant d’avoir eu la solution du problème dont il croyait déjà posséder les principaux éléments. Il en serait quitte pour prendre le paquebot suivant, et sa fille Frédérique, sa pupille Andrée de Maubreuil, rassurées par le télégramme qu’il leur faisait adresser, attendraient son retour sans inquiétude.
Après le repas du soir, il enleva de sa chambre la natte couverte de farine de riz, désormais inutile, et il attendit, avec une curiosité mêlée d’impatience, les événements nocturnes qui ne tarderaient sans doute pas à se produire.
Comme la veille, il s’installa dans son jardin, en laissant la porte entrebâillée. Il n’y avait pas de raison pour que ce stratagème, qui avait si bien réussi, n’eût pas de succès une seconde fois.
D’ailleurs, il ne prévoyait guère la venue de l’apparition – c’est-à-dire de la gentille Hatôuara – avant le milieu de la nuit. Mais une surprise lui était réservée.
Il était un peu plus de dix heures du soir lorsqu’on sonna à la porte extérieure. M. Bondonnat se précipita pour aller ouvrir. Il pensait que Rapopoff avait réussi à s’échapper. Mais, au moment de tourner la clé dans la serrure, il réfléchit qu’à une heure pareille il était peut-être prudent de n’ouvrir qu’à bon escient.
– Qui est là ? demanda-t-il.
– C’est moi, Amalu ! Ouvrez vite !
Le savant se hâta d’allumer une lampe et fit entrer son hôte dans la salle à manger. Amalu paraissait bouleversé.
– Vous aviez raison,’balbutia-t-il. Hatôuara, qui dormait tranquillement sur sa natte, vient de se lever, et je me suis bien aperçu qu’elle était sous l’influence des mauvais génies. Ses yeux étaient fixes, ses mouvements étaient brusques et saccadés, et j’ai eu beau me placer devant ses yeux, elle ne me voyait pas. C’était comme une morte que l’on eût forcée à sortir de son tombeau.
– Elle était en état d’hypnose, expliqua le naturaliste ; j’espère que vous ne l’avez pas réveillée ?
– Je m’en suis bien gardé. Je me suis rappelé vos recommandations. Je me suis contenté d’observer tout ce qu’elle faisait. Elle est d’abord allée dans une pièce où personne n’entre jamais, et où il y a toutes sortes d’objets hétéroclites : des coquillages, des vieux coffres, des porcelaines et d’anciennes armures. J’ai été stupéfié en la voyant ressortir de là avec le casque sans yeux dont vous m’aviez parlé.
– Elle n’a pas besoin de ses yeux puisqu’elle dort.
– Alors, elle est sortie de la maison de ce pas lent, presque machinal, qui a quelque chose d’effrayant. Elle a traversé les rues de la ville endormie et elle s’est dirigée vers la campagne.
– Elle se rendait au temple bouddhique ?
– Oui. Mais je n’ai pas osé la suivre de l’autre côté de la muraille du jardin. J’ai eu peur, et je me suis hâté de revenir sur mes pas pour vous prévenir.
– Eh bien, asseyez-vous là et attendez tranquillement. Je parie tout ce qu’on voudra qu’elle va être ici avant une heure.
À ce moment, le bruit léger d’une clé dans la serrure de la porte extérieure se fit entendre.
– Tenez, la voilà ! s’écria M. Bondonnat avec exaltation.
– Que faut-il faire ? demanda Amalu.
– Rien du tout. J’agirai seul.
Il alla se poster à la porte du jardin, qu’il ouvrit toute grande. Et, quand Hatôuara passa devant lui, il lui arracha d’un geste brusque le bouquet de fleurs du sommeil et le lança au loin dans le jardin.
La jeune fille, privée de son bouquet, avait eu un geste bizarre. Mais elle continuait à tenir la main fermée, comme si les fleurs eussent toujours été entre ses doigts.
– Venez vite ! dit le naturaliste au vieil indigène. Il faut que vous m’éclairiez !
Amalu prit la lampe ; tous deux, à la suite d’Hatôuara, gravirent lentement l’escalier. La jeune fille, marchant toujours de son pas fantomatique, alla droit au meuble de camphrier, et se mit à fureter dans les tiroirs.
– Voilà le moment propice ! s’écria M. Bondonnat.
Et il s’approcha, défit adroitement les agrafes qui retenaient le casque derrière la tête et l’enleva.
Hatôuara ne parut pas s’en apercevoir. Les yeux mi-clos, elle continuait à fouiller dans le tiroir, prenant au hasard des papiers qu’elle plaçait dans sa ceinture.
M. Bondonnat, lui, examinait le casque avec attention. Il constata qu’il était intérieurement tapissé d’une fine natte tressée avec des herbes qui répandaient une odeur amère et aromatique. L’air respirable ne pouvait arriver aux narines et à la bouche qu’après avoir traversé cette natte, trempée sans nul doute dans de puissants antidotes. Sans hésitation, M. Bondonnat se coiffa du casque, qui, beaucoup trop grand pour la jeune fille, lui allait à lui à merveille.
Il le mit, l’ôta et le remit à plusieurs reprises, pour être bien sûr du fonctionnement des agrafes.
– Qu’allez-vous faire ? demanda l’indigène qui suivait curieusement toutes les péripéties de cette scène. Voulez-vous que je vous accompagne ?
– Non. Je ne puis agir que seul. Je vous demande seulement de ramener chez vous cette pauvre Hatôuara et de ne plus vous occuper de rien.
M. Bondonnat considérait avec attention le casque – qui était, entre parenthèses, grâce à ses curieuses ciselures, une véritable pièce de musée.
Tout à coup, il prit dans un tiroir quelques outils. À la grande stupeur d’Amalu, il fit sauter les deux disques de corne, qui se trouvaient à la place des yeux, et les remplaça par deux verres convexes, empruntés à une paire de lunettes dont il se servait dans certaines expériences dangereuses. Les verres étaient, heureusement, du même diamètre que les disques. Le naturaliste les assujettit solidement à l’aide d’un peu de cire.
Pendant qu’il se livrait à ce travail, Hatôuara était allée regarder sous l’oreiller du lit, et, ne trouvant pas le portefeuille, elle était revenue au petit meuble qu’elle recommençait à fouiller.
Elle paraissait dépitée comme quelqu’un qui ne trouve pas ce qu’il cherche. Elle revint près du lit, puis retourna au petit meuble, renouvelant ce manège un grand nombre de fois avec tous les signes d’une mauvaise humeur manifeste.
Après avoir recommandé à Amalu de ne pas perdre de vue la jeune fille, M. Bondonnat descendit au jardin et, s’armant de son casque, il n’eut pas de peine à retrouver le bouquet de fleurs du sommeil. Comme il s’apprêtait à remonter, il se trouva en face d’Hatôuara, qui s’en allait. Sans hésitation, il lui approcha le bouquet des narines.
La jeune fille poussa un profond soupir, et soudainement, elle s’affaissa. M. Bondonnat n’eut que le temps de la recevoir dans ses bras, en se débarrassant de nouveau du dangereux bouquet, qui eût pu être nuisible à Amalu.
Celui-ci, sur un signe du naturaliste, avait pris Hatôuara, qu’il emporta sans peine, la tête penchée sur son épaule, car elle ne pesait guère plus qu’une enfant.
La porte se referma sur eux et M. Bondonnat, coiffé du casque magique, demeura seul dans sa maison.
– Voilà, murmura-t-il, qui est bien débuté. Je vais maintenant me rendre au temple bouddhique. Mais dois-je emporter le bouquet ? Je trouverai là-bas, dans le jardin, assez de ces étranges fleurs.
Après une minute de réflexion, M. Bondonnat se décida à se charger du bouquet, qui pouvait lui servir d’arme défensive. Il se munit aussi, à tout hasard, de son revolver et d’un solide couteau.
Ces dispositions prises, il se mit en route et refit, seul, le chemin qu’il avait parcouru la veille à la suite de la petite indigène. Il retrouva aisément la grande avenue de platanes, puis le sentier bordé d’arbustes épineux, dont il suivit la pente ténébreuse. Il admira avec quel art ceux qui avaient construit ce passage avaient su prolonger la haie d’arbustes en dessous des murailles. Enfin, le cœur battant d’émotion, il se trouva dans le féerique jardin, que dominait la statue géante du Bouddha à l’auréole d’or.
Cette fois, il eut grand soin de marquer, par plusieurs arbustes brisés et par une grosse pierre, l’endroit exact où s’amorçait le passage souterrain.
Marchant avec lenteur, pour ne pas se laisser égarer dans le labyrinthe des allées, M. Bondonnat se dirigea vers la statue du Bouddha.
Chemin faisant, il passa à côté de l’immense massif où s’épanouissait la fleur du sommeil, et il constata avec une vive satisfaction que l’odeur délicieuse, rappelant à la fois la tubéreuse et le narcisse, n’arrivait plus à ses narines. Ses prévisions étaient exactes. Le casque qu’il portait renfermait bien l’antidote qui permettait de braver la senteur mortelle.
Il s’arrêta un instant pour considérer la plante qui la produisait. Les feuilles en étaient larges et sombres, assez semblables à celles de l’acanthe ; les tiges, très droites, portaient à leur extrémité deux ou trois calices allongés, que terminaient six larges pétales d’une immaculée blancheur.
– C’est là, certainement, se dit-il, un végétal qui ne figure dans aucune nomenclature et qui n’a encore été étudié par personne. Il faudra absolument que j’en rapporte en France un ou deux pieds, avec les racines et la graine. De cette façon, mon séjour à l’île de Basan n’aura pas été inutile.
S’arrachant à ces considérations scientifiques, M. Bondonnat arriva bientôt jusqu’à une sorte de cloître soutenu par des colonnes, aux chapiteaux ornés de fleurs de lotus, et où aboutissaient plusieurs portes. Il en ouvrit une au hasard, se trouva dans un long couloir, qu’il suivit pendant quelque temps.
Une ombre se dressa devant lui. Un bonze, revêtu d’une robe gris cendré, lui barrait le passage. Le naturaliste fit le geste de porter son bouquet aux narines du religieux, et celui-ci tomba immédiatement à terre. M. Bondonnat put continuer son chemin.
Il poussa une autre porte, et se trouva dans une vaste salle aux voûtes majestueuses. Il comprit bientôt que c’était là le temple proprement dit.
Le sol était dallé de tables de marbre jaune, que recouvraient des nattes tressées avec des fils métalliques brillants comme de l’or.
Dans le fond du sanctuaire, s’élevaient trois effigies du Bouddha, entièrement dorées et d’une stature gigantesque. Le vieux savant entrevoyait tout cela à la lueur de grandes lanternes de papier, qui descendaient de la voûte et qui jetaient sur tous les objets une étrange lueur rouge et vert.
En face de l’autel, séparé de la nef principale par une balustrade, il y avait, dans des vases d’argent, de gros bouquets de fleurs, et des fumées d’encens s’exhalaient de cassolettes symétriquement disposées.
M. Bondonnat se disposait à traverser le temple, lorsque trois bronzes, en prière en face de l’autel et qu’il n’avait pas aperçus, se levèrent et s’avancèrent vers lui d’un air menaçant.
Le naturaliste alla droit à leur rencontre. Il savait qu’avec son bouquet il était invincible, et d’un coup d’œil il s’était rendu compte que ses trois adversaires n’avaient pas d’armes ; puis il y avait, dans leurs mouvements, une certaine hésitation et une certaine terreur, qui donnèrent à penser au naturaliste que ceux auxquels il avait affaire n’étaient pas au courant du secret de la fleur du sommeil.
La minute d’après, avant qu’ils eussent eu le temps de pousser un cri, les trois religieux avaient roulé à terre, et dormaient, étendus au pied de l’autel.
M. Bondonnat jugea prudent de dépouiller de sa longue robe gris cendré un des bonzes et de revêtir ce costume qui devait moins attirer l’attention. Ensuite, il traversa le temple dans toute sa longueur, passa devant de monumentales portes de bronze, qui, ouvertes pendant la journée, aboutissaient à l’hémicycle où il s’était arrêté la veille en allant rendre visite à Louis Grivard.
Finalement, il s’engagea sous une voûte qui le conduisit à un long couloir bordé de cellules à droite et à gauche ; les ronflements sonores qui s’en échappaient lui montrèrent que les moines étaient en train de se livrer au repos, et il ne jugea pas à propos de troubler leur sommeil.
À l’extrémité du corridor, il y avait un escalier que M. Bondonnat descendit à tout hasard, se disant que, si véritablement le cosaque était prisonnier des bonzes, ils devaient l’avoir enfermé dans un cachot.
L’escalier avait exactement soixante marches et M. Bondonnat, en pleines ténèbres, regretta alors de ne pas avoir apporté avec lui de quoi faire de la lumière.
Il se préparait même à remonter et à retourner au temple pour s’emparer d’une des lanternes pendues à la voûte, quand une faible lueur lui apparut. Il se dirigea de ce côté en suivant un interminable couloir et il se trouva bientôt dans l’endroit d’où partait la lumière.
C’était une vaste crypte, où l’air n’arrivait que par de rares soupiraux. Une grosse lanterne bleue l’éclairait ; c’était cette lueur que l’on apercevait des dernières marches de l’escalier.
En franchissant le seuil de cette crypte, M. Bondonnat aperçut un spectacle extraordinaire.
Tout au fond de la salle se dressait un autel de granit, sur lequel se trouvait, assise dans un fauteuil, une étrange statue, couverte, de la tête aux pieds, d’un nombre infini de colliers de perles. Il y en avait une si grande quantité que le torse n’était visible que par endroits.
Très intrigué, M. Bondonnat s’approcha de l’autel sur lequel était placé le fauteuil de porcelaine où était assise l’idole. Mais, tout à coup, il eut une exclamation de stupeur. Il venait de voir les seins de la statue s’enfler et s’abaisser, comme par le mouvement égal de la respiration d’une femme endormie.
L’idole était vivante !
Dans l’espace d’un éclair, M. Bondonnat se rappela les confidences de l’artiste.
– Lorenza ! s’écria-t-il. La guérisseuse de perles ! C’est elle ! ce ne peut être qu’elle !
Très excité par cette découverte, il se préparait à réveiller la jeune femme, à lui crier qu’il était venu pour la sauver, lorsqu’un bonze sortit brusquement de derrière l’autel.
Comme M. Bondonnat, le nouveau venu avait la tête couverte d’un casque protecteur, et, malgré sa surprise et son émotion, le vieux savant remarqua que le casque avait, à la place des yeux, de petites lames de mica, qui permettaient à celui qui le portait de voir clair autour de lui.
Contre cet agresseur inattendu, la fleur du sommeil devenait inefficace. M. Bondonnat battit précipitamment en retraite.
Le bonze, d’une vigueur herculéenne, eut vite fait de rejoindre le vieillard, de lui arracher son bouquet, qu’il lança au-dehors par un des soupiraux. Puis il le terrassa, lui mit un genou sur la poitrine et essaya de lui arracher son casque.
M. Bondonnat comprit qu’il était perdu. Haletant sous le genou de son ennemi, à demi étouffé, il eut quelques secondes d’angoisse atroce.
Le bonze était arrivé à retirer le casque de M. Bondonnat. Il contempla quelque temps le visage du vieux savant avec une étrange curiosité, comme s’il eût été étonné de sa capture.
– Au secours ! s’écria le naturaliste en faisant un violent effort pour se dégager.
Le bonze, pour le faire taire, lui appliqua brutalement sur la bouche une longue main brune, pareille à une patte de singe. Mais il ne put arriver à réduire M. Bondonnat au silence. Celui-ci continuait à appeler à l’aide, à crier : « Au secours ! à l’assassin ! » et se débattait de telle façon que, pour arriver à le mater, son ennemi dut le saisir à la gorge.
Il serra un peu, puis plus fort, et M. Bondonnat se tut, râlant, à demi étranglé.
C’est à ce moment qu’une des portes latérales, qui aboutissaient à la crypte, vola en éclats sous l’effort d’une vigoureuse pesée.
Un homme entra.
M. Bondonnat put reconnaître Rapopoff.
– À moi ! lança-t-il désespérément, en faisant un suprême effort pour se dégager.
Le cosaque était affublé, lui aussi, d’une longue robe gris cendré, qui lui donnait un aspect ridicule et qui eût paru comique en d’autres circonstances. Il brandissait un gros cylindre de bois, dont il eût été difficile de préciser l’usage. Mais Rapopoff eut vite fait de trouver un moyen de l’utiliser. Il en assena un grand coup sur la nuque du bonze, qui, assommé net, tomba sur sa victime.
Le cosaque était enchanté de son exploit. Il aida son maître à se relever, et lui montrant son cylindre :
– Hein, petit père ? fit-il, fameuse arme !
– Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda le naturaliste encore tout époumoné et hors d’haleine.
– Tout bonnement la meule du kouroudou… du moulin à prières… que l’on m’avait condamné à tourner dans mon cachot. Cet instrument de piété m’a été fort utile ! Je m’en suis déjà servi pour assommer deux ou trois bonzes, et, en particulier, celui qui m’apportait chaque jour à manger.
– Comment se fait-il que tu sois arrivé si à propos ?
– Je n’étais pas très éloigné de vous. Les cachots sont à côté de la crypte, et, dans le grand silence de la nuit, j’ai parfaitement reconnu votre voix. J’ai même distingué les mots : « Au secours ! à l’assassin ! »
– Allons, tout va bien ! s’écria le savant déjà remis de la secousse qu’il venait d’éprouver. Tu me raconteras tes aventures plus tard. Le plus pressé est de sortir d’ici, en emmenant cette jeune femme…
– Cette idole ! s’écria le cosaque avec une sorte d’épouvante.
– C’est une idole bien vivante, reprit le vieillard. Il faut que nous l’emmenions avec nous, ou, plutôt, que nous l’emportions, car elle me paraît plongée dans un sommeil causé par quelque drogue stupéfiante… Mais, auparavant, j’aurais bien voulu retrouver mes papiers et mes bank-notes.
– Je puis peut-être vous dire où ils se trouvent… Ils ne peuvent être que dans la chambre du supérieur. J’ai tout vu dans le monastère, et je sais que dans les cellules des simples religieux il n’y a qu’une natte pour dormir et une cruche d’eau.
M. Bondonnat réfléchit une seconde.
– Soit ! dit-il. Allons chez le supérieur, mais es-tu bien sûr au moins de pouvoir retrouver ton chemin, car tu sais qu’il faut que nous revenions ici chercher cette jeune femme.
– Soyez tranquille, petit père, je connais le monastère sur le bout du doigt, sauf une partie des jardins où l’on ne m’a pas permis d’entrer.
– J’en devine la raison.
– Pourquoi donc ?
– Je t’expliquerai cela plus tard. Pour le moment, dépêchons-nous. Nous n’avons pas une minute à perdre.
Tous deux remontèrent l’escalier. Auparavant, M. Bondonnat eut soin de placer sur la tête du cosaque le casque qu’il enleva au bonze, encore évanoui.
La chambre du supérieur ne se trouvait qu’à quelques pas du couloir bordé de cellules que M. Bondonnat avait déjà traversé.
La porte ne fermait que par un verrou de bois, Rapopoff l’ouvrit sans peine.
Tous deux entrèrent.
M. Bondonnat eut la surprise de trouver là une installation presque confortable. Il y avait même une horloge à cadran de cuivre et quelques meubles de provenance européenne ou japonaise.
La pièce était déserte. Pourtant, celui qui l’habitait n’avait pas dû la quitter depuis longtemps, car une lampe à pétrole brûlait encore sur la table. Il y avait gros à parier que le supérieur n’était autre que ce bonze qui avait failli étrangler le naturaliste et que Rapopoff avait si expéditivement assommé avec son kouroudou.
M. Bondonnat se mit aussitôt en quête de son bien. Par bonheur, il n’eut pas à faire de longues investigations. En ouvrant le tiroir de la table de travail, il aperçut, du premier coup d’œil, ses bank-notes, ses papiers, et même l’écrin qui avait contenu son appareil enregistreur.
Il s’empara rapidement du tout et redescendit dans la crypte, toujours suivi du cosaque, qui ne s’était pas séparé de son moulin à prières.
Mais, en entrant dans le temple souterrain, une terrible déception attendait M. Bondonnat.
L’idole vivante, la femme vêtue de perles, dans laquelle le naturaliste avait cru reconnaître Lorenza, avait disparu. L’autel était vide.
M. Bondonnat était désespéré.
– J’aurais bien mieux fait, s’écria-t-il, de laisser là papiers et bank-notes et de sauver cette, pauvre femme. Mais elle ne peut être loin ! Il faut absolument que nous la retrouvions !
Or, en cet instant, les sons lugubres et solennels d’un grand gong de bronze retentirent dans le silence de la nuit.
– Qu’est-ce que cela veut dire ? demanda M. Bondonnat.
Le cosaque donnait les signes de la plus vive terreur.
– Ce n’est pas, balbutia-t-il, pour appeler les moines à la prière qu’on fait un pareil vacarme. Je crains plutôt qu’on ne se soit aperçu de votre présence. Nous allons être pris comme des rats dans une ratière, car je ne sais comment on peut sortir !
– Conduis-moi seulement jusqu’au jardin, s’écria M. Bondonnat, et ne t’inquiète pas du reste.
Tous deux se jetèrent de nouveau dans l’escalier, dont ils gravirent les degrés quatre à quatre. Puis ils se mirent à courir éperdument dans les couloirs.
Aux sons du gong qui continuait à faire entendre ses mugissements, tous les bonzes s’étaient réveillés et sortaient, effarés, de leurs cellules. Des lumières paraissaient aux fenêtres du monastère. Partout, c’étaient des allées et venues, des bruits de pas, des exclamations, des chuchotements.
– Nous aurons fort à faire pour nous échapper, déclara M. Bondonnat au moment où ils entraient dans le grand temple, qu’il fallait traverser pour regagner les jardins.
Il n’avait pas achevé qu’un groupe d’une douzaine de bonzes se ruait sur les deux fugitifs. Rapopoff leva son terrible kouroudou et se mit à taper dans le tas, à tour de bras. On entendit un craquement d’os brisés : le cosaque venait de fracasser le crâne d’un des religieux. Les autres se sauvèrent en hurlant.
Quelques minutes après, M. Bondonnat et le cosaque arrivaient aux jardins, au centre desquels s’élevait le grand Bouddha à l’auréole d’or. Ils se dirigèrent, sans perdre un instant, vers le passage secret. Mais, arrivés à mi-chemin, ils furent assaillis par une grêle de projectiles. On leur jetait des pierres, on leur tirait des flèches et, même, des coups de feu éclatèrent ; preuve certaine que les bons religieux étaient pourvus de quelques armes bien modernes.
– Bah ! pensa le naturaliste, quand nous arriverons à un endroit que je connais bien, ils nous laisseront tranquilles.
En cela, il ne se trompait pas. Quand les bonzes s’aperçurent que leurs ennemis se réfugiaient près du massif des fleurs du sommeil, ils s’arrêtèrent net ; et M. Bondonnat eut la hardiesse d’arracher sous leurs yeux deux pieds entiers de la plante vénéneuse. Cet exploit accompli, il se hâta de regagner l’entrée du passage souterrain, qu’il reconnut sans peine.
Un quart d’heure plus tard, le cosaque et le naturaliste se trouvaient en sûreté dans la forêt.
M. Bondonnat empaqueta précieusement, dans sa robe de bonze, la plante qu’il venait de soustraire. Alors seulement, il put retirer son casque, et le cosaque en fit autant.
Le maître et le serviteur aspirèrent avec délice l’air frais du matin. Tous les arbres et toutes les plantes de la forêt étaient couverts d’une abondante rosée ; les oiseaux s’éveillaient par milliers dans leurs nids, et le ciel commençait à pâlir du côté de l’Orient.
– Je suis heureux de t’avoir délivré, dit le naturaliste à Rapopoff ; mais je ne me pardonnerai jamais de n’avoir pu sauver aussi la femme de mon ami, car je suis sûr que c’est elle ! Certes, je ne vais pas l’abandonner. Je sais où elle est ; il faudra bien que les bonzes nous la rendent. Dès que j’aurai pris quelques heures de repos, j’irai trouver le gouverneur Noghi, et je lui parlerai de verte façon.
Chemin faisant, le cosaque donna à son maître quelques explications sur sa captivité.
Rapopoff s’était, un beau matin, réveillé dans une cellule de moine, sans avoir jamais pu deviner de quelle façon on l’y avait transporté. Là, on ne lui donnait que quelques poignées de riz et un peu d’eau chaque jour, et on lui faisait subir de longs et minutieux interrogatoires.
M. Bondonnat crut comprendre que le gouverneur japonais n’était pas étranger à l’enlèvement de Rapopoff, qu’il avait sans doute pris, ainsi que son maître, pour un espion russe. Cette hypothèse expliquait parfaitement les vols de papiers et en même temps la négligence qu’avait mise le Japonais à rechercher les coupables.
Le résultat des réflexions de M. Bondonnat fut qu’il ne serait guère prudent pour lui de prolonger son séjour dans l’île de Basan, et, pourtant, le vieillard était bien décidé à ne pas abandonner Lorenza à ses geôliers.
Après cette nuit d’aventures, M. Bondonnat et le cosaque lui-même étaient brisés de fatigue. Ce fut avec un véritable bonheur qu’ils rentrèrent dans la villa, bien décidés à se reposer pendant toute la matinée.
Rapopoff se mit aussitôt en devoir d’allumer du feu et de confectionner une tasse de thé, pendant que M. Bondonnat passait dans sa chambre et se défatiguait par des ablutions d’eau glacée.
Il en avait à peine fini avec ces soins hygiéniques lorsqu’on frappa rudement à la porte extérieure. Il courut à la fenêtre et entrevit dans la pénombre – le jour commençait à peine à poindre – la robe grise d’un bonze.
– Diable ! grommela-t-il, voilà qui se complique ! Ces coquins viennent maintenant me relancer jusque chez moi ! Mais je suis bien décidé à ne pas me laisser intimider. Je vais leur répondre de la belle façon.
Il prit son browning et descendit rapidement pour aller ouvrir. Quelle ne fut pas sa surprise en se trouvant en présence du peintre Louis Grivard, qui soutenait par la taille une femme au visage horriblement pâle, encore vêtue d’une robe de bonze, et qu’il reconnut tout de suite pour l’idole vivante qu’il avait entrevue dans la crypte ! D’un coup d’œil, il constata que la jeune femme portait encore la splendide cuirasse de perles qui était son seul costume dans le temple souterrain.
L’artiste paraissait en proie à une vive exaltation.
– J’ai reconquis ma Lorenza, s’écria-t-il avec enthousiasme. Mais elle est comme morte. On dirait un corps sans âme. J’ai dû la porter pendant presque tout le trajet. Ou, alors, si elle marche, c’est comme un automate, ou comme un fantôme…
– Ce n’est rien, fit le naturaliste après avoir jeté un coup d’œil sur la jeune femme. Elle est seulement sous l’influence de quelque drogue hallucinatoire !… Bon ! j’y pense, j’ai précisément de quoi la guérir. Amalu m’a laissé, l’autre jour, la formule du breuvage qui m’a ramené moi-même à la vie.
Sans perdre une minute, le naturaliste courut à son jardin, en revint avec les plantes nécessaires, les râpa, et en ayant exprimé le suc, put bientôt présenter à la guérisseuse de perles un verre rempli du breuvage bienfaisant.
L’effet en fut aussi prompt qu’efficace. Au bout de quelques minutes, Lorenza ouvrit complètement les yeux, regarda autour d’elle avec une profonde surprise. À la vue de son mari, un faible sourire se dessina sur ses traits creusés par la fatigue.
– Où suis-je ? murmura-t-elle. Que m’est-il arrivé ?
Elle regardait avec stupeur les visages, inconnus pour elle, de M. Bondonnat et du cosaque Rapopoff.
– Rassure-toi ! dit vivement Louis Grivard, tu as été très malade ; mais, maintenant, tu es guérie, ma chère Lorenza ; et tu es avec des amis, M. Bondonnat, un Français, un grand savant, et ce brave cosaque, qui est le dévouement en personne.
Ce ne fut qu’avec d’infinies précautions que l’artiste, aidé de M. Bondonnat, finit par apprendre la vérité à la jeune femme.
– Il me semble que j’ai fait un mauvais rêve, murmura-t-elle. Je me sens si faible que je suis à peine capable de marcher.
– Nous vous soignerons bien, déclara paternellement M. Bondonnat.
Le savant et l’artiste se regardèrent.
– Vous savez, interrompit Louis Grivard, que le paquebot américain lève l’ancre à dix heures ?
– Mais alors, s’écria joyeusement le savant, nous avons encore le temps de le prendre ! J’ai hâte d’être loin de cette terre de malédiction ! Eh ! Rapopoff !…
– Qu’y a-t-il, petit père ?
– Dépêche-toi d’emballer, d’empaqueter n’importe comment tout ce qui nous appartient ! Puis tu courras le long du rivage jusqu’à ce que tu trouves une barque ; tu la loueras le prix qu’on t’en demandera, sans marchander, et tu diras à ses propriétaires de la conduire juste en bas du jardin.
– Mais s’ils demandent où vous voulez aller ?
– Dis-leur qu’il s’agit d’une simple promenade en mer. Et, surtout, tâche de te faire voir le moins possible. Tu n’ignores pas que les bonzes doivent nous en vouloir.
– Bah ! répondit insoucieusement l’artiste que le bonheur avait transfiguré et qui avait repris toute sa jovialité naturelle, ces fainéants ne sont pas si prompts à agir. Je crois que nous avons largement le temps de nous embarquer !
– Me direz-vous enfin, demanda brusquement le naturaliste, comment vous avez réussi à sauver Mme Lorenza ?
L’artiste eut un sourire.
– J’avais mon idée quand hier je vous ai demandé de me prêter une barre de fer. J’avais remarqué que la caverne qui me servait d’habitation avait dû être creusée de main d’homme, et j’étais persuadé qu’elle n’était que l’issue d’un long couloir souterrain qui devait aboutir à la pagode.
« Vos confidences m’avaient donné à supposer que Lorenza devait être prisonnière des bonzes. Je formai donc le projet de faire irruption chez eux en me servant du souterrain. Malheureusement, il était obstrué par les décombres. Vous devinez maintenant pourquoi je vous ai demandé une barre de fer. Quant au browning, il était, bien entendu, destiné à brûler la cervelle au premier de ces coquins qui aurait voulu me barrer le passage !
« Ce ne fut pas sans un pénible travail que j’arrivai à me frayer un chemin à travers les pierres éboulées. Comme je l’avais pressenti, je me trouvai dans un spacieux corridor souterrain aux murailles ornées de sculptures naïves. Je me munis de quelques branches de bois résineux, en guise de torches, et je m’enfonçai hardiment dans ces ténèbres, faisant lever sous mes pas des milliers de chauves-souris.
« Une fois un peu éloigné du rivage, je ne rencontrai plus heureusement que des éboulements insignifiants, et j’arrivai beaucoup plus vite que je n’aurais pu le supposer à l’autre extrémité de mon souterrain ; mais, là, le chemin m’était barré par une solide muraille de granit. D’après les calculs que j’avais faits, je devais, en ce moment, me trouver juste sous les fondations du monastère.
« J’étais fort embarrassé. Je ne m’étais pas attendu à cet obstacle. J’essayai de voir s’il n’y avait pas quelque porte secrète, quelque bloc virant sur lui-même. Rien. La muraille sonnait le plein sous les coups de ma barre de fer.
– À votre place, dit M. Bondonnat, j’aurais essayé de la démolir.
– C’est ce que je fis, mais en pratiquant des pesées dans l’interstice des pierres pour faire le moins de bruit possible, et j’eus la chance de tomber sur une muraille construite à la hâte, sans doute, et qui n’avait dû être destinée qu’à obstruer l’entrée du couloir aboutissant à la mer. Les pierres étaient de faibles dimensions et retenues par un mortier très friable. Je me demande ce que j’aurais fait s’il avait fallu m’attaquer aux énormes blocs de granit qui constituent les fondations du temple.
« Bientôt, je sentis que la paroi était devenue extrêmement mince, et je dus travailler avec beaucoup de précautions pour que ma barre de fer ne passât pas de l’autre côté. Enfin le trou était assez grand. D’un seul coup de barre, je fis tomber la lame de crépi qui, seule, maintenant, me barrait le passage, et je sautai d’un bond dans l’ouverture.
« Je me trouvai dans une crypte éclairée par une grande lanterne bleue. Je jetai un regard autour de moi, et je crus que j’allais devenir fou de joie… J’apercevais Lorenza, nue et couverte de perles des pieds à la tête, assise comme une idole sur l’autel !…
« Elle ne faisait pas le moindre mouvement.
« Tout mon sang se glaça dans mes veines. J’eus un instant la terrible pensée qu’elle était morte, embaumée, changée pour toujours en une muette idole.
« D’un bond, je sautai sur l’autel et je constatai avec un indicible bonheur, que ma Lorenza, quoique bien pâle, bien affaiblie, était encore vivante. Je la saisis dans mes bras, et je l’emportai jusqu’à mon trou, comme un tigre doit emporter sa proie. Je suis sûr qu’il ne s’écoula pas une minute depuis mon entrée dans le temple jusqu’au moment où j’en ressortis.
« Ma torche d’une main, maintenant de l’autre Lorenza dont la tête inerte reposait sur son épaule, je courais à perdre haleine le long du couloir.
« Pourtant je m’arrêtai, je revins sur mes pas chercher la barre de fer que j’avais oubliée, et, à un endroit où la voûte menaçait ruine, je provoquai – au risque de me faire écraser – un éboulement qui devait arrêter longtemps ceux qui tenteraient de me poursuivre.
« D’ailleurs, je croyais qu’on ne s’apercevrait pas immédiatement de ma fuite, car le trou que j’avais creusé aboutissait derrière l’autel et la lueur faible et presque brumeuse que jetait la lanterne bleue laissait dans l’ombre tous les recoins de la vaste salle.
– Si vous n’aviez pas sauvé madame, dit M. Bondonnat, c’était moi qui la sauvais. Il n’y avait pas une minute que vous étiez parti que j’entrai dans la crypte où j’avais déjà pénétré une première fois.
Le naturaliste fit, à son tour, le récit de ses aventures.
– Mais j’y pense, conclut-t-il, qu’allez-vous faire de toutes ces perles ? Le pittoresque costume que porte Mme Lorenza représente une somme fabuleuse.
– Je garde les perles, déclara résolument Grivard. Il y en a d’abord, dans le nombre, une grande quantité qui m’appartiennent, ou plutôt qui appartiennent à mon mandataire. Quant au reste, je crois que ce serait faire preuve d’une délicatesse ridicule que d’aller les reporter à MM. les bonzes. Qu’en pensez-vous ?
– Je vous approuve entièrement.
– Cela me fait penser, fit Lorenza d’une voix faible comme un souffle, qu’il faut pourtant bien que je me débarrasse de ces colliers, de ces bracelets et de ces ceintures qui m’enserrent de toutes parts, et que je prenne enfin un costume plus convenable que cette robe de bonze que Louis a trouvée derrière l’autel et qu’il a jetée sur moi au hasard pour m’emporter !
– Diable ! murmura M. Bondonnat, je n’avais pas pensé à cela. Mais commencez toujours par vous débarrasser de votre précieuse cuirasse dans mon cabinet de toilette. Je vous trouverai bien quelque coffre pour la serrer. Pour ce qui est du costume, je ne puis mettre à votre disposition qu’une robe de chambre japonaise.
– Cela suffira, répliqua vivement la jeune femme. En y ajoutant une ceinture, la robe de chambre sera bien assez bonne pour aller du rivage jusqu’au paquebot. À bord, nous trouverons sans doute tout ce qui nous manque.
M. Bondonnat regardait depuis quelques instants Louis Grivard.
– Vous n’allez pas m’accompagner avec ces haillons et cette barbe de sauvage ? lui fit-il tout à coup. Vous auriez d’autant plus tort que j’ai ici tout ce que vous pouvez désirer : veston, pantalon, chemise, et même une excellente paire de ciseaux. Je vous les offre de grand cœur.
L’artiste accepta cette proposition avec joie ; et, bientôt, il eut pris un aspect plus correct. Il paraissait rajeuni de dix ans. On n’eût jamais supposé que l’élégant gentleman qui venait d’apparaître dans la salle à manger de M. Bondonnat fût le même être mélancolique, sale et haillonneux que l’on voyait, étendu sur le sable de la baie, se repaître de fruits sauvages et de coquillages crus.
Lorenza, elle aussi, était complètement transformée. La robe de chambre de soie, à grands ramages, retenue par une légère ceinture, moulait ses formes sveltes ; ses beaux cheveux noirs étaient coquettement peignés à la mode japonaise, et son teint avait déjà perdu sa pâleur cireuse et repris les couleurs de la santé.
– Mon Dieu, que je suis heureuse ! s’écria-t-elle en se jetant d’un élan passionné dans les bras de son mari.
Les deux jeunes époux, étroitement serrés l’un contre l’autre, se parlaient à l’oreille ou s’embrassaient furtivement en véritables amoureux.
– Ce qui me rend le plus content, après le plaisir de te retrouver, s’écria Louis Grivard, c’est que nous allons pouvoir rembourser largement les avances de notre mandataire !
– Vous lui enverrez une dépêche au premier port où nous trouverons une station télégraphique, dit M. Bondonnat, qui ne s’était jamais senti aussi heureux.
Cette conversation fut interrompue par l’arrivée du cosaque, qui annonça que l’embarcation demandée se trouvait amarrée au pied même de l’enceinte du jardin.
On procéda en hâte aux derniers préparatifs. M. Bondonnat n’eut garde d’oublier les masques japonais qui lui avaient permis de traverser le jardin de la pagode. Il n’oublia pas non plus les pieds de la plante qui produit la fleur du sommeil, et il les empaqueta lui-même dans une petite caisse spéciale.
Le naturaliste ne se préoccupa même pas du mobilier de la villa, qui était pourtant sa propriété ; il savait que les minutes étaient précieuses, et il eût donné de bon cœur toutes les bank-notes qui se trouvaient dans son portefeuille pour être déjà loin de cette île néfaste.
Quoiqu’il lui en coûtât, il n’avait même pas voulu prendre le temps d’aller dire adieu à la gentille Hatôuara et à son père, Amalu. Mais il se promit de leur écrire et de leur envoyer tous les présents qu’il jugerait les plus capables de leur plaire parmi les productions de la civilisation occidentale.
Chacun transporta gaiement jusqu’au rivage les rares bagages qu’on emportait ; et l’on prit place dans l’embarcation que montaient deux robustes rameurs océaniens aux cheveux crépus, à la face souriante M. Bondonnat, guidé par la prudence, avait recommandé au cosaque de ne prendre aucun batelier de race japonaise ou tagale.
Le canot quitta le bord et se dirigea – assez lentement, à cause des récifs de corail – vers le paquebot américain, dont la coque se découpait clairement sur l’azur éblouissant du ciel et de la mer, et dont les cheminées lançaient des torrents de fumée noire.
– Je voudrais déjà, s’écria M. Bondonnat, être sous la protection du drapeau américain ! Je ne serai complètement tranquille que lorsque nous aurons mis le pied sur le pont du navire.
– Bah ! dit l’artiste, vous voyez bien que personne n’a cherché à nous inquiéter. Les bonzes étaient trop dans leur tort pour tenter quelque chose contre nous.
– Hum ! fit M. Bondonnat, je n’ai pas grande confiance dans ces gaillards-là !
Le savant fut interrompu par un des rameurs indigènes qui le tirait par la manche et lui montrait quelque chose de noir dans le sillage.
En regardant plus attentivement, il reconnut que cette tache noire était la tête d’un nageur ou plutôt d’une nageuse, car, au bout de quelques minutes, il reconnut la petite Hatôuara qui, fendant l’eau comme une sirène, ne se trouvait plus qu’à quelques mètres de l’embarcation.
M. Bondonnat était profondément touché.
– Pauvre petite ! murmura-t-il. Elle nous a vus partir, et elle n’a pas voulu que nous quittions l’île sans recevoir ses adieux.
Hatôuara était arrivée tout auprès du canot. Un des rameurs l’aida à s’y embarquer. Elle y monta ruisselante et nue. Puis, se jetant aux genoux de M. Bondonnat, elle lui embrassa la main. Sa physionomie avait une expression profondément suppliante et mélancolique.
– Voulez-vous de la petite Hatôuara pour votre esclave ? demanda-t-elle au botaniste. Je n’ai plus personne au monde.
– Mais ton père ? Lui serait-il arrivé malheur ?
– Ils l’ont tué, assassiné ! Je l’ai trouvé étendu sur sa natte, le cœur percé d’un poignard.
– Qui « ils » ? demanda M. Bondonnat, profondément troublé et affligé de cette terrible nouvelle.
– Les bonzes, les Japonais, que sais-je ? On n’a pas pardonné au pauvre Amalu d’être votre ami et de vous avoir arraché à la mort. Si vous ne me prenez avec vous, j’aurai certainement le même sort ! Quand j’ai vu votre barque quitter le rivage, j’ai senti mon cœur se serrer, et je me suis jetée à la mer pour vous demander si vous vouliez de moi.
– Eh bien, oui, c’est entendu ! s’écria M. Bondonnat dans un de ces élans de générosité dont il était coutumier. Tu es une brave enfant, et, après tout, c’est un peu moi qui suis la cause de la mort de ton père…
Hatôuara ne répondit qu’en embrassant avec tendresse les mains de M. Bondonnat et en les arrosant de ses larmes.
Il essayait de consoler de son mieux l’orpheline, lorsqu’il lui vint à l’idée qu’Hatôuara laissait derrière elle sa petite fortune et que, tout en l’emmenant, il serait peut-être bon de s’occuper de ses intérêts. Il demanda à la jeune fille si elle avait pris quelques dispositions à ce sujet.
– Hélas ! soupira la pauvrette, j’ai déjà fait le sacrifice de tout ce que je possédais. Je sais bien que, mon père une fois mort, le rapace Noghi ne tarderait pas à mettre la main sur sa succession ; aussi ai-je préféré ne pas même essayer de lutter.
On était arrivé à proximité du paquebot le Pacific, et ce fut avec un vrai bonheur qu’une fois les bateliers payés et congédiés M. Bondonnat et ses amis mirent le pied sur le pont du navire.
Le capitaine – un Yankee pur sang – ne fit au naturaliste aucune question. Il se contenta d’empocher les bank-notes qu’on lui tendait et de désigner les numéros des cabines réservées aux cinq passagers.
Le Pacific était surtout un navire de commerce, et il n’était pas aménagé pour le transport d’un grand nombre de voyageurs. M. Bondonnat constata avec regret qu’il n’était pas muni d’appareil de télégraphie sans fil, ce qui le forçait de ne prévenir sa fille qu’à son arrivée à San Francisco.
Pendant que chacun s’occupait de son installation, M. Bondonnat trouva, dans le salon des passagers, un journal américain de San Francisco qui ne remontait qu’à quelques jours et que le capitaine du Pacific tenait d’un de ses collègues, croisé en chemin.
Il le déplia machinalement. Puis ses yeux s’arrêtèrent sur un entrefilet placé en seconde page, et ce fut avec la plus profonde stupeur qu’il lut :
UNE IMPOSANTE CÉRÉMONIE
« La ville de San Francisco doit prochainement être le théâtre d’une solennité des plus imposantes. Le yacht la Revanche, qui doit ramener la dépouille du grand savant français M. Bondonnat, est impatiemment attendu dans notre ville.
« La remise du corps aux autorités françaises doit être l’objet d’une cérémonie officielle, où le gouvernement de l’Union sera certainement représenté.
« On parle aussi d’une délégation de savants américains, qui, sous la présidence du célèbre docteur Cornélius Kramm, l’éminent physiologiste que l’on a surnommé le sculpteur de chair humaine, doit rendre un suprême hommage au génial savant que fut M. Prosper Bondonnat. La fille et la pupille du défunt, dont on connaît les dramatiques aventures et l’héroïque dévouement filial, doivent conduire elles-mêmes le deuil en compagnie de leurs fiancés et de la famille du milliardaire Fred Jorgell… »
*
* *
– Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? se demanda M. Bondonnat devenu tout pensif. Je ne suis pourtant pas mort, que diable !
Il fut interrompu par la clameur stridente de la sirène à vapeur. Le Pacific avait levé l’ancre, l’hélice tournait. Le vieux savant oublia un instant toute autre préoccupation pour s’abandonner au plaisir de voir l’île de Basan s’atténuer petit à petit dans le lointain et se perdre enfin, comme un flocon de brume azurée, tout au fond de l’horizon.
QUATORZIÈME ÉPISODE
Le buste aux yeux d’émeraude
CHAPITRE PREMIER
Résurrection !
Depuis le matin, les rues de San Francisco présentaient une animation inaccoutumée. D’heure en heure, des centaines de trains débarquaient des milliers de voyageurs venus de tous les points de l’Amérique.
En dépit des efforts de quatre régiments de policemen à cheval qui se livraient, de temps à autre, à de véritables charges, il était à peu près impossible de circuler à travers cette multitude où se coudoyaient tous les peuples du monde : Américains, Chinois, nègres, Océaniens et jusqu’à des Esquimaux, encore vêtus, malgré la chaleur, de leurs blouses de peau de phoque et de leurs épaisses fourrures.
Des fenêtres des hautes maisons, presque toutes reconstruites en acier après le dernier tremblement de terre, des groupes nombreux se pressaient, et, dans certains endroits, des spéculateurs avaient dressé des estrades dont les places se louaient jusqu’à vingt, cinquante et cent dollars.
C’était sur le parcours des quais à la gare du Central Pacific Railroad que l’animation était la plus grande. Là, les policemen devaient livrer de véritables combats ; la marée humaine, sans cesse grossissante, se ruait par toutes les rues adjacentes, et cherchait à envahir la large avenue par où devait passer le cortège dont l’attente excitait à un si haut degré la curiosité des habitants de Frisco.
Au milieu de cette cohue, trois voyageurs, installés dans une automobile dont la plate-forme était chargée de nombreux bagages, n’arrivaient pas, en dépit de tous les efforts de leur chauffeur, à se frayer un passage.
Dans une autre ville que San Francisco, qui sert de rendez-vous à toutes les races de l’univers, le costume des voyageurs et leur allure n’eussent pas manqué d’attirer la curiosité des badauds ; mais ici, personne ne faisait la moindre attention à eux.
De ces trois personnes la première était un cosaque, facilement reconnaissable à ses yeux bridés, à ses pommettes saillantes et à son nez aplati ; il était vêtu d’un vieux costume de matelot, trop étroit pour sa grande taille, et coiffé d’une toque de fourrure ; la seconde était un vieillard à la barbe et aux cheveux blancs, à la physionomie pleine d’intelligence et de bonté. Il portait un élégant complet de coutil blanc et un chapeau en fibres de Panama ; enfin la troisième était une petite Océanienne, de quinze à seize ans tout au plus, tête nue, les cheveux relevés à la japonaise et retenus par de longues épingles ; elle se drapait dans un luxueux kimono de soie rouge brodé d’or.
– Je crois, dit tout à coup le vieillard, qui semblait observer cette foule avec un sourire ironique, que nous ne pourrons jamais arriver au Palace-Hotel. Qu’en penses-tu, mon brave Rapopoff ?
– Je pense, petit père, balbutia le cosaque, à qui cette multitude houleuse causait une sensation proche du mal de mer, ou tout au moins du vertige, que nous ferions mieux de retourner en arrière.
– Impossible, répliqua le vieillard. Il est aussi difficile de revenir sur ses pas que d’avancer.
À ce moment, une dizaine de voix hurlantes dominèrent le tumulte de la foule. C’était une bande de camelots auxquels on venait d’ouvrir la porte d’une imprimerie et qui se ruaient dans la bagarre, en criant :
– Demandez le numéro du San Francisco Herald ! Avec le portrait de l’illustre Bondonnat et le détail de ses obsèques !
On se battait pour leur arracher les feuilles, que certains badauds leur payaient jusqu’à un dollar. Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées qu’ils avaient épuisé leur provision de journaux ; on dut leur jeter de nouveaux numéros, des fenêtres de l’imprimerie.
La petite Océanienne regardait ce spectacle avec une surprise qui n’était pas exempte d’une certaine terreur, voyant et écoutant tout avec une attention suraiguë. Brusquement, elle tressaillit, et se tournant vers le vieillard :
– Mais il me semble, s’écria-t-elle, que c’est votre nom qu’ils prononcent !
M. Bondonnat ne répondit pas à cette question. Le sourire légèrement ironique, qui avait un instant déridé ses traits, avait disparu. Il était en proie à une fiévreuse impatience.
– Il faut pourtant que nous avancions ! dit-il au chauffeur.
– Impossible ! fit l’autre avec un geste résigné.
– Il y a cent dollars pour vous, si nous atteignons le Palace-Hotel ou seulement un café d’où je puisse téléphoner !
L’homme haussa les épaules :
– Quand vous m’en promettriez mille, répliqua-t-il, ce serait la même chose !…
Il ne put achever sa phrase. Un orchestre de cinq cents musiciens, qui se trouvait à peu de distance, venait d’attaquer la Marche funèbre de Chopin ; le rugissement des cuivres et les roulements lugubres des tambours couvraient même la voix de la multitude.
Mais, à ce moment, il se produisit dans la cohue une poussée formidable. L’automobile, enlevée par cent bras vigoureux, parcourut une trentaine de mètres par-dessus les têtes des spectateurs. Les trois voyageurs durent se cramponner à leurs sièges.
L’auto, projetée avec une puissance presque irrésistible, ne fut arrêtée dans son élan que par le régiment de policemen qui barrait l’extrémité de la rue. Mais, grâce à cette poussée brutale, elle se trouvait maintenant en bordure de l’avenue même où le cortège allait commencer à se dérouler.
M. Bondonnat et ses compagnons montèrent debout sur le siège pour mieux voir le spectacle qui s’offrait à eux. À peu de distance de là, ils apercevaient la gare du Central Pacific Railroad, toute tendue de velours noir orné de larmes d’argent et transformée en un gigantesque catafalque, éclairé par les flammes vertes de lampadaires de bronze. Toute la place qui s’étendait devant la gare n’était qu’un immense bouquet de fleurs. Il en était venu des trains entiers, hommage de tous les savants de l’univers à la mémoire de l’illustre Prosper Bondonnat !
L’avenue, de la gare aux quais, était également tendue de velours noir dans toute sa longueur. Tous les globes électriques étaient allumés et voilés de larges crêpes flottants, d’un aspect fantastique ; enfin, partout, à toutes les fenêtres, aux branches de tous les arbres, claquaient au vent des milliers de drapeaux américains et français, également cravatés de noir.
Au centre de la place, une estrade protégée par une tente de riches draperies était occupée par de graves personnages en habit noir, des diplomates et des généraux aux brillants uniformes.
Tout à coup, des vivats saluèrent l’apparition du cortège, que précédait une imposante escorte de policemen à cheval accompagnés d’un corps de la garde civique, immédiatement suivi par les cinq cents musiciens qui continuaient à jouer, en avançant lentement, la Marche funèbre de Chopin.
M. Bondonnat éprouvait un étrange saisissement. Ses mains amaigries tremblaient d’émotion, et, quand même la musique et le tumulte de la foule n’eussent pas couvert le bruit de sa voix, il n’eût pu parler, tant il avait la gorge serrée. Il se frottait les yeux pour s’assurer qu’il était bien éveillé, qu’il n’était pas en train de se débattre contre un cauchemar. Et il ne put s’empêcher de se comparer à Charles Quint qui, suivant une tradition, voulut assister lui-même, couché dans un cercueil, à ses propres obsèques, au monastère de Saint-Just.
Ce cortège, digne d’un roi ou d’un prince, continua à défiler devant ses yeux comme une étincelante vision.
Après les musiciens venaient, par douzaines, des voitures chargées de fleurs. Puis le char funèbre lui-même, orné aux quatre angles de torchères où brûlaient des flammes vertes ; il était surmonté d’un dôme de drap d’argent soutenu par quatre colonnes d’ébène. Le chauffeur, qui le conduisait avec une lenteur solennelle, était revêtu d’un habit à la française pompeusement galonné.
Derrière venaient plusieurs voitures de deuil, aux stores baissés.
À la pensée que sa fille se trouvait dans l’une d’elles, M. Bondonnat sentit le vertige le gagner. Il voulut s’élancer, crier ; mais son geste et son cri se perdirent dans la puissante rumeur de la multitude, dans le tonnerre des acclamations et des musiques.
Le vieillard se laissa retomber sur son siège, pâle, défait, à demi mort, regardant, d’un œil terne et comme brouillé par les larmes, la majestueuse cérémonie qui continuait à se dérouler selon les phases prévues.
Protégés par les policemen, dont la tâche devenait de plus en plus difficile, les représentants des diverses sociétés savantes, des États américains et des corps constitués étaient venus occuper, autour de la place, les estrades qui leur avaient été réservées.
Un petit groupe, au milieu duquel se remarquaient trois jeunes filles couvertes de longs voiles noirs, alla prendre place sur une petite estrade plus luxueusement décorée que les autres. Et l’on se répétait, dans la foule, que ceux-là qu’on honorait d’une distinction aussi flatteuse n’étaient autres que les parents et amis du défunt. M. Bondonnat se sentait défaillir.
– Ma fille ! ma chère Frédérique ! bégaya-t-il. Comment lui épargner cette douleur ?
Cependant le char funèbre s’était arrêté à côté de l’estrade où se trouvaient les savants et les diplomates, et annonça d’une voix claire :
– M. le docteur Cornélius Kramm va prendre la parole au nom des membres de la National Academy de New York…
M. Bondonnat, éperdu, vit alors se lever un personnage à la physionomie singulièrement caractéristique. Son visage, entièrement rasé, offrait des traits réguliers, et son front très haut, son crâne énorme annonçaient une puissante intelligence ; mais ses lèvres minces indiquaient une méchanceté froide et, derrière ses larges lunettes d’or, ses yeux sans cils étaient à la fois fixes et obliques comme ceux de certains oiseaux de proie.
– Cornélius ! le fameux docteur Cornélius ! se répétait la foule, le sculpteur de chair humaine !…
Le silence attentif de la multitude était devenu plus profond. Ce fut avec une aisance parfaite que le docteur Cornélius Kramm commença son discours.
– Messieurs ! Le savant, auquel nous venons rendre ici un juste et public hommage, fut une des plus nobles intelligences dont puisse s’honorer l’humanité. Grâce à lui, le savoir humain a accompli d’immenses progrès, et, si la mort n’était pas venue le frapper dans des circonstances assez mystérieuses, il aurait, sans nul doute, encore enrichi notre patrimoine intellectuel de découvertes comparables à celles qui ont tant contribué à sa gloire.
« M. Prosper Bondonnat est mort assassiné par les sinistres bandits de la Main Rouge, dans une île perdue de l’océan Pacifique…
Le docteur Cornélius, en proie à un trouble soudain, s’arrêta net, et ne put achever sa phrase.
Ses yeux, qui erraient distraitement sur l’assistance, venaient de rencontrer ceux de M. Bondonnat lui-même. Les deux regards s’étaient croisés, et Cornélius, malgré toute son audace, était tout à coup devenu d’une pâleur livide. Il ne se rappelait plus un seul mot de ce qu’il avait à dire.
– Messieurs, balbutia-t-il, excusez une émotion… bien légitime…
De longs murmures commençaient à s’élever dans la foule. Les uns s’extasiaient sur la sensibilité de ce bon docteur Cornélius, les autres trouvaient son attitude tout à fait étrange et incompréhensible.
La foule murmurait, mais sourdement. On devinait qu’il y avait, dans les esprits, comme une atmosphère de drame. C’était un de ces moments où l’on sent, sans savoir pourquoi, qu’il va se passer quelque chose d’extraordinaire. Cet « événement extraordinaire », on l’attendait. Il se produisit.
Dans la foule, à quelques mètres de l’estrade, un chien se mit à aboyer furieusement : un grand chien noir de la race des barbets. Puis il rompit sa chaîne que tenait un jeune homme pâle et chétif, un peu bossu, et s’élançant à travers les jonchées de fleurs, il atteignit en trois bonds l’automobile où se tenait M. Bondonnat.
Il lui léchait les mains ; il avait sauté sur ses genoux, et le vieillard, éperdu, ému jusqu’aux larmes, brisé par ces émotions successives, répétait d’une voix faible et cependant satisfaite :
– Pistolet ! Mais c’est mon bon chien Pistolet !
Des groupes nombreux commentaient l’incident et se demandaient quel était l’étrange vieillard, quand deux policemen, armés de leurs casse-tête de baleine à boules de plomb, s’approchèrent pour s’emparer de l’animal.
– Ce n’est pas ici la place d’un chien ! dit brutalement l’un d’eux.
Et il leva son casse-tête pour fracasser la tête du barbet.
– Je vous en prie, messieurs, balbutia M. Bondonnat. Ne faites pas de mal à ce chien qui m’appartient !
Le vieillard n’aurait peut-être pas eu le dessus dans la querelle, si le petit bossu, qui tenait encore en main le bout de la chaîne brisée, n’était intervenu tout à coup :
– Monsieur, commença-t-il, ce chien m’appartient…
Mais, quand il aperçut le visage de M. Bondonnat qui tenait Pistolet sur ses genoux et le protégeait de son mieux, il poussa un cri de surprise et de joie.
Et, s’élançant impétueusement dans l’auto :
– M. Bondonnat ! c’est lui ! vivant !…
Il avait pris les mains de son vieux maître et il les couvrait de ses baisers et de ses larmes.
Les deux policemen étaient demeurés stupéfaits, ne sachant ce que signifiait cette scène. Mais les paroles du petit bossu avaient été entendues de ses plus proches voisins, qui, presque tous, tenaient en main le numéro du San Francisco Herald, où se trouvait le portrait du savant.
Il leur suffit d’un coup d’œil pour découvrir la ressemblance du portrait et de l’original, et bientôt une rumeur courut dans la multitude, s’enfla et grandit comme le roulement lointain de la foudre.
Bientôt le même cri s’échappa de cent mille poitrines :
– Vivant ! Bondonnat est vivant !…
– Oui, s’écriait le bossu, il est vivant ! Le voici ! Venez vite, mon cher maître, vous jeter dans les bras de vos enfants et de vos amis !
– Vive Bondonnat ! cria une voix.
Ce mot fut le signal d’une acclamation générale. On voulait porter le vieux savant en triomphe. Une escouade de policemen était heureusement accourue au triple galop, et c’est grâce à leur protection que M. Bondonnat et Oscar, que suivaient le cosaque et la petite Océanienne apeurés et tremblants, purent arriver jusqu’au pied de l’estrade principale.
En apercevant le vieillard, une jeune fille s’était levée, pâle comme une morte sous ses longs vêtements de deuil.
– Frédérique ! mon enfant ! balbutia le vieillard.
– Mon père ! s’écria la jeune fille en étendant les bras.
Mais la secousse avait été trop brutale. Frédérique s’affaissa inanimée, morte peut-être, dans les bras de ceux qui l’entouraient.
– Je l’ai tuée ! s’écriait le vieillard avec désespoir.
Et, en proie à un véritable égarement, il voulait se précipiter sur le corps de la jeune fille.
À ce moment, deux policemen d’une taille athlétique l’empoignèrent avec rudesse et l’entraînèrent.
– Que me voulez-vous ? cria le malheureux savant. Laissez-moi, je vous en prie.
– Suivez-nous, lui répondit l’homme brutalement. Au nom de la loi, je vous arrête !
– Qu’ai-je fait ?
– Vous avez une fière audace de le demander ! Il faut que vous soyez vraiment effronté pour prendre le nom du grand savant et vous faire passer pour lui, au moment même où toute l’Amérique s’est dérangée pour assister à ses obsèques !
– Mais je vous jure que je suis bien Prosper Bondonnat, répondit le vieillard perdant tout sang-froid.
– C’est un fou, dit le second policeman qui jusqu’alors n’avait pas ouvert la bouche. Et, de fait, il lui ressemble un peu !
– Je vous jure que j’ai dit la vérité, répéta obstinément le vieillard.
– Allons, pas d’observations ! reprit le premier policeman. Vous vous expliquerez avec le chef du poste.
Tout en parlant, les deux agents qu’entouraient une vingtaine de leurs collègues avaient entraîné M. Bondonnat jusqu’au commissariat spécial de la gare. On le laissa seul dans une sorte de cellule qui n’était meublée que d’un lit de camp et d’un escabeau.
Le vieillard se demandait avec tristesse, en se voyant de nouveau captif, si la série de ses malheurs allait recommencer.
Au-dehors, il entendait des cris furieux, de longues acclamations, tout le bruit d’une tempête populaire, d’une véritable émeute.
Cependant, au milieu du désarroi qui s’était produit lorsque Frédérique était tombée, le bossu, Oscar Tournesol, s’était aperçu qu’on arrêtait son maître, et aussitôt il en avait prévenu l’ingénieur Paganot, le naturaliste Ravenel, Mlle Andrée de Maubreuil et miss Isidora, les deux meilleures amies de Frédérique.
– Mesdemoiselles, dit-il, occupez-vous, je vous prie, de soigner votre amie. M. Bondonnat vient d’être arrêté, il faut aller le plus vite possible à son secours. Je crains qu’il n’y ait là-dessous encore quelque coup de la Main Rouge.
Et Oscar, après leur avoir dit quelques mots à l’oreille, emmena avec lui l’ingénieur et le naturaliste.
Miss Isidora et Andrée de Maubreuil, qui avaient été presque aussi émues que Frédérique elle-même à l’apparition du spectre de M. Bondonnat, se raidirent contre leur émotion, et, en attendant que cet étrange mystère fût dissipé, s’empressèrent auprès de leur amie. Elles lui baignèrent les tempes d’eau fraîche, lui firent respirer des lavander salts, mais tous ces soins furent inutiles, Frédérique demeurait inerte et glacée.
– Mon Dieu, elle est morte ! s’écria Andrée. La joie et la surprise l’ont tuée !…
Les deux jeunes filles s’affolaient, perdant la tête, au milieu d’une foule de gens qui leur proposaient inutilement leurs bons offices.
Fred Jorgell survint heureusement. Il était parvenu à grand-peine à fendre la cohue pour arriver jusqu’à l’estrade. Miss Isidora lui expliqua la situation en quelques mots. Son premier soin fut de faire appel aux policemen, dont il était parfaitement connu, et qui, à l’aide de leurs casse-tête, firent place nette autour de l’estrade ; puis deux d’entre eux transportèrent Frédérique, qui ne donnait plus signe de vie, jusqu’au poste de secours dont la gare du Central Pacific Railroad est pourvue. Cornélius se faufila derrière en compagnie de Fred Jorgell, auquel il offrit obligeamment ses services, et celui-ci n’eut garde de refuser les soins de l’illustre praticien.
Avant de suivre le milliardaire, Cornélius avait eu le temps de dire quelques mots à l’oreille d’un correct gentleman qui avait suivi toute cette scène avec une anxiété visible et qui n’était autre que Fritz Kramm, le marchand de tableaux, le frère du docteur.
Cependant, dans toute la ville, le tumulte était à son comble, la foule était exaspérée par la curiosité et aussi par l’attente et la déception.
– Voyons, criaient les uns, Bondonnat est-il mort ou vivant ? Il faudrait le savoir !
– On se fiche de nous ! Ce fameux Français se porte aussi bien que vous et moi. Je l’ai vu !
– Je vous dis que non ! C’est un escroc qui lui ressemble !
– La preuve que Bondonnat est bien vivant, c’est que la musique ne joue plus, que les discours sont arrêtés, et que la fille de Bondonnat est morte de saisissement en apercevant son père !
Ce fait capital que musique et discours avaient cessé avait fait une grande impression sur la foule. Les Américains détestent, avant tout, qu’on se moque d’eux, et, dans cette occasion, ils se croyaient à peu près sûrs d’avoir été le jouet d’une mystification.
Ils commencèrent à manifester leur mauvaise humeur en cassant, à coups de pierres, les globes électriques et en culbutant les estrades d’où les notabilités étaient descendues, au milieu du désarroi général. Les Chinois, très nombreux dans la cohue, avaient été, dès le début, frappés de la beauté du velours noir frangé d’argent. Ils commencèrent à en arracher de larges morceaux, qu’ils emportaient sournoisement.
Ils furent, d’ailleurs, bientôt secondés dans ce travail par des bandits de toutes les nations, qui abondent à San Francisco. Comme par magie, l’avenue qu’avait suivie le cortège funèbre se trouva dépouillée de tous ses ornements.
La foule, pour qui ce pillage n’avait été, pour ainsi dire, qu’un avant-goût, était maintenant déchaînée. Elle houlait, comme la mer battue par l’ouragan. Les policemen ne savaient plus où donner de la tête. C’était une véritable émeute qui grondait ; quelques matelots commençaient déjà à briser les vitres des boutiques, et les commerçants fermaient leurs devantures en toute hâte.
Au milieu de ces scènes de désordre, les chars qui portaient les couronnes ne furent pas plus respectés que le reste, la multitude les culbuta et s’empara d’une partie des fleurs, foulant les autres aux pieds.
Une quarantaine de miliciens à cheval défendirent courageusement le char funèbre sur lequel se trouvaient les restes – authentiques ou non – de M. Bondonnat. Ils s’étaient retranchés à l’entrée d’une petite rue latérale ; mais ils allaient sans doute être obligés de céder à la canaille, qui tenait à s’emparer des torchères d’argent et des riches draperies, lorsqu’une auto vint stopper derrière les miliciens.
Elle était escortée par une vingtaine de robustes matelots, et l’homme qui la conduisait était celui-là même auquel le docteur Cornélius avait fait, une demi-heure auparavant, de mystérieuses recommandations. C’était Fritz Kramm.
Il fit entendre au chef des miliciens qu’il avait mission de mettre en lieu sûr le cercueil du grand savant ; on n’avait aucune raison de ne pas ajouter foi à ses allégations.
Le cercueil fut donc chargé dans l’automobile qui se perdit bientôt dans l’enchevêtrement des petites rues qui s’étendent entre le port et la gare du Central Pacific Railroad. Les miliciens battirent en retraite, et la foule en profita pour démolir entièrement le superbe char funèbre, dont elle se partagea les débris.
Pendant que cette scène avait lieu, l’ingénieur Paganot, le fiancé de Mlle Andrée de Maubreuil, le naturaliste Roger Ravenel, le fiancé de Frédérique, avaient suivi le bossu Oscar Tournesol jusqu’au commissariat spécial de la gare. Là, ils demandèrent à être mis en présence de l’homme qui se faisait passer pour M. Bondonnat ; le chien Pistolet les avait suivis en continuant à aboyer énergiquement, comme s’il eût été exaspéré de l’erreur dont son maître était victime.
L’officier de police se fit d’abord un peu tirer l’oreille, mais quand Roger Ravenel, qu’il savait être un ami du milliardaire Fred Jorgell, eut déclaré qu’il se portait caution pour la somme que l’on exigerait, si considérable fût-elle, toutes les objections tombèrent, et M. Bondonnat fut amené dans le bureau où se trouvaient déjà le commissaire spécial et les trois jeunes gens.
Le vieux savant était heureusement muni de pièces qui établissaient son identité et qui se trouvaient dans son portefeuille lorsqu’il avait été conduit à l’île des pendus. De plus sa ressemblance avec une photographie de M. Bondonnat, dont l’ingénieur Paganot était porteur, formait un sérieux argument. Enfin les aboiements et les caresses de Pistolet ne permettaient guère de conserver de doutes sur la personnalité réelle du vieillard.
– Mais enfin, demanda le commissaire spécial à qui cette aventure extraordinaire inspirait la plus grande méfiance, pourquoi, si vous êtes bien le véritable Bondonnat, n’avez-vous pas prévenu votre fille dès votre arrivée ? Vous auriez évité l’émeute qui, en ce moment, se déchaîne dans la ville, et dont vous êtes responsable.
– Monsieur, cela m’a été absolument impossible. Il y a deux heures à peine que le vapeur le Pacific, sur lequel je m’étais embarqué à l’île de Basan, a jeté l’ancre dans le port, et vous savez vous-même qu’il n’y a pas moyen de circuler dans la ville. Puis j’ignorais où se trouvait ma fille. J’ai fait vainement les plus grands efforts pour atteindre le Palace-Hotel, d’où je comptais téléphoner.
Le commissaire spécial réfléchit un instant.
– J’éclaircirai tout cela, murmura-t-il.
– Alors, demanda l’ingénieur Paganot, M. Bondonnat va être remis en liberté ?
– Soit ! mais à condition que vous répondiez de sa personne. Je vous ferai connaître tantôt à quelle somme je fixe le chiffre de sa caution.
– Messieurs, je vous en supplie, balbutia le vieillard que cette succession d’émotions violentes avait complètement anéanti, je vous en conjure, dites-moi si ma chère Frédérique est sauvée !
– Vous allez le savoir à l’instant même. Le poste de secours où elle a dû être transportée se trouve dans la gare.
– Je vais prendre de ses nouvelles ! s’écria impétueusement Roger Ravenel.
– J’y vais aussi, ajouta M. Bondonnat.
– Non, cher maître, dit l’ingénieur Paganot. Restez ici. Il est plus prudent de ne pas exposer Mlle Frédérique à une seconde commotion.
– Vous avez raison, murmura le vieillard en tombant anéanti sur un siège.
L’ingénieur n’avait pas dit le fond de sa pensée et, s’il avait retenu M. Bondonnat, c’est qu’il se disait avec angoisse que peut-être la jeune fille avait succombé au choc terrible qu’elle avait ressenti en voyant se dresser devant elle le spectre de son père.
Heureusement, ses craintes étaient exagérées. Quelques minutes plus tard, le naturaliste revint, la physionomie radieuse.
– Rassurez-vous, mon cher maître, dit-il, notre chère Frédérique a enfin recouvré ses sens, et cela, je dois le dire, grâce aux soins du docteur Cornélius qui a tout mis en œuvre pour venir à bout de la syncope.
Dès lors, il ne fut plus possible de retenir M. Bondonnat. L’instant d’après, le père et la fille se jetaient en pleurant dans les bras l’un de l’autre. Quant au docteur Cornélius, il s’était modestement éclipsé, sans doute pour échapper aux remerciements.
L’ingénieur Paganot, Roger Ravenel, miss Isidora, Andrée, Fred Jorgell et le bossu, Oscar Tournesol, n’étaient guère moins émus que M. Bondonnat et sa fille.
Le commissaire central mit fin à cette scène attendrissante en priant le milliardaire et ses amis de monter dans une auto qu’il avait fait venir et qui, sous bonne escorte, les conduirait tous au Palace-Hotel.
Chacun s’empressa d’obéir. Une demi-heure plus tard, tous les amis se trouvaient réunis dans un des salons du luxueux caravansérail, qui passe pour être le plus vaste de toute l’Amérique. Là, le premier soin de M. Bondonnat fut de téléphoner au Police-Office, en promettant une forte prime pour qu’on retrouvât le cosaque Rapopoff et la petite Océanienne, qui s’étaient perdus dans la foule en cherchant à le suivre, et que, dans son émotion, il avait un instant complètement oubliés. Deux policemen, d’ailleurs, les ramenèrent dans la soirée.
M. Bondonnat, qui, transporté de bonheur en se retrouvant au milieu des siens, avait oublié toute sa fatigue, fit le récit détaillé de ses étranges aventures.
– J’adopterai la petite Hatôuara, déclara Frédérique. Je veux que cette pauvre orpheline soit instruite et éduquée convenablement par mes soins. Mais pourquoi, mon père, n’avez-vous pas amené avec vous, pour nous les faire connaître, le peintre Grivard et la charmante guérisseuse de perles ?
– Je les ai priés tous les deux de m’accompagner, mais Lorenza a éprouvé de telles souffrances, pendant sa captivité chez les bouddhistes, que sa santé en a été fortement ébranlée. Elle a dû demeurer à bord, d’où elle prendra le premier train rapide en partance pour New York. Tous deux m’ont promis, d’ailleurs, que nous nous reverrions en France, et il est entendu qu’aussitôt notre retour Lorenza et son mari viendront passer quelques semaines dans notre villa bretonne.
« Quant au cosaque, déclara le naturaliste, nous en ferons un garçon de laboratoire émérite… s’il parvient à se corriger de l’habitude de vider des flacons d’alcool et de se confectionner des tartines avec certains produits chimiques.
M. Bondonnat, après avoir terminé le récit de ses aventures, attendait avec impatience qu’on lui fît connaître la manière dont on avait découvert sa retraite et dont on s’était emparé de l’île des pendus.
Ce fut l’ingénieur Paganot qui se chargea de cette narration, en donnant les plus vifs éloges à l’ingéniosité et au courage de lord Astor Burydan. Il dit comment l’excentrique avait eu l’heureuse idée de prendre à son service tous les clowns du Gorill-Club ; comment le nageur Bob Horwett avait détruit les torpilles ; enfin, comment les bandits, déjà terrifiés par les visions cinématographiques projetées du pont de l’Ariel, avaient été vaincus et anéantis en bataille rangée.
– Mais, demanda M. Bondonnat, que sont devenus les bandits de la Main Rouge ? Il y en avait parmi eux quelques-uns qui étaient d’assez braves gens.
– Le lendemain même de notre victoire, un croiseur de l’État – que les démarches de Mr. Fred Jorgell avaient enfin décidé le gouvernement américain à envoyer à notre secours – est venu jeter l’ancre en face de l’île et a pris à son bord tous les bandits ; ils doivent être jugés ultérieurement. Quant aux Esquimaux, on ne s’est pas occupé d’eux.
– Et les Russes ? Et le prophète Rominoff ? demanda encore M. Bondonnat.
– On a pris les mesures nécessaires pour qu’ils soient ramenés en Europe.
– En somme, reprit le vieillard, dans cette étrange aventure tout s’est terminé mieux que nous n’aurions pu l’espérer ; mais il y a trois personnes qui manquent à cette réunion. D’abord l’ingénieur Harry Dorgan, dont j’aurais été enchanté de faire la connaissance…
– Vous le verrez d’ici peu, répliqua Fred Jorgell. Il est en ce moment à New York, où l’extension qu’a prise la Compagnie des paquebots Éclair rend sa présence indispensable.
– Mais lord Burydan et le fidèle Kloum, le Peau-Rouge, n’ont pas les mêmes excuses ! dit en riant le vieux naturaliste, et il me semble que leur place était tout indiquée à mes obsèques ?
– Vous savez, répondit Roger Ravenel, que lord Burydan est l’homme le plus fantasque qui soit. Il n’en fait qu’à sa tête. Sitôt que nous avons été arrivés à San Francisco, il nous a quittés sans dire où il allait, en compagnie de Kloum et d’un Français nommé Agénor Marmousier, qui est en même temps son ami et son secrétaire. Mais, soyez tranquille, lord Burydan est de ceux qui ne restent jamais longtemps sans que l’on entende parler d’eux.
M. Bondonnat et ses amis ne se couchèrent qu’à une heure fort avancée, le soir de cette mémorable journée. Tous étaient brisés de fatigue, mais enchantés que les choses se fussent terminées de si heureuse façon.
Le lendemain, le premier soin de M. Bondonnat fut de se rendre au Police-Office, d’abord pour y déposer une caution comme il l’avait promis, puis pour savoir ce qu’était devenu le cadavre embaumé auquel les bandits de la Main Rouge avaient réussi à donner sa propre ressemblance. Il ne doutait pas que l’examen attentif de cette curieuse pièce anatomique n’amenât de singulières découvertes.
Malheureusement, ainsi que le lui apprit le directeur de la police de San Francisco, le cercueil où se trouvait le corps du prétendu Bondonnat avait disparu dans la bagarre. Les recherches les plus minutieuses ne donnèrent aucun résultat. On supposa qu’à la suite de l’émeute le cercueil avait dû être jeté à la mer. Il fallut renoncer à savoir ce qu’il était devenu.
Est-il besoin de le dire, les poursuites commencées contre M. Bondonnat ne furent pas continuées. La somme qu’il avait déposée en guise de caution lui fut rendue.
Bientôt, les journaux annoncèrent que le vénérable savant, dont la santé était complètement rétablie, avait consenti à passer quelques semaines en Amérique dans les propriétés de son ami, le milliardaire Fred Jorgell, avant de regagner définitivement la France. Les mêmes journaux annonçaient le triple mariage de Mr. Harry Dorgan et de miss Isidora, de M. Roger Ravenel et de Mlle Frédérique Bondonnat, de M. Antoine Paganot et de Mlle Andrée de Maubreuil.
CHAPITRE II
Une visite inattendue
Trois mois après ces événements, un lourd camion automobile, qu’escortaient huit cavaliers armés jusqu’aux dents, suivait lentement la belle route ombragée de platanes qui longe la rive méridionale du lac Ontario.
En cet endroit, le paysage est un des plus beaux qui se trouvent dans l’Amérique du Nord. La nappe immense du lac, d’un bleu presque blanc, est couverte de centaines de petites îles verdoyantes que l’on appelle les Mille Îles et qui semblent autant de bouquets flottant sur la calme surface des eaux limpides. Sur beaucoup de ces îles sont installés de délicieux cottages, construits en briques de couleurs vives, qui donnent de loin à ce paysage l’aspect d’un royaume enchanté. De riches canots d’érable, d’acajou, élégamment pavoisés et couverts de tentes multicolores, vont d’une île à l’autre. Toute idée de fatigue, de labeur et de misère est absente de ce décor gracieux.
Cette opinion était sans doute celle des cavaliers qui escortaient le camion, car ils n’avançaient qu’avec une nonchalante lenteur, s’arrêtant même de temps à autre pour admirer ce site merveilleux dans tous ses détails.
Cependant, ils étaient arrivés à un endroit où la route était bordée par une muraille monumentale, au-dessus de laquelle on apercevait les arbres d’un parc presque entièrement planté de gigantesques thuyas. Ils longèrent cette muraille pendant environ un mille, et arrivèrent enfin en face d’une haute grille de fer forgé près de laquelle s’élevait un coquet pavillon qui devait être l’habitation d’un garde.
Un homme à longue barbe et à lunettes, qui paraissait être le chef de la petite caravane, fit tinter la cloche destinée à signaler l’arrivée des visiteurs. Aussitôt, un robuste personnage à la face rubiconde et aux vastes épaules sortit du pavillon, et, considérant le nouveau venu d’un air soupçonneux :
– Que désirez-vous ? demanda-t-il d’une voix brève.
– Sir, répondit le visiteur, je suis chargé de remettre en mains propres à mistress Isidora un cadeau que lui adresse son beau-père, le milliardaire William Dorgan.
– C’est que, reprit le gardien avec méfiance, j’ai des ordres très rigoureux.
– Je suis muni d’une lettre de Mr. William Dorgan.
– Possible. En ce cas, vous allez entrer seul et je vais vous conduire à l’intendant général, Mr. Bombridge. C’est lui qui décidera si, oui ou non, je dois laisser votre fourgon franchir la grille.
– Soit ! fit l’inconnu sans impatience. Sur le vu de ma lettre, Mr. Bombridge me laissera certainement entrer.
L’inconnu descendit de cheval, franchit une petite grille latérale et suivit le gardien le long d’une allée sablée, bordée de gigantesques rhododendrons dans des caisses de cèdre. Tous deux arrivèrent bientôt en face d’un chalet de pitchpin aux élégantes balustrades qu’ombrageaient des érables magnifiques. Une blonde jeune fille, qui se tenait au balcon du premier étage, se hâta d’aller au-devant des visiteurs.
– Bonjour, monsieur Bob Horwett, dit-elle au gardien.
– Bonjour, miss Régine. Je vous amène quelqu’un qui voudrait parler à votre père.
– Entrez donc. Il est précisément dans son cabinet.
L’ex-clown Bombridge, devenu intendant général de la propriété d’Harry Dorgan, n’avait rien perdu de sa bonne humeur. Il portait un complet de velours vert et un chapeau de feutre, surmonté d’une plume de canard sauvage, qui lui donnait une allure tout à fait distinguée. Il invita ses hôtes à se rafraîchir, prit connaissance de la lettre de William Dorgan, puis s’absenta pour aller téléphoner au « château ». Il revint bientôt en déclarant que le camion pouvait entrer, mais que les hommes de l’escorte devaient rester en dehors de la grille.
Les choses étant ainsi réglées, il accompagna lui-même Bob Horwett et le représentant de William Dorgan pour veiller en personne à l’ouverture et à la fermeture de la grande grille de la propriété, qui, on le voit, était gardée comme un château fort.
Le camion, que conduisait Bob Horwett lui-même, s’engagea dans une longue avenue de frênes de Virginie, au bout de laquelle se trouvait une sorte de pont-levis jeté sur un bras du lac Ontario et qui donnait accès dans le parc proprement dit.
Le magnifique château d’Harry Dorgan – réduction exacte du fameux château de Chambord – se trouvait renfermé, ainsi que le vaste jardin qui l’entourait, dans une des îles de l’Ontario et n’était relié à la terre que par ce pont-levis.
L’ingénieur avait fait choix de cette propriété, non seulement à cause du pittoresque de sa situation, mais aussi dans le but de déjouer les tentatives des malfaiteurs, et, en particulier, des affiliés de la Main Rouge.
Le pont-levis franchi, on entra dans une autre avenue – de sycomores, celle-là – qui aboutissait à la cour d’honneur.
Pendant que Bob Horwett lui-même conduisait la voiture jusqu’en face du perron de marbre du château, Mr. Bombridge amena l’envoyé de William Dorgan à une salle de verdure où se trouvait en ce moment M. Bondonnat, en compagnie de trois jeunes femmes, toutes trois admirablement belles, quoique d’une beauté différente.
– À qui ai-je l’honneur de parler ? demanda courtoisement le vieux savant en allant au-devant du visiteur.
Celui-ci, d’un geste rapide, avait fait disparaître ses lunettes et sa fausse barbe.
– Lord Burydan ! s’écrièrent les trois jeunes femmes avec un même cri de surprise.
– Il n’en fait jamais d’autres ! grommela l’ex-clown Horwett.
– Je vois avec plaisir, dit gaiement le vieux savant, que votre humeur fantaisiste n’a pas changé ! Mais, maintenant, quoique vous soyez en pays de connaissance, permettez-moi de faire les présentations !
– Mistress Harry Dorgan, Mme Paganot et enfin Mme Frédérique Ravenel, née Bondonnat…
– Je vois, répliqua l’excentrique avec jovialité, que vous n’avez pas perdu de temps en mon absence.
« Tous mes compliments, mesdames. J’aurai, j’espère, le plaisir de voir vos époux ?
– Non, répondit M. Bondonnat. Tous trois sont à New York, d’où ils ne reviendront que dans deux ou trois jours. Ils ont emmené avec eux notre ami Oscar.
– Je ne sais, milord, reprit Frédérique avec une moue, si nous devons vous adresser la parole… Nous vous en voulons beaucoup toutes les trois…
– On ne lâche pas ainsi ses amis !… s’écria Andrée.
– Ne pas même être venu assister à notre mariage !… fit miss Isidora en s’efforçant de prendre une mine sévère.
– Mesdames, je vous fais mes excuses les plus humbles !… Ce n’est pas pour rien que l’on m’appelle « l’excentrique ». Il faut donc que mes amis aient assez d’indulgence pour fermer les yeux sur mes défauts et me prendre comme je suis !…
– Faut-il pardonner ? demanda Frédérique en se tournant vers ses deux amies.
– Ma foi, oui. Mais qu’il n’y revienne plus ! dit Andrée.
– Je ne puis pas lui en vouloir beaucoup, ajouta mistress Isidora, il m’apporte un cadeau.
– Et un cadeau magnifique !
– Mais comment se fait-il, demanda M. Bondonnat, que Mr. William Dorgan vous ait chargé d’une pareille commission ? Vous le connaissez donc ?…
Lord Burydan mit un doigt sur ses lèvres.
– Oui, dit-il en souriant. Mais, silence, c’est un secret.
Le naturaliste n’insista pas.
– Voyons le cadeau ! criaient à la fois les trois jeunes femmes.
Bob Horwett courut en toute hâte jusqu’au camion, et il revint suivi de quatre domestiques qui portaient à grand-peine, sur une civière, une volumineuse caisse carrée extérieurement doublée de tôle.
Les domestiques, dont les curieuses jeunes femmes stimulaient le zèle, ouvrirent cette caisse non sans peine. Elle en renfermait une seconde, en bois blanc léger, qui fut ouverte de même, et qui apparut remplie de bourre de coton très serrée.
– Je me demande ce que cela peut bien être ? dit Frédérique.
– Quelque vase, quelque bibelot précieux ! répondit mistress Isidora ; je sais que mon beau-frère Joë et mon beau-père sont des gens pleins de goût.
– Vous êtes donc réconciliée avec Mr. Joë Dorgan ? demanda lord Burydan.
– Oui, cela valait mieux ainsi. Mon mari et lui se voient rarement, mais enfin ils ne sont plus ennemis jurés, comme autrefois.
Frédérique et Andrée avaient commencé d’enlever elles-mêmes à grandes poignées le coton, d’une blancheur éblouissante, qui remplissait la caisse. Bientôt quelque chose de brillant apparut.
– De l’or ! dit Andrée. Quelque bijou sans doute ?
– C’est un buste de femme ! celui d’Isidora ! s’écria Frédérique qui, d’une main impatiente, avait achevé de vider la caisse. Il est en bronze doré. C’est magnifique.
– Il est plus magnifique encore que vous ne pensez, dit railleusement l’excentrique. Le buste de mistress Isidora est en or massif. C’est un vrai cadeau de milliardaire !
– Quelle folie ! murmura mistress Isidora, qui, en dépit de ses dénégations, devint rouge de plaisir.
Lord Burydan avait tiré le buste de sa caisse et l’avait posé sur la table de marbre qui se trouvait au centre de la salle de verdure. Le travail de l’artiste – un illustre sculpteur français – était à la hauteur de la précieuse matière qu’il avait employée. Ce buste, d’une grâce un peu languide, égalait les plus belles statues des artistes de la Renaissance. Jean Goujon ou Germain Pilon l’eussent trouvé digne de leur ciseau.
Les yeux avaient été traités à la mode de l’ancienne Rome, c’est-à-dire que les prunelles, au lieu de demeurer vides comme le sont en général celles des statues modernes, avaient été figurées par des pierres précieuses ; deux superbes émeraudes, de la teinte exacte des yeux de mistress Isidora, fulguraient sous les paupières d’or et donnaient à l’image une vitalité intense, presque inquiétante.
Comme l’avait dit lord Burydan, c’était là un vrai cadeau de milliardaire. Un buste pareil devait coûter plus d’un demi-million.
Les trois jeunes femmes demeurèrent quelque temps muettes d’admiration. Les deux Françaises, loin d’être jalouses, embrassèrent et complimentèrent chaleureusement leur amie.
– Où allez-vous placer ce beau buste ? demanda Frédérique.
– Il me semble, répondit mistress Isidora après un moment de réflexion, que sa place est tout indiquée dans le grand salon Renaissance.
– Celui du deuxième étage, au-dessus du laboratoire ?
– Précisément.
– Surtout, dit en riant lord Burydan, mettez-le dans une pièce dont la porte soit solide ! Ce buste serait une proie magnifique pour ces messieurs de la Main Rouge.
Les trois jeunes femmes eurent un même rire, qui sonna clair dans le silence des bosquets.
– La Main Rouge, s’écria mistress Isidora, est-ce que cela existe encore ? Après les condamnations en masse qui ont été prononcées ces temps derniers, après les centaines d’arrestations opérées sur tous les points de l’Union, la fameuse association peut être regardée comme anéantie.
– Allons, tant mieux ! fit l’excentrique. Je ne suis pas fâché de ce que vous m’apprenez ! On va donc pouvoir enfin dormir tranquille sur le territoire de la libre Amérique !
– D’ailleurs, reprit Frédérique, le salon Renaissance, où le buste va être placé, est muni de solides volets blindés, et la porte elle-même est revêtue de plaques de tôle de vingt millimètres d’épaisseur, précautions qui ont été prises, je crois, à cause des nombreux objets précieux que renferme déjà le salon.
Les jeunes femmes voulurent aller présider en personne à l’installation du buste dans le salon Renaissance. Pendant qu’elles s’y rendaient, lord Burydan et M. Bondonnat se promenèrent à pas lents le long d’une pièce d’eau couverte de nymphéas et bordée de tulipiers en fleurs. Brusquement, leur physionomie à tous les deux était devenue soucieuse et ils firent une vingtaine de pas sans prononcer une parole.
– J’ai reçu vos lettres, dit enfin M. Bondonnat en baissant la voix, comme s’il eût craint d’être entendu. Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau ?
– Je crois être sur une bonne piste. Mais je n’ai encore aucun résultat précis. J’attends. Je ne veux agir qu’à coup sûr.
– Soyez prudent.
– Vous n’avez pas besoin de me faire cette recommandation. Je n’ai rien dit pour ne pas effrayer les dames, mais n’avez-vous pas remarqué, comme moi, que tous les membres de la Main Rouge qui ont été condamnés récemment sont des bandits subalternes ? Les hommes, très intelligents, qui sont à la tête de l’Association, n’ont pas même été soupçonnés.
– Je suis certain, moi, répondit le vieux savant, que les Lords de la Main Rouge sont non seulement des gens intelligents, mais encore de véritables savants. Je suis encore émerveillé de ce que j’ai vu dans le laboratoire souterrain de l’île des pendus. Ces gens-là sont aussi forts que le docteur Carrel ; je ne connais qu’un homme, en Amérique, qui soit arrivé à ce degré de science.
– Et c’est ?…
– Le docteur Cornélius Kramm !
– C’est curieux, murmura lord Burydan d’un air préoccupé, nous avons eu la même pensée. Vous savez d’ailleurs – je l’ai appris tout récemment – que c’est Fritz, le frère de Cornélius, qui est, en réalité, le propriétaire de l’île des pendus. Voilà qui me semble très suspect.
– N’allons pas si vite, Fritz Kramm a, paraît-il, parfaitement établi son innocence. Il y avait de longues années qu’il n’était venu à l’île des pendus.
– Après tout, c’est possible. Mais ce que je m’explique moins, c’est que l’enquête que l’on a dû faire, sur l’existence du musée souterrain dont vous aviez indiqué l’emplacement, n’ait amené aucun résultat.
– J’ai cependant fourni les indications nécessaires, répondit M. Bondonnat ; mais il paraît que l’officier de marine chargé de l’enquête n’a trouvé, à l’endroit que j’avais désigné, qu’un ravin déchiré par une explosion de dynamite ; une main mystérieuse était venue détruire le souterrain.
– Les Lords de la Main Rouge sont très forts, il n’y a pas à dire.
– Pour en revenir à Cornélius et à Fritz Kramm, je sais, d’après le récit de Lorenza, la guérisseuse de perles, que ce sont des gens capables de tout. Ils se sont rendus coupables de vols et de chantages.
– Sans doute, répliqua lord Burydan. Mais il ne manque pas de gens peu scrupuleux, qui ne sont pas pour cela Lords de la Main Rouge. Pour porter une pareille accusation, il faut avoir des preuves réelles.
Le savant réfléchit quelques minutes.
– Voici encore, fit-il à tout hasard, un indice qui peut-être vous servira. Dernièrement, le docteur Cornélius, dont j’admire d’ailleurs très sincèrement l’immense savoir, est venu nous rendre visite, en compagnie de son frère. Mr. Joë Dorgan était là. À un moment donné, ils se sont trouvés tous trois placés l’un près de l’autre. Eh bien, savez-vous l’étrange impression que j’ai eue ? C’est que je me trouvais en présence de ces trois hommes masqués qui commandaient en maîtres à l’île des pendus et qui sont tant de fois venus me dicter leurs ordres dans ma prison. J’aurais juré que c’était la même taille, la même corpulence, la même voix. Seulement, je sais combien il faut se défier de ces impressions-là !
– Oui, répondit lord Burydan. Évidemment tout cela ne constitue pas des preuves… pas plus d’ailleurs que les aboiements de Pistolet, qui paraît avoir, contre les trois personnages dont nous parlons, une véritable haine. Je ne veux pas me laisser entraîner par le désir de deviner la vérité, et je sais parfaitement que toutes les personnes après lesquelles aboie Pistolet ne font pas partie de la Main Rouge.
– Vous croirez ce que vous voudrez, mon instinct me dit que ces gens-là sont suspects. Ainsi, ce Joë Dorgan, je suis sûr de l’avoir vu quelque part… Mais laissons cela pour le moment… De votre côté, n’avez-vous rien découvert ?
– Rien qui vaille la peine d’être mentionné, mais je ne demeure pas inactif une seule minute, et je suis, il faut le dire, admirablement secondé par mon ami Agénor. C’est ainsi que, depuis un mois, sous un déguisement, je suis entré au service de William Dorgan afin de pouvoir mieux surveiller les faits et gestes de son fils Joë. J’avoue que jusqu’ici je n’ai rien découvert. Joë Dorgan est très travailleur, très ambitieux. Il s’occupe activement du trust des cotons et maïs, qui appartient à son père. Mais précisément, ce serait là une raison pour qu’il ne soit pas affilié à la Main Rouge.
– Il est intimement lié avec Fritz et Cornélius ?
– Sans doute. Mais qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela ? Les deux frères possèdent des parts importantes dans le trust.
– Ma foi, vous avez raison. Et je ne sais, après tout, si j’ai le droit de dire tant de mal de Cornélius, qui, à San Francisco, a fait preuve envers ma fille du plus grand dévouement. C’est lui qui l’a arrachée à une syncope qui eût pu devenir mortelle.
– Tout cela est bizarre. Enfin, restons-en là. D’ici peu, j’espère avoir du nouveau. Il est bien entendu, d’ailleurs, que cette conversation doit demeurer entre nous. Il serait parfaitement cruel de troubler le bonheur de ces trois jeunes ménages par toutes ces sombres histoires. Ils se croient débarrassés de la Main Rouge ; laissons-les jusqu’à nouvel ordre dans cette croyance.
– Quand vous verrai-je ?
– Je n’en sais rien. Mais il se peut que d’ici quelques jours vous receviez une lettre de moi. Si les recommandations que je vous ferai avaient une importance spéciale, je mettrai un X au-dessous de ma signature. Ce signe voudra dire qu’il faut faire exactement ce que je vous recommanderai dans ma lettre, si étrange que cela vous paraisse.
– C’est entendu.
– Maintenant, plus un mot de la Main Rouge. Allons rejoindre ces dames, qui vont certainement vouloir nous montrer comment elles ont disposé le buste aux yeux d’émeraude.
Tous deux se rendirent au salon Renaissance et admirèrent de nouveau la cadeau princier de William Dorgan. Il avait été posé sur une élégante selle et dans un éclairage très favorable. Mistress Isidora annonça que, le jour du retour de son mari, elle cacherait le buste derrière un rideau afin de lui donner tout le plaisir de la surprise.
En présence de lord Burydan, elle fit une sorte de répétition de cette scène, et l’on déclara à l’unanimité que l’ingénieur Harry Dorgan était décidément le plus heureux des époux.
Cependant l’heure s’avançait. Lord Burydan, malgré les instances qu’on fit pour le retenir, prit congé de ses amis, après s’être affublé de la fausse barbe et des lunettes dont se composait son déguisement.
CHAPITRE III
Le buste aux yeux d’émeraude
Andrée et Frédérique, assises sur une des terrasses du château, regardaient le soleil disparaître à l’horizon du lac Ontario, semé de centaines d’îles verdoyantes. Des nuages aux plis majestueux se teignaient des riches couleurs de la pourpre violette, de l’écarlate sombre et de l’orangé. C’était un spectacle féerique.
– Quel beau soir ! murmura Andrée avec émotion. Quel calme ! quelle douceur dans l’air ! Il y a longtemps que je n’avais été aussi heureuse !
Frédérique ne répondit que par un soupir à demi étouffé.
– Tu as l’air triste ? dit Andrée en prenant affectueusement ses mains entre les siennes.
– Je t’assure que non.
– Voyons, Frédérique, tu me caches quelque chose. Crois-tu donc que je ne me sois pas aperçue de ta pâleur et de ta tristesse depuis quelques jours ?
– Eh bien, oui, c’est vrai ! Je ne suis pas heureuse, murmura la jeune femme avec effort.
– Mais c’est impossible ! répliqua Andrée. Que te manque-t-il donc ? Tu es riche, entourée d’amis dévoués, adorée de ton mari, et nous allons bientôt revenir en France, où de nouveaux bonheurs t’attendent.
– Mon mari ne m’aime pas ! murmura Frédérique avec une poignante tristesse. J’en suis sûre.
– Ah çà ! mais quelles idées te fais-tu donc ? Roger est aux petits soins pour toi ; il ne pense qu’à toi, ne parle que de toi.
– Oh ! reprit Frédérique qui retenait à grand-peine ses larmes, Roger est certainement d’une courtoisie parfaite à mon égard. Il déploie envers moi une sollicitude qui descend aux moindres détails ; il ne me donne aucun prétexte pour lui adresser un seul reproche, et cependant…
Frédérique paraissait hésiter.
– Allons, Frédérique, dit Andrée, ne t’arrête pas à mi-chemin. Tu sais que tu peux avoir toute confiance en moi.
– Je vais tout te dire ! Roger ne m’aime pas comme je voudrais qu’il m’aimât ! Il pense beaucoup plus à ses travaux qu’à moi. Mais cela ne serait rien… Je sais qu’un savant ne peut pas demeurer oisif et que, si je veux plus tard être fière de lui, il faut qu’il travaille ! Ce n’est pas tout !… Si je te disais, ma chère Andrée, que, depuis plusieurs nuits, il se lève, quitte sa chambre sans faire de bruit et ne revient qu’après une absence de deux ou trois heures… J’ai une rivale, j’en suis sûre !… Oh ! si je croyais cela !…
– Tu m’étonnes ! Mais tu dois te tromper.
– J’ai cru longtemps que je me rendais moi-même malheureuse par une jalousie sans cause, mais les faits sont là !… Pourquoi s’absente-t-il la nuit, comme il le fait ?
– Comment veux-tu que ton mari t’ait donné une rivale dans ce château qui est clos comme une forteresse et situé à dix miles de la ville ?
– Quand on est jalouse, on ne s’arrête pas à de pareils raisonnements. Je soupçonne tout le monde !
– Même Isidora, même moi ? demanda Andrée, piquée au vif.
Frédérique s’était jetée, en pleurant, dans les bras de son amie.
– Pardonne-moi, chère Andrée, balbutia-t-elle en sanglotant. Je n’ai voulu parler, bien entendu, ni de toi ni d’Isidora…
– Alors serais-tu jalouse par hasard de cette petite Océanienne que ton père a ramenée ?
– Oh non ! par exemple ! s’écria Frédérique dont les yeux jetèrent un éclair d’orgueil. J’espère, malgré tout, que mon mari me préférerait à cette peau cuivrée !
– Tu vois bien que tes soupçons sont absolument déraisonnables. Roger ne sort sans doute que pour aller prendre le frais sous les beaux ombrages du parc.
Frédérique réfléchissait.
– Un moment, reprit-elle, j’ai bien pensé à cette Dorypha, à cette danseuse endiablée que je déteste de tout cœur, quoiqu’elle nous ait sauvés, cette drôlesse qui a eu l’impudence d’embrasser Roger malgré lui…
– Réfléchis un instant. Tu sais bien que Dorypha, après avoir épousé son amant, le Belge Gilkin, s’en est allée très loin d’ici, dans l’Arizona, où Fred Jorgell a confié à son mari la direction d’une exploitation importante !
– C’est vrai. Tu as raison. Mais qui me dit que Roger ne me trompe pas avec quelque femme de chambre, ou avec quelque fille qui s’est éprise de lui et vient le visiter secrètement…
– Mais tu es folle ! absolument folle ! Veux-tu que je parle à Roger ?
– Garde-t’en bien ! Je mourrais de confusion s’il savait que j’ai de pareilles idées.
Cette conversation fut interrompue par le tintement de la cloche qui annonçait l’heure du dîner.
Frédérique passa en hâte dans son cabinet de toilette pour effacer la trace de ses pleurs, et les deux jeunes femmes descendirent à la salle à manger.
Le repas fut, comme à l’ordinaire, plein d’animation. Frédérique seule, malgré tous ses efforts, ne prit aucune part à la gaieté générale. Toutefois, dans le tumulte des causeries et des discussions, sa mélancolie ne fut remarquée de personne, sauf de son amie Andrée.
Après le repas, les trois jeunes femmes se rendirent dans la serre, qui était contiguë à la salle à manger, et où, chaque soir, tout en prenant le thé, elles avaient l’habitude d’écouter la lecture de certains journaux, que leur faisait la gouvernante écossaise, mistress Mac Barlott. Pendant ce temps, M. Bondonnat et ses amis étaient allés faire une promenade sur les rives du lac, d’où l’on pouvait contempler un clair de lune admirable ; ce ne fut qu’assez tard dans la soirée que Roger Ravenel regagna la chambre qu’il occupait et qui n’était séparée de celle de Frédérique que par une porte de communication.
Roger frappa doucement et, ne recevant pas de réponse, entra dans la chambre de sa femme. Il y régnait une obscurité à peine tempérée par la lueur d’une veilleuse électrique suspendue à la voûte de la pièce, creusée en forme de dôme.
Il s’approcha du grand lit à colonnes et aperçut Frédérique, immobile et les yeux clos, déjà couchée.
– Elle dort, murmura-t-il. Je ne vais pas la réveiller.
Et, s’avançant sur la pointe du pied, il effleura d’un baiser le front de la jeune femme, et se retira.
Frédérique ne dormait pas. Sitôt qu’elle eut entendu la porte de communication se refermer, elle sauta à bas de son lit, enfila à la hâte un peignoir, jeta sur ses épaules une mantille de dentelle ; puis, les pieds nus dans ses pantoufles, elle s’approcha de la porte de communication et colla son oreille au trou de la serrure.
Roger allait et venait dans sa chambre. Frédérique l’entendit ouvrir et refermer des tiroirs, puis il sortit.
– Cette fois, murmura la jeune femme, frissonnante d’angoisse, je vais savoir !… Il faut que je sache !
Silencieusement, elle se faufila dans le couloir sur lequel s’ouvrait la porte des deux chambres. Dans la pénombre lunaire, elle distingua la silhouette de Roger, qui, déjà parvenu au palier de l’escalier, commençait à descendre. Elle le suivit, mais en prenant les plus grandes précautions pour n’être pas aperçue.
Roger sortit par une petite porte qui donnait sur le parc, du côté opposé à la façade de la cour d’honneur. Frédérique se dissimulait derrière les massifs de plantes rares et ne le perdait pas de vue.
– Peut-être, après tout, pensait-elle, veut-il simplement, comme l’a dit Andrée, aller prendre le frais sous les arbres. Quel bonheur, si j’étais sûre qu’il ne me trompe pas !
Mais, à ce moment, elle distingua dans le taillis une forme féminine, qui semblait venir du côté du pont-levis et se diriger vers le château. L’inconnue avançait avec hésitation, se cachant derrière le tronc des arbres et se retournant fréquemment pour voir si elle n’était pas suivie.
Frédérique eut le cœur serré d’une mortelle angoisse.
– Mes pressentiments ne m’avaient pas trompée, se dit-elle. Roger me trahit ! Il aura beau mentir maintenant. Je l’ai vue, de mes propres yeux vue, l’odieuse rivale qui m’a volé le cœur à mon mari !…
Éperdue, elle s’était avancée en pleine lumière ; elle n’eut que le temps de se jeter derrière un massif d’hortensias pour n’être pas surprise par l’inconnue qui passa devant elle, à quelques pas de sa cachette.
Frédérique ne put voir son visage, qui était dissimulé sous un épais fichu de dentelle. Elle ressentit au cœur une douleur aiguë. Ses jambes fléchissaient sous elle. Elle crut qu’elle allait s’évanouir. Mais la haine la remit sur pied, et, elle continua son chemin.
Elle chercha alors des yeux sa rivale. Celle-ci avait disparu ! Frédérique ne vit plus que Roger, qui, après avoir côtoyé dans toute sa longueur la façade du château, était arrivé à l’aile la plus éloignée de la chambre qu’il habitait et cherchait une clé dans sa poche.
– Je vais le suivre, pensa-t-elle. Cette femme va le rejoindre, c’est certain. Je les surprendrai !
Frédérique, après avoir attendu une minute, poussa doucement la porte que Roger avait laissé ouverte, et monta derrière lui l’escalier qui conduisait au premier étage.
Roger longea quelque temps un corridor et s’arrêta devant une porte qui était celle du laboratoire que Fred Jorgell avait mis à sa disposition, car, depuis leur arrivée au château, ni l’ingénieur Paganot ni le naturaliste n’avaient interrompu leurs travaux.
Comme il mettait la clé dans la serrure, le petit bossu Oscar Tournesol arrivait par l’extrémité opposée du couloir. Il était entré par l’autre façade du bâtiment.
– Je crois, dit-il en riant, que voilà ce qui s’appelle de l’exactitude !
– Oui, répondit le naturaliste, c’est parfait !
Tout en parlant, il avait ouvert la porte. Tous deux entrèrent dans une première pièce où couchait ordinairement le cosaque Rapopoff, promu aux fonctions de garçon de laboratoire.
Oscar tourna le commutateur. Soudain il jeta un cri d’épouvante en apercevant le cosaque, étendu sur son lit tout habillé, la tête pendante et la face décomposée. À côté de lui se trouvait une bouteille vide.
– Ils l’ont tué ! s’écria le bossu avec émotion.
– Non, dit l’ingénieur. Je crois, moi, qu’il est tout simplement ivre.
– Ce n’est pas là l’ivresse ordinaire, s’écria l’adolescent qui avait pris Rapopoff à bras-le-corps, l’avait redressé et avait glissé sous ses épaules un oreiller.
Le naturaliste prit sur une planche un flacon d’ammoniac et l’approcha des narines du cosaque. Mais ce révulsif, ordinairement souverain dans les cas d’ébriété, ne produisit aucun effet.
– On a dû lui faire absorber un narcotique, dit Roger Ravenel ; il y a heureusement dans le laboratoire de quoi le soigner énergiquement.
Roger Ravenel, plus inquiet qu’il ne voulait le paraître, ouvrit la porte de la seconde pièce et, montant sur un escabeau, se mit en devoir d’atteindre des flacons qui se trouvaient sur une planche.
Tout à coup, un cri de stupeur jaillit de ses lèvres. Il venait d’apercevoir, au-dessous de la porte qui donnait accès à la troisième pièce, un imperceptible rai de lumière. Sans nul doute des malfaiteurs étaient là ! les mêmes, certainement, qui avaient fait absorber à Rapopoff un narcotique.
Roger demeura hésitant pendant quelques minutes.
– Je ne vois pas, songeait-il, ce qu’on peut bien trouver à voler dans ce laboratoire, où il n’y a pas un seul objet qui ait quelque valeur.
Soudain, une idée traversa son esprit avec la rapidité de l’éclair.
– Le buste aux yeux d’émeraude ! s’écria-t-il. Ce ne peut être que cela. Le salon Renaissance est juste au-dessus du laboratoire !
Sans réfléchir au danger qu’il courait, il ouvrit brusquement la porte.
Trois hommes, au visage couvert d’un masque, étaient là. L’un d’eux était encore monté sur l’échafaudage improvisé grâce auquel ils venaient de percer le plafond. Il tenait entre ses bras le buste d’or, rutilant de clarté à la lueur de la lampe électrique du plafond, et se préparait à le passer à un de ses complices.
Roger demeura une seconde immobile et comme figé de surprise. Avant qu’il ait eu le temps de prendre une décision, les trois malandrins s’étaient rués sur la porte et l’avaient refermée.
Le bossu était accouru. Roger le mit en deux mots au courant de la situation.
– Tu vas aller chercher du renfort, lui dit-il, et, pendant ce temps, je les empêcherai de prendre la fuite.
– Mais s’ils vous attaquent ?
– Je ne cours aucun risque. Je vais me contenter de fermer à clé la porte extérieure – celle qui ferme sur le corridor. Avant qu’ils aient eu le temps de l’enfoncer, tu seras de retour avec quelques solides gaillards…
À ce moment, le rai de lumière disparut et, en même temps, la porte s’ouvrait. D’une poussée irrésistible, les trois malfaiteurs, culbutant Roger Ravenel et son compagnon, traversaient les deux pièces d’un bond et gagnaient le corridor.
– Il n’y a que demi-mal, fit le bossu en se relevant, ils n’ont pas emporté le buste. Notre arrivée les a surpris, et ils n’ont songé qu’à prendre la fuite.
– Oui, mais il faut leur donner la chasse, sans perdre une minute. J’ai heureusement sur moi mon revolver. Viens avec moi !
Tous deux s’élancèrent dans le couloir et y arrivèrent juste à temps pour voir les trois bandits se précipiter, tête baissée, dans l’escalier. Roger et Oscar constatèrent une seconde fois, avec satisfaction, que les malandrins n’emportaient aucune espèce d’objet.
Roger tira sur eux, au jugé, un coup de revolver.
Un cri déchirant, un cri de femme apeurée, répondit au bruit de la détonation.
Roger s’élança et ne put que recevoir dans ses bras Frédérique évanouie.
– Morte ! s’écria-t-il, elle est morte !… et c’est moi qui l’ai tuée !…
Fou de douleur, il souleva le corps de la jeune femme et courut au laboratoire, où il la déposa dans un fauteuil.
– Mon adorée Frédérique, balbutiait-il, mais ce n’est pas possible ! Tu n’es pas morte ? Réponds-moi !… Et toi, Oscar, que fais-tu là ? Aide-moi donc ! Vite, de l’eau froide, des sels !
En proie à un véritable délire, il couvrait de baisers les mains et le visage de la jeune femme.
Au bout de quelques instants, elle ouvrit les yeux, et jetant sur son mari et sur Oscar des regards stupéfaits, elle murmura d’une voix faible :
– Oh ! cette femme !... Les bandits !…
– Où es-tu blessée, ma chérie ? demanda Roger, agenouillé aux pieds de Frédérique.
– Je ne suis pas blessée, mais j’ai eu si peur ! La balle a sifflé à mon oreille…
– Mais que faisais-tu là ?
Frédérique rougit et baissa la tête. Puis, jetant à son mari un regard chargé de rancune :
– Je sais tout !… Je t’ai suivi !… Je l’ai vue, cette misérable femme !…
– Quelle femme ?
– Celle avec qui tu me trompes ! celle que tu vas rejoindre tous les soirs ! Je n’ai pu apercevoir ses traits, mais je saurai bien la trouver, et je me vengerai !…
Frédérique s’était mise à fondre en larmes.
– Mais c’est à devenir fou ! s’écria Roger. Frédérique, ma chérie, je te jure que je ne t’ai jamais trompée ! que je n’ai jamais eu de rendez-vous avec aucune femme !
– Mais, alors, pourquoi t’échappes-tu toutes les nuits de ta chambre ? Roger et Oscar se regardèrent.
– Me voilà obligé d’avouer mon secret, dit le bossu. Comme vous le savez, madame, je dois épouser prochainement miss Régine Bombridge. Elle a eu la générosité d’y consentir, malgré la disgrâce dont je suis affligé… Je voulais lui faire une surprise.
– Quelle surprise ? demanda Frédérique d’un air soupçonneux.
– Depuis quelques années déjà, la science a trouvé le moyen de guérir l’infirmité dont je suis atteint. M. Ravenel a eu la bonté de consentir à m’appliquer le traitement qui doit me débarrasser de ma difformité.
– Et c’est, pour cela, demanda Frédérique un peu calmée, que Roger me quitte tous les soirs ?
– Mais oui, répondit le naturaliste. Ce pauvre Oscar m’avait demandé le secret ; il voulait faire à sa fiancée la surprise de se présenter un beau matin devant elle, allégé de sa bosse et droit comme le commun des hommes.
Frédérique était à demi convaincue. Elle hésitait pourtant encore. Ses regards méfiants allaient de Roger à Oscar, épiant le clin d’œil qui lui eût fait deviner entre eux la complicité d’un mensonge. Mais Oscar et Roger étaient de très bonne foi ; ils n’avaient dit que la vérité.
– Alors, cette femme ? demanda Frédérique avec insistance, pourquoi l’ai-je aperçue précisément à l’heure où tu te trouvais dans cet endroit du parc ?
Roger Ravenel eut un mouvement d’impatience.
– Que veux-tu que je te dise ? s’écria-t-il. Je ne la connais pas, moi, cette femme. Je n’en sais pas plus long que toi sur son compte… Quelle explication veux-tu que je te donne ?
– Il y en a bien une, fit Oscar. Je suis sûr, moi, que cette femme était avec les cambrioleurs. Elle faisait le guet, pendant que ses complices étaient en train d’enlever le buste.
– On a volé le buste ? demanda avec effarement Frédérique, à qui cette nouvelle faisait momentanément oublier sa jalousie.
– Non, on ne l’a pas volé, répondit le naturaliste, mais nous sommes arrivés à temps…
– Tant mieux ! s’écria la jeune femme. Isidora aurait été vraiment navrée. Alors vous l’avez repris ? Où était-il ?
– Nous l’avons repris, murmura l’ingénieur, c’est-à-dire que nous avons mis les cambrioleurs en fuite et qu’ils sont partis sans rien emporter. Pourvu qu’ils n’aient pas arraché les émeraudes !
– Je n’avais pas pensé à cela… Cherchons le buste… Ils ont dû le laisser dans quelque coin.
Roger ouvrit la porte de la troisième pièce, qu’il inspecta d’un coup d’œil rapide.
– Je ne vois pas le buste, fit-il avec un peu d’étonnement.
– Eh bien, tant pis ! s’écria Frédérique dont toute la jalousie s’était réveillée, tu retrouveras toujours bien le buste puisqu’il est là. Ce n’est pas lui qui m’intéresse, c’est cette femme. Vous devriez déjà tous les deux être à la poursuite des bandits. Qu’attendez-vous pour leur donner la chasse ? Ils ne peuvent être loin, puisque le pont-levis à cette heure-ci n’est jamais abaissé.
– Soit ! répondit docilement le naturaliste, nous allons nous mettre à la poursuite des cambrioleurs. Mais, auparavant, je veux te savoir en sûreté dans ta chambre.
– Pas du tout. Je vous accompagne. Je ne veux pas que cette prétendue cambrioleuse s’échappe à l’aide de quelque subterfuge. Je veux connaître la vérité, et je la connaîtrai !
Roger comprit qu’il n’y avait rien à faire contre une pareille obstination.
– Eh bien, viens avec nous, fit-il. Mais c’est insensé ! Tu serais beaucoup mieux dans ton lit. Tu t’exposes, comme tout à l’heure, à recevoir quelque balle perdue.
– Cela m’est égal ! Marchons !
Tous trois se préparaient à sortir du laboratoire lorsqu’ils entendirent une sorte de beuglement bizarre qui, pendant quelques minutes, les cloua d’étonnement sur place.
– Qu’est-ce que c’est que cela ? demanda Frédérique en prenant d’un geste instinctif le bras de son mari.
– Rassurez-vous, madame, répondit le bossu qui venait d’entrer dans la première pièce : c’est simplement notre ami Rapopoff qui bâille.
Ils aperçurent, en effet, le cosaque, qui, tout effaré de se réveiller en si nombreuse compagnie, roulait de gros yeux hébétés et se détirait en ouvrant une énorme mâchoire. Il finit par se cacher sous la couverture, tout honteux sans doute d’être surpris par une dame dans un état si peu présentable.
– Toi, mon bonhomme, lui dit Roger, qui au fond était exaspéré, tu auras affaire à moi ! Nous réglerons nos comptes demain matin. Tout ce qui arrive, c’est de ta faute. Si tu n’avais pas bu le contenu de cette bouteille… mais suffit…
Le cosaque ne répondit pas. Tapi sous ses couvertures, il laissait passer l’orage.
– Quelle brute ! s’écria le naturaliste.
Puis, se tournant vers Oscar :
– Cours vite, lui dit-il, éveiller tous les domestiques. Dis au premier que tu rencontreras d’avertir également Harry Dorgan et Paganot. Puisque Frédérique l’exige, nous allons faire une battue en règle.
Le bossu partit en courant, pendant que Roger refermait soigneusement à double tour la porte extérieure du laboratoire.
Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées que, déjà, la domesticité du château s’éveillait. On voyait des lumières aller et venir à toutes les ailes du corps de logis.
Harry Dorgan, l’ingénieur Paganot et M. Bondonnat lui-même, arrachés à leur sommeil, arrivaient dans le costume sommaire qu’ils avaient revêtu à la hâte.
En quelques mots, Roger Ravenel mit ses amis au courant, et tout aussitôt la battue s’organisa. Une troupe de domestiques commença à explorer les rives du lac, pendant qu’une autre se dirigeait vers le pont-levis.
On s’était muni de phares d’automobile pour fouiller les buissons les plus épais, et une dizaine de chiens, parmi lesquels se trouvait Pistolet, avaient été lancés sur la trace des malfaiteurs.
Frédérique et Roger suivaient cette meute d’aussi près que possible. Pistolet, qui avait pris les devants, revint bientôt sur ses pas, en aboyant d’un air plaintif qui éveilla l’attention de la jeune femme.
– Pistolet a découvert quelque chose, fit-elle. Il faut voir ce que c’est.
Le chien les conduisit au milieu d’un fourré inextricable, dans le centre duquel apparaissait un objet blanc dont Roger ne put tout d’abord préciser la nature. Frédérique eut vite fait de deviner.
– La femme ! s’écria-t-elle, c’est la femme ! Je reconnais la couleur de sa robe et de son fichu ! Cette fois, je la tiens !… Elle ne m’échappera pas !
Quittant brusquement le bras de son mari, elle s’était élancée en courant de toute la vitesse de ses jambes. On eût dit que la haine lui mettait des ailes aux talons.
Arrivée en face du buisson, elle demeura stupéfaite et décontenancée. Elle se trouvait en présence d’une femme au visage ensanglanté, et cette femme était Régine Bombridge, l’ex-écuyère du Gorill-Club, la fiancée d’Oscar Tournesol.
La jeune fille n’était pas évanouie. Elle poussait de faibles gémissements, et, avec l’aide de Roger et de Frédérique elle-même, qui ne savait que penser, elle se releva et put aller s’asseoir sur un banc rustique qui se trouvait à peu de distance de là, au pied d’un eucalyptus. Roger lui fit avaler une gorgée de whisky, lava la blessure qu’elle portait au front et qui, heureusement, n’offrait pas de gravité.
Frédérique avait aidé son mari, attendant avec impatience que la blessée fût assez remise pour parler.
– J’espère, miss, lui dit-elle enfin, d’un ton presque menaçant, que vous allez nous expliquer comment vous vous trouvez ici, à courir les bois, à pareille heure, quand vous devriez dormir paisiblement dans le chalet de votre père.
Miss Bombridge baissa la tête, toute confuse, et après une longue minute d’hésitation, se décida à parler.
– Madame, dit-elle, avec un accent de noble sincérité qui ne permettait pas de mettre en doute ses paroles, je dois dans quelques semaines épouser Oscar Tournesol qui, sur ses vives instances, a obtenu d’occuper une chambre dans le chalet de mon père jusqu’à ce que nous soyons mariés.
– Je sais cela, répondit Frédérique toute frémissante d’impatience, allez droit au fait, miss !
– Je me suis aperçue que, depuis quelque temps, Oscar s’absentait régulièrement toutes les nuits. J’ai essayé de savoir où il allait ; il m’a répondu d’une façon évasive. Que vous dirai-je ? Je me suis figurée qu’il me trompait.
La jeune fille ajouta avec un réel chagrin :
– Mais, malheureusement, madame, je le crois encore. J’en ai la preuve.
– Que voulez-vous dire ?
– Ce soir, j’ai eu la malencontreuse idée de l’espionner, et je vous assure que j’en ai été bien punie. J’étais arrivée, en suivant Oscar, jusqu’à la petite porte de l’escalier du laboratoire, quand j’ai aperçu une femme, soigneusement voilée d’une mantille, qui marchait dans la même direction… Cette fois, je ne pouvais plus douter. J’en ai reçu un tel coup au cœur que je n’ai pas eu le courage d’aller plus loin. Je suis revenue sur mes pas, la mort dans l’âme. Je me préparais à retourner chez mon père quand trois hommes masqués se sont présentés brusquement devant moi. Avant que j’aie eu le temps de fuir, j’ai été frappée à la tête et je suis tombée. Les hommes ont continué leur chemin, croyant m’avoir tuée.
Frédérique demeurait pensive.
– Comment était la femme que vous avez aperçue ? demanda-t-elle.
– Je ne me rappelle pas exactement, répondit Régine recueillant ses souvenirs. Tenez, elle était à peu près de votre taille, la tête enveloppée d’une mantille comme vous.
– C’était moi !
– Vous, madame ?
– Oui, mon enfant. Moi aussi, je l’avoue, je me suis inquiétée des absences nocturnes de mon mari…
– Inutile de raconter tout cela, fit Roger avec impatience.
Frédérique se jeta au cou de son mari et le serra éperdument dans ses bras ; puis elle lui dit à l’oreille :
– Laisse-moi tout avouer. Ce sera ma punition… Oui, miss, reprit-elle, j’ai eu les mêmes soupçons que vous, et j’ai cru, moi aussi, en vous apercevant, être sûre de mon fait. Mais je puis, dès maintenant, vous apprendre toute la vérité. Si mon mari et Oscar se rencontrent depuis plusieurs soirs, c’est qu’ils vous préparent une surprise.
– Une surprise ? À moi ?
– Oui, miss ; seulement, permettez-moi de ne pas vous en dire davantage.
– D’ailleurs, fit Roger avec insistance, il est temps de rentrer. Il faut que vous pansiez votre blessure d’une façon plus sérieuse. Croyez-moi. Oscar n’a jamais eu l’intention de vous tromper, et d’ici peu de jours, vous connaîtrez son secret.
Pendant que cette scène se déroulait dans un coin solitaire du parc, les deux troupes qui concouraient à la battue avaient opéré leur jonction. On avait suivi la trace des cambrioleurs sur les bords du lac, jusqu’à un endroit où la terre était piétinée et les roseaux brisés. C’est de là que les cambrioleurs avaient dû remonter dans l’embarcation grâce à laquelle ils avaient pu pénétrer dans la propriété. On retrouva d’ailleurs, le lendemain, un grappin dont ils avaient coupé la corde afin de fuir plus vite.
Miss Bombridge regagna le chalet paternel, sous la sauvegarde de son fiancé. Frédérique remonta furtivement dans sa chambre, toute honteuse encore de ses injustes soupçons.
Les domestiques reçurent la permission d’aller se coucher ; et M. Bondonnat, qui, trop légèrement vêtu, avait attrapé un rhume en marchant dans l’herbe humide de rosée, déclara qu’il allait en faire autant.
Harry Dorgan demeura seul, en compagnie de Roger et de l’ingénieur Paganot.
– Puisque nous voilà réveillés, proposa ce dernier, si nous allions jusqu’au laboratoire constater les dégâts et voir si, comme j’en ai bien peur, nos cambrioleurs n’ont pas emporté les émeraudes ?
– Allons-y, dit Harry Dorgan. Je ne me sens pas la moindre envie de dormir.
Ils remontèrent donc jusqu’au laboratoire, dont ils traversèrent les deux premières pièces sans réveiller le cosaque, qui de nouveau s’était remis à dormir d’un profond sommeil.
La troisième pièce avait été bouleversée de fond en comble par les malfaiteurs, qui certainement devaient être des professionnels du cambriolage et possédaient une habileté peu ordinaire. Ils avaient commencé par fermer les épais volets de la fenêtre qui donnait sur la cour d’honneur, d’où l’on eût pu voir la lumière. Puis, avec deux tables et quelques chaises, ils avaient construit un véritable échafaudage, juste en dessous de l’endroit où se trouvait le buste. On retrouva les vilebrequins et les scies perfectionnées dont ils avaient fait usage pour percer le plafond.
– Ceux qui ont fait le coup, fit observer Harry Dorgan, sont des gens parfaitement renseignés. Ils n’ignoraient pas que la porte et les fenêtres du salon Renaissance sont blindées et à peu près incrochetables.
– Avec tout cela, je ne vois pas le buste, dit l’ingénieur Paganot qui, depuis son entrée dans la pièce, furetait à droite et à gauche.
– Je suis pourtant bien sûr, répliqua Roger, qu’ils ne l’ont pas emporté.
– Nous allons le retrouver, fit Harry Dorgan.
– Cherchons !
– Cherchons.
Tous trois explorèrent la pièce dans ses moindres recoins. Ils montèrent même, à l’aide du trou pratiqué dans la voûte, dans le salon Renaissance. Le buste demeura introuvable.
– Nous continuerons nos recherches demain, dit Harry Dorgan, un peu nerveux. Mais je crois qu’il est de la prudence la plus élémentaire de mettre deux hommes solides en faction devant la porte du laboratoire.
– Je le crois aussi, approuva Roger, car il ne faut guère compter sur le cosaque.
Tous trois se retirèrent. Et comme ils en étaient convenus, ils se retrouvèrent le lendemain, dès la première heure, pour continuer leurs investigations.
D’après le conseil de ses amis, Harry Dorgan avait donné des ordres pour que personne ne parlât à mistress Isidora de la tentative de vol. Tous avaient jugé qu’il serait temps de l’en informer seulement quand ils auraient retrouvé le buste. Ils savaient combien la jeune femme y tenait, et ils avaient jugé inopportun de l’inquiéter et de la chagriner, avant d’avoir une certitude.
Ils ne tardèrent pas à être fixés. Les investigations les plus minutieuses n’aboutirent pas : le buste aux prunelles d’émeraude avait disparu, comme s’il se fût évanoui en fumée.
Rapopoff, interrogé, ne put fournir aucun renseignement. Le cosaque avait trouvé, à côté de son lit, une bouteille étiquetée « whisky », et pensant que c’était un cadeau de ses maîtres, il en avait bu consciencieusement la moitié. L’analyse du liquide restant montra que le whisky était additionné d’un puissant narcotique. Si le cosaque eût vidé entièrement la bouteille, il en fût certainement mort, en dépit de la robustesse de sa constitution.
Les bandits avaient dépassé leur but. Le narcotique était à dose trop forte, Rapopoff s’était endormi dès les premières gorgées, ce qui l’avait sauvé en l’empêchant de vider complètement la fiole.
Toute la journée s’écoula ainsi en recherches inutiles. Vers le soir, il fallut en prendre son parti et aller annoncer la triste nouvelle à mistress Isidora, qui s’en montra sincèrement contrariée.
– Pourtant, ne cessait de répéter Roger Ravenel, dont Oscar appuyait les dires, je suis sûr, parfaitement sûr, que le buste n’est pas sorti du château ni même du laboratoire !
CHAPITRE IV
L’auge de lave
Le vol du buste aux yeux d’émeraude avait fortement émotionné mistress Isidora.
Elle se demandait si ce dernier méfait n’était pas encore dû aux bandits de la Main Rouge. En tout cas, elle était exaspérée.
Pour la première fois de sa vie, peut-être, elle eut une discussion avec son père.
– Comment ! lui dit-elle, vous êtes milliardaire, vous avez fait votre fortune vous-même et vous n’arrivez même pas, avec cette immense richesse que tout le monde vous envie, avec votre intelligence et votre énergie que l’on cite en exemple, à garantir votre sécurité personnelle et celle de votre fille ?
– J’avoue, répondit le milliardaire, que je ne m’en suis pas assez préoccupé. Mes amis, Rockefeller, Pierpont Morgan, Mackey, et d’autres encore, sont entourés de centaines de détectives et gardés à vue…
– Eh bien ! Il faudrait faire comme eux ! répliqua la jeune femme un peu nerveusement.
– C’est bien. Je vais donner des ordres en conséquence. Mais je croyais suffisantes les précautions que j’avais prises, et aussi d’ailleurs, que la Main Rouge n’était plus à craindre.
– Que ce soient les bandits de la terrible association ou d’autres, il est indispensable que nous soyons mieux gardés et mieux défendus !
– Ne te mets pas en colère, ma chère enfant ! Aujourd’hui même, je vais faire venir cinq ou six canots à vapeur qui toute la nuit évolueront autour de la presqu’île. Du coup, j’espère que tu pourras dormir tranquille.
– Je ne parle pas seulement pour moi, mais pour toi-même et pour nos amis. J’aurais un remords éternel s’il arrivait malheur par notre faute à Frédérique, à Andrée ou à leurs époux…
« Mais ce n’est pas tout. Il va falloir maintenant avertir William Dorgan de ce qui s’est passé… Il sera peu charmé, j’en suis sûre, de voir quelle négligence nous avons mise à veiller sur le royal cadeau qu’il m’avait fait !
– Quant à cela, ne t’inquiète pas. J’ai déjà fait porter au Post-Office une longue lettre où je raconte à William Dorgan dans quelles circonstances s’est produit le vol. Il est trop intelligent pour nous rendre responsables d’un fait dont nous sommes les premières victimes.
« Puis il y a, dans le vol du buste, un côté mystérieux qui n’est pas encore éclairci. William Dorgan sera le premier à se passionner pour cette affaire.
Cette conversation avait lieu dans la soirée, le lendemain même du vol.
Trois jours après, une dépêche laconique annonçait l’arrivée du milliardaire.
Contrairement à ce que disait Isidora, William Dorgan ne manifesta aucune contrariété.
– Je vous donnerai un autre buste, ma chère enfant, dit-il à mistress Isidora ; en admettant toutefois qu’il soit définitivement perdu… Ce qui n’est pas prouvé.
– Évidemment, dit mistress Isidora, si nous pouvons trouver quelques détectives habiles et sérieux…
– Il n’en manque pas, interrompit William Dorgan. Et, que diable, un lingot de ce poids, deux émeraudes qui sont connues de tous les joailliers de l’Amérique, ne disparaissent pas aussi facilement que cela !
– D’ailleurs, s’écria Fred Jorgell qui venait de serrer la main cordialement à son adversaire financier et s’était installé, à côté de lui, dans un rocking-chair, nous avons déjà pris des mesures efficaces.
« J’ai lancé une centaine de télégrammes. La police de toutes les grandes villes de l’Union est prévenue. Je ferai tout ce qu’il faudra pour retrouver le portrait d’Isidora.
« J’y mets de l’amour-propre ; dussé-je dépenser autant qu’il a coûté, il faut que les voleurs soient pincés !
– Eh bien, bonne chance, dit William Dorgan d’un ton parfaitement détaché. Mais nous reparlerons plus à loisir demain de cet accident, auquel je n’attache pas, moi, une énorme importance. Je suis venu ici, surtout pour avoir le plaisir de vous voir tous.
« Vos amis les Français ont décidément fait ma conquête, et j’ai une véritable admiration pour le génial M. Bondonnat, auquel il est arrivé des aventures si extraordinaires.
– Le voilà, lui-même, en personne, s’écria le vieux savant en apparaissant à la porte du salon. Mais pas tant de compliments sur mon compte, je vous prie… Je n’aurais jamais cru que les Américains fussent si complimenteurs.
M. Bondonnat et William Dorgan se serrèrent la main avec effusion, et la conversation s’engagea entre eux avec la plus franche cordialité.
L’ingénieur Paganot et Roger Ravenel, Frédérique et Andrée, qui avaient été prévenus de la présence du milliardaire, arrivèrent successivement.
William Dorgan voulut même connaître la petite Océanienne Hatôuara, le cosaque Rapopoff et surtout le petit bossu Oscar Tournesol, dont l’ingénieur Harry lui avait beaucoup parlé.
Le milliardaire se trouvait heureux au milieu de cette réunion familiale, à laquelle manquait, seul, Harry Dorgan, retenu à New York pour s’occuper des intérêts de la Société des paquebots Éclair.
– Vous savez quel est mon projet ? dit tout à coup le milliardaire. Ce n’est pas du tout à cause du vol du buste que je suis venu. La lettre de mon ami Fred Jorgell à ce sujet n’a fait qu’avancer la date du voyage.
« Je vous emmène tous dans une ravissante propriété que je viens d’acheter en Floride, où le climat est délicieux.
– Pourquoi donc, dit vivement Fred Jorgell, ne pas passer ici quelques jours avec nous ? Ce serait bien plus simple.
– Je reviendrai, soyez tranquille. Je veux d’abord avoir le plaisir de vous avoir pour hôte…
Cette invitation fut en principe acceptée de tous, et la conversation devint générale.
Les deux milliardaires discutaient au sujet de leur trust, mais d’une façon tout à fait amicale et courtoise.
– J’ai eu la première manche, dit William Dorgan. Je vous ai battu dans le trust du maïs et des cotons ; mais je crois que vous allez avoir une belle revanche.
– Il est certain, répondit Fred Jorgell avec un malicieux sourire, que si la Compagnie des paquebots Éclair continue à réussir comme elle l’a fait jusqu’ici, nous entrerons de nouveau en lutte.
– Parbleu ! Quand vous allez avoir accaparé tous les moyens de transport par eau, nous ne pourrons plus expédier nos maïs et nos cotons que suivant les tarifs que vous voudrez bien fixer.
– Hé ! il vous reste les chemins de fer !
– Vous savez fort bien que les chemins de fer demandent un prix beaucoup trop élevé, quand il s’agit de matières encombrantes telles que le coton et le maïs.
– Soyez tranquille, nous nous arrangerons toujours. Il n’y aura plus entre nous de ces âpres batailles d’intérêts qui nous ont si longtemps séparés.
– Je suis heureux de vous voir aussi bien disposé, et nous sommes prêts à vous accorder des prix très rémunérateurs.
« Vous n’ignorez pas, en outre, que, dans le duel financier qui a failli nous brouiller à mort, je subissais surtout l’influence de mon fils Joë. Mais il est devenu beaucoup plus raisonnable, il s’est réconcilié avec son frère, et il a fini par comprendre, lui aussi, que la bonne entente et les affections familiales valent beaucoup plus que quelques millions de dollars.
– Cependant, objecta Fred Jorgell, vous avez maintenant des associés qui ne se montreront peut-être pas si accommodants. Je veux parler du docteur Cornélius Kramm et de son frère, le marchand de tableaux.
– Je vous assure que ce sont, eux aussi, des gens charmants. Ils ne feront que ce que je dirai.
« Leur part, d’ailleurs, n’est pas très considérable, et les sommes qu’ils ont avancées ou fait avancer au trust ont été déjà à moitié remboursées.
La conversation en était là, lorsque le petit bossu, qui s’était absenté quelques instants, rentra dans le salon et, s’approchant de M. Bondonnat, lui dit quelques mots à l’oreille.
Le vieux savant fit à l’adolescent un signe affirmatif, et tous deux, sans être remarqués, passèrent sur un vaste balcon orné de vases de marbre et d’arbustes, qui faisait au salon comme une annexe verdoyante.
– Tu as reçu une lettre de lord Burydan ? demanda le vieillard.
– Oui, cher maître. La voici.
M. Bondonnat prit connaissance de la missive et sa physionomie, à mesure qu’il lisait, exprimait une certaine surprise.
– Voilà qui est curieux, fit-il. Je n’aurais pas pensé à cela. Si lord Burydan ne s’est pas trompé, les filous américains sont décidément beaucoup plus forts que nos escarpes nationaux.
– Je n’ai pas bien compris ce que veut dire lord Burydan quand il parle de moyens chimiques.
– Je vais te l’expliquer. Allons d’abord au laboratoire.
Ils se dirigèrent vers l’aile du château, qui plusieurs jours auparavant avait été le théâtre du vol.
Chemin faisant, le bossu demanda à M. Bondonnat pourquoi l’excentrique ne lui avait pas écrit directement et s’était servi de son intermédiaire à lui, Oscar.
– Je me l’explique parfaitement, répondit le vieillard. Lord Burydan, que les événements de ces temps derniers ont rendu très méfiant, a peut-être craint que ma correspondance ne fût interceptée. Il a supposé que la tienne serait moins surveillée.
« Lord Burydan nous demande si l’on est venu, ces jours derniers, livrer des produits chimiques et emporter la verrerie inutile. Il paraît attacher à ce fait une grande importance.
– Nous allons le savoir à l’instant même.
Ils étaient arrivés au laboratoire. Ils y furent accueillis par Rapopoff, qui, par habitude, leur fit le salut militaire.
– Bonjour, mon brave, lui dit M. Bondonnat. Veux-tu me dire quel jour on est venu apporter des produits ?
– C’était hier, petit père, répondit le cosaque. Et, même, les deux hommes qui sont venus étaient très complaisants, très généreux. Ils m’ont donné une pièce de vingt cents pour les aider à descendre en bas deux bonbonnes.
– Étaient-elles pleines ou vides, ces bonbonnes ? demanda vivement le naturaliste.
– Pleines, et même très lourdes, petit père, répondit le cosaque.
– C’est cela même ! murmura M. Bondonnat à l’oreille d’Oscar. Je commence à croire que lord Burydan ne s’est pas trompé… Mais, voyons, Rapopoff, de quoi étaient-elles pleines ?
– Je ne sais pas.
M. Bondonnat et Oscar pénétrèrent dans la troisième pièce et, du premier coup d’œil, le savant s’aperçut qu’une grande auge de lave[1] qui se trouvait dans un coin et qui servait à rincer la verrerie était entièrement vide.
– C’est toi qui as vidé cette auge ? demanda-t-il au cosaque.
– Non, petit père.
M. Bondonnat ne répondit pas. Il s’était penché sur le bord de l’auge, où il restait encore un peu de liquide.
Il en puisa quelques gouttes à l’aide d’une spatule, puis il prit des flacons de réactif dans une armoire, une pierre de touche dans une autre, et se livra à certaines manipulations qu’Oscar et le cosaque suivaient avec curiosité.
– Décidément, fit-il au bout d’une minute, c’est lord Burydan qui avait raison. Maintenant, je peux reconstituer de quelle façon, extrêmement habile, le vol a été commis. Lord Burydan parle, dans sa lettre, d’un moyen chimique.
– Je ne vois toujours pas comment on a pu faire pour emporter un buste aussi volumineux.
– On l’a simplement fait dissoudre.
Oscar ouvrait de grands yeux.
– Mais oui, fit M. Bondonnat, c’est comme cela. Ainsi que je viens de le constater à l’aide des réactifs, l’auge de lave était remplie d’eau régale, et tu n’ignores pas que l’eau régale, formée d’un mélange d’acide azotique et d’acide chlorhydrique en parties égales, est le seul liquide qui attaque l’or et puisse le dissoudre.
« Les cambrioleurs, ou les bandits, ont tout simplement placé le buste dans l’auge, et, quand ils ont été bien sûrs qu’il était fondu, ils ont rempli avec l’eau régale les bonbonnes vides et ont encore eu l’aplomb de se faire aider par ce brave Rapopoff.
– Et les émeraudes ? demanda Oscar.
– Ils les ont retrouvées intactes au fond de l’auge. Ils n’ont sans doute eu garde de les oublier.
– Voilà qui est stupéfiant !
– Ah ! leurs précautions étaient bien prises ! Ils avaient tout prévu.
« Ainsi, l’eau régale elle-même était teintée avec un corps dont je n’ai pas pu reconnaître encore la nature, de façon que le liquide fût assez opaque pour qu’on ne pût apercevoir le buste.
– C’est tout de même se moquer du monde ! s’écria Oscar. Dire que nous avons fouillé le laboratoire de fond en comble sans avoir l’idée de regarder dans cette auge.
– Ah ! ce sont évidemment des gens intelligents !… Mais une question : comment se nomme notre fournisseur de produits chimiques ?
– Mr. Gresham.
– Fais-le demander au téléphone. Nous allons être fixés tout de suite.
Oscar s’empressa d’obéir, et, quelques minutes après, il obtenait la communication.
– La maison Gresham, de New York ? demanda M. Bondonnat.
– Yes, sir ! Qui me parle ?
– C’est de la part de Mr. Harry Dorgan.
– Bien.
– Pourriez-vous me dire, monsieur, quand vous avez effectué votre dernière livraison à notre laboratoire du lac Ontario ?
– Mais, monsieur, il y a une quinzaine de jours, tout au plus.
– Vous n’avez envoyé personne, hier, chercher la verrerie vide ?
– Personne.
– Merci, monsieur.
M. Bondonnat raccrocha le récepteur.
– Tu vois, mon cher Oscar, dit-il, que maintenant il n’y a plus de doute possible… Le buste aux yeux d’émeraude est perdu pour mistress Isidora.
– Il faut prévenir immédiatement Mr. William Dorgan et Fred Jorgell.
– Non, répondit le savant après un moment de réflexion. Je ne suis pas du tout de cet avis. Il faut, jusqu’à nouvel ordre, que ce secret demeure entre nous.
« Je vais simplement écrire un mot à lord Burydan qui, lui, doit être exactement renseigné.
– Je crois, cher maître, que vous avez raison. Mais n’empêche que la Main Rouge – en admettant que ce soit elle – a des affiliés qui connaissent admirablement bien la chimie. Il est évident qu’il doit y avoir parmi eux de véritables savants.
CHAPITRE V
Le pont de l’Estacade
Les Américains ne perdent jamais de vue cet axiome que « le temps c’est de l’argent » (time is money), et ils ne reculent devant aucune audace lorsqu’il s’agit d’économiser ce précieux capital. Ainsi, par exemple, chez vous, on attend, pour livrer à la circulation une voie de chemin de fer, qu’elle soit entièrement terminée, que les ponts, les tunnels et les autres œuvres d’art aient été installés partout et offrent une solidité à toute épreuve.
En Amérique, on commence par poser des rails au petit bonheur et par mettre, sur cette voie provisoire, des trains en circulation, quitte à exécuter plus tard, d’une façon plus sérieuse, tous les travaux nécessaires.
Rencontre-t-on un cours d’eau ? On le passe sur un pont de bois jusqu’à ce que les recettes de la compagnie permettent d’en construire un en pierre ou en fer. Les charpentiers américains n’ont pas de rivaux dans l’art de construire ces ponts de bois, ces trestle-works qui atteignent parfois soixante mètres de hauteur et qui sont installés avec une simplicité de moyens et une audace stupéfiantes.
Y a-t-il une vallée profonde à traverser ? On commence par poser un lit de pierres dures ; puis, on dresse un premier chevalet, lequel en supporte un second, puis un troisième, puis un quatrième, autant qu’il en faut pour atteindre le niveau de la voie ; sur le dernier chevalet, deux poutres, sur les poutres, deux rails.
Ces constructions audacieuses ne sont maintenues ni par des croix de Saint-André ni par des fers en T ; elles ne tiennent que grâce à des chevilles et à quelques poutrelles qui, de place en place, maintiennent l’écartement des chevalets.
C’est sur une estacade de ce genre qu’était posée la voie du chemin de fer de New York, à quelques kilomètres de la station de Rochester.
Le pont, d’une trentaine de mètres de hauteur, enjambait une large et profonde vallée, au fond de laquelle coulait un ruisseau marécageux qui, quelques lieues plus loin, allait se perdre dans le lac Ontario[2].
Ce paysage offrait un aspect sauvage et désolé. À perte de vue, les bords du ruisseau étaient couverts de joncs, de roseaux et de saules nains, qui servaient de refuge aux oiseaux aquatiques.
Il était environ dix heures du soir, et un épais brouillard occupait tout le fond de la vallée, lorsque trois hommes, emmitouflés dans d’épais manteaux à capuchon, s’aventurèrent à travers ce terrain boueux et détrempé, où ils enfonçaient à chaque instant.
– Je ne sais plus où nous sommes, dit l’un d’eux. Il n’y a pas moyen de s’y reconnaître. On n’y voit pas à quatre pas devant soi.
– Mon cher Cornélius, dit un autre, je crois que je ferais bien d’allumer ma lanterne électrique.
– Ce n’est pas très prudent. Vous savez, Baruch, que l’on peut voir la lumière du haut du pont.
– Avec ce brouillard, c’est impossible. Qu’en dites-vous, Fritz ? ajouta-t-il en se tournant vers le troisième personnage qui n’avait pas encore desserré les dents.
– Ma foi, je suis de votre avis. Avec une brume pareille, nous ne risquons pas grand-chose.
Baruch appuya sur le déclic d’une lanterne de poche, et, grâce à ce secours, les trois Lords de la Main Rouge purent suivre, sans trop patauger, le sentier qui serpentait au fond de la vallée.
Au bout d’un quart d’heure d’une marche pénible et lente, ils atteignirent une misérable cahute construite avec des branches de saule, couverte de roseaux et assez semblable aux abris dont se servent les chasseurs de bécassines et de canards sauvages. C’est à peine si un homme eût pu s’y tenir debout. Elle n’avait d’autre issue qu’une porte, qui faisait face au pont du chemin de fer dont la base était en ce moment noyée dans le brouillard, mais dont la partie supérieure se dessinait avec une netteté fantastique sur le ciel pâle éclairé par les rayons de la lune.
Les trois Lords s’étaient assis sur une botte de roseaux, qui tenait lieu de tout autre siège.
Baruch déplaça une de ces bottes et tira de dessous une boîte carrée, à laquelle était attaché un fil métallique protégé par une gaine de coton vert. La boîte renfermait un manipulateur électrique, dont Cornélius et Baruch vérifièrent soigneusement le mécanisme.
– Il est en parfait état, dit Fritz. Je craignais que l’humidité ne l’ait abîmé.
– Non, fit Baruch. Cette cahute est un peu plus élevée que le niveau du sol environnant… Mais quelle heure est-il ?
Cornélius tira son chronomètre.
– Dix heures dix à la station de Rochester. Nous avons donc encore vingt-cinq minutes à attendre. Vous n’oublierez pas mes recommandations, n’est-ce pas ? Sitôt que les lumières du train arriveront au niveau du signal qui se trouve à l’entrée du pont, vous ferez jouer le commutateur.
– Ce sera un bel écrabouillement ! ricana Fritz. Il y a dix kilos de panclastite sous chacune des maîtresses poutres… Voulez-vous, Baruch, que l’un de nous reste à vous tenir compagnie ?
– Non pas. Votre présence dans les environs de la gare même de Rochester, au moment où va se produire la catastrophe, est indispensable. Aussi, il va être temps que vous me quittiez… puis ce que j’ai à faire n’est pas bien difficile.
– Comme je vous l’ai expliqué, dit Cornélius, vous ne courez aucune espèce de risque. Les poudres brisantes, dans le genre de la panclastite, agissent toujours dans le sens de la verticale, et de bas en haut. Enfin, vous êtes ici assez loin du pont pour n’avoir rien à craindre.
– Je le sais… Puis je ne resterai pas longtemps ici. Sitôt que l’explosion se sera produite, je prendrai juste le temps de noyer mon appareil dans les boues de la rivière et je regagnerai mon auto. Je tiens beaucoup à ce que ma présence à New York soit constatée demain matin.
– Je crois, répondit Cornélius, que nos dispositions sont prises de la façon la plus sage. Nous avons, nous, un autre rôle à remplir et qui n’est pas le moins difficile.
– Tout se passera bien, dit Fritz. Il nous fallait une catastrophe de ce genre. Cela dénoue la situation de toutes les façons.
– Vous devez comprendre, fit Cornélius à ses deux complices, que des entreprises comme le vol du buste aux yeux d’émeraude ne nous offrent qu’une ressource précaire. Il nous faut mettre la main, d’un seul coup, sur des capitaux véritablement considérables.
– J’ai reçu, il n’y a pas une heure, continua Fritz, les derniers renseignements de mes agents… Tous nos ennemis seront dans le train : William Dorgan, Isidora et votre vrai père, mon cher Baruch, Fred Jorgell.
– Oh ! c’est celui-là que je déteste le plus ! répliqua le bandit, dont la physionomie prit une expression de férocité sauvage.
– Il y a aussi, reprit Cornélius avec un sourire gouailleur, toute la bande des Français, en commençant par mon savant collègue, M. Prosper Bondonnat, pour finir par ce malicieux bossu qui nous a déjà causé tant d’ennuis.
Le visage de Baruch se rembrunit.
– J’aurais pourtant bien voulu, continua-t-il, sauver Andrée !…
– Quel enfantillage ! s’écria Fritz. Au point où nous en sommes, nous n’avons plus rien à ménager. Il faut qu’ils disparaissent tous. C’est le seul moyen de dégager la situation. Andrée doit mourir comme les autres. Il faut qu’elle meure !
– Eh bien ! qu’elle meure ! murmura Baruch d’une voix faible.
Cornélius tira de nouveau son chronomètre.
– Hum ! fit-il, il ne nous reste plus qu’un quart d’heure. Nous avons juste le temps d’arriver. Au revoir, mon cher Baruch, et bonne chance ! Dès demain matin, vous aurez une dépêche chiffrée, qui vous renseignera.
– Au revoir, docteur ! Au revoir, Fritz !
Les trois bandits échangèrent un cordial shake-hand et se séparèrent.
Baruch demeura seul, étendu sur la litière de roseaux. Il avait éteint sa lampe électrique, et il attendait.
De temps en temps, une rafale de vent s’élevait et faisait craquer les poutres de l’immense estacade. Il semblait à l’assassin, frissonnant malgré lui, que des voix plaintives se mêlaient aux gémissements du vent dans les roseaux. À l’entrée du pont, dont les échafaudages émergeaient d’un océan de brouillard, le grand signal rouge était semblable à une prunelle sanglante, ouverte dans la nuit noire.
*
* *
Au moment même où Fritz et Cornélius prenaient congé de Baruch, trois luxueuses automobiles déposaient devant la gare du chemin de fer de New York à Rochester toute une bande affairée et joyeuse. Les hôtes de la propriété du lac Ontario se trouvaient réunis, sauf pourtant Harry, retenu à New York une bonne partie du temps par l’écrasant travail que lui imposait l’administration des paquebots Éclair.
Après de longues hésitations, il avait été convenu que tout le monde irait passer un mois dans la propriété que William Dorgan venait d’acheter en Floride. Le milliardaire, tout joyeux que l’on eût enfin accepté son invitation, alla chercher lui-même les billets du pullman-car dans lequel toute la société devait prendre place.
– Le rapide part à dix heures trente-cinq, dit-il gaiement. Nous serons à New York pour minuit et demi.
Tous se disposaient à passer sur le quai, pendant qu’une escouade de domestiques, sous la direction de l’ex-clown nageur Bob Horwett, s’occupait de l’enregistrement des bagages, lorsqu’un cycliste mit pied à terre devant la gare et se dirigea vers le groupe que formaient la famille et les amis des deux milliardaires.
M. Bondonnat eut un geste de surprise en reconnaissant dans ce cycliste le Peau-Rouge Kloum. Il était couvert de sueur et de poussière. Tout de suite, il s’approcha du vieux savant.
– Qu’y a-t-il donc, mon brave Kloum ? lui dit-il. Te voilà tout époumoné !
– Dépêche de lord Burydan ! répondit laconiquement l’Indien.
– Pour moi ?
– Oui, pour vous.
Kloum tendit à M. Bondonnat une lettre que celui-ci décacheta fiévreusement. Voici quel en était le contenu :
« Mon cher maître,
« Ne prenez pas le rapide de New York qui part de Rochester à dix heures trente-cinq, et faites en sorte que tous nos amis remettent leur voyage à demain. Insistez pour les retenir ; autrement, ils s’exposeraient à un terrible danger. J’ai des raisons de ne pas me montrer plus explicite.
« Cordialement à vous,
« Lord BURYDAN. »
La signature de l’excentrique était accompagnée de l’X qui signifiait, comme il avait été convenu, que la recommandation contenue dans la lettre devait être exécutée à la lettre.
M. Bondonnat se trouvait fort embarrassé. Il ne savait comment s’y prendre pour décider ses amis à ajourner leur départ ; d’un autre côté, il savait que l’excentrique devait avoir des raisons très graves pour agir comme il le faisait.
Le vieux savant ne trouva rien de mieux – car le temps pressait – que de prendre à part Fred Jorgell, l’ingénieur Paganot et le naturaliste Ravenel, qui se rendirent sans peine à ses raisons et se chargèrent de persuader miss Isidora, Andrée et Frédérique de la nécessité qu’il y avait à reculer d’un jour leur départ. Quant à Oscar Tournesol, il connaissait trop bien lord Burydan pour ne pas savoir que ce dernier avait eu de graves motifs pour écrire une pareille lettre.
Il ne restait donc plus à prévenir que William Dorgan. Mais celui-ci ne voulut rien entendre, même quand M. Bondonnat, après quelques hésitations, lui eut montré la lettre de lord Burydan. Il fut même un peu vexé que sa belle-fille, qui lui avait formellement promis de l’accompagner, ainsi que ses amis, changeât de décision si brusquement.
– Chacun est libre de faire ce qu’il veut, déclara-t-il sèchement, mais j’ai décidé que je prendrais ce train, et je le prendrai. Ni lord Burydan ni personne ne me fera changer d’avis, je me demande vraiment quel danger je puis courir, confortablement installé dans un compartiment de luxe. Avec des raisonnements pareils, on ne monterait jamais en wagon. J’ai, demain matin, à New York, plusieurs rendez-vous sérieux, et ce n’est pas sous un prétexte aussi futile que je vais les contremander.
– Ce n’est pas sous un prétexte futile, répliqua vivement Isidora. Qui sait si les bandits de la Main Rouge n’ont pas formé le projet d’attaquer le train ?
– Mais non ! La Main Rouge n’a jamais été si terrible que cela. Tous ceux qui en font partie sont sous les verrous, d’ailleurs… Vous vous forgez des craintes chimériques…
Tous les raisonnements, toutes les supplications même se heurtèrent à l’inébranlable entêtement du vieux gentleman.
Lorsque le train parut en gare, il monta dans son compartiment et, se penchant à la portière, il donna à ses amis une dernière poignée de main.
Mais il paraissait véritablement très contrarié de la défection de ses invités.
– J’espère, lui dit mistress Isidora, que vous ne nous en voudrez pas ?
– Nullement, répliqua le milliardaire qui avait repris toute sa bonne humeur. Je comprends très bien les raisons qui vous font agir, quoiqu’elles ne me paraissent pas suffisantes, à moi.
– Vous avez tort, mon cher beau-père, et je vais toute la nuit être inquiète à votre sujet. Promettez-moi, du moins, de m’envoyer, dès votre arrivée à New York, un télégramme pour me rassurer.
– C’est promis. Mais, j’y songe, quand nous reverrons-nous ? J’espère bien que votre départ, en dépit des mystérieux avertissements de lord Burydan, n’est pas définitivement ajourné ? Ah ! si vous saviez quel endroit délicieux que ce coin de la Floride, avec ses grands palmiers et ses lianes odorantes ! Quand vous l’aurez vu, vous ne voudrez plus le quitter.
– Nous n’avons nullement envie de refuser votre invitation, répliqua la jeune femme avec vivacité. La preuve, c’est que demain, à midi sans faute, nous serons à New York, d’où nous partirons tous ensemble pour la Floride.
– À moins, toutefois, répliqua malicieusement le milliardaire, que vous ne receviez de l’excentrique lord un nouvel avertissement mystérieux.
– Cela n’est pas probable.
– Qui sait ! murmura M. Bondonnat qui, depuis qu’il avait lu la lettre apportée par Kloum, était en proie à mille inquiétudes.
À ce moment, l’énorme locomotive du rapide fit entendre un sifflement déchirant ; la cheminée lançait des torrents de fumée noire mélangée à des flocons de vapeur ; les essieux grincèrent ; le train s’ébranlait.
Mistress Isidora, qui était montée sur le marchepied du wagon, n’eut que le temps de sauter à terre.
Le lourd convoi s’était mis lentement en marche, gravissant avec effort la pente de la voie, très raide en cet endroit, et à l’extrémité de laquelle se trouvait le signal rouge placé à l’entrée du pont de bois.
Les hôtes de Fred Jorgell remontèrent dans les autos qui les avaient amenés et reprirent assez tristement le chemin du château. Tous étaient péniblement impressionnés, surtout mistress Isidora et ses deux amies. Fred Jorgell essaya, mais bien inutilement, de les rassurer.
– Je ne sais vraiment pas, fit-il, quelle sorte de péril peut courir William Dorgan. Son train le dépose à la gare de New York, où il trouve son chauffeur qui l’attend et qui le conduit directement à son palais. Admettons même qu’il soit attaqué par la Main Rouge – si cela arrive, il ne devra s’en prendre qu’à son propre entêtement –, il est quand même prévenu. Il est armé. Puis, je le répète, je ne vois pas trop à quel moment il pourrait être attaqué. À l’heure où il arrivera, beaucoup de quartiers de la ville sont encore pleins d’animation.
– Vous avez sans doute raison, murmura Andrée de Maubreuil. Et pourtant, si lord Burydan nous a prévenus, ce n’est certainement pas sans motif, croyez-le bien.
– Je voudrais bien être à demain matin, dit mistress Isidora.
Personne n’essaya de continuer la conversation et le voyage se poursuivit dans un profond silence.
Fred Jorgell et ses amis, venaient à peine de quitter la gare qu’une auto, couverte d’une couche de poussière qui attestait une longue route, vint stopper en face de la porte de l’embarcadère. Deux hommes en descendirent. C’étaient lord Astor Burydan et son ami Agénor. Tous deux paraissaient en proie à une vive surexcitation.
Lord Burydan traversa les salles en quelques enjambées, se rua sur le quai, et apercevant le chef de gare, il se précipita vers lui.
– Sir, lui dit-il d’une voix pleine d’angoisse, le train de New York est-il parti ?
Le fonctionnaire crut se trouver, comme cela lui arrivait souvent, en présence d’un voyageur qui venait de manquer son train.
– Vous n’avez pas de chance, répondit-il flegmatiquement, il y a quelques minutes à peine que le train a quitté la gare. Tenez, en regardant bien, on le distingue encore. Il va franchir le signal qui se trouve en tête du pont de l’Estacade.
Il n’eut pas le temps d’achever sa phrase : une gerbe de flammes livides monta dans le ciel, montrant, pendant l’espace d’un éclair, la ville, les campagnes et le double ruban d’acier de la voie ferrée. Puis une détonation formidable retentit.
Le signal rouge avait disparu, comme éteint par un souffle invisible, et, à la place du pont et du train, il n’y avait plus qu’un grand nuage blanchâtre qui montait en tourbillonnant vers le ciel où resplendissait la pleine lune.
Le chef de gare était devenu blême.
– On a fait sauter le pont de l’Estacade ! s’écria-t-il avec désespoir.
Il ajouta, songeant tout de suite aux responsabilités qui pouvaient peser sur lui :
– Ce n’est pourtant pas ma faute !
– On ne peut vous accuser de rien, vous. Mais il faut aller tout de suite au secours de tous ces malheureux qui, là-bas, agonisent au fond du ravin… Un mot encore, ajouta-t-il en prenant la main du chef de gare, qui allait et venait sur le quai, à demi affolé. Je vous en supplie, dites-moi si le milliardaire Fred Jorgell – que vous connaissez sans doute – est monté dans le train avec ses amis ?
– Non, répondit le chef de gare machinalement. Ils avaient pris leurs billets ; mais, au dernier moment, il est venu un Peau-Rouge leur apporter une dépêche, et ils sont restés. Un seul d’entre eux est parti.
– Lequel ?
– C’est un milliardaire de New York… Ma foi, je n’ai pas retenu son nom…
– Ne serait-ce pas William Dorgan ?
– Oui, c’est cela.
Lord Burydan n’en entendit pas davantage. Il remonta en auto, en compagnie d’Agénor, et fila dans la direction du pont de l’Estacade de toute la vitesse que pouvait donner son moteur.
Pendant ce temps, les secours s’organisaient à la gare de Rochester. Le fameux docteur Cornélius et son frère Fritz, qui se trouvaient par hasard de passage dans la ville, furent les premiers à se mettre à la disposition des autorités et à se transporter sur le lieu de la catastrophe.
QUINZIÈME ÉPISODE
La dame aux scabieuses
CHAPITRE PREMIER
Après le sinistre du pont de
l’Estacade
Des malfaiteurs inconnus venaient de faire sauter le pont de l’Estacade, qui traverse une profonde vallée, à quelques miles en amont de la station de Rochester. Le rapide de New York avait été lancé dans l’abîme. Les wagons étaient broyés ; la plupart des voyageurs morts ou atrocement mutilés.
Lord Burydan, qui se trouvait avec son ami Agénor Marmousier à la gare de Rochester, s’était hâté de monter en auto et d’accourir sur le lieu du sinistre. Le spectacle qu’il aperçut était horrifiant, Des wagons avaient pris feu au fond de la vallée et les blessés, brûlés vifs dans les décombres, arrosés de l’eau bouillante de la locomotive éventrée, poussaient des cris lamentables. Quelques voitures demeuraient accrochées dans les rocs, à vingt ou trente mètres en l’air.
Cette scène de désolation était éclairée par la lune, alors dans son plein, et par la flamme rougeâtre des matériaux incendiés, qui permettait d’apercevoir les parois du gouffre.
Lord Burydan, si brave qu’il fût, se sentit ému de pitié et d’horreur. Il en oublia pour un instant les raisons qui l’avaient amené dans cette vallée de la mort. Le poète Agénor n’était guère moins épouvanté : il croyait voir se dresser devant ses yeux une vision de cauchemar ou d’apocalypse.
– Heureusement, murmura lord Burydan, que j’ai pu empêcher nos amis de prendre ce train ! Seul, William Dorgan est au nombre des voyageurs. Il faut tâcher de le retrouver !
L’auto fut laissée derrière un bouquet de saules, à mi-côte du chemin qui descendait au fond de la vallée, et les deux amis s’avancèrent à travers les joncs et les roseaux, jusqu’à l’amoncellement des débris, d’où montait un concert de plaintes déchirantes.
Ils avaient à peine fait quelques pas, dans cette vallée d’horreur, lorsque Agénor poussa une exclamation. Il venait d’apercevoir le corps inerte de William Dorgan, sous un enchevêtrement de roues et de traverses, qui, en formant au-dessus de lui une sorte de voûte, avaient dû, jusqu’à un certain point, le protéger. Le milliardaire portait à la tempe une profonde blessure.
– Je doute fort qu’il soit encore vivant après une pareille chute, dit lord Burydan en secouant la tête.
– Le cœur bat cependant, dit Agénor qui s’était approché du blessé. Que faut-il faire ?
– Aidez-moi, d’abord, à le transporter jusqu’à l’auto. Puis vous le conduirez…
– À Rochester ?
– Non. J’ai des raisons pour qu’on ne le voie pas à Rochester. Vous irez jusqu’à Syracuse, qui ne se trouve qu’à une heure d’ici, et vous le déposerez dans ma petite maison du faubourg… en ayant soin de vous faire voir le moins possible. Kloum, d’ailleurs, ne tardera pas à venir vous rejoindre.
– Cela sera exécuté de point en point. Vous pouvez être sûr que William Dorgan sera admirablement soigné.
Tous deux prirent le corps du milliardaire qu’ils eurent beaucoup de difficulté à retirer de dessous les décombres, et ils le transportèrent jusqu’à l’auto. Lorsqu’ils y furent arrivés, lord Burydan retira des poches du blessé tous les papiers qu’elles contenaient. Un étrange projet venait tout à coup de germer dans son esprit. Il s’empara d’un carnet de chèques, d’un portefeuille contenant des pièces d’identité, de deux cartes de circulation sur des lignes de chemin de fer et enfin de plusieurs lettres et télégrammes. Il prit aussi une bague ornée d’un brillant, que William Dorgan portait à la main droite, et une épingle de cravate ornée d’une grosse perle.
Agénor l’avait regardé faire avec surprise.
– Quels sont donc vos projets ? lui demanda-t-il.
– Il serait trop long de vous les expliquer. Sachez seulement que je viens peut-être de trouver le moyen d’anéantir la Main Rouge… Mais, adieu, mon cher Agénor. Prenez bien soin de notre blessé.
L’auto démarra et se perdit dans la nuit. Lord Burydan redescendit en toute hâte vers le champ du carnage. Il examina successivement plusieurs cadavres, atrocement défigurés, jusqu’à ce qu’il en aperçût un dont la tête ne formait plus qu’une bouillie sanglante et qui était de la même taille et à peu près de la même corpulence que William Dorgan. D’ailleurs, le cadavre inconnu était vêtu avec une rare élégance.
– Je crois que je ne trouverai pas mieux, murmura l’excentrique avec émotion.
Sans hésiter, il passa au doigt de l’inconnu la bague en brillants, le para de l’épingle de cravate ornée d’une perle et glissa dans sa poche intérieure le carnet de chèques, non sans avoir eu soin de se saisir de tous les papiers que possédait le défunt, un certain Mr. Murray, directeur des aciéries de Brooklyn.
Lord Burydan avait à peine fini de mener à bien cette substitution, qui eût paru suspecte à tous ceux qui ne le connaissaient pas, lorsque son attention fut attirée par de faibles gémissements qui partaient d’un pullman-car, renversé sens dessus dessous. Il s’approcha aussitôt, et, s’ensanglantant les doigts aux glaces brisées du compartiment, à demi étouffé par l’acre fumée, il parvint à retirer des débris embrasés une jeune femme d’une extrême beauté. Il fut frappé de ce fait qu’elle portait à la ceinture un gros bouquet de scabieuses et qu’elle était vêtue de deuil.
À peine avait-il réussi à la dégager qu’elle s’évanouit dans ses bras, après lui avoir jeté un regard éperdu de reconnaissance.
Lord Burydan porta la jeune femme jusqu’à un endroit éloigné d’une cinquantaine de pas, et la déposa doucement sur un tertre couvert d’un épais gazon. Puis il redescendit jusqu’au ruisseau qui coulait au fond de la vallée, pour y tremper son mouchoir afin d’humecter le front et les tempes de la blessée.
Il aperçut alors une troupe d’hommes, armés de torches et de phares électriques, qui descendaient en hâte le sentier de la vallée ; d’un coup d’œil, il reconnut, parmi eux, Fritz et Cornélius Kramm ; ce qui lui donna beaucoup à penser.
Le chef de gare de Rochester, qui se trouvait aussi au nombre des sauveteurs, l’avait aperçu. Ils échangèrent quelques mots, et lord Burydan lui recommanda tout spécialement la jeune fille qu’il venait d’arracher à la mort. Ensuite il se joignit lui-même à la troupe des sauveteurs, parmi lesquels figuraient une douzaine de robustes hommes d’équipe munis de pioches et de barres de fer destinées à déblayer les décombres.
Les secours furent organisés avec cette silencieuse rapidité que l’on ne trouve peut-être qu’en Amérique. Les morts furent déposés, côte à côte, sur le bord du ruisseau ; les blessés provisoirement installés sur des matelas, que deux fourgons de la Compagnie du chemin de fer avaient apportés de la ville. Grâce aux boîtes de pharmacie, on commença à donner aux blessés les soins les plus urgents. Leur nombre n’était, d’ailleurs, guère considérable. Dans cette catastrophe, dont on garde encore le souvenir en Amérique, presque tous les voyageurs avaient été tués. C’est à peine si, sur cent dix, une douzaine, plus ou moins mutilés, avaient survécu. Parmi ces rescapés, on retrouva une petite fille de quatre ans qui, couchée dans le filet aux bagages, avait supporté le terrible saut sans une égratignure. Elle souriait, regardant autour d’elle avec étonnement, comme si elle venait seulement de se réveiller. On l’emporta, pour qu’elle ne vît pas le cadavre de sa mère, décapitée net par une des roues de la locomotive. Plus loin, un gentleman, à barbe blanche, pris dans un enchevêtrement d’essieux et de roues, appelait désespérément au secours. Quand on voulut le dégager, on constata qu’il avait les deux cuisses coupées au ras du ventre. Il expira presque aussitôt. Une jeune femme, devenue folle, tenait dans un pan de sa jupe la tête de son mari.
Lord Burydan n’avait jamais vu de spectacle plus pitoyable.
La tâche des sauveteurs était, d’ailleurs, pleine de difficultés. Il fallut faire venir en hâte de Rochester une pompe à incendie pour éteindre le feu, qui avait pris aux débris des wagons et qui menaçait de tout consumer. La recherche des morts et des blessés continua, au milieu des poutrelles encore fumantes et des barres d’acier mal refroidies.
Lord Burydan faisait des prodiges d’héroïsme. Deux fois il faillit être écrasé en essayant de soulever un wagon, et il se brûla grièvement les mains en dégageant une vieille dame ensevelie sous les coussins. Cette dernière n’avait aucune blessure ; elle avait simplement failli être étouffée et grillée à petit feu.
Cornélius et Fritz feignaient de déployer, eux aussi, un grand zèle. Mais leur véritable préoccupation n’avait rien de philanthropique. Tous deux, persuadés que le milliardaire Fred Jorgell, sa famille et les Français, leurs amis, se trouvaient dans le train, attendaient, avec une impatience féroce, que les cadavres de leurs ennemis fussent retrouvés.
Lord Burydan, que ni l’un ni l’autre n’avaient reconnu, suivait leur manège du coin de l’œil et observait attentivement leurs faits et gestes.
Les deux bandits paraissaient décontenancés. Cependant, lorsqu’on apporta, à l’ambulance provisoirement installée, le cadavre défiguré de Mr. Murray et que Cornélius reconnut à son doigt la bague en brillants de William Dorgan, il ne put réprimer un geste de satisfaction. Il fouilla le cadavre et, dans une poche intérieure, trouva le carnet de chèques mis là par lord Burydan.
– En voici toujours un ! dit-il à Fritz qui, sur un signe de son frère, était accouru. Nous ne pouvons manquer de trouver les autres d’ici peu.
Les deux bandits jugèrent nécessaire de montrer ostensiblement le chagrin qu’ils étaient censés éprouver de la mort de leur ami et associé.
– Ce cher William Dorgan ! s’écria Fritz en appelant le chef de gare et d’autres personnes présentes, dire qu’il n’y a pas huit jours nous déjeunions gaiement ensemble ! Pourquoi faut-il que le hasard m’ait donné la douloureuse mission d’être le premier à reconnaître le corps de mon ami ?
– Vous veillerez, n’est-ce pas ? fit Cornélius sur un ton de circonstance, à ce que le corps de notre ami soit mis à part, en attendant que nous fassions prévenir ses deux fils.
– C’est encore une chance qu’il n’y ait que lui ! murmura l’honnête chef de gare en se rapprochant. Savez-vous que toute la famille a failli y passer ?
– Que dites-vous là ? demanda Fritz l’œil mauvais et la face subitement crispée.
– Je répète que c’est bien heureux que Mr. Fred Jorgell, que je connais de vue, et tous ses amis n’aient pas accompagné Mr. William Dorgan, comme ils en avaient l’intention. Au dernier moment, ils ont changé d’avis et ont refusé de monter dans le train.
– C’est fort heureux, en effet, répliqua Cornélius d’un air contraint.
Il avait grand-peine à ne pas trahir son dépit et sa mauvaise humeur.
– C’est décidément de la guigne ! s’écria Fritz avec rage, une fois que les témoins de cette scène se furent éloignés. Nous qui croyions nous débarrasser de toute la bande d’un seul coup !…
– Tant pis ! C’est à recommencer !
– Quel dommage ! Tout avait si bien marché !
– J’avais pris les plus minutieuses précautions. Je m’étais même muni d’un flacon spécial, dont il m’eût suffi de laisser tomber une goutte sur chaque pansement pour amener le trépas instantané des survivants !
– Ne nous désolons pas, cependant, dit Fritz après réflexion. Nous avons un résultat. Le décès de William Dorgan va mettre notre ami Baruch en possession de sommes importantes. Un des buts que nous poursuivions va se trouver atteint.
Pendant que les deux Lords de la Main Rouge dissertaient cyniquement, au milieu des morts et des mourants, lord Burydan continuait à dépenser, sans compter, ses forces et son énergie, risquant cent fois sa vie pour arracher, de dessous la charpente disloquée des wagons, des corps qui, le plus souvent, n’étaient que des cadavres.
Le petit jour se leva sur cette scène de désolation, lord Burydan était brisé de fatigue, les brûlures et les blessures dont il était atteint le faisaient beaucoup souffrir.
Il songea à se retirer. D’autant plus que sa présence devenait absolument inutile. Ceux des voyageurs qui étaient encore vivants avaient été mis en sûreté, et le nombre des sauveteurs croissait de minute en minute. Il en arrivait de tous côtés.
Un fait donnera idée de l’activité américaine. On s’occupait encore à déblayer le fond de la vallée sanglante que déjà une escouade d’une centaine de charpentiers, appelés par dépêche et venus en train spécial, s’occupaient de la reconstruction de l’Estacade.
Lord Burydan allait se retirer, en profitant d’une des nombreuses voitures de louage venues de Rochester, lorsqu’il se souvint tout à coup de cette belle jeune femme qu’il avait secourue la première, au teint si pâle, aux vêtements de deuil, avec un bouquet de scabieuses à la ceinture.
Oubliant sa fatigue, il remonta précipitamment vers l’ambulance provisoire, que, précisément, Cornélius venait de quitter, après avoir acquis la certitude que William Dorgan était le seul ennemi de la Main Rouge qui eût péri dans la catastrophe.
Lord Burydan, n’apercevant plus, tout d’abord, la jeune femme parmi les blessés, se mit à la recherche du chef de gare, auquel il l’avait recommandée. Il ne le trouva pas. Dans le désarroi, personne ne put lui donner un renseignement.
Machinalement poussé peut-être par un pressentiment, il alla jusqu’à l’endroit où avaient été déposés les cadavres. À peine eut-il jeté un coup d’œil sur les restes défigurés de ceux-ci qu’il reconnut, avec une douleur indicible, le cadavre de la belle jeune femme en deuil. À ses côtés, sans doute pour faciliter à ses parents ou à ses amis la tâche de la reconnaître, on avait replacé à sa ceinture le bouquet de fleurs d’un violet sombre.
– La seule femme que j’aurais aimée ! balbutia-t-il douloureusement.
Il effleura de ses lèvres le front glacé de la morte et s’enfuit, le désespoir dans le cœur.
CHAPITRE II
« Célérité. –
Discrétion !… »
Les semaines qui suivirent furent pour lord Burydan pleines de troubles, d’agitation et de neurasthénie. Tout d’abord, William Dorgan, qu’Agénor avait conduit dans le cottage que possédait l’excentrique dans la banlieue de Syracuse, n’avait pu, malgré tous les soins, se remettre complètement de l’émotion qu’il avait éprouvée. Il était devenu entièrement aphasique ; il ne pouvait plus articuler que quelques bégaiements inintelligibles.
Lord Burydan se repentait presque de la substitution opérée par lui. Des scrupules tardifs lui venaient. Il se demandait s’il avait bien eu le droit de faire ce qu’il avait fait.
Avec sa franchise ordinaire, il jugea que le plus simple était de mettre William Dorgan lui-même au courant de ses projets.
Le milliardaire, qui, à part l’impossibilité de parler, avait complètement recouvré ses facultés intellectuelles, écouta gravement la confidence du lord excentrique. Il demeura quelques minutes plongé dans ses réflexions. Enfin, il saisit d’une main ferme les tablettes dont il se servait pour correspondre avec ceux qui l’entouraient et traça ces simples mots :
Vous possédez ma confiance et j’approuve entièrement ce que vous avez fait. Pour tous, je suis mort, et mort je dois demeurer jusqu’à nouvel ordre.
Lord Burydan, malgré ses longues explications au milliardaire sur ses projets, fut un peu surpris de la facilité avec laquelle il donnait son assentiment.
– Ne faudrait-il pas, lui demanda-t-il encore, prévenir votre fils Harry ?
L’aphasique fit de la tête un signe de dénégation.
– Et votre fils Joë ?
William Dorgan renouvela son signe dénégatif, mais d’une façon plus énergiquement accentuée.
C’est que le milliardaire, pendant les longues heures de recueillement de sa convalescence, avait eu le temps de réfléchir à une foule de petits faits auxquels, jusqu’alors, il n’avait prêté aucune attention, et, sans les connaître dans leur entier, il avait deviné assez les projets de lord Burydan pour se rendre compte qu’il y avait neuf chances sur dix pour que l’excentrique eût raison. Il ne pouvait oublier que lord Burydan lui avait sauvé la vie. Enfin, il y avait eu, entre eux, deux ou trois entretiens confidentiels au cours desquels lord Burydan avait réussi à gagner entièrement le milliardaire à ses idées.
C’était pour ce dernier un point très important que d’avoir obtenu l’assentiment de William Dorgan, auquel il s’était fait connaître sous son véritable nom. Toutefois, par une contradiction curieuse, lord Burydan, en proie à une noire mélancolie, demeura, pendant une période assez longue, sans s’occuper de la Main Rouge.
Malgré tous ses efforts, le jeune lord ne pouvait oublier la tragique physionomie de cette belle inconnue – la dame aux scabieuses, c’est ainsi qu’il l’avait nommée – qu’il n’avait fait qu’entrevoir et tenir un instant dans ses bras, pour la perdre presque aussitôt.
En vain essayait-il de s’arracher à cette hantise. Le poète Agénor, malgré toutes les ressources de son imagination, ne put parvenir à l’en distraire.
Diverses circonstances vinrent raviver ce chagrin. Un jour, lord Burydan, entré pour se rafraîchir dans un café, trouva, sur la table à laquelle il s’était assis, un numéro du New York Illustrated News. L’ayant feuilleté d’abord distraitement, son attention fut attirée par une double page où se trouvaient les portraits de toutes les victimes du sinistre de Rochester. Du premier coup, il reconnut la dame aux scabieuses, dont le portrait offrait une ressemblance saisissante.
– Cette image me poursuivra donc partout ! balbutia-t-il, et il referma le journal.
Il allait se retirer lorsque, sur la couverture même du périodique, il fut invinciblement attiré par cette stupéfiante annonce :
INSTITUT SPIRITUALITÉ
Pour le soulagement des gentlemen
et ladies inconsolables.
DIRECTEUR : EZÉCHIAS PALMERS, PSYCHOLOGUE MENTALISTE, MEMBRE DE PLUSIEURS ACADÉMIES
Vous tous qui avez perdu un être cher, qui pleurez une mère, une épouse, une fiancée, une fille adorée, ne vous abandonnez pas au désespoir ! Allez en toute confiance trouver l’honorable Ezéchias Palmers. Il vous consolera de vos chagrins ; il fera apparaître à vos yeux les physionomies familières et bénies des chères disparues, miraculeusement délivrées des chaînes inexorables de la mort.
Nous ne faisons ici aucune promesse mensongère. Les incrédules viendront ; ils verront et ils seront convaincus.
MATÉRIALISATIONS.
APPARITIONS EN TOUS GENRES.
Conversations avec l’au-delà.
Révélations d’outre-tombe.
Voyages dans l’Astral. – Double vue.
Etc., etc.
Adresser toutes communications à M. Ezéchias Palmers, directeur de l’Institut spiritualiste, 15e Avenue, n°211. – Téléphone.
Célérité. – Discrétion. – Prix modérés. –
Évocations à domicile.
Lord Burydan relut deux fois cette étrange réclame ; puis il murmura, en haussant les épaules :
– Ce doit être quelque charlatan !
Il emporta cependant le numéro du New York Illustrated News, car il voulait découper la photographie de la dame aux scabieuses pour la conserver.
Trois jours après, une affaire l’ayant amené à New York, le hasard le conduisit dans la Quinzième avenue. Sans l’avoir cherché le moins du monde, il se trouva en face d’une haute porte de bronze au-dessus de laquelle on lisait en lettres d’or : Institut spiritualiste. Cette inscription était fixée au milieu d’une très haute muraille.
La curiosité fut plus forte, chez lord Burydan, que tout autre sentiment. Il sonna, se trouva dans une cour plantée d’ifs et de cyprès vénérables, d’où un domestique, vêtu d’une souquenille violette qui le faisait ressembler à un évêque, le conduisit dans un salon d’un aspect sévère et d’un style particulièrement original.
Les meubles massifs étaient d’ébène incrusté de petites étoiles de nacre. Les tentures d’un bleu foncé avec des franges d’argent ; de la voûte, en forme de dôme, pendait un grand brûle-parfum. La voûte elle-même formait comme un ciel d’azur parsemé d’anges souriants. Sur la cheminée, un groupe en marbre représentait la mort sous la forme d’un hideux squelette auquel un génie souriant mettait le genou sur la poitrine et arrachait sa faux. De hautes fenêtres à vitraux répandaient sur ce décor une mystérieuse lumière.
– Drôle de salon ! murmura lord Burydan en regardant autour de lui.
Cinq minutes plus tard, une des portières de velours bleu s’écarta, pour livrer passage à un gentleman d’une correction parfaite, qui s’inclina cérémonieusement devant le visiteur.
– À qui ai-je l’honneur de parler ? demanda lord Burydan.
– Je suis Ezéchias Palmers.
Il ajouta, sans donner à lord Burydan le temps de se reconnaître :
– Vous avez sans doute perdu une personne qui vous était chère ?
Lord Burydan était entré dans ce bizarre établissement sous l’impulsion de la curiosité. Maintenant qu’il se trouvait en face du directeur, il ne savait plus de quelle façon s’y prendre pour faire une retraite honorable. Au fond, il était persuadé qu’il avait affaire à un charlatan.
– Sir, répondit-il avec un peu d’embarras, il est vrai. Mais je voudrais vous demander quelques renseignements. Je ne vous cacherai pas que je suis un sceptique, je me demande comment vous pouvez faire pour réaliser les séduisantes promesses de votre prospectus.
Mr. Palmers jeta sur son interlocuteur un regard imposant ; et ce ne fut qu’après l’avoir toisé avec une sorte de pitié dédaigneuse qu’il répondit :
– Sir, les moyens que nous employons sont en partie naturels et en partie occultes. Mais qu’importe, si nous atteignons le but que nous nous sommes proposé ! Tous ceux qui s’adressent à moi, je vous l’affirme, n’ont jamais éprouvé de désillusions.
Lord Burydan se sentit entraîné, malgré lui, à mettre Mr. Palmers au défi. Il tira de sa poche la photographie de la dame aux scabieuses :
– Avez-vous le pouvoir, dit-il, de me faire voir la personne dont voici le portrait ?
– Parfaitement, répondit Mr. Palmers avec aplomb.
– Emploierez-vous les moyens surnaturels ou les autres ? ne put s’empêcher de demander l’excentrique.
– Cela dépendra… En tout cas, il est indispensable que je connaisse, de la façon la plus minutieuse, dans quelle circonstance vous avez vu cette personne pour la dernière fois.
Lord Burydan, très mécontent, au fond, de s’être aventuré dans cette officine, raconta en quelques mots la catastrophe du pont de l’Estacade, et demanda à Mr. Palmers quand il devrait revenir.
– Je vous écrirai, répondit celui-ci, mais encore faut-il que je connaisse votre adresse.
– Je ne tiens pas à vous dire mon nom. Écrivez-moi à Syracuse, poste restante, aux initiales A. B.
– Comme il vous plaira, répliqua le directeur avec le même sang-froid. Mais vous savez que, dans ce cas, l’usage de l’établissement est de demander des arrhes.
– Votre demande est trop légitime. Voici cinq cents dollars.
– Cela suffit pour un premier acompte. Si vous êtes satisfait, vous aurez à nous verser pareille somme. Dans le cas contraire, vous serez intégralement remboursé.
Mr. Palmers reconduisit son visiteur jusqu’à la porte de l’Institut spiritualiste, et il lui dit, avant de le quitter :
– Il y a fort longtemps, vous savez, que je m’occupe des sciences de l’âme, et nul ne peut soupçonner combien cette étude est passionnante. J’ai débuté par l’étude des maladies mentales, j’ai même été quelque temps directeur du Lunatic-Asylum de Greenaway ; et ce n’est que par degrés que je suis arrivé, peu à peu, à la connaissance de l’Occulte…
Ce mot de Greenaway fut un trait de lumière pour lord Burydan. Il comprit qu’il se trouvait en face de l’ex-jockey qui avait été quelque temps son geôlier, dans la maison de fous d’où il s’était évadé avec l’aide d’Oscar Tournesol, et il s’applaudit sincèrement de n’avoir pas fait connaître sa véritable personnalité à ce singulier industriel.
Lord Burydan retourna le soir même à Syracuse. Plusieurs jours s’écoulèrent sans qu’il entendît parler de Mr. Palmers. Il commençait à croire que les cinq cents dollars versés par lui pouvaient être regardés comme perdus, lorsqu’il reçut un court billet l’avertissant de se trouver à dix heures du soir, très exactement, à l’Institut spiritualiste et de s’attendre à toute émotion.
L’excentrique se sentait de plus en plus mécontent de s’être engagé dans cette affaire. Cependant, la curiosité le poussa à voir de quelle façon Mr. Palmers tiendrait ses engagements. Il prit donc, le lendemain matin, le train pour New York.
Il passa une partie de la journée à faire des visites. À mesure que l’heure fixée par le thaumaturge approchait, il ne pouvait s’empêcher d’éprouver une sourde impatience. Pour lui, le temps marchait avec une lenteur désespérante.
À dix heures, très exactement, il sonnait à la porte de l’Institut spiritualiste.
Le même serviteur, vêtu de violet, vint lui ouvrir. Sans un mot, il le conduisit, par une petite porte, jusqu’à une avenue bordée de noirs sapins et de houx aux baies écarlates, à l’extrémité de laquelle se trouvait une autre porte à double vantail surmontée d’une croix.
Lord Burydan frissonna. Allait-on donc le conduire dans un cimetière ? Il était déjà, par avance, indigné de cette macabre comédie. Mais il s’était trop avancé pour reculer. Il fallait aller jusqu’au bout.
Son guide lui ouvrit la porte de l’enclos funèbre, lui fit comprendre par signes qu’il ne pouvait l’accompagner plus loin et, finalement, le laissa seul.
À la clarté de la lune, que voilaient à peine de légers nuages, l’excentrique put examiner le lieu où il se trouvait.
C’était bien un cimetière, mais un cimetière du plus grand luxe. Les allées, bien sablées, étaient bordées de sphinx de bronze et, dans le fouillis des verdures funèbres, de hautes colonnes surmontées d’urnes, des chapelles gothiques et jusqu’à des statues silhouettaient leur blancheur marmoréenne. Des massifs montaient les pénétrants parfums des fleurs, auxquels se mêlait une vague odeur d’encens et d’aloès.
Lord Burydan, poursuivant sa route, longea les bords d’un étang où dormaient des cygnes noirs. Il passa près d’un immense jasmin couvert de fleurs, et il écouta quelques instants les chants d’un rossignol qui s’égosillait dans les branches d’un laurier.
Il savait gré à ceux qui avaient combiné cette mise en scène de lui avoir épargné les fantasmagories banales : les cris de hiboux, les squelettes frottés de phosphore, ou les spectres entortillés dans des draps de lit et traînant avec fracas des chaînes rouillées.
– Décidément, ce Palmers a plus de goût que je ne l’aurais cru, se dit lord Burydan. À présent, je me demande comment cela va finir.
Il s’enfonça dans une allée bordée de myrtes et de rosiers qui répandaient une odeur délicieuse. Des vers luisants rampaient dans les gazons, et des mouches à feu voletaient de fleur en fleur, comme de petites âmes en peine.
Petit à petit, il oubliait le lieu où il se trouvait et il continuait à marcher, plongé dans une profonde rêverie. Tout à coup, il tressaillit. Il avait cru entendre, tout près de lui, comme un gémissement à demi étouffé.
Il leva les yeux. Il se trouvait à quelque distance d’une chapelle au toit pointu, dont il n’était séparé que par un massif de buis sombre et d’acanthes aux larges feuilles. Au moment même où il la regardait, l’intérieur de la chapelle s’éclaira d’une lueur bleuâtre. La porte de fer roula sans bruit sur ses gonds. Une femme en deuil s’avança lentement dans l’allée. Elle tenait à la main un gros bouquet de scabieuses.
Haletant d’émoi, en dépit de son parti pris d’incrédulité, le lord excentrique demeura immobile, le cœur palpitant. Il contemplait de tous ses yeux l’apparition. Elle passa à quelques pas de lui, sans faire mine de le voir et sans plus de bruit qu’un véritable fantôme.
Il n’avait pu jusqu’alors distinguer ses traits. Mais, à un moment donné, elle atteignit un espace vide fortement éclairé par la réverbération de la lune et elle tourna lentement la tête.
Lord Burydan jeta un cri terrible. Celle qu’il voyait ne pouvait être une figurante. C’était bien cette dame aux scabieuses qu’il avait retirée de dessous les décombres fumants ! C’étaient bien ses traits, d’un dessin si pur et si gracieux !… Et, pourtant, il l’avait vue couchée parmi les morts, il avait effleuré de ses lèvres son front déjà glacé !
Il demeurait à la même place, cloué par la plus violente émotion peut-être qu’il eût jamais ressentie de son existence, pourtant si passionnément mouvementée.
Au cri retentissant de suprême angoisse qu’il avait jeté, l’apparition avait tourné vers le nocturne visiteur son pâle visage. Leurs yeux se rencontrèrent.
– Lui ! s’écria-t-elle, c’est lui !…
Elle se précipita en avant, comme pour se jeter dans ses bras.
Lord Burydan courut à l’autre extrémité de l’allée qui contournait le massif d’arbustes, afin d’aller à sa rencontre. Dans ce mouvement, il la perdit de vue un instant, derrière l’épais feuillage des buis. Quand il fut arrivé à la place qu’elle avait occupée l’instant d’auparavant, il ne la trouva plus. Elle avait disparu !
Elle semblait s’être fondue, comme une vapeur légère, dans la brume azurée qui enveloppait tout ce décor de prodiges et d’enchantements.
Vainement, il erra par les allées du luxueux cimetière ; vainement, il battit en tous sens les taillis et les bosquets. La dame aux scabieuses, qui n’était peut-être qu’un fantôme, s’était évanouie comme un fantôme.
Lord Burydan ne retrouva d’elle qu’une des sombres scabieuses échappée de son bouquet. Il la ramassa pieusement.
Complètement désemparé, il se retrouva sans savoir comment à la grille de l’étrange cimetière et se laissa reconduire, comme un enfant, jusque dans la rue par le silencieux serviteur à la souquenille violette.
CHAPITRE III
La dame aux scabieuses
Lord Burydan, chancelant comme un homme ivre et en proie à des alternances de fièvre et d’abattement, regagna à grand-peine l’hôtel où il était descendu. Là, il dut s’aliter, malade d’un commencement de neurasthénie causée par la violence des émotions qu’il avait ressenties.
Agénor, accouru aussitôt de Syracuse, s’installa à son chevet et le soigna avec son dévouement habituel. Au bout de huit jours, lord Burydan, quoique encore très faible, pouvait se lever et reprendre ses occupations.
Son premier soin fut de se rendre à l’Institut spiritualiste. Le premier mot de Mr. Palmers fut pour demander à son client s’il avait été satisfait.
– Très satisfait, répondit le jeune lord avec agitation, c’est à peine si je suis remis de la secousse que j’ai éprouvée.
– En ce cas, vous savez ce qui est convenu. C’est cinq cents dollars que vous me redevez.
– Les voici. Et vous en gagnerez beaucoup d’autres si vous pouvez me faire voir, une autre fois, la personne que je pleure…
– À mon vif regret, ce que vous me demandez là est impossible. Le prodige qui s’est opéré une fois en votre faveur ne peut se renouveler.
– Parlons sérieusement ! s’écria l’excentrique en haussant les épaules avec colère. Il ne faut pas essayer de m’en imposer, à moi ! J’ai la certitude que l’apparition que j’ai vue est une habile figurante qui possède une grande ressemblance physique avec la personne dont je déplore la perte !
– Vous pourriez vous tromper, répliqua gravement Mr. Palmers. Vous avez vu celle que vous désiriez voir. N’essayez pas d’aller au fond des choses.
– Parlons net. Je vous offre dix mille dollars si vous me faites voir de nouveau la dame aux scabieuses. Que ce soit un spectre ou une figurante, peu m’importe !
L’ex-directeur du Lunatic-Asylum, qui, malgré ses rapports avec les esprits infernaux, n’était pas encore parvenu à se guérir de sa passion pour les courses, où il mangeait le plus clair de ses bénéfices, parut vivement alléché par l’offre de son riche client.
– Diable ! murmura-t-il avec embarras, c’est que, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, je ne peux pas renouveler deux fois le prodige !… Cependant, je vais essayer. Je vous écrirai un mot d’ici quelques jours.
– Tâchez que ce soit le plus tôt possible !
Lord Burydan se retira, bouillant d’impatience à la pensée que Mr. Palmers s’était fait tirer l’oreille simplement pour se faire payer plus cher. Toutefois, plusieurs jours s’écoulèrent sans que le directeur de l’Institut spiritualiste donnât de ses nouvelles.
Cependant, l’acte de décès de William Dorgan avait été dressé et sa succession ouverte suivant toutes les formes légales. L’ingénieur Harry Dorgan s’aperçut alors que tous les traités signés à propos du trust des maïs et coton qu’avait dirigé son père, et dont la moitié eût dû lui revenir ; étaient rédigés de telle façon qu’il en était à peu près exclu ; Cornélius, Fritz et Joë avaient fait usage de prête-noms, créé des parts fictives, et s’étaient arrangés, en un mot, de façon à ne laisser à l’ingénieur qu’un nombre de parts dérisoire.
De plus, de nombreux procès étaient engagés ; puis les affaires avaient été si habilement embrouillées qu’il paraissait évident que le trust, dont Joë s’était fait nommer directeur provisoire, ne pourrait être liquidé avant de longs mois.
Dans sa retraite, William Dorgan, toujours bien portant, n’eût été la mutité dont il était atteint, suivait passionnément toutes les péripéties de la lutte juridique qui s’était engagée entre les deux frères et il était mis au courant de la procédure.
C’est à l’occasion de ces procès qu’Harry Dorgan pria lord Burydan d’aller, de sa part, demander à Cornélius Kramm le double de certaines pièces qui n’avaient pas été versées au procès.
L’excentrique accepta de se charger de cette mission, non seulement pour rendre service à son ami, mais parce qu’il était, en outre, assez désireux de voir le docteur, Cornélius sur son terrain, c’est-à-dire dans le laboratoire où il se livrait à ses audacieuses expériences de greffe humaine.
Le docteur, bien qu’il n’ignorât pas la part prise par lord Burydan dans le siège de l’île des pendus, l’accueillit avec la plus grande cordialité. Il lui expliqua si habilement le procès qui divisait les deux frères que lord Burydan en vint à se demander si ce n’était pas l’ingénieur Harry qui était dans son tort.
Tout en conversant avec son visiteur, Cornélius lui fit visiter la plupart des pièces du magnifique hôtel qu’il habitait. Le seul endroit où il ne le conduisit pas fut précisément le laboratoire où il accomplissait ses expériences les plus intéressantes et où, d’ailleurs, il n’admettait jamais personne.
Lord Burydan et le docteur se promenaient familièrement dans le beau parc qui entourait l’hôtel lorsqu’un vieil Italien nommé Léonello, depuis des années au service du sculpteur de chair humaine, vint dire à ce dernier que quelqu’un le demandait.
– Attendez-moi là un instant, dit Cornélius. Je n’ai qu’un mot à dire à la personne qui veut me parler. Je serai tout de suite de retour.
Lord Burydan accepta et continua à se promener solitairement par les allées, tout en réfléchissant à l’homme étrange, énigmatique et presque génial chez lequel il se trouvait.
Quelques minutes s’écoulèrent. Lord Burydan était arrivé à cette partie des jardins qui se trouvait située tout à fait derrière l’hôtel lorsqu’il aperçut, sur le rebord d’une fenêtre du premier étage, un gros bouquet de scabieuses placé dans un vase plein d’eau, comme si on eût tenu à le garder le plus longtemps possible.
– C’est véritablement une obsession ! murmura le jeune homme. Ces fleurs me poursuivront donc partout !…
Il regardait encore le bouquet quand une silhouette féminine apparut dans le fond de la chambre, puis se rapprocha de la fenêtre.
Avec une indicible stupeur, lord Burydan reconnut l’inquiétante dame aux scabieuses, la victime du pont de l’Estacade, l’apparition du cimetière de Mr. Palmers.
Cette fois, il crut que sa raison l’abandonnait, il se demanda s’il n’était pas l’objet d’une hallucination. Il regarda du côté de l’apparition, persuadé qu’elle allait s’évanouir ou se dissiper dans les airs comme une fumée.
Il n’en fut rien. Il faisait, ce jour-là, un temps parfaitement clair, et il était à peine deux heures de l’après-midi. Lord Burydan put se convaincre que, bien que très pâle, celle qui se présentait à sa vue était bien une créature de chair et de sang, et non un vain fantôme.
La victime de la catastrophe était-elle ressuscitée ? Se trouvait-il en face de son sosie ? Il ne voulut pas essayer de traiter la question.
À son tour, la jeune femme l’avait aperçu ; et elle semblait aussi effrayée et, surtout, aussi surprise que lui. Néanmoins, sa physionomie se rassérénait par degrés ; comme si elle prenait une brusque résolution, elle se pencha sur l’appui de la fenêtre.
Lord Burydan se rapprocha. Il allait donc avoir la clé de ce mystère. Malheureusement, presque au même instant, il vit de loin le docteur Cornélius qui venait le rejoindre.
Le jeune homme n’eut que le temps de mettre un doigt à ses lèvres pour faire comprendre à la dame aux scabieuses que le moment était peu favorable à une explication. Elle s’en rendit si bien compte, ayant aussi de loin aperçu Cornélius, qu’elle referma sa fenêtre avec hâte.
Lord Burydan demeura encore une heure dans l’hôtel. Il n’écoutait plus que d’une oreille distraite les raisonnements captieux du sculpteur de chair humaine. Quand il prit congé de ce dernier, il n’avait en tête qu’une seule et unique préoccupation : entrer à tout prix en relation avec la mystérieuse inconnue.
Il regagna son hôtel, absorbé par cette unique pensée et se jurant bien de ne pas quitter New York sans avoir eu la solution de cette énigme.
Par une coïncidence assez curieuse, mais qui, en réalité, n’avait rien que de très naturel, il trouva, en rentrant, une lettre de Mr. Palmers lui annonçant que, à son vif regret, il ne pouvait le faire assister à une seconde séance d’apparitions surnaturelles.
– Ce Palmers, songea-t-il, est certainement en relation avec Cornélius. Il espère, sans doute, m’extorquer la forte somme en me faisant croire à des difficultés imaginaires. Il se trompe grossièrement ; maintenant que je sais où est mon inconnue, je n’ai plus besoin de lui.
Lord Burydan eut la malice de répondre à Mr. Palmers une lettre ironique, où il lui disait de ne pas déranger inutilement les esprits qu’il avait à son service, attendu que lui-même s’était fait une raison et se trouvait maintenant tout à fait consolé.
Lord Burydan avait déjà élaboré tout un projet.
Après son dîner, il sortit en compagnie de Kloum, le fidèle Peau-Rouge, avec lequel il avait eu auparavant un long entretien.
*
* *
Ce soir-là, la dame aux scabieuses lisait près de sa fenêtre grande ouverte, s’arrêtant de temps à autre pour regarder les beaux arbres du parc. Vraiment, son pâle visage, éclairé par un rayon de lune, semblait bien appartenir à un être surnaturel.
Tout à coup, quelque chose passa au-dessus de sa tête avec un sifflement léger qui ressemblait à un frôlement d’ailes. Il y eut ensuite, contre la cloison, le bruit sec d’un choc.
Elle se retourna plus surprise qu’effrayée. Une courte flèche venait de se ficher dans le bois, où elle s’était profondément enfoncée.
Le premier mouvement de la jeune femme fut de refermer la fenêtre. Mais, regardant la flèche de plus près, elle s’aperçut qu’elle était lestée d’un petit papier roulé, attaché avec une faveur violette.
Elle s’en empara, mais, avant de le déplier, elle retourna à la fenêtre, et son regard inquiet embrassa d’un coup d’œil rapide le décor lunaire du parc.
En face d’elle, au-dessus d’un haut mur couronné de lierre, elle distingua le visage du jeune homme entrevu l’après-midi. À côté de lui, un autre personnage, au teint rougeâtre, à demi hissé sur le mur, tenait encore l’arc dont il venait de faire usage.
Certains que leur message était arrivé à destination, les deux inconnus disparurent. La jeune femme referma sa fenêtre et, d’une main un peu tremblante, elle ouvrit le billet et lut ces quelques lignes tracées à l’encre violette, d’une hautaine et, mâle écriture.
« Madame,
« Que vous soyez, comme je l’ai cru longtemps et comme je le crois encore à certains moments, un être immatériel, ou que vous ne soyez, comme cela est plus vraisemblable, qu’une victime du sculpteur de chair humaine, je vous suis entièrement dévoué. Ma vie, mon cœur et ma fortune vous appartiennent.
« Si vous êtes, comme j’ai tout lieu de le craindre, retenue ici contre votre gré, demain, à la même heure qu’aujourd’hui, la petite porte du parc vous sera ouverte, et je serai à vos ordres pour vous conduire où vous voudrez. J’ai déjà pu savoir qu’on vous permet, chaque soir, une promenade dans le parc de neuf à dix heures, sous la surveillance de ce vieux coquin qui est au service du docteur.
« Ne vous préoccupez pas de lui, car j’ai pris les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse s’opposer à votre évasion.
« Croyez, madame, que c’est sous l’impulsion d’un sentiment profondément pur et désintéressé que celui qui signe cette lettre se permet d’intervenir dans votre existence et vous demande la permission de se dire votre très humble serviteur et ami.
« Lord ASTOR BURYDAN. »
La jeune femme, après avoir relu deux fois ce billet, non sans une profonde émotion, eut la prudence de le brûler pour qu’il ne pût tomber entre les mains de ses geôliers. Puis elle se coucha, et, sa lampe une fois éteinte, essaya de s’endormir ; mais ses préoccupations la tinrent éveillée, et l’aube était près de paraître lorsque le sommeil vint enfin la visiter.
La journée du lendemain lui parut d’une interminable longueur. Chaque fois qu’elle entendait un bruit de pas dans le parc, elle se précipitait vers sa fenêtre pour voir si elle n’allait pas de nouveau se trouver en présence de ce lord si beau et si brave qui paraissait avoir pour elle une si noble affection. Elle attendit avec impatience ce moment de la soirée où on lui permettait de prendre le frais dans le parc.
À neuf heures précises, comme chaque soir, le vieux Léonello, homme de confiance et préparateur du docteur Cornélius, vint chercher la jeune femme, la conduisit dans le parc, et, silencieusement, comme il le faisait toujours, se mit à marcher à ses côtés sous les grands arbres.
La captive était profondément émue. Son cœur battait à coups précipités. La gorge serrée par l’anxiété, elle prêtait l’oreille aux moindres bruits, attentive à l’instant propice où la petite porte allait brusquement s’ouvrir pour livrer passage à son sauveur. Seul le bruissement mélancolique du vent gémissait dans les feuilles et, au loin, les rumeurs lointaines de la mer et de la ville interrompaient seules le silence.
Dans l’énervement où elle se trouvait, elle ne put s’empêcher d’adresser la parole à Léonello. Elle avait un besoin maladif de parler, de marcher, de s’agiter.
– Quand donc pourrai-je sortir d’ici ? murmura-t-elle.
– Je ne puis vous donner, à cet égard, aucun renseignement, répondit l’Italien avec une ironie glaciale.
– Mais, enfin, s’écria-t-elle, on n’a pas le droit de me retenir ainsi !
– Soyez sûre que ceux qui s’arrogent ce droit le font dans votre intérêt. Vous êtes ici chez un savant médecin. Il s’est aperçu que vous aviez besoin de soins, que vous étiez malade, et il ne vous laissera partir que lorsque vous serez complètement guérie.
À ce moment, dix heures sonnèrent à l’horloge d’un temple voisin.
La jeune femme ne vivait plus. Elle était frémissante d’angoisse.
– Eh bien, je m’échapperai ! répliqua-t-elle brusquement à Léonello.
L’Italien eut un petit rire qui sonna faux.
– Eh ! eh ! fit-il, c’est que l’on ne sort pas d’ici aussi facilement que cela !… Et quelquefois…
Il n’acheva pas sa phrase.
– Et quelquefois ? demanda la jeune femme avec insistance.
– Eh bien, madame ! puisque vous y tenez, je vais vous le dire… Quelquefois l’on n’en sort jamais !…
Tous deux étaient retombés dans le silence. La prisonnière ne respirait qu’avec peine ; elle sentait peser sur elle une oppressante atmosphère de terreur et de cauchemar. Elle crut qu’elle allait défaillir.
Tout à coup, il lui sembla entendre, dans un buisson voisin, un bruit imperceptible. Elle poussa un profond soupir et se reprit à espérer.
Léonello, depuis quelques instants, l’observait du coin de l’œil, en proie à de vagues soupçons.
– Il est temps de rentrer ! déclara-t-il. Il y a une heure que nous nous promenons. Vous pourriez attraper froid.
– C’est que, balbutia-t-elle, j’aurais voulu me promener encore quelques instants…
– Non, répéta-t-il brutalement, c’est suffisant comme cela ! Rentrons !
Il fit le geste de saisir la jeune femme par le bras. Avant que sa main eût pu effleurer l’étoffe noire de la robe de deuil, un Indien – le même qui, la veille, avait lancé la flèche – bondit de derrière un massif et saisit Léonello à la gorge.
L’attaque avait été si prompte et si inattendue que l’Italien n’eut pas le temps de jeter un cri. En un clin d’œil, le Peau-Rouge le renversait, garrotté et bâillonné.
Presque au même instant, la petite porte du parc s’ouvrait sans bruit, et lord Burydan entrait à son tour. Saluant respectueusement la captive :
– Venez, madame ! dit-il simplement. Je vous remercie d’avoir cru en moi.
Tellement émue qu’elle n’eut pas la force de prononcer une parole, elle accepta le bras que lord Burydan lui offrait et tous deux sortirent.
Kloum, resté le dernier, referma la porte avec la double clé dont il était muni.
Quelques minutes plus tard, une auto les emportait tous trois et ne s’arrêtait qu’à la porte du Preston-Hotel, où lord Burydan était descendu, et qui, on le sait, avait eu son heure de célébrité au moment où la ville de New York était terrorisée par les exploits des Chevaliers du Chloroforme.
Sur la terrasse, que décoraient des orangers et des lauriers en caisses, lord Burydan avait à tout événement fait servir pour dix heures et demie une délicate collation ; de vieux vins étincelaient dans des flacons de cristal à la lueur des lampes électriques, discrètement voilées d’abat-jour de soie, et les mets que les stewards se hâtaient d’apporter exhalaient un appétissant arôme dans les plats d’argent qui les contenaient.
Sur un geste de lord Burydan, les domestiques de l’hôtel se retirèrent. Il ne resta que Kloum, qui était plutôt un ami qu’un serviteur et en présence duquel on pouvait parler sans contrainte.
– Je crois, madame, murmura le jeune lord d’une voix vibrante de passion contenue, que nous serons admirablement ici.
Et, d’un large geste, il montrait la mer lointaine où allaient et venaient les fanaux des navires, la géante statue de bronze de la Liberté qui domine la rade, et l’énorme panorama de la ville coupée de ténèbres épaisses et de lumière crue.
La jeune femme jeta un coup d’œil extasié vers le grandiose horizon qui se déployait à ses yeux, et, silencieusement, elle tendit la main à lord Burydan dans un adorable geste de gratitude.
– J’espère, dit-il, que vous accepterez quelques rafraîchissements ?
– J’avoue que ce sera avec plaisir. J’étais tellement émue, ce soir, que je n’ai pu prendre que quelques cuillerées de bouillon, et, à vrai dire, depuis la terrible catastrophe du pont de l’Estacade, je n’ai pas eu un seul jour de tranquillité. J’ai passé par de terribles épreuves… Mais il faut que vous connaissiez toute la vérité.
– Je n’aurais pas osé vous demander de confidences. Pourtant, je vous avoue franchement que ma curiosité était vivement excitée… Nous nous sommes connus de façon si extraordinaire !
– Je n’ai absolument rien à vous cacher… J’ai éprouvé de terribles malheurs, c’est vrai ; mais je n’ai aucun reproche à m’adresser.
Lord Burydan regardait la jeune fille, comme en extase. Le son même de sa voix était pour lui la plus délicieuse des musiques.
– Dire, murmura-t-il, que je ne connais même pas encore votre nom !
– Je m’appelle Ellénor, et je suis la fille de ce lord Beresward qui, ayant abandonné l’Angleterre il y a une dizaine d’années, vint chercher fortune sur le Nouveau Continent. Il est mort il y a quarante ans[3], ne laissant à ma mère que de modestes revenus. Ce ne fut qu’à force de privations que lady Beresward réussit à mener à bien mon éducation et celle de ma sœur Clara. Comme vous le voyez, mes malheurs sont jusqu’ici de l’espèce la plus banale.
– Soyez persuadée, miss Ellénor, que je vous écoute avec l’attention la plus recueillie. Rien de ce qui vous touche ne peut m’être indifférent.
– Nous avions trouvé, ma sœur et moi, à New York, un modeste emploi de comptables dans les bureaux du milliardaire William Dorgan, lorsque ma mère, qui avait continué à habiter la ville de Rochester, mourut subitement. Notre douleur fut immense. Notre mère était la seule parente, la seule amie, que nous eussions. Elle s’était dévouée pour nous pendant toute son existence, et nous n’avions jamais eu pour elle le moindre secret.
– Vous étiez, sans doute, allées à Rochester pour assister aux obsèques de votre mère et pour vous occuper de liquider sa succession ?
– Vous avez deviné juste. Sitôt que la terrible nouvelle nous fut connue, nous partîmes en hâte, Clara et moi, après avoir demandé un congé de quelques jours à notre administration. C’est en revenant de ce funèbre voyage que nous fûmes victimes de la catastrophe.
La voix de la jeune fille tremblait, et elle ne put retenir ses larmes. Lord Burydan commençait à entrevoir quelques lueurs dans ce qui jusqu’alors lui avait paru complètement inexplicable. Après avoir donné à miss Ellénor le temps de se remettre, il lui demanda :
– Pardonnez-moi de réveiller vos chagrins, mais miss Clara a sans doute péri dans l’accident ?
– Hélas ! il n’est que trop vrai, et jusqu’à aujourd’hui je regrettais amèrement de n’avoir pas partagé le sort de ma sœur…
– Pourquoi jusqu’à aujourd’hui ?
Ellénor baissa la tête en rougissant, toute honteuse de l’aveu qui venait de lui échapper. Lord Burydan comprit, avec un frémissement de bonheur, que d’ores et déjà le cœur de l’orpheline lui était tout acquis.
À présent, il s’expliquait parfaitement la méprise dont il avait été victime. C’était bien Ellénor qu’il avait arrachée de dessous les décombres, mais c’était Clara qu’il avait aperçue couchée parmi les morts. La ressemblance des deux sœurs, leurs costumes de deuil exactement pareils, enfin le bouquet de scabieuses avaient achevé de lui faire illusion.
Ellénor avait eu plus de peur que de mal. Elle n’avait même pas entièrement perdu connaissance, puisque les traits de celui qui l’avait sauvée étaient demeurés profondément gravés dans son souvenir. Elle raconta comment les médecins – au nombre desquels se trouvait Cornélius – ne lui ayant découvert aucune blessure sérieuse, elle avait été, dès le commencement de la nuit, conduite à Rochester et installée dans un hôtel aux frais de la Compagnie du chemin de fer. Elle y demeura plusieurs jours pour veiller en personne aux obsèques de sa sœur.
Une autre cause l’y retint encore, bien après la cérémonie funèbre. Sa sœur Clara retenait dans un portefeuille les quelques bank-notes qui constituaient désormais tout l’avoir des orphelines. Malgré toutes les recherches, ce portefeuille ne put être retrouvé. L’enquête permit d’établir que beaucoup de morts et de blessés avaient été dévalisés par des misérables qui s’étaient joints aux sauveteurs et étaient accourus de tous les points de la région sur le théâtre du sinistre, comme des vautours qui ont flairé de loin l’odeur d’un champ de bataille.
– Un malheur ne vient jamais seul, continua-t-elle. En arrivant à New York, j’appris que j’avais perdu ma place. William Dorgan ayant péri lui-même dans la catastrophe, le personnel de ses bureaux avait été réduit au strict nécessaire, et on avait profité de ce que j’avais prolongé mon absence sans permission pour me congédier brutalement.
« J’étais sans ressources. Je me rendis aux bureaux de la Compagnie du chemin de fer pour demander une indemnité. On me répondit cyniquement que, si je croyais avoir droit à quelque chose, je n’avais qu’à faire un procès, la compagnie ayant pour habitude de ne payer ces sortes d’indemnités que contrainte par un jugement.
« Je sortis de là les larmes aux yeux. Il me restait à peine quelques pièces de monnaie. Je voyais approcher le moment où je n’aurais plus comme ressource, pour trouver un abri, que d’aller sonner à la porte de quelque asile charitable.
« Pourtant, je me raidis contre la faiblesse et le découragement. Dans un bar, où j’étais entrée boire une tasse de lait en mangeant un morceau de pain, je consultai les offres d’emploi qui couvraient entièrement les septième et huitième pages d’un grand quotidien. Je ne trouvai rien qui pût me convenir. Je passai l’après-midi à courir de porte en porte, en faisant des offres de service. Partout les places étaient prises. Je regagnai mon hôtel, brisée de fatigue. La gérante, par bonheur, consentit encore à me faire crédit du prix de ma chambre pour cette nuit-là, mais en m’annonçant que, si, le lendemain à midi, je n’avais pas payé, je serais impitoyablement jetée dehors et, en même temps, elle me remit une lettre qui était arrivée à mon adresse.
« Je fus très surprise, en la lisant, de voir que l’honorable Ezéchias Palmers me priait de passer à son bureau et m’offrait une position des plus avantageuses.
– C’était, sans doute, dit lord Burydan, quelques jours après la visite au cours de laquelle je lui avais montré la photographie de miss Clara.
Il raconta lui-même d’un trait dans quelles circonstances il avait été mené à s’adresser au directeur de l’Institut spiritualiste.
– Je comprends tout, maintenant, murmura la jeune fille. Mais je continue mon récit. Mr. Palmers m’accueillit avec bonté. Il prit tout de suite beaucoup d’empire sur moi. Il n’exigeait de moi d’autre travail que quelques lectures à haute voix ou quelques copies de manuscrits peu fatigantes. Je me crus sauvée.
« Ici, il faut que je vous avoue que, soit par éducation, soit par tempérament, je suis très superstitieuse. La mort de ma mère et celle de ma sœur avaient encore accentué chez moi cette tendance au mysticisme.
– Cette tendance a du bon.
– Sans doute, mais pas quand elle est exploitée par un effronté charlatan de l’espèce de cet Ezéchias Palmers. Il me fit assister à toutes sortes de scènes fantastiques et eut l’art de me persuader qu’il avait le pouvoir de me mettre en présence de ma sœur, la pauvre Clara. J’eus la naïveté de le croire.
– Quel infâme coquin ! Je me fais une véritable fête d’aller lui casser les reins et de démolir son attirail de sorcier. Nous avons d’ailleurs un vieux compte à régler ensemble !… Je n’ai pas oublié qu’au Lunatic-Asylum il a failli me laisser mourir d’inanition.
– Un soir, reprit miss Ellénor, il m’ordonna de prendre un bouquet de scabieuses, ces fleurs possédant, à ce qu’il assura, de puissantes vertus évocatoires. Il me conduisit lui-même dans le jardin de l’établissement, qu’il a disposé de façon à ressembler – la nuit surtout – à un luxueux cimetière.
« Il me mena jusqu’à un caveau, dans lequel il me laissa en me recommandant de ne m’étonner de rien de ce que je verrais et de suivre lentement l’allée qui se trouvait en bordure de la chapelle. « Vous serez tout à coup entourée d’une douce lueur bleue, me dit-il. Ce sera le moment de sortir de votre retraite et de vous avancer à la rencontre de votre sœur qui apparaîtra à l’autre extrémité de l’allée. Surtout, ne prononcez pas un mot, quand même vous apercevriez quelque spectacle extraordinaire ! Parler, c’est vous exposer à un grave péril et empêcher l’apparition de se produire. » Il me laissa seule dans les ténèbres, très impressionnée, dans l’attente de l’apparition. Quelques minutes s’écoulèrent et, bientôt, comme on me l’avait annoncé, je fus entourée d’une douce lueur bleue.
– Due, sans nul doute, à la lumière électrique !
– C’est probable !… Fidèle aux ordres que j’avais reçus, je poussai la porte de bronze du monument, dont les gonds usés ne firent pas entendre le moindre grincement, et je m’avançai dans l’allée, me recueillant de toutes les forces de mon âme pour me rendre favorables les puissances surnaturelles… J’avais à peine fait quelques pas, lorsque j’entendis un léger bruit dans une allée latérale. Machinalement, je tournai à demi la tête de ce côté…
– C’est alors que je poussai le cri que vous avez entendu !
– Cri auquel je répondis par une exclamation de surprise, car je venais de reconnaître, dans le promeneur nocturne du cimetière, l’homme généreux qui m’avait arrachée à la mort. Mais comme, pour vous rejoindre, je passais derrière un massif qui me cachait à vos regards pour quelques instants, deux hommes, dont l’un était Palmers lui-même, se jetèrent sur moi et me poussèrent brutalement dans un caveau aboutissant à une sorte de cachot souterrain.
« Là, Palmers m’accabla de reproches et d’injures, oubliant dans la fureur où il se trouvait toutes les simagrées grâce auxquelles il avait réussi à me persuader.
« – Sotte fille ! s’écriait-il en me serrant brutalement les poignets, nous avions sous la main un imbécile qui vous prenait pour un esprit et qui eût donné autant de bank-notes qu’on aurait voulu, et vous faites tout manquer par votre maladresse ! Croyez-vous, ajouta-t-il avec une dureté qui me révolta, que j’aie le moyen de vous nourrir à ne rien faire ? Il faut désormais m’obéir, ou nous verrons !
« – Mais, balbutiai-je en pleurant, vous m’aviez promis de me faire voir ma sœur !
« – Il faut, me répondit-il, pour avoir cru une bourde pareille, que vous soyez aussi naïve que le gentleman qui est en train de faire les cent pas là-haut dans le jardin en s’imaginant qu’il va voir des apparitions !…
« J’étais, cette fois, désillusionnée sur le compte de ce misérable. Désormais, je n’eus plus qu’un objectif : m’enfuir de ce repaire où l’on exploitait la chose la plus sacrée qui soit au monde – le souvenir des morts qui nous furent chers !
– Ah ! que n’ai-je connu plus tôt votre lamentable histoire ! murmura lord Burydan. Mais, soyez tranquille, Mr. Palmers ne perdra rien pour attendre. Je veux le régaler d’une petite séance de boxe dont il se souviendra longtemps.
– C’est plutôt un escroc qu’un méchant homme. Voyant que je n’étais bonne à rien, il allait sans doute consentir à me laisser partir, quand il reçut la visite du docteur Cornélius. Que fut-il convenu entre eux ? Je ne sais. Mais le docteur, que j’avais déjà eu l’occasion de voir le jour de la catastrophe et dont je connaissais l’immense réputation, me prit à part et m’offrit chez lui un emploi dont il assura que je serais pleinement satisfaite.
« J’acceptai. J’aurais accepté n’importe quoi plutôt que de rester dans cet Institut soi-disant spiritualiste, où j’étais, chaque jour, témoin des escroqueries les plus effrontées. Puis j’étais quelque peu rassurée par la renommée de science de mon nouveau maître.
– Naturellement, interrompit lord Burydan, bouillant d’impatience et de colère, Cornélius n’a pas mieux agi avec vous que Palmers ?
– Je mentirais en disant que j’ai eu à souffrir de quelque injure ou de quelque brutalité. Seulement, j’étais prisonnière. Il m’était interdit de sortir, et, de plus, chaque jour, Léonello me forçait d’absorber, d’après l’ordre du docteur, plusieurs cuillerées d’une potion qui devait, affirmait-il, rétablir ma santé…
– Ce médicament vous faisait réellement du bien ?
– Tout au contraire. Chaque fois que j’en avais pris, j’étais sujette à des vertiges, et je devenais de jour en jour plus pâle…
– Parbleu ! le sculpteur de chair humaine expérimentait sur vous quelque diabolique mixture de son invention. Mais, patience, j’éluciderai tout cela. Si certaines de mes suppositions se confirment, Cornélius aura de terribles comptes à rendre !
Cette conversation fut interrompue par l’arrivée d’un domestique qui apportait un bouquet de scabieuses. Miss Ellénor le prit, en remerciant lord Burydan d’un regard attendri.
– Je me suis aperçu, dit-il, que vous aimiez ces fleurs. N’est-ce pas grâce à elles que j’ai pu découvrir votre retraite et vous délivrer ? Quand je ne connaissais pas encore votre nom, je vous appelais la « dame aux scabieuses ».
– C’est vrai que je raffole de ces fleurs violettes, auxquelles on a attaché, je ne sais pourquoi, des idées de deuil. Je suis persuadée que les scabieuses me portent bonheur. Ne vous ai-je pas dit que j’étais superstitieuse ?
– Sans les scabieuses, vous auriez été perdue pour moi !
– D’ailleurs, elles n’ont pas toutes cette mélancolique couleur de demi-deuil. Il y en a des blanches, des roses, des lilas, je les aime toutes également…
Les deux jeunes gens s’entretinrent jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Lord Burydan prit la parole à son tour et tint miss Ellénor sous le charme par le récit de ses aventures prodigieuses. Puis la conversation prit une tournure plus intime et, quand ils se séparèrent, ils avaient échangé la plus douce et la plus solennelle promesse.
CHAPITRE IV
Une ancienne connaissance
L’hacienda de San-Bernardino se trouvait située dans la province de l’Arizona sur les frontières du Mexique. Elle était bâtie au centre d’une vallée verdoyante arrosée par une multitude de petits ruisseaux venus des montagnes voisines, et ses toits de brique rouge se détachaient gaiement sur le feuillage des sycomores et des lauriers qui l’ombrageaient.
C’était une véritable oasis, une retraite délicieuse, que cette ferme perdue en pleine nature, loin des chemins de fer et loin des villes. Les truites pullulaient dans les ruisseaux ; d’innombrables troupeaux paissaient en liberté dans les grasses prairies qui couvraient le flanc des coteaux voisins ; les vergers regorgeaient de fruits de toutes sortes : poires, pommes, raisins, ananas, figues, oranges ; et, dans les jardins, les légumes du Vieux Monde poussaient à côté de ceux des contrées tropicales.
Dans les forêts, le gibier abondait. C’étaient le colin de Californie, le lapin à queue de coton, « cottontail », le lièvre aux longues oreilles, « jackass », la caille, la tourterelle, la perdrix et même le canard, l’oie sauvage, l’antilope. Il est vrai qu’on y rencontrait aussi le chat sauvage, le serpent à sonnettes (rattle-snake) et, parfois, le puma ou lion de Californie, dont il ne reste plus aujourd’hui que quelques rares individus.
Le serpent à sonnettes n’inspire pas dans l’Arizona autant de terreur qu’on pourrait le croire. Si, par hasard, quelque chasseur est mordu, il se contente, pour tout traitement, de boire autant de whisky qu’il peut en supporter ; s’il ne meurt pas de cette absorption, il est sûr de se tirer d’affaire quant au venin de serpent.
L’hacienda de San-Bernardino, située au centre de ce paradis terrestre en miniature, appartenait au milliardaire new-yorkais Fred Jorgell, qui y avait installé, en qualité de gérants, un ancien matelot belge nommé Pierre Gilkin et sa femme Dorypha. Les deux époux, peu de temps auparavant, avaient eu l’occasion de rendre à la famille du milliardaire d’importants services et il les en avait récompensés en leur confiant ce poste, qui constituait pour eux la plus agréable et la plus délicieuse des sinécures.
D’ailleurs, Pierre Gilkin, très actif, très sérieux, donnait toute satisfaction au propriétaire, et les revenus de l’hacienda avaient presque doublé depuis qu’on lui en avait confié la direction. Vive, gaie, sémillante, en vraie Espagnole qu’elle était, la señora Dorypha secondait admirablement son mari.
On racontait bien que Dorypha avait mené, avant son mariage, une existence peu exemplaire, et, parfois, les jours de fête, pendant que les Indiens et les vaqueros au service de l’exploitation s’enivraient de whisky et de pulque, elle exécutait au son de la guitare mexicaine, dont Pierre Gilkin avait appris à jouer, des habaneras si entraînantes, si voluptueuses, qu’on venait de plusieurs lieues pour l’admirer. De l’avis des vieillards, une honnête femme ne doit pas posséder de tels talents, et on en déduisait que la señora avait figuré, en qualité de danseuse, sur quelque théâtre avant de devenir haciendera.
On remarquait aussi qu’aucune femme ne savait aussi bien qu’elle draper sur ses épaules une mantille de soie, ou parer sa chevelure blonde d’un ruban ou d’une simple fleur.
Là s’arrêtaient les racontars. La señora Dorypha menait une conduite exemplaire et, dans ce pays où les passions sont ardentes et les mœurs quelque peu relâchées, elle était considérée comme le modèle des épouses. Nul, parmi les plus médisants, n’avait la plus petite coquetterie à lui reprocher.
Dorypha et son mari étaient parfaitement heureux, et ils ne souhaitaient rien de plus que la continuation de cette paisible et laborieuse existence. Rien n’était plus calme que la vie que l’on menait à l’hacienda de San-Bernardino. Des semaines s’écoulaient sans qu’il s’y produisît d’autre événement que la capture d’un chat sauvage ou le renvoi d’un Indien convaincu de vol ou d’ivrognerie.
Un matin, Gilkin reçut une longue lettre de Fred Jorgell, qui, pourtant, ne lui écrivait à peu près jamais. Le milliardaire annonçait l’arrivée à l’hacienda d’une jeune femme qu’il recommandait à l’haciendero en le priant de la recevoir comme une de ses proches parentes.
Huit jours plus tard, Gilkin allait à la station de Cucomongo, dans son chariot attelé de quatre mules, et il en revenait avec une jeune fille aux yeux et aux cheveux noirs, d’une beauté admirable. Elle se nommait miss Ellénor.
C’est à la demande de lord Burydan lui-même que la dame aux scabieuses avait quitté les États du Nord pour se rendre dans cette partie des États-Unis encore sauvage, dont certains cantons ne sont pas encore défrichés.
L’excentrique était décidé à poursuivre jusqu’au bout la lutte qu’il avait entreprise contre les Lords de la Main Rouge, qu’il s’était juré de découvrir, de démasquer et d’anéantir. Dans une pareille entreprise, il ne fallait pas qu’il fût gêné par la présence d’une personne qu’il chérissait.
Il n’avait pas tardé à s’apercevoir qu’il suffisait d’un sourire d’Ellénor pour avoir raison de ses résolutions les plus farouches. Il savait qu’il avait affaire à des ennemis redoutables qui ne tarderaient pas à découvrir la jeune fille qu’il aimait et à se venger sur elle des échecs que leur aurait infligés lord Burydan. Il tremblait à la seule pensée que miss Ellénor pût devenir la victime des sinistres bandits de la Main Rouge.
Après de longues discussions avec sa fiancée, tous deux convinrent que celle-ci irait attendre, dans une retraite ignorée de tous, que lord Burydan eût mené à bien ses projets. Il ne demandait d’ailleurs, pour en arriver là, que quelques mois, peut-être quelques semaines. Depuis peu de temps, en effet, il avait découvert une foule d’indices qui devaient immanquablement le faire aboutir au succès.
Il s’agissait donc de trouver à la jeune fille un asile sûr et inconnu de tous. Après y avoir longtemps réfléchi, il pensa qu’il ne pouvait trouver mieux que cette verdoyante solitude de l’Arizona, demeurée pour ainsi dire en marge du monde civilisé. Il avait pu apprécier, en outre, le dévouement de Pierre Gilkin ; enfin, il connaissait, pour l’avoir visitée pendant son séjour à San Francisco, cette pittoresque région de la frontière mexicaine qui renferme d’admirables sites et jouit d’un climat exceptionnel.
Quoiqu’il lui en coûtât de se séparer de son fiancé, miss Ellénor consentit donc, sans trop de peine, à aller passer quelque temps à l’hacienda de San-Bernardino.
Fred Jorgell, auquel lord Burydan avait fait part de son projet, lui donna son entière approbation et lui assura que la jeune fille ne pourrait trouver, dans aucune autre partie de l’Amérique, une résidence plus agréable et, en même temps, plus tranquille.
La señora Dorypha fit l’accueil le plus empressé et le plus cordial à la protégée de Fred Jorgell. Elle lui installa, au premier étage de la ferme, une chambre claire et gaie d’où l’on découvrait les jardins étagés en terrasses verdoyantes et fleuries jusqu’au premier contrefort de la Sierra dont les cimes bleuâtres bornaient l’horizon.
Dorypha prit bien vite miss Ellénor en affection. Elle était aux petits soins pour tâcher de la distraire et de lui rendre la vie agréable. Tantôt elle l’emmenait pêcher dans les petits torrents qui descendent de la Sierra, tantôt elles faisaient de longues promenades à cheval. Sortant de la vallée, elles traversaient des plaines désertes semées de cactus, de palmiers sauvages et de « bunchgrass[4] » pour aller rendre visite à quelqu’un des propriétaires mexicains du voisinage, chez lesquels Dorypha, en sa qualité d’Espagnole, était toujours très courtoisement accueillie.
Cette existence de saines fatigues, au milieu de l’air pur des montagnes, eut bientôt une heureuse influence sur la santé de miss Ellénor. La pâleur qui parfois avait inquiété lord Burydan se colora du vif incarnat de la santé. Sa beauté, dans tout son épanouissement, avait pris un caractère de vigueur et de robustesse qui ne lui enlevait pourtant rien de son charme.
Miss Ellénor, sous la direction de Dorypha, devint une amazone intrépide. Elle parcourait quelquefois plusieurs dizaines de miles dans une même journée, montée sur un de ces mustangs, à demi sauvages, qui sont les seuls chevaux que l’on trouve dans le pays.
Deux mois s’écoulèrent ainsi. En dehors de ses promenades et de quelques heures consacrées à la lecture, la jeune fille n’avait d’autre occupation sérieuse que de répondre aux longues lettres débordantes de fougueuse passion et de délicate tendresse que deux fois par semaine lui écrivait lord Burydan. Par cette intime correspondance, malgré la distance qui les séparait, les deux fiancés apprenaient à se connaître un peu mieux chaque jour, unis par une étroite communion d’idées et de sentiment, et leur amour l’un pour l’autre ne faisait que s’accroître.
Dans les premiers temps, lord Burydan avait manifesté son inquiétude au sujet des aventuriers de toutes sortes qui rôdent dans l’Arizona, soit pour y découvrir des mines, soit pour explorer les vallées propices à l’élevage ou à la culture. Miss Ellénor le rassura bientôt en lui expliquant que les habitants de la Sierra de San-Bernardino n’avaient rien à craindre de ces rôdeurs de frontière.
D’abord, l’hacienda se trouvait en dehors des routes généralement suivies par les desperados[5], et les Indiens dont se composait le personnel de l’exploitation étaient nombreux, bien armés. Enfin, Pierre Gilkin, se conformant en cela aux habitudes du pays, offrait à tous ceux qui venaient frapper à sa porte une généreuse hospitalité. Il savait qu’il est extrêmement rare qu’un haciendero qui se montre humain et accueillant soit en butte aux entreprises des bandits.
Il était aimé de tout le monde dans le pays. Plusieurs fois, comme il conduisait des troupeaux à la station de Cucomongo, il fut arrêté par des desperados. Vite reconnu par eux, au lieu de lui voler ses bestiaux ou ses bank-notes, ils se contentèrent de boire un coup d’« aguardiente » dans sa gourde et firent route paisiblement avec lui en suivant, pendant quelques miles, le même sentier montagneux.
Ils savaient fort bien, d’ailleurs, que Pierre Gilkin n’était pas de ces poltrons qui donnent leur portefeuille à la première sommation, et qu’il se fût battu jusqu’à la mort plutôt que de se laisser dépouiller.
Un matin, Pierre Gilkin et Dorypha, montés tous deux à cheval, étaient allés inspecter les troupeaux qui se trouvaient dans les pâturages de la montagne. Miss Ellénor avait refusé de les accompagner. Elle venait de recevoir un paquet de journaux de New York et avait préféré la lecture à la promenade. Installée sous une tonnelle qu’ombrageaient les fleurs odorantes du jasmin de Virginie et du grand chèvrefeuille pourpré, elle se laissait aller à sa rêverie. À l’autre extrémité de la vaste cour, des serviteurs indiens s’occupaient à traire de superbes vaches de race normande, que Fred Jorgell avait fait venir de France à grands frais, et, plus loin, d’autres étaient occupés à battre des épis de maïs, au bruit cadencé des fléaux qui dominait tous les autres bruits de la vallée.
La jeune fille venait de lire avec intérêt le récit d’une fête donnée chez un milliardaire et où, pour comble d’extravagance, on avait, après le repas, avant de commencer à danser, arrosé les pelouses du jardin à l’aide d’arrosoirs en argent remplis de champagne des meilleures marques.
Miss Ellénor leva les yeux distraitement, et elle aperçut, à la barrière extérieure de la cour, un vagabond de l’aspect le plus lamentable.
Sa longue barbe grise et emmêlée était couverte de poussière, et ses traits se dissimulaient sous un sombrero tellement déteint par la pluie et le soleil qu’il était devenu d’une couleur à peu près indéfinissable. Ses vêtements étaient en haillons et, à travers les déchirures, la peau apparaissait, tannée par les intempéries. Les pieds nus dans de mauvais souliers, il boitait lamentablement, s’appuyant, pour marcher, sur un énorme bâton noueux. Enfin, il portait en bandoulière un sac de toile grise, qui, à en juger par son poids, devait être rempli de cailloux.
Ce vagabond était en train de parlementer avec un des vaqueros, lorsque miss Ellénor, poussée par son bon cœur, se hâta d’intervenir.
– Eduardo, dit-elle au serviteur, laissez donc entrer ce pauvre homme, qu’il s’assoie sur le banc de pierre en face de la porte !
– C’est que, señora, répondit le serviteur en se grattant la tête, le maître a bien défendu qu’on laissât entrer personne dans l’hacienda en son absence.
– Bah ! dit la jeune fille, celui-ci n’a pas l’air bien dangereux. D’ailleurs, j’en prends la responsabilité.
Le vagabond avait écouté ce dialogue en silence. Accoudé sur la barrière, il paraissait accablé de fatigue.
– Je vous remercie, señora, balbutia-t-il en voyant que miss Ellénor lui avait obtenu gain de cause.
Il alla, en boitant, s’asseoir sur le banc de pierre, et, sur l’ordre de la jeune fille, Eduardo lui apporta une miche de pain, un morceau de carne seca[6] et une cruche remplie de vin, qui, dans l’Arizona, est en grande abondance et très capiteux.
L’homme, sans dire un mot, se jeta sur ces provisions comme un loup affamé, et, bientôt, il eut achevé de tout engloutir.
Miss Ellénor le contemplait avec une curiosité mêlée d’une profonde pitié.
– Tenez, lui dit-elle en lui mettant un dollar dans la main, voilà pour vous aider à faire votre route. Vous allez loin ?
– Je me rends à Cucomongo, et je reviens de l’autre côté de la Sierra, où j’ai fait une tournée de prospection. Malheureusement, je me suis écorché le talon sur les roches, et j’ai eu bien de la peine à venir jusqu’ici.
– Avez-vous obtenu de bons résultats ?
– Je ne suis pas mécontent. Tenez, ajouta-t-il en tirant de sa besace quelques cailloux où scintillaient des parcelles métalliques, voici des échantillons de minerai que j’ai recueillis. Il y a du cuivre, de l’argent et même un peu d’or.
– Qui sait ? dit miss Ellénor en riant, vous serez peut-être un jour millionnaire. Il vous suffirait, pour cela, de mettre la main sur un filon productif.
– Qui sait ? répéta-t-il d’un ton singulier qui fit tressaillir la jeune fille.
Involontairement, elle le regarda. Mais ses traits étaient cachés par le feutre à larges bords et elle ne put voir l’expression de ses yeux. Il y eut entre eux quelques instants de silence.
– Désirez-vous encore quelque chose ? demanda la jeune fille.
– Oui, señora. S’il faut être franc, il y a bien huit jours que je n’ai bu une goutte de whisky ni fumé une pipe…
Ellénor apporta elle-même une bouteille, un verre et un paquet de tabac de Virginie qu’elle remit au vagabond, qui se confondit en remerciements.
– Si vous voulez attendre le maître de cette hacienda, dit-elle, il ne tardera pas à rentrer. Il peut être ici dans une demi-heure.
Cette proposition n’eut pas l’air d’être du goût de l’homme, qui, sans doute, avait quelque secrète raison d’éviter de se trouver en présence de Pierre Gilkin et de sa femme.
– Je vous remercie, señora, dit-il, mais je vais me remettre en route. Je ne marche pas vite et je ne serai guère arrivé à Cucomongo avant ce soir. Merci bien de vos bontés, je ne les oublierai pas.
Il rechargea sur son dos sa besace de cailloux, souleva poliment son feutre et se retira.
Eduardo le suivit des yeux jusqu’à ce qu’il eût disparu au tournant de la route. Puis il rentra dans la cour en hochant la tête.
– C’est singulier ! murmura-t-il. Voilà un bonhomme qui ne me revient guère ! Je n’aime pas les gens qui ont peur de vous regarder en face. Ce drôle a plutôt la mine d’un tramp que celle d’un honnête prospecteur…
Tant qu’il fut en vue de l’hacienda, le vagabond continua à boiter en marchant. Mais, dès qu’il fut entré dans un chemin creux, bordé de cactus et d’acacias, qui allait rejoindre la grande route de Cucomongo, il redressa sa haute taille et se mit à marcher à grandes enjambées, en homme qui ne ressent pas la moindre fatigue. Un peu plus loin, il vida dans une mare les soi-disant échantillons de minerai dont sa besace était gonflée. Puis il bourra sa pipe de terre du tabac que lui avait donné miss Ellénor et se remit en marche en sifflotant.
Il y avait à peu près une demi-heure qu’il avait quitté l’hacienda lorsqu’il distingua dans le lointain-la silhouette de deux cavaliers qui venaient au-devant de lui. Cette rencontre n’était sans doute pas de son goût, car il entra aussitôt dans un champ de maïs dont les hautes tiges le dérobèrent entièrement aux regards et, de sa cachette, il regarda passer les cavaliers.
C’étaient un homme et une femme, tous deux vêtus à la mode mexicaine, avec le vaste sombrero, l’ample manteau qu’on nomme « zarape » et les bottes armées d’immenses éperons.
– By God ! murmura le vagabond lorsqu’ils eurent disparu, je crois que j’ai bien fait de ne pas rester sur leur route. Mais tout va bien ! Maintenant, je suis fixé, je sais ce que je voulais savoir.
L’homme s’était remis en route. Cette fois, il marchait moins vite, grommelant de temps en temps des paroles inintelligibles, comme absorbé par ses préoccupations.
C’est ainsi qu’il parvint jusqu’à une misérable auberge, dont les murs étaient faits d’argile mêlée de paille hachée, et le toit, de planches vermoulues. Il entra pour se rafraîchir. Une vieille Mexicaine, au nez crochu, au teint de basane, lui apporta, sur sa demande, un verre d’aguardiente et une alcaraza pleine d’eau fraîche.
Il venait d’avaler distraitement une gorgée du breuvage, quand un autre client entra dans l’auberge. C’était un robuste gaillard aux cheveux et à la barbe d’un blond fade. Les cheveux étaient coupés très court, et la barbe, irrégulière et mal taillée, devait avoir plus de quinze jours de date.
Le nouvel arrivant était encore plus sale et plus déguenillé que l’homme à la besace, et un gros revolver faisait bosse dans la poche de sa veste de toile.
Il regarda autour de lui, comme ferait un tigre à jeun entrant dans une bergerie. La vieille Mexicaine ne put s’empêcher de trembler devant l’expression féroce de son regard.
– Que faut-il vous servir, señor ? balbutia-t-elle d’une voix étranglée par la peur.
L’inconnu ne répondit pas. Il venait d’apercevoir le soi-disant prospecteur, et sa physionomie exprimait maintenant une vive surprise, mêlée d’une certaine contrainte.
– Vous ici, master Slugh ? s’écria-t-il.
– Comme vous voyez, master Edward Edmond, répliqua l’autre avec un ricanement. Vous avez donc renoncé à servir les milliardaires… Mais asseyez-vous donc. Vous prendrez bien quelque chose avec moi ? Je suis charmé de vous rencontrer. D’où venez-vous comme cela ?
– Je sors de prison ! répondit piteusement Edward Edmond. Je n’ai plus ni argent ni domicile. Je suis réduit au désespoir !…
– Il ne faut jamais se désespérer, répliqua Slugh avec une gaieté philosophique. Tenez, buvez un coup. Cela vous remettra !
Il versa une large rasade d’aguardiente dans le verre que la Mexicaine, un peu rassurée, venait d’apporter.
Edward Edmond but d’un seul trait.
– Et vous, Slugh ? demanda-t-il tout à coup, vous n’avez pas l’air d’être beaucoup plus riche que moi ?
– Cela dépend. Il y a des jours où je suis riche, d’autres où je suis pauvre. Je m’arrange pour faire une moyenne.
– Alors, vous êtes satisfait ?
– Je n’ai pas trop à me plaindre.
– Mais, demanda encore Edward Edmond avec une certaine hésitation, vous voyagez toujours pour le compte de la Main Rouge ?
– Toujours.
– L’association n’est donc pas exterminée ?
– Elle n’a jamais été si solide.
Edward Edmond eut un rire amer.
– Cela est facile à dire, fit-il, mais l’île des pendus a été occupée, des centaines d’affiliés ont été jetés en prison, lynchés, pendus, électrocutés. Chaque jour, la police prend des mesures plus sévères. Enfin ces fameux Lords, que l’on disait puissants comme des dieux, ne donnent plus signe de vie.
– Vous n’êtes pas très bien informé, master Edward Edmond.
– Je le suis suffisamment pour savoir que je ne me trompe pas.
Il ajouta, les yeux brillants de haine et s’animant petit à petit, à mesure qu’il parlait :
– Je suis content, d’ailleurs, de tout ce qui arrive à la Main Rouge… C’est elle et c’est vous-même, Slugh, qui avez causé ma perte !…
– Hein ? fit le bandit en tressautant.
– Oui. Sans vous, je serais encore chez Fred Jorgell, où j’étais bien payé, bien nourri et où j’avais déjà amassé presque assez d’économies pour retourner en Irlande vivre de mes rentes. Que la Main Rouge soit maudite, elle et tous ceux qui en font partie !
Au lieu de se fâcher de cette violente sortie, Slugh eut un sourire indulgent.
– Vous êtes un enfant, mon cher Edmond, fit-il. Dites donc plutôt… et ce sera l’exacte vérité… que, si vous n’aviez pas eu la sottise de vous amouracher de la Dorypha, vous seriez encore chez votre milliardaire. Qu’a fait la Main Rouge, en somme ? Qu’ai-je fait moi-même ? Je vous ai empêché de vous suicider, je vous ai, pour de très légers services, avancé des sommes considérables. N’accusez pas la Main Rouge, n’accusez que votre sottise et vos vices !
Edward Edmond baissa la tête et demeura silencieux. Il comprenait parfaitement que Slugh avait raison.
– Oui, balbutia-t-il au bout d’un instant, j’ai agi comme un niais. C’est la Dorypha, cette créature de perdition, qui a été cause de ma ruine. La coquine !… je la déteste !… J’aurais un plaisir infini à lui écraser la tête contre un pavé !
« Oui, cette femme, non contente de prendre mon argent, de me trahir de toutes les manières, a encore essayé de m’assassiner !…
– Tiens, au fait ! dit Slugh négligemment, je ne pensais plus à cela. La dernière fois que nous nous sommes vus à bord du yacht la Revanche, dont j’avais l’honneur d’être capitaine, vous veniez de recevoir un vilain coup de couteau. Comment, diable, vous êtes-vous tiré d’affaire ?
– Après la prise de l’île des pendus, j’ai été arrêté comme tous les autres et transporté à Chicago, à bord d’un bâtiment de l’État. Comme, à cause de ma blessure, je me trouvais hors d’état de comparaître devant le tribunal, on m’a donné pour prison une chambre de l’hôpital, où j’étais gardé à vue par deux détectives. Je n’ai passé en jugement que bien longtemps après les autres, et j’ai eu cette chance que ni la Dorypha ni mon ancien maître n’ont été appelés en témoignage. Un avocat, auquel il m’a fallu donner ce qui me restait d’argent, a tiré parti de la situation. On n’a pu établir d’une façon certaine ma culpabilité, et on a fini par me relaxer après plusieurs mois de prévention. On m’a rejeté dans la rue, à peine guéri et sans un sou. Depuis ce temps-là, j’ai erré misérablement.
– Ce n’est pas gai, fit poliment Slugh.
– Dites que c’est lamentable. Mais, vous-même, je vous croyais mort ou en prison ?
– Moi, dit Slugh avec une certaine vanité, on ne m’a même pas arrêté. Quand j’ai vu que les affaires commençaient à se gâter, je me suis esquivé. D’ailleurs, je vous raconterai cela plus tard. Pour le moment, parlons de la Dorypha…
– Si je savais où la trouver…, grommela l’Irlandais en serrant les poings.
– Ah ! c’est une maîtresse femme. Elle a su, comme on dit, tirer son épingle du jeu. Elle et son mari ont été placés par Fred Jorgell à la tête d’une exploitation agricole en pleine prospérité.
– Elle est mariée ?
– Mais vous n’êtes donc décidément au courant de rien ? Elle a épousé Gilkin, ce grand Belge qui excitait mes matelots à la révolte. C’est un couple très uni.
Edward Edmond grinça des dents avec rage.
– Quand même, s’écria-t-il en donnant un furieux coup de poing sur la table, je devrais aller à pied jusqu’à l’autre bout de l’Amérique, je jure que je la retrouverai !…
– Si vous êtes bien sage, dit Slugh que cette conversation amusait fort, je vous apprendrai où elle est. Je puis même vous dire, dès maintenant, que ce n’est pas bien loin d’ici. À telle enseigne que c’est chez la Dorypha que j’ai déjeuné ce matin.
– Que me dites-vous là ?
– L’exacte vérité.
– Je vous en supplie, master Slugh, dites-moi où elle est ?
– Vous êtes trop pressé, mon garçon. Auparavant, nous avons à parler de choses sérieuses. Vous êtes, à ce que je vois, tout à fait à la cote !
Edward Edmond jeta un regard éloquent sur les haillons qui le couvraient.
– Eh bien, reprit Slugh, j’ai peut-être, moi, les moyens de vous venir en aide. Tout à l’heure vous avez calomnié les Lords de la Main Rouge. Vous avez eu tort, et je vous prouverai que la Main Rouge n’abandonne jamais ses amis, pas plus d’ailleurs qu’elle ne laisse en repos ses ennemis. Vous n’avez qu’un mot à dire pour que je vienne à votre secours, au nom des Lords.
– Eh bien, soit ! murmura l’Irlandais d’un air sombre. D’ailleurs, n’est-ce pas la seule ressource qui me reste ! Parlez, je suis prêt à tout !
– J’aime à vous voir dans d’aussi bonnes dispositions. Vous verrez bien vite que vous avez tout avantage à m’écouter.
– Mais, demanda l’Irlandais dont les yeux étincelèrent d’une flamme cupide, serai-je aussi bien payé qu’autrefois ?
– Pourquoi pas ? Cela dépendra, d’ailleurs des services que vous rendrez. Sachez-le, malgré les échecs qu’elle a subis ces derniers temps, la Main Rouge est loin d’avoir épuisé ses ressources.
Slugh avait tiré de dessous ses haillons un solide portefeuille qu’il ouvrit, étalant aux yeux ébahis de l’Irlandais une liasse de bank-notes.
– Vous voyez, fit-il, que les Lords sont loin d’être ruinés.
– Que faut-il faire ? demanda docilement l’Irlandais. Je suis à vous corps et âme.
– D’abord, nous allons aller jusqu’à la station de Cucomongo. Là, je vous achèterai des vêtements convenables. Nous dînerons ensemble, le mieux possible ; puis je vous ferai quelques avances, et vous passerez une bonne nuit dans un lit confortable. Vous paraissez en avoir besoin. Ce n’est que demain ou après-demain peut-être que j’aurai besoin de vous.
– Pour quoi faire ?
– Vous êtes bien curieux !… Mais, bah ! Autant que je vous dise de quoi il s’agit aujourd’hui que plus tard : ce sera pour aller rendre visite à Dorypha.
– Rendre visite, murmura Edward Edmond stupéfait.
– Oh ! mais, entendons-nous. Ce sera une visite d’un genre tout particulier. Elle aura lieu dans le courant de la nuit, et nous serons accompagnés de quelques camarades bien armés.
– Je comprends. Vous voulez tuer la Dorypha… Eh bien ! j’en suis !…
– Ce n’est pas d’elle qu’il s’agit. Tout de même, vous pourrez, par la même occasion, satisfaire votre rancune. Je n’y vois aucun inconvénient. Il y a en ce moment-ci, à l’hacienda de Pierre Gilkin, une jeune miss que les Lords m’ont donné l’ordre d’enlever. Il paraît que c’est la fiancée d’un des plus redoutables ennemis de l’association. Ce sera entre nos mains un précieux otage… Êtes-vous bon cavalier ?
– Je monte à cheval comme un cow-boy. Mais pourquoi cette question ?
– Parce que nous serons tous à cheval, et c’est de cette façon que nous enlèverons la jeune miss. À une dizaine de miles de l’hacienda, une auto nous attendra avec quelques hommes sûrs.
– Pourquoi ne pas faire venir l’auto plus près ?
– On voit bien que vous ne connaissez guère l’Arizona. Dans ce canton-ci, surtout, il n’y a que des sentiers à peine frayés : les chevaux et les chariots à roues massives sont les seuls moyens de locomotion employés.
– Je n’étais jamais venu de ce côté. Enfin, je ferai tout ce que vous me direz, pourvu qu’on me permette de tuer la drôlesse qui a causé mon malheur !
– Accordé ! s’écria Slugh. Et maintenant, en route. Il faut que nous arrivions à Cucomongo avant la nuit. Nous discuterons de nos petites affaires chemin faisant.
Slugh avait jeté sur la table le dollar que lui avait donné miss Ellénor. Il prit la monnaie que lui tendait la Mexicaine et sortit, suivi de l’Irlandais dont la face était rayonnante de joie.
CHAPITRE V
L’oiseau moqueur
Ce jour-là, la chaleur avait été accablante. Miss Ellénor, dont la chambre donnait sur un balcon à véranda ombragé de jasmin de Virginie et de chèvrefeuille pourpré, laissa toutes grandes ouvertes les larges fenêtres qui s’ouvraient sur les jardins.
L’atmosphère était d’une douceur remarquable, une brise fraîche et embaumée faisait murmurer harmonieusement les feuillages de la forêt voisine. Dans le grand silence de la campagne sommeillante, on discernait les plus petites rumeurs, le glouglou des petits torrents descendus de la montagne, les mugissements lointains des grands troupeaux de bœufs dans les pâturages, et, dominant sur le tout, en notes éclatantes, le chant du rossignol, le sifflement cristallin des crapauds géants, le ululement des rapaces nocturnes.
La jeune fille, vêtue seulement d’un léger peignoir, les pieds nus dans de mignonnes mules mexicaines, restait accoudée à la balustrade.
Elle contempla quelque temps les campagnes noyées dans une féerique brume d’argent, le ciel semé d’une poussière d’étoiles diamantées.
Le calme profond de cette belle nuit entrait en elle. Il lui semblait que des voix mystérieuses lui parlaient dans une langue inconnue pour apaiser ses tristesses ; et elle n’avait qu’à fermer les yeux pour voir apparaître le visage souriant de son fiancé.
Sa poitrine se gonfla d’un soupir.
– Je suis trop heureuse ! murmura-t-elle. Je crains qu’il ne m’arrive malheur !…
Elle avait prononcé ces paroles presque à voix basse. Mais, au-dessus de sa tête, une voix bizarre répéta l’intonation de sa phrase, sans pourtant donner le sens des mots. Miss Ellénor sourit et, se haussant jusqu’à une cage d’osier tressé, qui était suspendue à l’un des poteaux de la véranda :
– Tais-toi, Coco ! dit-elle. Il est temps de dormir !
Un gazouillement, parti de la cage, répondit à cette injonction. L’oiseau moqueur avait compris.
Cette bestiole – une des curiosités de l’histoire naturelle – est très commune dans l’Arizona, où elle habite les plaines couvertes de cactus. On l’apprivoise très facilement et on arrive à lui faire reproduire, car cet oiseau a le don et l’instinct de l’imitation, tout ce qu’il entend autour de lui, depuis le coassement des grenouilles jusqu’à la voix humaine, le bruit d’un moulin à café, le pétillement du feu dans l’âtre, etc.
Les Américains du Sud estiment beaucoup les oiseaux moqueurs et souvent les paient jusqu’à quarante et cinquante dollars, lorsque leur éducation ne laisse rien à désirer. Il est peu de maisons où l’on n’en garde quelques-uns en cage.
Celui que possédait Ellénor lui avait été offert par Dorypha, il était parfaitement apprivoisé. On le laissait, la plupart du temps, en liberté dans la ferme et, le soir, il ne manquait jamais de rentrer très exactement dans sa cage.
C’était une des distractions favorites de la jeune fille d’écouter les imitations de « Coco », ou de jouer avec lui. Elle le régalait elle-même, tous les jours, d’une pâtée de viande crue, finement hachée, car l’oiseau moqueur, à peu près de la grosseur de notre merle, est essentiellement insectivore et carnivore.
Miss Ellénor savoura pendant longtemps encore le charme de cette belle nuit languide et fraîche. Puis elle finit par se retirer dans sa chambre, mais en laissant, comme elle le faisait presque toujours, sa fenêtre ouverte.
Il y avait longtemps déjà que tous les habitants de l’hacienda étaient plongés dans le sommeil lorsqu’une dizaine d’hommes, qui, tapis, à quelque distance de là, dans un petit bois, avaient patiemment attendu ce moment, sautèrent par-dessus les palissades qui entouraient la cour et, un à un, disparurent mystérieusement dans les bâtiments où couchaient les vaqueros et les Indiens – bâtiments situés à l’autre extrémité de l’endroit où s’élevait le corps de logis habité par Pierre Gilkin, Dorypha et miss Ellénor.
Ces bandits, à la tête desquels se trouvaient Slugh et l’Irlandais Edward Edmond, demeurèrent une longue demi-heure dans ces bâtiments, contigus aux étables. Puis ils en sortirent à l’indienne, et se faufilèrent dans le jardin sur lequel donnaient la fenêtre de miss Ellénor et celle de la chambre des deux époux.
– Vous avez bien compris ce qu’il faut faire ? dit Slugh à voix basse à ses complices, groupés autour de lui à l’abri d’une haie d’orangers. La chambre de la fille est la troisième en commençant à compter à partir de la droite. Celle de Dorypha et de son homme est la première. Elle est située juste au-dessus de la porte d’entrée de la maison. C’est à cette porte que vous allez m’attendre pour barrer le chemin à ceux qui voudraient s’enfuir. Veillez au grain ! Mais, surtout, ne tuez personne sans me prévenir !
– Et vous ? demanda l’Irlandais.
– J’ai aperçu, sous le balcon, une échelle, je vais m’en servir pour pénétrer sans bruit dans la chambre de la jeune fille. Si j’ai la chance de la trouver endormie, je vais la ficeler en un tour de main et la bâillonner avant qu’elle ait eu le temps de pousser un cri.
Les bandits se rendirent au poste qui leur avait été assigné, pendant que Slugh, suivant de point en point le plan qu’il s’était tracé, arrivait sous la véranda, trouvait l’échelle et la dressait en l’appuyant sur le rebord du balcon, juste en face de la fenêtre de miss Ellénor.
Le ravisseur gravit quatre ou cinq échelons, en tâtonnant avec précaution. Cette façade de l’habitation, se portant ombre à elle-même, était plongée dans d’épaisses ténèbres, encore accrues par les masses de plantes grimpantes de la véranda.
Arrivé à peu près à moitié de l’échelle, Slugh s’assura que son revolver était à sa place dans sa poche de côté, et il l’arma avec un petit bruit sec.
Mais, à la profonde stupeur du bandit, à ce bruit répondit un autre bruit exactement semblable. Quelqu’un, placé en embuscade sur le balcon, venait sans nul doute d’armer un revolver et de mettre en joue l’assaillant. Ce fut du moins ce que pensa Slugh.
Sans donner le temps à son adversaire supposé de faire usage de son arme, le bandit tira le premier, en visant au hasard, un peu au-dessus de sa tête et battit précipitamment en retraite.
À sa grande surprise, personne ne riposta à cette attaque.
Slugh ne pouvait deviner que le bruit, cause de son alarme, était produit par l’oiseau moqueur, qui, ayant entendu craquer le ressort du revolver, s’était empressé de donner une nouvelle preuve de ses talents.
Miss Ellénor, réveillée en sursaut par la détonation qui avait retenti presque à ses oreilles, sauta en bas de son lit, et demi vêtue, glacée d’épouvante, elle ouvrit la porte qui donnait sur le couloir de communication, afin de chercher un refuge dans la chambre des deux époux ; mais elle recula précipitamment en apercevant, à la clarté de la lune, un groupe de physionomies hideuses qui barraient le couloir, à peu près à la hauteur de la chambre de Dorypha, dont ils cherchaient à enfoncer la porte à coups d’épaule.
C’étaient les bandits commandés par Edward Edmond qui, en entendant la détonation, s’étaient hâtés d’envahir la maison et de grimper l’escalier conduisant au premier étage.
Folle de terreur, miss Ellénor rentra dans sa chambre, dont elle ferma la porte au verrou. Puis, entendant des cris et de nouvelles détonations, elle s’élança vers le balcon de la véranda, sachant à peine ce qu’elle faisait. Slugh y avait heureusement laissé son échelle.
La jeune fille, sans réfléchir, s’en servit pour descendre dans le jardin et elle se mit à fuir par les allées ombreuses dans la direction des bâtiments occupés par les serviteurs, afin de leur donner l’alarme.
Dorypha et son mari avaient été, eux aussi, réveillés par le coup de revolver de Slugh. Mais les deux époux étaient braves et, tout d’abord, ils ne furent pas extraordinairement émus. Souvent il leur était arrivé d’avoir affaire à des bandits.
Pierre Gilkin passa en hâte un pantalon, saisit le browning placé à son chevet et sortit, décidé à faire feu sur le premier qu’il apercevrait. Pendant ce temps, Dorypha se hâtait d’allumer une lampe à pétrole placée à côté du lit.
Pierre Gilkin descendait l’escalier au moment même où les bandits le montaient. Il n’eut que le temps de se réfugier dans sa chambre et d’en refermer la porte.
– Nous sommes attaqués par la Main Rouge, s’écria-t-il avec épouvante.
– Eh bien, tant pis ! s’écria Dorypha. Nous nous défendrons, si c’est cela ! Tu sais fort bien, Pierre, que ces coquins-là ne sont pas aussi braves qu’on le croit… Puis, es-tu parfaitement sûr que ce soit la Main Rouge ?
– J’en suis convaincu. Il n’y pas de brigands dans le pays, tu le sais bien !
– Embrasse-moi, Pierre. Nous nous défendrons et nous mourrons ensemble, s’il le faut !
Les deux époux se jetèrent dans les bras l’un de l’autre, en une étreinte passionnée. Leurs lèvres s’unirent dans un brûlant baiser qui devait peut-être être le dernier.
– Et miss Ellénor !… s’écria tout à coup Dorypha avec désespoir.
– Nous ne pouvons nous occuper d’elle en ce moment. Nous avons assez de songer à nous !
À cet instant, la serrure tomba à terre, arrachée. La porte s’entrebâilla. Deux ou trois visages hideux apparurent.
Pierre Gilkin tira dans le tas, presque à bout portant, deux fois de suite. Deux hommes tombèrent. Des cris de fureur s’élevèrent.
– Rends-toi, coquin !… où nous t’écorcherons vif !…
– Nous mettrons le feu à ta cambuse !…
– Canailles ! riposta Pierre Gilkin exaspéré, vous ne me tenez pas encore !…
Et il tira une troisième fois, blessant encore un bandit.
Pendant que s’échangeaient au hasard ces paroles, les balles sifflaient à travers la chambre. Déjà Pierre Gilkin avait été légèrement atteint à l’oreille et à l’épaule.
Soudain, une rude et forte voix domina un instant le crépitement de la fusillade et les cris des combattants :
– Vive la Main Rouge ! Et mort aux traîtres !…
Dorypha avait reconnu cette voix, et elle était devenue blême.
– L’Irlandais ! balbutia-t-elle. Nous sommes perdus !… Oh ! comme je regrette de ne pas l’avoir tué !…
Edward Edmond, avec tout le sang-froid d’une haine concentrée par une longue rancune, visa longuement Pierre Gilkin et tira.
Le coup avait porté. Le maître de l’hacienda se rejeta en arrière, en laissant échapper son browning.
La balle d’Edward Edmond lui avait brisé l’os du bras.
– Donne-moi ton browning ! cria Dorypha éperdue.
Mais déjà l’Irlandais s’était rué dans la chambre et mettait en joue Pierre Gilkin, blessé, désarmé et incapable de se défendre.
Dorypha s’élança à son secours. Une lutte affreuse s’engagea. Mais Dorypha, à demi nue, affolée, n’était pas de taille à défendre son mari contre l’Irlandais, doué d’une vigueur peu commune.
De sa main droite, il serrait, comme dans un étau de fer, la gorge de la danseuse, étendue sur le lit et, de la gauche, il tira sur Pierre Gilkin qui, atteint en pleine poitrine, tomba, baigné dans son sang.
– Je l’ai tué, ce gredin de Belge ! ricana-t-il. Et, maintenant, à ton tour, chienne maudite !… Tu vas y passer !… Ton compte est bon !…
Il s’apprêtait à brûler la cervelle de la gitane, quand il se sentit la main saisie par un poignet de fer. Il se retourna, furieux, et se trouva face à face avec Slugh.
– Il ne faut pas tuer cette femme, dit celui-ci d’une voix brève !
– Je croyais…
– J’ai changé d’avis. Qu’on se contente de la garrotter solidement.
Edward Edmond baissa la tête, tout penaud. Mais il n’eut pas la moindre velléité de résister à la volonté de Slugh.
– Que tout le monde, continua ce dernier, m’aide à fouiller la maison ! L’autre femme s’est échappée. Il faut la retrouver à tout prix !
Dorypha, qui se tordait sur son lit, quoique les cordes lui serrassent les chevilles et les poignets, poussait des cris déchirants et, malgré eux, les bandits ne pouvaient s’empêcher de ressentir quelque émotion.
Slugh s’en aperçut.
– Bâillonnez cette gueuse ! ordonna-t-il. Qu’elle cesse de nous rompre les oreilles ! Elle va savoir, d’ici peu, ce qu’il en coûte de trahir les Lords de la Main Rouge.
Cet ordre fut exécuté immédiatement. Puis les tramps se répandirent dans toute la maison, battirent même les buissons du jardin et explorèrent les moindres recoins. Vainement ! Miss Ellénor avait disparu et il fut impossible aux bandits de deviner de quel côté elle avait pu s’enfuir.
La jeune fille avait atteint sans accident les bâtiments occupés par les vaqueros et les Indiens. Mais, comme elle poussait la porte, ses pieds butèrent contre un corps étendu au milieu d’une large flaque de sang.
Avant de pénétrer dans la maison des maîtres, les bandits avaient commencé par assassiner les serviteurs.
Frissonnant de terreur et sur le point de s’évanouir, la jeune fille demeura quelque temps à la même place, et c’est de là qu’elle assista au drame sanglant dont la chambre de Dorypha avait été le théâtre.
Persuadée que la gitane et son mari avaient été égorgés tous les deux, miss Ellénor n’eut plus qu’une pensée : fuir, fuir le plus loin possible de ce champ de carnage !
Elle se faufila jusqu’à la porte du corral où se trouvaient les mustangs, et, sautant sans étriers et sans selle sur le dos du premier venu d’entre eux, elle s’élança au hasard, à travers la campagne, cramponnée à la crinière de l’animal qu’elle excitait de la voix et du geste.
Le mustang, qui n’était pas habitué à être conduit de la sorte, se rua, comme s’il eût eu le mors aux dents, à travers les prairies et les plantations de vignes et d’orangers.
Ce fut peut-être cette course folle qui sauva la jeune fille.
L’animal ne fit halte qu’au milieu d’un champ de maïs, dont les tiges résistantes et drues l’empêchaient d’avancer.
Ce fut de là que miss Ellénor vit passer dans la nuit, comme une cavalcade infernale, la troupe des bandits qui s’étaient emparés des meilleurs chevaux de l’hacienda.
L’un de ces scélérats portait, brutalement jeté en travers de sa selle, le corps inerte de Dorypha, dont le peignoir blanc se distinguait nettement dans la pénombre.
La fugitive contempla ce spectacle les yeux agrandis par l’horreur. Bientôt les silhouettes des cavaliers se perdirent dans la nuit et disparurent dans la direction du nord.
La jeune fille, brisée de fatigue et d’émotion, se demanda un instant si elle ne ferait pas bien de rentrer à l’hacienda, où quelques-uns de ses habitants avaient peut-être échappé à la mort.
Elle allait se diriger de ce côté, quand des langues de flamme rouge montèrent dans le ciel, en même temps qu’éclataient des hennissements et des beuglements d’agonie. Horreur ! Infamie ! Les tramps avaient mis le feu à l’hacienda, après avoir eu soin de fermer à clé la porte des étables.
La rescapée pour la deuxième fois rebroussa rapidement chemin, plus morte que vive. Elle reprit au hasard sa course éperdue. Une demi-heure plus tard, des vaqueros, qui avaient vu de loin la lueur de l’incendie et qui accouraient au secours de Pierre Gilkin, la recueillirent presque inanimée et la conduisirent à la station de Cucomongo, dans un hôtel, où on la soigna avec sollicitude et où elle demeura trois jours entre la vie et la mort.
Quand elle fut remise de cette effroyable secousse, on lui apprit que Dorypha avait disparu, que Pierre Gilkin mortellement atteint n’avait pas encore succombé à ses blessures et était en traitement à l’hôpital de la station. Les vaqueros l’avaient découvert et emporté au moment même où les flammes allaient atteindre la chambre où ses assassins l’avaient abandonné dans la mare de sang provenant de ses blessures.
Anéantie par tant de terribles émotions, miss Ellénor réfléchit qu’il ne lui restait plus d’autre parti à prendre que de regagner New York. Et elle envoya, le jour même, une longue dépêche à lord Burydan.
Quatre jours plus tard, elle descendait à la station du Central Pacific Railroad, à New York. Lord Burydan fut la première personne qu’elle aperçut au débarcadère. Il tenait à la main une grosse gerbe de scabieuses.
Miss Ellénor eut un pâle sourire en reconnaissant les fleurs qui lui devenaient plus chères encore. Les fiancés montèrent sans tarder dans une auto qui les emporta rapidement dans la direction du Preston-Hotel.
Lord Burydan, en souvenir de leur première entrevue, avait fait mettre le couvert sur la terrasse d’où l’on dominait la ville. Pendant leur repas, ils eurent un long et tendre entretien.
Miss Ellénor raconta, sans rien omettre, toutes les péripéties du drame où elle avait failli jouer un si terrible rôle. Son fiancé l’écouta, tout pensif, sans l’interrompre par une seule observation.
– Ma chère Ellénor, dit-il enfin, depuis que j’ai reçu votre dépêche, j’ai beaucoup réfléchi. Je crois vous avoir trouvé, cette fois, une retraite absolument inviolable.
– J’irai partout où vous me direz d’aller, répondit la jeune fille avec une souriante obéissance. Je sais que tout ce que vous me conseillerez est dans l’intérêt de notre amour.
– Je possède au Canada, continua-t-il, d’immenses propriétés et des amis qui me sont entièrement dévoués.
« C’est à eux que je veux vous confier. Certes, la Main Rouge n’ira pas vous chercher dans les forêts qui bordent les rives du lac Winnipeg. Cette décision n’a, je l’espère, rien qui vous chagrine ?
– Mon seul chagrin est de m’en aller encore si loin de vous !
– Vous savez bien qu’il le faut. Prenez patience, allez, cette séparation ne doit plus durer bien longtemps. D’ici peu, je vais atteindre le but que je me suis fixé.
– Quand partirai-je ?
– Dès que vous aurez pris quelque repos. Je vous préviens, d’ailleurs, que vous aurez un compagnon de voyage, un vénérable vieillard qui est un de mes meilleurs amis.
– Cela m’ennuie un peu de voyager avec un inconnu.
– Oh ! rassurez-vous ! Celui-là n’est guère gênant. Le pauvre homme, à la suite d’une forte commotion, a été complètement privé de la parole. Il lui est impossible d’articuler un seul mot.
– Et il se nomme ?
– Mr. Clark.
Trois jours plus tard, miss Ellénor, que lord Burydan accompagna à la gare, prenait place dans un pullman-car du Canadian Railway, en compagnie du milliardaire William Dorgan, qu’on lui avait présenté sous le nom de Clark et que de larges lunettes noires rendaient absolument méconnaissable.
SEIZIÈME ÉPISODE
La tour fiévreuse
CHAPITRE PREMIER
En Floride
Du train qui venait de faire halte à la gare de Tampa, tout au sud de la Floride, il ne descendit, par cette torride matinée de fin d’été, que deux voyageurs seulement. Tous deux étaient vêtus de complets de couleur kaki, coiffés de casques de liège, et suivis d’un domestique noir chargé de porter leurs valises ; tous deux jetèrent le même regard distrait et fatigué sur les constructions blanches de la ville de Tampa, au-dessus desquelles le vent soulevait des tourbillons de poussière, et qui se découpaient crûment sur le ciel d’un bleu éblouissant.
Ils firent, chacun de son côté, quelques pas vers la sortie de la gare et, se trouvant brusquement l’un en face de l’autre, ils jetèrent le même cri de surprise.
– Vous ici, lord Burydan ?
– Vous y êtes bien, mon cher Oscar. Mais j’ai beau regarder, il me semble qu’il y a en vous quelque chose de changé ?
– Vous ne vous trompez pas, répondit gaiement le jeune homme. La dernière fois que je vous ai vu, j’étais encore quelque peu bossu ; maintenant je suis complètement débarrassé de cette difformité, et cela grâce au savant traitement que m’ont appliqué l’illustre Bondonnat, mon maître et ami, et son gendre, M. Ravenel.
– Tous mes compliments ! dit lord Burydan en serrant chaleureusement la main de l’ex-bossu. C’est donc pour cela qu’il y a un siècle qu’on ne vous a vu ?
– Oui. J’ai dû garder quelques semaines une immobilité absolue, le dos pris dans un appareil plâtré ; maintenant cela va tout à fait bien… Mais est-il indiscret de vous demander où vous allez ?
– Une voiture qui appartient à un de nos amis doit m’attendre à la gare, ici même.
– Tiens ! c’est comme moi ! J’attends aussi une voiture… Au fait, c’est peut-être la même ?
– Ce ne serait pas impossible. Dans tous les cas, voici bien une voiture, mais il n’y en a qu’une.
Tous deux s’approchèrent d’une sorte de char à bancs attelé de deux mules fringantes et protégé contre les ardeurs du soleil par un dais de toile cirée. Un Noir sommeillait sur le siège, à l’abri d’un vaste parasol. Oscar le secoua pour le réveiller et lui demanda s’il n’était pas au service de l’honorable Mr. Bombridge.
– Oui, répondit le Noir en bâillant. Je viens chercher deux voyageurs.
– Eh bien ! les voilà, dit lord Burydan.
Il ajouta, en se tournant vers Oscar :
– Vous voyez que je ne m’étais pas trompé. Il était écrit que nous devions prendre le même véhicule.
Les deux amis s’installèrent sur les coussins. Le Noir fit claquer joyeusement son fouet, et les mules partirent au grand trot, dans un tintinnabulement de grelots, secouant au vent les pompons de laine de couleur vive dont leurs harnais étaient garnis, en guise de chasse-mouches.
Ils traversèrent à fond de train la ville poussiéreuse et déserte. À cette heure de la journée, tout le monde avait déjà commencé à faire la sieste.
Ils se trouvèrent bientôt sur la grand-route, que bordaient, à droite et à gauche, des massifs de palmiers, de tulipiers et d’eucalyptus. Plus loin, s’étendait une fertile vallée, couverte de champs de tabac en pleine maturité, dont les feuilles couleur de bronze exhalaient, sous l’ardent soleil, un acre parfum.
Enfin, après deux heures d’une course que la poussière et les moustiques rendaient des moins agréables, ils gravirent une colline que couronnait une forêt de chênes, de cyprès et de pins. Là, régnait une délicieuse fraîcheur.
Les voyageurs essuyèrent leur visage baigné de sueur et respirèrent plus à l’aise.
Ils purent reprendre la conversation commencée à la gare pendant que le char à bancs, ralentissant sa marche, s’engageait dans une allée sablée, au-dessus de laquelle des myrtes arborescents, au délicieux parfum, formaient une voûte de verdure, impénétrable aux rayons du soleil.
– Je ne vous ai pas demandé, dit Oscar, le but de votre voyage ?
– C’est une affaire assez grave qui m’amène. Vous savez que, jusqu’ici, la Compagnie des paquebots Éclair, que dirigent le milliardaire Fred Jorgell et son gendre, Harry Dorgan, avait obtenu, près du public et près des actionnaires, un succès bien mérité d’ailleurs par la rapidité et le confortable de ses steamers ?
– Je suis parfaitement au courant. Les premiers dividendes distribués avaient été assez élevés.
– Malheureusement – c’est un secret que je crois pouvoir vous révéler –, la Compagnie traverse une crise. Depuis moins d’un mois, deux de ses plus grands paquebots ont péri corps et biens.
– Ah ! j’ignorais cela… c’est un grand malheur !
– Eh bien, je crois précisément, moi, que ces deux sinistres, survenus dans les mêmes parages, en face même des côtes de la Floride, ne sont pas de simples accidents ! Je suis persuadé qu’il faut en accuser la malveillance, bien plutôt que le hasard.
– Vous avez des preuves ?
– Je n’ai encore que des soupçons. Toutefois, avouez qu’il est au moins singulier que ces catastrophes se produisent à point nommé, au moment précis où Harry Dorgan, le codirecteur de la Compagnie des paquebots Éclair, entre en lutte ouverte avec son frère Joë, qui, depuis la mort de William Dorgan, a pris la direction du trust des cotons et maïs.
– Je ne vois pas bien dans quel intérêt…
– Vous allez comprendre. La Compagnie des paquebots Éclair, ayant accaparé les moyens de transport par eau, a relevé considérablement le prix du fret pour les cotons et maïs ; Joë Dorgan et ses deux associés, Fritz et Cornélius Kramm, donneraient, je crois, de bon cœur quelques millions de dollars pour apprendre que les paquebots Éclair sont en faillite.
– Je ne saisis pas davantage, déclara Oscar, quel rapport il peut y avoir entre ces deux naufrages et votre voyage ?
– Je viens tout simplement faire une enquête discrète, sur le théâtre même de la catastrophe, pour tâcher d’en deviner la véritable cause, et j’ai pensé, tout naturellement, à demander l’hospitalité à notre ami Bombridge, devenu maintenant millionnaire.
– J’aurais préféré qu’il ne le devînt pas ! murmura Oscar avec un soupir. Je maudis la fatale idée qu’il a eue de prendre un billet à cette loterie des États confédérés, où il a gagné un million de dollars.
– Pourquoi donc ? demanda lord Burydan avec surprise.
– C’est que…, murmura Oscar avec effort, j’étais fiancé à miss Régine Bombridge…
– Vous ne l’êtes donc plus ?
– Non. J’ai compris que ma situation n’était plus en rapport avec celle de Régine, et j’ai cru de toute honnêteté de lui rendre sa parole.
– Ho !… Quelle a été l’attitude de Bombridge et de sa fille ?
– Régine était désolée. Elle m’a supplié de ne rien changer à nos projets. Mais le père Bombridge a mis si peu d’insistance à me retenir que j’ai compris qu’il ne serait pas fâché d’avoir un gendre plus riche que moi.
– Cela m’étonne, dit pensivement lord Burydan.
– Je dois dire, reprit Oscar, que rien n’est définitivement rompu. J’ai reçu, ces jours derniers, une lettre de Régine, qui me prie de venir passer quelques jours chez son père.
– Singulière manière d’agir !
– En réalité, plusieurs prétendants ont posé leur candidature à la main de miss Régine. Le père Bombridge, qui connaît l’affection de sa fille pour moi, est très indécis. C’est, paraît-il, cette semaine que la question doit être tranchée. Bombridge, en sa qualité d’ancien clown, est passablement humoriste ; il doit réunir, pendant plusieurs jours, à sa table, les concurrents à la main de sa fille, afin de pouvoir établir des comparaisons.
– Je vous souhaite bonne chance, de tout mon cœur ! dit lord Burydan. Si je puis influer de quelque manière sur la décision de Bombridge, croyez que je ne manquerai pas de le faire.
À ce moment, le char à bancs franchissait un portique, dont les colonnes étaient assez bizarrement surmontées de deux gros escargots dorés. Ces ornements piquèrent la curiosité d’Oscar.
– Est-ce que Bombridge se serait anobli et aurait-il choisi les escargots pour décorer son blason ?
– Vous n’êtes donc au courant de rien ? répliqua lord Burydan. Bombridge, en quittant le poste de régisseur général qu’il occupait dans la propriété de Fred Jorgell, près du lac Ontario, s’est lancé en grand dans les affaires. Il a organisé d’une façon intensive l’élevage de l’escargot. Son établissement est, paraît-il, des plus curieux à visiter. Après tout, le trust de l’escargot peut devenir aussi brillant qu’un autre.
La voiture s’était arrêtée en face d’une charmante habitation, à la mode créole, bâtie au milieu d’un vaste parterre, que des pins parasols, de grands lauriers et des cyprès protégeaient contre les ardeurs du soleil.
L’habitation était petite, mais très confortable.
Sur toute sa longueur, régnait une « varangue », ou galerie couverte, soutenue par des colonnes de bambou, autour desquelles s’enroulaient des pieds de vanille grimpante, des pois d’Angole et des jasmins de la Floride.
Parmi les arbres, Oscar remarqua des magnolias et des flamboyants aux corolles éclatantes, les pelouses, de gazon anglais, étaient jonchées de leurs pétales, et l’atmosphère en était embaumée.
– On voit, murmura-t-il en respirant avec délice ces capiteuses senteurs, que nous sommes vraiment dans le pays des fleurs, dans la Floride !…
Oscar fut vite arraché à la contemplation de ces magnificences végétales par l’arrivée de miss Régine elle-même.
La jeune fille avait aperçu de loin les nouveaux arrivants et s’était empressée d’accourir.
– Si vous saviez, dit-elle au jeune homme, comme je suis heureuse de vous voir ! J’avais peur que vous ne vinssiez pas… Mais, qu’avez-vous donc ? ajouta-t-elle en jetant un léger cri de surprise et presque de frayeur.
Elle venait de s’apercevoir, elle aussi, qu’Oscar Tournesol était délivré de sa bosse. Ce furent des explications sans fin, des rires, et enfin des félicitations.
– Comme je suis contente ! s’écria la jeune fille en battant des mains. Vous ne vous êtes pas trompé en croyant me faire une bonne surprise ! Puis voilà encore une des préventions de mon père contre vous complètement réduite à néant.
– Les prétendants à votre main sont-ils nombreux ? demanda lord Burydan, souriant aux tendres protestations des deux amoureux.
– Il n’y en a que deux. L’un est le prestidigitateur Matalobos, un ancien membre du Gorill-Club. Je ne connais pas encore l’autre, mais je sais qu’il s’occupe de sciences occultes.
– Et il se nomme ? demanda Oscar.
– James Rollan.
– Connais pas.
– D’ailleurs, reprit miss Régine d’un petit air décidé, je n’en ferai qu’à ma tête ! Je me suis promis d’épouser Oscar et je l’épouserai ! Mon père aura beau dire !
À ce moment, Mr. Bombridge, lui-même, apparut sur le seuil de sa demeure. Allant au-devant de ses invités, il serra cordialement la main de lord Burydan et, peut-être un peu plus froidement, celle d’Oscar.
Pourtant, son accueil fut, somme toute, des plus hospitaliers.
Un Noir conduisit lord Burydan et son ami à leurs chambres, qui étaient munies de salles de bains où ils purent se rafraîchir et se débarrasser de la poussière de la route.
Quand ils redescendirent, ils étaient parfaitement reposés et s’apprêtaient à faire honneur au repas préparé pour eux, et dont la bonne odeur montait déjà des cuisines installées dans les sous-sols.
La salle à manger était aménagée avec le luxe particulier aux créoles de la Floride et de la Caroline. D’énormes blocs de glace, dans des vasques de marbre, y entretenaient une fraîcheur délicieuse ; la vaisselle plate et les cristaux étincelaient, et, derrière chaque convive, se tenait un serviteur noir, qui devait s’occuper exclusivement de celui auquel il était attaché.
Lord Burydan allait se mettre à table, lorsque Mr. Bombridge lui remit un pli qui portait le timbre de Winnipeg, dans le Canada.
– J’allais, dit-il, oublier cette missive, qui est arrivée de ce matin.
– Je vous remercie. C’est précisément une lettre que j’attendais avec impatience.
Lord Burydan brisa promptement le cachet de cire violette et s’absorba dans sa lecture.
– Je constate, dit à mi-voix Oscar, qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise nouvelle, votre physionomie est tout à coup devenue radieuse.
– En effet, répondit lord Burydan. C’est miss Ellénor qui m’écrit. Comme vous le savez, elle se trouve, en ce moment-ci, au Canada. L’excellent M. Pasquier a bien voulu se charger d’elle pendant quelque temps, ainsi que d’un autre de mes amis, un vieillard qui, à la suite de l’émotion ressentie dans la catastrophe du pont de l’Estacade, se trouve complètement privé de l’usage de la parole.
Oscar eût bien voulu savoir quel était ce vieillard devenu muet de peur, mais il n’osa questionner lord Burydan. Il n’ignorait pas que l’excentrique était d’une discrétion à toute épreuve quand il s’agissait de certaines affaires, et qu’il ne se laissait questionner que lorsqu’il le voulait bien.
Tous deux demeurèrent silencieux. Chacun se reportait, par la pensée, au temps qu’ils avaient passé dans les verdoyantes forêts qui s’étendent autour de la Maison Bleue, où le fou assassin Baruch, après s’être évadé du Lunatic-Asylum, avait trouvé un refuge.
Oscar demanda à lord Burydan comment se portait le dément. Cette question parut déplaire à l’excentrique :
– L’état du malade est assez satisfaisant, répondit-il évasivement. Sa santé physique est excellente ; mais je crains qu’il ne recouvre jamais sa raison…
Oscar n’insista pas.
Matalobos venait d’entrer dans la salle à manger. Le prestidigitateur, depuis qu’il aspirait à la main de miss Régine, était vêtu avec l’élégance d’un véritable gentleman. Des boutons de diamant étincelaient à ses manchettes et au plastron de sa chemise à petits plis.
Sa physionomie, qui reflétait autrefois la malice et la gaieté, avait pris une expression de raideur solennelle. Il portait monocle et ses doigts étaient chargés de bagues.
Il salua Oscar et lord Burydan. Une conversation générale s’engagea, dont la croisière du Gorill-Club fit les principaux frais, chacun évoquant quelque épisode de la prise de l’île des pendus.
Le repas se poursuivait joyeusement.
On en était au dessert, composé de ces fruits magnifiques comme il n’en mûrit que sous les cieux ardents de la Floride, lorsqu’un Noir apporta un télégramme à l’adresse de lord Burydan. Celui-ci en prit connaissance, et sa physionomie exprima aussitôt un vif mécontentement.
– Messieurs, déclara-t-il, Fred Jorgell m’apprend qu’un des navires de la Compagnie des paquebots Éclair vient encore de périr corps et biens !
– Où cela, demanda Mr. Bombridge.
– Mais toujours à la même place, sur les côtes de la Floride ! On dira ce que l’on voudra, il y a là autre chose qu’un simple hasard.
– Est-ce loin d’ici ?
– D’après les renseignements que m’envoie Mr. Jorgell, c’est sur les récifs du golfe d’Oyster Bay que se sont successivement brisés les trois paquebots venant de La Nouvelle-Orléans et se rendant à New York.
– Il y a eu, en effet, dit miss Régine, une terrible tempête avant-hier, je sais que plusieurs navires ont été jetés à la côte…
– Oyster Bay, interrompit Bombridge, mais ce n’est qu’à quelques miles d’ici !
– Je vous demanderai de m’y conduire, dit lord Burydan.
– Si vous y tenez…, répondit Bombridge avec hésitation.
– Cette proposition n’a pas l’air de beaucoup vous plaire ?
– Je vous dirai franchement que la région avoisinant Oyster Bay est une des plus sinistres qui soient au monde ! Ce n’est qu’un immense marécage peuplé d’alligators et de serpents. De plus, c’est le séjour favori de la fièvre jaune, que propagent les millions de moustiques nés des eaux croupissantes.
– Voilà, en effet, qui n’est pas très engageant.
– Toute cette partie de la côte est déserte. Autrefois, avant que les Espagnols aient vendu la Floride aux États-Unis, il existait à Oyster Bay un village de Noirs, mais voilà près d’un siècle que tous ses habitants sont morts de la fièvre ou ont pris la fuite.
« La côte est bordée de récifs, et les requins y pullulent. C’est un endroit tellement dangereux que, bien que les huîtres perlières y abondent, à peine quelques pauvres Noirs y viennent-ils sur leurs barques, dans la saison la plus favorable, se livrer à la pêche. Je ne connais pas de rivage plus inhospitalier.
– Il faudra pourtant bien, dit lord Burydan, que j’aille voir tout cela de près.
– Dans un pareil endroit, s’écria Oscar, le gouvernement aurait bien dû faire installer un phare…
– Il y en a bien un, dit Bombridge, juste à l’entrée de la rivière qui fait communiquer la mer et le lac Okeechobee ; mais, comme vous le voyez, il ne sert pas à grand-chose !
La conversation en demeura là.
Tout le monde quitta la table pour aller prendre le café, qui était servi sous la varangue, et savourer les excellents cigares que Mr. Bombridge récoltait sur sa propriété même.
CHAPITRE II
Le trust des escargots
Les invités de Mr, Bombridge s’attardèrent longtemps, paresseusement étendus dans des rocking-chairs, et s’abandonnant au charme de ce climat amollissant.
Comme l’expliqua le maître de la maison, aucun homme de race blanche n’eût pu se livrer à un travail quelconque par une pareille chaleur.
Quand le soleil se fut un peu abaissé, Mr. Bombridge proposa à ses hôtes de les mener visiter sa ferme aux escargots.
– C’est, dit-il, une immense et curieuse exploitation, qui n’a pas sa pareille en Amérique, et vous ne vous repentirez pas de l’avoir vue. D’ailleurs, elle ne se trouve pas très loin… à un mile d’ici.
On prit place dans un « carriage » attelé cette fois de quatre mules, qui ne mirent pas plus de dix minutes à parcourir la longue avenue d’eucalyptus qui conduisait à l’exploitation.
La ferme aux escargots comprenait une immense enceinte, entourée d’une muraille de brique dont le faîte était garni d’une plaque de tôle inclinée de haut en bas vers l’intérieur de façon à rendre aux élèves de Mr. Bombridge toute évasion impossible.
Cette enceinte franchie, tout le monde mit pied à terre, et l’on se trouva dans le parc proprement dit.
Il se composait d’une série d’enclos, en forme de parallélogrammes, que séparaient des murailles de brique, un peu moins hautes que celle de l’enceinte, mais également pourvues des plaques de tôle destinées à refréner toute velléité d’indépendance de la part des mollusques vagabonds.
– Comme vous voyez, expliqua Mr. Bombridge avec la complaisance d’un propriétaire, le parc est installé sur une colline de sable. L’escargot aime un terrain meuble, où il puisse facilement creuser des trous et faire sa ponte.
« Ces petites passerelles en planches permettent de parcourir en tous sens chaque enclos, et de recueillir ceux des animaux qui ont atteint la grosseur réglementaire, et qui sont bons pour la vente.
– C’est fort intéressant, déclara lord Burydan. Tiens ! Pourquoi ces mâts métalliques, terminés par une grosse boule ?
– Chacun d’eux est un gigantesque vaporisateur, destiné à produire une petite pluie fine par les jours de grande sécheresse. Vous n’ignorez pas que, lorsque le temps est trop sec, l’escargot rentre dans sa coquille, il maigrit, sa croissance subit un arrêt et peut demeurer stationnaire pendant plusieurs mois.
Oscar demanda, à son tour, l’usage d’un vaste hangar en brique, à la toiture vitrée, que l’on apercevait à l’une des extrémités de l’exploitation.
– C’est la salle des expéditions, expliqua Mr. Bombridge. Là, cinq cents nègres sont occupés, nuit et jour, à emballer les mollusques dans des caisses à claire-voie, qui en contiennent chacune un millier et sont expédiées d’Amérique dans tous les pays de l’univers.
« La marque de la « ferme Bombridge » est déjà célèbre, et ses produits sont très haut cotés en Australie, au Cap et sur les marchés de la vieille Europe.
« Il est indispensable que l’escargot soit cacheté pour qu’il puisse être transportable, surtout à de longues distances. Cette espèce de caverne, dont vous voyez l’entrée, est une salle souterraine aux murailles faites d’une roche très sèche. C’est là que les escargots se cachettent d’eux-mêmes, en attendant l’emballage et le transport sur les marchés.
Il y avait près d’une heure que Mr. Bombridge et ses amis suivaient le chemin pavé établi entre les enclos, et ils n’avaient pas encore parcouru la dixième partie de l’exploitation.
– Nous nous faisons facilement une idée du reste, déclara lord Burydan. Il ne faut pas abuser de votre complaisance.
– Vous n’avez pas encore tout vu, déclara Bombridge avec un sourire d’orgueil…
Il fut interrompu par un sifflement aigu. Une minuscule locomotive, conduite par un nègre aux cheveux crépus, filait rapidement à travers les enclos, remorquant une quinzaine de wagonnets chargés de feuillages verdoyants.
– C’est un train de fourrage qui arrive, reprit Mr. Bombridge. Je possède, à quatre miles d’ici, quelques centaines d’hectares de marécages, que j’ai fait en partie assainir par des plantations d’eucalyptus. Le terrain reste suffisamment humide pour produire, avec une abondance qui vous étonnerait, des végétaux à croissance rapide : le cresson, le radis géant, le chou des Florides, qui sont régulièrement fauchés tous les jours par mes Noirs.
« Huit jours avant la mise en vente, mes pensionnaires sont nourris exclusivement de feuilles de vigne. Pour cela, je cultive la vigne du Japon, dont la végétation est exubérante, surtout sous cette latitude. Cela donne à mes produits un goût exquis et très recherché des gourmets.
Pendant cette explication, la locomotive du chemin de fer Decauville avait stoppé sur un petit pont de fer qui enjambait les plus vastes des enclos.
– Regardez ! s’écria Bombridge, personne ne peut se faire une idée de la voracité de l’escargot.
Un robuste Noir fit basculer un des wagonnets. Un monceau de verdure tendre tomba dans l’enclos ; aussitôt il y eut parmi les escargots un remue-ménage général. Ils accouraient par centaines, par milliers, par myriades, et les spectateurs, étonnés, perçurent distinctement un bruit de mastication, qui ressemblait à celui qu’eussent fait une trentaine de rats.
Au bout de quelques minutes, il ne restait plus du wagon de verdure que quelques tiges et quelques côtes trouvées trop dures.
Le Noir s’occupait déjà de renverser le contenu du second wagonnet.
– C’est admirable ! déclara Matalobos. Cet amas de fourrage a été presque aussi lestement escamoté que si je m’en fusse mêlé !
– Vraiment, fit Oscar, je ne regrette pas d’avoir vu cela ! Mais j’aperçois de véritables phénomènes : des escargots gros comme les deux poings et d’autres d’un rose tendre, d’un jaune vif, aussi beaux que les plus jolis coquillages marins !
– Il faut vous dire, expliqua de nouveau Mr. Bombridge, que, comme tout éleveur sérieux, je m’occupe de l’amélioration de la race. Ces escargots qui font votre admiration, je les ai fait venir à grands frais, les uns des îles de la Grèce, les autres de Madagascar. Ce sont ces contrées qui produisent les plus grands individus de l’espèce ; mais ils sont un peu coriaces.
« Je ne désespère pas, à l’aide d’une série de sélections, d’arriver à fixer une variété aussi savoureuse et aussi tendre que l’escargot de Bourgogne, et qui aura la taille d’une tortue de moyenne grosseur.
– Ce qui m’étonne, dit lord Burydan, c’est que, en si peu de temps, vous ayez acquis les connaissances nécessaires pour diriger, comme vous le faites, un établissement aussi vaste et aussi ingénieusement compris.
Ce compliment alla droit au cœur de Mr. Bombridge.
– Il est vrai, fit-il en baissant les yeux avec modestie, que peu de gens pourraient m’en remontrer sur la question des escargots. Cependant, je dois beaucoup à la lecture des ouvrages d’un savant français, M. Raphaël de Noter, qui a écrit sur la matière des pages définitives. C’est à lui que je m’adresse chaque fois que je suis embarrassé.
Miss Régine, qui se tenait un peu en arrière à côté d’Oscar, lui dit à l’oreille :
– Ce que mon père ne raconte pas, c’est qu’il a découvert chez l’escargot une certaine intelligence ; et il s’occupe en ce moment d’apprivoiser quelques-uns des mieux doués de ses pensionnaires.
– Peut-être, dit en riant le jeune homme, se propose-t-il de les exhiber sur la scène d’un music-hall ?
– Je n’en sais rien. Mais il a beau être devenu riche, il lui est impossible d’oublier qu’il a fait partie du Gorill-Club…
– Messieurs, interrompit tout à coup Mr. Bombridge dont le visage s’était rembruni, je vous ai montré ce qu’il y avait d’intéressant. Je crois que nous ferons bien de ne pas nous attarder ici plus longtemps ; il se prépare un de ces terribles orages, une de ces tornades qui sont un des fléaux du pays.
Du doigt, il montrait le ciel devenu tout à coup d’un blanc livide, pendant que, du côté de l’ouest, de gros nuages d’un roux cuivré s’amoncelaient.
– Savez-vous ce que je propose ? ajouta-t-il. Nous allons tous monter dans le Decauville. Il nous ramènera à la maison beaucoup plus vite que ne le feraient les mules et cela nous permettra, en passant, de jeter un coup d’œil sur les cultures.
« Jupiter, ordonna-t-il à un nègre aux cheveux blancs qui jusque-là avait servi de guide à la société, donne l’ordre qu’on attache à la locomotive le wagon de promenade. Nous regagnerons la maison par la petite ligne.
Cet ordre fut immédiatement exécuté. Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées que les hôtes de Mr. Bombridge, et Jupiter lui-même, prenaient place dans l’intérieur d’un long wagonnet, très confortablement aménagé, et qui eût pu contenir une dizaine de personnes.
La minuscule locomotive lança un sifflement aigu ; le train se mit en marche, traversa, sur un long viaduc de fer, une série d’enclos, où grouillaient des millions d’escargots et d’où l’on semblait ne devoir jamais sortir.
Enfin, il franchit une sorte de poterne et, augmentant sa vitesse, fila en rase campagne.
Le paysage n’était plus égayé par des forêts ou des jardins. C’était la plaine nue et morne, où s’élevaient à peine, de loin en loin, une touffe de bambous, un vieux saule rabougri, ou un eucalyptus tordu par les vents.
Le vieux Jupiter, sur un signe de son maître, avait tiré d’une petite armoire placée à l’un des bouts du wagon une bouteille de xérès, un seau de glace, des citrons et d’autres rafraîchissements, qu’il déposa sur un étroit guéridon.
– Il fait une chaleur accablante, déclara l’amphitryon, et ce ne sera pas du luxe de nous rafraîchir un peu.
Personne ne répondit. La sueur ruisselait de tous les visages. Il n’y avait pas un souffle dans l’air, et l’on entendait dans le lointain les coassements de la grenouille-taureau, qui pullule dans ces parages.
Pendant qu’on absorbait avidement les boissons glacées, le train s’était engagé dans une plaine verdoyante, que coupaient des haies basses de mimosas et d’eucalyptus nains. C’étaient là les cultures dont avait parlé Mr. Bombridge.
Les Noirs, armés de longues faux, coupaient le fourrage nécessaire aux escargots. Ils saluaient respectueusement le train au passage, en ôtant leurs immenses chapeaux de rotin tressé.
Le train avait encore augmenté sa vitesse. Les cultures qui couvraient plusieurs centaines d’hectares furent dépassées. L’on se retrouva de nouveau au milieu d’un paysage nu et désolé. Jupiter, sans attendre l’ordre de son maître, avait brusquement fermé les glaces des portières, et il aspergeait le sol avec un antiseptique, d’une odeur fortement aromatique. Le train filait, cette fois, avec la rapidité d’un express.
– Pourquoi toutes ces précautions ? demanda lord Burydan un peu surpris.
– C’est que les vapeurs qui s’exhalent de ces marécages sont mortelles ! Celui qui s’y aventurerait sans précaution, surtout à la tombée de la nuit, serait sûr de mourir d’une fièvre maligne en quelques heures… Les nègres seuls, surtout quand ils ont été guéris une première fois de la fièvre jaune, peuvent résister à cette atmosphère méphitique.
Il montra du doigt les marais semés de larges flaques d’eau, et au-delà desquels on commençait à apercevoir la mer qui barrait l’horizon comme un ruban de couleur livide.
– Voyez-vous ces fumées jaunâtres, continua Mr. Bombridge, et ce brouillard gris qui, presque à ras de terre, semble agité d’un fourmillement perpétuel ? Ce brouillard est constitué par des millions de moustiques ! Ces fumées sont les exhalations délétères qui montent de la pourriture ! Il y a là des endroits où les Noirs eux-mêmes ne pourraient vivre, et où un homme blanc serait incapable de séjourner, même une seule minute, sans en mourir !
– Est-ce que vous n’exagérez pas un peu ? demanda Oscar. Il me semble bien apercevoir là-bas, tout près de la mer, quelque chose qui ressemble à un village, au milieu duquel se dresse la tour d’un clocher. Si le pays était aussi malsain, on n’aurait pas eu l’idée d’y construire une église !
– C’est bien une église. Mais, ne vous l’ai-je pas dit tantôt ? elle est abandonnée depuis près d’un siècle, et tous les habitants du village sont morts ou se sont enfuis ! Les nègres n’oseraient approcher de ce clocher, même en plein jour, et ils l’appellent « la tour fiévreuse ». Il s’y passe, d’après eux, des choses extraordinaires.
Tous regardèrent curieusement l’église en ruine, dont la tour carrée, d’une couleur brune comme recuite par le soleil, se profilait sur le ciel blafard avec quelque chose de lugubre et de menaçant.
– Singulier pays ! murmura lord Burydan. Il faudra bien, pourtant, que je voie de près cette tour fiévreuse.
Le vieux Noir, à ces mots, eut un geste de terreur. Son teint devint d’un blanc grisâtre – ce qui est, pour les nègres, la façon de pâlir – et ses gros yeux blancs et protubérants roulèrent comme s’ils allaient jaillir de leurs orbites.
Il prononça quelques phrases dans un jargon moitié espagnol moitié anglais, dont lord Burydan ne saisit que quelques mots.
– Que veut dire ce Noir ? demanda-t-il à miss Bombridge.
La jeune fille sourit.
– Ce brave Jupiter, répondit-elle, est effrayé à la seule idée que vous voulez aller à la tour fiévreuse. Il dit que pas un Noir, à dix lieues à la ronde, n’oserait vous servir de guide.
– Évidemment, ce ne doit pas être un endroit très sain. Pourtant, en prenant certaines précautions…
– Ce n’est pas seulement pour leur santé que tremblent les Noirs. Ils ont peur des mauvais esprits qui hantent la tour. Vous en trouverez qui prétendent avoir vu le démon de la fièvre jaune lui-même.
– Je serais curieux de savoir comment il est fait…
– Je puis vous en donner, toujours d’après Jupiter, une description exacte. Il ressemble à une énorme araignée ; sa tête a la grosseur de celle d’un taureau et ne fait qu’un avec le corps. De plus, elle a l’expression d’une face humaine hideuse ou plutôt d’une tête de mort, qui aurait de larges prunelles liquides et phosphorescentes comme celles des pieuvres. Deux trous sont à la place du nez et il a une bouche fendue jusqu’aux oreilles, garnie de petites dents aiguës. Cette tête horrible est d’un rouge sang et hérissée de piquants comme la carapace d’un crabe de marais. Il possède de chaque côté six pattes, d’une belle couleur vert clair, et qui se terminent par des suçoirs. Ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que ses prunelles sont d’un bleu clair et d’une douceur enfantine.
– Voilà un monstre bien fantastique ! dit Oscar à son tour. Savez-vous quelles sont ses habitudes, puisque vous paraissez si bien informée ?
– Le jour, il se tient tapi au fond de la vase fétide des marais. La nuit, il rôde et, s’il rencontre un nègre endormi, il lui pompe tout le sang avec ses suçoirs. Le lendemain, on trouve le nègre mort de la fièvre jaune.
« On dit aussi qu’il habite parfois les cryptes humides de l’église. Quand il doit y avoir une épidémie de fièvre dans le pays, il l’annonce en faisant tinter la cloche qui est demeurée à sa place dans la tour.
– Et l’on a quelquefois entendu cette cloche ? demanda Oscar impressionné, malgré lui, par ce récit.
– Jupiter prétend l’avoir entendue deux fois. La première fois, il serait mort dix mille personnes et, la seconde, quinze mille.
« Les Noirs racontent encore que les jésuites espagnols ont essayé d’exorciser cet étrange démon ; mais c’est lui qui a eu le dessus dans la lutte. Ils sont tous morts de la fièvre.
« Il est certain, conclut la jeune fille, que, pour mon compte, je n’aimerais pas entendre sonner la cloche de la tour fiévreuse.
Il y eut un moment de silence. Pendant le récit de la jeune fille, des nuages couleur de suie et de soufre avaient peu à peu envahi toute l’étendue du ciel. Un brouillard d’une odeur fétide avait complètement submergé les marécages. On n’apercevait plus la tour fiévreuse.
L’atmosphère était devenue étouffante. On eût dit l’haleine ardente qui s’échappe de la gueule d’un four. Malgré le soin qu’avait Jupiter d’arroser continuellement le plancher du wagon, tous haletaient, la gorge sèche, le cœur serré par cette sorte d’angoisse physique qui saisit même les animaux à l’approche de l’orage dans les contrées tropicales.
– Heureusement, s’écria Bombridge avec un soupir de soulagement, que, dans cinq minutes, nous allons nous trouver dans une belle forêt de pins où l’air est pur, aromatique et salubre ; dans un quart d’heure nous serons à la maison d’où nous pourrons braver la fièvre et la tempête !
Comme en réponse à cette phrase rassurante, il y eut un sourd grondement de tonnerre, des gerbes d’éclairs d’un vert aveuglant s’éparpillèrent aux quatre coins du ciel comme les boîtes d’un gigantesque feu d’artifice ; le soleil lança d’entre deux nuages un dernier et macabre rayon blanchâtre puis disparut complètement ; la pluie s’était mise à tomber, non pas par gouttes plus ou moins larges, mais par seaux, par jets de la grosseur du poignet ; ce n’était plus une averse, c’était un déluge.
Au mugissement de ces montagnes d’eau qui dévalaient en torrents le long des pentes, se mêlaient les grondements affaiblis du tonnerre et le sifflement du vent fouettant les grands roseaux et les arbres de la forêt.
Puis, comme il arrive dans ces brusques ouragans, il y eut une accalmie et, pendant quelques minutes, ce fut presque le silence.
C’est alors qu’avec une épouvante qu’ils ne purent dissimuler lord Burydan et ses amis entendirent distinctement le son lointain d’une cloche.
Jupiter claquait des dents, ses cheveux s’étaient hérissés sur sa tête.
– La cloche de la tour fiévreuse, balbutia-t-il en tremblant de tous ses membres.
– Oui, c’est bien elle ! murmura Bombridge d’une voix mal assurée. Il n’y a pas d’autre cloche à vingt milles à la ronde.
– Vous êtes sûr de ne pas vous tromper ? fit lord Burydan.
– Non, répondit l’ex-clown d’un ton brusque.
De nouveau le silence régna dans le wagon, qui fuyait maintenant en pleines ténèbres sous les épais ombrages de la forêt de pins.
Ainsi qu’il arrive sous les tropiques, la nuit avait succédé au jour en quelques minutes. On était maintenant dans l’obscurité la plus profonde.
Le voyage se termina tristement, et ce fut avec un véritable sentiment de bonheur qu’en mettant pied à terre tous aperçurent la façade de la maison, joyeusement éclairée, et où déjà les Noirs s’affairaient pour les préparatifs du dîner.
Ce repas fut beaucoup moins gai que celui du matin.
Mr. Bombridge eût rougi de partager les superstitions ridicules du vieux Jupiter. Néanmoins, il ne pouvait s’empêcher de penser que, depuis trois semaines, les cas de fièvre jaune avaient été d’une fréquence inaccoutumée parmi ses Noirs ; et il croyait toujours entendre bourdonner à ses oreilles le son de la fatale cloche.
Cependant, après le repas, il y eut une recrudescence de bonne humeur et d’entrain parmi les convives. La tempête s’était apaisée aussi rapidement qu’elle s’était déchaînée : l’atmosphère, purifiée par la pluie, était d’une fraîcheur délicieuse ; les fleurs et les feuillages exhalaient leur odeur embaumante et il montait de la terre cette senteur puissante qui s’en dégage après les orages.
Les nerfs détendus avaient aussi retrouvé leur calme, et personne n’éprouvait plus ce bizarre serrement de cœur, cette angoisse physique dont ils avaient tant souffert.
Mr. Bombridge proposa d’aller prendre le frais sur la terrasse qui dominait la maison. Tout le monde accepta avec enthousiasme et l’on put admirer le magnifique paysage, éclairé par les rayons de la lune.
À l’horizon, on apercevait le feu rouge du phare situé à l’entrée de la rivière, tout au fond du golfe d’Oyster Bay, et qui ressemblait à une étoile tout près de tomber dans la mer.
Lord Burydan contempla longtemps et en silence cette flamme lointaine. Il ne fit part à personne de ses réflexions, et bientôt tous les invités de Mr. Bombridge se retirèrent dans leur chambre pour y goûter un repos bien mérité.
CHAPITRE III
L’étoile rouge
Trois semaines environ avant l’arrivée de lord Burydan en Floride, un sloop de cabotage était venu, par une nuit sans lune, jeter l’ancre dans le golfe d’Oyster Bay.
De ce sloop s’était détachée une embarcation menée par quatre vigoureux rameurs noirs. Et dans le plus grand mystère, ils avaient débarqué, juste en face de la tour fiévreuse, trois personnes et plusieurs grandes caisses carrées. Puis l’embarcation avait regagné le bord ; le sloop avait levé l’ancre et avait repris la mer, sans avoir été vu d’aucun des rares bâtiments de cette côte inhospitalière.
De ce côté, le rivage était bordé de grands palétuviers, dont les racines, plongeant dans la vase, étaient chargées de grappes d’huîtres. Ces racines, enchevêtrées et tordues, formaient de profondes cavernes qui servaient d’asile à de gros crabes de terre, à des reptiles de tout genre, enfin à une foule d’animaux nuisibles.
Ce rempart de palétuviers n’avait pas été franchi sans peine par les trois voyageurs, encore embarrassés de leurs bagages. À chaque pas, ils glissaient sur les racines et s’enfonçaient dans la boue, ou bien ils se déchiraient les mains aux coquillages.
Leur arrivée dérangeait tout un monde de bêtes grouillantes.
– Brrr ! dit un des trois personnages, il me semble que j’ai mis la main sur un crapaud !
– Tu dois t’être trompé, répondit son compagnon. Je crois plutôt que c’est sur un serpent ; il n’y a pas de crapauds si près de la mer.
– Joli pays que cette Floride, dont tu m’avais dit tant de merveilles ! Je me demande un peu ce que nous allons faire là ?
– Cela ne te regarde pas, répondit l’autre durement. Tu es ici pour obéir aux Lords de la Main Rouge et à moi, Slugh, qui les représente…
« Allons, dépêche-toi ! Dans quelques minutes nous serons sortis de ces maudits palétuviers et nous mettrons le pied sur la terre ferme.
Edward Edmond ne répondit pas, et, tout en maugréant, il continua d’avancer.
Quant à la troisième personne, une femme, ses compagnons avaient soin de la faire passer devant eux, comme s’ils eussent craint qu’elle ne cherchât à s’enfuir, et, chaque fois qu’elle s’arrêtait, Slugh lui appuyait sur la tempe le canon de son revolver.
– Marche donc, Dorypha ! lui disait-il, ou je te tue comme une chienne de gitane que tu es !
Dorypha ne répondait pas. Mais sa rage et son humiliation étaient à leur comble, et elle proférait mentalement les plus terribles serments.
Enfin, tous trois atteignirent un terrain plus solide. C’était la place, autrefois dallée de grandes pierres plates, qui s’étendait en face de l’église et que bordaient, à droite et à gauche, les masures délabrées, anciennes habitations des colons espagnols.
Slugh, ayant tiré de sa poche une petite lanterne électrique, s’orientait à travers les décombres.
– Qu’est-ce que nous faisons ? demanda Edward Edmond qui paraissait de fort méchante humeur.
– Je vais d’abord mettre la Dorypha en lieu sûr. Ensuite, nous retournerons chercher les caisses que j’ai été obligé de laisser au pied des palétuviers ; après, tu pourras te reposer tant que tu voudras.
« Plains-toi donc ! Nous n’aurons presque rien à faire pendant notre séjour ici. C’est une vraie villégiature !
– Merci de la villégiature ! Un pays où il n’y a que des bêtes venimeuses, où l’on crève comme des mouches de la fièvre et du vomito negro[7]. J’ai grand-hâte que nous en soyons partis.
– Poltron ! Tu sais bien que nous n’avons rien à craindre de la fièvre, moi, parce que je l’ai eue, et toi, parce qu’un des docteurs de la Main Rouge t’a vacciné avec un sérum spécial avant notre départ.
– Tu as beau dire, je ne suis pas rassuré.
Dorypha n’avait pas perdu un mot de cette conversation. Slugh s’aperçut qu’elle écoutait, et tout de suite sa colère éclata.
– As-tu fini de nous espionner ? lui dit-il. Marche devant moi, que je te conduise à la niche qui t’est destinée.
La gitane obéit en tremblant de fureur, et elle pénétra à l’intérieur de l’église.
La nef, assez vaste et construite dans le style espagnol du XVIIIe siècle, était lézardée en de nombreux endroits. La voûte, humide et blanchie de salpêtre, portait par endroits des traces de dorure.
Les rayons de la lanterne montrèrent dans un coin un tableau moisi qui représentait une Madone noire, preuve que les gens de couleur avaient été les fidèles les plus nombreux de cette église.
De longues mousses, auxquelles étaient mêlés plusieurs champignons vénéneux, d’un rouge éclatant, couvraient le pavé du sanctuaire.
Slugh, qui consultait de temps en temps un carnet graisseux, se dirigea du côté gauche de la nef et ouvrit une petite porte, dont les gonds grincèrent lamentablement dans le silence. La porte donnait accès à un escalier en colimaçon qui occupait à lui seul l’intérieur d’une tourelle accolée au bâtiment principal.
Slugh passa le premier, puis Dorypha, enfin Edward Edmond. La gitane se demandait avec angoisse si on ne l’avait pas emmenée dans cet endroit sinistre pour la précipiter du haut du clocher ?
En montant, elle se retourna pour jeter à Edward Edmond un regard si mélancolique et si suppliant que l’Irlandais, malgré toute sa haine, se sentit remué jusqu’au fond de l’âme.
La gitane était amaigrie par les privations et les mauvais traitements que lui avaient fait subir ses geôliers ; mais elle n’avait rien perdu de sa beauté. Son aspect avait pris seulement quelque chose de plus farouche. Les coins de sa bouche, comme tirés par la souffrance, donnaient à son visage une expression poignante à laquelle on ne pouvait rester indifférent. Ses prunelles brûlaient d’un feu sombre, au fond de leurs orbites creusées par les chagrins et par les larmes.
Slugh, après avoir monté trente-cinq marches, s’arrêta sur un palier qui donnait accès à une pièce carrée occupant tout le premier étage de la tour.
À l’étage d’au-dessus, c’était la cloche que l’on entrevoyait à travers les interstices de la charpente.
– Nous sommes arrivés, dit Slugh en consultant de nouveau son carnet.
Puis il alla, sans hésitation, à la muraille qui faisait face à l’entrée et au milieu de laquelle se dressait un gros clou rouillé.
Il appuya fortement sur le clou. Aussitôt, une porte s’ouvrit, montrant l’intérieur d’une chambre carrée, de huit à dix pieds de largeur. La surface extérieure de cette porte avait été si habilement recouverte de briques minces et de ciment que, si l’on n’était pas au courant du secret, il était impossible de la distinguer du reste de la muraille.
Extérieurement, cette cellule correspondait à une poivrière accrochée à l’un des angles du clocher.
On rencontre beaucoup de cachettes de ce genre dans les anciennes constructions espagnoles, et c’est ainsi que maintes fois, dans les premiers temps de la conquête, les missionnaires purent échapper pour ainsi dire miraculeusement aux poursuites des Indiens révoltés.
Slugh poussa brutalement la gitane dans la cellule et en referma la porte.
– Maintenant, dit-il à Edward Edmond, redescendons !… Tu vois que ton ex-maîtresse sera admirablement bien logée.
– Comment as-tu découvert cette cachette ? demanda l’Irlandais avec ébahissement.
– Je ne l’ai pas découverte. On me l’a indiquée. Cette région appartient presque entièrement à la Main Rouge. Il n’y a pas longtemps que la crypte était entièrement remplie de marchandises volées.
« Il n’y a pas d’endroit au monde où l’on coure moins de chance d’être dérangé. Les gens du pays ont une peur épouvantable des fièvres. Puis les Lords de la Main Rouge ont eu soin de répandre parmi les nègres certaines légendes effrayantes, qui font que pas un d’eux n’oserait approcher d’ici, même en plein jour.
Ils étaient, à ce moment, sur le palier où s’ouvrait une petite fenêtre carrée.
– Malgré tout, dit Edward Edmond, c’est un pays terriblement malsain.
Et, de la main, il montrait la lugubre étendue des marécages qui, dans les ténèbres de la nuit, rayonnaient d’une faible lueur bleuâtre due à tous les phosphores de la pourriture, tandis qu’en d’autres endroits des feux follets dansaient par centaines autour des mares.
L’Irlandais était superstitieux. Il se souvenait, comme il l’expliqua à Slugh, avoir entendu dire dans son enfance, que les feux follets étaient les âmes des trépassés.
– Si j’étais seul ici, conclut-il, je crois que j’aurais très peur.
Slugh – un esprit fort – ne fit que rire de ces terreurs.
– Imbécile ! dit-il. Tu ne sais donc pas que ces flammes errantes sont une espèce de gaz d’éclairage, ou quelque chose de semblable. Il ne faut vraiment pas grand-chose pour t’effrayer !
Tout en discutant ainsi, les deux bandits étaient redescendus dans l’intérieur de l’église. Puis ils revinrent à l’endroit où ils avaient laissé leurs caisses.
Ce ne fut pas sans peine qu’ils parvinrent à leur faire traverser le massif des palétuviers.
Edward Edmond se demandait si on n’allait pas être encore forcé de hisser ces lourds colis jusqu’au sommet de la tour.
Slugh le rassura.
– Il y a, expliqua-t-il, sous l’église même, une crypte très spacieuse dont l’entrée n’est pas facile à deviner. C’est là que nous déposerons nos bagages.
Il montra à l’Irlandais une des dalles du chœur au centre de laquelle se trouvait scellé un anneau.
Il alla chercher ensuite, derrière l’autel, un levier de fer dont il se servit pour soulever la dalle. Elle découvrit l’entrée d’un escalier qui aboutissait à une salle souterraine, bordée de tombeaux à droite et à gauche.
– Tu vois que la place ne manque pas, dit encore Slugh, et l’on pourrait laisser ici des marchandises pendant dix ans sans que personne s’avisât d’oser y toucher.
– Je me demande, fit l’Irlandais, pourquoi nous prenons toutes ces précautions. Si personne n’ose approcher d’ici, ce n’est pas la peine de tant nous gêner.
– Tu n’y vois pas plus loin que ton nez. Il est possible que d’ici peu de temps la police vienne faire une perquisition dans la tour et il est prudent de tout prévoir.
L’Irlandais aurait bien voulu poser d’autres questions, mais il comprit que Slugh n’était pas disposé à lui donner d’éclaircissements sur ses projets. Alors il se résigna à garder le silence.
Edward Edmond et Slugh lui-même commençaient à ressentir une certaine fatigue. Ils sortirent d’une caisse une boîte de viande conservée et une bouteille d’alcool.
Après avoir mangé de bon appétit, ils allèrent dormir au premier étage, et, pour cette nuit, se contentèrent de leurs manteaux en guise de matelas et d’oreillers.
Nul n’eût pu soupçonner que cette tour, soi-disant hantée par des démons et des revenants, avait maintenant des habitants en chair et en os.
Les jours suivants, l’existence s’organisa. Slugh et Edward Edmond cueillirent des brassées de joncs pour s’en faire des matelas. Ils déballèrent aussi une partie des provisions contenues dans les caisses.
Celles-ci renfermaient toutes les choses indispensables à la vie, voire même du tabac, du whisky, des armes et des munitions, des flacons de pharmacie.
Les deux gardiens de la Dorypha passaient toute leur journée à fumer, à dormir ou à pêcher le long de la grève, qui était très poissonneuse.
D’ailleurs, ils se portaient très bien, et cela, sans doute, grâce aux médicaments fébrifuges que, suivant les recommandations qui leur avaient été faites, ils avaient soin d’absorber chaque soir.
L’Irlandais se fût assez accommodé de cette existence de paresse s’il n’eût senti qu’un danger mystérieux planait autour de lui.
Slugh, lui, passait parfois toute la nuit au sommet de la tour, scrutant l’horizon avec inquiétude. D’autres fois, il dormait tranquillement sur son lit de jonc, sans que l’Irlandais pût s’exprimer le mobile de ses actions.
Slugh restait impénétrable.
Edward Edmond n’avait encore pu tirer de lui un seul renseignement sur le sort réservé à la gitane. En outre, à mesure que le temps s’écoulait, Slugh semblait redoubler de précautions.
Chaque matin, il exigeait que le lit de jonc fût éparpillé sur toute la surface de la pièce, de manière que, si quelqu’un survenait, il ne pût soupçonner que l’on avait couché dans cet endroit. Pour la même raison, sans doute, il défendait à l’Irlandais de laisser traîner dans la tour un objet quelconque qui pût déceler la présence d’un être humain.
C’est dans la crypte qu’ils prenaient tous leurs repas, et c’est là qu’ils trouvaient un abri pendant les heures chaudes de la journée.
L’Irlandais était intrigué au plus haut degré, car il découvrait chaque jour de nouveaux faits capables d’exciter sa curiosité.
Un matin, Slugh ouvrit une caisse, jusqu’alors demeurée intacte, et en tira plusieurs bocaux emplis d’un liquide incolore et soigneusement emballés. Il en prit un et s’en alla avec à travers le marécage. De loin, Edward Edmond le vit occupé à en répandre le contenu dans les mares stagnantes, puis il vint prendre un nouveau bocal ; et il en fut ainsi jusqu’à ce que tous les bocaux fussent vides.
Une autre fois, Slugh se décida à ouvrir la plus grande des caisses, mais il la referma presque aussitôt.
L’Irlandais n’eut que le temps d’entrevoir des rouages, des verres, des fils, organes démontés de quelque machine dont il ne devinait pas la destination.
Enfin, il y avait des jours où Slugh partait sans vouloir être accompagné et ne rentrait qu’à la nuit tombante, parfois même le lendemain matin.
Vainement l’Irlandais se livrait à mille suppositions. Il n’arrivait à rien découvrir.
*
* *
Pendant ce temps, Dorypha menait une existence des plus misérables. Le réduit où on l’avait jetée ne prenait jour que par une étroite ouverture carrée. Encore était-il encombré de ces objets hétéroclites que l’on trouve dans le grenier de toutes les églises : chandeliers de bois rompus, chaises défoncées, et jusqu’à une statue sans bras de sainte Rose de Lima, à laquelle un coloris barbare prêtait, dans la pénombre, une apparence de vie. La gitane en avait presque peur.
Couchée sur une brassée de joncs, elle demeurait ainsi toute la journée, en proie au désespoir et à la tristesse. C’est à peine si elle touchait aux aliments que Slugh, sans un mot, lui apportait une fois par jour.
La pauvre danseuse attendait la mort. Elle eût bien voulu mourir, mais elle en était arrivée à cette période de dépression physique et morale où l’on n’a même plus le courage du suicide.
Rongée par l’ennui, elle en venait à se créer des distractions puériles, machinales, comme font les enfants et les vieillards.
Elle passait de longues heures à tresser les joncs desséchés dont se composait sa couche. Ainsi elle fabriqua une couronne à la statue de sainte Rose.
Un jour, elle eut la joie de découvrir, dans un coin, un vieux crucifix d’étain qui dormait, depuis plus d’un siècle, sous la poussière. Elle le nettoya, le fourbit, et l’attacha à la muraille.
Mais la grande consolation de Dorypha, c’était « son étoile ».
L’étroite meurtrière qui éclairait la cellule était placée si haut et tournée de telle façon que, même en se haussant, la gitane ne pouvait apercevoir qu’un coin de mer et un peu de la côte lointaine, mais, chaque soir, sur cette même côte, s’allumait un feu rouge, plus brillant qu’une étoile, et qui subsistait pendant toute la nuit.
Dorypha n’avait jamais pu deviner ce que c’était au juste que cette lumière. Mais elle la contemplait sans lassitude et elle attachait à sa présence une importance superstitieuse.
Les jours où le brouillard lui cachait son étoile, la gitane était plus triste, plus désespérée encore que de coutume, et, chaque soir, elle attendait avec impatience que la chère petite lueur jaillisse des vapeurs du crépuscule.
– La voilà ! Elle s’allume ! s’écriait-elle. Je ne suis donc pas encore tout à fait abandonnée !
Les yeux ardemment fixés vers l’étoile lointaine, elle se plongeait dans ses songeries où passaient en son imagination, comme les silhouettes fugaces d’un rêve, toutes les scènes de sa vie d’autrefois.
Dans cette monotone existence de recluse, il y avait certains jours qui étaient pour elle plus terribles à supporter. C’était quand il y avait de l’orage. Alors Dorypha ne pouvait dormir ; l’atmosphère de son étroite cellule devenait suffocante. Elle avait tôt fait de vider l’eau de la cruche que lui apportait Slugh très irrégulièrement, et elle se mourait de soif.
Une fois qu’un de ces formidables orages des tropiques s’était déchaîné, battant les murs de la vieille tour de ses trombes de pluie, lançant les vagues furieuses par-dessus le rempart des palétuviers, la gitane était demeurée sur son misérable lit, en proie à un immense accablement. Elle espérait que la nuit serait plus paisible et qu’elle pourrait, enfin, reposer un peu. Ses nerfs, encore exaspérés par les privations et la maladie, étaient tendus à se briser. Elle tressaillait au moindre bruit, aspirant avec une volupté maladive le parfum des fleurs empoisonnées du grand marécage, que lui apportait le vent.
La nuit allait venir, et la rafale ne perdait rien de sa violence.
– Mon étoile rouge ! s’écria tout à coup Dorypha. Il faut que je la voie s’allumer !…
Nerveusement, elle avait bondi et s’était haussée jusqu’à ce que ses yeux fussent au niveau de la meurtrière.
Presque aussitôt, la lueur jaillit des ténèbres, un peu plus faible que de coutume, mais visible encore à travers les hachures de l’averse, sous le ciel noir de nuages que déchiraient de temps en temps les éclairs.
– On dirait qu’elle m’a attendue ! murmura la gitane dont les yeux se mouillèrent de larmes.
Elle resta longtemps comme hypnotisée par cette lueur lointaine, cette fleur de feu qui semblait éclose pour elle au milieu de la tourmente.
Elle fut arrachée à sa contemplation par un bruit d’allées et venues inaccoutumées.
On montait et on descendait l’escalier précipitamment. Puis il y eut comme un heurt métallique dans les étages supérieurs de la tour. Enfin, des coups de marteau retentirent.
– Que peuvent-ils donc faire ? se demanda la gitane anxieusement.
Soudain, elle porta la main à ses yeux avec un cri de stupeur presque douloureuse.
Du sommet de la tour tombait une nappe de clarté rouge et crue, aveuglante. Il avait suffi de quelques rayons de cette clarté pénétrant par les meurtrières pour forcer la gitane à fermer les yeux, où elle éprouvait à présent la sensation d’une cuisante brûlure.
– Je ne comprends rien à tout cela ! balbutia-t-elle. Je crois qu’ils finiront par me rendre folle. Ils auraient mieux fait de me tuer d’un seul coup, en même temps que mon mari !
Dorypha avait petit à petit ouvert les yeux. Ses prunelles s’étaient lentement accoutumées à la lumière.
Renonçant à comprendre ce qui se passait, elle se contentait de contempler l’étoile rouge.
Brusquement, elle jeta un cri : l’étoile rouge avait disparu !
Dorypha attendit deux longues heures. Son regard avide scrutait vainement les profondeurs de la nuit et les ténèbres plus épaisses, en dehors du cercle d’inexplicable clarté qui environnait la tour.
Au bout de quelque temps, la fulgurante auréole s’éteignit aussi soudainement qu’elle s’était allumée.
Dorypha se retrouvait dans la profonde obscurité de son cachot. Elle se haussa vers la meurtrière. Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées qu’à sa profonde surprise l’étoile rouge scintilla de nouveau et, cette fois, pour ne plus s’éteindre qu’au jour.
C’était à n’y rien comprendre.
Le lendemain, la gitane attendit avec une fiévreuse curiosité que le coucher du soleil fût venu.
Cette nuit-là ni les suivantes, l’étoile ne subit d’éclipse. D’autre part, la mystérieuse lumière dont la tour avait été illuminée pendant deux heures ne se ralluma plus.
Y avait-il corrélation entre les deux faits ? Dorypha n’essaya même pas de chercher à s’en rendre compte.
Elle eût peut-être oublié même cet incident inexplicable, en arrivant presque à le regarder comme une hallucination, lorsque, la semaine d’après, le même fait se reproduisit dans des circonstances identiques.
La gitane entendit comme la première fois un grand remue-ménage dans l’escalier de la tour. Le clocher s’illumina, et l’étoile rouge disparut. Sa disparition dura plus de trois heures.
Le même fait se renouvela quelques jours après pour la troisième fois.
Dorypha en vint à penser que c’était sans doute chaque semaine que se produisait ce bizarre événement. Aussi, maintenant qu’elle l’attendait à peu près à date fixe, il n’était même plus, pour la captive, une source de distractions.
Son existence reprit son cours monotone, sans être de quelque temps troublé par aucun incident.
*
* *
Le jour même où Mr. Bombridge faisait visiter son exploitation à ses amis, Edward Edmond et Slugh fumaient philosophiquement leur pipe, assis sur le chapiteau d’une colonne renversée. Tous deux étaient silencieux. Slugh par habitude, l’Irlandais par nécessité, car son compagnon n’avait jusqu’ici répondu que par des monosyllabes à toutes les tentatives qu’il avait faites pour entrer en conversation.
Slugh, depuis un instant, observait attentivement le ciel livide et la mer blanchissante au-delà des récifs.
– Je vais faire un tour, dit-il.
– Veux-tu que je t’accompagne ?
– Inutile.
– Quand reviendras-tu ?
– Je ne sais pas !
– All right ! Alors, au revoir ! bon voyage !
L’Irlandais se mit à siffloter entre ses dents pour cacher son dépit, pendant que Slugh se dirigeait nonchalamment du côté de la grève aux palétuviers.
Edward Edmond le suivit longtemps des yeux. Quand, enfin, il l’eut vu disparaître, il donna libre cours à sa mauvaise humeur.
– J’en ai assez de cette vie ! s’écria-t-il. Je m’ennuie à périr. Il me faut obéir, comme un valet, à tout ce que commande ce vieux coquin, sans même savoir quels sont ses projets !…
« Aussi, pourquoi ai-je fait la sottise de redevenir moi-même l’esclave de la Main Rouge ? J’ai des dollars dans les poches, c’est vrai, mais je suis plus malheureux que quand je n’étais qu’un simple tramp errant par les grands chemins.
Edward Edmond regarda autour de lui comme pour chercher une bonne idée.
Soudain sa physionomie s’éclaira. Il se frotta les mains en homme qui vient de faire une découverte intéressante.
Il glissa dans sa poche une bouteille de whisky à moitié pleine et se dirigea lentement vers l’église.
Arrivé dans la nef, il alla droit à l’escalier de la tour et le gravit jusqu’au palier du premier étage. Là, il s’arrêta et, se penchant par une des meurtrières, il regarda du côté de la grève. Très loin, il distingua Slugh, qui, à cause de l’éloignement, ne paraissait pas maintenant plus gros qu’un pygmée.
Rassuré par la certitude que son tyran était réellement parti, Edward Edmond alla délibérément à la porte secrète, poussa le clou qui en commandait la fermeture et se trouva en présence de Dorypha, tristement étendue sur les joncs qui lui servaient de lit.
Il ne put s’empêcher d’être ému de l’état lamentable où se trouvait la gitane, dont le visage était amaigri et dont les cheveux blonds retombaient en désordre sur ses épaules.
Tous deux se regardèrent quelque temps en silence. Edward Edmond ne savait comment entamer la conversation, et Dorypha était trop fière pour parler la première. Enfin, l’Irlandais s’enhardit.
– Bonjour, Dorypha ! dit-il. Je suis venu t’apporter un peu de whisky en profitant de ce que Slugh n’était pas là…
– Tu trouves que je ne meurs pas assez vite ? répéta-t-elle amèrement.
– As-tu peur que mon whisky soit empoisonné ? Tiens, regarde !
Et il but une copieuse rasade à même la bouteille.
L’œil de la gitane étincela soudainement. Une idée venait de germer dans son esprit. Sa physionomie abattue et morne se fit tout à coup presque souriante.
– Eh bien, donne ! dit-elle. Je suis trop malheureuse pour avoir le droit d’être fière.
Elle but à son tour. Il lui sembla que la brûlante liqueur faisait descendre en elle une énergie surhumaine.
– Cela vaut mieux que la cruche d’eau de Slugh, fit-elle avec un faible sourire. C’est à lui surtout que j’en veux… Toi…
– Moi, je suis obligé d’obéir à la Main Rouge. D’ailleurs, j’ai bien le droit de t’en vouloir… N’as-tu pas essayé de me tuer ?…
– Ne revenons pas sur le passé, dit la gitane avec une simplicité qui ne manquait pas de noblesse. Tout cela est bien loin de nous. Soyons de bons camarades, comme autrefois… Ne trouves-tu pas indigne la façon dont je suis traitée ?
L’Irlandais avait brusquement oublié toutes ses rancunes. Il se sentait reconquis par cette voix aux caressantes inflexions.
– Je ferai ce que je pourrai pour t’être utile ! balbutia-t-il.
– Tu dis cela ! Mais je suis sûre, moi, que l’on ne m’a amenée dans cette tour maudite que pour m’assassiner impunément. Le premier jour que nous sommes arrivés ici, je t’ai entendu dire que tout le monde y mourait de la fièvre jaune.
– C’est vrai, fit Edward Edmond en baissant la tête.
– Seulement, dit la gitane avec un éclat de rire ironique, ce que Slugh ne sait pas, c’est que, moi aussi, je l’ai eue, la fièvre jaune, quand j’étais à La Havane.
La conversation continua encore un certain temps sur ce ton. La bouteille de whisky était vide depuis longtemps, et Dorypha avait intentionnellement poussé l’Irlandais à en boire la plus grande part.
Ni l’un ni l’autre ne faisaient attention à l’orage qui peu à peu montait dans le ciel. Ce fut la gitane qui s’en aperçut la première.
– J’étouffe dans cette cellule ! dit-elle. Si tu étais gentil, tu me laisserais sortir un peu pour me dégourdir les jambes.
– Impossible ! Si Slugh venait à le savoir, il me brûlerait la cervelle sans le moindre scrupule, puis, si je t’accordais ce que tu me demandes, tu chercherais à t’échapper.
– Non, je te le promets ! Laisse-moi monter seulement jusqu’au haut du clocher que je puisse respirer un peu !
Après de longs pourparlers, l’Irlandais finit par consentir. Tous deux montèrent jusqu’à la galerie circulaire qui se trouvait au-dessus de la chambre des cloches.
Edward Edmond avait eu l’idée de prendre sa longue-vue, et il s’amusait à regarder les divers aspects du marécage lorsque, subitement, il poussa un cri de surprise et de frayeur.
– Qu’y a-t-il donc ? demanda la gitane.
– J’aperçois Slugh tout là-bas. Il sera ici avant une heure.
– Eh bien ?
– Il faut que tu rentres dans ta prison. D’ailleurs, il y a un orage qui se prépare ; il tombe déjà des gouttes de pluie…
– Eh bien, soit ! répondit-elle docilement. Je vais descendre, mais, au moins, promets-moi de revenir me voir.
– C’est entendu.
Ils redescendirent jusqu’à l’étage inférieur. En passant devant la cloche, Dorypha demanda à la regarder de plus près. L’Irlandais y consentit et il s’aventura le premier sur la charpente à claire-voie.
Dorypha le suivit. Comme ils étaient arrivés à moitié de cette périlleuse traversée, la gitane eut tout à coup un rire bref et, d’un croc-en-jambes, elle fit perdre l’équilibre à l’Irlandais qui disparut par une des ouvertures béantes et alla rouler, meurtri et contusionné, sur la litière de jonc qui recouvrait, heureusement pour lui, le plancher de la chambre située au-dessous.
– Coquine ! s’écria-t-il.
Il essaya de se relever, mais ne put y parvenir, il crut avoir les reins cassés.
Sans s’occuper de lui, la gitane avait saisi la corde de la cloche et elle s’était mise à sonner avec une énergie désespérée.
La nuit était venue brusquement, la tempête faisait rage sur la campagne. Dorypha sonnait toujours. Le son grave du bronze se mêlait au grondement de la foudre.
– Quelqu’un viendra peut-être, pensait-elle. Je sais que ce pays est habité…
Elle continua de sonner jusqu’à ce qu’elle fût à bout de forces, puis tout à coup une autre idée s’empara d’elle. Malgré ce que l’Irlandais lui avait dit de l’impossibilité de traverser le marécage, elle crut qu’elle pourrait peut-être y réussir. Il faisait nuit : elle trouverait bien une cachette où ni Slugh ni Edward Edmond ne pourraient la découvrir.
Elle se précipita dans l’escalier qu’elle descendit quatre à quatre ; mais comme elle allait franchir le seuil de l’église, elle se trouva juste en face de Slugh.
– Ah ! ah ! ricana le bandit, il paraît que nous voulions nous échapper ! Mais je suis là, heureusement !
Tout en parlant, il s’était précipité sur la gitane et l’avait saisie à la gorge avant qu’elle ait eu le temps de se mettre en défense.
En un clin d’œil il la terrassa et il lui lia solidement les pieds et les mains.
Alors, seulement, il eut l’idée de savoir ce qu’était devenu l’Irlandais. Il n’eut pas de peine à le trouver, geignant et mal en point, dans la chambre du premier.
– C’est toi qui as sonné la cloche ? lui demanda-t-il d’une voix terrible.
– Non, je le jure !
– Alors, c’est toi qui as ouvert la porte à la gitane ?
– C’est vrai. Mais j’en suis cruellement puni !
Et il raconta les choses telles qu’elles s’étaient passées.
– C’est bon, dit Slugh. Passe pour une fois. Mais n’y reviens plus ! D’ailleurs, je vais m’arranger de façon à ce que cette sorcière ne nous cause plus aucun ennui du même genre. Sais-tu que son idée de sonner la cloche aurait pu nous mettre en grand danger. Heureusement qu’il fait un tel temps que personne, je l’espère, ne l’aura entendue.
Slugh aida l’Irlandais à se relever. Il le palpa, s’assura qu’il n’avait rien de cassé, et, finalement, lui frictionna les reins avec du whisky.
Ensuite, il redescendit et revint avec la gitane, toujours garrottée, qu’il avait transportée sur son dos et qu’il déposa, sans mot dire, dans son ancienne prison.
– Je vais maintenant, dit-il à l’Irlandais, sortir de nouveau. J’espère que, cette fois, il ne te viendra pas à l’idée d’ouvrir la cage de la Dorypha.
Il partit, sans attendre la réponse du blessé, et il ne revint que deux heures après. Il pliait sous le poids d’un sac volumineux.
– Qu’est-ce cela ? demanda l’Irlandais.
– C’est de quoi consolider la prison de la gitane. Je trouve que cette porte en imitation de pierre n’est pas assez sûre. C’est de vrais moellons que je vais y mettre… Mais nous verrons cela demain. Aujourd’hui je suis fatigué, je vais dormir.
L’Irlandais n’avait pas très bien compris ce que Slugh voulait. Aussi, un quart d’heure plus tard, pendant le repas, lui demanda-t-il s’il avait porté à manger à la gitane.
– Non, répondit froidement le bandit. Ce n’est pas la peine. Elle n’en a plus besoin.
– Que veux-tu dire ?
– Tu ne t’es donc pas rendu compte de mon projet ? Le sac que j’ai apporté est rempli de ciment. Je veux tout simplement murer la Dorypha dans son trou. Comme cela, elle ne nous ennuiera plus !
– Mais que diront les Lords de la Main Rouge ? balbutia l’Irlandais dont le sang se glaçait d’épouvante.
– Ce qu’ils diront, cela me regarde seul ! Ce n’est pas ton affaire !
La conversation en resta là. L’Irlandais ne pouvait se figurer que Slugh mît son horrible projet à exécution. En cela, il se trompait. Slugh avait pour principe de réaliser tout ce qu’il avait une fois nettement décidé.
Le lendemain matin, il se mit à l’œuvre et transporta jusqu’à la chambre du premier des pierres de taille bien équarries qui se trouvaient en grand nombre dans les ruines ; puis il descella les gonds de la porte et, sous les yeux de la gitane et de l’Irlandais, presque aussi épouvantés l’un que l’autre, il commença à poser les premières assises du mur.
Pour que la maçonnerie nouvelle qu’il édifiait ne se distinguât pas de l’ancienne par sa couleur, il poussa la précaution jusqu’à mêler de la suie au ciment dont il se servait.
Le travail avançait rapidement. À midi, il ne lui restait plus à poser qu’un dernier rang de pierres.
CHAPITRE IV
Le crucifix d’étain
C’est en qualité de jockey que Mr. Ezéchias Palmers, fils d’un honorable clergyman de l’État de New Jersey, avait débuté dans l’existence, laissant inachevées les études théologiques qu’il avait entreprises sous l’égide paternelle.
Un subit embonpoint le força de renoncer aux hippodromes, et il eut la chance d’obtenir la place de directeur d’une maison d’aliénés, d’un Lunatic-Asylum, ne gardant de son premier métier qu’une aptitude remarquable à perdre son argent aux courses.
Mr. Palmers se lassa bien vite de la société des fous, qui, d’ailleurs, lui jouèrent une foule de mauvais tours, et il quitta le Lunatic-Asylum pour installer, grâce aux capitaux de commanditaires bénévoles, un Institut spiritualiste où les personnes frappées par la mort dans leurs affections pouvaient à volonté voir apparaître leurs chers défunts, ou même converser avec eux.
Les clients de Mr. Palmers se déclaraient très satisfaits. Les matérialisations ne laissaient rien à désirer : l’or affluait dans les caisses de l’ingénieux spirite, lorsque la police de New York découvrit, par hasard, que les âmes évoquées étaient représentées par de jeunes dames dont les appas n’avaient rien d’immatériel et dont les mœurs étaient déplorables, surtout pour de purs esprits.
L’Institut Spiritualiste fut fermé par ordre de l’autorité supérieure. Mr. Palmers connut alors de mauvais jours. Il avait dépensé jusqu’à son dernier dollar et en était à se demander, en arpentant mélancoliquement les rues de New York, quel était le moyen de suicide le plus rapide, le moins douloureux et le plus économique. Il finit par conclure qu’un plongeon dans l’Hudson réunissait parfaitement ces trois conditions.
Le résultat de cette méditation fut qu’il alla porter chez un armurier le superbe browning avec lequel il avait d’abord projeté de se brûler la cervelle. Il revint avec quatre dollars, ce qui lui rendit à l’instant même toute sa bonne humeur.
Il était, ce jour-là, décidément en veine. En sortant de chez l’armurier, il aperçut un groupe de femmes, jeunes et vieilles, qui stationnaient autour de l’échoppe d’un cordonnier, en plein vent. Il s’approcha, poussé par la curiosité, et, tout de suite, son attention fut éveillée par ces paroles étranges :
– Cette jeune fille use du talon, donc elle est brune, tendre et fidèle.
Il y avait, dans cette simple phrase, toute une révélation.
Le hasard bienveillant avait poussé Mr. Palmers jusqu’à la boutique d’un « podomancien ».
La podomancie, comme chacun sait, est l’art de deviner le caractère des gens, et même leur avenir, d’après les manières dont ils usent leurs chaussures. Au bout d’une heure, Mr. Palmers savait que, si les brunes usent du talon et sont fidèles, les blondes usent de la pointe et sont volages, que les hommes de robe et les gens rusés usent les contreforts intérieurs, les prodigues et les étourdis les contreforts extérieurs ; et une foule d’autres notions de la même force.
Éperdu de joie, Mr. Palmers courut, tout d’une traite, jusqu’au bureau d’un journal, et, avec le peu d’argent qu’il possédait, fit insérer une annonce ainsi conçue :
Voulez-vous connaître :
VOS QUALITÉS, VOS DÉFAUTS, VOTRE AVENIR ?
Laissez de côté les charlatans et les farceurs !
Soyez pratiques !
Faites appel aux Sciences exactes et consultez
le fameux JAMES ROLLAN
le plus grand podomancien de toute l’Amérique.
Il suffit de lui envoyer une paire de chaussures ayant servi, mais non usées, pour connaître le secret de sa destinée par retour du courrier.
Dis-moi comment tu marches,
Et je te dirai qui tu es !
N. B. – Il ne sera pas fait de réponse aux personnes qui expédieraient des chaussures en mauvais état.
Mr. Palmers avait eu une idée géniale. Le lendemain du jour où il avait inséré cette annonce, il reçut une avalanche de chaussures de tout genre, mais celles des dames étaient en majorité.
Sans perdre de temps, il rédigea quatre notices qui, reproduites à un grand nombre d’exemplaires, devaient convenir à tous les cas possibles et imaginables. Elles étaient conçues dans un style si vague que chacun était forcé d’y trouver quelque chose de vrai.
Huit jours après, il était obligé de prendre trois employés pour classer son innombrable correspondance et il possédait un vaste hangar entièrement rempli de chaussures.
D’autres auraient vendu à vil prix cette marchandise. Mr. Palmers avait trop le génie des affaires pour commettre une pareille bévue. Il augmenta son personnel de trois maîtres savetiers et, avant que la fin du premier mois se fût écoulée, il inaugurait, à New York même, deux superbes magasins où d’excellentes chaussures étaient abandonnées au public à des prix d’un bon marché dérisoire.
Déjà le nom de James Rollan était presque célèbre. Le portrait du fameux podomancien s’étalait à la huitième page des journaux, encadré de réclames étourdissantes. Ses bureaux occupaient un vaste immeuble, et il dut installer des succursales à Chicago, à La Nouvelle-Orléans et à San Francisco.
Le succès allait croissant avec la rapidité de l’ouragan. Mr. Palmers fonda une Académie de pédicures, lança un emplâtre sans pareil contre les cors. Enfin, il mit le sceau à sa renommée en publiant, sous son pseudonyme de James Rollan, une brochure sur l’Esthétique rationnelle du pied qui eut un succès considérable.
Il ne manquait plus à son bonheur que de découvrir, parmi les plus riches et les plus belles héritières de l’Union, une compagne digne de lui. Pourtant, il ne se pressait pas, car il ne voulait faire son choix qu’en parfaite connaissance de cause. Il repoussa même, successivement, plusieurs partis fort avantageux.
C’est alors qu’à l’occasion d’un voyage d’affaires entrepris dans les États du Sud le hasard le mit en présence de Mr. et miss Bombridge, qui étaient montés dans le même wagon que lui.
Il fut charmé de la beauté et de la grâce de Régine, et, au bout d’un quart d’heure, il se jurait à lui-même qu’il n’aurait jamais d’autre femme qu’elle. C’était le coup de foudre !
Mr. Bombridge, sans se décider aussi rapidement, n’était pas hostile en principe à l’idée de donner sa fille à cet obligeant et correct gentleman, qui ne parlait que par millions de dollars et citait des chiffres d’affaires stupéfiants.
C’est ainsi que Mr. James Rollan, de même que Matalobos et Oscar Tournesol, fut invité à venir en Floride villégiaturer pendant une courte période, à la fin de laquelle Mr. Bombridge devait faire connaître sa décision définitive.
Mr. James Rollan était un homme si occupé que, malgré toute sa bonne volonté, il ne put arriver que deux jours après ses concurrents. D’ailleurs, il n’en fut pas moins bien accueilli, et il fut cérémonieusement présenté à ses rivaux, Oscar et le prestidigitateur, et aussi à lord Burydan.
Il semblait bien à l’excentrique que ce visage ne lui était pas inconnu, mais il ne se rappelait pas exactement où il avait pu le voir. Palmers, lui, reconnut du premier coup d’œil l’homme qui, à l’Institut spiritualiste, était venu lui demander de faire apparaître la dame aux scabieuses. Seulement, il pensa que son ancien client ne le reconnaîtrait pas sous son nom de James Rollan, et aussi à cause de certains changements qu’il avait fait subir à sa physionomie et à son costume.
Au lieu d’être complètement rasé comme autrefois, il portait une légère moustache et des favoris blonds qui lui donnaient l’aspect de quelque élégant diplomate austro-hongrois.
Mr. James Rollan fut parfaitement accueilli de Mr. Bombridge et de ses amis. Sa présence fit une heureuse diversion au mauvais temps qui n’avait cessé de régner depuis l’arrivée d’Oscar et de lord Burydan et qui empêchait les excursions les plus intéressantes dans le voisinage.
Le jour même de l’arrivée du célèbre podomancien, il y eut un orage épouvantable, et la petite société n’eut d’autre ressource que d’organiser une partie de bridge dans le grand salon de la villa, pendant que la pluie tambourinait à grand fracas le long des vitres closes et que le vent se lamentait dans les arbres de la forêt.
La soirée se termina de façon assez maussade et chacun se retira de bonne heure dans sa chambre.
Lord Burydan n’avait pas sommeil. Une fois seul, il essaya de lire ; mais il s’aperçut bientôt qu’il avait parcouru déjà deux ou trois feuillets sans en avoir compris un seul mot. Son esprit était ailleurs. Puis, quoique la fenêtre fût demeurée entrouverte, il faisait une chaleur insupportable.
Le jeune homme profita d’une accalmie pour monter fumer un cigare sur la terrasse. Le vent, trempé de pluie, rafraîchit son front brûlant, calma ses nerfs. Il se mit alors à marcher, à pas lents, en regardant distraitement le paysage.
Brusquement, il s’arrêta.
Le feu rouge du petit phare, qui brillait à l’entrée du golfe d’Oyster Bay, avait disparu. Une chose beaucoup plus surprenante, c’est qu’un autre feu, de la même couleur et d’une clarté plus intense, s’était allumé à une dizaine de miles, au nord.
Lord Burydan calcula approximativement que c’était à peu près dans cette direction que devait se trouver la tour fiévreuse.
Évidemment, il se passait quelque chose d’extraordinaire. Lord Burydan redescendit chercher un manteau imperméable – car la pluie s’était remise à tomber avec violence – et il demeura courageusement à son poste d’observation.
Il s’était figuré tout d’abord que, pour une raison quelconque, le phare avait été déplacé. Après examen, il reconnut qu’il se trompait.
Au bout d’une heure de faction sur la terrasse, lord Burydan vit le feu nouveau s’éteindre brusquement. Presque aussitôt le phare se ralluma.
L’excentrique comprit qu’il ne se produirait rien d’autre cette nuit-là. Aussi regagna-t-il sa chambre, très préoccupé.
Le lendemain matin, il faisait un temps superbe. Oscar Tournesol se leva de bonne heure et alla frapper à la porte de lord Burydan pour l’inviter à faire une promenade matinale. L’excentrique était déjà parti. Oscar apprit qu’il était sorti de la propriété déjà depuis une heure, en compagnie du vieux nègre Jupiter qu’il avait pris comme guide.
On l’attendit vainement pendant toute la matinée. Il ne revint qu’à midi, au moment où les hôtes de Mr. Bombridge allaient se mettre à table.
Il paraissait fatigué et mécontent. Il demanda la permission d’aller changer de vêtements, car il était couvert de boue des pieds à la tête. Quand il redescendit, ce fut à qui l’accablerait de questions.
– Vous allez, j’espère, nous raconter votre promenade ? dit le prestidigitateur.
– Vous auriez dû nous emmener ! ajouta Mr. James Rollan.
Comme lord Burydan ne répondait pas :
– Peut-être, dit miss Régine, en feignant d’être vexée, lord Burydan ne veut-il pas nous dire où il a été ! Il serait indiscret d’insister.
– Je n’ai aucune raison de vous cacher d’où je viens, répliqua l’excentrique. J’ai eu la fantaisie d’aller visiter la tour fiévreuse.
– Vous y avez été ?… Quelle imprudence ! s’écrièrent d’une même voix tous les convives.
– Rassurez-vous. J’avais pris mes précautions. Je dois à mon savant ami, M. Prosper Bondonnat, un fébrifuge inventé par lui, et grâce auquel on peut, du moins pendant quelques heures, demeurer dans les endroits les plus malsains… J’avoue que la précaution était loin d’être inutile. Je n’oubliai pas non plus de me couvrir la figure d’une moustiquaire et d’emporter avec moi une petite boîte de pharmacie…
– Les marécages sont-ils donc si terribles que cela ? demanda Oscar.
– Plus terribles encore qu’on ne le croit ! Sans parler des nuées de moustiques et d’insectes venimeux qui forment un nuage épais au-dessus des eaux croupies, ce marais est le refuge des reptiles les plus hideux que j’aie jamais vus ! À côté des inoffensives grenouilles-taureaux, on aperçoit des crapauds d’une prodigieuse grosseur, et ce fameux serpent-cercueil, d’un vert pâle et clair, qui donne la chasse à ses victimes comme un chien.
« Il y a certaines mares où pullulent des huîtres empoisonnées et de hideux crabes écarlates, qui s’ébattent autour des caïmans endormis que l’on prendrait pour des troncs d’arbre abattus.
« Dans les endroits où il pousse quelques arbres et où le sol est plus ferme, on rencontre des fourmis géantes, si nombreuses et si voraces qu’en une heure elles sont capables de réduire à l’état de squelette parfaitement nettoyé le cadavre d’un homme.
– Vous avez osé traverser tout cela ? demanda miss Régine en réprimant un frisson de dégoût.
– Je n’y ai pas eu grand mérite, puisque j’avais pour guide ce brave Jupiter qui connaît à fond le marécage et qui m’a fait passer par des sentiers relativement sûrs. Je n’ai fait, somme toute, que côtoyer d’assez loin toutes ces horreurs.
« Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que sur ces eaux pourries, dans ces fanges vénéneuses, s’épanouissent des fleurs d’un parfum admirable et d’une senteur capiteuse. Au milieu de ce pandémonium de reptiles éclatent des floraisons d’azur et de pourpre, des feuillages aux couleurs métalliques et chatoyantes. En certains endroits, l’eau noire se couvre d’un tapis de fleurs au-dessus desquelles on voit se dresser la tête plate des serpents.
« J’eus à traverser un buisson de grands mimosas qui exhalaient un entêtant parfum et qui écartaient de moi leurs branches avec un petit sifflement, car ce sont des arbustes doués de sensibilité et de nervosité presque comme des êtres humains.
« Ailleurs, au milieu des lianes de jalap aux corolles d’azur, de grands échassiers gris et roses se régalaient de serpents et de lézards, et s’envolaient avec un grand bruit d’ailes à notre approche. Puis, c’étaient d’immenses papillons couleur de soufre, des araignées grosses comme le poing, des chenilles de la taille de petits serpents.
« C’est à travers tout ce grouillement d’animaux plus ou moins suspects que je dus cheminer pendant trois heures, avant d’atteindre la tour fiévreuse. Quand j’en fus arrivé à une certaine distance, Jupiter refusa de m’accompagner plus loin, et il s’arrêta après m’avoir indiqué le chemin qui me restait à faire.
– Vous l’avez donc vue, cette sinistre tour ? demanda Mr. Bombridge. Je vous en fais tous mes compliments. Je n’aurais pas votre courage.
– N’exagérons rien. La tour fiévreuse et les ruines qui l’environnent sont bâties sur un plateau qui domine quelque peu le marais voisin, et l’air doit y être moins malsain, surtout à cause du voisinage de la mer.
« Je suis monté jusqu’au sommet de la tour. C’est une ruine, et une ruine abandonnée depuis longtemps. J’ai vu la cloche qui nous fit tant peur l’autre soir. Elle doit être ancienne, car elle est couverte d’armoiries et de devises latines.
« Pour ce qui est des sons que nous avons entendus, il n’est pas du tout impossible que, par une forte tempête, la cloche ne soit légèrement agitée par le vent. Il n’y a là rien de merveilleux.
– Avec votre manière d’expliquer les choses, dit miss Régine, vous me dépoétisez la légende de la tour fiévreuse ! Alors, il ne vous est rien arrivé de plus remarquable, au cours de toute cette expédition ?
– Non, murmura lord Burydan. J’ai même éprouvé une réelle déconvenue, car je croyais être sur la piste d’une découverte intéressante. Pourtant, j’allais oublier un fait assez bizarre. Comme je descendais l’escalier de la tour, j’ai cru distinguer des gémissements étouffés, je suis remonté, et je n’ai plus rien entendu. J’ai regardé partout et je n’ai rien vu. Il n’y a pas un endroit où quelqu’un puisse se cacher. J’en ai conclu que j’avais été victime d’une hallucination, ou que ces prétendus gémissements n’étaient qu’un de ces bourdonnements causés par l’écho que l’on entend souvent dans le voisinage immédiat des cloches.
Le narrateur fut soudainement interrompu dans son récit. Un Noir entra, disant qu’un homme demandait à parler à lord Burydan.
– Comment est cet homme ? répondit l’excentrique en se levant de table avec précipitation.
– Il a l’air d’un tramp, répondit le Noir tout étonné de l’empressement du lord.
À la porte, lord Burydan eut la surprise de se trouver en présence de Pierre Gilkin, le mari de Dorypha, qui, après avoir été laissé pour mort par les bandits de la Main Rouge, dans l’hacienda de San-Bernardino, avait dû passer de longs mois à l’hôpital de la station de Cucomongo, dans l’Arizona.
– Vous ici ! s’écria le lord stupéfait.
– Oui, murmura Gilkin dont les habits étaient couverts de boue et dont le visage pâle et défait, la taille un peu courbée annonçaient une immense fatigue. Dès que j’ai été capable de me tenir debout, je me suis mis à la recherche de Dorypha. J’ai couru par toutes les routes de l’Amérique, vêtu en vagabond et tâchant de lier connaissance avec tous les bandits que je rencontrais.
– Qu’avez-vous découvert ?
Gilkin, dont les mains tremblaient d’émotion, remit à lord Burydan un antique crucifix d’étain qu’il tira de dessous sa veste de toile.
– Voyez vous-même ! fit-il avec exaltation, voilà ce que j’ai trouvé tout à l’heure au pied de la tour fiévreuse !
Lord Burydan prit le crucifix et l’examina. Quelques mots y avaient été gravés d’une main maladroite, et l’inscription, à en juger par le brillant des caractères se détachant sur le métal plus terne, paraissait toute récente. Il déchiffra, non sans peine, cette phrase :
Je suis murée vivante dans la tour. Au secours ! Dorypha.
Au-dessous de la signature on avait ajouté, après coup, cette indication :
Premier étage.
Lord Burydan songea aux gémissements qu’il avait entendus et se sentit glacé d’horreur.
– Vous n’avez pas essayé de découvrir où elle est ? demanda-t-il à Gilkin.
– Je n’ai rien trouvé, murmura le mari de la gitane avec accablement. Puis, je ne suis pas encore bien guéri. J’ai la fièvre ! Ce n’est qu’à grand-peine que j’ai pu me traîner jusqu’ici, où je savais vous trouver, comme me l’avait appris une lettre de Mr. Fred Jorgell.
– Ne perdons pas une minute ! Nous allons aller en nombre à la tour fiévreuse. Dorypha sera délivrée !…
– Si toutefois il est temps encore ! murmura Pierre Gilkin d’une voix morne.
Lord Burydan se disposait à aller prévenir Oscar Tournesol, lorsqu’un Noir lui remit un télégramme. Le jeune homme le décacheta rapidement, le lut d’un coup d’œil, puis le fit disparaître dans sa poche en le froissant nerveusement.
– Qu’y a-t-il donc ? demanda Oscar, qui allait à la recherche de son ami.
– Un des navires de la Compagnie des paquebots Éclair a encore sombré cette nuit !
– C’est une vraie malchance !
– Il n’y a pas de malchance, il y a crime ! Mais je suis décidé à savoir la vérité, et je la connaîtrai aujourd’hui même ! Je vais de ce pas à la tour fiévreuse !
– En ce cas, je vous accompagne.
– Soit ! Mais préviens le vieux Jupiter que nous avons besoin de lui : seul il est capable de nous guider à travers le marais.
Mr. Bombridge fut mis au courant en quelques mots. Quelques minutes plus tard, lord Burydan, Oscar et Pierre Gilkin se mettaient en route pour la tour fiévreuse, escortés de quatre robustes Noirs armés de carabines et de revolvers.
Malgré l’état d’extrême faiblesse où il se trouvait, Pierre Gilkin avait insisté pour accompagner ses amis.
Mr. Palmers et le prestidigitateur s’excusèrent de ne pas suivre l’expédition, sous prétexte qu’ils étaient obligés de rester pour tenir compagnie à miss Régine. La vérité, c’est qu’ils n’avaient nulle envie de tenter la traversée des marécages maudits.
CHAPITRE V
La tour fiévreuse
Lorsque Slugh eut scellé la massive pierre qui bouchait la dernière ouverture de la muraille construite à la place de la porte de la cellule, Dorypha s’abandonna quelque temps au désespoir. Cette fois, elle était perdue, sans ressource. Nul ne viendrait à son secours, il ne lui restait plus qu’à mourir.
Elle regretta amèrement l’idée qu’elle avait eue de se mettre à sonner la cloche au lieu de s’enfuir le plus loin possible.
– Si j’avais mis à profit l’absence de Slugh, songeait-elle en frissonnant de rage et en se tordant dans les liens qui ensanglantaient ses chevilles et ses poignets, j’aurais pu atteindre le bord de la mer et je serais libre, au lieu que, maintenant, il ne me reste plus qu’à mourir de faim !
La gitane possédait heureusement un de ces tempéraments taillés pour la lutte et qui réagissent vigoureusement contre les choses, après avoir subi quelques moments de passagère dépression.
Il n’y avait pas un quart d’heure que la dernière pierre du mur avait été posée dans son alvéole que Dorypha s’était déjà mise au travail pour essayer de se débarrasser des cordes qui lui liaient les poignets.
Il ne fallait pas songer à les défaire, les nœuds en avaient été trop habilement et trop fortement serrés. Il ne restait plus à Dorypha qu’un moyen de s’en délivrer, c’était de les couper en les usant, petit à petit, contre la pierre.
La gitane choisit le granit le plus raboteux qu’elle pût découvrir le long des murailles de sa cellule, et elle se mit à l’œuvre. Mais la tâche était des plus pénibles. En limant la corde elle s’excoriait du même coup l’épiderme de la main et du poignet.
Lorsque au bout d’une heure de travail elle put enfin rompre les liens, elle était tout ensanglantée. Mais elle avait les mains libres et c’était là un grand point.
Encouragée par ce premier succès, elle attendit que ses mains engourdies et tuméfiées – car elle était garrottée depuis la veille – eussent recouvré le mouvement et l’élasticité ; puis elle défit, sans trop de peine, les cordes qui lui attachaient les chevilles.
Alors elle regarda autour d’elle pour voir si, parmi les objets hétéroclites qui se trouvaient dans ce réduit, aucun ne pourrait lui être utile. Et, tout d’abord, elle découvrit un vieux chandelier de cuivre qu’elle mit précieusement de côté, avec l’idée de s’en faire une arme ou un levier. C’est alors qu’elle remarqua qu’il était armé d’une pointe aiguë qui avait dû servir à ficher les cierges. C’était là un instrument tout à fait propre à gratter le mortier et à desceller les pierres.
La gitane, sans attendre l’épuisement complet de ses forces, diminuées par un long jeûne, se mit aussitôt au travail.
Elle pensa qu’il ne fallait pas s’attaquer à la muraille, faite de lourds blocs réunis par du ciment, que Slugh avait construite ; elle jugea qu’elle triompherait plus facilement du vieux mortier déjà friable et des pierres moins volumineuses dont se composait l’ancienne muraille.
Le point d’attaque qu’elle choisit se trouvait juste au ras du sol. La recluse s’était dit que le trou qu’elle se proposait de creuser resterait longtemps inaperçu, à cause de l’épaisse litière de jonc qui couvrait les dalles de la chambre.
Elle travailla patiemment pendant tout le reste de la journée. Hélas ! quand le soleil se coucha, elle s’aperçut que ce qu’elle avait fait n’était presque rien. Le trou qu’elle avait pratiqué dans la muraille lui parut ridiculement petit. Et pourtant, elle se sentait brisée de fatigue.
La nuit la força d’interrompre sa besogne. Elle se coucha, avec la ferme résolution de bien se reposer afin de continuer dès qu’il ferait jour.
Toute la journée du lendemain, elle travailla avec le même courage, quoique la faim lui tordît les entrailles. Elle trouva cependant quelque soulagement en mâchant les tiges des joncs qui lui servaient de lit. Palliatif bien anodin, car, le soir, elle était complètement à bout de forces.
Ses efforts cependant n’avaient pas été inutiles. La pierre de taille à laquelle elle s’était attaquée était maintenant complètement déchaussée. Il devait suffire d’une simple pesée pour l’arracher du mortier auquel elle n’adhérait presque plus.
Cette nuit-là, la captive entendit dans l’escalier de la tour le grand remue-ménage qui précédait d’ordinaire l’illumination du clocher.
Comme les autres fois, elle vit par la meurtrière l’étoile rouge s’éteindre à l’horizon pendant qu’une vive lueur tombait du sommet de la tour.
L’intérieur de la cellule se trouvait brillamment éclairé. Un rayon de lumière, pénétrant obliquement par la meurtrière, venait tomber d’aplomb sur le christ d’étain que la gitane avait nettoyé et accroché à la muraille dans les premiers temps de sa captivité.
– Qui sait ? murmura-t-elle, frappée d’une inspiration, j’ai peut-être là, entre les mains, un providentiel moyen de faire connaître ma situation au-dehors.
Elle détacha le christ du mur et, se servant de la pointe aiguë du chandelier en guise de stylet, elle grava péniblement quelques mots sur le revers de la croix ; puis, se haussant autant qu’elle le pouvait, elle le lança par la meurtrière.
C’est ce christ que, le lendemain même, Pierre Gilkin devait apporter à lord Burydan.
Cet effort avait achevé de briser les forces de la captive. Une fièvre, causée par la privation de nourriture, la dévorait également, et, malgré sa lassitude, ne lui permettait pas de dormir. La pauvre gitane passa une nuit horrible. La faim la tenaillait. Ses oreilles bourdonnaient. Il lui semblait voir danser, devant ses yeux, des mouches de feu.
Le jour venu, elle se leva et essaya de se remettre à l’ouvrage. En vain ! Elle était si affaiblie qu’au bout de quelques minutes elle fut prise d’une syncope et s’évanouit.
Un sommeil profond succéda sans transition à cet évanouissement.
Comme tous ceux qui souffrent de la faim, la gitane rêva qu’elle assistait à de magnifiques festins. Ce sont les paroles inarticulées qu’elle prononçait pendant ses rêves que lord Burydan entendit lors de sa visite à la tour.
Elle dormit plusieurs heures. Il y avait tant de ressources dans sa robuste nature que cette courte période de repos suffit à lui rendre une partie de son énergie.
Comme elle s’éveillait, elle perçut un bruit de voix dans la pièce contiguë à sa prison. Elle colla son oreille contre la muraille, et elle crut comprendre que c’était Slugh qui, avant de partir pour une de ses mystérieuses promenades, faisait à Edward Edmond ses recommandations.
Elle ne s’était pas trompée.
Des pas résonnèrent dans l’escalier de la tour. Slugh était parti, et Dorypha entendit bientôt l’Irlandais déboucher une bouteille, ouvrir une boîte de conserve et se mettre à manger. À travers la cloison, elle distinguait même très nettement le craquement de ses mâchoires.
La faim de la gitane s’augmenta de ces bruits, qui semblaient insulter à sa détresse. Elle se jura à elle-même qu’elle aurait sa part du repas de l’Irlandais.
Elle arracha doucement, avec d’infinies précautions, la pierre qu’elle avait eu tant de mal à décimenter.
*
* *
Tout à coup, Edward Edmond, qui, tout entier à son occupation, n’avait rien entendu, vit une longue main brune et sèche sortir d’entre les joncs, s’emparer de la bouteille de whisky et de la boîte de corned-beef, puis disparaître.
Ce larcin s’était opéré si rapidement que l’Irlandais, la bouche pleine, n’avait eu ni le temps ni la pensée de s’y opposer.
La surprise qu’il ressentait confinait à la frayeur.
– Est-ce toi, Dorypha ? balbutia-t-il tout tremblant.
Un éclat de rire moqueur lui répondit de l’autre côté de la muraille.
Il n’était pas encore revenu de sa stupéfaction que la main brune s’allongea de nouveau hors du trou et rafla le restant des provisions de l’Irlandais, c’est-à-dire un bloc de biscuits de mer et une tranche de jambon.
Dorypha s’était jetée avidement sur ces victuailles inespérées. Elle se contraignit, toutefois, à ne manger que très lentement et très peu à la fois, elle avait entendu dire que la nourriture ne doit être prise qu’avec beaucoup de modération après un long jeûne. Elle but une gorgée de whisky. Oh ! comme elle eût sacrifié de bon cœur tout ce qu’elle possédait pour une cruche d’eau fraîche !
La gitane se sentait renaître à la vie et à l’espérance. Avec ce peu de vivres qu’elle possédait, elle se sentait de taille à pratiquer un trou assez grand pour lui livrer passage. Ensuite, elle profiterait, pour s’échapper, d’un moment où ses bourreaux seraient absents ou endormis.
Elle ne voulait pas s’arrêter à cette pensée que l’Irlandais la dénoncerait à Slugh, et que celui-ci la tuerait peut-être d’un coup de revolver par quelque trou du mur.
Edward Edmond était bien loin d’avoir une pareille pensée.
Il écarta les joncs, découvrit l’ouverture béante et, se couchant à plat ventre, il appela de nouveau :
– Dorypha !
– Laisse-moi donc déjeuner tranquille ! répondit l’emmurée.
– Tu n’es donc pas morte ?
– Je ne meurs pas comme cela, moi !
– Comment as-tu fait pour percer la muraille ?
– Cela ne te regarde pas.
– Ah ! murmura l’Irlandais avec un soupir de regret, si tu n’étais pas si perfide et si fausse, si tu n’avais pas agi si traîtreusement !… Mais on ne peut pas avoir confiance en toi !…
Dorypha était profondément étonnée. Après avoir jeté l’Irlandais du haut de la chambre des cloches, elle ne se serait pas attendue à une pareille aménité.
– Où veux-tu donc en venir ? répliqua-t-elle.
– Écoute ! reprit-il avec un peu d’hésitation, j’en ai assez, moi, de la Main Rouge. Tu n’aurais pas essayé de me tuer comme tu l’as fait, que j’eusse été le premier à aider à ton évasion. Maintenant, je te connais trop bien ! Je vais montrer ce soir, à Slugh, le trou que tu as creusé et il s’empressera de le reboucher avec du bon ciment. Ce n’est pas le déjeuner que tu m’as volé qui te mènera bien loin !
La gitane réfléchissait.
« Évidemment, pensa-t-elle, il a un projet, et je crois qu’il ne va pas m’être difficile de lui tirer les vers du nez. »
– Écoute ! lui dit-elle de sa voix la plus enjôleuse et la plus caressante, je reconnais que j’ai eu de grands torts envers toi. Mais tu dois bien comprendre que j’ai aussi quelques excuses ! Si tu veux faire ce que je te dirai, un avenir des plus brillants s’ouvrira devant toi. Je vais te parler sans détour… Laisse-moi m’évader, suis-moi dans ma fuite, et je te jure que ton ancienne place, chez Fred Jorgell, te sera rendue ou, ce qui vaut mieux encore, le milliardaire nous donnera une bonne somme pour aller vivre en Europe, loin de la Main Rouge… Tu sais qu’il ne peut rien me refuser, puisque c’est moi qui ai sauvé tous ses amis…
– Oh ! ce Slugh, murmura l’Irlandais entre ses dents, je le déteste ! Il me fait aller et venir comme si j’étais son esclave !…
– Si tu disais à certaines personnes que je connais tout ce que tu sais de la Main Rouge, ta fortune serait faite, insinua perfidement la gitane.
– Cela demande réflexion !
La conversation continua une heure entière sur ce ton. Dorypha, à qui l’imminence du péril prêtait une véritable éloquence, mit en œuvre toutes les protestations, toutes les promesses. Même prévenu comme il l’était, Edward Edmond ne pouvait croire qu’elle ne fût pas de bonne foi.
– Laisse-moi m’évader ! répéta-t-elle d’une voix suppliante. Qui t’empêche de remettre la muraille dans le même état, une fois que je serai sortie ? Slugh ne s’apercevra de rien. Je trouverai bien, dans le village en ruine, quelque endroit pour me cacher en attendant que nous prenions la fuite.
Ce dernier argument acheva de décider l’Irlandais.
– Eh bien, soit !… Tant pis ! grommela-t-il, je risque le tout pour le tout. Mais, cette fois du moins, ne va pas me trahir ! Tu vois que tu fais de moi tout ce que tu veux !
Il alla dans la crypte prendre le levier de fer. En quelques minutes, il eut suffisamment agrandi l’ouverture commencée par Dorypha pour que celle-ci pût se glisser, en rampant, en dehors de son cachot.
– Ah ! quel bonheur d’être libre ! s’écria-t-elle en se détirant les membres.
– Oui, fit Edward Edmond d’un ton inquiet. Mais descends vite et va te cacher dans les ruines du village. Il faut, moi, que je me hâte de réparer la muraille avant que Slugh soit de retour !
Dorypha s’empressa d’obéir. Elle était en ce moment de très bonne foi.
Mais, à peine avait-elle descendu quatre marches de l’escalier que, par la meurtrière, elle distingua, à une centaine de pas de là, une troupe d’hommes qui la carabine sur l’épaule se dirigeaient vers la tour fiévreuse. Parmi eux, il lui semblait reconnaître lord Burydan et, ce qui mit le comble à son émotion, Pierre Gilkin lui-même.
Elle ressentit au cœur un choc si violent qu’elle fut près de défaillir. Cela ne dura qu’un instant. D’un élan irrésistible, elle dégringola les marches pour courir au plus vite au-devant de ses amis. Elle avait compté sans l’Irlandais. Lui aussi avait reconnu, d’un coup d’œil, lord Burydan, Oscar et Pierre Gilkin.
Il s’apercevait avec fureur que c’était pour d’autres qu’il s’était donné tant de mal. Il barra le passage à la gitane et la força de remonter.
– Tu ne t’en iras pas avec eux ! criait-il écumant de rage, tu resteras avec moi, ou je te tuerai !
Éperdue, Dorypha remonta jusqu’à la dernière plate-forme de la tour. Elle savait que, de là, elle serait aperçue de ses amis, et elle se mit à pousser de grands cris en agitant les bras pour attirer leur attention.
Edward Edmond, au comble de l’exaspération et de la fureur, se précipita sur la gitane, le revolver au poing, et tira sur elle presque à bout portant.
Dorypha, se baissant rapidement, esquiva la balle et, se ressouvenant de son ancien métier, elle fit, d’un leste coup de pied, sauter l’arme des mains de l’Irlandais.
Celui-ci se rua sur elle, les mains ouvertes, pour l’étrangler.
Une lutte atroce s’engagea entre eux.
Pierre Gilkin, qui marchait en avant de la petite troupe, vit cette scène de loin. Comprenant le péril où se trouvait Dorypha, il se mit à courir de toutes ses forces pour aller à son secours, sans même attendre ses amis.
Edward Edmond avait saisi Dorypha à la gorge, mais elle le mordit si cruellement qu’il dut lâcher prise et se rejeter en arrière.
Dans ce brusque mouvement, il oublia complètement où il se trouvait et, heurtant des talons la balustrade de pierre, il perdit l’équilibre et, la tête la première, dégringola dans le vide.
Tout cela avait été si rapide que la gitane se demanda tout d’abord comment elle avait pu faire pour jeter le robuste Irlandais du haut du clocher.
Maintenant, elle était en proie à une sorte de vertige. Après l’effort désespéré qu’elle venait de faire, la lutte qu’elle venait de soutenir, sa faiblesse la reprenait de plus belle. Elle ne se sentait pas plus de force qu’un petit enfant. Ce fut lentement, péniblement, qu’elle commença à descendre les degrés de l’escalier.
Elle allait arriver au premier étage lorsqu’une apparition terrible lui barra le passage.
Slugh, la pipe aux dents, s’avançait, l’air gouailleur, le browning au poing.
– Ah ! ah ! fit-il, il paraît que, quand le chat n’est pas là, les souris dansent ! Vraiment, cet Irlandais est stupide ! Je ne puis pas m’absenter une heure sans qu’il commette quelque sottise !…
Dorypha devint pâle comme un linge. Tout son sang reflua vers son cœur.
Alors, au moment même où Slugh étendait la main vers elle, une détonation retentit.
Le bandit roula à terre, l’épaule fracassée.
Derrière lui, tenant encore à la main son arme fumante, Dorypha aperçut Pierre Gilkin qui lui tendait les bras.
Elle sauta par-dessus le corps sanglant du vieux tramp et serra sur son cœur avec passion cet époux qu’elle croyait mort et qu’elle retrouvait si miraculeusement.
Tous deux se considéraient avec ravissement, si émus qu’ils ne trouvaient pas un mot.
– Comme tu es pâle, ma pauvre Dorypha ! dit enfin Pierre Gilkin. C’est donc vrai, ce qui était écrit sur le crucifix d’étain : que ces misérables t’avaient murée toute vivante ?
– Oui… Viens voir !
Dorypha entraîna son mari jusqu’à la salle du premier. Elle lui montra l’ouverture béante grâce à laquelle elle avait pu s’échapper.
– Ah ! c’est comme cela ! s’écria Pierre Gilkin tremblant de haine et de colère. Eh bien, tu vas voir !
– Que vas-tu faire ?
– Quelque chose qui t’amusera. Viens avec moi, et tu verras.
Le Belge remonta jusqu’à l’endroit où il avait laissé Slugh, il lui lia les pieds et les mains avec la ceinture rouge dont le bandit lui-même était porteur. Puis, avec l’aide de Dorypha, il descendit le vieux tramp, qui jurait et maugréait de tout son cœur, jusqu’à la chambre du premier.
– Je comprends ! s’écria Dorypha en battant des mains. Je n’aurais pas pensé à cela !
– Bon ! J’allais oublier quelque chose. Il faut le bâillonner, car lord Burydan et ses amis me suivent de près et ne vont pas tarder à venir, et je ne veux pas qu’ils délivrent ce bandit, même pour le mener en prison !…
– Tu as raison. Aussi dépêchons-nous !
En dépit de ses soubresauts, Slugh fut poussé la tête la première par la baie pratiquée dans la muraille. Les pierres furent remises en place tant bien que mal, et Dorypha cacha les traces de ce travail en amoncelant, à cet endroit, une grande quantité de joncs.
Elle et son mari se promirent de revenir le lendemain pour parachever leur œuvre de vengeance. D’ici là, Slugh, blessé comme il l’était, ne pourrait pas s’échapper.
Pierre Gilkin et Dorypha en avaient à peine fini avec leur prisonnier que lord Burydan et ses amis entrèrent, à leur tour, dans les ruines.
Dorypha fut chaudement félicitée de sa délivrance.
Puis l’excentrique lui posa quelques questions. Grâce à la gitane, il ne tarda pas à éclaircir le mystère qui l’avait tant intrigué.
– Ce n’est pas étonnant, dit la jeune femme, que vous n’ayez rien trouvé quand vous êtes venu. Il y a une crypte sous l’église, c’est là que les deux bandits serraient leurs vivres, leurs bagages et tout leur attirail.
– Il faut absolument que je visite cette crypte ! déclara lord Burydan. Si je ne me suis pas trompé dans mes suppositions, la découverte que je vais y faire me permettra de sauver la vie à des milliers de personnes.
Deux des Noirs furent appelés et, à l’aide du levier de fer, soulevèrent sans peine la dalle qui recouvrait l’entrée de l’escalier aboutissant au souterrain.
Il y avait là toutes sortes d’objets.
Mais lord Burydan avisa tout de suite une grande caisse, sur laquelle il venait de remarquer l’adresse d’un marchand d’appareils de physique et d’optique. La caisse contenait une grosse lampe à acétylène, des verres lenticulaires : en un mot, tout ce qui avait servi à Slugh à changer en un phare éclatant le clocher de la tour fiévreuse.
– Je sais maintenant, déclara lord Burydan d’une voix grave, comment se sont produits les désastres successifs des navires de la Compagnie des paquebots Éclair. Les gardiens du phare qui se trouve à l’entrée du golfe d’Oyster Bay sont certainement affiliés à la Main Rouge. J’en ai maintenant la preuve ! Aussi, les jours de tempête, lorsqu’ils avaient reconnu la présence d’un paquebot dans ces parages, ils éteignaient leur phare, en même temps que Slugh allumait le sien.
« Les capitaines, déroutés par ce changement, gouvernaient droit sur les récifs en croyant se diriger vers l’estuaire du fleuve, où ils eussent trouvé un abri contre la tempête. Ils périssaient misérablement !
– Il reste maintenant à savoir, dit Oscar, quels sont ceux qui ont intérêt à la ruine de la Compagnie des paquebots Éclair !
Lord Burydan ne releva pas cette observation. Il venait d’apercevoir des bocaux qui, d’après leurs étiquettes, avaient dû contenir des cultures microbiennes. Ce fut pour lui un trait de lumière. Il comprit soudainement à quoi était due la recrudescence de maladies contagieuses qui sévissaient depuis quelques semaines.
Appareils et bocaux furent soigneusement rangés dans les caisses, et les Noirs se chargèrent de les transporter chez Mr. Bombridge.
Le soir même, lord Burydan écrivit à Fred Jorgell une longue lettre explicative.
Quant aux Noirs du phare d’Oyster Bay, ils furent cueillis le lendemain par la police de Tampa.
Pierre Gilkin et Dorypha gardèrent jalousement le secret de leur vengeance. Personne ne sut ce que Slugh était devenu.
DIX-SEPTIÈME ÉPISODE
Le dément de la Maison Bleue
CHAPITRE PREMIER
Le choix d’un gendre
Mr. Bombridge, célèbre dans toute l’Amérique par la façon quasi géniale dont il avait organisé la production intensive de l’escargot comestible, avait réuni, ce jour-là, quelques amis dans la superbe propriété qu’il possédait en Floride, à quelques miles de la ville de Tampa.
Parmi ses invités, on remarquait lord Astor Burydan, fameux par ses aventures excentriques, le prestidigitateur Matalobos, l’honorable James Rollan, propriétaire du trust des chaussures d’occasion, et un jeune Français, Oscar Tournesol, attaché au laboratoire de l’illustre naturaliste Prosper Bondonnat.
Ces trois personnages avaient, depuis longtemps déjà, posé leur candidature à la main et aux millions de miss Régine Bombridge ; mais, jusque-là, il eût été impossible de dire lequel des trois avait le plus de chances de réussir.
Oscar Tournesol était, disait-on, très aimé de miss Régine ; d’un autre côté, Matalobos était un vieil ami de Mr. Bombridge qui le tenait en haute estime ; quant à Mr. James Rollan, ses millions, la distinction de ses manières et sa parfaite élégance faisaient de lui, pour ses deux rivaux, un concurrent redoutable.
Mr. Bombridge, après de longues hésitations, avait enfin déclaré qu’à l’issue d’un grand repas donné en l’honneur des prétendants il proclamerait le nom de l’heureux mortel appelé à devenir son gendre.
Cette conduite singulière lui avait attiré quelques observations courtoises de la part de Mr. James Rollan.
– Vous avez sans doute fait votre choix ? avait demandé le distingué gentleman.
– Eh ! cela se pourrait bien ! avait répondu Mr. Bombridge.
– Alors pourquoi ne pas le faire connaître tout de suite ? Il y a quelque cruauté à mettre si longtemps notre patience à l’épreuve !
– Laissez faire, j’ai mon idée à ce sujet.
James Rollan n’avait rien pu tirer de plus de Mr. Bombridge. En dépit de toutes les sollicitations, celui-ci s’était renfermé dans une discrétion impénétrable.
Le repas fut digne de la réputation hospitalière du maître de la maison.
Sur la carte du menu, le foie de tortue verte truffé voisinait avec les langoustes à la mexicaine, le faisan de la Floride et un de ces délicieux lézards iguanes, communs dans l’Amérique centrale, et qui fut servi avec une sauce caraïbe.
Citons encore, parmi les curiosités gastronomiques, des gombos tendres et savoureux et des choux palmistes.
Le cuisinier de Mr. Bombridge n’avait eu garde d’oublier un plat d’escargots, savamment grillés et servis avec une sauce dont le madère de la célèbre marque Barnum formait le principal élément.
Les convives s’installèrent autour de la table parée de fleurs magnifiques. Miss Régine, dont une claire toilette de linon des Indes faisait ressortir la beauté blonde, s’était assise à la place d’honneur entre son père et lord Burydan elle affectait beaucoup de bonne humeur et de gaieté ; mais, au fond, elle était inquiète et, de temps en temps, elle lançait à la dérobée, du côté d’Oscar, des regards anxieux et presque consternés.
Les invités de Mr. Bombridge venaient de savourer le potage aux huîtres – qui est pour ainsi dire la base de la cuisine yankee et sans lequel il n’y a pas de repas sérieux –, lorsque lord Burydan tira de sa poche une lettre qu’il venait de recevoir et la fit lire à Oscar.
Celui-ci, après l’avoir parcourue, se mit à sourire à miss Régine en même temps qu’il regardait Mr. James Rollan avec une fixité qui parut du plus mauvais goût à l’honorable gentleman.
Ce rapide incident passa, d’ailleurs, presque inaperçu, et bientôt la gaieté la plus cordiale régna parmi les convives.
On but d’abord à miss Régine, puis à son père, puis tour à tour à la santé de chacune des personnes présentes. Les serviteurs noirs avaient à peine le temps de déboucher les flacons d’extra-dry et de les remplacer par d’autres. L’enthousiasme était arrivé à son comble. Maintenant, chacun toastait pour son compte sans se préoccuper de ses voisins.
– Au père de l’industrie escargotière ! criait le prestidigitateur d’une voix légèrement éraillée.
– À sa charmante fille ! dit Oscar Tournesol au moins pour la quatrième fois.
– À Sa Majesté le roi d’Angleterre !…
– À l’illustre Prosper Bondonnat !…
– À la France !…
– À la libre Amérique !…
Ce joyeux vacarme fut tout à coup interrompu par l’arrivée d’un serviteur noir, le vieux Jupiter, qui semblait terrifié.
– Maître, s’écria-t-il, venez vite !…
– Tu m’ennuies ! répliqua Mr. Bombridge. Je t’ai défendu, une fois pour toutes, de me déranger quand je suis avec mes amis !
– À la porte, Jupiter !… cria l’assemblée tout d’une voix. À demain les affaires sérieuses !…
Le Noir ne semblait nullement ému de ce mauvais accueil.
– Maître, répéta-t-il avec insistance, venez vite ! C’est très sérieux ! On vous demande au téléphone !
– Eh bien, on me redemandera ! Je ne me dérange pas !
– Maître, répliqua le vieux Jupiter avec entêtement, c’est le directeur de votre succursale de la Caroline du Sud !
– Que me veut-il ?
– Une catastrophe terrible est arrivée !… Je ne peux pas vous expliquer…
– Allons, dit Mr. Bombridge en se levant d’un air contraint, il faut que ce soit moi qui cède ! Messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers ses convives, je vous prie de m’excuser, je reviens dans une minute… Mais soyez tranquilles, je suis sûr d’avance qu’il ne s’agit de rien de grave…
Mr. Bombridge sorti, les convives se regardèrent en silence. Leur gaieté s’était évanouie comme par enchantement. Le mot de catastrophe, prononcé par Jupiter, rendait soucieux les plus étourdis ; et tout le monde attendait impatiemment le retour du maître de la maison ; mais l’absence de ce dernier se prolongea beaucoup plus qu’il n’eût été nécessaire pour une simple communication téléphonique.
Miss Régine, très inquiète, allait se mettre à la recherche de son père, lorsque celui-ci reparut. Sa physionomie était bouleversée ; il baissait la tête comme un homme accablé.
– Qu’y a-t-il donc, mon cher ami ? demanda le prestidigitateur Matalobos d’un ton plein de sollicitude. J’espère qu’il ne vous est arrivé aucun malheur !
– Messieurs, dit Mr. Bombridge avec une simplicité impressionnante, Jupiter n’avait pas exagéré quand il a prononcé tout à l’heure le mot de catastrophe. Je suis complètement ruiné.
Cette déclaration produisit une impression profonde parmi les convives, et ce fut au milieu de la plus religieuse attention que Mr. Bombridge poursuivit :
– Vous n’ignorez pas que je possède dans la Caroline du Sud un établissement aussi important que celui de la Floride. C’est là que j’avais centralisé trois millions de sujets destinés à l’exportation et que je faisais jeûner en attendant qu’ils se fussent cachetés naturellement. Je vous ai déjà expliqué, n’est-ce pas ? que, pour être envoyés à de grandes distances, mes mollusques doivent être cachetés.
– Eh bien ? demanda miss Régine avec impatience.
– Comme de coutume, les animaux avaient été enfermés dans trois serres spécialement construites à cet effet et qui peuvent en contenir chacune un million.
« Un cyclone a ravagé la nuit dernière toute cette région de la Caroline du Sud. Le vitrage de mes serres a été entièrement détruit ; une pluie diluvienne, survenue aussitôt après le passage du cyclone, a rendu aux escargots toute leur vivacité et aussi, hélas ! tout leur appétit !
– Je devine, fit lord Burydan, qu’ils ont dû s’échapper et commettre quelques dégâts dans le voisinage.
– Quelques dégâts ? s’écria Mr. Bombridge en s’arrachant les cheveux, mais vous ne savez donc pas, milord, de quoi sont capables des escargots à jeun, surtout quand il y en a trois millions ? Vous avez vu cependant avec quelle rapidité, même quand ils ne sont pas affamés, ils font disparaître un wagon entier de fourrage tendre !…
« Par une de ces malchances comme il n’en appartient qu’à moi, la propriété voisine appartient au célèbre horticulteur Brigmann, qui s’est spécialisé dans la production des orchidées et des primeurs ; les fugitifs se sont précipités sur ses cultures et ont rongé plantes, herbes et fleurs jusqu’à la racine ; en quelques heures le désastre a été consommé. Il y en a pour des millions de dollars !
« Quand j’aurai désintéressé Mr. Brigmann, comme j’y suis forcé, je ne sais s’il me restera de quoi vivre.
Un silence de mort avait accueilli cette fatale nouvelle. Les convives se regardaient, la consternation peinte sur le visage.
– Messieurs, reprit Mr. Bombridge, c’est évidemment un malheur, un grand malheur… mais il ne faut pas que cela nous empêche de dîner. Il est tout à fait incorrect de ma part de vous avoir importunés par le récit de mes infortunes.
Chacun se récria. On essaya de consoler Mr. Bombridge, en lui disant que le désastre n’était peut-être pas aussi grand qu’on l’annonçait. Mais sous toutes ces paroles on devinait la gêne et l’ennui. Et ce fut au milieu de la tristesse et de la contrainte la plus pénible que se poursuivit le repas si gaiement commencé.
Malgré la chère exquise et les vins précieux, personne n’avait plus ni faim ni soif.
Miss Régine gardait un silence imperturbable. Toutefois, elle faisait visiblement les plus grands efforts pour ne pas pleurer ; et chacun se demandait avec une pitié sincère quels devaient être les sentiments de la jeune fille. N’était-elle pas la première victime de la catastrophe, et la plus cruellement atteinte ?
Chacun comprenait combien était fausse la situation pour miss Régine et pour ses fiancés, et chacun attendait le dénouement inévitable.
Ce fut Mr. Bombridge lui-même qui se chargea de l’amener.
– Messieurs, dit-il en se tournant vers les prétendants, il est bien entendu, n’est-ce pas ? que je vous rends votre parole à tous les trois, Miss Régine n’est plus maintenant que l’héritière d’un ancien clown, d’un homme ruiné qui ne pourra même pas lui donner la dot la plus modeste…
Matalobos leva hypocritement les yeux au ciel.
– Hélas ! murmura-t-il, quel malheur que je ne sois pas moi-même favorisé des dons de la fortune ! Je me serais fait une joie de partager tout mon avoir avec mon vieil ami Bombridge… Mais, hélas ! je suis pauvre, très pauvre !…
« Il est pour moi bien douloureux de renoncer à la main de miss Régine… Il est pourtant de mon devoir de le faire, puisque je n’ai pas la fortune qui me permettrait de lui créer une existence digne d’elle ni même de lui assurer le confort indispensable…
– La ruine de Mr. Bombridge ne change rien à mes intentions, déclara Oscar, j’aimais miss Régine avant qu’elle ne fût riche, je l’aime toujours autant, et je m’applaudirais même – si un tel sentiment n’était égoïste de ma part – d’un événement qui nous met tous deux sur le pied d’égalité quant à la fortune.
Miss Régine remercia Oscar d’un regard et d’un sourire. Mr. Bombridge déclara d’un ton maussade que, du moment où il n’avait pas de dot à donner à sa fille, il ne voulait pas la marier.
Il n’y avait que Mr. James Rollan qui n’eût encore rien dit, et véritablement le distingué gentleman se trouvait fort embarrassé. Malgré la beauté de miss Régine, il n’était nullement disposé à prendre une épouse qui n’apporterait pas un dollar dans l’association conjugale. D’un autre côté, il trouvait que Matalobos avait montré un peu trop crûment le fond de sa pensée : or, lui, James Rollan, prétendait agir, en toute chose, en véritable homme du monde.
– Il me semble, fit-il avec un bon sourire, que ce n’est guère le moment de parler mariage. Laissons Mr. et miss Bombridge se remettre de cette dure secousse, s’accoutumer à un changement de fortune qui, après tout, n’est peut-être pas irrévocable !
Il ajouta jésuitement, en mettant une main sur son cœur :
– Pour ce qui me regarde, rien ne pourra modifier mes sentiments à l’égard de miss Régine ; ils n’ont jamais changé et ne changeront jamais !
En entendant cette déclaration ambiguë, Oscar et lord Burydan échangèrent un rapide coup d’œil.
– Je crains, dit tout à coup l’excentrique, que monsieur – disons monsieur James Rollan, puisque c’est sous ce pseudonyme qu’il s’est présenté – n’ait, d’ici peu de temps, des préoccupations assez sérieuses pour être obligé d’ajourner indéfiniment toute espèce de projet d’union !
Mr. James Rollan était tout à coup devenu très pâle, puis très rouge. Il jeta un regard instinctif du côté de la fenêtre.
– Permettez, milord, fit-il d’une voix mal assurée, pourquoi avez-vous employé, à mon égard, ce mot de pseudonyme ?
– Parce que, répondit tranquillement l’excentrique, quand je vous ai connu autrefois, on vous appelait tout simplement Ezéchias Palmers, et vous dirigiez un établissement où les affligés pouvaient voir apparaître les âmes des personnes qui leur furent chères.
Palmers sauta sur sa chaise comme s’il eût été soudain piqué par un serpent.
– Quand je vous ai connu, moi, dit à son tour Oscar, vous dirigiez une maison de santé, et même, si j’ai bonne mémoire, vous nourrissiez assez mal vos pensionnaires.
Mr. Palmers, qui était doué d’un aplomb imperturbable, avait déjà eu le temps de se ressaisir.
– Je ne veux pas contredire milord Burydan, dit-il avec une politesse ironique ; mon véritable nom est bien Ezéchias Palmers. Mais depuis quand, dans notre libre pays d’Amérique, fait-on un crime à quelqu’un de prendre un pseudonyme pour les besoins de son industrie ? J’ai dirigé une maison de fous, et même un Institut spirite. Où est le mal ? Tout le monde ne serait pas capable d’en faire autant.
Il ajouta, avec un sourire méphistophélique, à l’adresse de lord Burydan et d’Oscar :
– Il est certainement plus facile au premier venu de se faire enfermer comme fou que de diriger une maison d’aliénés. Somme toute, à l’heure actuelle, grâce à mon intelligence et à mon énergie, je suis à la tête d’une affaire superbe et je puis donner sur mon honorabilité les plus hautes références.
Lord Burydan était émerveillé de l’aplomb du personnage.
– Master Palmers, lui répliqua-t-il, n’exagérons rien. Ce n’est certainement pas au Police-Office qu’il faudrait aller pour avoir de bons renseignements sur votre compte. Et j’ai de fortes raisons de croire que la « superbe affaire » que vous dirigez ne vienne à péricliter dans un avenir qui me paraît très rapproché.
– Milord, répondit Mr. Palmers avec un sang-froid parfait, je méprise ces sortes d’insinuations.
– Ce ne sont pas, hélas ! des insinuations, fit l’excentrique en tirant de sa poche la lettre qu’il avait lue au commencement du repas ; j’apprends de bonne source que quelques centaines de vos clients se sont syndiqués pour déposer contre vous une plainte en escroquerie…
– Mensonges ! calomnies ! protesta Mr. Palmers.
– Je crains bien, dit à son tour Bombridge en tirant de sa poche un numéro du New York Herald, que ce ne soit milord qui ait raison.
Et, montrant un paragraphe du journal, encadré d’un trait de crayon rouge :
– Ma foi oui, ajouta-t-il, c’est extraordinaire, voilà bien un certain Palmers, dit James Rollan, ancien jockey, ancien directeur de maison de santé, ancien spirite, que la police recherche activement. Plusieurs détectives ont été lancés à sa poursuite, et son arrestation ne serait plus qu’une question d’heures.
Palmers faisait peine à voir.
– Mensonges que tout cela ! balbutia-t-il d’une voix faible.
– Écoutez-moi bien, master Palmers, reprit Bombridge. Je vous ai reçu sous mon toit. Il n’entre donc pas dans mes intentions de jouer le rôle de mouchard et de vous livrer à la police ; mais, dans votre propre intérêt, je crois que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c’est de ne pas prolonger trop longtemps votre séjour ici.
S’apercevant qu’on n’en voulait pas à sa liberté, Palmers avait reconquis toute son égalité d’âme et tout son aplomb.
– Vous me donnez-là, mon cher monsieur Bombridge, répliqua-t-il, un excellent conseil. Je vais partir à l’instant pour Tampa, où je prendrai le rapide de New York. Ma présence est nécessaire là-bas pour déjouer les machinations de mes concurrents… Quant aux journaux qui m’ont diffamé en affirmant qu’une plainte avait été déposée contre moi, je vais leur intenter un procès et demander cent mille dollars de dommages et intérêts. Au revoir, messieurs ! Au revoir, miss Régine ! Je suis sûr que vous n’avez pas cru un mot de toutes les infamies que l’on a débitées contre moi ! Vous aurez sous peu de mes nouvelles. Ah ! certes, il m’en coûte beaucoup de vous quitter au moment où vous traversez une épreuve aussi cruelle !
Mr. Bombridge, qui s’était levé de table en même temps que Palmers, sortit de la salle à manger et y rentra presque aussitôt.
– Soyez rassuré sur le sort de Régine, dit-il. Je suis heureux de vous annoncer, comme Jupiter vient de me l’apprendre à l’instant, que le message téléphonique qui m’annonçait ma ruine était l’œuvre d’un mauvais plaisant.
« Au revoir, master Palmers. Vous avez juste le temps de prendre le rapide. J’ai fait atteler le buggy. Jupiter vous reconduira jusqu’à la gare de Tampa.
Palmers comprit cette fois clairement qu’on s’était moqué de lui.
Incapable de conserver plus longtemps son masque de politesse souriante, il sortit en faisant claquer les portes, après avoir jeté un regard furieux sur lord Burydan et Oscar.
Matalobos ne faisait guère meilleure contenance. Il était, lui aussi, exaspéré d’avoir donné tête baissée dans le piège que lui avait tendu le malicieux Bombridge.
Quant à miss Régine, elle contenait à grand-peine son envie de rire.
Cette attitude mit le comble à la fureur de Matalobos. À son tour, il se leva en balbutiant qu’il était attendu à New York pour affaires urgentes et que, lui aussi, profiterait du buggy pour se rendre à la gare de Tampa.
– Bon débarras ! fit Bombridge lorsque le prestidigitateur eut tourné les talons. Je n’aime pas les intrigants.
Miss Régine s’était jetée gentiment à son cou.
– Dis donc, père, murmura-t-elle en souriant, est-ce que tu vas continuer ainsi à flanquer à la porte mes amoureux ?
– Ne te plains pas, puisque je te laisse le meilleur de tous !
Et il ajouta d’une voix grave :
– Oscar » je vous permets d’embrasser votre fiancée !
Les deux jeunes gens tombèrent dans les bras l’un de l’autre.
– C’est curieux, murmura lord Burydan, j’avais prévu ce dénouement. Je dois même m’être précautionné de certaines de ces babioles qu’il est d’usage d’offrir aux jeunes filles en pareil cas.
Fouillant dans sa poche avec une négligence affectée, il en retira un petit écrin qu’il remit à miss Régine.
Elle l’ouvrit d’une main impatiente, mais le referma presque aussitôt, éblouie.
L’écrin contenait une bague de fiançailles, ornée d’un gros diamant.
Lord Burydan fut chaleureusement remercié, puis Mr. Bombridge remplit de nouveau les coupes et s’écria :
– Maintenant que nous sommes débarrassés des trouble-fête, nous allons boire encore un coup à la santé des amoureux ! Hein, milord, que dites-vous de mon stratagème ? Si je n’avais pas fait croire à ces deux drôles que j’étais ruiné, la pauvre Régine aurait peut-être épousé l’un d’eux ?
– Non ! s’écria vivement la jeune fille ; j’avais promis à Oscar d’être sa femme, et je lui aurais tenu parole !…
On ne se sépara qu’assez tard dans la soirée. Il avait été convenu que le mariage de Régine et d’Oscar aurait lieu dans le plus bref délai possible.
CHAPITRE II
Un enlèvement
Le lendemain de ce mémorable dîner de fiançailles, Mr. Bombridge descendit de bonne heure, suivant sa coutume, pour se promener sous les grands arbres avant que l’ardent soleil eût entièrement fait évaporer la rosée, à cet instant bref et charmant qui suit le lever du soleil sous les tropiques.
Il fut tout étonné de voir que lord Burydan l’avait devancé. L’excentrique était en train de parlementer avec un boy qui, chaque matin, venait de Tampa, à franc étrier, pour apporter le courrier.
– Eh bien, milord, quoi de neuf ? demanda Mr. Bombridge après avoir pris des nouvelles de la santé de son hôte.
– Je vais, à mon grand regret, répondit lord Burydan, être obligé de vous quitter.
– Pas aujourd’hui, j’espère ?
– Aujourd’hui même. J’apprends à l’instant que mon yacht l’Ariel est arrivé hier soir à Tampa, où il est ancré dans la rade. Il reprendra la mer sitôt que je serai à bord.
– C’est fort ennuyeux, murmura Bombridge d’un air contrarié. J’avais espéré que vous assisteriez au mariage de Régine et de votre ami Oscar.
– C’était bien aussi mon intention, et, d’ailleurs, j’y assisterai peut-être.
Puis, changeant brusquement de ton :
– À propos, voulez-vous profiter de mon yacht pour faire une promenade en mer : je projetais tout à l’heure pour vous une charmante excursion.
– Dont l’itinéraire ?…
– Consisterait à côtoyer le rivage jusqu’à Oyster Bay, ou même, si vous avez le temps, à contourner toute la presqu’île de Floride jusqu’à Sainte-Lucie, d’où vous regagneriez Tampa par le chemin de fer.
– Je ne dis pas non, murmura Bombridge un peu hésitant. Je connais très mal cette partie de la côte.
– La surveillance de votre établissement, insista lord Burydan, ne réclame pas votre présence d’une façon tellement impérieuse que vous ne puissiez vous absenter deux ou trois jours.
– Ce n’est pas cela. L’organisation de mes fermes à escargots est telle que je pourrais m’en aller pendant deux ou trois mois sans qu’il y parût. Tous les directeurs, tous les surveillants que j’ai choisis sont des hommes de confiance.
– En ce cas, c’est entendu ! s’écria joyeusement l’excentrique. Je vais prévenir Oscar et miss Régine. Ils seront, j’en suis sûr, enchantés de ce petit voyage.
On fit rapidement les préparatifs nécessaires, et, deux heures plus tard, un buggy déposait les quatre touristes sur les quais du port de Tampa, d’où ils aperçurent la gracieuse silhouette de l’Ariel, ancré un peu en dehors du port, et dont les cheminées lançaient déjà des torrents de fumée noire.
Oscar et miss Régine échangèrent un furtif serrement de mains. À la vue du yacht, tous deux avaient éprouvé la même charmante émotion : ils se rappelaient la longue croisière qu’ils avaient faite ensemble, de Vancouver à l’île des pendus, et ils ne pouvaient oublier que c’est au cours de cette traversée qu’ils s’étaient fait pour la première fois le mutuel aveu de leur amour. Ce fut avec un vrai plaisir qu’ils montèrent à bord de l’Ariel.
Ils avaient à peine mis les pieds sur le pont du yacht, suivis de près par Mr. Bombridge et lord Burydan, qu’un gentleman d’un certain âge vint à leur rencontre. Il était accompagné d’un vieux Peau-Rouge qui, à la vue d’Oscar, laissa éclater sa joie.
– Bonjour, mon brave Kloum ! fit le jeune homme. Bonjour, monsieur Agénor.
Il ajouta non sans orgueil :
– Je vous présente miss Régine, ma fiancée !
Pendant que la jeune fille, toute rougissante, recevait les compliments du poète Agénor Marmousier et du Peau-Rouge, lord Burydan causait avec le capitaine.
– Avons-nous suffisamment de charbon ? lui demanda-t-il.
– Nos soutes sont pleines, milord…
– Et les approvisionnements ?…
– J’ai fait embarquer tout ce que nous avons pu trouver de mieux à Tampa comme vivres frais ; avec les provisions du bord, nous pourrions presque faire le tour du monde.
– C’est bien, capitaine. Je ne vois pas trop alors ce qui peut nous empêcher de partir ?
– Les feux sont allumés. On va lever l’ancre. Dans un quart d’heure nous aurons appareillé.
Après avoir donné des ordres, qui furent exécutés avec une rapidité et une précision toutes militaires, lord Burydan ne s’occupa plus que de ses invités.
Une grande tente de coutil avait été dressée à l’arrière du yacht. Chacun prit place sur de légers et confortables sièges de bambou, et l’on se prépara à admirer les beaux paysages qui allaient se succéder sans interruption jusqu’à la fin de l’excursion.
Déjà les ancres avaient été levées, le mécanicien forçait ses feux et la ville de Tampa, avec ses maisons blanches sur un ciel d’un bleu cru, ses palmiers et son petit port somnolent, commençait à décroître à l’horizon.
La côte, profondément découpée, se déployait dans toute sa majesté sauvage, avec ses récifs, ses golfes que bordaient de vieux palétuviers, dont les racines trempaient jusque dans la mer.
De loin en loin, sur ce rivage désert, on apercevait une hutte couverte de feuilles de palmier ou l’embarcation d’un nègre pêcheur de perles.
– Pauvres Noirs ! murmura miss Régine. Je les plains !
Elle montrait d’un geste effrayé deux ou trois requins qui s’ébattaient dans le sillage du yacht, et le suivaient patiemment dans l’espoir qu’on leur jetterait quelque chose en pâture.
– Ces Noirs n’ont pas aussi peur des requins que vous le croyez, expliqua lord Burydan. Ils sont habitués à cette pêche depuis l’enfance et ils sont tous armés de coutelas affilés à l’aide desquels ils savent parfaitement se défendre.
– Qu’est-ce que c’est que ces ruines ? interrompit tout à coup Agénor, et comme ce paysage a l’air désolé !
L’Ariel côtoyait, en ce moment, une région du plus sinistre aspect ; le rivage était parsemé d’un amoncellement de roches déchiquetées qui devaient le rendre inabordable. Derrière cette bande de récifs s’élevait une côte marécageuse, au centre de laquelle se dressait un clocher entouré de maisons en ruine.
– Voici la tour fiévreuse, dit gravement Burydan à son ami Agénor, qu’il attira un peu à l’écart. C’est à cette place même qu’ont péri plusieurs des navires de la Compagnie des paquebots Éclair.
– Je sais déjà, par votre dernière lettre, que vous avez brillamment et rapidement conduit cette enquête. Vous êtes toujours sûr que c’est bien la Main Rouge qui a causé ces naufrages ?
– Absolument. Vous allez comprendre comment les choses se passaient. Vous voyez là-bas, à une dizaine de milles vers le sud, ce petit phare blanc ? Il commande l’entrée du golfe d’Oyster Bay qui, par les tempêtes, peut servir de refuge aux navires. Les gardiens de ce phare – deux Noirs actuellement sous les verrous – étaient affiliés à la Main Rouge. Lorsque l’un des paquebots de la compagnie de Fred Jorgell quittait La Nouvelle-Orléans, son départ était signalé aux naufrageurs.
« En cette saison-ci, les tempêtes sont fréquentes et terribles. Qu’arriverait-il ? Le capitaine du steamer, croyant trouver un refuge dans le golfe d’Oyster Bay, gouvernait droit sur le feu qu’il apercevait et que lui signalait sa carte marine. Mais ce feu n’était plus à la même place ; les gardiens du phare avaient éteint le leur, et il en brillait un autre au sommet même de cette tour fiévreuse, que nous apercevons d’ici. Immanquablement le steamer allait se briser sur les récifs.
– Ce sont là des faits très graves, répliqua Agénor devenu pensif. Trois personnes seules peuvent avoir intérêt à faire sombrer les paquebots de Fred Jorgell.
– Je parie que vous avez la même idée que moi ?
– Je ne sais. Mais la ruine de la Compagnie des paquebots Éclair ne peut intéresser que ses adversaires financiers, c’est-à-dire Joë Dorgan, Cornélius et Fritz Kramm.
– C’est bien ce que je m’étais dit. Et savez-vous que c’étaient les mêmes bandits, qui ont pillé l’hacienda de San-Bernardino et blessé presque mortellement Pierre Gilkin, qui attiraient les paquebots sur les brisants ?
– Voilà qui est extraordinaire !
– L’un d’eux, continua lord Burydan, n’était autre que ce Slugh qui joua si bien le rôle de capitaine de la Revanche et qui, à l’île des pendus, réussit, je ne sais comment, à nous glisser entre les doigts.
– L’avez-vous capturé ?
– Non. Il nous a encore échappé, mais il doit avoir eu le même sort que son complice, Edward Edmond, dont on a retrouvé le squelette parfaitement nettoyé par les fourmis rouges et par les reptiles du marais.
Lord Burydan raconta alors, dans le plus grand détail, la façon dont Dorypha avait été sauvée, et il lui apprit que la gitane ainsi que son mari Pierre Gilkin, tous deux grièvement malades à la suite des privations et des blessures, étaient en ce moment soignés dans un pavillon isolé dépendant de l’habitation de Mr. Bombridge.
Agénor, à son tour, mit lord Burydan au courant des projets de Fred Jorgell. Celui-ci se proposait d’acheter l’immense marécage qui entourait la tour fiévreuse, d’y faire creuser des canaux qui transformeraient en eaux vives les mares croupissantes, et d’assainir cette région maudite par des plantations d’eucalyptus, de peupliers et des cultures d’une variété de pommes de terre d’origine brésilienne, le solarium commersoni, qui réussit admirablement dans les terrains humides.
Auparavant, les moustiques devaient être détruits par le pétrolage, et l’on devait pour exterminer les reptiles, se servir de ces serpents chasseurs, inoffensifs pour l’homme, tels que la mussurana, qui débarrassent en peu de temps toute une région des animaux venimeux qu’elle renferme.
Ce projet, qui serait mis à exécution sitôt que Fred Jorgell serait affranchi de certains soucis immédiats, devait être complété par la construction d’un phare dont la tour fiévreuse fournirait les matériaux, et par la destruction des récifs à l’aide de la dynamite.
Pendant que lord Burydan et Agénor conversaient ainsi, l’Ariel s’éloignait à toute vapeur de ces dangereux parages et la tour fiévreuse disparut bientôt dans l’éloignement.
Le paysage avait changé du tout au tout. De hautes forêts de palmiers, d’acajous et de cèdres ondulaient à perte de vue, les plages étaient couvertes d’un sable fin et brillant, et de jolis villages de pêcheurs se reflétaient indolemment dans l’eau bleue.
On déjeuna sur le pont. Miss Régine, dont l’air vif de la mer avait excité l’appétit, fit honneur à la cuisine du bord, qui, d’ailleurs, ne le cédait en rien à celle qu’on eût pu lui servir à la villa paternelle.
Dans l’après-midi, on doubla le cap Sable et l’on côtoya les petites îles dont est parsemé le canal de la Floride.
Vers le soir, chacun se retira dans sa cabine. Mr. Bombridge, en souhaitant le bonsoir à lord Burydan, lui demanda quand on atteindrait Sainte-Lucie.
– Demain, sans nul doute, répondit l’excentrique.
Tous deux se séparèrent en échangeant un cordial shake-hand.
Le lendemain matin, Mr. Bombridge monta de bonne heure sur le pont. Quelle ne fut pas sa surprise en constatant que les côtes de la Floride avaient complètement disparu. De tous côtés, c’étaient le ciel et la mer immense et bleue.
Le « roi des escargots » – car tel est le titre que les journaux commençaient à lui donner – demeura absolument stupéfait. Il se frottait les yeux pour s’assurer qu’il était bien éveillé, et il se demandait avec inquiétude si, une fois de plus, il n’était pas victime de quelque subtile machination des bandits de la Main Rouge.
Il remarquait avec une certaine inquiétude que l’Ariel, pourvu des nouveaux moteurs inventés par Harry Dorgan, filait avec la rapidité d’un express ordinaire.
D’ailleurs, personne sur le pont.
De plus en plus inquiet, il se dirigea vers l’avant, et, avisant un mousse, il lui demanda si on pouvait voir le capitaine. Le mousse répondit que le capitaine était toujours visible et conduisit Mr. Bombridge jusqu’à la cabine de l’officier.
Celui-ci fit comprendre à son interlocuteur, avec la plus exquise politesse d’ailleurs, qu’il ne pouvait lui fournir aucun renseignement sur la marche du navire, milord ayant recommandé la plus grande discrétion à cet égard.
– Mais, répliqua Bombridge suffoqué d’étonnement, je suis un ami de lord Burydan.
– C’est peut-être, alors, dit le capitaine, qu’il veut avoir le plaisir de vous renseigner lui-même. Et tenez, d’ailleurs, le voilà !
Il montrait lord Burydan qui, vêtu d’un élégant complet de flanelle rayée et coiffé d’un vaste panama, se promenait nonchalamment à l’arrière.
Mr. Bombridge s’empressa d’aller le trouver.
L’excentrique ne put s’empêcher de sourire en voyant la mine déconfite de son passager.
– Ah ça ! lui dit-il, mon cher Bombridge, vous avez ce matin un air d’enterrement.
– Dame, répliqua piteusement le roi des escargots, avouez qu’il y a de quoi. Je m’embarque hier pour une petite excursion et je me réveille en plein Atlantique.
– Il est de fait, répondit lord Burydan avec le plus grand sang-froid, que nous côtoyons en ce moment-ci la mer des Sargasses…
– J’en étais à me demander si je n’étais pas victime de quelque complot de la Main Rouge.
– Non, dit en riant lord Burydan. Le seul coupable, c’est moi ! Je n’ai pu résister au plaisir de vous jouer un tour de ma façon. Ne m’avez-vous pas dit, hier, que vous pourriez vous absenter plusieurs mois sans que vos intérêts eussent à en souffrir ?
– Oui, repartit l’ex-clown avec mécontentement. Encore faut-il que je prévienne mon monde, que je donne des ordres !
– Soyez tranquille, l’Ariel est pourvu d’appareils de télégraphie sans fil. Vous voyez que tout a été prévu.
– Mais enfin, milord, demanda Mr. Bombridge prêt à se fâcher, où me conduisez-vous ?
– Au Canada, répondit l’excentrique avec le plus grand sang-froid.
Le roi des escargots était tellement abasourdi qu’il ne trouva pas un mot à répondre.
– Ah ça ! murmura-t-il enfin, c’est une mauvaise plaisanterie ?
– Rien n’est plus sérieux, je vous assure.
– Mais que vont dire ma fille et mon futur gendre ? Et puis, d’abord, qu’est-ce que je vais faire au Canada ?
– Rassurez-vous. Primo, miss Régine et Oscar sont du complot…
– C’est très mal de leur part.
– Et vous serez le premier à me remercier de vous avoir emmené. N’avez-vous pas manifesté le désir de me voir assister au mariage de miss Régine ?
– Oui, mais !…
– Non seulement j’assisterai à ce mariage mais vous assisterez au mien. Apprenez, mon cher Bombridge, que je vous invite à ma noce, qui aura lieu en même temps que celle d’Oscar et de votre fille.
– Je vois, reprit Mr. Bombridge qui avait pris rapidement son parti de la situation, qu’il n’y a vraiment pas moyen que je me fâche. Je vous dois assez de reconnaissance pour ne pas prendre mal cette facétie…
– Qui cache au fond une bonne intention… D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que l’on m’a surnommé l’excentrique.
Miss Régine et Oscar, qui avaient attendu la fin de cette explication pour paraître sur le pont, se montrèrent alors en riant aux éclats et félicitèrent lord Burydan d’un enlèvement si bien conduit et si bien réussi.
À ce moment, un marin apporta à l’excentrique un marconigramme que venaient d’enregistrer les appareils du bord.
– Tiens ! dit le jeune lord après l’avoir parcouru, voici du nouveau. Savez-vous qui l’on vient de retrouver muré dans les décombres de la tour fiévreuse ?… Slugh lui-même, le fameux Slugh ! C’est un vieux Noir, dont la manie est de chercher les trésors, qui s’est aperçu qu’une muraille avait été fraîchement réparée. Il a pratiqué un trou, et il a découvert le bandit encore vivant, mais dans un état lamentable.
– Et qu’en a-t-on fait ? demanda Bombridge.
– On l’a transporté chez vous. Mais, s’il en réchappe, je vais donner des ordres pour qu’il soit mené sous bonne escorte au Canada. C’est par lui, j’en suis sûr, que nous arriverons à découvrir les grands chefs de la Main Rouge.
– Hum ! le voudra-t-il ?
– Peu importe ! J’emploierai les moyens nécessaires pour arriver à mon but. À tout à l’heure. Je veux moi-même m’occuper de ce gredin, à la capture duquel j’attache une grande importance.
Et lord Burydan rentra précipitamment dans la cabine où se trouvaient les appareils de télégraphie sans fil, dont il connaissait à fond le maniement.
CHAPITRE III
Le dément de la Maison Bleue
Le printemps canadien offre une vigueur et une puissance que l’on ne trouve dans aucun autre pays du monde ; la couche épaisse de neige et de glace dont la terre a été couverte pendant de longues semaines fond en quelques jours. Soudainement réveillée, la généreuse nature semble alors user de toute sa puissance créatrice et fécondante, et se hâte de recouvrir le sol d’un décor verdoyant.
Alors s’épanouissent, comme par enchantement, les violettes blanches, bleues et roses, les orchidées, les tournesols, les lis tigrés et mille autres fleurs.
La majestueuse avenue d’érables, de frênes noirs et de bouleaux qui conduisait au château de lord Astor Burydan, dans le district de Winnipeg, commençait à prendre un aspect attrayant. Les oiseaux voletaient joyeusement dans les taillis, qui se couvraient de bourgeons et de pousses nouvelles ; un gai soleil montrait, dans le lointain, les toits bleus et les girouettes dorées du château.
La matinée était radieuse, et lord Burydan, marié depuis quelques semaines à peine, contemplait, en proie à une douce songerie, ces jeunes et printaniers horizons, lorsqu’une lourde automobile, peinte en gris et dont la construction n’offrait rien de luxueux, s’avança lentement dans l’avenue seigneuriale.
Le chauffeur qui la pilotait était d’une stature colossale. Sous son veston de cuir, on voyait se gonfler d’énormes biceps, et ses épaules, d’une imposante carrure, suggéraient tout de suite l’idée que cet hercule eût pu facilement soulever le pesant véhicule qu’il conduisait.
À la vue de l’auto, l’excentrique avait eu un geste brusque, et il n’avait pu réprimer un tressaillement. Son visage souriant était subitement devenu grave.
La voiture, après avoir traversé la cour d’honneur, où rien ne subsistait plus des sordides vestiges qu’avait laissés derrière lui Mathieu Fless, vint stopper devant le perron, maintenant orné de deux nymphes de bronze et de beaux vases de marbre.
– Bonjour, mon brave Goliath, fit lord Burydan en prenant la main du géant qui le gratifia d’un shake-hand capable de tordre une barre de fer. Eh bien ! le voyage s’est-il passé sans incident ?
– Oui, milord ! Il ne s’est produit rien de remarquable. Suivant votre recommandation, on a fait respirer au prisonnier, quelque temps avant de passer la frontière, le flacon qui nous avait été remis à cet effet. Nous avons dit aux douaniers que nous escortions un gentleman dangereusement malade, et ils n’ont pas fait la moindre observation.
– Bien. J’aime mieux que les choses se soient passées de cette façon.
– Où faut-il conduire notre homme ?
– Je vais vous l’indiquer moi-même… Mais ne demeurez pas en face du perron. Je serais désolé que lady Burydan et ses amis aperçoivent la figure de ce hideux coquin.
Goliath remonta sur son siège, fit effectuer à l’auto un savant virage, et la conduisit dans une petite cour située derrière une des ailes du château. Alors seulement Goliath ouvrit la portière, qui était d’une solidité exceptionnelle et qui fermait à clef.
Deux hommes descendirent de l’intérieur du véhicule. L’un n’était guère moins robuste que Goliath lui-même ; l’autre portait le bras en écharpe et était pâle et affaibli.
Le premier n’était autre que le nageur Bob Horwett. Il était toujours au service d’Harry Dorgan. Celui-ci, à la demande de lord Burydan, lui avait confié la mission délicate de conduire Slugh de la villa de Mr. Bombridge jusqu’au château que l’excentrique possédait sur la rive du lac Winnipeg.
Le bandit gardait un silence farouche, et, quoiqu’il parût considérablement déprimé, il relevait de temps en temps la tête avec fierté et lançait un regard de défi à ses ennemis.
– J’ai pris toutes les dispositions nécessaires, expliqua lord Burydan, pour loger ce scélérat de façon qu’il lui soit impossible de s’échapper : les fenêtres de la chambre du premier étage, qu’il va occuper, sont munies de barreaux de fer gros comme le poignet ; la porte de chêne est blindée et elle donne sur une pièce où l’un de vous deux, soit Goliath, soit Bob Horwett, devra se tenir en permanence.
– Nous nous relayerons de trois heures en trois heures, dit Bob Horwett.
– Faites comme il vous plaira. L’essentiel est que Slugh ne reste jamais sans surveillance… Si même vous avez besoin d’un renfort…
– Inutile, fit Goliath ; à nous deux nous suffirons parfaitement à cette tâche… Et, si le misérable faisait la moindre tentative pour s’échapper, je l’aplatirais comme une nèfle !
Et le géant leva ses formidables poings, avec lesquels il se faisait un jeu de briser une noix de coco d’un seul coup ou de tuer un bœuf d’un horion bien asséné sur le crâne.
– Je vous le confie, dit lord Burydan en remettant à Bob Horwett les clefs de la chambre du premier.
Il ajouta, après avoir consulté sa montre :
– Je vous quitte. Si vous avez besoin de quelque chose, ne vous gênez pas pour le demander.
– Ma foi, dit Goliath, je mangerais bien un morceau !
Il montrait une rangée de dents qui eussent fait honneur à un jeune requin.
– Je crois, fit lord Burydan, qu’il ne serait pas prudent de vous laisser longtemps sans manger… Mais, rassurez-vous, vous étiez attendus, et votre couvert est mis là-haut. Vous verrez que vous serez contents de la cuisine canadienne !
Lord Burydan, quittant en hâte Slugh et ses gardiens, traversa le château dans toute sa largeur et arriva sur le perron où déjà se trouvaient Mr. Bombridge, son gendre Oscar, Agénor et le célèbre naturaliste Bondonnat.
– Ces dames vont nous mettre en retard ! s’écria Bombridge avec impatience.
– Rassure-toi, père ! s’écria une voix joyeuse.
Mistress Régine apparut au seuil de la porte du château.
Elle était suivie à peu de distance par lady Ellénor Burydan (la dame aux scabieuses) et ses amies Mme Andrée Paganot et Mme Frédérique Ravenel. Étincelantes de beauté, radieuses de santé et de bonheur, les quatre jeunes femmes portaient de simples mais exquises toilettes de printemps. M. Bondonnat les contempla quelques instants avec attendrissement.
– Mesdames, dit lord Burydan, je vous annonce l’arrivée au château d’un hôte de distinction… une de nos vieilles connaissances, d’ailleurs.
– Qui donc ? demanda curieusement Frédérique.
– Le capitaine Slugh en personne. Cet honorable gentleman est venu villégiaturer quelque temps près de nous pour se remettre des suites d’une blessure reçue au service de la Main Rouge.
– Vous voulez plaisanter, milord, murmura Frédérique avec effroi. Je ne dormirai pas tranquille si je sais que cet exécrable bandit habite sous le même toit que nous.
– Rassurez-vous, belle dame ; il est dans une cellule solidement grillée, et, de plus, je lui ai donné comme gardiens le champion des nageurs Bob Horwett et le géant Goliath, qui brise des chaînes et rompt une barre de fer entre le pouce et l’index comme si ce n’était qu’un bâton de guimauve.
– Pourquoi donc, mon cher Astor, dit tendrement lady Burydan, vous préoccupez-vous de ces misérables ? Ne sommes-nous pas heureux ?
– Oui, ma chère amie, vous avez raison, nous sommes très heureux. Mais nous ne continuerons à l’être qu’à la condition de triompher des ennemis qui nous ont fait tant de mal, à vous comme à moi et à nos amis. Je me suis juré d’exterminer la Main Rouge, et j’y réussirai !
Pendant que ces propos s’échangeaient, un superbe mail-coach, attelé de quatre chevaux irlandais que les palefreniers avaient peine à maintenir, vint s’arrêter en face du perron. Tout le monde s’installa sur les banquettes du véhicule. Lord Burydan prit en mains les guides. L’équipage partit à fond de train, pendant qu’Oscar, embouchant la trompe, réveillait, par de joyeuses fanfares, les échos endormis.
Régine s’était assise près de lady Ellénor, car il y avait entre la grande dame et l’ancienne écuyère une profonde sympathie. Ce n’était pas sans une vraie contrariété que la dame aux scabieuses voyait Régine et son mari quitter le château.
Le mail-coach traversait en ce moment des bois de merisiers rouges en pleine floraison et de bouleaux dont la sève exhalait une aromatique senteur.
– Regardez, Régine, fit Ellénor, vous partez au bon moment. Jamais la campagne canadienne n’est plus agréable.
– Je n’oublierai jamais, croyez-le, milady, répondit Régine avec une sincère émotion, les heureux jours que j’ai passés près de vous. Mais notre villégiature ne pouvait se prolonger davantage. Mon père ne peut négliger plus longtemps l’exploitation qu’il dirige. Et, vous le savez, lord Burydan lui-même a chargé mon mari et M. Agénor de courses très importantes à New York.
– Mais vous reviendrez ?
– Certainement. De votre côté, il ne faudra pas oublier que nous vous attendons cet hiver en Floride. Quand vos forêts canadiennes seront ensevelies sous une épaisse couche de neige et de glace, vous serez heureuse de vous retrouver à l’ombre des palmiers et des orangers, parmi les bosquets en fleurs de nos jardins.
– Je viendrai vous voir, je vous le promets encore.
– Et nous aussi, dirent d’une même voix Andrée et Frédérique, qui avaient suivi distraitement la conversation.
Pendant que les quatre jeunes femmes arrangeaient pour l’avenir des projets de villégiatures et d’excursions, le mail-coach, dévorant la distance, entrait dans la ville de Winnipeg, qu’il traversait en coup de vent, et venait s’arrêter en face de la gare.
Tout le monde mit pied à terre, et, pendant que les domestiques s’occupaient de l’enregistrement des bagages, Régine fit ses adieux à ses trois amies.
Pendant ce temps, lord Burydan et M. Bondonnat adressaient à Oscar et à Agénor leurs dernières recommandations.
– Avant tout, dit M. Bondonnat, je vous prie de m’envoyer les rapports détaillés qui doivent exister au Police-Office sur la façon dont a été opérée l’arrestation de l’assassin Baruch.
– Un autre document qui nous sera indispensable, interrompit lord Burydan, c’est une liste à peu près complète des guérisons et transformations officiellement opérées par le docteur Cornélius.
– Je ferai de mon mieux, répondit Oscar, pour vous adresser des notices intéressantes.
– D’ailleurs, interrompit Agénor, vous savez sans doute que Fred Jorgell a mis en campagne plusieurs détectives habiles, qui certainement découvriront des faits nouveaux…
Cette conversation durait encore lorsque le train entra en gare avec un fracas de tonnerre. Mr. Bombridge et Régine, Oscar et Agénor adressèrent un dernier adieu à leurs amis et prirent place dans le compartiment de luxe qui leur avait été réservé.
Le train allait s’ébranler lorsque lord Burydan cria de loin à Mr. Bombridge, qui le saluait à l’une des portières :
– J’ai oublié de vous dire qu’il ne faut pas manquer de m’envoyer des nouvelles de Dorypha et de son mari.
Mr. Bombridge fit un signe d’assentiment au moment où le train partait.
Lady Ellénor et ses deux amies avaient quelques emplettes à faire à Winnipeg : il fut convenu que les domestiques conduiraient le mail-coach jusqu’à la sortie de la ville, lord Burydan et M. Bondonnat ayant de leur côté des visites à faire.
Pendant que les trois jeunes femmes couraient les magasins, l’excentrique et le vieux savant se dirigeaient pédestrement vers la demeure de Mr. Pasquier, un homme de loi très intègre et en même temps un ami de lord Burydan, auquel celui-ci avait confié l’administration d’une part importante de ses revenus. C’était Mr. Pasquier qui avait aidé lord Burydan, après son internement au Lunatic-Asylum, à faire reconnaître ses droits et à expulser le baronnet Mathieu Fless des domaines de son parent, dont il était indûment entré en possession.
Le légiste canadien fit à son riche client l’accueil le plus cordial, et il introduisit ses visiteurs dans le cabinet de travail, simple mais confortable, où il passait en général toutes ses matinées.
– Eh bien ? demanda lord Burydan, les politesses ordinaires une fois échangées, comment va votre pensionnaire ?
Mr. Pasquier hocha la tête.
– La santé de Mr. Clark, murmura-t-il, est excellente, sauf sur un point : il est toujours aphasique, et je crois bien qu’il ne recouvrera jamais la parole.
– Qui sait ? murmura M. Bondonnat, devenu tout à coup pensif. J’ai vu des guérisons plus extraordinaires. La science connaît à peine ce que sont les maladies nerveuses. Je crois, moi, que nous pouvons encore espérer.
– Vous voudriez peut-être voir le malade ? demanda Mr. Pasquier.
– Mais oui, fit lord Burydan. Je suis sûr que ma visite lui fera plaisir. J’ai d’ailleurs à m’entendre avec lui sur certains points.
– Je crois, déclara M. Bondonnat, qu’il vaut mieux que je ne vous accompagne pas.
– En effet…
– Inutile de me montrer le chemin, dit l’excentrique à Mr. Pasquier qui s’était levé ; je connais la maison.
Lord Burydan sortit du cabinet de travail, traversa un beau jardin à la mode française, aux allées bordées de buis, et alla frapper à la porte d’un corps de logis isolé, construit un peu en retrait du bâtiment principal.
À la demande de son ami, Mr. Pasquier avait consenti à céder cette partie de sa maison à Mr. Clark, ou plutôt au milliardaire William Dorgan dont il ignorait la véritable personnalité.
Un domestique attaché spécialement au service du malade introduisit lord Burydan dans un luxueux petit salon où bientôt William Dorgan lui-même ne tarda pas à paraître.
Depuis la terrible catastrophe du pont de Rochester où il avait failli périr, le vieillard avait beaucoup changé.
Ses cheveux étaient devenus complètement blancs et sa physionomie, sillonnée de rides, était empreinte de cette mélancolie que l’on rencontre chez presque tous ceux qui sont privés de la parole.
William Dorgan s’était levé avec empressement en apercevant lord Burydan, pour lequel il avait une affection toute paternelle.
Le vieillard s’était emparé de ses tablettes et il traça rapidement :
« Ma réclusion va-t-elle bientôt prendre fin ? Touchons-nous au dénouement ?… »
– Encore un peu de patience, répondit l’excentrique. Vous savez que, dans la partie que je joue contre la Main Rouge, une démarche imprudente pourrait avoir les conséquences les plus graves. Je suis venu précisément vous trouver avant de prendre certaines résolutions…
« Ne vous ai-je pas dit cent fois, écrivit le milliardaire, que j’approuvais d’avance tout ce que vous feriez ? »
– Il y a pourtant des choses au sujet desquelles il faut que je vous consulte.
Une discussion s’engagea et ce ne fut qu’au bout d’une demi-heure que lord Burydan sortit de chez William Dorgan. Il paraissait très satisfait.
Dans le cabinet de l’homme d’affaires, il retrouva M. Bondonnat, et tous deux, après avoir échangé quelques paroles de politesse avec Mr. Pasquier, prirent congé de lui et se rendirent à l’endroit où le mail-coach les attendait.
Les trois jeunes femmes étaient déjà au rendez-vous et les domestiques achevaient de les débarrasser des nombreux cartons dont elles s’étaient chargées chemin faisant.
On remonta en voiture et l’on se dirigea à une vive allure vers le château.
À moitié route, lady Ellénor et ses amies déclarèrent qu’elles voulaient descendre et regagner le château à pied.
Par ce beau soleil, dans cette campagne diaprée de fleurs, égayée par le ramage de milliers d’oiseaux, la promenade serait charmante.
Lord Burydan accéda de grand cœur à la demande de sa femme.
– Accordé, dit-il. Nous ne déjeunerons donc guère que dans une heure et demie. Je vais en profiter pour pousser jusqu’à la Maison Bleue avec M. Bondonnat.
– Avec M. Bondonnat, répéta Frédérique un peu surprise.
La jeune femme savait en effet que son père avait toujours refusé d’aller à la Maison Bleue, en ce moment habitée par Noël Fless, chez lequel était soigné l’assassin Baruch depuis son évasion du Lunatic-Asylum.
Jusqu’à ce jour le vieillard avait éprouvé une horreur insurmontable à la seule pensée de se trouver en présence du meurtrier de son ami, M. de Maubreuil.
– Oui, s’écria lord Burydan, M. Bondonnat m’accompagne.
– Il le faut ! dit le vieillard d’un ton grave.
Les trois jeunes femmes s’étaient dispersées dans le sous-bois. Longtemps encore, on aperçut leurs robes claires briller comme de grandes fleurs à travers les taillis qui n’avaient pas encore de feuillages, longtemps on entendit leurs rires joyeux jeter dans l’air limpide leurs notes cristallines.
Lord Burydan et M. Bondonnat se trouvaient seuls sur la plate-forme du mail-coach ; les domestiques, qui s’étaient assis à l’intérieur du véhicule, ne pouvaient les entendre ; aussi, leur entretien prit-il tout de suite une allure confidentielle.
– William Dorgan, dit M. Bondonnat, sait donc maintenant que vous m’avez appris qu’il vivait encore ?
– Oui, et il n’en a paru nullement mécontent. Mais il tient beaucoup à ce que vous soyez la seule personne qui soit au courant de ce secret.
– Cependant, Harry Dorgan et mistress Isidora, ne faudrait-il pas les prévenir ?
– Leur père s’y oppose formellement. « Il n’est pas encore temps », a-t-il dit.
– Peut-être a-t-il raison, somme toute ? murmura le vieux savant.
Il y eut un moment de silence. On n’entendit plus que le grondement d’un torrent qui coulait à gauche de la route et dont le bruit se rapprochait de minute en minute.
– C’est ce Ruisseau rugissant dont vous m’avez parlé ? demanda le vieillard.
– Oui, c’est ce cours d’eau qui sépare mes domaines de ceux de Mr. Pasquier. Vous verrez tout à l’heure le joli pont de pierre que j’ai fait construire à la place de la passerelle vermoulue dont ce vieux coquin de Mathieu Fless – justement surnommé le baron Fesse-Mathieu – avait fait scier les poutres pour que je me noie dans le torrent ; de cette façon, il serait demeuré seul en possession de mon château et de mes domaines.
– Qu’est devenu ce vieux ladre ?
– Il s’est retiré sur ses terres qui sont presque aussi vastes que les miennes. Il n’est pas à plaindre, croyez-le. J’ai appris qu’il était furieux de mon mariage.
– Je comprends cela.
– Ne parlons pas trop haut du baron Fesse-Mathieu !
Montrant de loin, à travers les arbres, la masse élégante d’un chalet à balcons, à larges auvents et au toit couleur d’azur, lord Burydan ajouta :
– Voici la Maison Bleue. Et c’est là que demeure mon cousin, Noël Fless, le fils du baron Fesse-Mathieu lui-même.
Le mail-coach roulait, en ce moment, dans un chemin de traverse tapissé de gazon et qui courait en zigzag à travers les futaies. Lord Burydan laissait ses chevaux marcher au pas.
De même que M. Bondonnat, au moment de franchir le seuil de la Maison Bleue, il éprouvait une profonde émotion.
– Je vous avoue, dit le savant, que je vais avoir besoin de tout mon courage pour supporter la présence de ce misérable.
– Soyez ferme jusqu’au bout. Je vous ai fait part de l’étrange conclusion à laquelle, de raisonnement en raisonnement, de déduction en déduction, j’ai fini par aboutir. Il se pourrait bien que je sois dans le vrai. Et, pour en arriver à une certitude, vos lumières me sont absolument indispensables.
– Eh bien, soit ! dit M. Bondonnat avec fermeté. Nous sommes arrivés. Je suis prêt !
Les domestiques s’élancèrent à la bride des chevaux. Le lord et son ami descendirent et furent accueillis, dès le seuil de la maison, par une robuste et souriante jeune femme, qui se hâta de poser sur un coussin l’enfant qu’elle était en train d’allaiter pour aller au-devant du lord.
Mistress Ophélia était blonde, avec un teint délicatement rosé et des yeux d’un bleu limpide, qui exprimaient la tendresse et la bonté. Elle trouvait le moyen d’être distinguée, tout en offrant une splendeur de formes et une robustesse bien canadiennes.
– Comment allez-vous, ma cousine ? s’écria lord Burydan en déposant un baiser sur les joues rebondies de mistress Ophélia.
– À merveille, mon cher cousin ! Mais que nous vaut le plaisir de votre visite ? Vous nous délaissez, ainsi que mistress Ellénor et ses gentilles amies les Françaises. Il y a huit jours au moins que l’on ne vous a vus.
– Nous avons été si occupés ! Mais nous ne vous oublions pas. Noël est-il ici ?
– Hélas ! non, répondit mistress Fless. Il est parti ce matin, de très bonne heure, pour visiter une coupe de bois, et ne rentrera que ce soir.
– Tant pis ! Sa présence n’est du reste pas absolument nécessaire.
– De quoi s’agit-il ?
– Voici mon savant ami M. Bondonnat, que j’ai amené tout exprès pour examiner notre malade.
– Je doute fort que personne puisse le guérir. Le pauvre innocent est, en ce moment, dans le jardin, où il prend beaucoup de plaisir à sarcler, à émonder les haies… Je vais l’appeler.
M. Bondonnat était retourné, pendant ce temps, jusqu’au mail-coach, et il avait pris dans la caisse de la voiture une longue boîte. Il rejoignit lord Burydan au moment même où l’évadé du Lunatic-Asylum se présentait tout effaré devant les visiteurs. Il était vêtu d’un habit de gros drap, sa physionomie était fine et distinguée, mais ses yeux conservaient une expression de vague et d’hébétude.
M. Bondonnat l’examina quelque temps avec attention et, tout à coup, un cri s’échappa de ses lèvres :
– Ce n’est pas Baruch ! Je ne le reconnais pas ! Il est impossible que ce soit là l’assassin de M. de Maubreuil !…
– Regardez, dit lord Burydan à l’oreille du vieux savant.
Et il tendit au jeune homme un carnet et un crayon.
– Inscrivez votre nom, lui dit-il.
Sans hésitation, l’innocent écrivit très lisiblement ces mots : Joë Dorgan.
– Que dites-vous de cela ? fit lord Burydan.
– C’est effrayant ! murmura le vieillard. Je n’ose croire encore que vous ayez raison. C’est d’une invraisemblance presque folle. Voulez-vous que j’essaye d’examiner le malade à l’aide des rayons X ? C’est peut-être comme cela que nous arriverons à connaître la vérité.
– Ah ! encore un instant, s’il vous plaît ! Voici une lettre écrite par Joë Dorgan avant sa captivité chez les tramps. Comparez les deux signatures.
– Elles sont absolument identiques ! Il faut vraiment que vous ayez raison…
– Attendez ! je n’ai pas fini ! Je vais ordonner à ce malheureux d’écrire le nom de Baruch Jorgell, soi-disant son propre nom.
Le dément obéit avec docilité, mais il mit beaucoup de temps et d’effort à tracer les deux mots. Et les lettres dont il se servit ressemblaient exactement à celles de la signature Joë Dorgan.
– Vous comprenez, expliqua l’excentrique, qu’il n’a ni dans la mémoire ni dans la main cette signature qui, j’en ai la certitude maintenant, n’est pas la sienne.
– Et vous concluez ? demanda M. Bondonnat en proie à une violente émotion.
– Que l’homme qui est devant nous n’est pas Baruch Jorgell ! Il ne peut être que Joë Dorgan.
M. Bondonnat ne répondit pas. Il réfléchissait.
– Dans ce cas, s’écria-t-il brusquement, le Joë Dorgan que nous connaissons serait…
– Baruch Jorgell, l’assassin lui-même merveilleusement transformé par la science diabolique de Cornélius !
– C’est presque impossible, murmura M. Bondonnat hésitant et stupéfait. Si Cornélius a été capable de réaliser un pareil tour de force, il mérite presque qu’on lui pardonne.
– C’est aller un peu loin… Avant toute chose, voyons quel va être le résultat de l’examen par les rayons X.
M. Bondonnat prit la boîte qui renfermait ses appareils, et passa dans la salle à manger où l’accompagnèrent lord Burydan, le dément et même mistress Ophélia, dont toute cette scène excitait vivement la curiosité.
Il y eut quelques instants de silence, pendant lesquels M. Bondonnat disposait méthodiquement l’écran, les tubes et les autres accessoires.
À peine l’appareil était-il braqué que des lignes confuses se précisèrent sur la surface blanche de l’écran.
– Regardez ! s’écria M. Bondonnat, c’est bien ce que je pensais !… Ce malade a été traité selon la méthode du docteur Garsuni ! Tenez ! on distingue parfaitement, sous l’épiderme, les masses de vaseline paraffinée, à l’aide desquelles on a, pour ainsi dire, remodelé un nouveau visage au sujet. Voyez encore, à certains endroits du squelette, les bourrelets et les déformations qui résultent d’opérations chirurgicales !
« Maintenant, je puis affirmer sans la moindre hésitation que nous nous trouvons en présence d’un faux Baruch, d’un homme dont le visage a été remanié, retouché par un grand chirurgien, qui lui a donné une physionomie toute différente de celle qu’il possédait auparavant.
« Reste à savoir quel est le virtuose capable d’obtenir un résultat si merveilleux…
– N’appelle-t-on pas Cornélius Kramm le sculpteur de chair humaine ? répondit simplement lord Burydan.
– Ma conviction, d’ores et déjà, est faite. Cornélius est coupable, et Baruch, le vrai Baruch, est son complice !
– Quelles sont vos intentions, cher maître ? demanda lord Burydan.
– Il me semble qu’il y a tout d’abord une chose à faire, c’est de rendre à ce pauvre diable la physionomie qu’on lui a volée.
– Est-ce possible ?
– Ce n’est pas très difficile, puisque je connais les moyens dont on s’est servi. Dès aujourd’hui, ce malade va être soumis à un traitement énergique. Je viendrai le voir deux fois par jour, et je suis sûr que, dans un délai très rapide, il aura recouvré le visage que la nature lui avait primitivement donné.
– Mais lui rendrez-vous aussi la mémoire, la raison ?
– Non, je ne le crois pas. L’opération qui a été pratiquée sur son cerveau a dû produire des lésions telles que le mal est irrémédiable…
« Puis, s’écria le vénérable savant en proie à une légère impatience, n’allons pas si vite en besogne, que diable ! Je m’engage à restituer à cet homme sa vraie physionomie, c’est bien déjà quelque chose, ce me semble. Plus tard nous verrons.
Tenant son enfant dans les bras, mistress Ophélia avait suivi les phases de cette scène avec une stupéfaction où se mêlait une terreur respectueuse. L’application des rayons X, à laquelle elle assistait pour la première fois, lui paraissait une chose diabolique et merveilleuse.
D’un mouvement irraisonné, elle s’était peu à peu écartée le plus loin possible de cet appareil étrange, qui permettait de voir ce qui se passait dans l’intérieur du corps.
M. Bondonnat lut sur son visage l’impression qu’elle ressentait, et il ne put s’empêcher de sourire.
– Ne croyez pas, mistress, dit-il, que je sois un suppôt du diable ! Mes bottines, je vous prie de le croire, ne recèlent pas un pied fourchu. Je n’emploie d’autre sortilège que la connaissance – hélas ! bien incomplète – des lois de la nature.
– Alors, demanda la jeune femme, rassurée par les paroles de M. Bondonnat et par l’expression de ses traits empreints d’une sereine bonhomie, notre « innocent » guérira ?
– Nous ferons du moins tout ce qu’il faut pour cela. Et, tenez, donnez-moi du papier et de l’encre ! Je vais vous libeller une ordonnance que vous voudrez bien faire exécuter le plus tôt possible.
Le vieillard couvrit toute une page de sa grosse écriture nette et claire comme de l’imprimé.
– C’est que, objecta mistress Ophélia, Noël est absent et ne rentrera que ce soir… Je ne pourrai l’envoyer à Winnipeg que demain matin.
Lord Burydan intervint.
– Donnez-moi l’ordonnance, fit-il, je vais expédier un domestique à la ville et la faire exécuter. Il ira et reviendra à franc étrier et sera de retour dans deux heures.
M. Bondonnat était retombé dans le silence.
Il considérait attentivement ce jeune homme aux joues roses, au regard vague, qui devait être Joë Dorgan.
Il ne retrouvait dans ce visage, d’une expression très douce, rien de la physionomie, énergique jusqu’à la cruauté, qui était celle de Baruch Jorgell.
– Je comprends ce qui est arrivé, dit-il à lord Burydan. La ressemblance a dû demeurer parfaite tant que Cornélius a eu son sujet sous la main, tant qu’il a pu contenir les efforts de la nature, qui tendaient à détruire son œuvre !
« Depuis de longs mois, le malade est hors des griffes du sculpteur de chair humaine. La nature a pu reprendre sourdement, sournoisement pour ainsi dire, son lent travail de reconstruction. Ce n’est pas encore Joë Dorgan que nous avons devant les yeux, mais ce n’est déjà plus Baruch Jorgell !
– À vous de compléter l’œuvre de la nature ! répliqua lord Burydan.
– J’y ferai tout mon possible ! s’écria modestement l’illustre savant. Le dément semblait avoir compris le sens de cette phrase.
Un éclair d’intelligence passa dans ses yeux éteints. Il se leva, s’avança jusqu’auprès de M. Bondonnat et, lui prenant la main :
– N’est-ce pas, sir, balbutia-t-il d’une voix sourde, que vous ferez tout votre possible ?
– Pourquoi donc, mon ami ? demanda le vieillard avec une violente émotion.
– Pour me guérir ! Là ! là !…
Et le dément porta la main à son front avec un geste égaré, puis il s’enfuit dans le jardin de la Maison Bleue, en poussant un hurlement sauvage.
CHAPITRE IV
Les drames du feu
En bordure des propriétés de lord Astor Burydan et de Mr. Pasquier s’étendaient, sur une longueur de plus de cinq miles, des bois et des cultures appartenant au baronnet Mathieu Fless.
Au centre de ce domaine, un des plus vastes du district de Winnipeg, s’élevait une ferme solidement construite en pierres de taille et qui avait des allures de gentilhommière.
C’est là que le vieil avare s’était retiré lorsque le retour inopiné de lord Burydan l’avait forcé d’abandonner le château de ce dernier.
Depuis le jour fatal où il avait été obligé de déguerpir de cette résidence princière, le vieillard ne décolérait pas. Il faisait expier à ses créanciers, par mille tracasseries, l’amère désillusion qu’il avait éprouvée.
Levé avant le jour, il chevauchait de ferme en ferme, monté sur une jument poussive qui eût rendu des points à Rossinante pour la maigreur, et qu’on eût crue échappée de l’abattoir d’un équarrisseur.
Le baronnet avait conservé l’aspect que nous lui connaissons. Il ressemblait, comme par le passé, au Juif errant de nos vieilles images d’Épinal. Sa barbe était seulement un peu plus longue, son visage un peu plus ridé et ses vêtements un peu plus sales.
Ses cheveux, qui flottaient sur ses épaules, étaient, comme jadis, protégés par un bonnet de peau de lièvre, qui tenait à la fois de la casquette, du béret et de la mitre épiscopale.
Il n’avait pas cessé de porter sa robe de chambre de drap vert, chaudement doublée de peaux de lapin et ingénieusement raccommodée avec des morceaux d’étoffe de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Ses doigts étaient toujours aussi crochus et aussi maigres ; ses ongles, par exemple, étaient devenus aussi longs que ceux de certains mandarins.
D’ailleurs, sa santé demeurait excellente.
Ses petits yeux noirs pétillaient toujours, aussi vifs que ceux d’un merle, derrière ses sourcils broussailleux. Et son appétit, entretenu par le régime austère que lui imposait son avarice, semblait s’accroître au lieu de diminuer avec l’âge.
Ce matin-là, le baronnet s’était levé plus tôt que de coutume. Son premier soin, en sautant à bas du canapé aux ressorts détraqués qui lui servait de lit, fut de se confectionner une soupe rafraîchissante avec de l’oseille sauvage, qu’il alla cueillir dans la clairière voisine, et des croûtes de pain sec, gardées de la veille et qu’un chien tant soit peu délicat eût refusées avec mépris.
L’avare huma avec délice ce laxatif potage jusqu’à la dernière cuillerée.
– Excellent ! murmura-t-il, entre ses dents. Au printemps, le sang a besoin d’être rafraîchi… Et, maintenant que me voilà bien réconforté, en route ! Je vais aller déjeuner chez mon fermier Flambard, qui ne demeure qu’à huit miles d’ici… une vraie promenade… et chemin faisant, je verrai si les orges et les avoines ont bonne mine.
Le baronnet se coiffa de son bonnet de peau de lièvre, prit en main son bâton de houx et se mit en route, tout guilleret. Ses jarrets étaient aussi secs et aussi nerveux que ceux d’un vieux cerf. Aussi marchait-il avec une rapidité qu’eût enviée un coureur de profession.
De temps en temps, il faisait halte, s’assurait de la bonne venue d’un de ses nombreux champs de céréales, arrachait çà et là une mauvaise herbe, et repartait de plus belle.
Il parcourut ainsi, sans ressentir le moindre symptôme de fatigue, le chemin qui le séparait de la ferme de Flambard.
Il y arriva juste à temps pour se mettre à table.
Une vaste marmite de soupe aux choux fumait, pendue à la crémaillère, et exhalait une vapeur qui chatouilla agréablement les narines de l’avare.
Le fermier, assez mécontent de cette visite, ne put s’empêcher d’inviter le baronnet à s’asseoir à la table commune.
Le nouveau convive émerveilla les valets de ferme par son appétit, car, autant le baron Fesse-Mathieu était sobre chez lui, autant il était avide et même glouton quand il dînait en ville.
De mauvais plaisants prétendaient que, semblable au serpent boa, il pouvait manger pour quinze jours.
Après avoir dévoré comme un ogre et bu comme un templier, le baronnet reçut cent dollars que lui devait son tenancier, et, bien restauré, se remit en chemin pour la ferme d’un autre de ses débiteurs, qui se trouvait à dix miles de là.
Il y arriva à la tombée de la nuit, toucha cinquante dollars et dîna.
– La journée n’a pas été mauvaise, songeait-il tout en allongeant le pas pour regagner sa demeure. Je n’ai pas trop dépensé aujourd’hui. Tout irait bien sans ces diables de sabots qui semblent s’user à vue d’œil. Il faudra que j’y mette moi-même de gros clous un de ces matins ! J’en ai déjà ramassé une dizaine qui feront parfaitement l’affaire.
Il était dix heures du soir lorsque l’avare franchit le seuil de sa cuisine.
C’est à peine s’il ressentait quelque fatigue, et, en dépit de l’usure de ses sabots, il était, somme toute, enchanté de sa journée.
Il frotta précautionneusement une allumette et s’en servit pour enflammer l’extrémité, aiguisée d’avance, d’une de ces branches de pin résineux que l’on trouve dans les tourbières. Ce luminaire répandait une fumée acre et nauséabonde ; mais il avait, aux yeux du baron Fesse-Mathieu, l’inappréciable avantage de supprimer l’emploi de la bougie, du pétrole et de tous autres éclairages dispendieux.
L’avare relut avec soin, à la lueur de ce flambeau, son livre de comptes. Puis il alla serrer son argent dans une chambre spéciale, ferma soigneusement serrures et verrous, et, enfin, fatigué d’une journée si bien remplie, il se jeta sur son lit, après avoir pris soin toutefois de se débarrasser de ses sabots et de son bonnet de peau de lièvre.
Il s’endormit presque immédiatement.
Il n’avait pas fermé les yeux depuis cinq minutes qu’on frappa rudement à la porte.
Le baronnet, en homme habitué aux alertes de ce genre, sauta rapidement en bas de son lit, s’arma du gros revolver placé sous son oreiller, et s’avança pieds nus du côté de la porte, où l’on continuait à frapper, à coups redoublés.
– Qui est là ? grommela-t-il. Passez votre chemin. Ce n’est pas une heure pour réveiller les honnêtes gens !…
Il ponctua sa phrase en faisant craquer la batterie de son arme.
– C’est moi, mon père, répondit une voix forte et claire. Moi, votre fils aîné… Ouvrez-moi vite… Le vent est glacial…
L’avare avait reconnu la voix de son fils, attaché de l’ambassade anglaise de New York et dont il n’avait pas eu de nouvelles depuis un mois. Par un reste de défiance, il ne se hâta pas d’ouvrir.
– C’est bien toi ? fit-il. Parle encore, que je sois bien sûr de ne pas me tromper.
– Mon père, je vous en prie, s’écria le visiteur avec impatience, dépêchez-vous ! La bise du nord me pique les oreilles comme un millier de fines aiguilles.
– Allons, ne t’impatiente pas ! Je crois que c’est bien toi. Je vais t’ouvrir !
Lentement, le baronnet tira les verrous, fit jouer la clef dans la serrure. Mais, d’abord il ne fit qu’entrouvrir la porte, qu’une chaîne solide maintenait entrebâillée : puis, haussant sa torche de résine d’une main et tenant son revolver de l’autre, il s’assura d’un coup d’œil circonspect que c’était bien son fils aîné qui venait heurter à son huis à cette heure indue.
Enfin, la chaîne tomba. La porte s’ouvrit toute grande, et le fils aîné du baronnet put entrer dans la cuisine.
Grand et robuste, il était engoncé jusqu’aux oreilles dans une pelisse de renard noir et coiffé d’un élégant chapeau de voyage. Entre le fils et le père, il y avait une dissemblance complète de tenue et d’allure ; l’un était aussi élégant que l’autre était sale et négligé. Mais leurs regards à tous deux brillaient du même feu cupide, et Fless le diplomate, la question d’âge mise à part, ressemblait trait pour trait à Fless l’avare.
– Comment se fait-il que tu sois ici ? demanda le baronnet à son fils avec surprise. Je ne t’attendais pas !… Tu as donc pris un congé ?
– Mon père, s’écria le jeune homme avec agitation, il n’est plus question de congé pour moi. Je viens d’être révoqué.
– Révoqué ? s’écria le vieillard avec saisissement.
– Eh bien, oui ! Et cela, grâce à mon cousin lord Burydan. Il a fait agir contre moi les hautes influences dont il dispose en Angleterre. On m’a accusé de jouer, d’avoir des maîtresses et de faire partie d’une association de bandits qui s’appelle la Main Rouge.
L’avare était hébété de stupeur et de chagrin. Il chérissait son fils aîné à sa façon. Autant il détestait Noël Fless, le mari d’Ophélia, l’habitant de la Maison Bleue, autant il aimait le diplomate. Celui-ci avait su jusqu’alors faire croire à son père qu’il était aussi « économe » que lui. Et il avait eu l’art de faire déshériter entièrement son frère Noël à son profit.
– Qu’y a-t-il de vrai dans toutes ces accusations ? demanda le baronnet avec inquiétude.
– Pas un mot. Ce sont d’atroces calomnies. Lord Burydan – qui vient de se marier exprès pour nous déshériter – ne m’a jamais pardonné d’avoir pris part à son internement au Lunatic-Asylum, de même qu’il vous en voudra éternellement, mon cher père, d’être entré un peu trop vite en possession de ses domaines quand tout le monde le croyait mort.
– Ah ! les beaux domaines ! murmura l’avare avec un soupir de regret, les belles forêts ! les bonnes terres à blé ! les beaux pâturages ! Dire que j’ai été dépouillé de tout cela !… J’en ai reçu un tel coup que je ne m’en remettrai jamais.
Le diplomate regardait avec une grimace de dégoût cette misérable cuisine sans feu, où toutes les provisions étaient représentées par un bloc de pain noir qui paraissait aussi dur qu’une pierre et qui devait avoir au moins huit jours de date. Heureusement, il avait pris la précaution de dîner à Winnipeg.
– Lord Burydan est un mauvais parent, dit-il après un moment de silence ; c’est à lui que je dois la perte de mon emploi et l’accusation qui pèse sur moi.
– Une accusation ? s’écria le vieillard, que veux-tu dire ?
– Ne vous ai-je pas dit tout à l’heure, répliqua le jeune homme avec impatience, qu’on avait prétendu que j’appartenais à la Main Rouge ?… Il vaut mieux que vous sachiez toute la vérité… Un mandat d’arrêt a été décerné contre moi et j’ai dû m’enfuir précipitamment…
Le vieillard s’était assis sur un escabeau, en proie à un véritable chagrin.
– Mais, au moins, murmura-t-il d’un air soucieux, tu n’es pas coupable ?
– Lord Burydan est cause de tout !
– Tu ne risques pas d’être arrêté ici ?
– Il faudrait pour cela me faire extrader…
Le vieillard, la tête dans ses mains, demeura plongé quelques instants dans de sinistres réflexions.
– Alors, dit-il avec amertume, te voilà réduit aux expédients, et tu viens me demander de l’argent ! Vraiment je n’ai pas de chance !
– Non, répliqua le jeune homme d’une voix sombre, je ne veux rien ! Je ne viens pas vous priver des économies que vous avez amassées avec tant de peine…
– Je n’ai pas un sou d’économies, répondit machinalement l’avare.
– C’est entendu. Mais vous seriez bien aise, j’en suis sûr, de rentrer en possession du château et des terres qui l’entourent ?
– Que faudrait-il faire pour cela ?
– Tout simplement me laisser agir à ma guise. J’ai voué à lord Burydan une haine mortelle. Il faut que l’un de nous disparaisse.
– Mais il est marié ! murmura l’avare épouvanté des sanglants projets de son fils.
– Sa femme aura le même sort que lui !
Un tragique silence plana pendant quelques minutes dans la cuisine glaciale. Ni Mathieu Fless ni son fils n’osaient dire tout haut ce qu’ils pensaient.
– Lord Burydan est un coquin, murmura enfin l’avare. Si j’étais sûr de le tuer sans courir aucun risque, je n’hésiterais pas un instant.
Le diplomate soupira bruyamment.
– C’est cela, mon père ! s’écria-t-il. Pas de faiblesse ! Pas de scrupules inutiles ! Soyons énergiques ! Je suis heureux de constater que vous partagez entièrement ma façon de voir.
Il ajouta, comme s’il eût voulu brusquer les choses et empêcher l’avare d’hésiter plus longtemps :
– Le vent est très violent cette nuit… il souffle de l’ouest… et les terres de lord Burydan sont précisément situées à l’est des vôtres.
Le vieillard avait compris.
– Tu veux mettre le feu ? demanda-t-il en tremblant de tous ses membres.
– Ai-je dit cela ?… Eh bien, je ne reviens pas sur mes paroles ! Un incendie de forêt, en cette saison, produirait des ravages incalculables. Le château est précisément situé au milieu de bois d’arbres résineux.
– Mais mes forêts, à moi ? répliqua le vieillard avec vivacité.
– Ne vous ai-je pas dit que le vent soufflait de l’ouest ?
– C’est vrai… Toutefois, quand même les bois et le château brûleraient, cela ne nous débarrasserait pas de l’excentrique ?
Le diplomate haussa les épaules.
– Vous ne m’avez donc pas compris ? murmura-t-il. L’incendie n’est que le prétexte. À la faveur du désordre causé par un pareil sinistre, il peut se passer bien des choses.
Et le misérable eut un geste significatif, en portant la main à la crosse de son revolver.
– D’ailleurs, continua-t-il, la ville de Winnipeg est trop loin pour qu’il puisse en venir du secours en temps utile.
– Mais, interrompit précipitamment le vieillard, la Maison Bleue où habitent ton frère Noël et Ophélia, sa jeune femme, se trouvera forcément englobée dans l’incendie ?
– Eh bien, tant pis ! Je déteste Noël. Tout ce que je peux lui souhaiter de mieux, c’est qu’il ne se trouve pas en face de moi pendant les quelques heures qui vont s’écouler d’ici le lever du soleil !
Le baronnet n’osa répondre.
Il était épouvanté de ce fils qu’il avait pourtant élevé suivant ses principes, et auquel il avait appris, dès sa plus tendre enfance, à mettre la richesse avant toutes les autres choses.
Le vieillard comprenait bien qu’il était trop tard pour empêcher le misérable de donner suite à son projet, et, par une réflexion rapide, il en arrivait à trembler pour lui-même et pour son trésor.
– Allons, dit précipitamment le fils de l’avare, hâtons-nous ! Les heures sont précieuses… Vous m’accompagnez ?
– Je… je ne sais !… balbutia le baronnet.
– Je vois que ça vous ennuie. Bon ! Je n’ai besoin de personne pour agir !… Ah ! une dernière recommandation… Si je ne reviens pas, n’ayez nulle inquiétude… Si j’ai réussi, je m’arrangerai pour disparaître pendant quelque temps, de façon à ce qu’aucun soupçon ne puisse tomber sur moi. J’ai sur le lac Winnipeg une petite embarcation avec laquelle je me rendrai où je voudrai. En tout cas, n’avouez jamais, quoi qu’il arrive, que vous m’avez vu ce soir !
– Bien ! bien ! murmura l’avare avec inquiétude ; bonne chance !
Le fils de Mathieu Fless avait déjà disparu dans la nuit.
*
* *
Le baron Fesse-Mathieu demeura quelque temps immobile et accablé sur le seuil. Puis, prenant subitement une résolution désespérée, il se munit de son revolver et se glissa à son tour dans la forêt.
La nuit était brumeuse et froide, un furieux vent d’ouest faisait gémir mélancoliquement le tronc élastique des sapins et semblait murmurer aux oreilles de l’avare de confuses et terribles paroles.
Le baronnet frissonna, et, enfonçant sur ses oreilles son bonnet de peau de lièvre, il se dirigea vers cette partie de sa forêt qui confinait aux propriétés de lord Burydan.
Il avait fait à peine une centaine de pas qu’à une assez grande distance, entre les arbres, il vit jaillir une petite lueur qui alla en s’élargissant lentement.
Le crépitement du brasier, qui commençait à s’allumer, parvint à ses oreilles. La lueur, pourtant, demeurait fuligineuse. Malgré le vent furieux qui l’activait, l’incendie couvait, dévorant les buissons et les brindilles jusqu’à ce qu’il eût rencontré quelque bouquet d’arbres résineux qui lui fourniraient un aliment.
Retenu par une terrible curiosité, le baronnet continua à longer le saut-de-loup qui séparait sa propriété de celle de lord Burydan.
Coup sur coup, il vit s’allumer deux autres foyers d’incendie. Un moment viendrait où les trois brasiers n’en feraient plus qu’un, où la forêt flamberait comme une torche immense, cernant le château de l’excentrique d’une mer de feu.
Une heure s’écoula.
L’incendie s’accroissait avec une imposante lenteur.
C’était comme une aurore sanglante qui se levait peu à peu entre les hauts troncs noirs des sapins, entre les troncs blancs des bouleaux et des érables.
La forêt de lord Burydan était, maintenant, recouverte d’un dôme de fumée noire d’où jaillissaient des millions d’étincelles. L’avare n’avait plus froid. Le rayonnement intense du brasier le pénétrait à travers ses haillons, et il se reculait, épouvanté de cette lueur qui montait, toujours plus terrible de minute en minute.
Tout à coup, de grands cris éclatèrent dans le silence, suivis de sons de cloche et jusqu’au bruit aigu d’une trompe d’automobile.
À travers le rideau mouvant des flammes, l’avare aperçut des ombres qui allaient et venaient avec des gestes fous. Des coups de cognée retentirent, entremêlés d’ordres brefs.
Comme cela se pratique en pareil cas, lord Burydan essayait de limiter le fléau par des abattages ; à la tête de ses serviteurs, lui-même guerroyait contre le feu envahisseur. Il était, d’ailleurs, vaillamment secondé par ses amis. Goliath faisait tomber des hêtres en trois coups de cognée. Bob Horwett, Kloum dirigeaient les serviteurs du château sur les points les plus menacés.
Puis on vit arriver une escouade de bûcherons sous la conduite de Noël Fless.
Caché derrière le tronc d’un chêne, l’avare assistait à ce poignant spectacle et, lui aussi, de son coin, se passionnait pour cette bataille contre le plus destructeur des éléments.
– Ils sont capables de venir à bout de l’incendie, grommelait-il avec rage. Voilà déjà toute une partie de préservée. Heureusement que nous avons le vent pour nous.
Une demi-heure s’écoula. Le nombre des travailleurs s’augmentait de minute en minute. La fureur de l’avare ne connut plus de bornes lorsque les deux autos et le mail-coach, expédiés en toute hâte dans les villages voisins, débarquèrent une nouvelle troupe de bûcherons.
Tous ces efforts n’auraient servi de rien si lord Burydan n’avait eu une idée de génie.
– Nous ne viendrons jamais seuls à bout du fléau, s’écria-t-il, nous ne sommes pas assez nombreux ! Que tout le monde laisse les abattages et qu’on se rende au Ruisseau rugissant.
On avait compris.
– Le lord a raison ! cria la foule des travailleurs, il faut faire un barrage ! L’eau seule est capable de lutter contre le feu !… Le torrent vaincra l’incendie !
Des pierres, des troncs d’arbres, des sacs de sable furent précipités dans le lit du torrent. En moins d’un quart d’heure un solide barrage fut élevé. Dégringolant impétueusement les pentes, les eaux se précipitèrent vers le brasier qui s’y trouvait reflété comme dans un miroir. Puis il y eut un long sifflement. Entre les éléments ennemis, la lutte commençait.
Toute la forêt fut envahie par un acre brouillard de fumée et de vapeur d’eau. Il y avait de grands arbres dont le pied était déjà entièrement baigné et qui continuaient à flamber comme des torches, en projetant de tous côtés leurs branches changées en tisons incandescents. Certains taillis formaient comme de petites îles de feu que l’action de l’eau diminuait de minute en minute et qui finissaient par s’écrouler avec un bruit strident, ne laissant à leur place qu’un grand nuage de vapeur blanche.
L’incendie n’avait heureusement pas atteint les hauteurs, de sorte que le Ruisseau rugissant, dont les eaux ne cessaient de se déverser, finit par en avoir presque complètement raison.
De sa cachette, le baronnet Fless avait suivi les péripéties de ce drame en grinçant des dents. Il voyait avec rage que son fils avait commis un crime inutile.
Mais il était écrit que le vieux coquin épuiserait, cette nuit-là, la coupe de l’horreur.
Mêlé aux travailleurs qui avaient combattu l’incendie à son début, le Peau-Rouge Kloum avait, à un moment donné, aperçu un homme qui, étendu à plat ventre et prenant les plus grandes précautions, amoncelait des brindilles sur un foyer disposé dans le creux d’un vieux sapin.
Taciturne de sa nature, Kloum ne dit rien à personne de sa découverte ; mais, se séparant de ses compagnons, il se mit à la poursuite de l’incendiaire et, avec l’habileté spéciale aux gens de sa race, il le suivit de loin, sans en être aperçu.
Au moment où le misérable, croyant son œuvre terminée, se disposait à prendre la fuite par un sentier qui aboutissait au lac, le Peau-Rouge se dressa devant lui et, avant qu’il eût eu le temps de faire un geste, lui sauta à la gorge et le terrassa.
Puis, mettant un genou sur la poitrine de l’homme ainsi abattu, il le considéra avec attention à la lueur rougeâtre de l’incendie.
– Tiens ! fit-il, le fils du baron Fesse-Mathieu ! Cela ne me surprend pas…
– Laisse-moi m’enfuir ! râla l’incendiaire à demi étranglé.
– Non ! dit froidement Kloum en armant son revolver.
– Grâce ! J’ai dans ma poche un portefeuille plein de bank-notes. Il est à toi si tu me laisses aller.
– Non.
– Au moins, murmura le fils de l’avare dans un râle, ne me tue pas maintenant ! Conduis-moi à ton maître !… Lord Burydan est mon cousin, il est l’ami de mon frère, il me fera grâce ! Tu n’as pas le droit de me tuer, toi !
– Eh bien ! je le prends ! répliqua Kloum impassible.
Et, appuyant le canon de son arme sur la tempe de son ennemi, il lui brûla la cervelle.
Le corps fut agité d’un long tressaillement, puis demeura immobile. L’héritier du baron Fesse-Mathieu était mort.
Au bruit de la détonation, un homme avait surgi brusquement de derrière le chêne où il s’était tenu caché jusqu’alors. C’était l’avare lui-même. Il se dirigea en hâte vers le corps ensanglanté, qu’il avait reconnu au premier coup d’œil, pendant que Kloum s’évanouissait, comme une ombre, dans l’épaisse fumée.
L’avare vit son fils le front troué d’une balle, la face encore hideusement crispée par une suprême grimace de haine et d’épouvante, et il n’eut pas une parole. Il souleva cette tête morte que le reflet des flammes entourait d’une auréole sanglante, effleura de ses lèvres ce front encore tiède et tomba évanoui.
*
* *
Quand il revint à lui, il se trouvait environné d’une vive clarté, des bouquets de mélèzes flambaient en jetant une lueur blanche éblouissante. Chacune de leurs branches, gonflée de sève humide, éclatait comme un feu d’artifice. C’était le bruit de ces détonations qui avait tiré le vieillard de sa torpeur.
Chose étrange, il ne vit plus à côté de lui le cadavre de son fils. Quelqu’un avait profité de son évanouissement pour l’emporter.
L’auteur de cette disparition n’était autre que Kloum. Ne sachant trop comment lord Burydan pourrait apprécier le supplice de l’incendiaire, le Peau-Rouge avait jugé prudent de porter le cadavre à l’endroit où les flammes étaient le plus ardentes.
Le baronnet regarda quelques instants autour de lui, avec hébétement. Tout à coup, il jeta un cri d’épouvante et de stupeur. Il était environné d’un cercle de flammes qui allait sans cesse en se rétrécissant.
– Le feu ! s’écria-t-il atterré, le feu !… Et c’est mon propre bois qui brûle !… Comment cela se fait-il ?…
Bondissant à travers les flammes, il s’enfuit en hurlant, droit devant lui, sans savoir ce qu’il faisait.
Voici ce qui s’était produit.
Pendant que lord Burydan, ses amis et ses serviteurs s’occupaient à combattre le fléau, le vent avait brusquement sauté de l’ouest au nord-est, et l’on s’était aperçu, à un moment donné, que c’est vers la forêt appartenant à l’avare que se déversait une pluie d’étincelles, de charbons ardents et de branches enflammées.
Tout entier à ses préoccupations, le baronnet ne s’était pas aperçu que l’incendie, rampant sournoisement au ras du sol, avait fait un long détour et l’avait peu à peu encerclé.
La barbe grillée, son bonnet de peau de lièvre roussi, il se retrouva, on ne sait comment, dans sa propre maison.
Il en ressortit presque aussitôt pour crier, appeler au secours.
Mais sa voix se perdit dans le tumulte de l’incendie.
Le feu, presque éteint dans la propriété voisine, semblait prendre pour ainsi dire une revanche en dévorant les bois qui appartenaient à l’avare.
Les bûcherons avaient été longtemps sans s’apercevoir que les bois du baron Fesse-Mathieu, eux aussi, étaient en flammes. Quand ils s’en furent rendu compte, ils refusèrent énergiquement d’aller continuer chez le baronnet leur travail de préservation.
– Ce vieil égoïste peut bien griller tout vif dans sa tanière ! dit l’un ; ce n’est pas moi qui lèverai un doigt pour le sauver.
– Il n’a jamais secouru personne, dit un autre. Il n’est pas juste que l’on vienne à son secours !
– Qu’il crève ! dit un troisième. Ce sera un bon débarras !
Par une malchance que l’on considéra plus tard comme un châtiment providentiel, l’eau du Ruisseau rugissant trouvait son écoulement naturel dans le fossé du saut-de-loup qui entourait les bois de l’avare, de telle sorte que l’incendie put se donner libre carrière en cet endroit. Le feu dévora donc plusieurs hectares sans rencontrer d’obstacles, et il s’arrêta de lui-même à l’espace découvert qui se trouvait tout autour de la maison d’habitation.
Lord Burydan était d’un caractère trop généreux pour laisser les flammes dévorer les propriétés de son ennemi. Il fit honte aux travailleurs de leur égoïsme, et, suivi de Goliath, de Bob Horwett, de Kloum, de Noël Fless et de sa femme Ophélia, il entra dans le bois de l’avare.
Mais l’excentrique arriva trop tard. Lui et ses amis ne purent constater qu’une chose, c’est que le sinistre n’avait produit que des dégâts, somme toute, peu considérables dans les futaies du baron Fesse-Mathieu.
Ils se contentèrent donc de circonscrire par quelques fossés le feu qui couvait encore sourdement, propagé par les racines des arbres. Une petite pluie qui se mit à tomber acheva d’éteindre complètement les souches embrasées.
Ils se retirèrent complètement rassurés.
Noël Fless et Ophélia, qui étaient demeurés les derniers, allaient en faire autant lorsqu’ils distinguèrent, au milieu d’un monceau de cendres, un squelette complètement carbonisé. Ophélia faillit s’évanouir, persuadée que c’étaient là les restes de l’avare.
– Grand Dieu ! s’écria-t-elle, mon beau-père a été victime de l’incendie. Aussi, c’est notre faute : nous ne sommes pas accourus à son aide assez promptement.
Noël était devenu très pâle.
– Ce serait pour moi un éternel remords s’il en était ainsi, murmura-t-il, mais je doute fort que ces ossements noircis soient ceux de mon père. Il n’a jamais porté des chaussures aussi fines.
Et il montrait une des bottines du défunt qui, par hasard, avait complètement échappé au feu.
– C’est vrai, s’écria la jeune femme dont la physionomie se dérida, je ne l’ai jamais vu que chaussé de gros sabots.
– N’importe ! Je ne veux pas rester dans le doute ! Mettons-nous à la recherche de mon père. Il est assez surprenant, tu l’avoueras, que personne ne l’ait vu sur le lieu du sinistre.
Les deux jeunes gens n’étaient qu’à quelques pas de l’habitation de l’avare. Ils trouvèrent la porte grande ouverte, ils entrèrent.
Les meubles et les ustensiles étaient en désordre. Évidemment, la demeure du baron Fesse-Mathieu avait été le théâtre de quelque drame.
Très inquiets, Ophélia et son mari parcoururent dans tous les sens le rez-de-chaussée et les chambres du premier étage. Ils explorèrent même, mais toujours sans résultat, les granges, les étables et les remises.
– Il n’y a que le grenier que nous n’avons pas vu, dit tout à coup Ophélia.
– Allons-y, murmura Noël en s’efforçant de dissimuler l’inquiétude qu’il ressentait.
Ophélia gravit la première l’escalier qui conduisait au grenier. Aux clartés de l’aube livide et grise, elle aperçut un spectacle effrayant.
Le baron Fesse-Mathieu, réduit au désespoir, s’était pendu à l’une des poutrelles de soutènement du toit.
Demeuré économe jusqu’au dernier moment, il avait eu soin de déposer son bonnet de peau de lièvre, sa robe de chambre de drap vert et ses sabots avant de se décider à passer sa tête dans le fatal nœud coulant. À ses pieds, on voyait encore l’escabeau sur lequel il s’était hissé pour mettre à exécution son funèbre projet.
Ophélia était heureusement une femme d’action à qui la vie en plein air, les longues chasses, les fatigantes randonnées à travers bois avaient communiqué une énergie et une robustesse presque viriles.
Son premier geste fut de couper la corde qui enserrait le cou du vieillard, sans même attendre que son mari fût là pour l’aider.
Quand Noël Fless fut à son tour parvenu dans la soupente, la jeune femme avait étendu le baronnet sur une gerbe de paille, et, constatant que le corps était encore souple et tiède, elle s’était mise en devoir de lui prodiguer tous les soins usités en pareil cas.
– Il est mort ? s’écria Noël terrifié.
– Non, dit Ophélia, mais il n’en vaut guère mieux.
– Pauvre père ! murmura le jeune homme profondément troublé.
– Il ne s’agit pas de perdre notre temps en doléances inutiles ! Aide-moi… Peut-être peut-on encore le sauver !
Tous deux, par bonheur, étaient au courant des derniers progrès de la science ; ils pratiquèrent la respiration artificielle, les tractions rythmées de la langue.
Au bout d’un quart d’heure, l’avare ouvrait les yeux, puis les refermait après avoir poussé un profond soupir.
– Il est sauvé ! s’écria joyeusement Ophélia.
CHAPITRE V
Double guérison
M. Bondonnat se promenait lentement dans une des allées du jardin qui s’étendait derrière le château. Plongé dans ses réflexions, il ne songeait même pas, comme il le faisait d’ordinaire, à classer dans sa mémoire les nombreux échantillons de la flore canadienne qui s’épanouissaient dans les plates-bandes, mêlés aux plantes originaires de la vieille Europe.
Le naturaliste semblait préoccupé. De temps en temps, il tirait de sa poche un carnet couvert de chiffres et de formules, et le consultait d’un air de mécontentement.
– Évidemment, s’écria-t-il, s’oubliant à parler tout haut, je n’ai encore obtenu que la moitié d’un résultat !
– Eh bien, il faut tâcher de l’obtenir tout entier, ce fameux résultat ! cria à deux pas de lui une voix joyeuse.
Lord Burydan sortit en riant de derrière un massif de sorbiers, où il s’était caché pour faire une niche à son vieil ami.
– Je m’aperçois, milord, dit M. Bondonnat en souriant, que vous m’espionnez. Aussi, c’est de ma faute. Je n’ai pas besoin de dire tout haut ce que je pense.
– Parions que j’ai deviné quel est ce fameux résultat auquel vous faisiez allusion.
– Ce n’est pas bien difficile. Vous savez qu’en ce moment je ne pense qu’à une chose, à guérir complètement notre « dément de la Maison Bleue » qui, certes, n’est plus un dément, mais qui n’a recouvré ni son intelligence ni sa mémoire.
– Vous l’avez vu ?
– Oui. J’arrive précisément de la Maison Bleue, où j’ai eu aussi l’occasion de me trouver avec votre cher cousin, le baronnet Fless.
– Que dit ce vieux coquin ? Son fils a eu vraiment bien de la bonté de ne pas le laisser où il était.
– Ne dites pas cela. Le baronnet est entièrement converti. Il a reconnu ses torts, demande pardon à son fils et à sa belle-fille de toutes les misères qu’il leur a faites. Il est changé à ce point qu’il ne parle que de dépenser de l’argent. C’est presque un prodigue.
– Allons donc ! fit l’excentrique avec stupéfaction.
– C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire. Le baronnet est vêtu de neuf. Il a sacrifié son bonnet en peau de lièvre et sa robe de chambre verte, qui servent maintenant d’épouvantail aux oiseaux. Il a fait tomber sa barbe broussailleuse ; il est rajeuni de dix ans. Un pédicure, venu de la ville, a rogné ses griffes diaboliques, plusieurs bains à la cendre de lessive l’ont débarrassé de la crasse invétérée qui lui faisait comme une carapace. Il est maintenant propre comme un sou neuf.
– Allons, tant mieux ! fit l’excentrique, très égayé de cette métamorphose. Il faudra que je me donne la satisfaction d’aller l’admirer sous son nouvel aspect. Puis nous lui ménagerons une entrevue avec son ancien serviteur Slugh. Ce sera réjouissant !… Pour l’instant, laissons de côté le baron Fesse-Mathieu, et revenons à notre malade.
– Comme je vous le disais, aucun changement ne se produit dans son état. Il a retrouvé presque entièrement sa personnalité physique, et c’est lui, à n’en pas douter, le véritable Joë Dorgan, mais l’intelligence et la mémoire laissent beaucoup à désirer.
– C’est peut-être moi, dit alors lord Burydan en tirant une lettre de sa poche, qui vais vous donner le moyen de rendre plus complète sa guérison. Oscar m’a écrit…
– Qu’annonce-t-il ?
– Il m’envoie des renseignements très intéressants. Lisez donc… Grâce à certains journaux de médecine et grâce aux brochures mêmes de Cornélius, il a pu reconstituer les procédés employés par le sculpteur de chair humaine pour réaliser quelques-unes de ses cures les plus merveilleuses.
M. Bondonnat prit la lettre que lui tendait lord Burydan et la lut avec attention.
– Voilà, fit-il en montrant du doigt un des paragraphes de la missive, des détails qui vont m’être particulièrement précieux. C’est la formule même des ordonnances employées par Cornélius pour guérir une vieille dame milliardaire, devenue folle de chagrin à la suite de la mort de son fils. Pour y réussir il s’est contenté d’abolir chez elle, mais pour quelques mois seulement, la mémoire des choses passées.
– Eh bien ?
– Vous ne comprenez pas ? Cornélius a dû certainement se servir du même moyen dans le cas qui nous occupe, et comme le traitement a été publié, il y a plusieurs années de cela, dans une revue médicale, je n’ai plus qu’à suivre l’ordonnance même de Cornélius pour guérir notre malade.
– Oscar est décidément un garçon précieux.
– Je vais, sans perdre un instant, confectionner moi-même la potion indiquée dans la lettre de notre ami. S’il ne s’est pas trompé, le résultat de cette médication serait extrêmement rapide.
– Quand, par exemple, produirait-elle entièrement son effet ?
– Mais, d’après les substances qui y sont employées, si ma supposition est juste, quelques heures suffiraient pour chasser de l’organisme les substances stupéfiantes qui ont paralysé le cerveau et pour rendre à la mémoire du malade toute sa netteté.
– Ce serait trop beau ! murmura l’excentrique. Enfin, nous allons bien voir…
M. Bondonnat remonta dans le laboratoire qu’on lui avait installé au château.
Une heure après, il en ressortait, tenant un flacon de l’énergique médicament indiqué par Cornélius lui-même.
Celui-ci, sans doute, était bien loin de penser qu’il était battu par ses propres armes et que M. Bondonnat se servait d’un article de revue médicale où le sculpteur de chair humaine avait consigné une des merveilleuses guérisons opérées par lui.
Le vieux savant voulut aller lui-même à la Maison Bleue faire ses recommandations à Noël Fless et à sa femme sur la manière dont ils devaient administrer la potion à leur pensionnaire.
M. Bondonnat ne dormit guère cette nuit-là. Il était anxieux de savoir si son traitement allait réussir, et il se disait que, si le moyen qu’il employait venait à échouer, il n’en voyait aucun autre qui lui parût efficace.
Dès l’aurore, il était sur pied et, par les sentiers qui traversaient la forêt, dans cette partie heureusement épargnée par l’incendie, il se dirigeait vers la Maison Bleue.
Ce fut Ophélia qui vint lui ouvrir, les yeux encore bouffis de sommeil.
– Comme vous êtes matinal, cher maître ! dit la jeune femme en souriant.
– Oui, oui, répondit le vieillard avec impatience. Comment va notre malade ?
– Je n’en sais rien. Il doit encore dormir. Personne n’a pénétré dans sa chambre.
– J’y vais moi-même. Ne dérangez pas votre mari. J’ai hâte d’être fixé !
M. Bondonnat gravit précipitamment l’escalier du premier étage. Arrivé en face de la chambre du malade, il s’arrêta, tourna doucement la clé dans la serrure, ouvrit la porte sans bruit et entra sur la pointe des pieds.
Une demi-obscurité régnait dans la pièce. D’amples rideaux étaient tirés devant la fenêtre. M. Bondonnat les écarta avec précaution.
Quelques rayons du soleil printanier s’aventurèrent alors dans la chambre aux meubles d’une couleur claire et gaie, montrant au vieillard son malade encore endormi. Un vague sourire errait sur ses lèvres, comme s’il eût été sous l’empire de quelque bon rêve.
M. Bondonnat réveilla doucement le jeune homme, qui, d’abord, regarda autour de lui avec stupéfaction.
Puis lui prenant la main :
– Comment vous trouvez-vous ce matin, mon cher Joë ?
– Très bien, monsieur. Mais il me semble que, depuis hier, il s’est produit en moi un grand changement…
Il se tut brusquement et tomba dans une profonde rêverie.
M. Bondonnat le surveillait anxieusement.
– C’est étrange ! murmura le malade d’une voix faible. Il me semble qu’un bandeau est tout à coup tombé de mes yeux… que la nuit qui enveloppait ma mémoire s’est dissipée !…
– Puissiez-vous dire vrai !… murmura le vieux savant avec émotion.
Joë porta les mains à son front avec une sorte de fatigue.
– Il me semble, fit-il, que j’ai parcouru dans la nuit des régions inconnues… Il me semble que je sors d’un rêve.
Mais soudain, il jeta un cri perçant et se redressa sous l’impression d’une pensée d’épouvante.
– Les bandits ! s’écria-t-il. Tout le monde a péri autour de moi ! Et mon père, qu’a-t-il dit ?… J’ai dû courir un grand danger… avoir le délire pendant longtemps !…
Il s’était caché la tête dans ses mains et s’était mis à pleurer à chaudes larmes. Après, il regarda M. Bondonnat comme s’il ne l’eût jamais vu auparavant, et, rassuré par la physionomie bienveillante du vieux savant, il lui sourit.
– Monsieur, lui dit-il, vous paraissez vous intéresser à moi. Il faut que vous m’aidiez à me retrouver dans mes souvenirs. Mais qui êtes-vous ?
– Je suis un médecin qui vous soigne depuis quelque temps, se hâta de dire M. Bondonnat, et qui est bien heureux de voir que vous êtes en pleine voie de guérison.
– Mais mon père ?
– Votre père se porte bien. Vous le verrez bientôt. Pour le moment, ne parlons pas de lui. Il est nécessaire que vous m’expliquiez minutieusement ce que vous ressentez, ce dont vous vous souvenez.
– Voyons, reprit le malade avec une sorte d’hésitation, je suis bien Joë Dorgan, n’est-ce pas ? Le fils du milliardaire, le frère de l’ingénieur Harry ?
– Mais oui, mon ami. À quelle date, selon vous, remonte cette perte de la mémoire dont vous avez souffert ?
– Je ne saurais vous le dire au juste. J’ai perdu pour ainsi dire la notion du temps, répondit Joë avec effort, mais ce dont j’ai un exact souvenir, c’est un drame sanglant, au-delà duquel je ne me rappelle plus rien.’
– Racontez-le-moi en quelques mots.
– Mon père m’avait envoyé dans le Sud toucher des sommes importantes… J’avais une escorte d’une douzaine d’hommes… Nous avons été attaqués dans les défilés du Black-Cañon par les tramps… Nous nous sommes battus courageusement… Tous les miens ont été tués… Moi, on m’a fait prisonnier. Tandis qu’on m’emmenait, un des bandits m’a collé sur le visage quelque chose de froid, d’une odeur violente.
– Un masque de chloroforme ?
– Oui, c’est cela. Et c’est à partir de cet instant qu’il y a comme un trou d’ombre dans mes souvenirs, comme une lacune ténébreuse. C’est comme une interminable nuit qui aurait été pleine de ces cauchemars qui laissent à peine une trace au réveil… Il y avait un endroit où j’étais maltraité, d’où je me suis échappé… Mes souvenirs un peu précis ne recommencent qu’à partir de mon arrivée dans cette forêt… dans cette maison…
– Tout va bien ! interrompit joyeusement M. Bondonnat. Vous êtes sauvé. C’est à moi, maintenant, de vous expliquer tout ce qui vous paraît incroyable. Vous avez été victime d’une épouvantable machination. Un génial savant, qui est en même temps un grand criminel, a modifié votre personnalité, et, pendant quelque temps, vous avez porté, pour ainsi dire comme un masque, le visage d’un autre – mais vous allez tout savoir.
M. Bondonnat passa deux longues heures à raconter à Joë Dorgan l’odyssée sanglante de la Main Rouge et les audacieux attentats perpétrés par Baruch et les frères Kramm.
Au cours de cet entretien, M. Bondonnat constata, avec une indicible satisfaction, que Joë avait recouvré non seulement la mémoire, mais encore toute son intelligence. Il ne restait plus en lui aucune trace de la métamorphose opérée par Cornélius. Sauf quelques cicatrices, quelques imperceptibles déviations de certains organes, il était redevenu lui-même.
C’est avec le sentiment d’une infinie béatitude qu’il respirait, par la fenêtre grande ouverte, l’air embaumé du jardin ; il lui semblait naître à l’existence une seconde fois. Tout l’enchantait, il était heureux de vivre.
Enfin, il éprouvait une immense reconnaissance pour tous ceux qui l’avaient sauvé, abrité, guéri. Il serra en pleurant la main de M. Bondonnat. Il voulut aller embrasser Noël Fless et Ophélia, il embrassa leur enfant ; il embrassa même le baron Fesse-Mathieu, peu habitué à de pareilles effusions.
– Tout cela est fort bien, dit M. Bondonnat s’adressant à la fois à Noël Fless et à Joë Dorgan. Mais vous savez ce que je vous ai dit. Je cours à Winnipeg… Faites en sorte que tout soit prêt à mon retour…
Une demi-heure après, le vieillard avait rejoint lord Burydan qui sautait en auto et se laissait conduire chez Mr. Pasquier.
L’homme d’affaires l’introduisit presque aussitôt dans le corps de logis habité par William Dorgan, toujours caché sous le pseudonyme de Clark.
– Il faut m’accompagner à l’instant, dit l’excentrique au vieux milliardaire.
« Où cela ? » écrivit le muet sur ses tablettes.
– Vous allez le voir… Hâtons-nous !
« De quoi s’agit-il ? » traça de nouveau William Dorgan qui ne paraissait guère disposé à se déranger.
– C’est une surprise, s’écria lord Burydan impatienté. Mais il faut que vous veniez !
Le milliardaire finit par céder aux instances de son ami et prit place, à ses côtés, dans l’auto qui partit en quatrième vitesse pour ne s’arrêter qu’à la porte même de la Maison Bleue.
Une nombreuse société se trouvait déjà réunie dans la salle à manger. William Dorgan aperçut Andrée, Frédérique, mistress Ellénor, M. Bondonnat, Kloum, Bob Horwett.
Il y avait encore plusieurs personnes que n’avait jamais vues le milliardaire et qui n’étaient autres que le baronnet Mathieu Fless, son fils et sa belle-fille.
Suivant la recommandation expresse de Bondonnat, nul ne fit mine de reconnaître William Dorgan, qui prit place sur le siège que lui offrit M. Bondonnat.
William Dorgan était en proie à une étrange émotion, il comprenait que l’heure était solennelle.
Les témoins de cette scène n’étaient pas moins émus. Ce n’est que depuis le matin que l’on savait que William Dorgan n’avait pas succombé à la catastrophe du pont de Rochester. Aussi, chacun comprenait que de graves événements se préparaient.
– Mes amis, commença lord Burydan au milieu d’un profond silence, je vous ai fait venir ici pour vous associer à un acte de justice et de réparation. J’ai de grandes nouvelles à vous apprendre.
« D’abord notre ami, le milliardaire William Dorgan, est vivant, bien vivant. Mais, pour échapper aux assassins qui le menaçaient, pour faire éclater la vérité, il a dû laisser croire à sa mort.
D’un geste rapide, l’excentrique avait enlevé les lunettes noires que portait le vieillard.
Toutes les mains se tendirent à l’envi vers le ressuscité, qui, ne connaissant pas le but exact de cette scène, était profondément troublé.
– Je n’ai pas fini, reprit lord Burydan en faisant signe à tout le monde de se rasseoir. William Dorgan avait un fils qu’il affectionnait tendrement. Ce fils fut pris par des bandits, puis revint après quelques mois de captivité… Ou du moins on crut qu’il revenait, car c’était un imposteur qui avait pris les traits, la physionomie, l’apparence physique du véritable Joë Dorgan.
« Un criminel de génie, un savant sans conscience, Cornélius Kramm, le sculpteur de chair humaine, avait réalisé ce prodige de donner à Baruch Jorgell les traits de Joë Dorgan et à Joë ceux de Baruch…
« Pendant que la victime, atrocement mutilée, languissait dans une maison de fous, l’assassin, caché derrière ce masque de chair vive que l’infernal Cornélius avait appliqué sur ses traits, semait la mort et la ruine autour de lui. Ce sont Cornélius et Baruch qui ont fait sauter le pont de l’Estacade ; c’étaient eux les possesseurs de l’île des pendus ; ce sont eux, enfin, les Lords de la Main Rouge !…
Un silence de consternation plana quelques minutes sur les assistants. Tous étaient effrayés de ces révélations. Ce fut au milieu du plus profond recueillement que lord Burydan poursuivit :
– Heureusement, les bandits ont trouvé à qui parler ! Grâce à la science et au courage de nos amis, nous sommes sur le point de triompher dans la lutte… D’abord nous avons retrouvé le vrai Joë. Nous lui avons rendu sa véritable physionomie…
Lord Burydan n’acheva pas. D’un geste impétueux, il arracha le rideau derrière lequel Joë s’était tenu caché pendant toute cette scène. Le jeune homme se précipita dans les bras de son père.
– Mon fils ! s’écria le milliardaire à la stupéfaction de tous les assistants.
La violence de la commotion morale ressentie par le milliardaire avait été telle qu’il se trouvait brusquement guéri de sa mutité.
– Mon espoir s’est réalisé ! s’écria M. Bondonnat avec exaltation. Je savais qu’une violente émotion était seule capable de guérir le mal causé par une autre émotion violente. J’ai tenté cette audacieuse expérience, et je suis heureux de voir qu’elle a complètement réussi ! Master Dorgan, vous êtes guéri, complètement guéri.
Ce coup de théâtre avait été si saisissant, si poignant, que tous ceux qui venaient d’y prendre part demeuraient accablés de stupeur. Ce fut lord Burydan qui rompit le premier le silence.
– Nous ne venons d’assister, dit-il, qu’au premier acte du drame final. Il nous reste maintenant à mettre Cornélius et Baruch hors d’état de nuire et à leur infliger le châtiment qu’ils méritent. Je vous donne ma parole d’honneur que je ne faillirai pas à cette tâche !…
DIX-HUITIÈME ÉPISODE
Bas les masques !
CHAPITRE PREMIER
Un projet d’union
Il n’était bruit depuis quelque temps dans le monde des « Cinq-Cents[8] » que de l’installation, à New York, de la señora Carmen Hernandez. La jeune fille, qui devait, à la mort de sa mère, se trouver à la tête d’une fortune de plus d’un milliard et demi, avait abandonné Buenos Aires, où elle possédait des domaines aussi vastes que plusieurs départements français, et avait acheté un des plus luxueux hôtels de la Cinquième avenue.
La Cinquième avenue, dont certaines rues de la plaine Monceau et des Champs-Élysées peuvent donner une idée, n’est habitée que par des milliardaires et ne se compose que d’une suite de palais et d’hôtels entourés de jardins, dont quelques-uns ont coûté des fortunes.
Habiter la Cinquième avenue est déjà une preuve de grande richesse.
L’hôtel qu’avait choisi la señora Carmen était la reproduction exacte d’un palais de la Renaissance espagnole, dont le modèle se retrouverait dans une des rues les plus pittoresques de la vieille cité de Cordoue.
On pensa, non sans raison, que doña Carmen avait élu, entre tant de merveilleuses demeures, celle qui faisait le cadre le plus avantageux à sa beauté.
Carmen offrait, dans toute sa splendeur, le type de la race castillane que n’altérait en elle le mélange d’aucune goutte de sang étranger.
Très blanche de peau, avec des cheveux si noirs qu’ils avaient dans l’ombre de métalliques reflets bleuâtres, Carmen avait des traits d’une pureté de dessin admirable, et ses adorateurs ne manquaient pas de comparer ses regards, à la fois fulgurants et dominateurs, à de beaux diamants dans un écrin de velours sombre.
Ses lèvres étaient pareilles aux pétales couleur de sang de la fleur du grenadier, et ses dents étaient comme d’étincelantes gouttes de lait.
Le pied cambré, la main petite et fine, Carmen avait un corps d’une beauté sculpturale. Sa gorge était belle sans exagération et ses hanches harmonieusement développées ; elle avait, en marchant, cette rythmique nervosité :
Qui d’un seul mouvement révèle une déesse.
D’ailleurs, Carmen Hernandez avait autant d’esprit, de bonté et de franchise que de beauté.
Les plus indifférents devenaient ses amis dévoués, ses adorateurs même, dès qu’ils l’avaient vue, dès qu’elle avait souri ou prononcé quelques paroles.
En dépit de leurs milliards, les Cinq-Cents n’offrent pas un grand nombre d’exemples d’une pareille perfection : les jeunes filles rechignées et laides, méchantes et vulgaires, n’y sont pas rares ; aussi l’arrivée de la señora Carmen produisit-elle, dans les salons de la Cinquième avenue, l’effet d’une apparition quasi céleste.
En Amérique, on est pratique avant tout. On commença par se renseigner exactement sur la fortune et sur la situation de la charmante señora, et voici ce que l’on apprit :
Doña Carmen était la fille unique de Pablo Hernandez, un des plus riches propriétaires fonciers de la République argentine. Il avait encore doublé sa fortune en installant, au moment le plus opportun, des filatures de coton. C’était le milliardaire Fred Jorgell, alors propriétaire du trust cotonnier, qui lui fournissait la matière première.
Pablo Hernandez était mort environ trois ans auparavant, dans de tragiques et mystérieuses circonstances. Il se rendait à Jorgell-City, seul, en automobile, pour effectuer lui-même, entre les mains de Fred Jorgell, un paiement considérable, lorsqu’il avait été assassiné par des malfaiteurs demeurés inconnus.
On avait retrouvé son cadavre à quelque distance de la ville, près d’un ruisseau marécageux, à deux pas de l’auto d’où le malheureux avait dû descendre pour quelque réparation.
Les bank-notes avaient disparu. Mais, chose extraordinaire, le cadavre ne portait aucune trace de blessure, sauf une légère contusion, une imperceptible tache noire derrière l’oreille.
Les assassins ne furent jamais découverts.
D’autres crimes se produisirent par la suite, dans les mêmes circonstances, sans que le mystère fût éclairci ; mais on se répétait tout bas que les meurtres qui désolaient Jorgell-City avaient brusquement cessé dès que Baruch Jorgell, le fils du milliardaire, avait quitté la ville pour se rendre sur le vieux continent, où il devait bientôt acquérir une sanglante célébrité en assassinant traîtreusement son hôte et son bienfaiteur, M. de Maubreuil.
À la mort de son mari, doña Juana Hernandez, aidée par quelques serviteurs de confiance, avait continué à administrer, avec beaucoup d’activité et d’intelligence, les propriétés et les manufactures. Quand le trust avait passé des mains de Fred Jorgell à celles de William Dorgan, elle avait continué à acheter, chaque année, à ce dernier des quantités de coton qui se chiffraient par des millions de balles.
Elle apprit avec beaucoup de chagrin la mort de William Dorgan, tué dans la catastrophe du pont de Rochester.
Elle connaissait les deux héritiers du défunt, Harry et Joë Dorgan. C’est avec peine qu’elle vit le procès engagé entre eux et qui devait avoir pour résultat, en dépouillant l’ingénieur Harry, d’assurer la propriété à peu près entière du trust à Joë et à ses deux associés, Cornélius et Fritz Kramm.
Joë Dorgan – ou plutôt Baruch auquel l’art diabolique de Cornélius avait donné les traits de sa victime – tenait à ne pas perdre une cliente aussi importante. Aussi multiplia-t-il, à ce moment, ses visites chez la señora Juana. Harry Dorgan, qui dirigeait pour le compte de son beau-père la Compagnie des paquebots Éclair, fut loin de se montrer aussi assidu. Il ne fit que quelques visites de loin en loin, et les deux orgueilleuses Espagnoles – la fille aussi bien que la mère – gardèrent rancune au jeune homme de sa négligence.
Baruch sut profiter habilement de la situation. Il gagna entièrement les bonnes grâces de la vieille dame, et, un beau soir, il lui déclara qu’il était passionnément épris de doña Carmen et qu’il sollicitait l’honneur de devenir son époux.
Doña Juana ne fit d’objections que pour la forme.
– Vous aimez ma fille, dit-elle avec une franchise tout espagnole ; je ne sais pas si elle vous aime, mais je vous crois capable de la rendre heureuse.
– Toute ma vie, murmura le prétendant, sera consacrée à faire le bonheur de votre adorable fille !
– Parbleu, répliqua doña Juana, qui avait le parler un peu libre, croyez-vous que, de son côté, ma Carmen ne vous apportera pas une somme de bonheur supérieure de beaucoup à celle que vous lui promettez ? Quelle femme est plus capable de rendre heureux un époux ?
– Je sais, murmura galamment Baruch, que je suis indigne d’une personne aussi parfaite à tous égards que doña Carmen.
– Trêve de compliments ! s’écria brusquement la vieille dame, à laquelle un soupçon de moustache grise donnait quelque chose de viril. Je vous ai dit déjà qu’au point de vue des qualités morales, au point de vue de l’affection, je vous crois digne de devenir le mari de mon enfant. Vous êtes intelligent, énergique, et je vous crois loyal. Mais il y a une question, hélas ! dont il faut bien parler.
– La question d’argent ?
– Oui, señor, et traitons-la tout de suite pour n’y plus revenir.
– De ce côté-là, répondit Baruch avec une parfaite assurance, je crois que nous nous entendrons rapidement.
– Vous êtes en procès avec votre frère ?
– Sans doute, mais je suis sûr d’avoir gain de cause. Tout le monde vous le dira, et quand même je perdrais – ce qui est invraisemblable –, il me resterait encore assez de millions de dollars…
– C’est bon. Dans ce cas, mon notaire se mettra dès demain en rapport avec votre solicitor, et, sitôt que je serai fixée sur ce point important, vous serez officiellement autorisé à faire votre cour à Carmen.
– Je ne demande qu’à en finir avec toutes ces formalités le plus vite possible, reprit le jeune homme d’un air détaché. Mais ce n’est pas là, à mon sens, la question la plus importante.
– Que voulez-vous dire ?
– Doña Carmen a-t-elle quelque sympathie pour moi ? Voilà ce qui me préoccupe avant toute chose. Elle ne m’aime pas, je le sais, mais je serais au désespoir de lui être antipathique.
La vieille Espagnole eut un fin sourire.
– Je crois pouvoir vous affirmer, murmura-t-elle, que Carmen n’a aucune prévention contre vous. Je puis dire, sans nullement m’avancer, que vous êtes plutôt de ceux qui lui sont sympathiques.
– Je ferai l’impossible, s’écria Baruch avec un geste de protestation émue, pour conquérir entièrement l’affection de la señora !
L’endroit où cette conversation avait lieu était un petit salon d’été meublé de sièges de bambou, encombré de plantes vertes, et qui donnait, par une large baie, sur le magnifique jardin du palais.
– Voici précisément Carmen elle-même, dit aimablement doña Juana en montrant de loin la jeune fille qui s’avançait, insoucieuse, sous une grande allée de magnolias.
« Je vous laisse. Si vous craignez que Carmen n’ait quelques préventions contre vous, il ne tient qu’à vous de les dissiper. Mais surtout, pas un mot de nos projets, n’est-ce pas ?
Et, mettant un doigt sur ses lèvres avec un malicieux sourire, la vieille dame disparut au moment même où Carmen pénétrait étourdiment dans le salon.
À la vue du jeune homme, elle eut un petit cri de surprise. Ses joues se couvrirent d’un vif incarnat.
– Je ne vous savais pas là, murmura-t-elle, master Joë.
Le jeune homme baisa respectueusement la main petite et charmante que lui tendait la señora.
– J’espère, fit-il, que ma visite ne vous dérange pas ?
– Nullement, cher monsieur. C’est toujours avec grand plaisir que nous vous voyons, ma mère et moi.
La conversation se continua quelque temps ainsi, alimentée par des lieux communs de politesse mondaine.
Baruch parla négligemment des millions qu’il allait toucher sous peu. Il dit un mot des dernières représentations théâtrales, de la réception donnée la semaine précédente par un membre des Cinq-Cents – les Rockefeller – et où, par une excentricité que tout le monde trouva d’un goût exquis, le dîner fut servi par des singes apprivoisés, admirablement dressés et d’une taille ingénieusement appropriée aux mets qu’ils étaient chargés d’apporter.
Ainsi, ce fut un orang-outang qui se chargea du rôti ; un gorille apporta le saumon ; un macaque les légumes ; un sapajou les entremets, et de délicieux ouistitis les desserts.
– Et le café ? demanda Carmen qui riait de tout son cœur.
– Ce fut un négrillon.
– Décidément, voilà un dîner charmant. Mais je pense qu’il faut avoir bien envie de faire parler de soi pour trouver du plaisir à de pareils festins.
– Bah ! il faut bien donner des fêtes originales. Quand vous serez mariée, il vous faudra avoir aussi vos réceptions.
– Oh ! nous avons le temps d’y penser ! murmura Carmen en rougissant imperceptiblement.
Elle leva les yeux vers Joë.
Leurs regards se rencontrèrent. Tous deux avaient réciproquement pénétré leur pensée.
Baruch, d’un geste très doux, prit la main de Carmen, qui ne la retira pas.
– Écoutez, señora, dit-il, je suis la franchise même, et je ne puis vous cacher plus longtemps que j’ai pour vous la plus profonde admiration, le dévouement le plus entier…
– Est-ce une déclaration ? répliqua la señora en retirant promptement sa main.
Puis, prenant tout à coup un air sérieux :
– Vous venez de dire tout à l’heure, master Dorgan, que vous étiez la franchise même. J’ai la prétention d’être tout aussi franche que vous pouvez l’être, et vous allez connaître en deux mots mon opinion sur le mariage. Je n’accepterai d’époux que celui que ma mère me désignera.
– À condition, bien entendu, qu’il vous plaise.
– Oh ! ma mère ne me mariera jamais contre mon gré. Elle serait désolée de me faire de la peine. Moi, de mon côté, vous m’entendez, jamais je ne prendrai pour mari quelqu’un qui déplairait à ma mère.
– Señora, murmura le jeune homme avec un trémolo dans la voix, quelle serait votre décision si la señora Juana avait agréé ma demande ?
– Je ne sais…, murmura la jeune fille, surprise par cette question inopinée. Je n’ai jamais pensé à une telle chose…
Cette conversation, qui commençait à prendre une allure tout à fait intime, fut brusquement interrompue par l’entrée d’un domestique qui portait sur un plateau de vermeil une carte de visite couverte d’une fine écriture.
Le jeune milliardaire brûlait d’envie de connaître le nom du visiteur inopportun. Mais, malgré toute sa curiosité, il ne put arriver à déchiffrer ce qui était écrit sur le bristol.
Carmen, après y avoir jeté un coup d’œil, s’était levée précipitamment.
– Excusez-moi, master Dorgan, fit-elle. Je vous laisse pour quelques minutes. Si vous n’êtes pas trop pressé, attendez mon retour. Le piano et les albums du salon vous aideront à patienter. Il y a aussi des havanes bien secs dans le petit meuble d’ébène.
Vive et légère comme une fée, Carmen avait déjà disparu, sans attendre la réponse de son adorateur. Baruch était enchanté. Par la pensée, il se voyait déjà à la tête de la royale fortune de doña Hernandez.
– Tout va bien, murmura-t-il. Je crois que, cette fois, j’atteindrai mon but sans trop de mal !
Il prit nonchalamment, dans le meuble d’ébène, un régalia couleur d’or, le fit craquer d’un coup d’ongle et l’alluma, voluptueusement étendu dans un rocking-chair.
Il s’abandonnait aux idées les plus riantes, enseveli dans un nuage d’odorante fumée, sans s’apercevoir de la fuite du temps.
Une heure déjà s’était écoulée, et doña Carmen n’était pas encore revenue.
*
* *
Si Baruch avait pu deviner quels étaient les visiteurs pour lesquels doña Carmen l’avait laissé, il eût été certainement moins rassuré. Voici ce que portait la carte de visite remise à la jeune fille :
Lord Astor Burydan et Mme Andrée Paganot, née de Maubreuil, se rappellent au souvenir de doña Carmen Hernandez, et la prient de leur accorder quelques minutes d’entretien, pour une affaire extrêmement sérieuse.
Carmen connaissait lord Astor et Andrée, qu’elle avait rencontrés à différentes reprises dans les salons des Cinq-Cents. Elle s’empressa donc d’accueillir leur demande.
Elle avait cru d’abord qu’il ne s’agissait que d’une question mondaine. Mais, dès que lord Burydan eut prononcé quelques mots, la jeune fille comprit que ce qu’on avait à lui dire était de la plus exceptionnelle gravité.
Quand elle vint enfin rejoindre Baruch, ses traits exprimaient encore une violente émotion et ses beaux yeux de velours étaient rougis par des larmes, mais elle fit effort pour ne rien laisser paraître de ses inquiétudes. Ce fut même avec un visage souriant et un calme parfait – du moins en apparence – qu’elle pénétra dans le petit salon.
Si Baruch avait été plus observateur, ou, plutôt, s’il n’avait pas été abusé par la certitude du succès, il eût remarqué que les paroles et les manières de la jeune fille n’avaient ni la même insouciance ni la même franchise. Une secrète contrainte se devinait dans ses moindres gestes, dans ses phrases les plus insignifiantes.
– Excusez-moi de vous avoir fait attendre, dit-elle. Je n’ai pu me libérer plus tôt d’une visite importune. Mais maintenant je suis toute à vous.
– De grâce, ne vous excusez pas, señora.
– Vous avez dû vous ennuyer ?…
– Qu’importe ! Vous voici, vous êtes pardonnée…
Et il ajouta hardiment :
– Vous plaît-il, señora, que nous reprenions la conversation à l’endroit où elle a été interrompue ?
– De quoi parlions-nous donc ? murmura-t-elle avec une feinte distraction.
– Ne vous souvient-il plus qu’il était question de mariage ?
– C’est vrai, dit Carmen avec un brusque mouvement.
– Je vous disais, reprit Baruch, que vous me rendriez le plus heureux des hommes, señora, en consentant à m’accorder votre main.
Carmen rougit et pâlit tour à tour.
Ce fut en se contraignant terriblement qu’elle répondit :
– En effet, master Dorgan. Et je vous expliquais que je n’accepterais de mari que s’il était agréé par ma mère…
– Je crois, murmura Baruch avec une émotion bien jouée, que j’ai les plus grandes chances d’obtenir le consentement de doña Juana.
– Je ferai ce que me dira ma mère…, dit-elle en baissant les yeux.
Elle ajouta, avec une inflexion de voix qui parut étrange à Baruch :
– Je n’aime personne, certes. Mais j’avoue que j’accorderais tout de suite ma main à l’homme qui réussirait à découvrir les assassins de mon père et à venger sa mort.
Baruch était devenu livide.
– Je sais, balbutia-t-il avec de grands efforts, que le señor Pablo Hernandez a péri de façon mystérieuse à Jorgell-City. Croyez, señora, que je ferai l’impossible pour vous être agréable et pour découvrir les meurtriers. Si je n’y réussis pas, personne n’y réussira !
Carmen avait reconquis tout son calme, toute son amabilité.
– Je vois, master Dorgan, dit-elle en souriant, que nous nous entendrons parfaitement. N’oubliez pas surtout que la chose importante, c’est d’obtenir le consentement de doña Juana.
Elle tendit sa main à Baruch qui y déposa un long et respectueux baiser.
Le bandit se retira la joie dans le cœur.
Il ne voyait pas d’obstacle sérieux à son union avec la charmante Espagnole. Il était même surpris de n’avoir pas rencontré plus de difficultés.
D’abord vaguement inquiet des paroles de la jeune fille au sujet de l’assassinat de Pablo Hernandez, il s’était promptement rassuré.
– Carmen est comme toutes les jeunes filles, s’était-il dit ; elle aimerait à épouser le vengeur de son père. C’est une romantique déclaration qui fait bon effet. Carmen est sans doute d’ailleurs très sincère en s’exprimant de la sorte. Mais la mort du vieux filateur est une affaire déjà bien lointaine ; elle est maintenant classée, oubliée, il serait invraisemblable qu’elle revînt sur l’eau.
« Je ferai quelques enquêtes pour la forme. Je promettrai des primes ; Carmen sera enchantée de mon zèle. Mais à l’impossible nul n’est tenu. On s’apercevra bien que les assassins sont introuvables ; on n’y pensera plus. J’ai le consentement de doña Juana, tout ira bien. Avant trois mois, je serai l’époux d’une charmante femme et l’homme le plus riche de toute l’Amérique.
*
* *
Huit jours plus tard, les journaux de l’Union annonçaient, à mots couverts, le très proche mariage de la belle Carmen et du jeune et célèbre directeur du trust des cotons et maïs.
CHAPITRE II
Un sauvetage
Une grande automobile, de forme massive et fermée hermétiquement, était partie, depuis la veille, du château que possédait lord Burydan dans les environs de Winnipeg, au Canada.
Par ce clair matin de printemps, elle longeait la rive du rio Rouge, qui arrose l’État de Minnesota, en bordure de la frontière canadienne.
En tout autre pays qu’aux États-Unis, où chacun a pour principe de ne pas se mêler des affaires de son voisin, cette voiture eût attiré, pour plus d’une raison, l’attention des curieux. Elle n’était éclairée que par deux petites lucarnes de verre dépoli intérieurement grillagées. On eût dit une vraie prison roulante. D’ailleurs, en dépit de sa solidité et de son poids, elle était munie d’un moteur très puissant et elle dépassait aisément à l’occasion une vitesse de cent vingt à l’heure.
Trois personnes occupaient cette mystérieuse voiture. L’une, que l’on ne voyait jamais, était, au dire des deux autres, un malade frappé d’aliénation mentale, et que l’on conduisait dans l’État de New York, où il devait être enfermé dans une maison de santé.
C’était ce qu’avaient affirmé ses conducteurs lorsqu’on avait franchi la frontière canadienne.
Les douaniers yankees, plus méfiants que dans tout autre pays du monde, avaient demandé à voir le malade. On leur avait montré, affalé dans le fond de la voiture, un personnage maigre et blême dont le bras était entouré d’un appareil et qui semblait plongé dans un anéantissement proche du coma. Les douaniers n’avaient plus eu alors aucun doute.
– D’ailleurs, avait ajouté l’un des chauffeurs – un homme d’une stature gigantesque qui répondait au nom de Goliath –, nous sommes obligés à beaucoup de précautions, car notre malade, M. Slugh, est sujet à de violents accès de fièvre chaude.
Tout cela avait paru fort vraisemblable.
La vigilance des deux gardiens était telle, à l’égard de leur prisonnier, qu’ils ne lui permettaient jamais de descendre de la voiture, même pour prendre ses repas.
Quand ils s’arrêtaient – c’était toujours en face de quelque auberge isolée –, Goliath, le premier, allait manger, laissant son compagnon, Bob Horwett, en sentinelle, puis c’était le tour de ce dernier, de façon que Slugh ne fût jamais seul une minute.
Précaution peut-être superflue, car le pauvre diable paraissait dans un si lamentable état qu’il lui eût été bien difficile de parvenir à recouvrer sa liberté.
Goliath et Bob Horwett, sans se relâcher de leur surveillance, avaient fini par se tranquilliser complètement sur la possibilité d’une évasion de la part de leur prisonnier.
Un matin, charmés par la beauté de la température, ils étaient montés tous deux sur le siège après avoir eu soin d’enfermer Slugh à double tour dans sa prison roulante.
Ils prenaient plaisir à regarder les rives du rio Rouge bordées de peupliers, d’aulnes, de saules et de grands osiers, qui commençaient à se couvrir de bourgeons. Dans la forêt voisine, on entendait le bruit cadencé de la cognée d’un bûcheron, et ce coin de solitude avait quelque chose de sauvage et de paisible en même temps, qui reposait l’esprit et la vue.
– Tiens ! dit tout à coup Goliath en tirant de son gousset un énorme chronomètre en or (un cadeau de lord Burydan), il n’est pas loin de onze heures et j’aperçois là-bas une maisonnette qui est peut-être une taverne.
– C’en est une certainement, répondit Bob Horwett. Je vois d’ici l’enseigne.
– Dans ce cas, nous allons nous y arrêter pour déjeuner. L’air vif de la rivière m’a donné une faim de loup.
– C’est comme moi. Et nous pourrions aller loin, avant de trouver un endroit aussi propice.
Quelques minutes après, l’auto stoppait devant la taverne, une jolie construction de bois peinte en rouge et en vert, neuve et bien vernie, comme un de ces chalets que l’on offre aux enfants à l’époque du jour de l’an.
Devant la porte s’étendait une tonnelle, en ce moment dépouillée de son feuillage de houblons et de gobéas, mais d’où l’on avait une vue magnifique sur la rivière.
– Nous serons admirablement bien là, dit Goliath en appelant le patron d’un coup de poing qui fit craquer la table.
– Il y a déjà du monde, fit Bob Horwett en montrant, à l’autre extrémité de la tonnelle, deux hommes, deux gentlemen en costume de touriste, attablés devant une bouteille de whisky.
– Bah ! ce sont des excursionnistes !
– Pour une fois, proposa Bob Horwett, nous pourrions bien déjeuner ensemble. Slugh ne va pas s’envoler.
– Entendu. Il n’y a rien de si désagréable que de manger seul. D’ailleurs, tout en mangeant je surveillerai la voiture.
Le patron, un Écossais de mine joviale, était accouru.
– Or ça ! lui dit Goliath en se donnant un coup de poing sur le thorax qui sonnait le creux, que vous reste-t-il dans votre garde-manger ? Je vous préviens que j’ai un appétit sérieux.
– Il n’y a qu’à vous regarder pour en être convaincu, répondit facétieusement l’hôte. Ce n’est certainement pas en mangeant des sauterelles que vous vous êtes fait de pareils biceps ! Mais, rassurez-vous, mon garde-manger est bien garni.
– Dites-nous donc un peu ce qu’il renferme.
– Rien que du bon, sirs. Bon saumon du rio Rouge, bon jambon d’ours canadien, bon rosbif des prairies du Minnesota. Sans compter des anguilles fumées, des tomates de San Francisco et d’autres bagatelles.
– Je vois, murmura Goliath, que nous pourrons nous entendre. Servez-nous au plus vite !
– Mais que faut-il vous apporter ?
– Ce qu’il y aura de mieux et de meilleur, répliqua Bob Horwett. Nous ne regardons pas à la dépense…
– Servez-nous donc de tout, interrompit Goliath en montrant dans un bâillement une formidable rangée de dents. Je me sens, ce matin, une telle faim que je serais capable de manger un mouton tout entier, comme cela m’est arrivé un jour à la suite d’un pari !
Le tavernier, enchanté d’avoir affaire à de si bons clients, se hâta de dresser le couvert qu’il flanqua symétriquement de deux cruchons de pale-ale à droite et de deux bouteilles de vin de Californie à gauche.
Il se convainquit bientôt que Goliath n’avait nullement exagéré en parlant de son appétit. C’était plaisir de le voir torcher les plats et faire disparaître avec rapidité les tranches de saumon et les quartiers de rosbif, comme s’il les eût jetés dans quelque abîme.
Bob Horwett, sans posséder la puissance d’absorption de son camarade, était ce qu’on appelle une belle fourchette.
Le tavernier, qui avait fait autrefois ses études pour être professeur à Glasgow, n’était pas loin de penser qu’il avait l’honneur d’héberger à sa table le fameux Gargantua et son rival, le célèbre Gouliafre.
Il n’était pas le seul d’ailleurs à admirer l’appétit des dîneurs.
Les deux touristes, attablés devant leur whisky à l’autre bout de la tonnelle, n’étaient pas moins émerveillés ; surtout l’un d’eux, un vieillard à cheveux gris et à lunettes bleues, vêtu d’un complet de molleton vert et d’une casquette de yatchman. Il ne quittait pas des yeux Goliath et Bob Horwett.
Ce dernier finit par s’apercevoir de l’attention dont il était l’objet et il demanda négligemment à l’hôte s’il connaissait les deux gentlemen.
– Ma foi non, répondit l’Écossais. Je crois que ce sont de braves gens. Ils sont là depuis hier et ils paient rubis sur l’ongle. C’est à eux le grand canot à pétrole que vous voyez à l’ancre là-bas derrière les saules. Ils vont à la chasse et à la pêche. Leur projet est, à ce qu’ils disent, de remonter à petites journées le cours du rio Rouge jusqu’au lac.
Bob Horwett, rassuré par ces paroles, ne s’occupa plus des deux étrangers.
D’ailleurs, bientôt après, tous deux se levèrent et se dirigèrent paisiblement vers l’endroit où leur embarcation était amarrée.
Pour y parvenir, ils étaient obligés de passer de l’autre côté de l’auto dont la lourde masse les séparait de Goliath et de Bob Horwett.
Au moment où les yatchmen passaient derrière la voiture et où, par conséquent, ils ne pouvaient être vus des dîneurs, l’homme au complet de molleton sauta prestement sur le marchepied et plongea un regard inquisiteur à travers la lucarne grillagée.
Tout de suite il poussa une exclamation de surprise.
– Mais c’est Slugh ! s’écria-t-il. Je le croyais mort !
– Qui êtes-vous ? demanda le prisonnier avec émotion.
– Silence, au nom des Lords ! fit l’inconnu en posant un doigt sur ses lèvres.
Et il continua son chemin, laissant Slugh dans la stupéfaction la plus profonde.
Goliath et Bob Horwett n’avaient naturellement rien vu de ce petit drame, qui s’était déroulé à quelques pas de la table même où ils déjeunaient.
Quelques minutes plus tard, le yachtman, toujours suivi de son compagnon – un vigoureux matelot –, revint du canot à pétrole à la taverne. Il demanda de quoi écrire et parut s’absorber dans la rédaction d’une longue lettre.
En réalité, il n’avait écrit qu’un billet d’une dizaine de lignes et d’une écriture si serrée que toute la missive tenait sur un carré de papier de dimensions très exiguës.
Alors, sans éveiller l’attention de personne, il alla rôder du côté de la cuisine. Sur la table massive, qui en occupait le centre, se trouvait un plateau sur lequel étaient disposés les éléments d’un repas confortable mais sans luxe.
Un petit boy achevait de ranger tous les ustensiles nécessaires.
L’inconnu s’approcha de lui.
– À qui donc est destiné ce déjeuner ? demanda-t-il avec un sourire plein de bonhomie.
– Sir, répondit le négrillon, ce repas est préparé pour un malade qui voyage en auto avec les deux gentlemen que vous avez vus sous la tonnelle.
– Et c’est toi qui vas être chargé de le porter ?
– Non pas. Ces gentlemen ont insisté pour servir eux-mêmes leur ami.
– Ah ! bien ! fit l’étranger en s’éloignant d’un air d’indifférence. Mais, dès que le boy eut tourné les talons, le yachtman revint sur ses pas et glissa dans le pain le billet qu’il venait d’écrire et qu’il avait roulé en forme de tube à peu près de la longueur et de la grosseur d’une allumette ordinaire. Il l’enfonça assez profondément dans la mie de pain pour qu’on ne pût voir dépasser la moindre parcelle de papier.
Cela fait, il sortit de la cuisine sur la pointe des pieds et alla se rasseoir sous la tonnelle.
Deux minutes plus tard, Goliath se levait pour aller porter le déjeuner à Slugh.
Il ouvrit la portière de l’auto, déposa le plateau sur les genoux du bandit, qu’il enferma à clef, selon son habitude.
Slugh se mit à manger de bon appétit ; car, quoiqu’il fît mine d’être toujours très malade, il était presque complètement remis de la blessure qu’il avait reçue à l’épaule.
Tout à coup, il sentit sous ses dents une résistance et il retira de sa bouche le billet plié qu’il avait presque manqué d’avaler.
Il le déplia avec soin, et, pendant qu’il en faisait la lecture, son visage rayonnait.
– Je savais bien, s’écria-t-il, que les Lords ne m’abandonneraient pas ! Maintenant, je suis sûr de ne pas rester longtemps prisonnier.
Avec sa prudence habituelle, Slugh déchira le petit carré de papier, le mâcha et en fit une boulette qu’il avala.
Peu après, Goliath revint chercher le plateau et les reliefs du repas de son prisonnier. Puis l’on ne tarda pas à se remettre en route.
Une de ces averses de printemps, qui durent peu et auxquelles succède bientôt le soleil, s’était mise à tomber. Goliath demeura sur le siège, pendant que Bob Horwett se retirait dans l’intérieur de la voiture et s’asseyait à côté de Slugh.
L’auto continuait à suivre la route qui longe le rio Rouge.
La campagne était absolument déserte.
Tout à coup, Slugh, qui était aux aguets depuis la lecture du mystérieux billet, entendit, dans l’éloignement, trois coups de trompe régulièrement espacés.
Il tressaillit. C’était le signal auquel le billet qu’il avait reçu lui disait de faire attention.
Ni Goliath ni Bob Horwett ne prirent garde à ces sons de trompe venant du canot à pétrole qui s’était mis en marche presque en même temps que l’auto qui suivait parallèlement le cours de la rivière.
Immobile dans son coin, Slugh retenait sa respiration, le cœur palpitant d’anxiété.
Soudain, un grand cri s’éleva. C’était le matelot du canot à pétrole qui venait de tomber à l’eau et qui appelait au secours de toutes ses forces.
Bob Horwett, qui, on le sait, détenait le record du monde de la natation, ne prit pas le temps de réfléchir. Il ouvrit brusquement la portière, la referma négligemment en criant à Goliath de faire attention, et courut à l’endroit de la berge où l’homme venait de disparaître.
Sans même prendre le temps de se déshabiller, il piqua une tête et, filant entre deux eaux, se mit à la recherche du disparu.
Slugh avait suivi Bob Horwett des yeux.
Au moment précis où il le vit s’enfoncer dans l’eau, le bandit ouvrit la portière, qui n’avait pas été refermée à clef, et se mit à courir de toutes ses forces.
Il avait momentanément l’avantage, car Goliath, à cause de son poids énorme, était un médiocre coureur.
Le géant s’en rendit compte immédiatement, et, lâchant un juron retentissant, il lança l’auto à la poursuite du fugitif qui courait droit à la rivière.
Pendant ce temps, le canot à pétrole s’était rapproché du bord. Slugh y monta au moment même où le faux noyé y mettait le pied.
Celui au secours duquel Bob Horwett s’était élancé si généreusement était lui-même un excellent nageur. Il avait plongé deux fois pour faire perdre sa trace à son sauveur, et, après avoir contourné le canot, il y était tranquillement remonté.
Aussitôt, le yachtman, qui n’était autre que Léonello, l’homme de confiance et le préparateur du docteur Cornélius, mit en marche le moteur du canot, qui fila de toute la vitesse qu’il était capable de fournir.
Bob Horwett, désespéré de son imprudence, avait compris, mais trop tard, le stratagème dont il était victime.
Furieux, découragé, il suivit quelque temps le canot à la nage. Mais ceux qui le montaient l’assaillirent d’une décharge de brownings, qui fit crépiter autour de lui une grêle de balles. La rage au cœur, il dut plonger, battre en retraite et, finalement, regagner la rive.
Non moins exaspéré que son compagnon, Goliath tira dans la direction du canot tous les projectiles de son revolver. Mais l’embarcation, favorisée par le courant très rapide en cet endroit, ne tarda pas à disparaître.
*
* *
Deux heures plus tard, Slugh et Léonello, laissant le canot à la garde du matelot, débarquaient en face d’une station de chemin de fer et prenaient un billet pour New York, où ils arrivaient le lendemain.
Le vieil Italien conduisit Slugh à l’un des hôtels qui étaient sous l’occulte dépendance de la Main Rouge, puis il s’empressa d’aller rendre compte de sa mission au sculpteur de chair humaine.
Il trouva Cornélius dans son laboratoire souterrain.
– Eh bien, Léonello, demanda le docteur avec impatience, m’apportes-tu de bonnes nouvelles ?
– Elles sont à la fois bonnes et mauvaises. Je n’ai pu mettre la main sur Joë Dorgan.
– Explique-moi cela, grommela Cornélius en fronçant le sourcil. Voilà un échec très regrettable et qui m’étonne fort de ta part. Tu sais cependant qu’il est très important pour nous d’avoir entre les mains le faux Baruch.
– Il n’y a pas eu de ma faute, vous allez vous en rendre compte. J’arrive à Winnipeg, comme vous me l’aviez ordonné, je m’informe à droite et à gauche, et j’apprends, tout d’abord, que lord Burydan et tous ses amis, parmi lesquels se trouvait M. Bondonnat, venaient de quitter le Canada pour se rendre à New York.
– En effet, leur arrivée m’a été signalée.
– Je ne tardai pas à retrouver les traces de Joë Dorgan. Il avait été longtemps soigné dans un cottage habité par Noël Fless, le fils de ce vieil avare que Slugh autrefois essaya vainement de dévaliser. Les gens du pays l’avaient surnommé le dément de la Maison Bleue ; ils le regardaient comme un idiot inoffensif, mais absolument incurable.
– Tu me rassures, murmura Cornélius. Si jamais Bondonnat, qui n’est pas un ignorant, s’était avisé de l’étudier de près, il eût été bien capable de le guérir.
– Il est impossible que l’on ait pu se douter d’une substitution pareille.
– Je le crois aussi… Quand même, j’ai eu tort de laisser vivre ce Joë… Baruch ne jouira paisiblement de la personnalité qu’il a usurpée que lorsque ce Joë aura définitivement disparu.
– Il y a peu de temps, le dément quitta le cottage de Noël Fless, et personne ne put me dire ce qu’il était devenu. C’est alors que j’appris qu’un mystérieux prisonnier était gardé à vue dans le château de lord Burydan.
– C’était Joë ?
– Je le crus aussi, et je pris mes mesures en conséquence. Quand le captif fut emmené en auto par ses deux gardiens, je suivis leur voiture d’étape en étape, et je saisis la première occasion pour regarder dans l’intérieur de ce cachot roulant. Je m’attendais à voir Joë. Vous devinez quelle fut ma surprise en me trouvant en présence de Slugh, que nous croyions mort et enterré dans les marais de la Floride.
– Il fallait le faire évader ! Slugh a été très fidèle à la Main Rouge. De plus, c’est un homme de ressource, un homme d’action.
– Je l’ai fait évader… Malheureusement, je n’ai aucun renseignement à vous fournir sur Joë Dorgan.
Cornélius réfléchit un instant.
– Il faut à tout prix savoir où il est ! Je ne serai pas tranquille tant qu’il sera vivant.
– Je suppose qu’il est à New York, ou dans les environs. Je crois aussi qu’il ne sera pas difficile de remettre la main sur lui, en faisant suivre lord Burydan et Bondonnat.
– N’épargne, pour y réussir, ni le temps ni l’argent. Nous avons été trop négligents à l’égard de ce Joë, il faut rattraper le temps perdu. Tout marche à souhait. Baruch va entrer en possession des millions de William Dorgan, en attendant ceux de Fred Jorgell qui nous reviendront aussi.
– Comment cela ?
– Isidora héritera de son père, l’ingénieur Harry de sa femme, et Baruch de l’ingénieur Harry. C’est à la Main Rouge qu’il appartient seulement de régler l’époque du décès de ces trois personnages.
– Quelle combinaison grandiose ! s’écria Léonello émerveillé.
– Grandiose ! Oui, peut-être ! Mais il ne faut pas qu’une vétille, un détail oublié viennent la réduire à néant. Va vite commencer tes recherches. Il faut que Joë Dorgan soit retrouvé avant la fin de la semaine.
CHAPITRE III
Règlement de comptes
Joë Dorgan venait de passer la soirée chez Carmen Hernandez, dont il était, depuis plusieurs semaines déjà, le fiancé officiellement reconnu.
Le mariage, annoncé à grand fracas par toute la presse new-yorkaise, devait avoir lieu dans trois jours, et il n’était bruit que des merveilleux cadeaux que les membres du groupe aristocratique des Cinq-Cents avaient envoyés à la jeune fille.
Baruch nageait dans la joie. L’avenir s’étendait devant lui comme un ciel sans nuages. Il avait décidément gagné la terrible partie qu’il avait jouée. Le matin même, il avait signé, chez l’homme d’affaires d’Harry Dorgan, les arrangements qui le mettraient définitivement en possession du trust des maïs et cotons.
Il ne voyait aucune ombre à son bonheur.
– Encore trois jours ! avait-il dit à doña Carmen en prenant congé d’elle. Ces trois jours vont me sembler bien longs.
– Je n’en doute pas, avait répondu la jeune fille avec un étrange sourire. Mais ne faut-il pas, en toutes choses, se montrer patient ?
Et, dans un geste digne d’une reine, la jeune fille avait tendu sa main à Baruch, qui, comme il faisait chaque soir, y avait déposé un baiser à la fois respectueux et tendre.
Il pouvait être à ce moment dix heures du soir. Le jeune homme remonta dans son auto et ne tarda pas à s’absorber dans une agréable méditation.
– Carmen est charmante, songeait-il ; un peu fière, un peu dédaigneuse et froide, mais je finirai bien par me faire aimer d’elle. J’ai réussi des choses plus difficiles que cela… Après tout, qu’elle reste aussi cérémonieuse qu’elle voudra, une fois que j’aurai touché la dot…
Baruch prit le cornet acoustique qui aboutissait à l’oreille du chauffeur :
– Vous stopperez à l’entrée de la Trentième avenue, dit-il.
– Well, sir ! répondit l’homme obséquieusement.
Et l’auto fila à toute vitesse à travers les avenues déjà désertes.
Un quart d’heure plus tard, Baruch mettait pied à terre, et, après avoir ordonné au chauffeur de l’attendre, remontait à pied la Trentième avenue, le pardessus remonté jusqu’aux oreilles, comme s’il eût craint d’être reconnu.
Il passa en face du magnifique hôtel habité par le docteur Cornélius, contourna les hautes murailles du jardin et se trouva dans une ruelle déserte, bordée de masures branlantes.
Il s’arrêta en face d’une cahute de planches, en bordure d’un terrain vague qu’entourait une palissade, et frappa quatre coups régulièrement espacés.
Une porte s’ouvrit, et Baruch se glissa silencieusement dans une salle basse qu’une lampe à huile, suspendue au plafond, éclairait d’une lueur tremblotante. C’est dans ce local qu’avaient lieu les répartitions de butin que les Lords de la Main Rouge faisaient à leurs affiliés à des époques régulières.
En entrant, Baruch aperçut Fritz et Cornélius, assis à une petite table sur laquelle s’empilaient des carrés de papier portant, à l’un des angles, la signature de la Main Rouge. Une petite boîte, encore à demi pleine de bank-notes et d’aigles d’or, était à côté de Fritz.
– Eh bien ! demanda joyeusement Baruch, la répartition est-elle terminée ?
– Elle vient de finir à l’instant, répondit Cornélius.
– J’y aurais assisté aussi comme de coutume, mais un fiancé bien épris a des devoirs…
– Que nous comprenons parfaitement, murmura Fritz sur le même ton jovial. Vous êtes tout excusé, mon cher !
– Nous n’avons, je pense, reprit Baruch, aucune raison de rester plus longtemps dans ce taudis. Nous serons beaucoup mieux ailleurs pour causer.
– C’est ce que j’ai pensé, fit Cornélius. J’ai fait servir un petit souper dans mon laboratoire ; là, nous ne serons dérangés par personne.
Les trois Lords de la Main Rouge sortirent un à un de la maisonnette et s’engagèrent dans la ruelle, en ce moment tout à fait déserte.
Ils rentrèrent dans le jardin de Cornélius par une petite porte dont celui-ci avait la clef, et bientôt l’ascenseur les déposa dans le vestibule du laboratoire souterrain.
Cornélius ouvrit une porte.
Ce fut un éblouissement. Sans doute, en raison de la solennité des circonstances, Cornélius avait ordonné de magnifiques préparatifs. La vaste salle voûtée était éclairée par une centaine de lampes électriques, dissimulées par des massifs de feuillage et de corbeilles de fleurs. Les cadavres à demi disséqués, les appareils effrayants ou étranges étaient cachés aux regards sous de lourdes tentures de velours orangé.
Cornélius n’avait laissé en évidence qu’une grande vitrine, où se trouvaient des statues de cire, coloriées avec tant d’art qu’elles donnaient l’illusion de la vie.
Au centre du laboratoire, se dressait une table couverte de vaisselle plate et de cristaux rares, que décoraient des gerbes de roses et d’orchidées. Deux dressoirs lui faisaient pendant : l’un chargé de flacons poudreux des crus les plus célèbres du monde, l’autre de pâtisseries et de fruits magnifiques disposés sur des compotiers de vermeil.
Léonello se tenait dans un coin, occupé aux derniers préparatifs.
– J’espère, fit Cornélius, que vous n’aurez pas trop à vous plaindre de mon hospitalité.
– Elle est digne des Lords de la Main Rouge, s’écria Baruch avec enthousiasme.
– À table, messieurs ! La soirée d’aujourd’hui est doublement solennelle pour nous. Elle marque le couronnement d’une des plus audacieuses entreprises qui aient jamais été tentées !…
Les trois bandits s’assirent, et, tout en savourant les mets délicats que Léonello leur servait dans des plats recouverts de cloches de vermeil, ils commencèrent à discuter des importantes affaires qui avaient motivé leur réunion.
Tout d’abord, on but aux fiançailles de l’heureux Baruch, le futur époux d’une des plus belles héritières de New York et la plus riche peut-être.
Cornélius, avec son ironie quelque peu caustique, ne se fit pas faute de rappeler au fiancé les circonstances qui avaient accompagné l’assassinat de Pablo Hernandez, alors que Baruch habitait Jorgell-City. Il rappela également comment, tenu en rigueur par son père, Baruch en était réduit à escamoter les bijoux de sa sœur, miss Isidora, ou à électrocuter les passants pour se procurer quelques dollars et aller les jouer au club du Haricot Noir.
Baruch était si heureux, ce soir-là, qu’il ne se fâcha même pas de cette évocation d’un passé sanglant.
– Qu’importe tout cela ! s’écria-t-il. Ce sont des faits qui sont aussi loin de nous, aussi hors de notre pouvoir, que peut l’être l’histoire de l’empereur Néron ou la destruction de Babylone… Baruch n’existe plus, grâce à la science toute-puissante du docteur Cornélius. Il n’y a plus, devant vous, que Joë Dorgan, l’homme le plus riche de toute l’Amérique dans quelques jours et, en ce moment même, le plus heureux peut-être !
« Je vous le déclare ici, mes amis, je n’ai pas l’ombre d’un remords. Je suis fier de l’énergie qui m’a permis d’accomplir des actes qui épouvanteraient le commun des mortels.
– Vous ne souffrez donc plus, demanda sournoisement Cornélius, de ces « cauchemars du samedi » qui vous ont tant effrayé à une certaine époque ?
Baruch eut un haussement d’épaules.
– Bah ! fit-il, j’ai fini par dompter mes nerfs. Ma santé est en ce moment aussi bonne que possible.
– À votre santé ! s’écria Fritz.
Tous trois rapprochèrent leurs coupes pleines d’un vieux vin de lacrima-christi aux reflets d’or, et burent en silence.
La conversation se continua ainsi jusqu’à la fin du repas.
Elle ne prit une allure plus sérieuse que lorsque Léonello eut enlevé le dessert et apporté le café, les liqueurs et les cigares.
– Mes amis, dit Baruch en tirant de sa poche un carnet couvert de chiffres, il est temps de parler de choses pratiques. Comme ma dépêche de ce matin vous l’a appris, nous sommes maintenant entrés en possession du trust des cotons et maïs. Grâce aux sages précautions que nous avions prises, Harry n’a touché, en tout et pour tout, de l’héritage paternel que vingt millions de dollars, tandis que la part de chacun de nous dépasse quatre-vingts millions de dollars… Encore cette somme est-elle appelée à doubler dans un laps de temps très court, à cause de l’extension, pour ainsi dire automatique, du trust qui, à un moment donné, doit englober toute la production américaine. Voici les détails des chiffres que vous pourrez vérifier vous-mêmes.
Cornélius d’abord, puis Fritz examinèrent avec une attention méticuleuse le carnet de Baruch et le trouvèrent parfaitement en règle.
Par un scrupule, assez fréquent chez les coquins de sa trempe, Baruch avait fait preuve, dans ce partage, d’une probité méticuleuse.
Ses deux complices le félicitèrent chaleureusement, et tous trois, sous l’influence des grands vins et des mets de haut goût, s’abandonnèrent à leurs rêves ambitieux.
Baruch rêvait le trust des trusts, l’universelle royauté de l’argent.
– À nous trois, s’écria-t-il, nous sommes de taille à attaquer une entreprise aussi sublime. Quel roi, quel empereur posséderait une pareille puissance ? Quels rêves grandioses ne pourrait-on pas réaliser avec ce levier d’or entre les mains ?… Les concepts les plus audacieux, les plus chimériques deviendraient de réalisation facile !… Atteindre les planètes, pénétrer jusqu’au centre de la terre, rendre l’homme immortel, tout cela deviendrait possible !… La science n’est-elle pas souveraine maîtresse ?
Cornélius jeta quelques gouttes d’eau froide sur cet enthousiasme.
– En principe, dit-il, rien de tout cela n’est impossible… Mais nous en reparlerons. Pour le moment, je suis d’avis que ce que nous avons de mieux à faire, c’est de consolider notre situation, de la rendre tout à fait inattaquable et d’éviter qu’on parle trop de nous.
– À propos, demanda brusquement Fritz, a-t-on des nouvelles de Joë ?
Ce fut Léonello qui se chargea de répondre.
– Il se trouve en ce moment, dit-il, dans la propriété que possède Harry Dorgan dans une île du lac Ontario.
– N’est-ce pas là que se trouvait le buste d’or massif aux prunelles d’émeraude ?
– Précisément. Mais la propriété est si bien gardée qu’il n’y a pas moyen d’y pénétrer. Comme je l’ai expliqué au docteur, nous n’avons, je crois, rien à craindre de lord Burydan et de ses amis. Ils sont complètement matés et ils ont bien d’autres soucis que de chercher à nous nuire.
– Parbleu, dit Baruch, je le sais bien. Les actions de la Compagnie des paquebots Éclair qu’Harry Dorgan m’a intenté lui a porté un coup terrible. Il aura bien de la chance s’ils sont en pleine baisse ! La perte du procès n’arrive pas à la faillite. D’un autre côté, j’ai appris que M. Bondonnat allait retourner en France, en emmenant avec lui Paganot et Ravenel. Une fois livré à lui-même, Harry n’est pas de force à soutenir la lutte.
– Je vais aussi, dit brusquement Cornélius, m’arranger de façon à dissoudre la Main Rouge. Les bandits dont elle se compose sont des alliés trop dangereux… Il faut faire peau neuve d’une façon complète. Nous sommes désormais d’honnêtes milliardaires ; nous ne devons avoir rien de commun avec la canaille !
Les trois bandits se séparèrent à une heure assez avancée. Baruch, en prenant congé des frères Kramm à la petite porte de la grille, leur rappela qu’il comptait sur eux pour assister à son mariage, qui devait être d’une somptuosité sans précédent, même dans le monde des milliardaires. Tous deux l’assurèrent de leur exactitude. Il leur donna un dernier shake-hand, et, le cigare aux dents, en flâneur, descendit nonchalamment la Trentième avenue.
Son auto l’attendait à la place où il l’avait laissée. Après y être monté, il s’étendit tout de son long sur les somptueux coussins, les yeux mi-clos, savourant le plaisir de se sentir emporté avec une vertigineuse vitesse et se laissant bercer par sa rêverie.
« Le trust des trusts ! songeait-il. Il faudra que j’arrive à convaincre Cornélius. Sa science m’est nécessaire pour mener à bien un projet aussi magnifique. Que seront tous les chefs d’État en présence de celui qui sera l’unique détenteur de ce métal magique, de cet or que les alchimistes appelaient « l’essence de soleil ». Et quand je serai devenu le roi des rois, l’empereur des empereurs, qui osera me reprocher d’avoir sacrifié à la réalisation d’une idée aussi grandiose quelques existences inutiles !… »
La vitesse de l’automobile avait encore augmenté.
Elle était devenue vertigineuse.
Baruch regarda machinalement par la portière et ne reconnut pas l’endroit où il se trouvait. C’étaient des cahutes de planches des terrains vagues, tout un misérable paysage de banlieue, que les rayons de la lune éclairaient sinistrement.
– Ah ça ! grommela-t-il, ce chauffeur est ivre ! Ce n’est pas du tout le chemin… Chauffeur !
Un ricanement sardonique fut la seule réponse qu’il reçut à ses réclamations.
Au même moment, deux ressorts se déclenchèrent avec un bruit sec. Deux fortes plaques de tôle, glissant dans leurs rainures, vinrent obturer complètement les glaces des portières. Une obscurité profonde régna dans l’intérieur du véhicule.
Baruch était pris comme un rat dans une ratière. Il cria, trépigna, menaça, sans qu’on fît la moindre attention à ce qu’il disait.
Voyant que tout ce qu’il faisait était inutile, le bandit se tint coi. Il comprenait maintenant que sa voiture avait été remplacée par une autre exactement semblable en apparence. Son chauffeur avait sans doute été assassiné, et lui, il était prisonnier.
Prisonnier de qui ?
Là gisait l’angoissant mystère.
Il souhaitait de tout son cœur d’être tombé dans les mains de véritables malfaiteurs. Avec ceux-là, il en serait quitte pour une rançon.
« Ce n’est pourtant pas la police, songeait-il en essayant de se rassurer lui-même. Si l’on avait dû tenter quelque chose contre moi de ce côté, j’en aurais déjà été prévenu. La Main Rouge a, dans les bureaux du Police-Office, des agents dévoués ; comme elle en a partout… Qui sait ? C’est peut-être un amoureux de Carmen qui m’enlève pour empêcher mon mariage ? »
Baruch se livra ainsi, pendant quelques minutes, à toutes sortes de suppositions extravagantes, mais il ne put en échafauder une seule qui lui parût vraisemblable en fin de compte.
L’auto qui lui servait de prison allait maintenant à une allure plus raisonnable. Enfin, elle ralentit sa marche et, brusquement, stoppa.
Baruch eut une minute d’angoisse. Il se demandait avec impatience si on n’allait pas bientôt le faire descendre, lui expliquer à la fin ce qu’on voulait de lui.
Il avait pris en main son browning, en cas qu’il eût affaire à des assassins, décidé à vendre chèrement sa vie.
Tout à coup, les deux portières s’ouvrirent en même temps et, avant qu’il ait pu faire usage de son arme, quatre hommes d’une stature herculéenne l’empoignèrent et le garrottèrent.
– Où suis-je ? criait-il. Qui êtes-vous ? Vous vous trompez. Je suis le milliardaire Joë Dorgan. Si vous êtes des bandits, je suis prêt à vous payer telle rançon que vous me demanderez !…
Personne ne lui répondit.
Mais, pour le réduire complètement au silence, un des hommes le bâillonna avec un mouchoir, pendant qu’un autre lui bandait les yeux. Puis il se sentit soulever de terre et emporter comme une masse inerte.
Bientôt, au bruit qu’il perçut, à la légère secousse qu’il ressentit, il comprit qu’on l’avait déposé dans la cage d’un ascenseur.
Il entendit l’appareil s’arrêter.
De nouveau, brutalement saisi, emporté, on le posa à terre ; on lui arracha son bandeau et son bâillon.
Une porte se referma bruyamment, et Baruch se trouva au milieu d’épaisses ténèbres.
CHAPITRE IV
Le cauchemar du samedi
Baruch demeura plus d’une heure à l’endroit où on l’avait déposé, sans faire le moindre mouvement.
Il était tellement atterré, tellement stupéfait qu’il n’avait plus la force de raisonner. La transition était tellement brusque, du pinacle triomphal où il se plaçait par imagination à ce cachot obscur, qu’il en restait comme foudroyé sur place.
Dans le désarroi d’idées où il se trouvait, il en arrivait à se demander si ce n’étaient pas Fritz et Cornélius eux-mêmes qui lui avaient tendu ce traquenard. Mais il lui suffisait de réfléchir un instant pour se rendre compte que ses deux complices avaient, au contraire, le plus grand intérêt à ce qu’il entrât en possession des sommes immenses qu’il devait toucher.
Petit à petit, il finit par se calmer, comprenant bien que, dans aucune des circonstances si périlleuses de sa vie, il n’avait eu autant besoin de sang-froid, de lucidité et d’intelligence.
Baruch était brave et l’idée qu’il allait perdre la partie au moment même où il croyait l’avoir gagnée rendit à son énergie tout son ressort. Il fallait lutter de nouveau ? Eh bien, il lutterait !
La conviction d’avoir derrière lui de puissants alliés qui, lorsqu’ils connaîtraient la situation où il se trouvait, s’empresseraient de venir à son secours avec les formidables moyens dont ils disposaient, acheva de lui rendre courage.
« Il serait honteux, songea-t-il, de m’abandonner lâchement au désespoir, alors que la partie est encore si belle pour moi, même dans l’état où je me trouve réduit. »
Le premier usage que fit Baruch de son énergie reconquise fut de se dégager de ses liens ; il constata avec surprise qu’ils n’avaient point été extrêmement serrés, soit par suite d’une négligence de la part de ses geôliers, soit à cause de la croyance où ils étaient qu’il ne pourrait s’évader.
À l’aide d’une série de torsions et de mouvements des poignets, il se débarrassa des cordes qui le liaient. Au bout d’une demi-heure d’efforts, il eut la satisfaction de recouvrer la liberté complète de ses mouvements.
– Maintenant, murmura-t-il, nous allons voir ! J’ai les mains libres ! Il se mit à arpenter son cachot de long en large pour rétablir la circulation du sang, et, tout en marchant, il se fouilla. À son grand désappointement, il ne retrouva ni le browning dont il était toujours porteur ni même son mouchoir. On ne lui avait laissé aucun objet qui pût lui servir d’arme ou de moyen de corruption à l’égard de ses gardiens.
Dans les ténèbres profondes où il était plongé, il se mit en devoir d’explorer les murs et le sol de son cachot. En dépit de tous ses efforts, il ne put découvrir aucune trace de porte ou de fenêtre.
Le sol, les parois, et même le plafond de la chambre carrée, où il se trouvait renfermé, étaient uniformément revêtus d’un épais capitonnage, soigneusement matelassé, comme le sont les cellules où l’on enferme les aliénés atteints de la monomanie du suicide.
Ce qui alarma encore plus Baruch, c’est qu’il s’aperçut qu’on n’avait mis à sa disposition ni boisson ni nourriture. Aussi se demanda-t-il en frissonnant s’il n’était pas condamné à mourir de faim dans cette cabine rembourrée, d’où aucun cri d’appel ne devait pouvoir arriver au-dehors.
Il fallait, pourtant, que l’air respirable pénétrât dans cette cage si hermétiquement close. Il n’y arrivait sans doute que par des ouvertures imperceptibles et si bien dissimulées que c’eût été du temps perdu que de les chercher.
Bientôt, il tomba dans un abattement profond.
Il s’étendit tout de son long, ferma les yeux, essaya de dormir ou de penser. Mais, dès qu’il fermait les paupières, il se trouvait aussitôt obligé de les rouvrir.
Il songea tout à coup avec épouvante qu’il se trouvait précisément dans cette nuit du samedi au dimanche qui, pendant si longtemps, avait été hantée, pour lui, par les plus terribles cauchemars.
Ces craintes hâtèrent le commencement de l’hallucination même qu’il redoutait.
Dans ce silence profond, dans ces épaisses, ténèbres, il entendait les battements de son cœur sonner à grands coups sourds dans sa poitrine. Il lui sembla ensuite que des voix chuchotaient à son oreille. En même temps, l’obscurité s’animait de toutes sortes de figures grimaçantes dont l’aspect se modifiait sans cesse et qui voletaient, en tourbillonnant, tout autour de lui.
C’était, à certains instants, comme des milliers de mouches de feu douées d’un rapide mouvement de vibration ; puis ces points lumineux se réunirent pour former d’innombrables mains sanglantes, qui toutes se tendaient vers son visage et le désignaient de l’index tendu, comme pour dire : « C’est lui ! »
– La Main Rouge ! bégaya-t-il éperdu de terreur.
Il lui semblait que ces mains, de minute en minute plus nombreuses et plus menaçantes, lui sautaient sur les épaules, lui tiraient les cheveux, se suspendaient aux basques de son habit ou se promenaient lentement sur son visage, en lui procurant la même sensation que s’il eût été frôlé par l’aile d’une chauve-souris.
Baruch était épouvanté.
– Si je reste ici plus longtemps, songea-t-il, je deviendrai sûrement fou…
Il se mit à trembler de tous ses membres, en songeant que l’endroit où il se trouvait n’était peut-être que le cabanon de quelque Lunatic-Asylum, d’où il ne sortirait jamais et où sa raison aurait bientôt sombré.
Le propre de certaines hallucinations, c’est de varier avec l’incessante rapidité d’un kaléidoscope.
Aux mains sanglantes qui tournoyaient autour de lui comme des oiseaux de mauvais augure, avaient succédé des faces grimaçantes, qui le regardaient avec de hideux sourires, et parmi lesquelles il reconnaissait les physionomies de quelques-unes de ses victimes.
Il aperçut au premier rang Pablo Hernandez, qui s’avançait en donnant le bras au chimiste Maubreuil. Tous deux avaient le visage d’une couleur cadavérique, mais leurs prunelles rayonnaient d’un éclat insoutenable, d’une cruelle fixité ; et la contemplation de ces regards avait, pour l’assassin, quelque chose de si terrible qu’il finit par perdre connaissance.
Un lourd sommeil, peuplé de mauvais rêves, succéda à cet évanouissement.
Quand Baruch rouvrit les yeux, il avait complètement perdu toute notion du temps et du lieu : il lui fallut beaucoup d’efforts pour arriver à se rappeler ce qui lui était arrivé la veille, et dans quel endroit il se trouvait.
Il avait été réveillé par le bruit d’une musique lointaine, dont les sons, à la fois doux et majestueux, allaient sans cesse en augmentant jusqu’à atteindre les grondements imposants du tonnerre, auxquels se mélangeaient des chants aériens et légers, comme si les voix célestes d’un chœur d’archanges se fussent mêlées aux mugissements d’une tempête.
Peu à peu, les rumeurs de l’ouragan eurent le dessous et le chant d’allégresse et d’amour s’enfla plus largement en montant vers le ciel.
Baruch était d’abord demeuré, comme en extase, bercé par cette mystérieuse musique qui lui semblait avoir une expression surnaturelle.
Il comprit bientôt que ce qu’il entendait, c’était la voix d’un orgue puissant sur lequel un grand artiste exécutait de géniales improvisations. Le caractère de la musique se modifia brusquement ; il prit quelque chose de suave, d’intime et de mélancolique à la fois. C’étaient comme de tendres promesses chuchotées à mi-voix, de timides aveux, des confidences entremêlées de chastes caresses, des baisers et des sourires mouillés de larmes vite essuyées. Il y avait tout cela, et bien d’autres choses encore, dans ces surhumains accents qui parvenaient aux oreilles de Baruch comme s’il eût été tout proche de l’instrument qui les produisait.
Tout à coup, il lui sembla que les opaques ténèbres s’illuminaient d’une tremblante lueur, faible et incertaine, comme un reflet lointain qui paraissait monter du sol même de son cachot.
D’un mouvement instinctif, il se leva, porta la main à son front brûlant de fièvre et se dirigea d’un pas mal assuré du côté d’où venait la lumière.
Après avoir traversé la cellule, il vit à ses pieds une sorte de judas, qui s’était brusquement ouvert dans le sol même, à la place d’un des losanges de cuir du capitonnage, et dont le treillis serré laissait passer la lueur qui avait attiré son attention.
Avidement, fiévreusement, Baruch s’étendit à plat ventre, colla ses yeux au grillage et regarda.
Le spectacle qui se déploya alors à ses regards était tel que l’assassin sentit tout son sang refluer vers son cœur. Ses oreilles bourdonnaient, et il crut un instant qu’il était le jouet de quelque nouvelle hallucination. Mais la netteté, la réalité même du tableau qu’il apercevait, éclairé par des centaines de lampes électriques, ne lui permirent pas de croire à un rêve.
De son cachot situé dans les combles, Baruch voyait à ses pieds, comme au fond d’un gouffre, le chœur et la nef principale d’une chapelle catholique étincelante d’ors et de lumières ; l’autel était paré de fleurs et la fumée d’azur des encensoirs s’élevait en harmonieuses spirales entre les piliers drapés de satin blanc et décorés de guirlandes de roses, de lis, de lilas blanc et de jasmin. Devant l’autel, un évêque aux vénérables cheveux blancs, à la chasuble coruscante de pierreries, s’apprêtait à donner la bénédiction nuptiale à un jeune homme et une jeune fille qui, en ce moment, tournaient le dos à Baruch.
Une brillante assistance remplissait la chapelle, et Baruch reconnut avec stupeur, parmi les invités aux brillantes toilettes, lord et lady Burydan, Fred Jorgell, Harry Dorgan, mistress Isidora, M. Bondonnat, Frédérique, Andrée et leurs époux, Oscar Tournesol, Régine, Agénor et le Peau-Rouge Kloum.
Cette stupeur se changea en une véritable horreur lorsque, dans un vieux gentleman mis avec une suprême élégance, qui s’était tenu jusqu’alors caché derrière un pilier, Baruch reconnut, à ne pouvoir s’y tromper, William Dorgan lui-même !
William Dorgan, dont l’acte de décès avait été dûment dressé ! William Dorgan, dont Cornélius et Fritz avaient retrouvé le cadavre sous les décombres du pont de Rochester et dont lui, Baruch, avait touché l’héritage presque entier, après un retentissant procès avec Harry Dorgan !
Baruch porta la main à son front avec un cri sourd. Il sentait sa raison chavirer en plein cauchemar, en pleine invraisemblance.
Il eut, un moment, la pensée qu’on lui avait fait absorber l’un de ces poisons du cerveau qui, comme le haschisch, ont le pouvoir de déformer les perceptions des sens.
Il se pinça jusqu’au sang, il se frotta les yeux, pour être bien sûr qu’il ne rêvait pas.
Mais non ! Tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il entendait était d’une réalité trop intense pour appartenir au domaine du songe.
Il distinguait les moindres détails des toilettes ou des costumes, il pouvait compter les perles étincelantes au cou des jeunes femmes. La rumeur des orgues bruissait encore à son oreille et le parfum de l’encens montait à ses narines.
Tout ce qu’il voyait avait donc une existence bien tangible. Baruch se demanda comment tous ses ennemis se trouvaient, comme par un fait exprès, réunis là, dans cette chapelle.
Il n’avait pu apercevoir encore le visage de la mariée, mais il tremblait de le deviner.
Il avait peur de savoir.
Au moment où la jeune fille, en somptueuse robe de brocart d’argent garnie de perles, se retourna pour la cérémonie de l’anneau, il ferma les yeux pour ne pas apercevoir son visage. Néanmoins, la curiosité fut la plus forte, il les rouvrit presque aussitôt.
Il vit la fière doña Carmen Hernandez, tout à la fois souriante, extasiée, rougissante, échanger la bague nuptiale avec Joë Dorgan !… Joë Dorgan lui-même, le visage rayonnant d’intelligence et de santé !
Baruch eut la sensation qu’éprouve un homme qui roule dans un gouffre.
Il poussa un cri d’angoisse et s’évanouit.
*
* *
Le docteur Cornélius Kramm était paisiblement occupé à travailler dans son laboratoire souterrain, en compagnie de son préparateur Léonello, lorsque son frère Fritz y fit brusquement irruption.
Le visage du marchand de tableaux était blême, décomposé. Ses vêtements en désordre, son front couvert de sueur montraient qu’il était accouru précipitamment sans même faire usage de son auto.
Il s’écroula plutôt qu’il ne s’assit sur un siège placé à côté de celui de son frère.
– Qu’y a-t-il donc ? demanda Cornélius avec surprise.
– Tout est perdu ! bégaya Fritz d’une voix étranglée. Baruch est pris ! Doña Carmen est mariée !…
– Que me chantes-tu là ?… Tu es fou !… Mais c’est impossible, ce que tu me racontes !…
– Baruch n’a pas reparu à son hôtel depuis notre dernière entrevue, et l’on n’a revu ni son auto ni son chauffeur… On ne sait ce qu’ils sont devenus !…
– Voyons ! tu déraisonnes… Si Baruch est arrêté ou en fuite, doña Carmen n’a pas pu se marier !
– Voilà bien le plus terrible ! C’est qu’elle a épousé Joë Dorgan… Entends-tu ? le vrai Joë Dorgan !… Mais ce n’est pas tout encore… William Dorgan est ressuscité !…
Cornélius tombait de son haut.
– Ah ça ! fit-il, je commence à croire sérieusement que tu divagues… Soyons calmes, d’abord, pas d’énervement… Avant tout, de la logique et des faits précis !
– Il n’y en a que trop, hélas ! de faits précis…, murmura Fritz d’un air abattu.
– William Dorgan ne peut pas être ressuscité, puisque c’est nous-mêmes qui avons reconnu son cadavre lors de l’accident du pont de Rochester.
– Ce n’était pas lui. William Dorgan – à ce que m’a confié un de nos affiliés qui est employé au parquet – a introduit une demande en rectification d’état civil. Ramassé sur le lieu du sinistre par des amis, il a été soigné jusqu’à ce jour dans une maison de santé, et il possède toutes les preuves capables d’établir la vérité de ses affirmations. L’homme qu’on a enterré à sa place est un certain Murray. Tout l’échafaudage de nos projets s’écroule comme un château de cartes…
– Nous avons été roulés comme des enfants, comme des niais, par lord Burydan… Je vais réfléchir au meilleur parti à prendre… Mais explique-moi d’abord L’histoire du mariage de doña Carmen.
– Rien de plus simple. La jeune fille était du complot. Je viens d’apprendre, mais trop tard, qu’elle a eu plusieurs entrevues secrètes avec lord Burydan et Andrée de Maubreuil. Andrée et Carmen, qui, toutes deux, avaient à venger la mort de leur père assassiné par Baruch, se sont entendues à merveille. Et c’est ainsi qu’a été organisée une comédie dont nous sommes nous-mêmes victimes aujourd’hui.
– Je comprends maintenant, reprit Cornélius avec une sourde exaspération, pourquoi l’Espagnole se montrait si fière et si cérémonieuse avec Baruch, pourquoi elle ne lui accordait que de si courtes entrevues.
– Elle en accordait de plus longues au véritable Joë, que, paraît-il, Bondonnat a complètement guéri. Elle le connaissait, d’ailleurs, depuis longtemps, car William Dorgan et Pablo Hernandez avaient été autrefois en relations d’affaires.
« Persuadée par lord Burydan et par Andrée, l’Espagnole est fougueusement entrée dans la combinaison qui devait assurer sa vengeance. Quant à Baruch, il a disparu, et maintenant nous allons avoir à compter à la fois avec William Dorgan et le véritable Joë.
– Et sans doute, ajouta Cornélius d’un air sombre, avec la police des États-Unis… C’est une vraie catastrophe…
– Dont tu peux bien accuser ton imprudence ! s’écria Fritz avec colère. Si tu avais, dès le début, comme je le demandais, supprimé Joë Dorgan, nous n’en serions pas réduits à cette extrémité.
– Inutile de nous quereller. Tes reproches ne servent à rien, ne signifient rien ! Nous avons la partie plus belle encore que tu ne penses. Nos contrats avec le trust de William Dorgan sont parfaitement en règle. Il faudra plaider, et, d’ici là, il peut se passer bien des événements.
– Mais si l’on t’accuse d’avoir opéré la transformation des physionomies ?
– Il faudra me le prouver. Les procédés que j’ai employés sont connus. Je les ai expliqués moi-même dans plusieurs brochures qu’a pu lire n’importe quel médecin. Reprends courage, mon cher Fritz, rien n’est encore désespéré.
– J’aime à te voir cette belle confiance, murmura le marchand de tableaux un peu calmé, mais que faut-il faire ?
– Le plus pressé, c’est de retrouver Baruch, de savoir ce qu’ils en ont fait. C’est lui, en réalité, la seule et vivante preuve que l’on puisse invoquer contre nous.
– Je vais m’en occuper. Aujourd’hui même, Slugh se mettra en campagne avec une douzaine de nos plus habiles affiliés. Mais, crois-moi, il faut que nos adversaires soient bien sûrs du triomphe pour se démasquer comme ils le font.
– C’est précisément cette assurance qui les perdra. Une fois que nous aurons retrouvé Baruch, je t’affirme, moi, que je ne serai pas embarrassé ! Il est heureux, d’ailleurs, que tu m’aies prévenu. Je vais mettre à profit le temps qui nous reste pour faire disparaître certains objets et certains papiers compromettants.
« Crois-moi, lord Burydan et sa bande n’ont pas encore gagné la bataille, comme ils se l’imaginent !
– Je voudrais te croire.
– On n’attaque pas ainsi un homme comme moi. Je suis célèbre ! Je suis riche ! Et j’ai à mes ordres les poignards de la Main Rouge.
*
* *
Les deux bandits passèrent trois longues heures à prendre les mesures nécessaires à leur défense.
Quand Fritz Kramm sortit de chez son frère, il avait reconquis sinon toute sa sérénité, au moins toute son audace.
CHAPITRE V
La coupe empoisonnée
Quand Baruch reprit connaissance, il fut tout surpris de ne plus se retrouver dans le cachot obscur d’où il avait assisté au mariage de doña Carmen. On avait profité de son évanouissement pour le transporter dans une autre prison.
C’était une chambre blanchie à la chaux, éclairée par une étroite fenêtre, garnie de forts barreaux de fer et meublée d’un lit de sangle, d’un escabeau et d’une table.
L’assassin pensa d’abord qu’on l’avait enfin livré à la justice et qu’il était dans un des établissements pénitentiaires de l’État de New York. Mais la vue d’un grand parc qu’il apercevait à travers les carreaux de la fenêtre, bien qu’on eût pris la précaution de les brouiller au lait de chaux, lui fit comprendre qu’il se trompait.
Il chercha vainement les raisons qui avaient poussé ses geôliers à le transférer là.
Décidément tout ce qui lui arrivait depuis le commencement de sa captivité était mystérieux.
Voici quel était le véritable motif de ce transfert :
C’était dans le palais de doña Carmen qui, appartenant à la religion catholique, possédait une chapelle installée dans une des ailes de sa riche demeure, que Baruch avait pu assister à son mariage. Mais, après lui avoir infligé ce premier châtiment, la jeune fille eût voulu, tout de suite, que le meurtrier de son père fût livré à la justice.
Lord Burydan lui démontra bien vite que c’était là une chose impossible. La découverte de la vérité eût causé un scandale dont Carmen elle-même et son mari eussent été les premières victimes. En outre, lord Burydan et Fred Jorgell tenaient beaucoup à ce que mistress Isidora, qui ne savait rien de ces événements, continuât à demeurer dans l’ignorance.
La jeune femme demandait toujours, de temps à autre, des nouvelles de son misérable frère, et on lui répondait constamment que sa santé était satisfaisante, mais qu’il ne recouvrerait jamais la raison.
Elle le croyait encore au Canada, et elle avait, à maintes reprises, pris la résolution d’aller y voir. Son mari et ses amis s’étaient toujours arrangés de façon à ce qu’elle ne pût mettre ce projet à exécution.
Très bonne et très généreuse, doña Carmen n’eût voulu causer aucun déplaisir à mistress Isidora. Alors, elle déclara avec beaucoup de fermeté à lord Burydan qu’elle voulait que la mort de son père fût vengée, et que, d’un autre côté, elle ne pouvait conserver plus longtemps dans son palais l’infâme scélérat dont la présence sous son toit lui causait un insurmontable dégoût.
La question était embarrassante. Pour la résoudre, lord Burydan réunit, dans une secrète conférence, William Dorgan, Fred Jorgell, l’ingénieur Harry et M. Bondonnat.
La discussion fut longue et animée. Les uns étaient d’avis que Baruch, auquel on restituerait sa véritable physionomie, fût réintégré dans le Lunatic-Asylum ; d’autres voulaient qu’on se débarrassât simplement de ce misérable d’un coup de revolver, comme on fait d’un chien enragé.
Ce fut Fred Jorgell lui-même qui trancha la question.
– Mes amis, dit-il d’une voix grave, puisque j’ai le malheur d’être le père d’un pareil monstre, c’est à moi seul qu’appartient le droit de le châtier. Je demande donc que ce fils indigne soit remis entre mes mains. Vous pouvez compter que je ne faillirai pas à ma tâche de justicier. Baruch doit recevoir le châtiment qu’il a mérité !…
Un profond silence accueillit ces paroles, qui mettaient fin à la discussion.
Personne ne s’opposa à ce que demandait l’inexorable vieillard.
C’est ainsi que Baruch fut transporté dans une propriété que possédait Fred Jorgell dans la banlieue de New York, propriété qui se composait d’un parc au Centre duquel était édifiée une villa, inhabitée depuis de longues années.
*
* *
… L’assassin passa le restant de la journée en proie à une indicible angoisse.
Il eût voulu, à tout prix, connaître la vérité, sortir de la torturante indécision où il se trouvait.
Par moments, il avait de véritables accès de rage, en songeant que, pendant qu’il languissait entre les quatre murs d’un cachot, son sosie Joë Dorgan s’installait à sa place et jouissait sans doute, près de la belle Carmen, des douces prérogatives d’un époux.
– Que suis-je donc, moi, maintenant ? s’écria-t-il en grinçant des dents. Je ne suis plus Joë Dorgan, je ne suis même plus l’assassin Baruch !… Je n’existe plus que comme un spectre vivant, qui n’a ni nom ni personnalité légale ! Je suis à la merci du premier venu qui voudra me tuer puisque, socialement parlant, je n’existe pas !…
Baruch fut tiré de ces affligeantes réflexions par la venue d’un geôlier qui lui apportait des vivres.
Dans cet homme, qui était d’une taille colossale, il reconnut le géant Goliath à la description que Slugh lui en avait faite, et, dès lors, il n’eut plus de doute sur sa situation.
Il était évident qu’il était tombé entre les mains de lord Burydan, de qui il n’avait, à coup sûr, aucune pitié à attendre.
Cette découverte lui porta un coup terrible. Il eût préféré mille fois être dans les mains de véritables bandits ou même de policiers.
Avec les bandits, il en eût été quitte pour une rançon ; avec les policiers, il se fût réclamé de la Main Rouge, qui avait parmi eux de nombreuses et puissantes accointances. De tels procédés n’étaient pas de mise avec des gens comme lord Burydan et Fred Jorgell, qu’on ne pouvait ni séduire ni tromper.
Baruch s’était fait toutes ces réflexions en l’espace de quelques secondes. Il pensa qu’il pourrait peut-être obtenir des éclaircissements de son geôlier.
– Qui êtes-vous, mon ami ? lui dit-il de sa voix la plus affable.
Goliath, pour toute réponse, mit un doigt sur ses lèvres et roula de gros yeux féroces, donnant à entendre qu’il lui était défendu de parler.
Il n’y avait décidément rien à faire de ce côté.
Le géant avait mis le couvert et posé sur la table le repas du prisonnier.
Baruch avait faim. En dépit de ses préoccupations, il mangea de grand appétit, sous la surveillance de son silencieux geôlier, qui ne le quitta pas des yeux une seule minute.
Le repas fini, Goliath enleva le couvert et se retira.
Baruch remarqua alors que la porte, massive et blindée comme celle d’un coffre-fort, était munie d’un guichet, à travers lequel on pouvait le surveiller à tout instant.
En proie à un sombre désespoir, que ses réflexions ne faisaient qu’augmenter, l’assassin se jeta sur son lit de sangle et essaya de dormir. Brisé par la fatigue et les émotions, il tomba dans un profond sommeil et il fut tout surpris, en rouvrant les yeux, de voir qu’il avait passé la nuit entière à peu près paisiblement.
Le soleil brillait joyeusement aux vitres de l’étroite fenêtre. Baruch regarda quelque temps les grands arbres du parc ; puis il arpenta sa cellule de long en large en bâillant. Il ressentait déjà les premières atteintes de cette neurasthénie aiguë à laquelle succombent, tôt ou tard, ceux qui sont condamnés à la réclusion.
Il y avait des moments où il eût désiré être jugé, condamné, exécuté même, pour échapper à cette existence d’inaction et d’effroyable monotonie. Il avait la pénible sensation d’être pour toujours séparé du monde des vivants.
« Ils n’oseront pas me tuer ! songeait-il en crispant les poings avec rage, ils vont me laisser crever d’ennui dans ce trou, pour ne pas charger leur conscience d’un meurtre !… Ah ! j’aimerais cent fois mieux en avoir fini tout de suite !… Ces hypocrites m’assassineront à petit feu ! Un coup de poignard serait préférable !… »
Cette journée parut à Baruch d’une durée interminable. Il la passa étendu sur son lit, ou se promenant de long en large dans sa cellule comme un tigre en cage.
Il était maintenant convaincu qu’on avait décidé de son sort et qu’il ne quitterait jamais sa prison.
Il se trompait.
Vers la fin de l’après-midi, la porte s’ouvrit brusquement. Goliath entra, précédant respectueusement un vieux gentleman, dans lequel Baruch reconnut, avec saisissement, son véritable père, le milliardaire Fred Jorgell.
Tous deux se regardèrent quelques instants en silence. Mais, malgré toute son insolence et toute son audace, Baruch fut obligé de baisser les yeux sous le regard sévère du vieillard.
– Je ne croyais jamais vous revoir, dit Fred Jorgell d’un ton glacial. Je pensais, comme tout le monde, qu’après les premiers crimes que vous avez commis vous aviez perdu la raison. Et, certes, je m’en applaudissais.
« Mes amis pouvaient ainsi prétendre, avec quelque vraisemblance, que les assassinats de Jorgell-City, que le meurtre de M. de Maubreuil n’étaient que le résultat d’une sanglante démence. Je sais maintenant que vous possédiez parfaitement votre raison, que vous n’avez jamais cessé d’être parfaitement intelligent, parfaitement conscient de vos actes !
Les yeux baissés, Baruch écoutait son père sans mot dire, se demandant à quoi tendait ce préambule.
– Vous avez une première fois échappé au châtiment, continua le vieillard, et cela par un crime plus monstrueux que les précédents. Mais tout a une fin. Il est temps de mettre un terme à vos exploits, et, cette fois, ni la science infernale du docteur Cornélius ni les poignards de la Main Rouge ne réussiront à vous sauver !…
L’assassin eut un mouvement de révolte. Sa physionomie prit une effroyable expression de haine et de rage impuissantes. Il serra les poings, s’élança sur Fred Jorgell et essaya de le saisir à la gorge.
Heureusement, Goliath veillait. D’une simple bourrade de son formidable poing, il força Baruch à s’asseoir sur l’escabeau, et il le maintint dans cette position.
– Je ne regrette qu’une chose, s’écria le bandit en grinçant des dents hideusement, c’est de ne pas vous avoir tué !…
– Silence, malheureux ! dit le vieillard. J’ai hâte d’en avoir fini avec vous. Je ne pourrais longtemps supporter votre odieuse présence.
– Oui, finissons-en ! Que me voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous venu me tourmenter ?
– J’ai pensé que, si lâche que vous soyez, vous auriez encore le courage de vous suicider. Je vous laisse jusqu’à demain matin pour prendre une résolution à ce sujet. Mais, si, demain, vous ne vous êtes pas fait justice, d’autres se chargeront de ce soin !…
Baruch comprit que tout était perdu. Sa fierté disparut. Il se fût trouvé, en ce moment, parfaitement satisfait en se voyant condamné à une réclusion perpétuelle, lui qui, une heure auparavant, préférait la mort à l’emprisonnement.
– Mon père, balbutia-t-il d’une voix toute changée, j’aurais voulu revoir ma sœur Isidora… la seule personne que j’ai aimée et qui se soit montrée bonne pour moi !…
« Ah ! vous n’avez pas dû lui dire ce que vous vouliez faire !… Isidora eût intercédé pour moi !… Que pensera-t-elle, quand elle saura que vous avez eu le triste courage de me forcer à mourir ! Accordez-moi la vie ! seulement la vie !… Grâce, mon père, grâce, au nom d’Isidora !
Baruch, si Goliath ne l’eût contenu, se fût jeté aux genoux de Fred Jorgell.
– Cette lâcheté est écœurante, dit le vieillard avec dégoût. Je croyais qu’un bandit de votre sorte aurait montré plus de courage !… Ces supplications sont inutiles. Je ne changerai rien à ce que j’ai résolu. Vous avez jusqu’à demain matin pour mourir !
Fred Jorgell avait tiré de sa poche une longue boîte d’acajou qu’il posa sur la table. Il sortit de la chambre, suivi de Goliath, sans un mot d’adieu, sans un regard pour le misérable, qui demeurait affaissé la tête dans ses mains, sur l’escabeau où la forte poigne du géant l’avait pour ainsi dire cloué.
Baruch entendit les verrous et les serrures grincer.
La porte s’était refermée.
Il se leva, en flageolant sur ses jambes comme un homme ivre, prit sur la table la boîte d’acajou et l’ouvrit.
Elle renfermait un revolver tout chargé.
Il le prit et l’examina avec une attention minutieuse.
– C’est une arme de précision, fit-il avec un ricanement amer, une arme de luxe, digne d’être offerte par un milliardaire à son fils !
Il demeura longtemps les yeux fixés sur les nickelures brillantes de l’arme, qui semblaient l’hypnotiser. Puis, brusquement, il le déposa sur la table, alla vers la fenêtre et regarda avec une avide curiosité le ciel, où les derniers rayons du soleil couchant allaient en s’effaçant de minute en minute.
– Demain, murmura-t-il d’une voix sombre, le soleil ne se lèvera pas pour moi.
Il se jeta sur son lit, fermant les yeux pour ne plus penser. Quand il les rouvrit, la chambre était pleine de ténèbres. Seul le revolver étincelait dans la pénombre.
– Eh bien, non ! s’écria l’assassin d’une voix rauque, je n’obéirai pas à cet ordre de suicide, et je lutterai jusqu’au bout !… Mon père – c’est lui qui est au fond la cause de tous mes maux – me tuera de sa propre main, s’il a le cœur de le faire ! Je me défendrai, et avec cette arme même dont on a voulu faire l’instrument de mon supplice. Je tuerai le premier qui demain ouvrira ma porte, je lutterai jusqu’au bout !…
Ce mouvement de révolte ne dura guère. Baruch réfléchit que des hommes aussi intelligents que lord Burydan et Fred Jorgell avaient dû prendre leurs précautions contre toute tentative de résistance.
– À quoi bon essayer de lutter ? murmura-t-il. Ils s’apercevront bien vite que je ne suis pas mort. Périr d’une balle dans la tête ou périr de faim et d’ennui entre ces quatre murs, lequel est préférable ?… Il vaut mieux en finir tout de suite. Il ne me reste aucun espoir d’être secouru !
Le bandit se leva, prit le revolver d’une main fébrile et revint de nouveau s’étendre sur son lit de sangle. Le doigt sur la gâchette de l’arme, il réfléchissait.
Toutes les scènes qui s’étaient déroulées dans le courant de son existence tumultueuse se présentaient l’une après l’autre à ses regards. Il revoyait par la pensée, avec une singulière netteté, des actes et des gestes qu’il croyait avoir complètement oubliés.
Il comprenait maintenant qu’il était seul, que les luttes passionnantes de la vie active ne viendraient plus le distraire de ses pensées, qu’il était condamné à vivre dans la seule compagnie de ses terribles souvenirs, à vivre jour et nuit dans la société de ses victimes !
– Décidément, soupira-t-il, le sommeil éternel de la mort est encore préférable à tous ces cauchemars !
Il prit le revolver cette fois d’une main ferme et l’appuya contre sa tempe.
Mais, au moment où il allait presser la détente, il lui sembla entendre un bruit singulier au-dessus de sa tête.
– Qu’est-ce que c’est que cela ?
Il se dressa en sursaut et tendit l’oreille.
Le bruit avait cessé.
– Bah ! fit-il, qu’importe !…
À l’instant même où il prononçait ces paroles, un menu fragment de plâtre se détacha du plafond et tomba sur son visage.
Le même bruit de grattement avait recommencé.
Cette fois, Baruch mit son revolver dans sa poche et se leva, en proie à une grande agitation. Il ne pensait déjà plus à ce suicide auquel il était si fermement résolu l’instant d’auparavant.
Un autre plâtras venait de se détacher du plafond, puis un autre. On cognait maintenant à coups redoublés et Baruch était profondément étonné que Goliath n’eût pas déjà été attiré par le bruit.
Le cœur du prisonnier palpitait d’espérance. Mais, en même temps, Baruch tremblait que Goliath n’intervînt.
– Si cette brute a le malheur de venir nous déranger, grommela-t-il, je le tue comme un chien ! Décidément, mon père a eu une heureuse idée en me faisant cadeau de ce revolver.
Un énorme fragment du plafond venait de se détacher, un rayon de lumière pénétra par le trou béant qui venait de s’ouvrir, et Baruch vit apparaître la face énergique de Slugh. Il était armé d’une hache, grâce à laquelle il venait de se frayer un passage à travers le toit.
Baruch crut qu’il allait devenir fou de joie. Il chancelait comme pris d’une sorte d’ivresse.
– C’est toi, mon brave Slugh ? balbutia-t-il.
– Oui, milord, répondit le bandit avec respect. J’ai reçu l’ordre de vous délivrer.
– Mais, malheureux, ne put s’empêcher de dire Baruch, tu fais trop de bruit. Je suis surpris que Goliath ne soit pas déjà là !… Un peu plus de prudence, que diable !
Slugh eut un bruyant éclat de rire.
– Ce bon Goliath, fit-il jovialement, ne vous faites pas d’inquiétude à son sujet ! Ils dorment d’un si profond sommeil – lui et ses collègues qui montaient la garde dans le jardin – qu’il serait, je crois, très difficile de les réveiller.
– Tu les a tués ?
– Non, milord. Ils sont seulement endormis. J’ai pris avec moi, pour mener à bien cette expédition, une dizaine des plus expérimentés de nos chevaliers du chloroforme. À l’heure qu’il est, les geôliers sont tous solidement garrottés et bâillonnés. Les Lords avaient défendu qu’on leur fît le moindre mal.
Baruch reconnut, à cet ordre, la prudence de Cornélius.
– Les Lords ont eu raison, dit-il. Mais apprends-moi donc où je me trouve ?
– Tout simplement dans la banlieue de New York, et j’ai ici une auto qui vous conduira où vous voudrez.
– Eh bien, soit ! Mais pas de paroles inutiles ! J’ai hâte d’être déjà hors d’ici.
Baruch monta sur l’escabeau qu’il avait hissé sur la table et, avec l’aide de Slugh, il passa par le trou pratiqué dans le plafond et se trouva dans un grenier, d’où il fut facile aux deux bandits de gagner le parc, à l’aide d’une échelle. La même échelle leur servit aussi à franchir le mur d’enceinte. Et, enfin, Baruch eut la satisfaction de se retrouver dans une auto – l’automobile fantôme elle-même – qui, pilotée par Slugh, partit à toute allure dans la direction de New York, dont les lumières formaient, au fond de l’horizon, comme une brume de clarté.
Baruch éprouvait une immense satisfaction en se voyant si miraculeusement sauvé, après avoir été pour ainsi dire effleuré par les ailes de la mort.
Il aspirait avec délice l’air frais de la nuit, se jurant en lui-même de ne plus tomber aussi sottement entre les mains de ses ennemis.
– Libre ! s’écria-t-il avec une sorte d’ivresse, je suis libre ! Je vais donc pouvoir prendre ma revanche ! Ils ont eu la sottise de me laisser échapper, ils m’ont manqué, mais moi je ne les manquerai pas !…
Se conformant aux ordres qu’il avait reçus, Slugh déposa Baruch à l’entrée de la Trentième avenue, et, après lui avoir courtoisement demandé s’il n’avait besoin de rien, il remonta en auto et disparut.
Baruch Jorgell ne se trouvait qu’à quelques pas de l’hôtel habité par le docteur Cornélius. Il s’y rendit aussitôt, bien sûr qu’il y était attendu.
La petite porte du jardin avait été laissée ouverte à son intention. Il entra, après s’être assuré que personne ne l’avait suivi, et se dirigea vers l’hôtel, dont quelques fenêtres étaient encore éclairées.
Il ne rencontra sur son passage aucun serviteur. Le vestibule, le salon et les autres pièces du rez-de-chaussée où il pénétra successivement étaient déserts. On eût dit que la maison avait été abandonnée. Mais Baruch connaissait les aîtres. Il alla droit à l’ascenseur. Quelques minutes plus tard, il frappait à la porte du laboratoire souterrain.
Ce fut Cornélius qui vint lui ouvrir. Tous deux se serrèrent la main avec effusion.
– Mon cher Baruch, dit le docteur, je suis charmé de vous revoir en liberté. Je viens d’apprendre, il y a une demi-heure à peine, le succès de votre évasion…
– Comment ! vous saviez déjà ?… murmura Baruch avec surprise.
– Oui… Un de nos affiliés m’a téléphoné sitôt que vous avez été hors de votre prison.
– Je vous dois tous mes remerciements pour votre intervention. Slugh est arrivé juste à point. Il m’est apparu comme un messager céleste au moment même où j’appuyais le canon d’un revolver sur ma tempe.
Cornélius fronça le sourcil.
– Vous vouliez donc vous suicider ? fit-il avec une subite méfiance.
– Je voulais, n’est pas le mot, j’étais forcé de me suicider.
En quelques mots rapides, Baruch raconta à Cornélius ses aventures des jours précédents.
Tout en parlant, ils étaient entrés dans le laboratoire, où se trouvaient déjà Fritz et Léonello, que Baruch mit aussi au courant de sa captivité et de son évasion. Ses regards, pendant qu’il parlait, erraient distraitement autour de lui. Il constata qu’un grand nombre des appareils et des moulages coloriés qui garnissaient les murs et les vitrines avaient disparu.
– Il me semble, dit-il, qu’il y a chez vous quelque chose de changé.
– Oui, répondit Fritz, nous avons dû prendre quelques précautions, détruire certains objets compromettants, car il n’y aurait rien de surprenant à ce que la police fît ici une perquisition.
Et Fritz, à son tour, mit Baruch au courant de ce qu’il ignorait, et lui fit comprendre la gravité de la situation.
Tous trois demeurèrent quelque temps silencieux, comme si nul n’eût voulu émettre son opinion le premier.
– Que faut-il faire ? demanda enfin Baruch avec agitation.
– Il ne vous reste, répondit Cornélius, qu’un seul parti à prendre. C’est de fuir le plus vite possible… Cette nuit même, à l’instant… Et de vous en aller très loin, jusqu’à ce que nous ayons réparé l’échec que nous venons de subir.
Baruch était atterré, anéanti.
– Je n’aurais jamais cru, fit-il, à une catastrophe aussi complète. C’est l’écroulement de tous nos projets !… Pour mon compte, je ne crois pas que cet échec soit réparable…
– Vous avez tort, fit hypocritement Cornélius. Nos adversaires ne sont pas immortels. Les trains peuvent dérailler, les paquebots sombrer, les maisons sauter. Il pourrait suffire d’un seul de ces accidents pour rétablir complètement nos affaires ! J’ai gagné autrefois des parties plus difficiles !
– Vous me rendez un peu d’espoir, murmura Baruch avec accablement. Je vais vous obéir de point en point.
– Tout a été disposé pour votre fuite. Dans une heure, vous serez à bord d’un paquebot dont le capitaine est des nôtres et qui met la voile pour les Antilles.
– Mais, dit Fritz avec un bizarre sourire, vous devez avoir besoin d’argent. Voici toujours une liasse de bank-notes pour parer au plus pressé. Vous en recevrez d’autres, sitôt votre arrivée à La Havane.
– J’accepte les bank-notes, fit Baruch en serrant le portefeuille que Fritz lui tendait. Je voudrais bien aussi que vous me fassiez donner quelque chose à boire : j’ai la gorge sèche, je meurs de soif.
Sur un geste de Cornélius, Léonello apporta trois coupes et alla chercher, dans la glacière où elle était tenue au frais, une bouteille d’extra-dry.
Fritz et Cornélius trinquèrent au bon voyage de leur complice. Baruch se leva et se disposa à partir.
– Léonello va vous conduire jusqu’au paquebot dans mon automobile, dit Cornélius. Il ne vous quittera que quand vous serez monté à bord. Adieu donc, mon cher Baruch, et bon voyage !
Les trois bandits échangèrent un dernier et cordial shake-hand. Baruch se dirigea vers la porte du laboratoire, suivi à quelques pas par Léonello, qui s’était courtoisement effacé pour le laisser passer le premier.
Comme l’Italien allait entrer dans le vestibule, il se retourna et échangea un rapide coup d’œil avec le docteur Cornélius.
Baruch entrait déjà dans l’ascenseur. Au moment précis où, tournant le dos à Léonello, il baissait la tête pour franchir la porte de la cage vitrée, l’Italien, d’un geste prompt comme la foudre, le frappa d’un coup de stylet aigu à la base du crâne.
Le coup avait été porté avec une sûreté et une précision qui eussent fait honneur à un spadassin de profession.
La pointe affilée de l’arme avait atteint la moelle allongée, l’endroit que les anciens anatomistes appelaient le « nœud vital » et dont la moindre lésion amène une mort foudroyante.
Baruch roula comme une masse sur les coussins de l’ascenseur.
Il était mort sans avoir poussé un cri.
Léonello essuya sur les vêtements du mort le stylet à peine rougi et rentra dans le laboratoire.
– C’est déjà fait ? demanda Fritz avec surprise.
– Oui, maître ! répondit l’Italien avec un calme parfait.
– Maintenant, dit Cornélius, il faut, sans perdre une minute, porter ce cadavre dans le four électrique et y lancer un courant aussi puissant que nos accumulateurs pourront le fournir. Avant une demi-heure, il n’en restera qu’une poignée de cendres…
Léonello chargea aussitôt sur ses épaules le cadavre encore chaud et alla le déposer dans l’intérieur du four électrique.
– C’est curieux, murmura soudain Fritz devenu songeur, Baruch meurt presque dans les mêmes conditions que le chimiste français, M. de Maubreuil, qu’il assassina autrefois !
– Ne croirais-tu pas à la Providence ? s’écria sarcastiquement le sculpteur de chair humaine. Moi, j’y crois. Ce doit être elle qui nous a permis de nous débarrasser si aisément de Baruch, qui ne pouvait que nous compromettre, et dont nous avions retiré toute l’utilité possible.
– D’une façon ou d’une autre, il n’aurait pas été très gênant, reprit Fritz, puisqu’il devait, cette nuit même, se brûler la cervelle. Si j’avais été prévenu de cela, je n’aurais certes pas dérangé Slugh pour le faire évader.
– Cette disparition me met tout à fait à l’aise. Que lord Burydan et sa bande osent maintenant porter plainte contre moi ! Il leur sera impossible de prouver une seule de leurs accusations. Baruch était une vivante pièce à conviction, et maintenant il n’en reste rien.
– Ce qu’il y a de mieux, reprit Fritz avec un sourire de satisfaction, c’est que nous avons touché notre part du trust des maïs et cotons.
– Sans oublier qu’il nous reste encore un grand nombre de diamants de M. de Maubreuil…
Cornélius s’interrompit brusquement. Depuis quelques instants il jetait des regards anxieux dans la direction du four électrique.
– Que fait donc cet animal de Léonello ? grommela-t-il. Nous devrions déjà sentir la chaleur du four. Est-ce que, par hasard, le courant serait interrompu ? Ce serait alors une vraie malchance !
Le sculpteur de chair humaine s’était levé d’un mouvement brusque et s’était dirigé vers le four.
À peine avait-il tourné les talons que Fritz tira de sa poche un petit flacon et laissa tomber quelques gouttes de son contenu dans la coupe de Cornélius, qui était demeurée à demi pleine après le départ de Baruch. Puis il reboucha le flacon, le fit disparaître avec prestesse et se leva pour aller rejoindre son frère, en simulant un grand intérêt pour l’accident arrivé à l’électricité.
– Qu’allons-nous faire, dit-il, si le courant vient à manquer ? Nous serons obligés d’attaquer le corps à l’aide des acides ?
– Nous n’aurons pas cette peine, ricana Cornélius, le courant marche de nouveau à merveille. Dans une minute, la température dépassera deux mille degrés dans l’intérieur du four.
– Où est donc Léonello ?
– Il est allé me chercher une clé anglaise.
L’Italien revint, en effet, un instant après, tordit un fil, resserra un boulon et les portes de métal ne tardèrent pas à devenir incandescentes malgré l’amiante dont elles étaient doublées. Une violente chaleur força les trois bandits de se retirer à l’autre extrémité de la pièce.
– Le rayonnement de ce four est insupportable, dit Cornélius du ton le plus naturel. Rien que d’être demeuré quelques minutes dans son voisinage, je me sens la gorge desséchée. Je vais boire un peu.
– Moi, de même !
Fritz et Cornélius se rapprochèrent de la table. Léonello acheva de remplir les coupes, qui étaient à moitié vides et il s’en servit une lui-même. Tous trois burent la pétillante liqueur jusqu’à la dernière goutte.
– Il me semble, dit Cornélius d’un ton singulier, que ce vin a un goût bizarre.
– Je ne trouve pas, moi, répondit Fritz qui rougit imperceptiblement.
– Vois-tu que je me sois empoisonné, ajouta le docteur d’un ton de cinglante raillerie. C’est pour le coup que tu serais en droit de dire qu’il y a une Providence. Sans compter que je te laisserais un héritage assez rondelet…
– Pourquoi parler de cela ? murmura Fritz avec embarras.
– Bah ! il faut bien dire quelque chose… Mais qu’as-tu donc ? Il me semble que tu es pâle !
– Ce n’est rien, balbutia le marchand de tableaux qui ressentait depuis quelques instants un commencement de malaise. J’ai la tête lourde…
– Tant mieux que ce ne soit rien… Je reviens à ma plaisanterie de tout à l’heure. Je disais donc que je te laisserais, mon cher Fritz, un héritage assez important. Puis, faisons une supposition…
« Mon cher Fritz se dit un beau matin que son legs se fait décidément bien attendre, que le docteur Cornélius est un parent compromettant, et que ce serait vraiment un très heureux hasard si ledit Cornélius venait à mourir de mort subite…
– Je n’ai jamais eu une pareille pensée ! protesta Fritz dont le visage était devenu d’une pâleur livide, mais ne me parle plus ainsi…
– Je plaisante… Laisse-moi continuer ma petite histoire… La mort de son excellent frère Cornélius est donc devenue chez Fritz une idée fixe, et, comme dit un proverbe, « l’occasion fait le larron »… Un beau jour que les deux frères sont à boire tranquillement une coupe de champagne, Fritz profite de ce que Cornélius a le dos tourné pour jeter du poison dans son verre…
– Grâce ! grâce ! balbutia Fritz qui commençait à sentir dans ses entrailles comme la brûlure d’un fer rouge.
Cornélius continua, avec une tranquillité parfaite :
– Heureusement pour lui, Cornélius, sur qui veille la Providence dont nous parlions tout à l’heure, a vu dans la glace de Venise le geste, pourtant rapide, de son cher Fritz. Que fait Cornélius ? Il dit un mot à l’oreille de son fidèle Léonello. Celui-ci va au fond du laboratoire sous prétexte de chercher une clé anglaise et change les verres, de sorte que…
Pendant cette explication, Léonello s’était éclipsé. Fritz se tordait sur sa chaise. L’effet du poison était si rapide que déjà son visage se marbrait de larges plaques rougeâtres.
– Grâce, Cornélius ! répétait-il d’une voix déchirante en jetant le flacon dont il s’était servi sur la table ! Tu dois avoir le contrepoison, ajouta-t-il.
– Je l’ai, répondit froidement Cornélius.
– Donne-le-moi ! Tu peux encore me sauver !
– Non !
– Je t’en supplie !…
– Non ! Tu m’as trahi, tu mourras !
Fritz n’avait plus même la force de parler. Il poussait des gémissements inarticulés, tordant vainement ses mains suppliantes vers Cornélius, qui le regardait avec un sourire inflexible.
Subitement, Fritz battit l’air de ses bras, roula à terre. Tout son corps fut agité de spasmes violents. Puis, brusquement, il demeura immobile.
Le poison avait fait son œuvre !
Cornélius cria de loin :
– Léonello ! Il faudra porter ce corps dans le four électrique avec l’autre !
Léonello apparut au bout d’un instant. Mais son visage était bouleversé.
– Maître ! s’écria-t-il, nous avons attendu trop longtemps ! L’hôtel est cerné ! La rue est barrée par un cordon de policemen, et il y a des détectives plein le jardin !…
– Alors, vite ! Fuyons ! Nous avons encore quelques minutes devant nous ! Ouvre la porte de fer, pendant que je prendrai les papiers de Fritz.
Une minute après, les deux bandits s’engageaient dans une issue secrète qui aboutissait au laboratoire.
Ils refermèrent avec soin, derrière eux, la porte blindée qui y donnait accès.
À peine venaient-ils de disparaître qu’une cinquantaine de détectives, le revolver au poing, firent irruption dans le laboratoire.
Mais au même moment une terrible commotion ébranla le sol. Une gerbe de flammes enveloppa l’hôtel, lançant de tous côtés des moellons, des poutres et des débris embrasés.
Le laboratoire du sculpteur de chair humaine venait de sauter.
CHAPITRE VI
Épilogue
La nouvelle de l’explosion de l’hôtel du docteur Cornélius Kramm eut, dans toute l’Amérique, un profond retentissement ; dans certains milieux dévots, protestants ou catholiques, on affirma que c’était le diable en personne qui, sur un cheval de feu, était venu emporter, tout vivant, dans les enfers, le sculpteur de chair humaine.
Ailleurs, le bruit s’était répandu que c’étaient Cornélius et Fritz les grands chefs, les Lords de la Main Rouge, et cette découverte causait dans la société new-yorkaise une émotion considérable.
Pendant trois jours, un cordon de policemen entoura les ruines de l’hôtel, et des détectives, assistés d’une escouade de travailleurs, explorèrent les décombres.
On retrouva plusieurs cadavres, plus ou moins défigurés. Celui de Fritz Kramm fut le premier qu’on put identifier ; un autre, découvert dans un four électrique et à demi carbonisé, était absolument méconnaissable. On supposa, avec quelque vraisemblance, que c’était celui de Léonello, qui, trop bien informé des secrets de son maître, avait dû être assassiné par lui. Seuls, lord Burydan et Fred Jorgell, mis en présence du corps, avaient parfaitement reconnu Baruch. Mais ils gardèrent pour eux leur secret, et le nom de l’assassin de M. de Maubreuil ne fut même pas prononcé au cours de l’instruction qui fut ouverte pour essayer de déterminer les causes de l’explosion, où plus de cinquante policiers avaient perdu la vie. Quelques-uns des hauts fonctionnaires du Police-Office connurent la vérité. Mistress Isidora, à laquelle on ne voulait causer aucun chagrin inutile, ne soupçonna jamais de quelle façon son misérable frère était mort. Ce ne fut que de longs mois après qu’une lettre du Canada lui annonça que le dément de la Maison Bleue s’était éteint doucement sans avoir recouvré la raison.
Lorsque l’on eut terminé le déblaiement, on se trouva en présence du cadavre de Cornélius affreusement mutilé, mais, au dire des détectives, suffisamment reconnaissable.
Un fait qui causa beaucoup d’étonnement, c’est qu’on ne trouva trace, ni dans les banques ni dans les ruines de l’hôtel, des sommes considérables en or et en bank-notes que possédait Cornélius, au vu et au su de tout le monde. On supposa que le docteur avait été prévenu à l’avance de l’arrestation qui le menaçait et qu’il avait mis son argent en lieu sûr en le confiant à quelqu’un des affiliés de la Main Rouge.
Quant à la fortune de Fritz, elle eut une destination inattendue. Il existait chez un notaire de New York un testament en bonne et due forme, par lequel Cornélius, Fritz et Joë Dorgan se léguaient réciproquement tout ce qu’ils possédaient. Ce fut donc le véritable Joë Dorgan, l’époux de Carmen, qui entra en possession des vastes magasins remplis de tableaux et d’objets d’art.
Le jeune milliardaire ne voulut garder de cette fortune suspecte que quelques tableaux sans valeur et les diamants provenant du vol commis chez M. de Maubreuil, dont un certain nombre n’avaient été ni taillés ni vendus.
Ce testament, que Fritz et Cornélius avaient imposé à leur complice Baruch, eut pour conséquence de rendre Joë seul propriétaire du trust des maïs et cotons. Il s’empressa de partager intégralement avec son frère, l’ingénieur Harry, les capitaux provenant de cet héritage.
Un moment, certains journaux, probablement dans une intention de chantage, insinuèrent que Joë Dorgan avait été en trop bons termes avec les deux frères pour ne pas être leur complice. Mais les hauts fonctionnaires de la police de New York, parfaitement au courant de la véritable personnalité de Baruch, eurent vite fait de réduire au silence les maîtres chanteurs.
Débarrassée de ses adversaires financiers, la Compagnie des paquebots Éclair entra dans une ère de prospérité qu’elle n’avait jamais connue, et, bientôt, elle fusionna avec le trust des maïs et cotons, où lord Burydan possédait une part d’actions très importante.
Fred Jorgell et William Dorgan, devenus inséparables, avaient abandonné la direction des deux trusts à Joë et à Harry. Ces derniers auraient été ravis de garder près d’eux – à de royaux appointements – l’ingénieur Paganot et le naturaliste Roger Ravenel, dont ils avaient pu apprécier le mérite ; mais, après tant d’aventures, les deux jeunes gens et leurs femmes, Andrée et Frédérique, désiraient revenir en France. M. Bondonnat, lui aussi, réclamait à grands cris son laboratoire et ses magnifiques jardins du pays breton.
Les Français demeurèrent encore un mois près de leurs amis de New York ; puis ils s’embarquèrent sur l’Ariel, que lord Burydan tint à commander lui-même pendant la traversée de New York à Brest.
Andrée et Frédérique, en se séparant d’Isidora et de Régine, leur avaient fait promettre de venir les voir en France à la première occasion favorable.
Les Américaines tinrent leur promesse, six mois plus tard, à l’occasion d’une fête de famille qui réunit dans la propriété de Kérity-sur-Mer tous les amis de l’illustre Bondonnat.
À huit jours de distance, Andrée et Frédérique étaient devenues mères. La fille d’Andrée fut appelée Frédérique, le fils de Frédérique, Prosper, ainsi que l’avait désiré son grand-père.
Les fêtes du baptême durèrent huit jours et donnèrent lieu à des réjouissances dont on n’a pas perdu le souvenir dans ce coin de Bretagne.
M. Bondonnat, qui venait de remporter le prix Nobel, à la suite de la publication de son beau livre, La Conscience des végétaux, put voir réunis autour de sa table presque tous ceux qui, de près ou de loin, avaient pris part à ses fantastiques aventures.
C’était d’abord Harry Dorgan et mistress Isidora qui avaient voulu tenir, sur les fonts baptismaux, la petite Frédérique Paganot, tandis que Joë Dorgan et Carmen étaient les parrain et marraine du petit-fils de M. Bondonnat.
William Dorgan et Fred Jorgell étaient venus aussi, heureux de revoir le vieil ami dont la science et l’abnégation leur avaient rendu de si grands services.
Les deux milliardaires étaient chargés de cadeaux qui eussent, par comparaison, fait taxer de mesquinerie et d’avarice les génies des Mille et une Nuits et les princesses des contes de fées.
Mr. Bombridge, qui était en train de devenir milliardaire grâce à la création par sélectionnement d’un escargot géant exceptionnellement savoureux, n’avait pu venir, absorbé par le souci des affaires ; en ses lieu et place, il avait délégué sa fille, la gentille Régine, et son gendre, Oscar Tournesol.
C’est avec la plus profonde émotion que l’ex-bossu mit le pied sur le sol de la terre natale et qu’il revit ses bienfaiteurs et ses amis, M. Bondonnat et sa famille.
Il fut aussi très heureux de revoir son camarade, le Peau-Rouge Kloum, qui était venu avec lord Burydan, le cosaque Rapopoff, à présent garçon de laboratoire, et la petite Océanienne Hatôuara, qui avait quitté, pour assister au baptême, l’institution parisienne où elle faisait ses études.
Ce fut également une grande joie pour lui de se rencontrer avec lord Burydan, qu’accompagnait l’indispensable Agénor.
Depuis son mariage, l’excentrique avait cessé d’occuper l’attention des feuilles humoristiques des deux mondes. En revanche, il était complètement guéri de sa neurasthénie, et c’est à la charmante lady Ellénor, à « la dame aux scabieuses », qu’il attribuait, non sans raison, tout le mérite de cette guérison.
M. Bondonnat n’avait eu garde d’oublier dans ses invitations Lorenza et son mari, le peintre Grivard, qui avait commencé quelques semaines auparavant un superbe portrait du vieux savant. Tout le monde admira la beauté de la guérisseuse de perles, dont la santé, un instant compromise par les privations qu’elle avait endurées pendant sa captivité chez les bouddhistes, était plus florissante que jamais.
Le chien Pistolet, comme on peut le penser, eut aussi sa part des réjouissances et, s’il n’eût été un animal presque aussi raisonnable et aussi sobre qu’un être humain, il serait certainement mort d’indigestion, tant il lui fut offert de sucreries, de gâteaux et de friandises de toutes sortes.
La semaine que durèrent les réjouissances s’écoula avec la rapidité d’un rêve. Ce fut avec un vrai chagrin que les invités de M. Bondonnat songèrent enfin à se séparer de leurs amis.
La veille du départ, le vieux savant et les deux milliardaires se trouvaient seuls sur une des terrasses du magnifique jardin de la villa. Les massifs de fleurs embaumaient l’air ; le ciel étincelait de milliers d’étoiles. On entendait, dans le lointain, la chanson murmurante de la mer contre les rocs. Les trois vieillards demeurèrent longtemps silencieux, prêtant l’oreille au bruit des rires et des voix joyeuses qui s’échappaient de la villa aux fenêtres illuminées.
– Eh bien, demanda tout à coup M. Bondonnat, et la Main Rouge ?
– Complètement anéantie, répondit Fred Jorgell. Le gouvernement américain s’est enfin décidé à prendre des mesures énergiques. Plus de dix mille arrestations ont été opérées. Le Police-Office a été épuré. On a révoqué tous les détectives qui, de près ou de loin, avaient appartenu à la sanglante association. Un seul des bandits que nous avons connus a pu échapper à toutes les recherches : c’est Slugh.
– Que peut-il bien être devenu ?
– On suppose qu’il s’est retiré dans un des cantons perdus de la frontière mexicaine, où il existe encore des bandits. La dernière fois que j’ai entendu parler de lui, c’est lorsqu’il tenta de mettre à sac l’hacienda de San-Bernardino, qu’habitent toujours Dorypha et son mari. Les tramps, en cette circonstance, rencontrèrent une résistance à laquelle ils ne s’attendaient pas. Trois d’entre eux restèrent sur le carreau, et Slugh fut gravement blessé.
– Et nos amis de la Maison Bleue ? demanda encore M. Bondonnat.
– C’est moi, répondit William Dorgan, qui suis à même de vous donner de leurs nouvelles. Ils sont très heureux. Le baron Fesse-Mathieu, qui est mort le mois dernier, leur a laissé une fortune princière. On a découvert après son décès, dans un caveau soigneusement blindé, un trésor de près d’un million de dollars en or et en bank-notes.
– J’espère, dit le vieux savant avec un sourire, qu’ils en feront un meilleur usage que le baronnet…
Puis, passant brusquement à une autre idée :
– Souvent, murmura-t-il, il m’arrive de penser à ce mystérieux docteur Cornélius qui est mort en emportant son secret. C’est pour moi une physionomie inoubliable.
– Croyez-vous qu’il soit mort ? dit Fred Jorgell.
– On a retrouvé son cadavre, fit William Dorgan.
– Était-ce bien le sien ? Vous savez mieux que personne, monsieur Bondonnat, que le sculpteur de chair humaine excellait dans l’art de truquer les pièces anatomiques. Or, il y avait à l’île des pendus un bandit qui offrait la ressemblance exacte de Cornélius et qui n’a jamais été retrouvé. N’est-ce pas le cadavre de ce bandit qui a été exhumé des décombres ? Voilà ce que je me suis souvent demandé avec une certaine perplexité.
– Mais par où se serait-il échappé ? reprit William Dorgan.
– Je n’ose rien affirmer. Mais on s’est aperçu, en déblayant le terrain, qu’un couloir, aboutissant à un ancien égout et fermé d’une porte de fer, communiquait avec le laboratoire de Cornélius. S’il s’est échappé, cela n’a pu être que par cette issue.
– Ce qui confirmerait cette hypothèse, dit M. Bondonnat après un instant de réflexion, c’est que les sommes énormes qu’il avait à sa disposition ont disparu avec lui.
– Tenez, dit Fred Jorgell en tirant de sa poche un journal tout froissé, voici un numéro du Sydney Times. Il contient un portrait d’un certain docteur Malbourgh, qui, en dépit de ses favoris, ressemble étonnamment à Cornélius. Le plus étrange, c’est qu’en quelques mois il s’est fait, en Australie, une réputation grâce à des tours de force chirurgicaux qui ressemblent singulièrement à ceux qu’opérait jadis Cornélius.
– Il n’y a peut-être là qu’une simple coïncidence, murmura M. Bondonnat devenu songeur.
– Qui pourra jamais nous le dire ? s’écria Fred Jorgell en se levant.
Personne ne releva ces paroles. Et les trois vieillards regagnèrent silencieusement la villa toute bruissante de l’animation et de la gaieté des invités.