
Gustave Le Rouge
LE MYSTÉRIEUX DOCTEUR CORNÉLIUS
TOME II
1912-1913
Paris, Maison du livre moderne
18 volumes
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
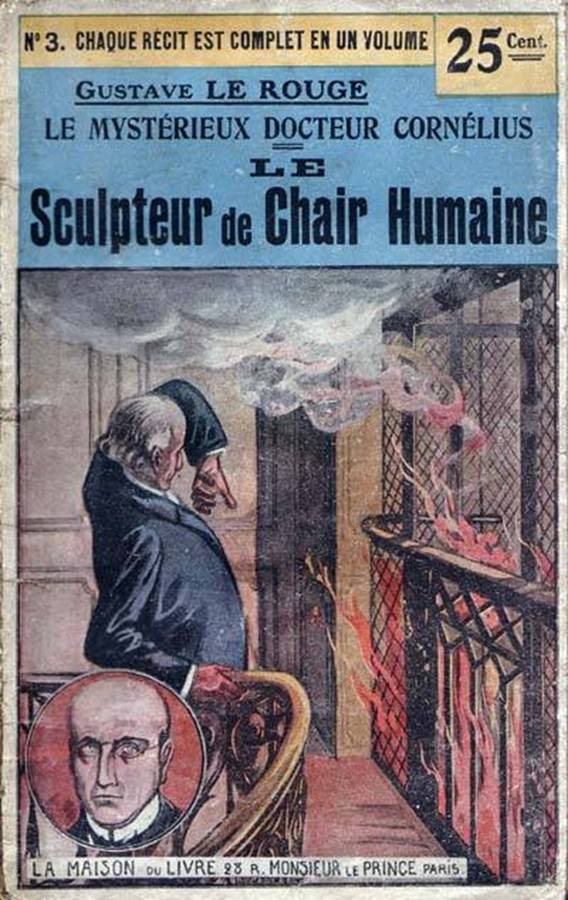
Table des matières
SEPTIÈME ÉPISODE …Un drame au Lunatic-Asylum
CHAPITRE PREMIER Une maladie foudroyante
CHAPITRE IV Le repas des caïmans
CHAPITRE VI Une joviale réception
HUITIÈME ÉPISODE L’automobile fantôme
CHAPITRE PREMIER Mr. Steffel n’est pas content
CHAPITRE II La buvette du Grand Wigwam
CHAPITRE IV La « Maison Bleue »
CHAPITRE V Deux serviteurs modèles
CHAPITRE VII Une mésaventure du baron Fesse-Mathieu
NEUVIÈME ÉPISODE Le cottage hanté
CHAPITRE PREMIER La bodega du « Vieux-Grillage »
CHAPITRE II Une lettre rassurante
CHAPITRE III Les malheurs d’un manager
CHAPITRE IV Un locataire fantastique
CHAPITRE VI Un chien détective
DIXIÈME ÉPISODE Le portrait de Lucrèce Borgia
CHAPITRE PREMIER Balthazar Buxton, collectionneur
CHAPITRE III Un déplorable accident
CHAPITRE IV Un drame de la misère
ONZIÈME ÉPISODE Cœur de gitane
CHAPITRE III Une soubrette compromettante
CHAPITRE VII La gitane héroïque
À propos de cette édition électronique
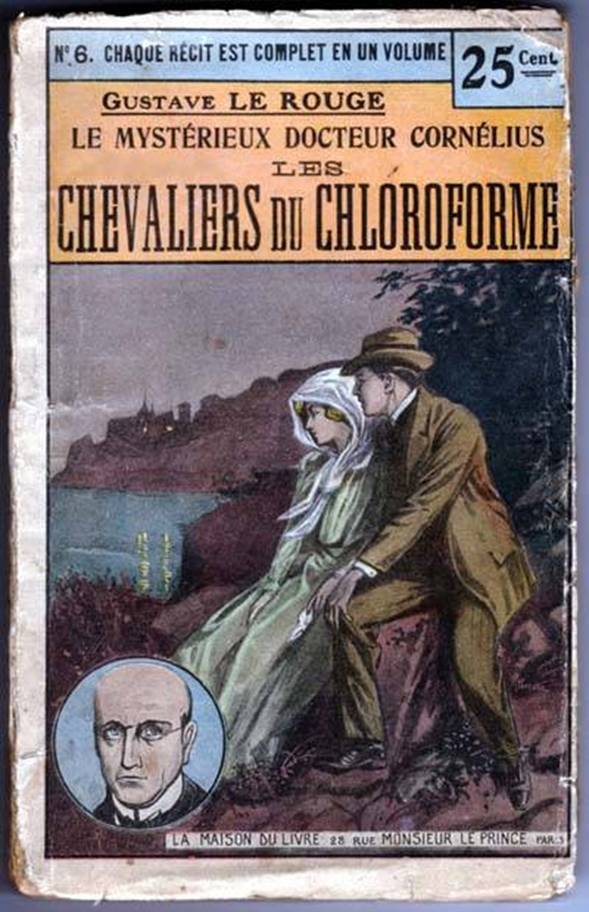
SEPTIÈME ÉPISODE
…Un drame au Lunatic-Asylum
CHAPITRE PREMIER
Une maladie foudroyante
Il n’était bruit dans New York que du prochain mariage de l’ingénieur Harry Dorgan et de miss Isidora, la fille du milliardaire Fred Jorgell, directeur de la Compagnie de navigation des paquebots Éclair. Fred Jorgell était une personnalité très sympathique dans les milieux financiers et industriels. Ces paquebots Éclair, construits avec la collaboration de l’ingénieur Harry Dorgan, détenaient le record de la vitesse ; grâce à leur coque extra-légère en aluminium et nickel, grâce à leur machine chauffée au pétrole, ils effectuaient en quatre jours la traversée du Havre à New York. Aussi les actions de la société émises à cent dollars étaient maintenant cotées trois mille dollars dans toutes les Bourses de l’univers.
Bien qu’à cause de certains malheurs de famille le mariage de miss Isidora dût être célébré dans l’intimité la plus stricte, il n’était question que des innombrables et fabuleux cadeaux adressés à la fiancée de tous les points de l’Amérique.
On citait entre autres merveilles une reproduction exacte du célèbre « collier de la reine » que dut acheter Marie-Antoinette et qui fut volé par la comtesse de Lamotte-Valois, un service de toilette en or massif avec incrustations d’opales et d’aigues-marines, un meuble de salon en quartz fondu, c’est-à-dire en cristal de roche, une bicyclette en vermeil, sans compter les tableaux de maîtres, les bijoux, les fourrures précieuses et les objets d’art de toute sorte.
Chaque matin, en compagnie de sa lectrice, l’excellente mistress Mac Barlott, et du secrétaire particulier de Fred Jorgell, miss Isidora prenait plaisir à ouvrir elle-même les caisses et les écrins qui arrivaient en foule au palais paternel.
À peine convalescent d’une blessure qu’il avait reçue dans une attaque nocturne, le secrétaire de Fred Jorgell, un Français nommé Agénor Marmousier, était encore très faible et très pâle ; mais le bonheur de miss Isidora avait hâté sa guérison et il goûtait une joie enfantine en assistant au déballage des cadeaux de noce.
– Qu’est-ce que ceci ? dit mistress Mac Barlott avec curiosité.
Et elle coupa les ficelles qui entouraient le papier de soie où se trouvait un écrin.
– Peuh ! fit-elle d’un ton méprisant, une parure d’émeraudes, nous en avons déjà sept ou huit !
Pendant ce temps, Agénor ouvrait avec précaution une longue caisse de cèdre. Cette caisse en renfermait une seconde en acajou.
– Je me demande ce qu’il peut bien y avoir là-dedans ! s’écria miss Isidora, dévorée de la fièvre de la curiosité.
– Nous allons bien voir, répondit Agénor en poussant le verrou d’argent qui fermait la caisse d’acajou.
La jeune fille jeta un cri de surprise en apercevant une réduction en argent du dernier paquebot que venait de lancer Fred Jorgell et qui s’appelait le Miss Isidora. Les moindres détails du bâtiment avaient été scrupuleusement imités, mais toutes les pièces de cuivre étaient reproduites en or, les fanaux rouges et verts étaient figurés par des rubis et les hublots par de petits diamants. Ce navire en miniature était un énorme bijou d’un prix fabuleux.
À ce moment, miss Isidora se sentit doucement saisie par la taille, puis deux mains se posèrent sur ses yeux en même temps que des lèvres brûlantes effleuraient son front.
La jeune fille poussa un petit cri, mais elle se rassura bien vite et sourit en reconnaissant dans l’auteur de cette tendre plaisanterie l’ingénieur Harry Dorgan qui était entré dans le salon sur la pointe des pieds.
– Je suis furieuse, dit miss Isidora avec un radieux sourire qui était en formelle contradiction avec ses paroles. Est-ce agir en homme sérieux ?
– Il faut me pardonner cet enfantillage.
– Soit, mais à une condition, c’est qu’une autre fois vous m’embrasserez d’une façon moins « shocking ».
– Je suis prêt à le faire, dit l’ingénieur.
Et de nouveau il appuya ses lèvres sur le front pur de la jeune fille dans un long et tendre baiser.
– Vous ne restez pas avec nous, monsieur Harry ? demanda Agénor. Vous assisteriez à l’ouverture de toutes ces caisses mystérieuses.
– Impossible. Je ne suis venu que pour souhaiter le bonjour à ma chère Isidora avant de me rendre à mon bureau. Le lancement des trois nouveaux paquebots nous donne une besogne terrible.
– Je ne vous retiens plus. À tantôt, mon cher Harry, murmura miss Isidora en serrant avec une délicieuse émotion la main de son fiancé.
L’ingénieur une fois parti, l’examen des cadeaux continua.
– Qui a bien pu donner à miss Isidora le beau paquebot d’argent ? demanda Agénor.
– Ce ne peut être que Mr. Fred Jorgell, répondit mistress Mac Barlott.
– Je suis sûre que c’est bien lui, fit miss Isidora. Le paquebot d’argent, c’est certainement la surprise dont il me parlait hier à table. Ce présent m’est doublement cher, car il me rappelle à la fois mon père et mon fiancé. N’est-ce pas Harry – j’en suis justement fière – qui a dressé les plans de ce paquebot, le plus rapide de l’univers ?
À ce moment, deux serviteurs apportèrent une longue caisse de bois de santal ornée des initiales de la jeune fille. Mistress Mac Barlott ouvrit la caisse d’une main impatiente.
– Cela vient de Paris ! s’écria-t-elle ; voici la marque de Worth, le grand couturier. C’est une robe sans doute plus belle que celles que vous avez déjà reçues.
– Voyons, dit miss Isidora.
Et d’une main agitée de la petite fièvre de la coquetterie, elles déplièrent les nombreux papiers de soie.
– Je m’en doutais, dit la gouvernante, c’est une robe de satin blanc toute brodée de perles.
– Elle est splendide. Qu’en pensez-vous, monsieur Agénor ?
– C’est une pure merveille, une véritable œuvre d’art. Il faut la déployer, que nous puissions l’admirer dans son entier.
Aidée de mistress Mac Barlott, miss Isidora étala avec mille précautions la luxueuse robe virginale sur un des divans du salon.
Mais tout à coup la jeune fille jeta un cri d’épouvante : sur le corsage, à la place du cœur, une main sanglante était brodée avec de petits rubis et cette empreinte effrayante se détachait nettement sur la blancheur immaculée de l’étoffe aux reflets d’argent.
– Je suis maudite ! s’écria la jeune fille en se reculant avec un frisson d’horreur. Mes ennemis veulent me faire comprendre par cet affront que le nom que j’apporte à Harry est souillé d’une tache sanglante et que je suis la sœur de Baruch l’assassin. Ah ! je le vois maintenant, je ne serai jamais heureuse.
– Remettez-vous, mademoiselle, murmura Agénor. Ne croyez pas que l’on ait voulu vous faire injure. Je crains plutôt que cet envoi ne vienne de l’association de la Main Rouge dont votre père s’est toujours montré un adversaire acharné…
Miss Isidora ne l’écoutait plus. L’émotion avait été trop forte. La jeune fille venait de perdre connaissance. Agénor et mistress Mac Barlott n’eurent que le temps de la recevoir dans leurs bras.
Les soins usités en pareil cas lui furent prodigués. Elle revint à elle et, à force de raisonnements ingénieux et de bonnes paroles, ses amis parvinrent à la rassurer un peu.
La fatale robe fut soustraite à tous les regards et il fut convenu qu’on ne mettrait pas Fred Jorgell au courant de l’incident ; mais toute la joie de la fiancée était gâtée. Ce fut avec une languissante indifférence qu’elle assista au déballage des autres cadeaux. La Main Rouge avait fané les sourires sur tous les visages et semé l’angoisse dans tous les cœurs.
Tous pensaient à la fatale robe, mais personne n’osait en parler. Ce fut la gouvernante qui, la première, se hasarda à dire :
– Ne croyez-vous pas, miss Isidora, qu’il serait bon de prévenir votre fiancé ?
– Non, murmura la jeune fille, pas cela !
– Cependant, si vous courez un danger, si cet envoi n’est pas une macabre fumisterie, si c’est bien une réelle menace de la redoutable association…
– Qu’importe. C’est déjà suffisant que j’aie, moi, à souffrir, sans que le bonheur de mon cher Harry, sa tranquillité soient troublés par des misérables.
– Mais, miss, avez-vous bien réfléchi ?
– Oui. Je vous le dis une fois pour toutes, je veux que mon fiancé ne soit pas prévenu et je vous serai reconnaissante, à vous, mistress, ainsi qu’à M. Agénor, de ne plus jamais me rappeler cette sinistre main sanglante.
Après cette déclaration, la jeune milliardaire, délaissant le salon où s’amoncelaient les cadeaux, remonta dans sa chambre pour y réfléchir.
La courageuse jeune fille possédait une grande puissance sur elle-même et lorsque, deux heures plus tard, elle redescendit pour s’asseoir aux côtés de son père et de son fiancé, son visage s’était complètement rasséréné ; elle paraissait calme, heureuse et souriante comme chaque jour. Harry Dorgan, si perspicace qu’il fût, ne put lire sur ses traits la trace d’aucun souci, d’aucune préoccupation.
L’ingénieur était d’excellente humeur. Il venait de découvrir un dispositif qui permettait de réaliser une économie de vingt pour cent sur le combustible.
– Tout va pour le mieux, dit-il à Fred Jorgell, et je suis assez en avance dans mes travaux pour que le congé que je prendrai à l’occasion de notre mariage ne nuise en rien à la bonne conduite des travaux de la Compagnie des paquebots Éclair.
– Vous pourrez prendre autant de congé que vous voudrez, dit Fred Jorgell avec un gros rire. N’est-ce pas, ma petite Isidora ?
La jeune fille ne répondit que par un timide sourire et baissa les yeux en rougissant.
– Ce matin, dit tout à coup l’ingénieur, j’ai reçu une lettre très intéressante d’un inventeur inconnu. Il s’agit d’un nouveau moteur à turbines.
Et il tira de sa poche une enveloppe qui renfermait une carte carrée couverte, sur les deux faces, d’une microscopique écriture. Fred Jorgell jeta un coup d’œil sur la missive et la rendit à Harry Dorgan.
– Ces caractères sont beaucoup trop fins pour ma vue, murmura-t-il. Il sera plus simple que vous m’expliquiez l’affaire en deux mots.
Harry Dorgan remit la lettre dans sa poche.
– De fait, dit-il, ces pattes de mouche sont presque indéchiffrables. J’ai mis une bonne demi-heure à les lire.
À ce moment, miss Isidora remarqua que l’ingénieur avait aux extrémités du pouce et de l’index de la main droite deux rougeurs qui ressemblaient à des écorchures.
– Qu’est-ce que cela ? demanda-t-elle en prenant la main du jeune homme. Vous vous êtes blessé, mon cher Harry ?
– Mais non. C’est une légère irritation de la peau que je ne sais trop à quoi attribuer et qui me cause une certaine démangeaison.
– Vous n’aviez pas ces rougeurs ce matin, ce me semble ?
– Non. Cela m’est venu tout d’un coup pendant que je lisais mon courrier. Mais bah ! cela s’en ira tout seul comme c’est venu.
L’incident fut oublié et, après avoir déjeuné rapidement, l’ingénieur se rendit de nouveau à son bureau et se plongea dans un travail absorbant. Au courrier du soir, il y avait une nouvelle lettre de l’inventeur inconnu du nouveau moteur à turbines.
Le texte, de même que la signature, étaient aussi peu lisibles que ceux de la première missive et Harry Dorgan passa beaucoup de temps à la déchiffrer. Quand il en eut terminé la lecture, il s’aperçut tout à coup que ses doigts avaient beaucoup enflé, puis il ressentit un étrange malaise, une sorte de vertige. Il quitta son bureau plus tôt que de coutume, persuadé que le grand air dissiperait ce mal de tête qu’il attribuait au surmenage des jours précédents. Mais, une fois dans la rue, le mal, au lieu de s’atténuer, ne fit que s’accroître et empirer. Ses jambes flageolaient sous lui, il avait des éblouissements, ses oreilles bourdonnaient. Il se trouvait si faible qu’au lieu de revenir à pied comme il se l’était promis il dut prendre un taxi-cab.
Au dîner, il ne put toucher à aucun des mets. Une soif ardente le dévorait et il voyait danser devant ses yeux des myriades de points noirs comme il arrive dans certains cas de fièvre. Enfin, il se sentait accablé d’une inexplicable fatigue. Mais pour ne pas inquiéter miss Isidora il se raidit contre la souffrance et réussit à prendre part à la conversation comme de coutume.
Cependant miss Isidora n’avait pu s’empêcher de remarquer sa pâleur, et elle avait observé que les rougeurs suspectes qui se trouvaient aux extrémités du pouce et de l’index s’étaient entourées d’un cerne violâtre et s’étaient creusées au centre comme deux petites plaies. Sur les instances de la jeune fille, il promit de soigner ce qu’il appelait un bobo insignifiant et, sous prétexte de travaux urgents, il regagna l’appartement meublé qu’il occupait à peu de distance de l’hôtel de son futur beau-père.
Une fois seul dans sa chambre, Harry fut pris de frissons, de douleurs lancinantes dans la région de l’estomac et il se sentit si mal qu’il dut se coucher en envoyant le domestique attaché à sa personne lui chercher un médecin.
Le praticien, après avoir examiné le malade, déclara que son état était de peu de gravité et devait être attribué à la fièvre causée par la fatigue. Il conseilla du sommeil, du repos, un bain tiède et des calmants.
Sitôt après le départ du docteur, Harry Dorgan tomba dans un sommeil de plomb. Il ne se réveilla que très tard dans la matinée.
– Comment ! balbutia-t-il en jetant un coup d’œil sur la pendule électrique placée près de son lit, déjà neuf heures et demie, mais je devrais être à mon bureau depuis une heure !
Il fit un mouvement brusque pour se lever. Il ne put y réussir. Ses membres étaient ankylosés, il éprouvait une sourde douleur dans toutes les articulations. Péniblement, il se dressa sur son séant et ses regards se portèrent sur la grande glace de la psyché placée en face de lui et où se reflétait son image. Il poussa un cri de surprise.
Son visage, d’une pâleur livide, était marbré de taches violâtres, ses lèvres blêmes et ses paupières rouges et gonflées.
– Je suis malade et même très malade, bégaya-t-il. Que va dire ma chère Isidora ?
Il allongea la main jusqu’au bouton du timbre électrique situé à son chevet. Quelques minutes plus tard, le waiter entra dans la chambre. À la vue d’Harry Dorgan il se recula, vaguement épouvanté.
– Qu’avez-vous donc, master, demanda-t-il, vous êtes malade ?
– Oui, balbutia l’ingénieur d’une voix faible. Je suis même très malade… Voulez-vous aller prévenir Mr. Fred Jorgell que je n’irai pas à mon bureau ce matin et que je ne viendrai sans doute pas déjeuner… Mais n’exagérez rien. Dites que je suis légèrement indisposé et que ce soir j’irai mieux sans doute…
Le waiter se hâta d’aller faire la commission.
Quand il entra dans le cabinet de Fred Jorgell, miss Isidora s’y trouvait en compagnie de son père. En apprenant la maladie de son fiancé, elle fut envahie d’un funèbre pressentiment. Tout de suite elle songea à la main sanglante brodée sur la robe nuptiale.
– Mon Dieu, murmura-t-elle Harry est malade !… Je tremble d’apprendre une catastrophe !… Et moi qui n’ai voulu prévenir ni mon fiancé ni mon père de la menace terrible suspendue sur leur tête !
Miss Isidora se sentait le cœur bourrelé de remords. S’exagérant sa faute, elle se regardait comme la cause de la maladie de l’ingénieur.
– J’aurais dû l’avertir, se répétait-elle.
Elle résolut de réparer le mal en racontant immédiatement la vérité à son père.
Le milliardaire se montra très affecté de cette confidence et pourtant il essaya de rassurer sa fille.
– Évidemment, dit-il, tu as eu tort de ne pas me prévenir, mais je suis persuadé qu’il n’y a aucune corrélation entre la maladie d’Harry Dorgan et l’injurieux envoi d’hier.
Miss Isidora s’était levée.
– Je vais voir Harry ! s’écria-t-elle impétueusement. Ma place est au chevet de mon époux !…
– Je t’accompagne, dit Fred Jorgell avec agitation, mais auparavant je vais donner des ordres pour que le chef de la police de New York soit prévenu et que mon hôtel soit particulièrement surveillé, gardé s’il le faut par une vingtaine de robustes détectives. D’ailleurs, ajouta le milliardaire, tu t’inquiètes peut-être à tort. Le waiter n’a parlé que d’une légère indisposition.
– Non. Harry est gravement malade. Je le devine, je le sens, j’en suis sûre.
Un quart d’heure plus tard, le milliardaire et sa fille pénétraient dans la chambre du malade. En apercevant les traits défigurés d’Harry Dorgan, miss Isidora eut un cri déchirant.
– Mes pressentiments ne m’avaient pas trompée, murmura-t-elle avec accablement. Harry est très malade ! Mais, puisqu’il en est ainsi, je ne veux plus le quitter, c’est moi qui le soignerai, qui le veillerai et qui le guérirai !…
L’ingénieur, rassemblant toute son énergie par un suprême effort, s’était redressé en souriant – d’un sourire navrant.
– Je ne suis pas si mal que vous croyez, balbutia-t-il d’une voix faible comme un souffle ; je vous assure, ma chère Isidora, que je vais déjà beaucoup mieux…
– Je veux vous soigner moi-même. N’est-ce pas déjà comme si j’étais votre épouse, ne la serai-je pas dans quelques jours ?
Le malade eut un geste de vive dénégation.
– Non, articula-t-il péniblement, je ne veux pas. La maladie dont je souffre est peut-être contagieuse et c’est déjà une imprudence d’être venue et de m’avoir serré la main.
Fred Jorgell s’était approché.
– Harry, dit-il, je vous considère déjà comme si vous faisiez partie de la famille, j’approuve entièrement Isidora et je trouve son dévouement tout naturel. D’ailleurs, vous n’êtes pas si gravement malade que vous le croyez et j’ai déjà pris les mesures nécessaires pour qu’avant une heure les plus célèbres médecins de New York soient ici. Il faudrait que votre mal fût vraiment bien grave pour ne pas céder devant la science.
– D’ailleurs, ajouta Isidora, quand on combat énergiquement le mal, il s’en va. C’est une lutte comme une autre. Il s’agit d’être vainqueur.
– De l’énergie, j’en ai, murmura le malade d’une voix faible.
– Et nous en aurons, s’il le faut, pour vous. Que diable ! je ne tiens pas à être privé d’un collaborateur dont les services me sont aussi précieux.
Et le milliardaire, bien qu’il fût au fond sérieusement alarmé, eut un rire cordial comme s’il n’eût pas pris au sérieux la maladie de l’ingénieur.
Laissant miss Isidora au chevet de son fiancé, Fred Jorgell se retira, après avoir constaté qu’Harry Dorgan se trouvait moralement très réconforté par cette visite. Le milliardaire devait revenir peu après, accompagné des médecins qu’il avait fait mander téléphoniquement. Il venait de sortir de la maison meublée lorsqu’un personnage, vêtu comme un domestique, y pénétra.
– Je voudrais voir Mr. Harry Dorgan, dit-il au gérant.
– C’est que, lui fut-il répondu, Mr. Dorgan est très malade. Il garde le lit et l’on attend plusieurs médecins qui doivent venir en consultation. Mais de la part de qui venez-vous ?
– De la part de Mr. Fred Jorgell.
– Mais il sort d’ici, reprit le gérant avec méfiance.
– Alors c’est que nous nous sommes croisés en route. Je cours le rejoindre.
Et l’homme s’esquiva sans demander de plus amples explications.
Cent pas plus loin, il entra dans l’arrière-salle d’un bar, en ce moment presque désert, et où deux hommes l’attendaient. C’étaient Joe Dorgan, le frère même de l’ingénieur, et un médecin célèbre à New York où il était connu sous le nom de « sculpteur de chair humaine », le docteur Cornélius Kramm. L’homme leur rendit rapidement compte de sa mission et se retira.
Cornélius et Joe Dorgan, une fois seuls, échangèrent un sourire diabolique.
– Je crois, fit Cornélius, que le mariage de miss Isidora n’est pas près de se conclure. La charmante miss pourrait bien devenir veuve avant que d’être mariée.
– Cet Harry que je déteste va enfin disparaître, murmura Joe avec une haineuse crispation de la face.
– Pour cela, soyez sans crainte. Avec le microbe que je lui ai inoculé et qui est à peine connu de quelques rares savants, Harry Dorgan n’en a pas pour plus de huit jours au maximum.
Les deux bandits s’entretinrent encore pendant quelque temps, puis ils regagnèrent l’automobile qui les attendait à quelque distance de là.
La Main Rouge triomphait cette fois encore. Harry Dorgan allait mourir.
CHAPITRE II
La lèpre verte
L’ingénieur Antoine Paganot et sa fiancée Mlle Andrée de Maubreuil, prenaient le thé en compagnie d’Oscar Tournesol dans un petit salon du Preston-Hotel. Leurs amis, Roger Ravenel et Frédérique, étaient sortis pour quelques emplettes. Tous trois étaient plongés dans la tristesse et le découragement.
– Nous n’avons eu que de la malchance depuis notre arrivée à New York, dit la jeune fille. Ç’a été d’abord la tentative d’assassinat dont nous avons failli être victimes de la part des « Chevaliers du Chloroforme » Nous comptions sur l’aide du milliardaire Fred Jorgell pour retrouver M. Bondonnat, mais voici que le futur gendre du milliardaire tombe malade et que tous nos projets sont ajournés, remis à une date indéfinie.
Le bossu Oscar réfléchissait.
– On ne m’ôtera pas de l’idée, murmura-t-il à mi-voix, que l’étrange maladie dont souffre l’ingénieur Harry est due à un empoisonnement. Les plus célèbres médecins n’ont pas su dire ce que c’était que cette étrange affection. Et le malade est à la dernière extrémité.
– Vous avez eu des nouvelles ce matin ? demanda Andrée.
– L’ingénieur Harry est à l’agonie. Sa mort n’est plus qu’une question de jours, d’heures peut-être.
– Il est certain, dit Antoine Paganot, qu’il y a là quelque chose d’inexplicable.
– Il y a trois jours, reprit Oscar, Mr. Harry était plein de vie et de santé. Aujourd’hui, on dirait presque un cadavre. Le visage est livide, marbré de taches violettes, les paupières sanguinolentes et gonflées. Le malade a horreur des aliments et il éprouve d’intolérables souffrances dans les régions du cerveau et de l’estomac. Enfin, tous les membres sont agités d’un tremblement convulsif.
– C’est singulier, dit l’ingénieur. Voilà des symptômes qui se rapportent étrangement à ceux que cause une maladie très peu connue et qui, sous le nom de lèpre verte, causait au Moyen Âge d’affreux ravages en Russie et en Pologne. Je serais vraiment curieux de voir de près le malade.
– Qui sait, murmura Oscar, se raccrochant à cette espérance, si vous n’arriveriez pas à découvrir la cause du mal ?
– Allez voir Mr. Dorgan, approuva Andrée ; je serais bien heureuse que vous pussiez le sauver. Comme miss Isidora doit souffrir ! Je me mets à sa place par la pensée. Quel ne serait pas mon chagrin si je vous voyais atteint d’un si épouvantable mal !
– Eh bien, nous y allons !
Oscar Tournesol et l’ingénieur s’étaient levés. Une demi-heure plus tard ils se présentaient à l’hôtel du milliardaire, où tout le monde était plongé dans la consternation. Oscar alla droit au bureau qu’occupait Agénor, le secrétaire particulier de Fred Jorgell.
Agénor écouta avec attention les explications du bossu et applaudit à son initiative. Il connaissait l’ingénieur Paganot, aussi renommé comme médecin que comme inventeur.
– Vous avez eu là une excellente idée, mon cher compatriote, lui dit-il. Venez avec moi. Mais ne perdons pas un instant, car dans le lamentable état où se trouve le pauvre Harry Dorgan les heures, les minutes mêmes sont précieuses.
Tous trois sautèrent dans l’auto qui, jour et nuit, stationnait dans la cour de l’hôtel, et ils arrivèrent à la maison meublée où se trouvait l’appartement d’Harry. Sur un mot que fit passer Agénor à Fred Jorgell, ils furent introduits sans difficulté dans la chambre du malade. Là, ils se trouvèrent en présence d’un spectacle navrant. Sombre, la face creusée par le chagrin, vieilli de dix ans, Fred Jorgell se tenait dans un coin. Près de lui, miss Isidora pleurait silencieusement. L’on n’entendait que le bruit de ses sanglots et les râles sifflants qui s’échappaient de la poitrine du moribond.
– À quoi me servent mes milliards ! murmura le vieillard en crispant les poings avec une sourde rage. Tous ces médecins sont des ânes, habiles seulement à soutirer des dollars aux naïfs. Ils n’ont même pas su dire le nom de la maladie dont le fiancé de mon enfant est en train de mourir.
– Je ne sais pas si je serai plus heureux que mes confrères, dit modestement Antoine Paganot, mais je vais essayer.
Miss Isidora leva vers lui son beau visage baigné de larmes.
– Ah, monsieur ! bégaya-t-elle en joignant des mains suppliantes. Sauvez mon Harry adoré et toute la fortune de mon père est à vous !
– Oui, toute ma fortune, répéta Fred Jorgell.
– Il ne s’agit pas de cela, dit Paganot, voyons le malade.
Il s’approcha du lit où reposait Harry Dorgan, plongé dans une sorte d’état comateux, la tête renversée en arrière, les prunelles révulsées. La lèvre inférieure était pendante et les narines déjà pincées comme celles des moribonds.
Miss Isidora sentait son cœur battre à grands coups dans sa poitrine pendant qu’Antoine Paganot, au milieu d’un silence tragique, procédait à l’examen du malade.
– Je ne m’étais pas trompé, s’écria-t-il tout à coup, c’est bien la lèpre verte.
– Est-ce une maladie guérissable ? demanda la jeune fille palpitante d’angoisse.
– Quelquefois, répondit Antoine Paganot qui, soucieux, réfléchissait, se demandant par quel hasard ce microbe de la lèpre verte, cultivé seulement comme une curiosité dans quelques laboratoires de l’Europe et de l’Amérique, avait pu être inoculé à l’ingénieur Harry Dorgan.
Tout à coup, l’attention de Paganot fut attirée par la main droite du patient dont l’index et le pouce portaient des boursouflures tuméfiées et formant une plaie hideuse.
– Voilà, songea-t-il, des écorchures singulièrement placées. Ne serait-ce pas par là que le microbe s’est introduit dans l’organisme ?
Son regard errait distraitement autour de la chambre. Tout à coup, il se porta sur une carte couverte d’une fine écriture et à l’angle de laquelle se trouvait très nettement marquée l’empreinte d’un pouce. Il prit la carte, en regarda le verso. Une autre trace de doigt y était marquée, celle de l’index, sans doute, car le geste le plus naturel que l’on fasse pour tenir une carte dont on fait la lecture, c’est de la prendre entre ces deux doigts.
Or, c’est précisément le pouce et l’index du malade qui portaient des blessures correspondant aux empreintes. Cette constatation donna beaucoup à penser au jeune homme. Il demeurait silencieux, lorsqu’il ressentit lui-même un étrange picotement à l’extrémité du pouce et de l’index à l’aide desquels, machinalement, il avait continué à tenir la carte. Il regarda ses doigts : ils portaient déjà la trace d’une imperceptible rougeur. Il ne put s’empêcher de pâlir et rejeta précipitamment le carton, puis, apercevant sur une étagère un flacon de lysol, il s’en servit pour antiseptiser rapidement sa main droite.
Miss Isidora et Fred Jorgell avaient suivi tous ses gestes avec une curiosité poignante. Ils comprenaient que l’instant était décisif.
– Que se passe-t-il donc ? demanda fiévreusement Fred Jorgell, et qu’avez-vous découvert ?
– Mr. Harry Dorgan a été empoisonné, déclara gravement Antoine Paganot.
– La menace de la Main Rouge !… murmura Isidora frissonnante.
Le silence de la consternation régna quelques minutes dans la chambre.
Seul, Antoine Paganot continuait à fureter nerveusement dans les coins de la pièce. Tout à coup, il aperçut une seconde carte couverte de la même écriture fine et illisible. Et, comme la première, elle portait deux empreintes disposées de la même façon, mais d’une couleur différente.
– Quand Mr. Harry a-t-il reçu ces cartes ? demanda-t-il d’une voix brève.
– La veille du jour où il est tombé malade.
– C’est cela même. Je m’explique tout. Ces deux cartes ont dû lui parvenir à deux ou trois heures d’intervalle l’une de l’autre ?
– C’est-à-dire, expliqua miss Isidora, que la première est arrivée au courrier du matin et la seconde à celui du soir.
– J’en sais assez maintenant, reprit Antoine, pour être fixé sur le procédé qu’ont employé les criminels. Je vous expliquerai cela tout à l’heure, mais le plus pressé est de combattre le mal.
Et il libella rapidement une ordonnance et la remit au bossu qui sortit en courant pour la faire exécuter.
– Maintenant, continuait le jeune homme, vous allez avoir l’explication. La première carte est imbibée d’une substance vésicante de la nature de la cantharide et dont le contact, même prolongé pendant peu de temps, produit des excoriations et des ampoules. Je viens moi-même d’en avoir un exemple, ajouta-t-il en montrant l’extrémité de ses doigts. C’est pour que la personne à qui la lettre est destinée soit obligée de la tenir longtemps que l’écriture est à dessein fine, illisible et serrée.
– Oui, réfléchit Fred Jorgell, Harry nous a dit qu’il avait mis plus d’une demi-heure à la déchiffrer.
– La seconde carte, elle, a été imbibée d’une culture du microbe de la lèpre verte qui a trouvé dans les légères plaies du pouce et de l’index un terrain tout préparé, une issue commode, qui lui a permis de se glisser dans l’organisme.
– Je châtierai les empoisonneurs, s’écria Fred Jorgell en serrant les poings d’un air menaçant.
– Je crois que vous aurez grand-peine à les découvrir. Le moyen qu’ils ont employé montre que ce sont des gens fort intelligents et, bien entendu, l’adresse donnée sur la carte doit être fausse, de même que la signature est illisible.
À ce moment, Oscar revenait apportant divers flacons et une seringue de Pravaz.
– J’espère que je suis arrivé encore à temps, s’écria Antoine Paganot, je vais essayer des injections hypodermiques pour combattre l’empoisonnement du sang, mais j’ai besoin d’être seul pour procéder à cette opération. Dans une demi-heure, je serai à même de vous dire si vous pouvez encore conserver quelque espoir.
Tout le monde quitta la chambre. Miss Isidora sortit la dernière, se retournant pour jeter à l’ingénieur Paganot un regard chargé de muettes supplications.
– Vous le sauverez, n’est-ce pas ? murmura-t-elle.
– Hélas ! miss, je ferai tout mon possible, mais cela ne dépend pas de moi. Que n’ai-je été appelé un jour plus tôt.
La demi-heure de délai s’écoula, pour Fred Jorgell et sa fille et pour leurs amis, dans toutes les affres de l’angoisse. Réfugiés dans un petit salon de la maison meublée, ils épiaient anxieusement la marche des aiguilles sur le cadran de l’horloge et les minutes leur paraissaient longues comme des années.
– Il y a dix minutes que la demi-heure est passée, s’écria miss Isidora en se levant impatiemment. Si nous allions voir !
– Non, dit Fred Jorgell, attendons encore.
Mais, à ce moment, l’ingénieur Paganot pénétra brusquement dans la pièce. La physionomie du jeune homme était radieuse.
– Mes amis, s’écria-t-il d’une voix que la joie et l’émotion faisaient trembler, une réaction salutaire s’est opérée dans l’état de notre malade, et dès maintenant je crois pouvoir répondre de sa vie. Il n’y a plus qu’à continuer le traitement que j’ai commencé et, d’ici deux jours, le mieux s’accentuera. D’ailleurs, je veillerai moi-même à ce que mes prescriptions soient suivies de point en point.
Fred Jorgell, trop ému pour remercier l’ingénieur d’une autre manière, lui broya la main d’un énergique shake-hand. Miss Isidora balbutia de vagues paroles de remerciement, mais la pâleur avait disparu de son visage et la flamme de l’espoir brillait de nouveau dans ses beaux yeux.
D’ailleurs, l’énergique traitement appliqué par l’ingénieur Paganot réussit complètement. Le soir du même jour, le malade sortit de l’état comateux où il était plongé. Les taches bleuâtres de son visage s’atténuèrent et il passa une nuit assez tranquille.
Le lendemain, l’état général s’améliora encore et deux jours après on pouvait regarder Harry Dorgan comme définitivement hors de danger.
Pendant tout ce temps, l’hôtel du milliardaire, de même que la maison meublée où était soigné l’ingénieur, furent gardés à vue par des détectives de choix ; les cartes furent analysées par un chimiste assermenté et les assertions d’Antoine Paganot se trouvèrent pleinement vérifiées. La première carte avait été trempée dans un mélange vésicant d’une activité extraordinaire et l’autre, examinée au microscope, laissa voir distinctement les bacilles de la lèpre verte dont elle était imprégnée.
La police, est-il besoin de le dire, rechercha vainement l’expéditeur des missives empoisonnées. Une seule chose paraissait certaine, c’est qu’elles émanaient des affiliés de la Main Rouge. Mais, comme le dit Fred Jorgell à sa fille, il n’y avait, pour le moment, rien à faire contre les insaisissables bandits. Le mieux était de faire bonne garde et d’attendre que la police eût enfin mis la main sur les chefs de l’association, ce qui ne pouvait tarder, car un groupe de capitalistes, à la tête duquel se trouvait Fred Jorgell, avait offert des primes considérables qui devaient stimuler le zèle des détectives.
Cependant, la guérison d’Harry Dorgan marchait à grands pas. Il allait entrer en convalescence. Miss Isidora résolut de profiter de ce qu’Harry n’avait plus un besoin immédiat de sa présence pour aller faire à Antoine Paganot une visite de remerciement.
Elle se rendit donc au Preston-Hotel, accompagnée d’Agénor, assez âgé et assez sérieux pour lui servir de chaperon.
En montant dans l’ascenseur qui devait la déposer sur le palier même de l’étage habité par les Français, miss Isidora ne put réprimer une étrange émotion. N’allait-elle pas, peut-être, se trouver en présence de celle dont le père avait été assassiné par Baruch ? Dans son empressement à aller remercier Antoine Paganot, elle n’avait pas encore songé à cette éventualité, mais il était trop tard pour reculer. Déjà un waiter l’introduisait, ainsi qu’Agénor, dans un petit salon où se trouvaient Mlle de Maubreuil et l’ingénieur.
En voyant entrer l’Américaine, Andrée s’était levée. Sans l’avoir jamais vue, elle reconnut miss Isidora à la description qu’on lui en avait faite. Malgré tout son empire sur elle-même, elle pâlit et tout son sang reflua vers son cœur. Elle se trouvait en présence de la sœur du meurtrier de son père. Miss Isidora avait deviné ce qui se passait dans son âme et, s’avançant vers elle, elle murmura d’une voix que l’émotion faisait trembler :
– Mademoiselle, je sais que ma place ne devrait pas être ici, que ma présence ravive dans votre cœur de cruels souvenirs, mais il fallait que je remercie M. Paganot auquel je dois la vie de mon fiancé. Il fallait que je lui en exprime toute ma reconnaissance et aussi que je lui demande, de la part de mon père, quelle récompense il désire pour l’inappréciable service qu’il nous a rendu. Mademoiselle, n’est-ce pas que vous me pardonnez d’être venue ?
– Miss Isidora, répondit Andrée de Maubreuil avec effort, je sais que vous êtes loyale et généreuse. Je ne puis vous rendre responsable du crime d’un autre. Qu’il ne soit plus jamais question entre nous de ce passé sanglant…
Tout en parlant, Andrée tendait sa main à Isidora. La jeune fille la prit et la serra, mais toutes deux étaient tellement émues qu’elles avaient des larmes dans les yeux. Il y eut un moment de silence attristant.
Ce fut Agénor qui reprit le premier la conversation.
– N’oubliez pas, miss Isidora, fit-il, que nous sommes venus demander à M. Paganot quels honoraires il désire pour la cure miraculeuse qu’il vient d’opérer.
– Il ne saurait être question entre nous d’une récompense quelconque, déclara l’ingénieur. Je suis trop heureux d’avoir pu être agréable au protecteur de notre ami Oscar.
– Savez-vous, dit tout à coup Andrée, ce qui ferait le plus de plaisir à M. Paganot ?
– Dites vite, s’écria Miss Isidora, c’est accordé d’avance.
– Eh bien, reprit la jeune fille, retrouvez le père de mon amie Frédérique, M. Bondonnat, et vous nous aurez largement récompensés du service que mon fiancé vous a rendu.
– Nous le retrouverons, fit gravement miss Isidora, la main tendue comme pour un serment, nous le retrouverons, dût mon père dépenser pour cela toute sa fortune.
À ce moment, Frédérique, ignorant qu’il y eût des visiteurs, entra brusquement dans le salon. L’ingénieur Paganot fit les présentations. Et, tout de suite, la fille du milliardaire et la nouvelle venue sympathisèrent.
– Excusez-moi d’être entrée ainsi sans crier gare, dit joyeusement Frédérique, mais je vous apporte une bonne nouvelle.
– De quoi s’agit-il ?
– Je viens de recevoir une lettre de mon père. La voici, je vais vous la lire, ajouta-t-elle en tirant de son corsage une enveloppe toute froissée. Tous se rapprochèrent avec curiosité pendant que Frédérique lisait.
« Ma chère enfant,
« Je suis heureusement vivant et en bonne santé. Je suis, il est vrai, séquestré, gardé à vue, dans un endroit sur lequel il m’est impossible de te donner aucun renseignement, mais je ne cours aucun danger. Je suis entre les mains de riches capitalistes qui me font – un peu malgré moi, il est vrai – travailler à certaines découvertes, mais ils doivent m’indemniser et, ce qui est beaucoup plus important pour moi, me rendre très prochainement à la liberté.
« Mes geôliers m’interdisent de t’écrire avec plus de détails, mais ne te fais pas d’inquiétude à mon sujet, je serai bientôt de retour.
« Embrasse bien de ma part mon autre fille Andrée et prends patience.
« Mille baisers de ton vieux père.
« Prosper Bondonnat. »
« P.-S. – Mes amitiés à mes excellents collaborateurs, Roger Ravenel et Paganot. »
– Drôle de lettre, s’écria Agénor quand Frédérique eut terminé sa lecture.
– Oh ! répliqua la jeune fille, c’est bien un autographe de mon père. Il a une façon de barrer ses T, de faire ses F et de parapher sa signature qui n’appartient qu’à lui. Je reconnaîtrais son écriture entre mille.
– Voyons l’enveloppe, dit l’ingénieur. Cette lettre a été adressée en Bretagne, puis réexpédiée à New York.
– Mais d’où venait-elle, voilà ce qu’il importe de savoir.
– D’Amérique, reprit Paganot qui examinait attentivement les estampilles postales. Cela nous prouve toujours une chose, c’est que M. Bondonnat est bien en Amérique et que nous avons eu raison en venant l’y chercher. Cette lettre a été jetée à la poste à La Nouvelle-Orléans.
– Eh bien ! déclarèrent d’une voix Andrée et Frédérique, nous irons à La Nouvelle-Orléans. Nous allons y partir le plus tôt possible.
– Précisément, dit miss Isidora, mon père possède à la Nouvelle-Orléans de nombreux correspondants qui se mettront à votre disposition pour tous les renseignements imaginables. Dès demain, je vous enverrai par Oscar une dizaine de lettres de recommandation qui vous seront, j’en suis sûre, de la plus grande utilité.
Andrée et Frédérique remercièrent miss Isidora qui prit congé d’elles en leur renouvelant la promesse qu’elle avait faite de les aider de toute la puissance des milliards paternels dans la recherche qu’elles allaient entreprendre.
Cette journée fut heureuse pour tout le monde. Le petit clan des Français était heureux d’avoir enfin des nouvelles de M. Bondonnat, et miss Isidora et son père voyaient avec une indicible satisfaction que l’ingénieur Harry Dorgan entrait en pleine convalescence.
Quant aux menaces de la Main Rouge, personne ne voulait ou n’osait y penser.
CHAPITRE III
La cabine 29
Après un fatigant voyage en railway, Andrée, Frédérique et les fiancés des deux jeunes filles étaient arrivés à Saint Louis sur le Mississippi. Descendus dans un excellent hôtel situé sur les quais du fleuve, l’hôtel de La Louisiane, dont le nom français les avait séduits, ils se levèrent le lendemain matin assez tard. Ils déjeunèrent sommairement et ils se disposaient à faire une promenade dans l’intérieur de la ville, lorsque leur attention fut attirée par une gigantesque affiche d’une polychromie hurlante et qui se trouvait apposée dans la cour intérieure de l’hôtel.
Voici le texte exact de ce placard :
Précieux avertissement
aux ladies et gentlemen amateurs de tourisme
OXYGÈNE-CÉLÉRITÉ-MUSIQUE
Atmosphère vivifiante des forêts du Mississippi
Voyage extra-rapide sur le yacht de luxe
L’ARKANSAS
Orchestre de 30 musiciens.
Cuisine française et anglaise.
Confortable de premier ordre.
Innombrables attractions à bord.
Pêche. Chasse. Sports de tout genre.
L’Arkansas effectue le trajet de Saint Louis
à La Nouvelle-Orléans en trente heures
PRIX DES PLACES
Première classe 120 dollars.
Seconde classe 80 dollars.
Les quatre Français étaient occupés à lire cette affiche, digne de Barnum, lorsqu’un des gérants de l’hôtel s’approcha d’eux et, après les avoir salués obséquieusement :
– Mesdames et messieurs, dit-il en excellent français, j’ai vu sur le livre de l’hôtel que vous vous rendez à La Nouvelle-Orléans. S’il m’était permis de vous donner un conseil, je vous engagerais à prendre passage à bord de l’Arkansas. C’est peut-être un peu plus cher que sur les steamboats ordinaires, mais cet inconvénient est largement compensé par d’autres avantages.
– Lesquels ? demanda l’ingénieur Paganot.
– Cette affiche en indique la plus grande partie. En outre, l’Arkansas, ne pouvant emporter qu’une centaine de passagers, tous gentlemen du meilleur monde, vous évitera la promiscuité désagréable des paquebots ordinaires. Tous ceux qui ont descendu les rives du superbe fleuve dans ces conditions n’ont eu qu’à se louer de leur excursion. En outre, ajouta le gérant pour aller au-devant d’une objection qu’il lisait dans les regards de l’ingénieur, je vous dirai que je n’ai aucun intérêt à ce que vous preniez passage à bord d’un paquebot plutôt que d’un autre.
– La proposition est séduisante, dit Andrée de Maubreuil, sans remarquer l’obstination à bon droit suspecte du gérant.
– Nous y réfléchirons, ajouta Frédérique.
– C’est que, fit l’homme en insistant de plus belle, il faudra me donner réponse avant six heures. L’Arkansas lève l’ancre demain matin.
– Il suffit, dit Roger Ravenel impatienté. Vous aurez votre réponse en temps voulu.
Les quatre Français sortirent de l’hôtel sans remarquer que l’obséquieux gérant les suivait de loin d’un regard à la fois ironique et haineux.
– Ils ont l’air à peu près décidés, grommela-t-il entre ses dents. Je crois bien qu’ils embarqueront.
Il ne se trompait pas. Les jeunes voyageurs, après avoir vu l’Arkansas, un élégant petit vapeur en acier de construction récente, se résolurent à adopter ce mode de voyage que tout le monde, d’ailleurs, leur recommandait comme plus court, moins fatigant et plus pratique. Ils firent donc transporter leur léger bagage à bord du yacht, et le lendemain, vers neuf heures, ils prenaient possession de leurs cabines pendant que l’Arkansas levait l’ancre au son d’un orchestre endiablé, exécutant avec une furia tout américaine le Yankee-Doodle, la Marseillaise et le Danube bleu.
Le pavillon étoilé fut hissé à la corne d’artimon et l’on partit.
Les passagers, dont le pont était couvert, étaient vêtus avec une certaine élégance qui, chez nous, eût paru quelque peu voyante. Ils arboraient des complets à carreaux de couleur hurlante, des cravates invraisemblables et des gilets rutilants. Presque tous étaient coiffés de casquettes de voyage ornées de petits drapeaux ou d’écussons désignant les sociétés sportives auxquelles ils appartenaient. Beaucoup étaient munis de jumelles, de longues-vues et de Kodaks qu’ils braquaient tour à tour sur les deux rives du fleuve.
Le Mississippi est, à cet endroit, presque aussi large qu’un lac. Il roule ses eaux jaunâtres et boueuses entre deux berges marécageuses couvertes d’une moisson de plantes aquatiques que continuent un peu plus loin d’immenses acréages de cotonniers, de maïs, coupés de temps en temps par des bouquets de bois. Çà et là apparaissaient des villes ou des villages tapis au fond de quelque petite baie avec leurs usines aux hautes cheminées noires et leurs estacades de pilotis qui s’avançaient dans l’eau fangeuse du fleuve.
La chaleur était accablante ; des domestiques noirs se hâtèrent de dresser sur le pont de longues tentes de coutil, sous lesquelles la plupart des voyageurs s’installèrent sur des sièges de rotin, pendant que des barmen faisaient circuler les plateaux chargés de cocktails incendiaires.
Vers onze heures, la cloche du bord sonna pour le lunch. Le menu ne différait guère de celui des hôtels où les quatre Français étaient déjà descendus ; c’était l’inévitable soupe aux huîtres, le saumon à la canadienne et les gigantesques rosbifs entourés de tout un arsenal de sauces corrosives dans de petits flacons aux étiquettes multicolores. Le pale ale et le stout étaient excellents, mais les vins, qualifiés de vins de France et comptés en supplément, étaient exécrables. Somme toute, l’ordinaire ne démentait pas trop les promesses du prospectus.
C’est pendant ce premier lunch qu’Andrée et Frédérique remarquèrent deux convives d’un certain âge dont la physionomie et les manières leur inspirèrent une instinctive répulsion. L’un d’eux avait une de ces figures qui restent gravées dans le souvenir dès qu’on les a vues seulement une fois. Son crâne énorme était entièrement chauve, ses yeux sans cils, pareils à des yeux d’oiseau de proie, étaient abrités par de larges lunettes d’or, l’expression de son regard avait quelque chose de fascinateur et d’inquiétant. Les lèvres étaient minces, le visage maigre, rasé, presque squelettique. Il s’exprimait avec une lenteur et une sécheresse glaciales et donnait à première vue l’impression d’une intelligence géniale jointe à une méchanceté diabolique.
Son compagnon, sans doute son frère, car il avait avec lui un air de vague ressemblance, en différait entièrement comme physionomie et comme aspect.
Autant l’autre était maigre, émacié et morose, autant il était corpulent, rubicond et jovial.
Son sourire bienveillant, ses yeux gris clair pleins de franchise le rendaient tout d’abord sympathique, mais si l’on observait avec attention ses mâchoires trop développées, ses vastes oreilles, ses mains énormes aux doigts courts et aux pouces en billes, on se sentait beaucoup moins rassuré.
Ces deux hommes étaient énigmatiques et troublants.
Pendant tout le repas, ils ne prononcèrent que quelques paroles, mais ils ne quittaient pas des yeux les Français, et Frédérique, surtout, sentait peser sur elle le regard hypnotique de l’homme aux lunettes d’or et elle éprouvait un étrange malaise.
Ce fut avec un véritable soulagement qu’elle vit les deux inconnus se lever de table et monter sur le pont où ils allaient fumer un cigare.
– Quelles étranges physionomies ! murmura la jeune fille avec un léger frisson, de véritables personnages d’Hoffmann ou d’Edgar Poe. Ils m’ont coupé l’appétit.
– On ne voit de ces têtes-là qu’en Amérique, répondit Roger Ravenel ; ce sont peut-être, d’ailleurs, de très honnêtes gens.
– J’en doute fort, fit l’ingénieur Paganot en hochant la tête. J’ai entendu dire que l’un d’eux était un médecin connu, quant à l’autre ce doit être un négociant quelconque.
La conversation dévia peu à peu et, le lunch terminé, tout le monde remonta sur le pont pour admirer le paysage qui, à mesure qu’on avançait, se renouvelait incessamment.
On apercevait beaucoup de crocodiles : les plus jeunes, alertes et frétillants comme des lézards, les plus gros, les patriarches, se laissant entraîner paresseusement au fil de l’eau, le dos recouvert d’une mousse verdâtre qui les faisait ressembler à de vieux troncs d’arbre à la dérive.
Les deux étrangers aux mines inquiétantes avaient disparu. Sitôt après le déjeuner ils étaient rentrés dans une cabine, la cabine 29, et s’étaient fait apporter du champagne glacé et des cigares.
– Alors, fit l’homme aux lunettes d’or en baissant la voix, ce sera pour ce soir, n’est-ce pas ?
– Oui, mon cher Cornélius, il n’est que temps que nous soyons débarrassés de ces maudits Français qui nous ont déjà causé un tort considérable.
– Baruch ne sait rien ?
– Non, on lui apprendra la chose quand elle sera terminée. C’est infiniment préférable. S’il n’est pas content, nous lui dirons que nous n’avons pas eu le temps de le consulter, que le péril était urgent.
– Oui, cela vaut beaucoup mieux, mais notre homme ne vient pas vite.
– Oh ! il n’est pas en retard, dit Fritz en tirant sa montre. Il se nomme Dodge, il a déjà été condamné pour vol et pour meurtre et il est entièrement dévoué à la Main Rouge. Il a séjourné d’ailleurs pendant plusieurs mois à l’île des pendus et faisait partie des sentinelles surveillant le vieux Bondonnat. J’aurais beaucoup préféré Slugh.
– Oui, mais Slugh n’est pas encore guéri des coups de revolver que lui a donnés Fred Jorgell, j’ai bien cru qu’il n’en réchapperait pas…
À ce moment, on frappa trois coups régulièrement espacés à la porte de la cabine. Fritz et Cornélius s’empressèrent d’appliquer sur leurs visages deux masques de caoutchouc, puis ils attendirent. On frappa de nouveau.
– Entrez, dit Cornélius.
L’homme qui pénétra dans la cabine était un robuste compagnon aux vêtements de toile bleue, au visage et aux mains noircis par le charbon. Il tenait respectueusement sa casquette à la main.
– Fermez la porte, dit Fritz.
– Sirs, j’ai reçu un avis de me rendre à la cabine 29.
Et il montrait un billet portant comme signature une main grossièrement tracée à l’encre rouge.
– C’est bien, reprit Fritz. Nous t’avons fait appeler. Nous avons des ordres à te donner de la part des Lords de la Main Rouge. Il faut que, cette nuit, lorsque tous les passagers seront endormis dans leurs cabines, l’Arkansas sombre sans que personne puisse être sauvé. Rien n’est plus facile que de produire une voie d’eau dans la cale. Il suffit d’enlever quelques planches. Cela ne demande pas une heure de travail. Tu auras soin, bien entendu, de nous conduire à terre dans une des chaloupes avant l’accident.
Dodge, un des chauffeurs de l’Arkansas, ne semblait pas décidé. Cornélius lut de l’hésitation dans son regard.
– Songe bien, fit-il de sa voix glaciale et coupante comme la bise de décembre, que tu dois obéir aux ordres des Lords. Tu ne cours aucun risque, d’ailleurs, et tu n’ignores pas que, sans la Main Rouge qui te couvre de sa puissante protection, tu n’aurais pas quarante-huit heures à vivre.
– Sirs, dit humblement Dodge, j’obéirai. À onze heures et demie précises, je viendrai vous chercher dans cette cabine pour vous faire descendre dans le canot.
Fritz tendit au chauffeur une bank-note de cinquante dollars.
– Voici, dit-il, qui te permettra de payer à boire aux gens de l’équipage. Il faut qu’ils soient suffisamment ivres pour ne pas te déranger dans ton travail. Maintenant, tu peux te retirer.
Dodge sortit à reculons et, sitôt qu’il se fut retiré, Fritz et Cornélius enlevèrent leurs masques et s’empressèrent de quitter la cabine 29.
Ils remontèrent sur le pont au moment même où la cloche du bord annonçait que l’Arkansas allait accoster le long des quais de bois d’un village riverain pour mettre à terre quelques passagers et en laisser monter d’autres.
L’échange des passagers se fit assez rapidement. Il n’en monta qu’une dizaine, presque tous gros cultivateurs de la région. Parmi eux se trouvait un jeune homme de mine et de mise élégantes dont la vue produisit une étrange impression sur Mlle de Maubreuil. Elle eut la sensation rapide d’avoir vu ces traits-là quelque part, mais où ? Elle n’eût pu le dire.
L’inconnu franchit la passerelle et son regard rencontra celui d’Andrée. La jeune fille, sous le rayon magnétique de ses prunelles, ressentit au cœur une douloureuse commotion. Ce regard l’avait pour ainsi dire matériellement blessée, comme si elle eut reçu un coup de poignard. Elle détourna la tête avec une sorte de répulsion instinctive pendant que le jeune homme, après l’avoir suivie d’un long regard, se perdait dans la foule des passagers dont le pont du vapeur était encombré.
Par quelle étrange association d’idées Andrée de Maubreuil se rappela-t-elle tout à coup en cet instant ce cauchemar qui pendant longtemps avait hanté ses nuits le samedi de chaque semaine et qui, maintenant, ne se représentait plus que rarement à elle ?
La jeune fille ne put s’empêcher de frissonner, mais elle n’osa confier à personne l’étrange pressentiment dont elle était assaillie.
Pendant ce temps, l’inconnu, en s’avançant à travers la foule des voyageurs, n’avait pas tardé à apercevoir Fritz et le docteur Cornélius. Il échangea avec eux un clin d’œil imperceptible et tous trois descendirent à la cabine 29, spécialement choisie par Cornélius parce qu’elle était isolée des autres. Les deux frères essayaient à peine de dissimuler leur mécontentement à la vue du nouveau venu.
– Ah ça ! mon cher Baruch – ou plutôt, mon cher Joë –, que se passe-t-il donc pour que vous courriez ainsi après nous ? s’écria Cornélius ; votre arrivée est une vraie surprise.
– Il se passe des choses très graves, dit Baruch, dont la physionomie exprimait l’inquiétude et la mauvaise humeur. Et tout d’abord, je viens de recevoir, par marconigramme, une nouvelle des plus fâcheuses. Lord Burydan s’est évadé de l’île des pendus en compagnie de l’Indien Kloum.
– Mais au moins, demanda Fritz précipitamment, le vieux Bondonnat ne s’est pas échappé ?
– Non, mais il ne s’en est fallu que de peu de chose. Il était déjà monté dans la nacelle de son aéronef – dont entre parenthèses lord Burydan s’est emparé –, lorsqu’un de nos fidèles agents, Sam Porter, l’a empoigné à bras-le-corps et a empêché son évasion.
Fritz et son frère échangèrent un regard furieux et dépité.
– J’ai toujours dit, grommela Cornélius, que ce vieux Français était rusé comme le diable et qu’il finirait par nous glisser un jour ou l’autre entre les doigts comme une anguille.
– Oh ! reprit Baruch, j’ai télégraphié de doubler la surveillance et je ne crois pas que ce soit de sitôt que le vieillard puisse combiner un nouveau plan de fuite. Mais ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle que je vous apporte. Mon frère, Harry Dorgan, est maintenant complètement rétabli. La fameuse lèpre verte l’a retenu au lit à peine plus longtemps qu’une grippe bénigne.
– Cela, nous le savons, répliqua Cornélius avec impatience, puisque c’est l’ingénieur Paganot, précisément un élève de notre prisonnier de l’île des pendus, qui a réussi à découvrir le microbe et qui a appliqué au malade un traitement approprié.
– Oui, répliqua Baruch avec emportement, mais ce que vous ignorez, c’est que mon pseudo-père, William Dorgan, en apprenant que son rejeton était gravement malade, a mis de côté tout orgueil et toute rancune et est allé le voir. Tout ce que j’avais fait devient inutile. Maintenant, ils sont réconciliés, et William Dorgan consent même au mariage de son fils avec miss Isidora.
– Diable ! cela se gâte, murmura Fritz entre ses dents.
– Oui, ajouta Cornélius sur le même ton, il est grand temps d’intervenir d’une façon énergique.
– En tout cas, reprit Baruch, dont la colère longtemps contenue se déchaînait, il faudrait éviter certaines maladresses du genre de celles qui ont été commises sans qu’on m’en ait prévenu.
– Quelles maladresses, s’il vous plaît ? demanda Cornélius dont les prunelles d’oiseau de proie scintillèrent derrière le cristal de ses lunettes d’or.
– Ma sœur Isidora a reçu une robe brodée d’une main sanglante. Pourquoi a-t-on fait cela ? C’est aussi ridicule que maladroit !
– Nous avons nos raisons, répliqua sèchement Cornélius. Cet envoi emblématique, précédant de quelques heures la maladie subite d’Harry Dorgan, était destiné à frapper Fred Jorgell et sa fille d’une terreur telle que…
– Eh bien, interrompit Baruch avec un ricanement sinistre, le résultat a été tout différent de celui que vous espériez. Maintenant, Fred Jorgell et les Français ont fait cause commune. Ils vont remuer ciel et terre pour découvrir M. Bondonnat.
Fritz eut un haussement d’épaules.
– Les Français ne nous gêneront pas longtemps.
– Pourquoi cela ?
– Parce que, ce soir, ils n’existeront plus. L’Arkansas aura sombré corps et biens. Il y a à bord des affiliés de la Main Rouge et toutes nos dispositions sont prises.
Baruch était devenu blême de rage.
– Cela ne sera pas, déclara-t-il en serrant les poings. Je le constate depuis quelque temps, vous ne vous donnez plus la peine de me consulter lorsqu’il s’agit de prendre une décision importante. C’en sera vite fait de notre association si la discorde se met parmi nous !
– Il ne s’agit pas de cela, répondit Fritz d’un ton conciliant ; il est urgent de se débarrasser de ces Français qui sont pour nous un danger. Nous avons saisi au vol une occasion propice. Nous étions persuadés que vous seriez de notre avis. Il n’y a pas de quoi vous mettre en colère.
– Lorsque vous avez quitté New York, reprit Baruch, il n’était pas question de ce projet. La lettre expédiée à Mlle Frédérique devait être simplement un moyen de séparer Fred Jorgell de ses alliés et d’attirer ceux-ci jusqu’à La Nouvelle-Orléans pour leur faire perdre du temps en démarches inutiles et nous permettre, à nous, de prendre une résolution à leur sujet.
– Oui, mais chemin faisant nous avons réfléchi qu’il était de beaucoup préférable de nous débarrasser d’un seul coup de ces gens-là dans une catastrophe qui paraîtra naturelle à tout le monde et ne forcera pas la justice à intervenir. Quand l’Arkansas sera au fond du Mississippi, bien malin celui qui pourrait arriver à savoir comment le naufrage s’est produit. Si vous réfléchissez un instant, vous serez de mon avis.
Baruch avait eu le temps de se calmer et avait repris peu à peu son sang-froid.
– Eh bien, précisément, fit-il d’un ton net et tranchant, j’ai réfléchi. Il ne faut pas que cette catastrophe ait lieu. Je m’y oppose absolument.
– Et la raison ?
– C’est que je ne veux pas qu’Andrée de Maubreuil périsse. Je l’ai vue tout à l’heure encore sur le pont et nos regards se sont croisés. Je l’aime autant que je l’aimais autrefois lorsque j’étais chez son père. Elle me détestait, elle me déteste sans doute encore, mais justement ce sera mon triomphe à moi de me faire aimer d’elle, de gré ou de force, et c’est pour cela que je veux qu’elle vive.
Cornélius et Fritz se consultaient du regard et demeuraient hésitants et perplexes.
– Comprenez bien, d’ailleurs, dit encore Baruch, que le moment serait très mal choisi pour attirer l’attention sur la Main Rouge. Je sais qu’Harry Dorgan me déteste, il a d’ailleurs de bonnes raisons pour cela ; et je suis sûr qu’il me soupçonne d’avoir été pour quelque chose dans sa maladie. Il ne suffirait que d’une enquête menée avec sagacité pour découvrir que c’est nous qui sommes ces fameux Lords de la Main Rouge dont l’existence est passée, en Amérique, à l’état de légende. Réfléchissez à votre tour et voyez s’il n’est pas préférable de montrer de la prudence.
La discussion se prolongea pendant une heure entière. Cornélius et son frère, bien qu’à contrecœur, finirent par céder aux raisons de Baruch. Ils savaient qu’il avait dit vrai en annonçant une véritable levée de boucliers contre la Main Rouge. De grandes précautions étaient nécessaires, momentanément du moins.
Au moment où les trois bandits venaient de tomber d’accord, on frappa de la manière convenue à la porte de la cabine 29.
D’un geste rapide, les trois Lords se couvrirent le visage de leurs masques, puis Fritz alla ouvrir.
C’était Dodge, le chauffeur.
– Sirs, dit-il, mes préparatifs sont terminés. J’attends vos ordres définitifs. Le canot qui doit vous emmener est déjà hissé sur son portemanteau.
– Tes préparatifs seront pour cette fois inutiles, dit Cornélius. La catastrophe qui avait été décidée n’aura pas lieu. Retourne à ton travail et oublie ce que tu as vu et entendu.
– Mais les cinquante dollars ?
– Garde-les, ils t’appartiennent.
Le chauffeur se retira, au comble de la surprise causée par ce dénouement inattendu.
Quelques heures plus tard, à la nuit tombante, les trois Lords de la Main Rouge profitaient d’une escale de l’Arkansas dans le port d’une bourgade riveraine pour descendre à terre. Ils se firent conduire à la gare la plus proche où ils prirent le rapide de New York.
CHAPITRE IV
Le repas des caïmans
Pendant tout le temps que Baruch était demeuré à bord de l’Arkansas, Andrée de Maubreuil, subissant, sans s’en rendre compte, une sorte de suggestion, avait été en proie à un malaise proche de l’angoisse. Sitôt que le bandit et ses deux acolytes eurent quitté le navire, elle éprouva, sans en bien comprendre la cause, un soulagement immédiat. Elle respira comme si elle eut été tout à coup délivrée d’un accablant fardeau. La nuit se passa pour elle d’une façon très tranquille dans la cabine qu’elle partagea avec Frédérique, et qui, sans être luxueuse, offrait un confort très suffisant.
Levées de bonne heure, les deux jeunes filles montèrent sur le pont, où leurs fiancés les avaient déjà précédées. Tous quatre s’extasièrent devant le panorama qui était splendide. La végétation plus luxuriante et d’un caractère différent annonçait l’approche de la zone tropicale. Les rives étaient bordées de bambous géants, les bois devenaient plus fréquents, et les palmiers, les tulipiers, les lauriers et les cèdres y étaient nombreux. Le fleuve lui-même avait doublé de largeur et il était maintenant parsemé d’îlots marécageux et verdoyants d’où l’approche du vapeur faisait s’envoler des nuées d’oiseaux aquatiques. Les embarcations de toutes sortes, steamboats, voiliers, chalands, pirogues, etc., voguaient en grand nombre autour de l’Arkansas. Andrée et Frédérique aperçurent même d’énormes trains de bois qui descendaient au fil de l’eau. Il y avait là les preuves d’un trafic intense dont nos calmes fleuves de la vieille Europe ne sauraient donner la moindre idée.
La température était devenue intolérable. Des vapeurs jaunâtres montaient des eaux surchauffées du fleuve et les caïmans devenaient innombrables. Ils s’ébattaient par centaines, par milliers tout autour du vapeur. On entendait distinctement le claquement sec de leurs mâchoires et on distinguait leurs petits yeux féroces qui étaient comme allumés d’une lueur sanglante.
Les passagers s’amusèrent d’abord à leur jeter des épluchures de toutes sortes : croûtes de pain, pelures de banane et jusqu’à des journaux roulés en boule. Puis, des sportsmen qui se trouvaient à bord s’avisèrent de tuer quelques-uns de ces monstres avec des carabines de précision.
Cette idée eut le plus grand succès. Toutes les armes à feu du bord furent mises en réquisition et bientôt le vapeur avança au milieu d’un feu roulant de détonations, d’un vrai crépitement de fusillade.
La plupart des balles des chasseurs improvisés allaient ricocher sur l’épaisse cuirasse d’écaille dont les caïmans sont couverts. Pour les tuer, il fallait les atteindre à l’œil ou au ventre, les deux seules parties vulnérables de leur individu. Ce n’était pas chose commode. Seuls quelques tireurs émérites réussirent à accomplir ce tour de force ; mais sitôt qu’un caïman était tué ou simplement blessé à mort, ses congénères se précipitaient sur lui et le déchiquetaient férocement, avec de petits cris assez semblables aux vagissements d’un nouveau-né.
Le fleuve s’était teint de sang sur une large surface. Andrée et Frédérique, qui trouvaient le spectacle de cette boucherie profondément répugnant, se disposaient à descendre dans leurs cabines, lorsqu’il se produisit un incident tout à fait inattendu.
Pour éviter les îlots, qui occupent en cet endroit le centre du fleuve, le vapeur avait dû se rapprocher de la côte où d’immenses champs de cotonniers apparaissaient, parsemés de villages composés de huttes de paille et habités par des Noirs, pour la plupart anciens esclaves, qui sont très nombreux dans la région.
Tout à coup, les passagers de l’Arkansas virent déboucher d’un fourré de bananiers et de palmiers épineux deux hommes en haillons, qui détalaient de toute la vitesse de leurs jambes, espérant sans doute trouver un refuge dans les vastes marécages dont le fleuve est bordé.
Ils étaient chaudement poursuivis par une troupe de Noirs, armés de bâtons, de fourches et même de fusils et de revolvers. Les nègres gagnaient du terrain de minute en minute et ils poussaient déjà des hurlements de triomphe en déchargeant leurs armes dans la direction des fugitifs qui paraissaient à bout de forces.
Le capitaine de l’Arkansas, en bon Yankee passionné pour tous les sports, même pour la chasse à l’homme, donna l’ordre au timonier de se rapprocher du rivage pour permettre aux passagers de suivre les péripéties de la lutte. On vit alors que les deux fuyards étaient un Blanc et un Peau-Rouge. Déjà les paris s’engageaient.
– Je mets cinq dollars sur le Blanc.
– Et moi dix sur le Peau-Rouge. Il a des jarrets superbes.
– Tenu ?
– Tenu !
– J’accepte les Noirs à dix contre un.
Mais tout à coup les choses prirent une autre tournure. On sait quels sont aux États-Unis le mépris et la haine des hommes blancs pour les nègres. Ceux-ci ont au théâtre des places spéciales, en chemin de fer on ne leur permet de monter que dans certains wagons, dans les restaurants même un Noir ne s’aviserait jamais de venir s’asseoir à la table où un Blanc se trouve déjà.
Les parieurs, qui s’étaient d’abord amusés de la poursuite, ne tardèrent pas à passer de la curiosité à l’indignation.
– C’est une honte, s’écria un gros marchand de blé de Saint Louis, Yankee pur sang ; voilà maintenant que les hommes noirs se mettent à chasser les citoyens américains comme si c’étaient de simples sangliers.
– C’est indigne !
– Il faut empêcher cela.
– Sus aux moricauds !
– Il faut tirer sur les nègres !…
– C’est cela !…
Les cervelles étaient arrivées à un état d’exaltation intense. Quelques gentlemen, plus décidés que les autres, intimèrent au capitaine l’ordre d’approcher l’Arkansas du rivage autant que cela serait possible et en même temps de détacher du vapeur un canot pour recueillir les fugitifs. Le capitaine yankee qui, au fond, était exactement de l’avis de ces passagers ne se fit pas tirer l’oreille pour obéir. Louvoyant avec précaution entre les bancs de boue, et de joncs, le vapeur se rapprocha du rivage. Pendant ce temps, les tireurs qui venaient d’exercer leur adresse contre les caïmans s’empressaient de recharger leurs armes et couraient chercher de nouvelles munitions dans leurs cabines.
Sitôt qu’ils furent à bonne portée, les Noirs furent accueillis par une décharge générale. Trois ou quatre tombèrent, plus ou moins grièvement blessés, aux cris de joie de l’assistance.
– Bien tiré, sir ! un coup superbe. Hourra pour la vieille Amérique !
– Mort aux Noirs !
Voyant leurs camarades blessés, les nègres s’étaient arrêtés net, tout ébahis de cette intervention inattendue. Ils se gardèrent bien de riposter, sachant combien il aurait été grave pour eux d’attaquer un navire américain. Le moins qui eût pu leur arriver eût été d’être pendus haut et court comme pirates.
Après une courte délibération, ils battirent prudemment en retraite et ils eurent bientôt disparu dans l’immense et ondoyant océan des plantations de coton et de maïs. Les deux fugitifs, sans que personne s’y opposât, gagnèrent paisiblement le canot qui les transporta à bord du vapeur.
À peine eurent-ils mis le pied sur le pont qu’ils furent entourés d’un cercle de curieux pleins de sympathie pour l’état lamentable où ils se trouvaient. Ils offraient, il faut le dire, un spectacle pitoyable. De leurs vêtements arrachés, brûlés par place, il ne leur restait que des lambeaux. Ils étaient couverts de boue et de sang, balafrés d’égratignures et meurtris de coups.
De tous côtés les exclamations se croisaient.
– Coquins de Noirs, dans quel état ont-ils mis ces pauvres gens !
– Il faut leur donner des habits !
– Et, avant tout, leur faire boire un bon coup de whisky, cela les remettra.
– Ils doivent avoir faim !
– Non, le whisky d’abord, ils mangeront après.
Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées que les deux fuyards, si miraculeusement échappés à la mort, étaient en possession chacun d’une veste et d’un pantalon de matelot en bonne toile à carreaux et tenaient en main un gobelet d’étain rempli d’excellent rye-bourbon. Ils absorbèrent à longs traits la généreuse liqueur.
– C’est un vrai velours sur l’estomac, dit le Blanc.
Le Peau-Rouge ne fit aucune réflexion, mais il but comme si c’eût été de l’eau pure le second gobelet de l’ardent breuvage qu’une passagère complaisante venait de lui verser.
– Maintenant, dit quelqu’un, ils vont nous expliquer d’où ils viennent et nous raconter leurs aventures.
– Volontiers, répondit le Blanc, je vous dois bien cela.
Il n’acheva pas sa phrase. Dans la foule des passagers, il venait d’apercevoir le chauffeur Dodge et sa physionomie avait pris une expression de colère et de haine épouvantable.
– Ah ! voici un de ces coquins ! rugit-il. Je me suis juré que j’étranglerais le premier qui me tomberait sous la main.
Et il ajouta d’une voix tonitruante :
– Gentlemen, cet homme est un bandit, un tramp. Je le connais et je vais en faire justice séance tenante.
Malgré la couche de charbon qui recouvrait son visage, Dodge était devenu livide.
– Ce n’est pas vrai, c’est un mensonge, bégaya-t-il d’une voix étranglée.
– Ah ! ce n’est pas vrai, attends un peu ; tu vas voir de quel bois je me chauffe !
Profitant de la surprise générale, le fugitif avait saisi Dodge par sa cravate et le serrait à l’étouffer. Une courte lutte s’ensuivit, mais Dodge était loin d’être aussi vigoureux que son adversaire. En un clin d’œil celui-ci l’eut renversé, râlant, sous son genou. La galerie se préparait déjà à l’applaudir lorsque se produisit une péripétie tout à fait inattendue. Le vainqueur empoigna le vaincu à bras-le-corps et, l’élevant en l’air à la force du poignet, il le lança par-dessus le bord.
Un cri d’horreur s’échappa de toutes les poitrines. Les passagers se penchèrent vers le fleuve. À la place où était tombé le misérable, il n’y avait plus qu’une grande tache rouge au milieu de laquelle une dizaine de crocodiles se battaient furieusement avec de sinistres claquements de mâchoires.
Le premier moment de surprise passé, les passagers de l’Arkansas, indignés d’un acte sanglant dont ils ne s’expliquaient pas la raison, se précipitèrent contre les deux fugitifs avec des cris menaçants !
– La loi de lynch ! la loi de lynch !
Tel était le cri dominant.
– Il faut les jeter à l’eau.
– Tous les deux !
– Le Blanc et le Rouge !
– Ils ne valent pas mieux l’un que l’autre !
– Cela va régaler les crocodiles !
En présence de tous ces poings menaçants qui se tendaient vers lui, l’inconnu était demeuré impassible. Lui et l’Indien, son compagnon, s’étaient adossés à la porte d’une cabine et semblaient décidés à vendre chèrement leur vie. Le premier qui s’approcha d’eux reçut un formidable coup de poing dans le creux de l’estomac. Un autre fut lancé d’un coup de pied à l’autre extrémité du pont. Cinq adversaires furent ainsi successivement mis hors de combat.
Quelqu’un proposa d’abattre ce redoutable boxeur à coups de revolver, mais cette motion fut accueillie par des protestations unanimes.
– Non, pas de revolver, ce n’est pas le franc jeu ! Il faut voir s’il sera le plus fort !
Les Américains sont très appréciateurs du véritable courage, sous quelque forme qu’il se manifeste. Comme on le voit, l’attitude résolue des deux fugitifs leur avait déjà concilié certaines sympathies parmi les passagers. Antoine Paganot jugea que le moment était peut-être opportun pour intervenir en faveur de ces deux hommes dont la conduite était trop extraordinaire pour n’avoir pas une raison d’être sérieuse.
– Ladies et gentlemen, dit le Français en s’avançant hardiment au milieu du groupe, il me semble qu’il serait imprudent d’agir avec précipitation. Ces hommes ont le droit d’être jugés légalement. Je suis sûr, d’ailleurs, qu’il y a là-dessous quelque mystère.
– Oui, répliqua l’inconnu, j’ai agi comme je le devais ; le bandit que j’ai jeté en pâture aux caïmans était un membre de la Main Rouge.
– Au fait, dirent quelques voix, il a peut-être raison.
Une discussion acharnée se produisit entre les partisans des deux opinions, mais tout à coup le capitaine apparut, flanqué de quatre robustes matelots armés de brownings et de coutelas.
– C’est moi seul qui suis le maître à bord de mon navire, déclara-t-il. Je sais ce que j’ai à faire.
Et, tirant son chronomètre, il ajouta :
– Je donne trois minutes à ces deux vauriens pour se rendre à discrétion. Passé ce délai, je les tue comme des chiens.
Les quatre matelots avaient mis en joue les fugitifs et le capitaine, l’œil sur son chronomètre, attendait la dernière seconde de la troisième minute pour commander le feu.
Dans ces conditions, toute résistance était impossible. Les fugitifs se rendirent. On les garrotta solidement et on les enferma dans une cabine vide.
Le coup de force du capitaine avait produit une grande impression. Un profond silence régna quelque temps sur le pont, et ce ne fut qu’au bout d’une dizaine de minutes que les conversations et les discussions recommencèrent aussi passionnées et aussi bruyantes qu’auparavant. La curiosité de tous était excitée au plus haut point. On voulait savoir quels étaient les deux étranges personnages qui venaient de faire une si belle défense et d’où ils arrivaient. Quelques-uns des plus importants parmi les passagers supplièrent le capitaine de procéder à un interrogatoire qui donnât satisfaction à l’opinion, et il s’y résolut sans peine car il était lui-même très intrigué par cette aventure.
Pour donner à ses agissements une sorte de forme légale, il s’adjoignit un constable qui allait passer ses vacances à La Nouvelle-Orléans et un marchand de suif qui avait été membre du jury l’année précédente.
L’Indien déclara se nommer Kloum ; quant à son compagnon, il affirma être ce même lord Astor Burydan, dont plusieurs mois auparavant la mort avait été annoncée par tous les journaux. Cette affirmation était déjà invraisemblable, mais quand le capitaine lui demanda d’où il venait il se perdit dans une histoire tellement incroyable qu’il devint évident pour les membres du tribunal improvisé qu’ils se trouvaient en présence de deux fous, car l’Indien Kloum appuyait énergiquement toutes les affirmations de son compagnon.
Le prétendu lord Burydan racontait que, s’étant trouvé en compagnie de Kloum sur un navire chargé de cercueils de Chinois, il avait fait naufrage, avait été jeté dans une île glacée, l’île des pendus, qui appartenait à la Main Rouge, et où il avait été chargé de surveiller les phoques à fourrure.
– Vous avez le cerveau fêlé, mon garçon, dit le capitaine, et où est-elle, cette île ?
– Je ne sais pas.
– Et comment vous en êtes-vous échappé ?
– Dans un aéronef merveilleux qui nous a déposés au milieu d’un village de Noirs. Ces misérables ont brisé notre machine et vous connaissez le reste de notre histoire.
– Et pourquoi avez-vous tué mon chauffeur ?
– Parce que je l’ai reconnu pour être un des bandits de la Main Rouge qui, dans l’île des pendus, avaient été chargés de me garder.
Le capitaine ne voulut pas en entendre davantage. Son opinion et celle de ses assesseurs étaient désormais irrévocablement fixées. Ils avaient affaire à deux fous dangereux, échappés de quelque asile.
En dépit de toutes leurs protestations, lord Burydan et Kloum furent gardés à vue, surveillés plus étroitement que jamais et le soir du même jour, quand l’Arkansas prit terre à La Nouvelle-Orléans, ils furent conduits sous bonne escorte à la prison de la ville en attendant qu’on décidât de leur sort.
CHAPITRE V
La signature
Oscar Tournesol, malgré la proposition qui lui en avait été faite, avait refusé d’accompagner ses amis dans leur voyage à Saint Louis et à La Nouvelle-Orléans. Le bossu avait ses projets. Avec l’indépendance de caractère et l’entêtement qui étaient ses qualités dominantes, il s’était dit que, jusqu’alors, on n’avait pas pris les meilleurs moyens pour retrouver la trace de M. Bondonnat. Selon lui, il eût fallu se faire affilier à l’association de la Main Rouge et il était persuadé que c’était seulement de cette manière que l’on arriverait à un résultat. Il se promit donc d’explorer les bas-fonds de la ville de New York et de faire à tout prix connaissance avec quelqu’un des bandits.
Un matin, il alla trouver Fred Jorgell qui, précisément, était d’excellente humeur, car ce jour-là, pour la première fois, l’ingénieur Harry Dorgan avait pu descendre au jardin, appuyé aux bras de miss Isidora et d’Agénor Marmousier.
– Je viens vous demander un congé, dit-il au milliardaire.
Et il exposa nettement ses projets. Fred Jorgell accueillit sa requête par un sourire. L’esprit d’initiative et l’originalité du bossu lui étaient de plus en plus sympathiques.
– Tu veux un congé, mon garçon, répondit-il, eh bien, soit. Agis à ta guise. Après le service que tu m’as rendu, je n’ai rien à te refuser. En outre, si tu as besoin de quelques centaines de dollars, demande-les à mon ami Agénor qui te fera un bon sur ma caisse.
– J’accepte votre offre, mais je n’en abuserai pas. Ainsi donc, ne vous étonnez pas de me voir disparaître pendant une semaine et peut-être plus.
– Et où vas-tu, comme cela ?
– Permettez-moi de ne pas vous le dire. Pour que mes projets réussissent, il faut qu’ils soient conduits dans le plus grand secret.
– Comme il te plaira, fit le milliardaire sans insister. Au revoir, mon garçon, et bonne chance !
Quelques heures plus tard, Oscar Tournesol, qui avait remis son ancien costume délabré de cireur de bottines, faisait sa première apparition dans un bizarre établissement que l’on appelait le « Gorill Club » et qui était situé dans la partie la plus sordide et la plus fangeuse du quartier irlandais. Le Gorill Club était un établissement d’un genre tout spécial et dont on n’eût certainement pas trouvé l’équivalent dans toute l’Amérique. C’était une sorte d’école professionnelle où, moyennant la modique rétribution de trois dollars par semaine, les équilibristes, les athlètes, les hommes-serpents, les mangeurs de feu, les dresseurs de reptiles, en un mot les acrobates de toute espèce venaient se perfectionner dans leur art. Un ancien directeur de cirque, l’honorable Mr. John Sleary, veillait aux destinées de cet institut d’un nouveau genre, dont il était également le propriétaire.
Ce nom de Gorill Club venait d’une troupe de clowns qui, revêtus de peaux de singe, exécutaient des exercices à la fois périlleux et comiques qui avaient été applaudis dans quelques villes de l’Ancien et du Nouveau Monde. Un peu de gloire avait rejailli sur l’école où ils avaient modestement débuté.
Après avoir traversé les ruelles boueuses où s’ébattaient des enfants à demi nus et où de loin en loin des ivrognes, allongés sur le trottoir, cuvaient paisiblement leur whisky, Oscar fit halte devant une porte cochère aux ais disjoints. Au-dessus, on lisait en lettres d’or délavées par les pluies : Professional School Sleary, et à côté, en caractères plus gros, et qui semblaient avoir été tracés avec du cirage : Gorill Club.
Une fois dans l’immeuble, Oscar pénétra dans une pièce d’entrée où, devant un bureau démodé et couvert de taches d’encre, il aperçut un homme d’une quarantaine d’années, à la chevelure broussailleuse, à la figure replète et au ventre bedonnant, qui écrivait sur un registre graisseux. Un verre et une bouteille de gin se trouvaient à portée de sa main. C’était le directeur lui-même, John Sleary.
Tout dans sa personne révélait son ancienne profession, la bague énorme qu’il portait au doigt comme la lourde chaîne d’or à laquelle étaient suspendues des griffes de tigre et qui s’étalait sur un gilet de velours incarnadin.
En voyant entrer le bossu, il se leva et alla au-devant de lui avec un sourire plein d’affabilité.
– Salut, jeune gentleman, dit-il à Oscar d’une voix que le gin et l’asthme rendaient à la fois rauque et haletante, je suis un peu poussif, n’y faites pas attention ! Heu ! heu !… des fatigues du métier… vous savez…
– Monsieur…, interrompit Oscar.
– Oui, oui, je devine ce qui vous amène… Vous voulez devenir un artiste célèbre. Vous pouvez dire que vous avez été bien inspiré en venant ici. Sans me vanter, vous ne trouverez pas dans tout New York, et même dans toute l’Amérique, un établissement pareil à celui de John Sleary. Combien de compagnons, après avoir terminé leur éducation artistique sous mes ordres, gagnent aujourd’hui des cachets de vingt-cinq dollars par soirée !
– Je n’ai pas de si grandes prétentions, dit modestement Oscar.
– Vous avez tort, jeune homme… heu ! heu !… il faut être ambitieux… heu ! heu !… Vous avez le dos un peu rond, c’est un excellent atout dans votre jeu. Tous les bossus que j’ai connus… heu ! heu !… sont arrivés à des situations superbes… Voulez-vous prendre un verre de gin avec moi ?… heu ! heu !…
– Je vous remercie.
– Mais quelles sont vos intentions ?… Heu ! heu !…
– Je voudrais surtout prendre des leçons de gymnastique.
– Excellente idée !… C’est… heu ! heu !… une des spécialités de l’établissement. Vous me paraissez taillé pour faire un clown de premier ordre. D’ailleurs, mon garçon, mettez-vous bien une chose dans l’esprit, c’est que notre époque… heu ! heu !… est l’époque du muscle. Celui qui n’a pas de solides biceps aura beau être intelligent, il sera certainement… heu ! heu !… foulé aux pieds dans la bataille de l’existence !
– C’est absolument mon avis. Et maintenant, quelles sont les conditions ?
– Trois dollars par semaine pour les leçons… heu ! heu !… Maintenant, si vous logez dans l’établissement même, ce sera trois dollars en plus pour une chambre très confortable… heu ! heu !… Et douze dollars encore en plus si vous prenez vos repas à la pension des artistes… Je crois que c’est… heu ! heu !… très raisonnable !
Oscar ne fit pas la moindre observation et il versa une quinzaine d’avance, ce qui le mit immédiatement dans les bonnes grâces de l’illustre John Sleary.
– Maintenant que cette petite formalité est remplie, lui dit pompeusement celui-ci, je vais vous introduire tout de suite dans le hall des exercices.
Il poussa une porte et Oscar pénétra à la suite du directeur dans une vaste salle où, dans un épais brouillard causé par la fumée du tabac, s’agitait une foule d’êtres fantastiques. Le hall des exercices était constitué par une vaste cour carrée autour de laquelle s’élevaient quatre corps de bâtiments à demi ruinés. C’était dans ces constructions que logeaient les pensionnaires du Gorill Club. La cour avait été recouverte d’un vitrage, mais nombre de carreaux en avaient été cassés à coups de pierre et des toiles d’araignée faisaient régner dans le hall une pénombre discrète.
À mesure que ses yeux s’accoutumaient à la fumée, le bossu distingua une soixantaine d’acrobates, en ce moment dans toute l’ardeur du travail, si absorbés qu’ils ne s’étaient pas aperçus de son arrivée. Tout en haut et semblant voguer au-dessus du brouillard de la fumée, des équilibristes en maillot cerise évoluaient sur des trapèzes ; plus bas, des clowns tournaient comme des météores autour d’une barre fixe ; des sauteurs franchissaient une série de tremplins avec une agilité d’écureuil, tandis que, sur le sol même, ramaient des hommes-serpents, des femmes-troncs et des culs-de-jatte, ce qui n’empêchait pas qu’une petite écuyère, Mlle Régine Bombridge elle-même, montée sur un vieux cheval blanc ne s’exerçât à franchir des cerceaux enflammés et à retomber d’aplomb sur le panneau de la selle.
Dans un autre coin, des tireurs canadiens s’exerçaient au noble jeu de la cible humaine, et un vieillard à mine respectable, armé d’une cravache, apprenait à deux gorilles, tristement assis en face d’une table de zinc, à lire le journal et à fumer des cigares comme deux gentlemen du meilleur monde.
Se frayant un passage entre un maigre jeune homme qui s’étudiait à marcher sur la tête et un Japonais fort occupé à jongler avec des torches allumées, ils s’arrêtèrent en face d’un personnage corpulent qui, les poings recouverts de gants de boxe, était en train de faire un match avec un kangourou. À la vue de Mr. Sleary, il interrompit cet exercice violent.
– Allons, monsieur Tony, dit-il à l’animal, en voilà assez pour le moment. Prenons un peu de repos, s’il vous plaît.
Et en même temps, il montrait sa cravache. Le kangourou comprit l’injonction avec une remarquable docilité et se tint coi. Mr. Sleary put procéder aux présentations de rigueur.
– Jeune homme, dit-il à Oscar, je vous présente Mr. Bombridge, le célèbre clown, si connu dans les États de l’Union et même dans le Vieux Monde. C’est lui qui, sur ma recommandation, et par faveur spéciale, va se charger de votre éducation artistique. Vous êtes en bonnes mains et avec un pareil maître, vous irez loin.
Mr. Bombridge, dont la voix était presque aussi éraillée que celle de son directeur, remercia celui-ci de l’honneur qui lui était fait, et après avoir échangé divers compliments, tous deux sortirent pour aller trinquer à la santé du néophyte qu’ils laissèrent dans le hall, afin qu’il « prît l’air de la maison ».
Une heure plus tard, un roulement de tambour appela les pensionnaires au « dining-room », longue salle blanchie à la chaux et décorée d’instruments de musique et de la fourrure d’un ours qui avait été longtemps le collaborateur dévoué de Mr. Sleary.
Là, Oscar se régala médiocrement de morue aux pommes de terre et de bière aigre. Le directeur qui, suivant un usage patriarcal, présidait à ces agapes et occupait le haut bout de la table déclara, avec un à-propos tout à fait remarquable, que la sobriété était une des conditions nécessaires au succès dans les arts acrobatiques, ce qui ne l’empêcha pas, d’ailleurs, de donner, au dessert, une forte accolade à la bouteille de gin, sa compagne inséparable.
Après avoir passé le reste de la journée à de fatigants exercices d’assouplissement, sous la direction de Mr. Bombridge, qui était véritablement un bon professeur, Oscar gagna le galetas qui lui avait été assigné pour demeure. Le milieu excentrique et débraillé où il se trouvait ne l’étonnait pas et il s’endormit en pensant qu’il aurait vraiment peu de chance si, dans cette société interlope et mêlée, il n’arrivait pas à faire connaissance de quelque membre de l’association de la Main Rouge.
Au bout d’une semaine Oscar écrivit à Agénor une longue lettre où il lui décrivait les types curieux avec lesquels il se trouvait en rapports journaliers ; en même temps, il lui faisait part de ses espérances.
Fred Jorgell, auquel Agénor montra cette lettre, la lut avec beaucoup d’intérêt et fit adresser au futur clown un bon de cinquante dollars à titre d’encouragement.
Après les effroyables transes qu’il venait de traverser, le milliardaire se trouvait dans une période de calme et de chance. Ses ennuis semblaient complètement terminés. La Société des paquebots Éclair donnait de magnifiques dividendes et, ce qui était beaucoup plus important encore pour Fred Jorgell, l’ingénieur Harry Dorgan terminait heureusement sa convalescence. Le jour vint où les médecins déclarèrent qu’il pouvait, sans inconvénient, faire une promenade en auto, en compagnie de miss Isidora et de l’indispensable mistress Mac Barlott.
Il faisait une tiède journée de printemps. Harry Dorgan, encore un peu pâle, aspirait avec bonheur l’air pur des grandes avenues du bord de l’Hudson, Isidora contemplait silencieusement en souriant ce fiancé si miraculeusement échappé à la mort, et elle le couvait du regard comme un avare son trésor.
Les deux jeunes gens effleurèrent divers sujets de conversation, puis mistress Mac Barlott ayant prononcé le nom de Baruch, ils en vinrent à parler du misérable toujours détenu au Lunatic-Asylum de Greenaway, dans la banlieue de New York.
Miss Isidora, on le sait, n’était pas entièrement persuadée de la culpabilité de son frère. Ses longues réflexions l’avaient conduite à penser qu’un profond mystère planait sur toute cette affaire et que Baruch n’était peut-être pas aussi coupable qu’il le paraissait. Elle était la seule personne qui s’occupât encore de lui et elle continuait à lui faire servir une petite pension pour qu’il fût bien traité et qu’on ne le confondît pas avec la tourbe des déments pauvres.
– Il y a bien longtemps que je n’ai été rendre visite à ce malheureux, murmura-t-elle non sans émotion.
– Voulez-vous qu’aujourd’hui même je vous accompagne jusqu’à Greenaway ? proposa Harry Dorgan qui s’évertuait à satisfaire les moindres caprices de la jeune fille.
– Je n’osais vous le demander, mais je ne veux pas vous infliger une si pénible entrevue. Nous irons jusqu’à Greenaway, mais vous m’attendrez pendant que j’irai voir ce pauvre être.
– Non pas, je viendrai avec vous.
L’ingénieur, en effet, n’était pas fâché de se faire une opinion personnelle sur les transformations que le temps, la maladie et la captivité avaient pu apporter dans la physionomie matérielle et morale du meurtrier. Un ordre fut donc crié au chauffeur et l’auto stoppa bientôt en face de la solide grille aux lances dorées qui donnait accès à l’intérieur du Lunatic-Asylum.
Mistress Mac Barlott, ayant déclaré que la vue des aliénés lui était toujours désagréable, demanda à demeurer dans l’auto. Harry Dorgan et miss Isidora entrèrent donc seuls, et le concierge les remit aux soins d’un athlétique personnage, vêtu d’un uniforme jaune à boutons de métal et coiffé d’un casque de cuir bouilli. C’était le surveillant en chef.
Dès l’entrée, la jeune fille avait été frappée de l’état de désordre qui semblait régner dans l’établissement. Les allées sablées étaient encombrées de mauvaises herbes, les couloirs n’étaient pas balayés, les surveillants se promenaient insoucieusement, la pipe à la bouche ; enfin, d’un baraquement en bois où étaient enfermés les fous pauvres, s’élevait une chanson populaire hurlée en chœur par des centaines de voix exaspérées. Miss Isidora ne put s’empêcher de manifester son étonnement d’un pareil état de choses. Le surveillant en chef eut un sourire qui en disait long.
– C’est que, miss, expliqua-t-il, depuis l’arrestation de Mr. Johnson, l’ancien directeur – un brave homme, quoi qu’il ait commis certains abus de pouvoir –, tout est changé ici. Le nouveau directeur, Mr. Palmers, est un ancien jockey. On ne le voit jamais ; il passe tout son temps sur les champs de courses. Aussi, chacun fait ce qu’il veut, et s’il n’y avait pas quelques surveillants sérieux comme moi, je ne sais pas ce que cela deviendrait.
Tout en parlant, il avait ouvert une petite porte de fer munie d’un judas. Il introduisit les visiteurs dans un enclos dont le maigre gazon était ombragé par quelques arbres chétifs. C’était là, sans nul doute, les magnifiques jardins propices aux cures de plein air annoncés pompeusement par des prospectus. Une trentaine d’aliénés s’y trouvaient, les uns gesticulant et parlant tout seuls, les autres en proie à un morne abattement.
Miss Isidora s’était rapprochée d’Harry Dorgan. Elle se sentait le cœur serré.
– Cher Harry, murmura-t-elle, ces visites à mon frère si coupable, mais si terriblement puni, me sont tellement pénibles que je suis heureuse que vous soyez près de moi pour m’aider à supporter ma douloureuse émotion.
– Ne dois-je pas partager avec vous le malheur aussi bien que le bonheur ? répondit le jeune homme en pressant tendrement la main de la jeune fille.
– Voici mon frère, dit-elle en montrant dans une allée sablée du triste jardin rectangulaire un homme pâle et vêtu de noir dont l’attitude et la physionomie reflétaient bien plus que la folie une poignante tristesse.
Harry Dorgan ressentait une étrange émotion, mais, à mesure qu’il examinait le dément, une étrange surprise s’emparait de lui. Cet homme à la mine chétive et timide était-il bien l’audacieux Baruch ? Cela lui paraissait impossible.
– Comme il est changé ! ne put-il s’empêcher de dire à miss Isidora qui, doucement, avait pris les mains du dément et le regardait en souriant.
Le fou paraissait très préoccupé de la présence de l’ingénieur qui, lui, se sentait envahi par une sorte d’angoisse. Leurs regards se rencontrèrent et on eût dit qu’un éclair de lucidité avait passé dans les yeux vagues de Baruch. Il semblait faire des efforts inouïs pour se rappeler où il avait vu ce visiteur et comment il se nommait.
– Comment te trouves-tu ? demanda miss Isidora avec sollicitude.
À la grande surprise d’Harry Dorgan, Baruch répondit d’une façon très sensée :
– Je suis très mal, mademoiselle. J’ai cru un moment que j’allais guérir, puis j’ai fait une rechute. Je n’ai plus de mémoire…, je ne puis plus me souvenir…
– Ma chère Isidora, dit l’ingénieur, ne prolongeons pas trop longtemps notre visite. Ne craignez-vous pas de fatiguer le malade ?
– Non, répondit-elle ; aujourd’hui il semble aller mieux. Il a répondu sensément à ma question. Qui sait si le temps et le repos ne rallumeront pas la flamme de la raison, mais comme il est changé !
– C’est ce que je remarquais tout à l’heure.
Il y eut un silence. Baruch s’était emparé de l’ombrelle de miss Isidora et, comme les enfants, s’amusait machinalement à écrire sur le sable de l’allée. Mais tout à coup, Harry poussa un cri de stupeur :
– Regardez, Isidora, ce qu’il vient d’écrire !
La jeune fille lut avec surprise ces deux mots très nettement tracés : Joë Dorgan.
– Peut-être me prend-il pour mon frère, murmura l’ingénieur ; mais il me vient une idée. Et tirant de sa poche un carnet et un crayon, il les présenta au dément. Celui-ci ne se fit pas prier pour écrire de nouveau les deux mots Joë Dorgan, qu’il souligna d’un paraphe compliqué.
– Par exemple, s’écria l’ingénieur en arrachant le carnet presque des mains du fou, voilà qui est stupéfiant. Regardez donc, Isidora. Il vient de tracer la propre signature de mon frère. C’est à n’y rien comprendre. C’est l’écriture de Joë lui-même et c’est son paraphe.
– Qu’est-ce que cela signifie ? murmura la jeune fille au comble de l’étonnement, rendez-lui donc le carnet et le crayon. Nous allons bien voir.
Baruch n’hésita pas à écrire de nouveau comme on l’en sollicitait, mais on eût dit qu’il ne connaissait rien d’autre que la signature Joë Dorgan. Il la reproduisit plusieurs fois et traça des mots sans suite, comme mémoire… mort…, docteur…
– Tu connais donc Joë Dorgan ? lui demanda Isidora.
– Oui… Joë Dorgan, répéta-t-il stupidement.
– Écris : Baruch Jorgell.
Il obéit docilement, mais à la surprise croissante d’Harry, les mots Baruch Jorgell étaient tracés de l’écriture de Joë Dorgan.
– Il y a là un étrange mystère ! s’écria l’ingénieur. Il faudra que j’arrive à l’éclaircir. Je n’ose aller jusqu’au bout de ma pensée.
– Ne cherchons pas à expliquer ce qui est inexplicable, dit miss Isidora, profondément troublée. J’ai toujours, moi aussi, dit qu’il y avait là un mystère.
– Il est temps de nous retirer. J’ai besoin de beaucoup réfléchir à ce que je viens de voir.
– Oui, partons, vous avez raison.
Ils prirent congé du dément qui, maintenant, était retombé dans un morne abattement. La fugitive étincelle de lucidité qui avait brillé un instant s’était éteinte. C’est à peine s’il parut s’apercevoir du départ de ses visiteurs.
Obséquieux et flairant sans doute quelque pourboire, le surveillant en chef attendait Harry et Isidora à la petite porte de fer du jardin. Pendant qu’il les reconduisait par les allées en friche de l’entrée, l’ingénieur dit brusquement :
– Je suis persuadé que si le malade était entre les mains de spécialistes habiles, arraché à la promiscuité des aliénés, il finirait par guérir et alors nous aurions la clef de l’énigme.
– Je m’occuperai de le faire sortir d’ici, balbutia la jeune fille avec agitation, je suis sûre, moi aussi, que mon frère serait guérissable.
– Il n’y a qu’un inconvénient à cela, interrompit le gardien-chef qui avait tout entendu, c’est que Mr. Baruch Jorgell, ayant été condamné à mort, ne peut sortir d’ici.
– Mais, objecta la jeune fille, on indemniserait le directeur.
– La chose est impossible. Il n’y a pas d’indemnité qui tienne. La loi est la loi. Le directeur est responsable de son prisonnier et si nous appliquions strictement le règlement, il devrait être enfermé dans une cellule munie de barreaux de fer. Ce n’est que par faveur qu’on lui permet de demeurer avec les aliénés paisibles.
Miss Isidora ne répondit pas un mot à cette phrase qui lui rappelait de cruels souvenirs, qui lui montrait que, pour la société, Baruch était toujours un criminel.
Quelques minutes après, elle remontait dans l’auto où mistress Mac Barlott l’attendait avec impatience.
Le retour à New York fut silencieux. L’ingénieur ne pouvait s’empêcher de se demander anxieusement si c’était bien l’assassin Baruch qu’il venait de visiter.
CHAPITRE VI
Une joviale réception
Comme chaque matin, le hall des exercices du Gorill Club était en pleine animation. Jongleurs, athlètes, écuyers et animaux savants étaient plongés dans l’ardeur du travail, sous la bénévole surveillance de l’illustre John Sleary et de son non moins illustre ami, le clown Bombridge.
Oscar Tournesol, qui depuis son arrivée au club avait fait de rapides progrès et donnait à ses professeurs les plus belles espérances, était occupé à réaliser une série de sauts périlleux, vêtu d’une fourrure ajustée à sa taille, qui lui donnait l’aspect d’un singe de grande espèce, lorsque John Sleary, le visage très animé, vint lui dire qu’un gentleman de la plus rare correction le demandait au bureau.
– C’est, fit-il, heu… heu… quelqu’un qui appartient certainement… heu… heu… à l’aristocratie du vieux continent… Il porte une chemise brodée, un costume qui sort de chez le tailleur, et il est arrivé dans une auto tout à fait… heu… heu… luxueuse.
Sans quitter son pittoresque déguisement, Oscar s’empressa de suivre le directeur jusqu’au bureau situé près de la porte d’entrée, et là, il se trouva inopinément en face de son compatriote et ami, Agénor Marmousier. Tous deux se serrèrent la main avec effusion. Et leur premier soin fut de congédier Mr. Sleary qui s’obstinait à vouloir faire prendre aux visiteurs un verre de son gin.
– Ce vieil ivrogne est assommant, dit Oscar, il est tellement imbibé d’alcool que je suis sûr qu’il prendrait feu comme un simple punch si l’on approchait de lui une allumette.
Agénor paraissait si préoccupé qu’il n’avait pas même fait attention à l’étrange costume dont était revêtu son ami et que complétait une tête de carton au masque hideux, pour le moment rejetée en arrière comme un capuchon.
– Mon brave Oscar, je suis venu vous trouver pour vous confier mon embarras. Je me trouve dans une situation singulière. Et, pour comble d’ennui, Mr. Fred Jorgell, l’ingénieur Dorgan et miss Isidora sont allés en auto au-devant de vos amies Andrée et Frédérique et de leurs fiancés qui reviennent de La Nouvelle-Orléans sans avoir abouti dans leurs recherches.
– Je m’attendais à cela, murmura Oscar, mais de quoi s’agit-il ?
– Vous allez le savoir. Je vous ai bien des fois parlé de mon bienfaiteur, lord Astor Burydan, qui possède l’imagination d’un poète en même temps que la générosité d’un prince, lord Burydan près duquel pendant trois ans j’ai coulé les plus heureux jours de ma vie.
– Mais vous m’avez dit qu’il était mort, qu’il avait péri dans le naufrage de la Ville-de-Frisco ?
– Il n’en est rien, heureusement ; mais lord Burydan, ce qui ne m’étonne qu’à moitié de sa part, d’ailleurs, se trouve en ce moment-ci dans la plus étrange des situations. Tenez, lisez ceci, et vous serez plus rapidement renseigné.
Et Agénor tendait au bossu un numéro du New York Sun dont un article portait en manchette :
Un drame sur le Mississippi.
Un prétendu lord jette le chauffeur d’un yacht
en pâture aux caïmans. Deux aliénés dangereux.
Le commencement de cet article sensationnel contenait le récit à peine exagéré des événements que nous avons vu se dérouler à bord de l’Arkansas. On y narrait l’arrestation de lord Burydan et de l’Indien Kloum. Les deux fugitifs avaient d’abord été enfermés dans une prison de La Nouvelle-Orléans. Mais, devant le constable, lord Burydan s’était réclamé de l’ambassade d’Angleterre à New York et avait mené grand tapage. Le consul anglais de La Nouvelle-Orléans ayant par principe appuyé ses réclamations, le lord et son compagnon avaient été embarqués sous bonne escorte et conduits à New York. L’excentrique lord, qui avait dans les milieux diplomatiques de hautes et puissantes relations, ne doutait pas qu’une fois arrivé dans la capitale de l’Union il ne lui fût rendu promptement justice.
Malheureusement, l’ambassade avait montré une mauvaise volonté extraordinaire et, comme lord Burydan n’avait sur lui aucun papier qui pût prouver sa qualité, on l’avait bel et bien enfermé avec son soi-disant complice au Lunatic-Asylum de Greenaway, en attendant qu’on prît un arrêté d’expulsion en bonne forme.
Ce que le journal ne disait pas, c’est qu’un des attachés de l’ambassade anglaise était le fils d’un parent éloigné de lord Burydan, qui, sur la nouvelle de son décès, s’était fait provisoirement envoyer en possession de son immense fortune.
Dans ces conditions, l’excentrique avait de grandes chances de faire un long séjour dans les cabanons grillés du Lunatic-Asylum où, sur recommandations expresses, il avait été immédiatement « bouclé » en qualité de fou dangereux.
– Vous savez, dit Agénor, lorsque le bossu eut terminé la lecture de l’article, que, dans le naufrage, j’ai réussi à sauver tous les papiers de lord Burydan dont j’étais porteur. Comme tout le monde l’aurait fait à ma place, je courus avec ces papiers à l’ambassade d’Angleterre ; mais on m’a fort mal accueilli, on m’a presque jeté dehors en me conseillant de ne pas me mêler de ce qui ne me regardait pas. Très surpris, je suis allé au Lunatic-Asylum. On ne m’a même pas laissé entrer et on m’a fort insolemment fait entendre qu’il fallait que je fusse un complice des deux internés pour demander ainsi à venir les voir. Il faut absolument que je porte secours à mon ami et que je l’aide à s’échapper de cet asile. Pour qu’on n’ait pas tenu compte de mes réclamations, il faut qu’il ait des ennemis puissants. Si je ne me hâte pas de lui faire rendre la liberté, il sera peut-être emmené dans quelque hospice de province où il me serait impossible de le découvrir.
– Attendez l’arrivée de Fred Jorgell.
– Je ne puis rien attendre. J’aurais remords éternel d’avoir, par mes retards, causé le malheur de mon bienfaiteur.
– Je comprends cela. Mais en quoi puis-je vous être utile ?
Depuis un instant, Agénor considérait attentivement le costume de singe dont Oscar était revêtu.
– Eh bien, fit-il, grâce à votre déguisement.
– Je comprends de moins en moins.
– Voici mon plan. Je vais vous faire enfermer au Lunatic-Asylum.
– Hum !… s’écria Oscar, dont la bosse tressauta.
– Ne vous étonnez pas et écoutez-moi jusqu’au bout. Vous êtes agile. Ce doit être un jeu pour vous d’escalader une muraille ou de franchir une grille ?
– Bien sûr.
– Alors, il s’agit de faire évader lord Burydan et le Peau-Rouge. Je vais vous donner une bonne lime, un revolver, cinq ou six bank-notes de cent dollars. Si avec cela vous ne réussissez pas, vous n’êtes pas digne de la haute opinion que j’ai de vous.
– On est parisien, fit Oscar en se rengorgeant. Bien que ça n’ait pas l’air très commode, je vais tenter l’entreprise. Seulement, il faudra m’excuser près de Mr. Sleary et dire que vous m’emmenez en vacances.
Au bout d’une demi-heure de conversation, Oscar, d’abord un peu hésitant, était devenu enthousiaste de cet original projet qui n’avait pu germer que dans la cervelle d’un poète fantaisiste tel que l’était Agénor Marmousier.
Après divers préparatifs, les deux amis montèrent en auto et se firent conduire au Lunatic-Asylum de Greenaway. Oscar était toujours en singe et le hideux masque de carton qu’il avait rabattu sur son visage complétait à miracle le déguisement.
Comme ils allaient descendre en face de la grille dorée de l’établissement, Oscar dit à son compagnon :
– J’espère bientôt vous faire parvenir des nouvelles ; mais je vous recommande surtout de ne souffler mot de cette aventure ni à Mlles Frédérique et Andrée ni à leurs fiancés. Je leur avais promis de ne rien faire qui n’eût pour but de retrouver M. Bondonnat et je manque à ma parole pour vous être agréable en me laissant enfermer dans cet asile.
Agénor fit la promesse que son ami exigeait de lui ; tous deux passèrent gravement devant la loge du concierge ébahi et se dirigèrent vers le cabinet directorial. Dans sa stupeur, le concierge n’avait pas reconnu dans Agénor le gentleman qui, quelques heures auparavant, était venu lui parler de lord Burydan.
Ils sonnèrent et ce fut Mr. Palmers lui-même qui vint leur ouvrir, très mécontent d’avoir été dérangé d’un travail de pointage des journaux sportifs auquel il se livrait avant de se rendre sur le turf, suivant sa louable habitude.
À la vue du quadrumane qui accompagnait Agénor, il eut un froncement de sourcils.
– Que signifie cette mauvaise plaisanterie ? grommela-t-il.
– Ce n’est pas une plaisanterie, reprit gravement Agénor, je vous amène un client, et un client payant.
Mr. Palmers eut un sourire débonnaire.
– Oui, continua le poète, mon malheureux neveu, que vous voyez affublé de ce déguisement ridicule, a la funeste quoique inoffensive manie de se croire devenu singe. Il passe son temps à grimper aux arbres, à croquer des noisettes et à faire de hideuses grimaces ; mais je ne doute pas qu’après quelques semaines de traitement il ne revienne à des idées très raisonnables.
– Vous pouvez en être sûr, fit Mr. Palmers, dont l’imagination rapide combinait déjà une nouvelle martingale. Mais vous savez que l’usage est de payer trois mois d’avance, à raison de cent dollars par mois.
Sans la moindre observation, Agénor tendit trois bank-notes. Mr. Palmers les fit disparaître dans la profondeur de son gilet avec la prestesse d’un escamoteur de profession ; puis, oubliant la présence de ses visiteurs, il jeta un coup d’œil radieux vers les journaux de sport annotés au crayon bleu et murmura entre ses dents :
– Décidément, je joue le favori, cela suffira.
– Si cela ne vous suffisait pas…, reprit Agénor, gardant à grand-peine son sérieux.
– Non, mille pardons, je pensais à autre chose. Vous dites donc que ce malade est inoffensif ?
– Absolument.
– C’est bien. Je vais procéder moi-même à son installation et, d’ici peu, je vous garantis qu’il ira mieux.
Et il congédia doucement Agénor qui contenait difficilement une grande envie de rire.
Pendant tout ce dialogue, Oscar était demeuré dans un coin, feignant de ne rien entendre de la conversation, mais sitôt qu’Agénor eut disparu, il se mit à gambader, sautant par-dessus les meubles et déchirant au hasard des journaux de courses qui lui tombaient sous la main.
Mr. Palmers, vaguement inquiet, se réfugia le plus loin possible du singe et se hâta de sonner un des gardiens. Un de ces fonctionnaires, vêtu de la casaque jaune à boutons de métal et coiffé du casque de cuir bouilli, qui était, on le sait, l’uniforme de la maison, apparut dans l’entrebâillement de la porte. C’était le surveillant en chef, celui-là même que nous avons vu servir de guide à miss Isidora et à son fiancé dans leur dernière visite au Lunatic-Asylum.
– Rugby, lui dit-il d’un air dégoûté, conduisez-moi vivement ce gorille dans un cabanon quelconque et commencez par le mettre au pain et à l’eau pour lui apprendre à vivre. Ah ! mon bonhomme, je vais t’enseigner à faire le singe, moi, attends un peu !
– Est-il dangereux ? demanda Rugby.
– Inoffensif, complètement inoffensif, et de plus, c’est un malade payant.
– Bien, monsieur le directeur ; mais je voulais vous dire quelque chose…
– Qu’y a-t-il encore ? fit Mr. Palmers d’un air furieux.
– Les malades refusent énergiquement de manger du boudin.
– Alors, donnez-leur des harengs marinés ; il y a encore la moitié du stock que j’ai acheté à la criée le mois dernier.
– Ils ne veulent pas de harengs marinés non plus. Ils prétendent que cela leur donne une soif de tous les diables. Et précisément, il n’y a plus de bière en cave et le brasseur refuse de faire une nouvelle livraison à crédit.
– Au diable tous ces toqués ! ils sont vraiment bien difficiles. Pour ce matin, tâchez qu’ils se contentent encore de boudin et de harengs marinés et comme boisson, vous leur donnerez de l’eau teintée de whisky. Je vais aux courses. J’ai des tuyaux épatants. Si j’ai touché le gagnant, les fous auront ce soir un bon rôti de cheval avec des pommes de terre autour et de la bière à discrétion.
– Mais, monsieur le directeur…
– Assez ! Je n’ai pas le temps d’écouter vos sornettes. Emmenez votre gorille et fichez-moi le camp !
Le bossu, que cette scène réjouissait infiniment, suivit le gardien sans résistance, mais avant de sortir de la pièce, il eut soin de renverser d’un coup de pied une bouteille d’encre dont le contenu inonda toutes les paperasses de Mr. Palmers.
Pendant que celui-ci jurait et tempêtait, Oscar suivit le gardien qui riait sous cape, et se laissa conduire par lui jusqu’à une arrière-cour presque entièrement entourée de cellules grillagées. Le surveillant en ouvrit une et poussa brutalement Oscar dans l’intérieur, non sans l’avoir gratifié d’un coup de pied.
– Tiens ! fit-il, reste là ! Tu pourras faire le singe tout à ton aise. Oscar regarda autour de lui et vit une étroite pièce meublée d’un lit de sangle, d’un escabeau et d’une cruche d’eau au-dessus de laquelle était posé un pain de munition.
– Ça, c’est rigolo, par exemple ! s’exclama-t-il, je me demande un peu comment on traite les pensionnaires qui ne paient pas et qui ne sont pas inoffensifs ?
Il passa le restant de la journée fort tristement et il fut assez surpris quand, le soir, on lui apporta une portion de rôti entourée de pommes de terre, accompagnée d’une pinte de bière. Il pensa que, décidément, Mr. Palmers avait dû toucher le gagnant. Après son repas, auquel assista le surveillant, celui-ci, qui paraissait de moins mauvaise humeur que le matin, daigna lui souhaiter le bonsoir et le laissa méditer sans chandelle sur sa bizarre situation. Bientôt, une cloche annonça que tout le monde dormait ou devait dormir dans l’établissement. Oscar n’attendait que ce moment pour se mettre au travail.
Tout d’abord, il tira des poches intérieures de sa fourrure de singe une minuscule lanterne électrique de forme plate, un tournevis et une lime. En un clin d’œil, à l’aide du tournevis, il eut dévissé la serrure de son cabanon. Une fois dans la cour, il réfléchit. Il était évident pour lui que lord Burydan devait se trouver dans une des cellules voisines. Éteignant sa lanterne, il frappa à l’une des portes ; il n’obtint pas de réponse. Il en heurta une autre, puis une autre encore, puis une quatrième, toujours du silence. Il commençait à désespérer, à se demander si celui qu’il cherchait ne se trouvait pas dans une autre partie de l’établissement, et ce fut sans grand espoir qu’il ébranla du poing la cinquième porte ; mais, à sa grande joie, une voix bien timbrée répondit de l’intérieur :
– Qui est là ? Quel est le gredin qui se permet de troubler le sommeil de ma seigneurie ?
– Silence, fit Oscar. Vous êtes lord Burydan ?
– Parbleu, oui, mais…
– Silence, vous dis-je ; je viens de la part de M. Agénor Marmousier.
L’excentrique lord eut peine à retenir un cri de joie :
– Ce cher Agénor ! s’écria-t-il, il est vivant ! Comme je suis heureux qu’il ait échappé au naufrage !
– Ne criez pas si fort. Je suis envoyé par votre ami pour vous délivrer ; mais soyez prudent et ne manifestez aucun étonnement du bizarre costume dont vous me verrez revêtu.
– Bon, je suis tout oreilles.
– Passez la main entre les deux barreaux de l’ouverture grillée qui est au bout de la porte. Je vous donne trois objets : une lime, un tournevis et une lampe électrique ; avec cela, vous pouvez être libre dans dix minutes.
Le noble lord ne se fit pas répéter cette invitation. Oscar entendit grincer le tournevis, bientôt la serrure tomba et la porte s’ouvrit.
Les deux amis de fraîche date échangèrent une cordiale poignée de main, puis ils se mirent à la recherche de la cellule de Kloum qui fut délivré de la même manière.
– Maintenant, dit Oscar, il ne nous reste plus qu’à passer par-dessus les murs ou à franchir la grille.
– C’est que, dit lord Burydan, la muraille a dix-huit pieds de haut et je souffre encore d’une blessure à la jambe. Il me semble préférable de s’emparer des clefs que le surveillant porte toujours à sa ceinture. Je sais déjà que la petite porte du jardin aboutit à une ruelle déserte. C’est la clef de cette porte qu’il nous faudrait.
– Il faut faire venir ici le surveillant.
– Comment ?
– En poussant des hurlements féroces et en allumant votre lampe électrique.
Ce stratagème eut un plein succès. Au bout de dix minutes de cris accompagnés d’illuminations, les fugitifs entendirent une clef grincer dans la serrure de la porte de la cour. Aussitôt, ils éteignirent leur lanterne et se tapirent dans un angle obscur. Un surveillant – mais ce n’était pas le gardien en chef – passa devant eux sans les voir. Dès qu’il les eut dépassés, l’impassible et silencieux Kloum lui sauta à la gorge, le bâillonna avec son mouchoir et le ficela soigneusement. Cela fait, l’homme fut jeté dans la cellule qu’avait occupée Oscar. La lanterne électrique fut rallumée et les vociférations recommencèrent. Le truc était décidément excellent, car un second gardien fut capturé de la même manière, puis un troisième qui était venu à la recherche des deux autres. Enfin, ce fut le tour du surveillant-chef qui, après une courte lutte, alla rejoindre ses collègues dans le cabanon.
Kloum prit les clefs que ce fonctionnaire portait à la ceinture, pendant qu’Oscar s’écriait joyeusement :
– Je crois que l’affaire est dans le sac. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à filer.
– Une minute, dit lord Burydan. Je ne veux pas que le passage dans cet établissement de celui qu’on a surnommé le « lord excentrique » ne soit pas signalé par quelque haut fait. Je ne m’en vais pas d’ici sans avoir offert un joyeux souper à mes collègues, messieurs les aliénés.
Oscar voulut faire quelques timides objections, mais lord Burydan lui coupa la parole et lui démontra clair comme le jour qu’un pareil repas était d’autant plus indispensable que les malheureux aliénés mouraient à peu près de faim, réduits qu’ils étaient, depuis quelques semaines, au régime de la charcuterie et des conserves avariées.
L’occupation méthodique de l’établissement par les trois conspirateurs continua et, tout d’abord, on s’empara de la loge du concierge qui, surpris dans son premier sommeil aux côtés de sa femme, fut promptement mis hors d’état de nuire.
La menace du revolver que portait Oscar et les poings solides de lord Burydan eurent vite raison des autres gardiens cernés dans le logement qu’ils occupaient, et Kloum, sortant tranquillement par la grille principale, sauta dans un taxi en jetant au chauffeur l’adresse d’un restaurant ouvert toute la nuit. Il était de retour une demi-heure après avec les éléments d’un pantagruélique souper : jambons roses comme les joues pudiques des jeunes misses, andouilles phénoménales, savoureux rosbifs, volailles truffées, sans compter plusieurs paniers de vins de divers crus où le champagne n’était pas oublié.
Pendant que le Peau-Rouge remplissait ainsi les fonctions d’officier de bouche, lord Burydan et Oscar ouvraient une à une les portes des dortoirs et annonçaient que, par extraordinaire, l’honorable Mr. Palmers, ayant touché la forte cote, offrait à tous les pensionnaires un joyeux réveillon.
Cette nouvelle suscita un réel enthousiasme. En un clin d’œil tout le monde fut sur pied ; l’électricité fut allumée dans tous les corps de bâtiment, puis le domicile particulier de Mr. Palmers fut envahi et c’est là que l’on prit les serviettes, les nappes damassées, les cristaux et les porcelaines jugés indispensables à la solennité du festin. Les folles mirent le couvert, chacun prit place à table, et bientôt la réunion présenta le spectacle le plus vif et le plus animé.
À la grande surprise de lord Burydan, qui s’en donnait à cœur joie, les convives, à part quelques éclats de rire trop perçants, quelques répliques un peu trop vives, conservaient un décorum parfait. Les hommes offraient à boire à leurs voisines et leur passaient les plats avec une politesse exquise ; on se fût cru dans la salle d’une table d’hôte ordinaire ; mais à mesure que les fumées du vin montaient à ces cerveaux déséquilibrés, des changements se produisirent dans l’attitude des invités.
On n’était pas arrivé au dessert que l’homme-chat sautait sur la table, faisait le gros dos en exécutant toute une gamme de miaulements les plus réjouissants du monde. L’homme-automobile, qui se promenait toute la journée emmailloté de pneumatiques, réclamait à grands cris du benzonaphtol. On lui fit avaler un siphon d’eau de Seltz et il déclara qu’il avait son plein d’essence et qu’il allait bientôt partir. Une grosse dame, qui se croyait changée en gigot de mouton, offrait un couteau et une fourchette à ses voisins pour leur permettre de goûter un morceau de son épaule dodue. Quelques charitables folles, songeant aux blessés de la guerre balkanique, transformaient activement en charpie la nappe et les serviettes damassées de Mr. Palmers.
Quelques-uns chantaient des cantiques et d’autres des chansons à boire. La bacchanale était devenue indescriptible. On cassait la vaisselle pour s’amuser et l’on jetait les bouteilles vides par les fenêtres. Quelqu’un proposait d’organiser un bal lorsque, tout à coup, l’honorable Mr. Palmers, qui était rentré tranquillement par la petite porte de la grille dont il avait la clef et que l’illumination de son établissement à une heure pareille remplissait d’étonnement, parut à la porte de la salle du festin. En présence de cet étonnant spectacle, ses yeux s’arrondirent et son visage exprima la stupeur la plus complète ; mais bientôt, il reconnut les lambeaux de son linge de table déchiqueté et les débris de ses assiettes et de ses couverts. Il poussa un cri de rage et sa figure devint écarlate.
– Vive Mr. Palmers ! criaient les convives avec enthousiasme.
– Canailles !… fripouilles !… bandits !… rugit-il en tirant son browning, vous me paierez cela !
Et tout en menaçant les fous de son revolver, il cherchait à faire retraite du côté de la porte.
Il n’en eut pas la possibilité. Sur un signe de lord Burydan, Kloum l’avait saisi par le poignet et l’avait désarmé. Il continuait à proférer de terribles menaces, mais les fous l’entouraient en hurlant et exécutaient autour de lui une sarabande échevelée.
– C’est ce misérable qui ne nous fait manger que des harengs marinés et de la charcuterie !
– Il faut le pendre !
– Le faire rôtir avec des pommes de terre autour !
– Le goudronner et l’emplumer !
– Oui, c’est cela ! appuyèrent une dizaine de voix.
Et aussitôt, on alla chercher à la cave un baril de goudron et au dortoir tout ce qu’on put trouver d’édredons et d’oreillers de plumes, et Mr. Palmers, déshabillé malgré ses supplications, fut soigneusement goudronné et emplumé. On eût dit un poulet échappé par miracle au cuisinier en train de l’apprêter. Son aspect était si piteusement comique que tous les fous éclatèrent d’un rire effrayant.
– Il faut, proposa quelqu’un, emplumer les gardiens.
Cette proposition fut vivement applaudie et tout le monde se dirigea précipitamment du côté des cellules. Il ne demeura dans la salle que lord Burydan, le Peau-Rouge, Oscar et un aliéné triste, timide et vêtu de noir, qui se dissimulait derrière les doubles rideaux des fenêtres.
– En voilà assez, maintenant, dit lord Burydan, filons !
– Oui, approuva Oscar, le moment est propice.
Et tous trois rasant les murs se dirigèrent du côté des jardins. Ils ne s’aperçurent pas que le fou aux vêtements noirs les suivait lentement à une trentaine de pas en arrière.
Le lendemain du soir qui avait vu se dérouler ces mémorables événements, Agénor fut un peu surpris de ne pas recevoir de nouvelles d’Oscar, mais il ne s’en inquiéta pas outre mesure. Il pensa que le bossu s’était trouvé dans l’impossibilité d’écrire et qu’il aurait sans doute une lettre le jour suivant ; d’ailleurs, l’attention du poète fut retenue par Fred Jorgell et miss Isidora, revenus en compagnie des Français plus tôt qu’ils ne l’avaient annoncé.
Ce matin-là, d’ailleurs, miss Isidora trouva dans son courrier une lettre arrivée déjà depuis deux jours et dont la teneur lui causa quelque inquiétude. Elle était signée Rugby, le surveillant en chef du Lunatic-Asylum. Il y disait en substance que l’établissement, depuis la dernière visite de la jeune fille, allait de mal en pis. Il n’y avait plus ni organisation ni discipline ; bien plus, le directeur, Mr. Palmers, jouant aux courses tout l’argent qu’il pouvait rassembler, ne payait plus ses fournisseurs. Malades et gardiens étaient affreusement mal nourris, quand ils l’étaient. Le Lunatic-Asylum était devenu une vraie pétaudière et des catastrophes étaient à prévoir. Il considérait de son devoir, lui, Rugby, de prévenir de cet état de choses l’honorable miss Jorgell, pour qu’elle prît telles mesures qu’il conviendrait et il déclarait en terminant qu’il espérait que la jeune fille lui serait reconnaissante de sa vigilance et de son dévouement.
Cette lettre alarma tellement Isidora qu’aussitôt après son déjeuner elle se rendit à Greenaway en compagnie de Frédérique qui avait bien voulu consentir à l’accompagner.
Mais elles ne purent pénétrer dans l’établissement. Les grilles étaient fermées et barricadées intérieurement. Elles n’aperçurent aucun surveillant. Du haut des murailles où ils étaient juchés, des aliénés leur faisaient des signes menaçants.
Elles s’enfuirent épouvantées jusqu’au premier poste de policemen auxquels elles racontèrent ce qu’elles venaient de voir. Le chef du poste, sachant qu’il avait affaire à la fille du milliardaire Fred Jorgell, se hâta d’obtempérer à sa demande et envoya douze hommes accompagnés d’un serrurier. La grille fut forcée et les policemen pénétrèrent dans l’intérieur de rétablissement.
Tout d’abord, ils aperçurent Mr. Palmers et les gardiens qui, vêtus seulement de leur plumage improvisé, avaient cherché un refuge dans les arbres de l’avenue. On recueillit ces malheureux pour leur procurer les soins que nécessitait leur état.
Il fallut plusieurs heures pour faire le siège des bâtiments où les fous s’étaient retranchés et ce ne fut qu’à grand-peine qu’ils purent être réintégrés dans leurs cellules. Mais en dépit de toutes les perquisitions, on ne retrouva ni l’excentrique lord Burydan, ni Kloum le Peau-Rouge, ni Baruch Jorgell, pas plus d’ailleurs que l’homme-singe dont on ignorait le nom et qui devait certainement avoir été l’un des principaux instigateurs de la révolte.
HUITIÈME ÉPISODE
L’automobile fantôme
CHAPITRE PREMIER
Mr. Steffel n’est pas content
Mr. Steffel, le chef de la police de New York, était ce jour-là de fort mauvaise humeur. Il arpentait d’un pas saccadé son luxueux cabinet de travail en brandissant un rapport qu’il venait de recevoir et qui émanait du chef de poste de Greenaway.
– Vraiment, s’écria-t-il tout haut, c’est à ne plus savoir où donner de la tête. Je suis débordé. Il me faudrait un personnel deux fois plus considérable ! Il n’y a pas de jour que les journaux ne me tournent en plaisanterie au sujet de cette fameuse association de la Main Rouge !…
Et il ajouta en froissant nerveusement le rapport qu’il tenait entre les mains :
– Comment diable veut-on que je détruise les bandits de la Main Rouge ? Ils sont mieux organisés que la police. Il y a des moments où je suis, ma foi, tenté de le croire ! Sans compter que, dans mon administration, il y a pas mal de fonctionnaires, grands et petits, qui sont à la solde des bandits ! Vraiment, c’est décourageant. Il y a des jours où, ma foi, j’ai envie de donner ma démission !
Mr. Steffel déposa le rapport, dont la lecture l’avait tant irrité, parmi les paperasses qui encombraient son bureau, mais sa mauvaise humeur n’avait pas fini de s’exhaler.
Il ne manquait plus que cette révolte de fous au Lunatic-Asylum pour compléter la série !
Le chef de la police sonna.
– Qu’on fasse venir l’agent Grogmann, dit-il au garçon de bureau qui était accouru.
Une minute après, un personnage à la mine rubiconde, aux longues moustaches rousses, et au ventre bedonnant, fit son entrée dans le cabinet directorial. Un sourire naïf s’épanouissait sur sa physionomie débonnaire.
– Alors, dit Mr. Steffel d’un air impatienté, vous avez assisté au siège du Lunatic-Asylum ? Vous pouvez me donner des détails précis ?
– Oui, monsieur le directeur. Et il a fallu déployer une véritable bravoure, faire le siège de chaque corps de bâtiment. Les fous nous ont jeté toutes sortes d’objets sur la tête : des traversins, des pommes de terre pourries et jusqu’à des marmites, des vases de nuit et de vieux souliers.
– Je ne vous demande pas cela ! s’écria Mr. Steffel en haussant les épaules, vous avez l’air tout fier d’avoir reçu de vieux godillots et des vases de nuit sur le nez ; il n’y a pas de quoi s’en vanter. Dites-moi plutôt le nombre exact des évadés et leur signalement.
– Ils ne sont que quatre.
– Vous trouvez que ce n’est pas assez, sans doute ; continuez…
– Il y a d’abord le prétendu lord Burydan et Kloum, son domestique peau-rouge ; puis un inconnu qui s’est présenté la veille habillé en singe.
– Un inconnu ? Mr. Palmers n’a donc pas noté son nom et son âge ainsi que les règlements l’y obligent.
– Non, monsieur le directeur.
– C’est bon ! Mr. Palmers sera mis à l’amende. Il faudra le convoquer à mon bureau sitôt qu’il aura été suffisamment savonné et qu’il sera débarrassé des plumes et du goudron dont il est enduit. Mais quel est le quatrième évadé ?
– C’est le fameux Baruch Jorgell, l’assassin milliardaire.
Le visage de Mr. Steffel peignit la consternation.
– Voilà qui est très ennuyeux, murmura-t-il. Les journaux vont faire un beau tapage. Et si je ne repince pas ce gredin dans les vingt-quatre heures, on ne va pas manquer de dire que j’ai touché la forte somme pour le laisser évader.
– Cela ne sera peut-être pas si commode que ça de le rattraper, dit tranquillement l’agent Grogmann.
– Parbleu oui, vous, cela vous est égal ! s’écria Mr. Steffel exaspéré. Ce n’est pas vous qui êtes responsable ! Mais je veux qu’ils soient retrouvés tous les quatre aujourd’hui même ! Vous entendez ? Et c’est vous que je vais charger de cette quadruple arrestation et que je rendrai responsable !
– Mais, monsieur le directeur…
– Taisez-vous. Possédez-vous seulement le signalement des évadés ?
– C’est que…, balbutia l’agent Grogmann d’une voix hésitante.
– Quoi ?… Allons, parlez donc !
– Le signalement de Baruch Jorgell doit certainement se trouver dans son ancien dossier. Quant à celui du fou qui portait un déguisement de singe, je ne l’ai pas. Et celui des deux autres non plus. Je sais seulement que Kloum est Peau-Rouge et que le faux lord Burydan est un homme blanc…
– Nous voilà bien avancés ! s’écria Mr. Steffel en donnant, de colère, un coup de poing sur la table. Autant dire tout de suite que vous ne possédez aucun renseignement ! D’autant plus que Baruch lui-même a, dit-on, beaucoup changé, beaucoup vieilli depuis son internement !
Mr. Steffel fut interrompu par l’arrivée du garçon de bureau qui lui apportait une demi-douzaine de lettres et de télégrammes.
– Donnez, fit-il nerveusement.
Tout de suite, il décacheta une grande enveloppe fermée d’un cachet rouge, mais le contenu de ce pli était sans doute satisfaisant, car à mesure qu’il lisait sa physionomie se détendait. Et quand il eut achevé la missive, qui ne portait ni date ni signature et qui était écrite à la machine, il poussa un soupir de satisfaction.
– Allons, murmura-t-il, voici heureusement une dénonciation anonyme qui va nous éviter bien des démarches inutiles.
Et il relut, mais cette fois à voix haute :
« Les quatre aliénés qui se sont échappés du Lunatic-Asylum ont trouvé un refuge dans un cabaret de la banlieue de New York, qui n’est guère fréquenté que par les Indiens et les métis : la buvette du Grand Wigwam, à Tampton. C’est le Peau-Rouge Kloum qui a conduit dans cet endroit ses compagnons de fuite. Si la police prend bien ses mesures et surtout si elle ne perd pas de temps, elle mettra la main sur eux sans coup férir. »
– Certainement que je ne perdrai pas de temps, fit Mr. Steffel en se frottant les mains. Grogmann, vous allez prendre deux escouades d’agents et partir immédiatement. Pendant ce temps, je téléphonerai au poste de Tampton pour que deux ou trois escouades se mettent en marche de façon à cerner cette buvette du Grand Wigwam, que je connais d’ailleurs parfaitement. Elle est notée comme un repaire de rôdeurs indiens, d’ivrognes et de mauvais drôles de toute espèce.
Mr. Steffel n’eut pas un seul instant de doute sur l’exactitude du renseignement qui lui parvenait si à point dans ce billet anonyme. L’habitude qu’il avait de ces sortes de dénonciations lui avait permis de se rendre compte, d’un coup d’œil, que celle-là disait bien la vérité.
Mais, par exemple, le chef de la police eût été fortement étonné s’il avait pu deviner que c’étaient les Lords de la Main Rouge eux-mêmes qui le renseignaient gracieusement. C’était, en effet, de Cornélius qu’émanait le billet. Le diabolique docteur avait pensé que le meilleur moyen d’avoir sous la main les quatre personnages dont il redoutait tant les révélations était de leur faire réintégrer le Lunatic-Asylum où il les savait à sa merci.
Aussitôt que Grogmann se fut retiré pour exécuter l’ordre qu’il venait de recevoir, Mr. Steffel saisit le récepteur du téléphone placé sur sa table et demanda la communication avec le chef du poste de police du village de Tampton ; mais à ce moment le garçon de bureau lui remit une carte de visite ainsi libellée :
AGÉNOR MARMOUSIER
Secrétaire particulier de Mr. Fred Jorgell
– Faites entrer, dit immédiatement Mr. Steffel ; et, se composant une physionomie à la fois digne et souriante, il salua le représentant du milliardaire et lui désigna courtoisement un fauteuil.
– Monsieur le directeur, dit Agénor après avoir échangé avec le haut fonctionnaire les politesses d’usage, je viens au sujet de la révolte dont le Lunatic-Asylum de Greenaway a été cette nuit le théâtre…
– Et vous n’ignorez pas, sans doute, interrompit Steffel, que le fils de Mr. Fred Jorgell est un des quatre fugitifs qui ont réussi à franchir les murailles de l’établissement.
– C’est précisément à cause de lui que je viens, et tout d’abord je vais vous dire que ce n’est pas le père du dément qui m’envoie : il a maudit une fois pour toutes le fils indigne et il ne veut plus entendre parler de lui sous quelque prétexte que ce soit.
– De la part de qui venez-vous donc ? demanda le chef de la police avec étonnement.
– De la part de miss Isidora, la sœur de Baruch. Plus pitoyable que le milliardaire envers le fou assassin, elle tremble que ce misérable, perdu dans New York et ne possédant pas sa raison, ne soit victime de quelque accident, et elle vous supplie instamment de le faire rechercher et de le réintégrer sans violence dans l’établissement où il reçoit les soins nécessaires à son état. Voici d’ailleurs, ajouta le poète en déposant un petit portefeuille sur le bureau, quelques bank-notes de cent dollars chacune pour stimuler le zèle de vos agents.
Mr. Steffel jeta négligemment le portefeuille dans un des tiroirs de son bureau.
– Merci pour mes hommes, de la part de la charmante miss, dit-il, mais cette prime n’était pas nécessaire…
Le directeur de la police fut interrompu par la vibration sonore du téléphone.
– Une minute, cher monsieur, dit-il à Agénor, vous permettez ?… Et prenant en main le récepteur qu’il avait quitté lorsque son visiteur était entré :
– Allô ! cria-t-il.
– C’est vous ?… le chef du poste de Tampton ?
– …
– Ah ! parfaitement. Il s’agit de faire cerner par vos hommes, et cela sans perdre un instant, un repaire d’Indiens et de métis que je vous ai d’ailleurs donné ordre de surveiller ! C’est la buvette du Grand Wigwam…
– Oui, je sais. C’est là qu’ils sont tous les quatre. Deux escouades sont déjà parties qui arriveront dans la direction du sud. Que vos escouades à vous se portent dans la direction nord et ne laissent passer personne ! Vous pourrez opérer l’arrestation à la nuit tombante…
– …
– Alors, je compte sur vous. Ces arrestations, surtout celles de Baruch Jorgell et de lord Burydan, sont très importantes !
Mr. Steffel raccrocha le récepteur et, se tournant avec son sourire le plus aimable vers Agénor qui était devenu pâle en entendant ce lambeau de conversation dont il n’avait pas perdu un seul mot :
– Je vous disais donc, cher monsieur, reprit-il, qu’il était absolument inutile que miss Isidora offrît une prime à mes agents. Nous savons d’ores et déjà où se trouvent les évadés du Lunatic-Asylum. J’ai envoyé des hommes pour procéder à leur arrestation. Toutes nos mesures sont prises. Vous pouvez rassurer miss Isidora et lui dire que son malheureux frère sera traité avec tous les égards possibles et réintégré sans violence dans la maison de santé où il est en traitement.
Agénor se hâta de prendre congé du haut fonctionnaire et sitôt qu’il fut sorti des bâtiments de la police, il sauta dans un cab, promit cinq dollars au cocher en lui jetant l’adresse de la buvette du Grand Wigwam dans le village de Tampton.
– Pourvu que j’arrive à temps, répétait-il en jetant de minute en minute des coups d’œil impatients sur sa montre.
Pendant une demi-heure, le cab attelé d’un vigoureux cheval du Far West fila au grand galop à travers les mornes paysages de brique et de plâtras de la banlieue new-yorkaise. On était arrivé au haut d’une montée lorsque Agénor vit, à cinq cents mètres en avant de lui, une demi-douzaine de policemen qui s’avançaient d’un pas tranquille, sous la conduite d’un sergent qui n’était autre que le jovial Grogmann.
Le poète réfléchit un instant. Il apercevait tout à fait dans le lointain un amas de cahutes sordides qui ressemblaient plus à des tanières de romanichels qu’à la demeure d’honnêtes citoyens yankees.
– Arrêtez ! cria-t-il au cocher ; sommes-nous bientôt à Tampton ?
– Mais nous y sommes depuis quelques minutes.
– Et ces masures, là-bas, ne serait-ce pas la buvette du Grand Wigwam ?
– Mais oui, nous allons y arriver.
– Alors, c’est bien, je n’ai plus besoin de vos services !
Agénor descendit, paya le cocher et se mit à marcher à grandes enjambées sur la route déserte.
Il n’eut pas de peine à dépasser le petit groupe des policemen qui continuaient à avancer avec un flegme tout britannique, comme des gens qui sont sûrs, quoi qu’il arrive, de toucher leurs appointements à la fin du mois. La présence d’Agénor ne parut nullement suspecte à Grogmann, car il l’avait précisément aperçu au moment où il sortait du Police-Office.
L’honnête sergent pensa que ce monsieur si bien mis qui suivait le même chemin que lui était sans doute un agent supérieur de l’administration, chargé par Mr. Steffel d’assister en personne à l’arrestation des quatre dangereux aliénés.
CHAPITRE II
La buvette du Grand Wigwam
Quand on avait franchi une porte verrouillée faite de planches arrachées à des caisses d’emballage et à laquelle des morceaux de cuir servaient de gonds, on se trouvait dans une salle longue, basse et enfumée, où la vue et l’odorat étaient aussi désagréablement affectés l’un que l’autre ; il régnait là une infâme odeur de poisson fumé, mêlée à des relents de mauvais alcool et de graisse rance ; la fumée des pipes compliquée de celle du foyer s’échappait par un trou pratiqué dans la toiture après avoir saturé toute l’atmosphère de la pièce en formant un brouillard tellement épais qu’on ne se voyait pas à trois pas.
Lorsque le regard s’était accoutumé à ces ténèbres, on distinguait, accrochées au mur, des panoplies barbares qui avaient dû appartenir autrefois à quelque chef redouté. Il y avait des couronnes de plumes d’aigle, des colliers faits avec les dents du puma ou les griffes de l’ours gris, des arcs, des flèches, des tomahawks, mêlés à des mocassins de peau de daim, à des bracelets de graines et de verroteries. On voyait encore des couteaux à scalper, une ou deux carabines d’ancien modèle, des pistolets à pierre, des bois d’élan et de renne, et tout un arsenal de petits sacs brodés pour mettre le tabac, et de calumets, dont quelques-uns, les plus anciens, étaient formés d’une pierre creusée et emmanchés d’un roseau.
En outre de ces panoplies qui recouvraient entièrement les murailles, le mobilier se composait de quelques escabeaux boiteux, de nattes de paille de maïs et d’une étagère qui supportait une douzaine de bouteilles de whisky.
Tel était l’étrange repaire connu dans le pays sous le nom de buvette du Grand Wigwam. C’est là que, de deux lieues à la ronde, se réunissaient les Indiens pour converser des choses de leur race et surtout pour boire de l’« eau de feu » jusqu’à ce qu’ils restassent morts sur la place.
La propriétaire de cet établissement unique en son genre était une vieille « squaw » aussi sèche, aussi noire et aussi ratatinée qu’une momie. Elle se tenait généralement accroupie devant l’âtre et fumait sans répit une vieille pipe de terre noire qu’on lui connaissait depuis des années. Les familiers de la maison prétendaient même que c’était à cette atmosphère fuligineuse qu’elle devait sa grande longévité et ils affirmaient qu’elle ne mourrait jamais, conservée qu’elle était par la fumée, à la façon des harengs saurs et des jambons.
Les deux filles de cette vénérable matrone, deux grandes créatures à la peau rouge, aux cheveux bleuâtres, au nez plat et aux dents longues, servaient les buveurs et, disait-on, étaient pour beaucoup dans la prospérité de l’établissement.
La directrice de la buvette du Grand Wigwam étant cousine de Kloum au huitième degré, celui-ci avait eu l’idée d’emmener ses amis dans ce repaire où ils avaient les plus grandes chances de n’être pas découverts. En quittant le Lunatic-Asylum, ils s’étaient donc rendus à Tampton.
Ils y étaient arrivés au petit jour, très fatigués tous les quatre par la nuit blanche qu’ils avaient passée et par toutes les émotions qu’ils avaient dû traverser. Ce n’est qu’une fois sortis de la maison de fous que lord Burydan s’était aperçu qu’un quatrième pensionnaire de l’établissement s’était attaché à leur suite.
– Qu’allons-nous faire de lui ? avait demandé Oscar, qui ne reconnaissait nullement dans le nouveau venu le Baruch qu’il avait connu chez M. de Maubreuil, tant la captivité et la nature avaient déjà altéré l’œuvre du sculpteur de chair humaine.
– Ma foi, je ne sais pas, avait dit lord Burydan.
Kloum, plus catégorique, avait déclaré qu’il fallait se débarrasser à tout prix de ce gêneur et, d’un geste impérieux et bref, il avait intimé au dément l’ordre de quitter la place au plus vite.
C’est alors que le pseudo-Baruch s’était jeté aux genoux de lord Burydan en joignant les mains d’une façon tellement suppliante que l’excentrique avait été profondément apitoyé.
– Ce pauvre diable a l’air inoffensif, avait-il dit ; gardons-le provisoirement, plus tard, nous verrons.
L’aliéné, comme un chien perdu qui s’attache aux pas du premier passant sympathique, s’était mis à marcher docilement derrière ses compagnons.
À peu de distance du Lunatic-Asylum, les fugitifs avaient eu la chance de rencontrer un cab, et le « cabman » s’était figuré, en voyant le déguisement de singe dont Oscar était revêtu, qu’il avait affaire à des gens revenant de quelque mascarade et les avait laissés monter dans son véhicule sans observation. C’est de cette façon qu’ils avaient gagné le village de Tampton ; mais ils avaient eu la prudence de descendre à quelque distance de la buvette du Grand Wigwam pour qu’on ne sût pas où ils se rendaient.
Kloum et ses amis avaient été chaleureusement accueillis par la vieille squaw et ses filles, et là Oscar avait pu se débarrasser de son costume de singe qu’il avait accroché à la muraille où il faisait bonne figure à côté des peaux de grizzly et des panoplies barbares. Le bossu avait revêtu un complet de toile bleue que lui avaient cédé les Indiennes et qu’avaient laissé là des Peaux-Rouges qui travaillaient à une carrière du voisinage.
– La première chose que nous ayons à faire, déclara lord Burydan, c’est de nous reposer. Nous pouvons demeurer ici toute la journée ; je pense que personne n’aura l’idée de venir nous y chercher. Quand il fera nuit, nous sortirons.
La vieille Indienne, mise au courant de cette décision par Kloum, fit passer les quatre amis dans un cabinet obscur attenant à la pièce principale, dont il n’était séparé que par une portière faite d’une couverture de laine de couleur voyante. Les fugitifs se jetèrent sur les nattes dont le logis était meublé et ne tardèrent pas à tomber dans un profond sommeil.
Ce fut Kloum qui se réveilla le premier. Il ronflait encore à poings fermés lorsqu’un singulier picotement derrière la tête l’arracha à ses rêves. C’était une des Indiennes qui, suivant une ruse des gens de sa race, le chatouillait doucement au-dessous de l’oreille.
Kloum ouvrit les yeux, sans avoir fait le moindre bruit, sans avoir prononcé une parole ; il vit devant lui l’une des deux sœurs qui, mettant un doigt sur ses lèvres, lui faisait signe de regarder avec précaution dans la grande pièce.
Le Peau-Rouge écarta doucement la couverture qui tenait lieu de portière et, à quelque distance d’un groupe de carriers indiens occupés à lamper à petits coups une bouteille d’eau de feu, il aperçut Agénor en train de parlementer, non sans force cris et gesticulations, avec la vieille squaw toujours impassible, la pipe aux dents, au coin de son âtre.
Tout de suite, il poussa un cri de joie et réveilla lord Burydan et les autres dormeurs. L’instant d’après, le lord excentrique et son ami se jetaient en pleurant dans les bras l’un de l’autre.
– Mon cher Agénor ! comme je suis heureux de vous retrouver !
– Et moi qui pleurais votre mort !
– Moi aussi, je me figurais que vous aviez péri dans le naufrage de la Ville-de-Frisco ! Mais maintenant, j’espère que nos ennuis sont terminés !
– Hélas, non ! répliqua Agénor brusquement devenu grave, ne perdons pas de temps en effusions inutiles car vous êtes sérieusement menacés et c’est pour cela que je suis ici.
– Qu’y a-t-il encore ? demanda Oscar Tournesol.
– La maison est cernée par les policemen qui, je ne sais comment, ont appris votre retraite. Dans un quart d’heure, ils seront ici !
– Diable ! murmura lord Burydan d’un air mécontent, c’est que je ne tiens nullement, moi, à retourner en prison ou dans une maison de fous !
– Il faut aviser, et rapidement, murmura Agénor ; mais tout d’abord, je vous rends vos papiers que j’ai pu sauver du naufrage. Ils sont dans ce portefeuille où j’ai aussi, en cas de besoin, glissé quelques bank-notes.
Pendant ce temps, Kloum parlementait avec les Indiens occupés à boire du whisky. Au bout de quelques minutes, l’un d’entre eux, le plus leste, se hissa à la force du poignet par le trou qui tenait lieu de cheminée et grimpa sur le toit. Il ne tarda pas à redescendre, la mine consternée.
– Quatre troupes de policemen, expliqua-t-il en comptant sur ses doigts. Ils occupent toutes les routes qui aboutissent au Grand Wigwam.
– Nom d’un chien ! s’écria Oscar, comment va-t-on faire ?
– Ma foi, je ne vois pas trop, répliqua lord Burydan. Nous ne sommes ni assez nombreux ni assez bien armés pour faire une trouée.
Il y eut quelques minutes de réelle angoisse. De quelque côté qu’on se tournât, la fuite était impossible ; et les policemen, de minute en minute plus distincts, approchaient avec l’implacable lenteur du Destin.
Tout à coup, Kloum eut un rire silencieux, et du doigt il montra, en face de la porte du Wigwam, trois ou quatre wagonnets que les carriers indiens avaient laissés là pendant qu’ils entraient se désaltérer.
Tous avaient compris. Il s’agissait simplement pour les évadés de se cacher dans l’intérieur des petits véhicules et de passer ainsi au nez et à la barbe de messieurs les policemen.
Mais il n’y avait pas une minute à perdre, et, tout d’abord, il fallait décider les carriers à prêter la main à cette évasion. L’éloquence de Kloum, appuyée de quelques dollars, obtint sans peine ce résultat.
Agénor serra en hâte la main de ses amis.
– Surtout, recommanda-t-il à lord Burydan, ne manquez pas de m’écrire et de m’indiquer votre retraite.
– Je n’y manquerai pas, d’autant plus que j’ai des révélations à vous faire.
– Oui, dit Oscar, nous savons où est M. Bondonnat. Lord Burydan a été son compagnon de captivité.
– Et où est-il ?
– À l’île des pendus.
– Qu’est-ce que c’est que cette île-là ?
– Je n’ai pas le temps de vous l’expliquer. Ma prochaine lettre vous racontera tout cela dans le plus grand détail…
Une dernière poignée de main fut échangée, puis l’excentrique lord et Oscar s’étendirent au fond du premier wagonnet pendant que Kloum et leur compagnon, toujours muet et docile, prenaient place dans le second.
Les deux Indiennes couvrirent le corps des fugitifs de vieilles couvertures par-dessus lesquelles les carriers jetèrent quelques pelletées de sable, en assez grande quantité pour faire illusion, pas assez pour empêcher l’air de pénétrer.
Ces préparatifs terminés, les Indiens se mirent à pousser les wagonnets sur les rails, de la nonchalante allure qui leur était habituelle, en marchant à la rencontre de l’escouade que commandait l’honnête Grogmann. L’attitude flegmatique des Peaux-Rouges en imposa complètement au policier. Il n’eut pas le moindre soupçon. Il continua à marcher du même pas majestueux à la tête de ses hommes dans la direction de la buvette du Grand Wigwam.
Il y arriva au moment même où Agénor en sortait et, toujours persuadé que le poète était un haut fonctionnaire de la police :
– Vous les avez vus ? lui demanda-t-il.
– Non, répondit Agénor en secouant la tête. Les oiseaux sont envolés !
– Diable ! Tant pis ! Mais je vais toujours perquisitionner. Ces Peaux-Rouges ont des ruses diaboliques et nos fous peuvent être cachés dans quelque cave ou dans quelque soupente.
– Oui, c’est cela, perquisitionnez bien, dit à tout hasard le poète en reprenant le chemin de New York sans que personne s’y opposât.
Les policiers remuèrent vainement les loques sordides qui composaient le mobilier de la buvette et ne découvrirent rien.
Pendant ce temps, les quatre fugitifs étaient arrivés sans encombre jusqu’à la carrière de granit où travaillaient les Indiens et qui se trouvait à cinq cents mètres de là. Ils s’empressèrent de sortir de leurs incommodes véhicules et remercièrent chaleureusement leurs sauveurs.
La nuit venait à grands pas. Désormais, tout danger avait disparu. Ce fut donc sans se presser mais cependant en prenant un sentier qui permettait d’éviter la grand-route qu’Oscar Tournesol et ses amis arrivèrent à la gare de Tampton. Là, lord Burydan, qui avait déjà combiné tout un plan, prit quatre billets de seconde classe à destination de Montréal, car il connaissait parfaitement le Canada où il possédait d’immenses propriétés.
Avant même que le train eût quitté la gare, les quatre fugitifs avaient pris place autour de la table du wagon-restaurant et ils étaient en train de combiner un menu substantiel lorsque tout à coup Oscar poussa un cri de stupeur et demeura bouche bée, les yeux agrandis, les mains tremblantes comme s’il venait d’avoir une vision.
– Qu’y a-t-il donc ? demanda lord Burydan inquiet.
Du doigt Oscar montra sur la route, qui n’était séparée de la voie que par une barrière de bois, une énorme automobile rouge et noir qui venait de stopper. Au volant se tenait, comme auréolé par la clarté éblouissante des phares, un homme à la physionomie énergique et dure ; et, dans l’intérieur, un vieillard à la face glabre, au profil d’oiseau de proie, dont les yeux fascinateurs semblaient scintiller derrière les verres de ses lunettes à branches d’or.
– Voyez, dit le bossu avec une indicible émotion, le jeune homme qui conduit cette auto, eh bien ! c’est le même, j’en suis sûr, qui a participé à l’enlèvement de M. Bondonnat et qui m’a moi-même à demi assommé d’un coup de crosse.
Mais à ce moment, le train s’ébranla et, quelques minutes plus tard, l’auto mystérieuse, l’auto fantôme, comme l’appelait déjà Oscar, avait disparu cachée par un tournant de la voie.
CHAPITRE III
Pour une femme
Le milliardaire Fred Jorgell avait pour principe que, si l’on veut être bien servi, il faut payer largement ses serviteurs ; aussi tous ceux qui l’approchaient, depuis les ingénieurs de la Compagnie des paquebots Éclair jusqu’aux moindres domestiques, étaient-ils magnifiquement appointés. Le concierge même du palais était un véritable personnage et les sommes qu’il touchait chaque année, en y comprenant des bénéfices de divers genres, égalaient les appointements d’un général ou d’un directeur de ministère de notre vieille Europe.
Ce concierge se nommait Edward Edmond et était d’origine irlandaise. Il y avait près de dix ans qu’il était au service de Fred Jorgell, qui n’avait jamais eu contre lui le moindre sujet de plainte et qui le tenait en grande estime. C’était à Edward Edmond qu’était dévolue l’importante fonction de recevoir le nombreux courrier du milliardaire et de trier les lettres. Et il s’en acquittait à la satisfaction générale.
Au physique, Edward Edmond était un gaillard de belle prestance et de mine joviale, ses traits réguliers étaient encadrés de favoris blonds et il y avait dans l’ensemble de sa physionomie une expression de franchise, de santé heureuse et de bonne humeur qui le rendait de prime abord sympathique à tout le monde.
Edward Edmond déclarait lui-même qu’il était le plus heureux des hommes. Il n’avait pas de soucis, son travail n’avait rien d’absorbant, et il plaçait chaque année des sommes assez importantes. Il attendait patiemment que ses économies eussent atteint un certain chiffre qu’il s’était fixé pour se retirer dans son pays et y mener l’existence paisible du rentier.
Brusquement, le caractère de ce serviteur modèle se modifia du tout au tout. Edward Edmond devint mélancolique, distrait. Il ne s’occupa plus de ses fonctions que d’une façon machinale et il cessa de parler du projet d’aller habiter l’Irlande qui faisait autrefois le fond de ses conversations. Il avait suffi d’un événement presque insignifiant pour troubler la béatitude de cette sereine existence.
Un soir, poussé par le désœuvrement, Edward Edmond était entré dans un music-hall presque exclusivement fréquenté par des matelots de toutes les nations ; il se divertit extraordinairement aux grimaces de comiques irlandais vêtus de complets en toile à matelas et grotesquement coiffés de chapeaux hauts de forme en paille. Puis ce fut un chœur de musiciens noirs en habit rouge et vert qui jouèrent du banjo et exécutèrent des danses excentriques. Il y eut encore un homme-serpent qui, à force de s’amincir par des déhanchements gradués, arrivait à entrer dans une énorme carafe de cristal où sa face maquillée apparaissait hideuse comme celle d’un pitre fœtus dans son bocal. Il y eut un tireur canadien au coup d’œil infaillible qui, d’une balle de sa carabine, cassait, à trente mètres, au ras des lèvres, la pipe que fumait paisiblement son associé.
Mais l’assistance réclamait à grand tumulte la célèbre Dorypha, la danseuse espagnole, dont le nom s’étalait en majuscules énormes sur l’affiche. Elle parut : un tonnerre de bravos salua son entrée, puis tout le monde redevint silencieux. Edward Edmond lui-même, à la vue de cette créature, se sentit agité d’un étrange frisson.
Dorypha n’avait pas plus de vingt ans. C’était une gitane blonde aux grands yeux noirs dévorateurs sous le velours de leurs longs cils. Décolletée jusqu’aux pointes roses de ses seins menus, elle portait un corsage très long qui dessinait sa taille de guêpe et faisait valoir les rondeurs de sa croupe presque tangible aux regards sous une courte jupe de soie noire pailletée d’or.
Elle dansa le tango, accompagnée de deux guitares et d’une mandoline qui semblaient gémir d’amour pendant que la jeune femme, voluptueusement renversée, faisant rouler ses hanches, suggérait, par une série de mimiques passionnées, toutes les tortures et tous les délices des étreintes voluptueuses. Tantôt elle feignait de tomber comme une femme qui s’abandonne aux bras de son amant, puis elle se raidissait toute, la chair vibrante, à demi pâmée.
Edward Edmond n’avait jamais éprouvé si foudroyante sensation. Ses yeux ne quittaient pas la grosse rose rouge piquée dans cette chevelure d’un blond roussi par les feux de l’enfer. Sa langue se collait à son palais, ses regards brillaient de luxure. Il pensait qu’un seul baiser de cette femme serait capable de rajeunir les vieillards et de réveiller les morts endormis dans leurs tombeaux.
D’ailleurs, dans toute la salle, les spectateurs haletants déliraient, le cœur bondissant, la cervelle chavirée par la vue de cette sorcière blonde qui semblait résumer en elle tous les piments sucrés de la féminité, toute la douceur et toute la fougue brutale des caresses.
La danse finit au milieu du vacarme des ovations et la señora Dorypha, les seins moites de la fatigue de la danse, descendit rose et souriante pour faire la quête. Elle se faufilait comme une couleuvre entre les groupes, et de son corps ardent s’échappait un affolant parfum d’œillet, de poivre et de praline. Les sous, les piastres, les dollars tombaient dru comme grêle dans le tambour de basque qu’elle tendait avec un sourire ingénu, et elle remerciait gracieusement, presque timidement, ses longs cils noirs pudiquement baissés, tandis que les coins des lèvres rouges, grasses et arquées, se relevaient dans une expression d’une canaillerie décevante qui démentait la fausse candeur du regard.
Edward Edmond donna pour sa part un aigle d’or et il en fut remercié par la plus coquine des œillades. Il sentit à cette minute que cette femme ferait de lui ce qu’elle voudrait, qu’il était à elle tout entier et que rien ne pourrait arracher de son cœur cette passion qui y avait grandi avec une foudroyante rapidité et qui maintenant y était enracinée pour toujours.
Dès lors, il ne quitta plus le music-hall. Il accabla la belle Dorypha de cadeaux, de bouquets, de bijoux, mais, toujours provocante, elle se refusait, non sans un sourire aguicheur, qui, mieux que des paroles, promettait que sa résistance ne serait pas éternelle.
Au bout d’un mois, les économies d’Edward Edmond étaient profondément entamées, mais il avait triomphé. La Dorypha était à lui et quand, un matin, il sortit de la chambre de la danseuse, les reins cassés par une fatigue à la fois douloureuse et voluptueuse, il se regardait comme le plus heureux des hommes.
Quelques semaines passèrent encore. L’Irlandais menait une existence ardente, fiévreuse, qui ne lui laissait ni le temps de penser ni celui de réfléchir, et il fut tout surpris lorsque, à la banque où il avait déposé son avoir, on lui dit un jour qu’il ne restait plus à son actif qu’une somme insignifiante. Il alla conter ce malheur à Dorypha, mais la danseuse l’accueillit avec un éclat de rire gouailleur.
– J’en suis bien fâchée pour toi, lui dit-elle, mais si tu es pauvre, tu ne peux continuer à rester mon amant. J’ai toutes sortes de désirs et toutes sortes de besoins, moi. Il me faut de l’argent, beaucoup d’argent. Ne t’ai-je pas été fidèle jusqu’ici ?… Trouve de l’argent et je continuerai à être pour toi ce que j’étais par le passé… Mais un homme qui n’a pas le pouvoir de satisfaire mes caprices n’est pas digne de m’avoir pour maîtresse.
– C’est bon, murmura l’Irlandais d’un air sombre, j’en aurai, de ce maudit argent !
Ce jour-là il emprunta une centaine de dollars à des amis, se rendit dans un tripot qu’il connaissait, joua et gagna ; mais cette ressource était précaire. Huit jours ne s’étaient pas écoulés que les grecs du tripot, qui d’abord l’avaient laissé faire quelques gains pour l’amorcer, avaient entièrement raflé le peu qu’il possédait encore.
Dorypha ne tenait aucun compte de ses sacrifices. Cet argent, qui coûtait si cher, elle le dépensait en fantaisies, en objets inutiles que très souvent elle jetait dans un coin sans même les avoir regardés. Et elle lui disait de sa voix tranquille :
– Que veux-tu, ce n’est pas de ma faute, à moi, si je suis ainsi faite. Si tu ne peux pas y parvenir, laisse-moi, il ne manque pas d’adorateurs qui voudraient bien être à ta place !
Littéralement ensorcelé, Edward Edmond en était arrivé aux pires expédients. Un jour, ayant affaire dans les appartements de miss Isidora, il vola une bague en diamants oubliée par la jeune fille dans une coupe. Quelques heures après, il vendait le bijou à un receleur pour cinq cents dollars, le quart de sa valeur. Muni de cet argent, il se rendit au tripot, se persuadant à lui-même qu’il gagnerait la forte somme et qu’il pourrait racheter la bague.
Mais en franchissant le seuil de la longue salle où des aigrefins de toutes les nations jouaient au baccara, au bridge et à l’écarté dans un tumulte de vociférations, d’éclats de rire et d’injures, il se sentit atteint d’un funeste pressentiment. Il s’assit néanmoins à une table de jeu et tout aussitôt les grecs ou, comme on dit en Amérique, les « gamblers » papillonnèrent autour de ses bank-notes. Deux heures ne s’étaient pas écoulées qu’il avait perdu non seulement ses cinq cents dollars, mais encore cent dollars sur parole. Il était désespéré.
– Je suis fini, songea-t-il, déshonoré, il ne me reste plus qu’à me faire sauter la cervelle.
Il prit dans sa poche la photographie de Dorypha pour la regarder encore une fois, furtivement, dans un coin, puis s’assurant que son browning était bien dans la poche de son pardessus, il se faufila dans les couloirs qui aboutissaient à un morne petit jardin situé derrière la salle de jeu. Il était calme maintenant comme un homme dont la résolution est prise. L’air glacé de la nuit rafraîchit délicieusement son front brûlant, et il écoutait comme dans un rêve la voix lointaine des joueurs, qui lui semblait venir comme d’un autre monde.
– Allons, murmura-t-il avec effort, tout est dit, il faut en finir ! Adieu, Dorypha !
Et il prit son arme dans sa poche et s’assura de son bon fonctionnement.
Mais à ce moment une ombre bondit de derrière un massif. Edward Edmond se sentit le poignet broyé par une main de fer. Il lâcha le browning sans même avoir la pensée de résister, tant il avait été pris à l’improviste. Son agresseur, le laissant presque aussi brusquement qu’il l’avait empoigné, ramassa le revolver qui était tombé dans l’herbe, le mit dans sa poche, puis dit d’un ton très calme :
– J’ai à vous parler et je vous défends de vous tuer avant d’avoir entendu ce que j’ai à vous dire !
– Que me voulez-vous ! murmura Edward Edmond d’une voix étranglée. Rien maintenant ne peut m’intéresser.
– Eh ! eh ! cela dépend, ricana l’inconnu. Master Edward Edmond, sachez que je connais votre situation. Vous vous êtes endetté à cause d’une femme. Vous avez volé une bague à votre maîtresse, miss Isidora.
– Qu’est-ce que cela peut vous faire ? Et puis d’abord, ce n’est pas vrai…
– C’est très vrai.
– Mêlez-vous donc de vos affaires ! Je ne vous connais pas, moi, je ne vous demande rien !
– Eh bien, moi, je vous connais et je vous offre quelque chose. Que diriez-vous si, à l’instant même, je vous mettais dans la main un beau billet de mille dollars ?
Comme Edward Edmond demeurait silencieux, l’inconnu continua d’un ton plus pressant :
– Que diriez-vous encore si je vous mettais à même de gagner chaque mois une pareille somme ? Auriez-vous encore l’idée de vous suicider comme un imbécile ? La belle Dorypha se moquerait de vous et elle aurait, certes, bien raison.
– Ne vous raillez pas de mon malheur ! Mais si vous avez une proposition sérieuse à me faire, faites-la vite.
L’inconnu avait tiré d’un portefeuille une bank-note qu’il s’amusait à froisser entre ses doigts.
– La preuve, reprit-il, que ma proposition est très sérieuse, c’est qu’il dépend d’un mot de vous de toucher immédiatement les mille dollars que voici.
– Que faudra-t-il faire pour cela ?
– Peu de chose, dit l’inconnu en baissant la voix. Vous êtes au service de Fred Jorgell. Il faudra simplement me permettre d’examiner les lettres qui lui parviennent et me donner certaines d’entre elles.
– C’est impossible, s’écria Edward Edmond dans une dernière révolte de sa probité à demi vaincue, demandez-moi autre chose, mais je ne veux pas trahir mon maître. Fred Jorgell a été très bon pour moi…
– Ce n’est pas si grave que vous l’imaginez, fit le tentateur qui continuait à froisser la bank-note avec un crissement de soie énervant, vous ne causerez aucun tort à Fred Jorgell, je suis tout simplement un détective privé au service d’une agence. J’ai besoin de certains renseignements. Si vous ne voulez pas me les procurer, je les aurai d’une autre façon, voilà tout.
Edward Edmond était plus qu’à demi persuadé.
– Si je croyais, murmura-t-il avec hésitation, que cela ne dût pas causer préjudice…
– Mais aucun. Vous avez vraiment une conscience trop timorée. Tout le monde fait cela. Fred Jorgell lui-même sait fort bien que toutes ses démarches sont épiées, que toutes ses lettres sont lues par des agents au service de ses adversaires financiers ; mais il s’en moque, personne ne peut faire sérieusement de tort à un homme comme lui…
Cet argument fut décisif. L’Irlandais avait souvent entendu Fred Jorgell lui-même tenir un pareil raisonnement en sa présence.
– Eh bien, soit ! s’écria brusquement l’amant de la Dorypha, j’accepte aux conditions que vous m’avez proposées. Mille dollars maintenant et autant chaque mois.
– C’est convenu. Voici votre première bank-note. Vous aurez désormais ma visite régulière aux heures du courrier, et si par hasard on remarquait mon assiduité, vous diriez que je suis un beau-frère ou un cousin venu d’Irlande, qui cherche à se placer. Ah ! encore une recommandation : du moment où vous entrez dans ma combinaison, je vous défends de remettre les pieds dans ce tripot. Il n’y vient que des filous… Avant huit jours vous vous retrouveriez dans la même situation et c’est ce que je ne veux pas !
L’Irlandais ne fit plus aucune objection. Sur l’invitation de l’inconnu il quitta le tripot, et les deux hommes, pour sceller leur entente, ne se séparèrent qu’après avoir bu un whisky au comptoir d’un bar du voisinage.
– Quel est votre nom ? dit Edward Edmond, au moment où ils allaient se séparer. Je tiens à le connaître pour vous recevoir quand vous viendrez me demander.
– Slugh ! répondit brièvement l’inconnu.
Et il s’éloigna d’un pas rapide.
Dès le lendemain, le concierge de Mr. Fred Jorgell reçut, chaque jour régulièrement et aux heures d’arrivée des courriers, le mystérieux Mr. Slugh, qui ne faisait dans la loge qu’un très rapide séjour. Il examinait méticuleusement la suscription et les divers cachets de chacune des missives qui lui étaient remises ; mais il n’emportait que certains plis et, de préférence, ceux qu’on avait expédiés du Canada, qui étaient généralement adressés à Agénor Marmousier.
Aussi le poète, qui attendait avec impatience des nouvelles de lord Burydan et d’Oscar, éprouva-t-il une vive surprise, bientôt changée en inquiétude, en voyant qu’ils ne donnaient pas signe de vie. Il fit part de cette situation à Andrée de Maubreuil et à Frédérique. Les deux jeunes filles furent sérieusement alarmées. Pour que le bossu ne donnât pas de ses nouvelles, il fallait qu’il eût été victime de quelque catastrophe. Sans oser se l’avouer, elles tremblaient que les bandits de la Main Rouge n’eussent fait disparaître le courageux gavroche.
Leur crainte, d’ailleurs, était en partie bien fondée, car toutes les lettres volées par Slugh étaient aussitôt transmises au Dr Cornélius, qui se trouvait aussi admirablement informé des faits et gestes et même des intentions de ses adversaires.
Pourtant ces précautions faillirent être mises en défaut. Un jour que Slugh se trouvait dans le bureau du concierge, la sonnerie du téléphone retentit. C’était Agénor que l’on demandait à l’appareil.
Edward Edmond allait mettre le Français en communication avec son correspondant inconnu lorsque Slugh se saisit brutalement du récepteur de l’appareil et le porta à son oreille.
– M. Agénor Marmousier ? répéta une voix lointaine.
– Qui est-ce qui le demande ? fit Slugh.
– Ses amis Oscar Tournesol et lord Burydan.
– C’est que M. Agénor n’est plus ici, il a quitté l’Amérique depuis quelques jours et il est retourné en France.
– Voilà qui est singulier, reprit la voix d’un air mécontent. Puisqu’il en est ainsi, mettez-moi en communication avec Mr. Fred Jorgell, lui-même, vous lui direz que c’est son ancien protégé, Oscar Tournesol, qui le demande.
Slugh laissa s’écouler un certain temps pour faire croire qu’il avait prévenu le milliardaire, puis il reprit la conversation commencée dans l’appareil.
– Mr. Fred Jorgell est très mécontent. Il ne désire avoir désormais aucune relation avec vous. Il est très irrité que vous l’ayez quitté sans le prévenir. Écrivez-lui ou venez le trouver, si vous désirez avoir de plus amples renseignements !
Puis Slugh, pour couper court à de nouvelles questions, raccrocha le récepteur. Se tournant ensuite vers Edward Edmond, auquel maintenant il commandait en maître :
– Faites bien attention à ceci, lui dit-il, c’est que du jour où un de ces deux individus, lord Burydan ou Oscar Tournesol, réussirait à entrer en communication téléphonique avec Mr. Fred Jorgell ou son secrétaire Agénor, votre pension de mille dollars par mois serait radicalement supprimée. Vous voilà prévenu. Il en serait de même, bien entendu, si vous laissiez passer sans me la remettre une des lettres que je vous ai signalées.
L’amant de la belle Dorypha s’inclina obséquieusement. Il comprenait, mais un peu tard, qu’en la personne de Slugh il s’était donné un maître impérieux et tyrannique à la discrétion duquel il se trouvait entièrement.
Slugh se retira après cet avertissement, laissant Edward Edmond livré à ses réflexions. L’affilié de la Main Rouge avait à peine tourné les talons qu’Agénor entra dans le bureau.
– Il n’y a rien pour moi, aujourd’hui, monsieur Edward ? demanda-t-il.
– Rien, monsieur, répondit Edward d’une voix morne.
– Tant pis ! S’il y avait une lettre pour moi, vous me la monteriez immédiatement.
Agénor regagna sa chambre très soucieux. Le poète avait des remords. Lors de sa visite à la buvette du Grand Wigwam, il n’avait songé qu’au salut de ses amis traqués par la police et avait complètement oublié la mission dont miss Isidora l’avait chargé au sujet de son frère Baruch ; mais il avait bien vite réfléchi que, placé sous la protection de lord Burydan, l’aliéné ne pouvait être tombé en de meilleures mains. Et comme il comptait avoir le lendemain même une lettre d’Oscar, il s’était contenté de dire à miss Isidora qu’on ignorait ce que son frère était devenu, se réservant de dire la vérité à la jeune fille dès qu’il pourrait lui apporter une certitude.
L’absence de lettres et de nouvelles d’Oscar et de lord Burydan le mettait dans le plus cruel embarras. Il se reprochait d’avoir peut-être causé la mort du dément par sa négligence et, lorsque miss Isidora le chargeait d’ordonner des recherches au sujet de l’aliéné, il ne savait quelle contenance tenir et baissait la tête, tout honteux.
Depuis le drame dont avait été le théâtre le Lunatic-Asylum, Agénor avait complètement perdu le sommeil et l’appétit.
CHAPITRE IV
La « Maison Bleue »
M. Denis Pasquier, Canadien français, occupait à Winnipeg une situation à part. Très estimé pour sa probité, appelé plusieurs fois par ses concitoyens à des fonctions municipales, c’était l’homme d’affaires le plus occupé de la ville. C’était lui qu’on chargeait de toutes les transactions délicates, de toutes les ventes de terrain importantes. Il était d’ailleurs, grâce à cette probité même, parvenu à amasser une fortune considérable.
Denis Pasquier était un gros homme placide dont les yeux d’un vert clair, les joues roses, la barbe rousse taillée en pointe à la française, décelaient suffisamment l’origine normande. Très lent, très réfléchi, il ne se pressait jamais en affaires et l’emploi de son temps était distribué avec une régularité mathématique dont il ne se départait pas. Il n’eût jamais avancé ou reculé l’heure de ses repas, même s’il se fût agi de réaliser un gros bénéfice. En somme, c’était un de ces types d’hommes de loi intègres, débonnaires et maniaques comme il en existait encore en France il y a une soixantaine d’années et dont la race est à peu près complètement disparue.
Denis Pasquier, assis dans son cabinet, près du gros poêle de faïence sur lequel se dressait une bouilloire de cuivre luisante, installé dans son vieux fauteuil de cuir à oreilles, était occupé à compulser un dossier avec la lenteur méthodique qui lui était habituelle, lorsque son petit clerc lui remit une enveloppe qui contenait une carte de visite.
L’homme d’affaires coupa proprement l’enveloppe avec son canif, mais sitôt qu’il eut jeté un coup d’œil sur la carte, il tressaillit et, se levant promptement de son fauteuil :
– Fais entrer la personne qui attend, dit-il à son employé.
– C’est qu’ils sont deux, fit le petit bonhomme.
– Eh bien, fais-les entrer tous les deux.
On comprendra facilement les raisons qui avaient causé l’émotion de Denis Pasquier, quand on saura que la carte qui venait de lui être remise était celle de lord Astor Burydan, dont tous les journaux avaient annoncé la mort plusieurs mois auparavant.
– Si ce n’est point un revenant, réfléchit-il, ça ne peut être qu’un escroc.
Il fut interrompu dans ses réflexions par l’arrivée de celui-là même qui en était l’objet. Lord Burydan entra dans la pièce, accompagné d’Oscar Tournesol. Kloum et l’aliéné étaient demeurés à l’hôtel où les fugitifs étaient descendus.
– Ce n’est point un escroc, ma foi, c’est bien un revenant ! murmura Denis Pasquier à la vue du noble lord, qui s’avançait vers lui, la main tendue.
– Mon brave Denis, dit lord Burydan, avec un joyeux éclat de rire, vous paraissez tout interloqué.
– Hum… c’est qu’il y a de quoi, milord.
– Remettez-vous ! Je ne suis pas un fantôme. Vous allez savoir tout de suite comment il a pu se faire que j’aie passé pour mort. Je vous demande seulement de me prêter toute votre attention.
Et lord Burydan raconta dans le plus grand détail son naufrage, sa captivité à l’île des pendus, son évasion en aéronef, enfin son internement au Lunatic-Asylum et sa fuite.
À mesure que l’excentrique avançait dans son récit, Denis Pasquier hochait la tête d’un air soucieux.
– En voilà une affaire ! répétait-il, en voilà une affaire !
Il ajouta vivement :
– Vous savez que votre cousin, le vieil avare Mathieu Fless, votre héritier le plus proche, est entré en possession de votre château et de toutes vos propriétés de Winnipeg ; et en ce moment-ci il fait les démarches nécessaires pour obtenir la libre jouissance de tous vos autres biens situés en Écosse et en Angleterre.
– Je sais tout cela, repartit le lord, et c’est même pour cette raison qu’aussitôt évadé de la maison de fous j’ai pris le train pour Montréal d’abord, puis pour Winnipeg.
– Quelles sont vos intentions, milord ?
– Parbleu, elles ne sont pas difficiles à deviner, mon brave Denis ; rentrer en possession de mon bien d’abord, et, sitôt que ce sera fait, équiper une flottille et aller détruire les bandits de la Main Rouge dans leur repaire de l’île des pendus. C’est un plaisir que je me suis promis.
– Savez-vous, continua l’homme d’affaires, que cela ne va pas être bien commode de rentrer en possession de ce qui vous appartient ? C’est une affaire qui sera très longue et très épineuse. Ne vous faites pas d’illusions, milord ; aux yeux de la loi, aux yeux de tout le monde, vous êtes mort et bien mort. J’ai ici même une copie de votre acte de décès dressé au consulat de San Francisco suivant toutes les formes légales.
– Par exemple, voilà ce qui est trop fort ! Il me semble qu’on s’est bien hâté de m’enterrer.
– Il y a une raison à cela et vous allez la comprendre. Vous connaissez votre cousin, le baronnet Mathieu Fless ?
– Fort peu. Je ne l’ai jamais vu. Tout ce que je sais, c’est que c’est un pingre, un grigou qui tondrait un œuf et couperait un liard en quatre. Je sais aussi que dans le pays on ne l’appelle que le baronnet « Fesse-Mathieu ». Voilà à quoi se bornent tous mes renseignements.
– Le baronnet est tout à fait digne de ce gracieux surnom ; mais il importe que je vous documente plus complètement sur son compte. Mathieu Fless est d’une avarice légendaire dans tout le Canada. Son costume, composé d’un bonnet confectionné avec la peau des lièvres qu’il a tués lui-même et d’une pelisse de la même fabrication, le fait ressembler à la fois au Juif errant et à Robinson Crusoé. Quand il vient en ville, il fait la joie des polissons, qui lui font cortège en chantant, malgré tous les efforts des policemen.
– Voilà un réjouissant bonhomme, s’écria lord Burydan en riant aux éclats. Je ne serais pas fâché de faire sa connaissance.
– Il n’est pas si réjouissant que cela, milord, car il est impitoyable envers les pauvres gens. Il a fait expulser d’une masure qui lui appartenait une veuve et ses cinq enfants, pour une misérable dette de cinq ou six piastres. Il est détesté dans tout le pays. Il a grand-peine à trouver des domestiques. Il les accable de travail et les nourrit si mal qu’on n’en a jamais vu rester plus de quinze jours chez lui. Ils s’enfuient à moitié morts d’inanition, préférant perdre leurs gages que de demeurer chez un pareil ladre. Lui-même vit plus mal qu’un trappiste, ne mangeant guère que le gibier qu’il tue, les œufs de ses poules, et ne buvant que de l’eau.
– Certes, s’écria lord Burydan, je ne laisserai pas ce vieux coquin installé dans mon château. J’aimerais mieux lui couper les deux oreilles. Mais tout cela ne m’explique pas comment mon acte de décès a été si vite dressé et pourquoi la mise en possession de mon héritier a été si rapide.
– J’en connais la raison, dit l’agent d’affaires en baissant la voix. Le fils aîné du baronnet est attaché au consulat d’Angleterre à New York. Il a certainement dû user de son influence près du conseil de San Francisco.
– Vous êtes dans le vrai. Et cela m’explique aussi pourquoi toutes les réclamations d’Agénor à mon sujet n’ont pas été admises. Ce Mathieu Fless et son fils sont décidément deux misérables. D’après ce que vous me dites, ils savaient parfaitement ce qu’ils faisaient en m’enfermant au Lunatic-Asylum, où je serais encore certainement sans le brave Oscar que vous voyez ici.
– Vous savez, reprit le Canadien, après avoir réfléchi une longue minute, que je vous suis entièrement dévoué, milord ; mais soyez prudent. Vous avez pu vous rendre compte que vous êtes en présence d’un homme sans scrupules, dévoré par la passion de l’argent, qui ne reculera devant aucun moyen pour vous supprimer légalement et rester en possession de vos domaines. Il faut aujourd’hui même que vous quittiez l’hôtel où vous êtes descendus. Ensuite, voici, à mon avis, ce que vous auriez de mieux à faire : je possède, à quatre lieues de Winnipeg, une maisonnette située en plein bois et qui ne me sert qu’à l’époque de la chasse. D’ailleurs, elle est confortablement meublée et munie de toutes les choses nécessaires.
– Eh bien, louez-la-moi.
– Non, je vous la prête, et si j’ai un conseil à vous donner, c’est de vous terrer dans cette retraite comme un lièvre dans son gîte et de vous montrer en ville le moins possible. Si on me demande des renseignements sur vous je dirai que vous êtes des émigrants venus du Haut-Canada et auxquels je dois vendre des terrains ; cela paraîtra suffisamment vraisemblable.
– J’accepte cette proposition avec reconnaissance.
– Maintenant, donnez-moi vos papiers. Je vais télégraphier en Angleterre pour obtenir ceux qui vous manquent, et réunir un faisceau de témoignages qui me permette de demander avec des chances de succès la radiation de votre acte de décès et l’expulsion de ce vieux drôle de baronnet auquel, entre parenthèses, je ne serais pas fâché de jouer un tour de ma façon. Il ne faudra pas négliger de votre côté d’écrire aux lords de la Chambre des pairs que vous connaissez, pour qu’ils usent de toute leur influence dans cette affaire.
Puis, changeant brusquement de ton, il ajouta :
– Midi va sonner dans cinq minutes. Nous avons assez parlé de choses sérieuses, j’espère que maintenant vous allez me faire le plaisir de partager mon modeste déjeuner. Oh ! ce ne sera pas de la cuisine bien compliquée, tout simplement un beau saumon du lac Winnipeg et un jambon de mouton à l’écossaise. Mme Pasquier et mes fils seront enchantés de faire votre connaissance. Le petit clerc ira jusqu’à votre hôtel prévenir vos amis qu’ils ne vous attendent pas.
Lord Burydan accepta de bon cœur l’invitation de l’homme de loi et il admira la simplicité patriarcale de cette famille de braves gens. Il se croyait ramené à cent ans en arrière.
Après le repas, qui fut très gai et arrosé de quelques bouteilles de vieux vin de France que Denis Pasquier gardait dans sa cave pour les grandes occasions, lord Burydan et Oscar prirent congé de leurs hôtes, qui avaient mis à leur disposition une carriole à deux chevaux et un domestique pour les conduire à leur nouvelle résidence.
Pendant qu’on attelait, M. Pasquier renouvela ses recommandations.
– Surtout, soyez prudents, montrez-vous en ville le moins possible. Je connais assez le baronnet pour savoir qu’il n’hésiterait pas un instant à vous dénoncer et à vous livrer aux autorités américaines.
– Vous pouvez être tranquille, nous observerons vos conseils de point en point.
– Ah ! encore un renseignement que j’oubliais. L’avare a un second fils, un très brave garçon d’ailleurs, qu’il a chassé de chez lui pour je ne sais quelle histoire d’amourette…
La carriole était attelée, les chevaux piaffaient dans les brancards, une dernière poignée de main fut échangée et les deux fugitifs prirent place sur l’un des bancs du rustique équipage pendant que Laurent, le domestique, s’installait sur le siège.
On fit halte à l’hôtel, juste le temps nécessaire pour régler la note et pour prendre le Peau-Rouge Kloum et l’aliéné, puis l’on partit.
Sitôt qu’on fut sorti de la ville et que l’on se trouva sur une belle route, solidement empierrée et bordée de sapins et de peupliers, les deux chevaux prirent une sorte de trot allongé qu’ils ne quittèrent plus jusqu’au moment de l’arrivée. Le paysage était magnifique. On apercevait de verdoyantes forêts de sapins, de hêtres et de châtaigniers, coupées de loin en loin par de florissantes cultures de blé, d’avoine, de chanvre et de sarrasin. Tout respirait la tranquillité, le calme et l’abondance. Le pays, d’ailleurs, était absolument désert ; à peine, de temps en temps, rencontrait-on un paysan conduisant un troupeau de bœufs et de moutons ou une charrette de fourrage, et qui saluait les voyageurs d’un bonjour amical en apercevant le domestique de l’homme de loi qui était connu dans toute la contrée. Cependant, à mesure qu’on avançait, le paysage devenait plus accidenté et plus boisé, les cultures se faisaient plus rares ; bientôt ce fut la forêt dont les arbres aux vastes branches semblaient vouloir se rejoindre pardessus la route. Au loin, on entendait le fracas d’un torrent, le Ruisseau Rugissant qui, à ce qu’expliqua le domestique canadien, servait de ligne de démarcation entre le domaine de M. Denis Pasquier et celui du baronnet Mathieu Fless, pour aller ensuite se jeter dans le lac Winnipeg.
La carriole avait quitté la grand-route pour prendre un chemin de traverse tapissé de gazon et qui courait en zigzag à travers les futaies ; bientôt la masse élégante d’une maison de bois à balcons et à larges auvents, à toiture de tuile bleue, apparut entre les arbres.
On était arrivé.
– Nous sommes à la Maison Bleue, dit le Canadien, je vais vous donner la clef, et d’ici un quart d’heure vous serez installés. Il y a de la vaisselle et des couverts dans les buffets, du linge dans les armoires, de la bière et du whisky dans la cave. Rien n’y manque.
Le Canadien avait sauté en bas de son siège. Il ouvrit la porte, et lord Burydan et ses compagnons purent constater que la maisonnette perdue en plein bois était pourvue de toutes les choses nécessaires. Il y avait même des jambons et des andouilles appendus aux solives de la cuisine. Le Canadien ouvrit un petit cabinet qui renfermait plusieurs carabines en excellent état et tout un assortiment de filets, de pièges et de cannes à pêche.
– Avec cela, dit-il en riant, vous ne risquez pas de mourir de faim et vous pourrez tout à votre aise faire la guerre au gibier de la forêt, aux saumons du lac et aux truites du torrent. D’ailleurs, comme l’a dit M. Denis, l’un de vous pourra venir chaque semaine se ravitailler à Winnipeg.
Après avoir laissé son cheval se reposer pendant une heure et montré aux hôtes de son maître la cave, le cellier et les chambres à coucher de la maison, le domestique de M. Pasquier remonta dans sa carriole qui bientôt se perdit dans l’éloignement. Les fugitifs étaient seuls en pleine nature, en plein désert.
– Enfin, s’écria lord Burydan en poussant un long soupir, nous allons donc pouvoir nous reposer, loin des paquebots, des chemins de fer, des maisons de fous, des bandits de la Main Rouge et des hôtels pourvus de tout le confort moderne !
– Ce ne sera pas trop tôt, approuva le bossu, qui paraissait très préoccupé. Puis, ici, nous serons tranquilles pour causer et pour prendre les décisions nécessaires.
Cette journée fut employée à l’installation et tout de suite les fugitifs virent que la Maison Bleue leur offrirait un asile des plus confortables.
Au rez-de-chaussée, il y avait une cuisine, une salle à manger, un office et un salon. Quatre chambres à coucher auxquelles on accédait par un large escalier de bois composaient le premier étage.
Tout cela était clair, gai, neuf et d’une éblouissante propreté. On aurait dit que le propriétaire de la maison l’avait quittée seulement depuis la veille. C’était décidément un vrai cadeau que M. Denis Pasquier avait fait à ses amis.
CHAPITRE V
Deux serviteurs modèles
Slugh venait de quitter Edward Edmond, le concierge de Mr. Fred Jorgell, après avoir assisté au dépouillement du dernier courrier et il regagnait philosophiquement, en fumant un cigare, l’hôtel meublé qu’il habitait dans le quartier irlandais. De temps à autre il entrait dans un bar, savourait un whisky and soda, puis se remettait en route paisiblement. Très sérieux d’ailleurs à sa manière, il ne faisait jamais plus de trois stations de ce genre dans sa soirée. Autant, en effet, il regardait comme une chose légitime de se rafraîchir d’une façon raisonnable, autant il avait en horreur l’ivrognerie qu’il considérait comme le plus répugnant des vices. Seulement, si un autre que lui s’était raisonnablement rafraîchi d’autant de verres de whisky pendant sa journée, il eût été immanquablement ivre mort avant le coucher du soleil.
Slugh venait de faire sa troisième et dernière station et il traversait une ruelle déserte et privée de becs de gaz, quand un individu coiffé d’un feutre à larges bords et cravaté d’un foulard de soie qui dissimulait presque entièrement ses traits s’approcha de lui et lui prenant la main d’une certaine façon lui dit à l’oreille quelques paroles cabalistiques, Slugh sursauta.
– De la part des Lords ? murmura-t-il. Je vous suis à l’instant.
– Bien, dit le mystérieux inconnu, mais auparavant, il faut que je vous bande les yeux.
Slugh se laissa faire docilement.
– Est-ce que nous allons loin ? demanda-t-il.
– Ne vous inquiétez pas de cela. D’ailleurs, vous n’aurez pas à vous fatiguer, car nous allons en auto.
Guidé par l’inconnu qui lui avait pris la main, Slugh fit une vingtaine de pas, puis on l’aida à monter en voiture et à prendre place sur de moelleux coussins.
L’instant d’après, l’auto partait à toute allure. Il roula ainsi pendant une demi-heure, puis l’inconnu qui, jusqu’alors, n’avait pas desserré les dents, cria un ordre au chauffeur qui stoppa immédiatement. Slugh descendit, aidé par son guide qui, lui ayant pris le bras, lui fit traverser un large espace vide qui devait être une cour, monter un escalier et suivre un couloir au bout duquel il y avait une porte. Slugh sentit alors qu’on lui lâchait le bras et qu’on le poussait dans une pièce dont le parquet était recouvert d’un épais tapis.
– Enlevez votre bandeau, fit une voix brève et rauque, qui n’était pas celle du guide.
Slugh obéit et les yeux éblouis par la vive clarté qui régnait dans l’endroit où il se trouvait, il regarda autour de lui. Il était dans une haute salle dont les murailles, du sol au plafond, étaient couvertes de tableaux aux larges cadres dorés. Il y avait aussi des statues de marbre blanc et de bronze, des vitrines bondées d’orfèvreries précieuses et de bijoux étincelants, des meubles incrustés de lapis et de nacre, des armes damasquinées d’or, d’antiques tapisseries où des personnages de légende s’agitaient dans ces paysages fantastiques.
Au centre de la pièce, trois hommes au visage recouvert d’un masque de caoutchouc mince étaient assis autour d’un guéridon de porcelaine de Sèvres, encombré d’une masse de papiers, parmi lesquels Slugh reconnut la plupart des lettres qu’il avait enlevées lui-même au courrier de Fred Jorgell. Les trois hommes regardaient curieusement Slugh et paraissaient s’amuser de son ébahissement.
– Slugh, dit enfin l’un d’entre eux, assieds-toi et réponds sincèrement à mes questions. Y a-t-il longtemps que tu appartiens à l’association de la Main Rouge ?
– Oui, milord, cinq ans.
– N’as-tu jamais eu envie de quitter l’association ?
– Non, milord. Je suis tout dévoué à la Main Rouge.
– Ne t’a-t-on jamais proposé de l’argent pour trahir nos secrets ?
– Plusieurs fois, milord, mais j’ai toujours refusé, et j’ai immédiatement signalé les auteurs de ces propositions.
– Je crois, fit l’homme masqué, à voix basse, à ses assesseurs, que l’on peut compter sur lui. Il a des états de service excellents. C’est lui qui commandait les tramps qui ont enlevé Joe Dorgan dans la Sierra. Il a rempli avec beaucoup de zèle les fonctions de capitaine-gouverneur de l’île des pendus, tout récemment il a été dangereusement blessé en attaquant le milliardaire Fred Jorgell. Enfin, c’est lui qui, très intelligemment, se charge de l’examen du courrier de l’Américain.
Les trois Lords examinèrent quelque temps silencieusement Slugh, qui ne pouvait s’empêcher de ressentir une certaine gêne sous le feu croisé de ces trois paires de regards inquisiteurs ; mais l’examen lui fut favorable.
– Tu sais, reprit l’homme masqué, qu’en ce moment-ci l’association traverse une véritable crise. Un syndicat de milliardaires, à la tête desquels se trouve Fred Jorgell, a offert des primes considérables à ceux qui parviendraient à nous détruire. Tu es un homme de confiance à qui l’on peut parler franchement.
– Oui, milord, fit Slugh en se rengorgeant.
– Eh bien, les mauvaises nouvelles arrivent de tous les côtés. Dans l’État de New-Jersey, une cinquantaine des nôtres sont en prison et vont passer en jugement. Dans l’Illinois, on a lynché une douzaine de tramps dans la même semaine, enfin, tout dernièrement un des banquiers chez lesquels sont déposés les capitaux de la Main Rouge a été dénoncé et l’on a saisi dans sa banque pour près de trois cent mille dollars de valeurs, appartenant à l’association.
Et comme Slugh paraissait consterné :
– Rassure-toi, reprit son interlocuteur, la Main Rouge est plus riche, plus puissante qu’on ne peut le supposer et c’est elle qui triomphera. Personne ne peut soupçonner le pouvoir de sa formidable organisation. Mais si nous t’avons fait venir, c’est que le conseil des Lords a décidé de te charger d’une mission délicate et qui n’est pas sans danger. Il s’agit d’enlever à un vieil avare, qui habite un château tout à fait isolé, une somme de plus de trois millions de dollars en or et en bank-notes.
– Je suis prêt ! s’écria Slugh avec un noble enthousiasme.
– Silence. Et une autre fois, ne te permets pas de me couper la parole.
Slugh baissa la tête humblement en balbutiant de vagues excuses.
– Mais, poursuivit l’homme masqué, ce n’est pas à New York que se trouve la somme. C’est très loin d’ici au Canada, dans les environs de Winnipeg. L’harpagon se nomme Mathieu Fless et il te sera très facile d’entrer à son service comme domestique.
– Irai-je seul accomplir cette expédition ?
– Non, de toute manière, il est préférable que vous soyez deux. On te donnera comme compagnon un homme solide, Sam Porter, par exemple. Te sens-tu, dans ces conditions, capable de réussir ?
– Je pense que oui, milord. Une maison isolée, un vieillard, cela me semble très facile.
– C’est aussi l’opinion des Lords, mais ce n’est là que la moitié de ce que tu as à faire. À quelque distance du château de l’avare, habitent quatre des plus redoutables ennemis de la Main Rouge. Il faudra t’arranger de façon à les supprimer. Deux d’entre eux te sont déjà connus : lord Burydan et le Peau-Rouge Kloum ont été, en effet, confiés à ta garde dans l’île des pendus. Les deux autres sont : un fou, échappé du Lunatic-Asylum et un Français, un malicieux petit bossu, qui se nomme Oscar Tournesol. La suppression de ces quatre individus est une chose presque aussi importante que l’autre affaire. Et, surtout, il est indispensable que la Main Rouge, qui est à peu près inconnue au Canada, ne puisse être soupçonnée.
Slugh reçut encore une foule de minutieuses recommandations et il fut convenu qu’on mettrait à sa disposition une auto extra-rapide et d’une robustesse exceptionnelle grâce à laquelle, le double crime accompli, il pourrait rapidement prendre la fuite avec le produit du vol.
Quelques jours plus tard, à la nuit tombante, une énorme auto rouge et noir pénétrait dans la ville de Winnipeg et faisait halte devant l’établissement d’un mécanicien yankee arrivé depuis quelques mois seulement au Canada. Ce Yankee, que personne ne soupçonnait, était un affilié de la Main Rouge qui avait dû s’expatrier à la suite d’un vol. Il fit le meilleur accueil à Slugh et à Sam Porter, mit sous clef leur voiture dans un hangar spécial, et leur fournit tous les renseignements dont ils avaient besoin. Enfin, il leur donna les moyens de se déguiser.
Le lendemain deux hommes coiffés de chapeaux de feutre terreux, chaussés de gros souliers à clous, et vêtus d’un complet de velours élimé, sortaient des ateliers du mécanicien bien avant le lever du soleil. Tous deux portaient un sac de toile en bandoulière et un faisceau d’outils aratoires sur l’épaule. Tout le monde les eût pris pour ces journaliers nomades qui vont, de ferme en ferme, offrir leurs services jusqu’à ce qu’ils aient amassé assez d’argent pour s’acheter un lopin de terre et qui sont très nombreux au Canada où ils n’éveillent l’attention de personne.
Slugh et Sam Porter, car c’étaient eux, sortirent de Winnipeg sans avoir éveillé la curiosité et, après avoir marché pendant deux heures, ils atteignirent les rives du Ruisseau Rugissant, dont ils remontèrent le cours pendant quelque temps.
Arrivés à un pont de bois que le Yankee leur avait indiqué, ils franchirent le torrent et se trouvèrent dans une vaste et majestueuse avenue de sapins, à l’extrémité de laquelle ils entrevoyaient les toits aigus et les tourelles sculptées d’un château. Mais cette demeure seigneuriale, de loin si luxueuse, leur montrait, à mesure qu’ils en approchaient, les indices du délabrement et de l’incurie les plus profonds.
La cour était envahie par les mauvaises herbes, et le toit couvert de lichen et de mousse. Les fenêtres sans rideaux avaient un grand nombre de carreaux cassés que l’on avait remplacés par des bouts de planche ou même par des bottes de paille. Quelques poules étiques picoraient çà et là et une vache était nonchalamment étendue au milieu même du perron.
Les deux bandits avaient eu à peine le temps d’embrasser d’un coup d’œil ce spectacle, que deux chiens d’une maigreur d’Apocalypse, et qui devaient être à jeun depuis plusieurs jours, leur sautèrent aux mollets avec des aboiements furieux. Slugh et son compagnon avaient grand-peine à repousser les attaques de ces animaux faméliques, lorsqu’un vieillard sortit par une porte latérale.
– À bas, Fanor ! À bas, Tom ! cria-t-il d’une voix grondeuse.
Les deux arrivants parurent stupéfaits à l’aspect de ce personnage qui n’était autre que le baronnet Mathieu Fless, plus communément appelé le baron Fesse-Mathieu. Comme, par économie, il ne faisait jamais usage ni des ciseaux ni du rasoir, sa longue barbe blanche lui descendait jusqu’au ventre et ses cheveux flottaient sur ses épaules, couronnés de l’étrange bonnet de peau de lièvre qu’il s’était fabriqué lui-même. Il ressemblait tout à fait au Juif errant de nos vieilles images d’Épinal. Deux petits yeux noirs et vifs comme ceux d’un merle accompagnaient un nez long et crochu et ses mains aux ongles en griffes soutenaient un revolver de gros calibre.
Quant à son vêtement, il tenait à la fois de la robe de chambre, de la pelisse et de la soutane. Il avait dû être primitivement taillé dans du gros drap vert olive, mais son propriétaire, sans doute pour le rendre plus chaud, l’avait doublé de peaux de lapin et d’autres animaux et l’avait studieusement raccommodé avec des lambeaux d’étoffe de couleurs différentes. La chaussure de ce vieillard falot se composait d’une paire de gros sabots.
Les bandits eurent toutes les peines du monde à réprimer une violente envie de rire. Jamais, au cours de leurs nombreuses aventures, ils ne s’étaient trouvés en présence d’un aussi grotesque bonhomme. Sam Porter, à part lui, se demandait avec incrédulité s’il était possible que ce vieux mendiant possédât tant de millions de dollars. Quant à Slugh, il étudiait le baron Fesse-Mathieu avec la satisfaction d’un véritable amateur.
Cependant le vieillard, inquiet du silence des deux visiteurs, s’avançait vers eux en braquant son revolver d’un air menaçant :
– Que voulez-vous ? s’écria-t-il. Et d’abord qui vous a permis d’entrer chez moi ?
– Sir, répondit humblement Slugh, nous sommes de braves travailleurs, qui cherchons de la besogne et en voyant votre beau château nous avons pensé que vous en auriez peut-être à nous donner.
– Hum ! riposta le baron avec une petite toux sèche, ce n’est pas la besogne qui manque, mais les gens à l’époque actuelle sont devenus d’une telle fainéantise… ils voudraient tous toucher de bons dollars et se goberger sans rien faire…
– Nous ne sommes pas de cette catégorie-là, répliqua Slugh avec une modeste assurance ; vous pourriez parcourir tout le Canada sans trouver deux valets de labour aussi laborieux, aussi sobres et aussi dociles.
L’avare était évidemment alléché par cette accumulation d’épithètes laudatives, d’autant plus que ses trois domestiques l’avaient brusquement quitté l’avant-veille en l’accablant des pires injures.
– Hum ! fit-il, ceux qui travaillent aussi bien que vous le dites se font payer très cher. Si je vous embauche, je parie que vous allez me demander les yeux de la tête.
– Nous, s’écria Slugh, avec un air de bonhomie tout à fait accommodant, nous sommes les gens les moins exigeants du monde.
– Vous vous contenteriez, hum… par exemple de trois dollars par semaine ?
Slugh et Sam Porter échangèrent un coup d’œil comme s’ils hésitaient. L’avare crut qu’ils allaient opposer un refus à son offre dérisoire.
– Hum ! permettez, s’écria-t-il vivement. Vous serez nourris. Bonne soupe le matin, bonne soupe à midi et bonne soupe le soir. Du gibier et du poisson chaque fois que j’irai à la chasse ou à la pêche.
Et il ajouta avec une ironie qu’il était le seul à comprendre :
– Je vous donne ma parole d’honneur de gentilhomme que vous serez nourris aussi bien que moi.
– Et qu’est-ce qu’on boit chez vous ? demanda Slugh qui tenait à se faire prier.
– Hum ! fit le vieillard avec embarras, de l’eau, de la bonne eau de source, avec un peu de vinaigre dans les grandes chaleurs pour désaltérer.
Les deux bandits firent une grimace épouvantable. D’un même mouvement, ils hochèrent la tête en signe de négation.
– Écoutez, insista le baron Fesse-Mathieu qui ne voulait pas les laisser partir, nous allons nous entendre. Je ferai venir de la bière, hum !… Oui, vraiment, de la petite bière ! mais la semaine prochaine seulement, parce que je n’ai pas prévenu mon brasseur…
– Ah ! comme cela, je ne dis pas, répliqua Slugh, qui étouffait d’une envie de rire. Si vous nous donnez de la bière, on pourra s’entendre. Et je vous garantis que vous ne regretterez pas votre dépense. Mon camarade et moi, nous abattons de la besogne comme quatre hommes ordinaires.
Après une discussion qui se prolongea pendant plus d’une heure, l’honnête Slugh et son ami Sam Porter consentirent à entrer définitivement au service du baronnet, à raison de trois dollars par semaine, mais avec la brillante perspective de manger chaque jour à la table du châtelain et d’être nourris exactement de la même manière que lui.
CHAPITRE VI
Madame Sibylla
On était au commencement de l’automne, la forêt canadienne, si mélancolique l’hiver sous son manteau de neige et de glace, offrait alors les majestueuses perspectives de ses clairières, de ses avenues bordées d’arbres géants où dès les premiers rayons du matin s’égosillaient des milliers d’oiseaux.
Les feuillages commençaient à revêtir de belles teintes de cuivre et d’orange assombri, les écorces blanches des bouleaux brillaient doucement dans le lointain comme des colonnes d’argent.
Chaque matin, les quatre amis partaient en expédition, soit pour la chasse, soit pour la pêche. Les bords du lac et ceux du torrent pullulaient de gibier aquatique. Les canards sauvages, les pilets, les sarcelles, l’oie du Canada, le vanneau et l’outarde y abondaient. Dans les bois les chasseurs rencontraient les grives, les coqs de bruyère, les lièvres arctiques et les perdrix de neige ou ptarmigans.
La pêche fournissait des saumons superbes, des truites arc-en-ciel, des anguilles, de gigantesques brochets et des écrevisses d’une saveur particulièrement exquise.
Grâce à l’adresse du Peau-Rouge et de lord Burydan, tous deux excellents tireurs, l’office de la Maison Bleue était toujours abondamment pourvu de gibier.
Quant à Oscar, il s’était découvert les plus heureuses dispositions pour la pêche à la ligne, et il était en peu de temps devenu de première force à ce sport contemplatif.
Joë, toujours taciturne, passait quelquefois des journées entières sans prononcer une parole, mais il obéissait à tous les ordres qu’on lui donnait et se montrait serviable, doux et complaisant, en toutes circonstances.
– Ce garçon-là n’est pas fou, dit un jour lord Burydan, qui l’avait soigneusement observé. Je crois qu’il a tout simplement un peu d’amnésie et qu’il ne serait pas du tout impossible de le guérir.
– En tout cas, répondit Oscar, il est tout à fait inoffensif. Laissons-le tranquille et il ira mieux. On dirait que, depuis qu’il est en notre compagnie, son état s’est déjà sensiblement amélioré.
– Je suis persuadé qu’au Lunatic-Asylum il devait être en butte à toutes sortes de mauvais traitements. Quand mes affaires seront arrangées, il faudra que j’arrive à connaître le nom et les antécédents de ce pauvre diable.
Plusieurs fois, on avait demandé au dément comment il s’appelait, mais il n’avait jamais répondu qu’en poussant un douloureux soupir ; et chaque fois qu’on le questionnait à ce sujet, il s’enfuyait dans le bois et restait une demi-journée sans reparaître. On finit par le laisser tranquille.
D’ailleurs, comme nous avons déjà eu l’occasion de le remarquer, le temps, la séquestration et l’ennui avaient tellement altéré l’œuvre du docteur Cornélius que la ressemblance de Baruch, qui pendant quelque temps avait été frappante, s’était très atténuée.
Oscar, qui avait parfaitement connu l’assassin chez M. de Maubreuil, et qui savait pourtant que Baruch avait été enfermé au Lunatic-Asylum, n’eut pas un instant la pensée que c’était le meurtrier de M. de Maubreuil qu’il avait aidé à s’enfuir.
Somme toute, en attendant le résultat des démarches entreprises par M. Denis Pasquier, et qui devaient certainement réussir, les habitants de la Maison Bleue eussent été parfaitement heureux sans la déception qu’ils avaient eue de ne recevoir aucune réponse aux lettres adressées à Fred Jorgell et à Agénor.
Cet obstiné silence les inquiétait, et ils ne pouvaient s’empêcher de penser qu’il devait y avoir là-dessous une manœuvre de leurs ennemis de la Main Rouge.
Un soir, les quatre fugitifs assis sous le manteau de la vaste cheminée de la Maison Bleue, où brûlait un joyeux feu de bûches résineuses et de pommes de pin, devisaient de toutes ces choses, tout en savourant un bol de grog.
Assis tous deux au coin de l’âtre, Kloum et l’aliéné, aussi taciturnes l’un que l’autre, ne prenaient part à la conversation que par de rares monosyllabes.
Oscar Tournesol et lord Burydan, qui étaient rapidement devenus très amis, discutaient.
– Je connais trop bien Agénor, qui est la loyauté même, dit lord Burydan, pour croire qu’il ait pu retourner en Europe, en se désintéressant absolument de ce que je devenais.
– Qui sait ? fit Oscar, notre ami a peut-être été rappelé en France par quelque deuil de famille.
– Il n’a plus de parents. Je croirais plutôt que nos lettres ont été interceptées.
– C’est impossible. Il règne chez Fred Jorgell un ordre parfait. Tous les gens qui l’approchent sont des serviteurs de confiance et il verse chaque année de gros pourboires à l’administration postale, pour que son courrier lui soit remis avec une parfaite exactitude.
– Je ne sais que penser. Il faudrait donc croire à ce qu’on nous a dit quand nous avons téléphoné.
– Il faut que je tire cette situation au clair, s’écria le petit bossu en se levant avec un geste décidé. Demain nous allons à Winnipeg. Si je ne trouve aucune lettre de nos amis à l’adresse que j’ai donnée poste restante, je partirai pour New York.
– Ma foi, vous avez peut-être raison.
– Je n’ai pas le droit de rester plus longtemps ici, surtout quand je suis en mesure d’apporter à Mlle Frédérique et à son amie les nouvelles de M. Bondonnat qu’elles attendent avec tant d’impatience. Voilà six lettres que je leur écris, en leur faisant le récit détaillé de tout ce que vous avez vu à l’île des pendus, et pas un mot de réponse. Vous avouerez que cela est tout de même étrange !
À ce moment, Kloum se leva brusquement, l’oreille tendue.
– Il me semble, fit-il, que l’on a appelé au secours.
Oscar et lord Burydan écoutèrent, mais le fracas de la pluie, qui tombait cette nuit-là à torrents, se mêlait au rugissement du vent dans les futaies et au grondement du tonnerre.
– Vous avez dû vous tromper, mon brave Kloum, fit le petit bossu.
– Je disais donc, reprit lord Burydan, qu’il y aurait peut-être un moyen d’expliquer tout cela. Supposons, par exemple, que M. Bondonnat ait réussi à s’échapper et qu’il soit reparti pour la France avec ses filles et que, pour une raison ou pour une autre, leur courrier ne leur ait pas été expédié en Europe.
– Mais, reprit le bossu, cela n’expliquerait pas le silence de Fred Jorgell.
– Peut-être s’est-il brouillé avec les Français ?…
En réalité si Andrée et Frédérique n’avaient pas répondu aux pressants messages d’Oscar Tournesol, c’est, nos lecteurs le savent, qu’il y avait au Preston-Hotel un agent de la Main Rouge qui, de même que Slugh chez Fred Jorgell, épluchait soigneusement le courrier des quatre Français et subtilisait toutes les lettres provenant du Canada. Cornélius et ses affidés, qui comprenaient de quelle importance eussent été pour Frédérique les révélations de lord Burydan, n’avaient rien négligé pour que l’existence de l’île des pendus ne lui fût pas dévoilée. Le jour où on connaîtrait cette retraite accessible, c’en était fait de la Main Rouge. C’était ce qu’il fallait éviter. Même en faisant disparaître ceux qui étaient possesseurs de ce secret, et c’est ainsi que le voyage de Slugh avait été décidé.
Lord Burydan et le bossu se taisaient, devenus pensifs, en songeant à l’extraordinaire complication d’événements où le hasard les avait placés, mais ils furent brusquement arrachés à leurs réflexions.
Kloum s’était levé de nouveau, la mine inquiète :
– Cette fois, j’en suis sûr, s’écria-t-il, on vient de heurter à la porte.
Il n’avait pas achevé sa phrase que lord Burydan et le bossu entendaient des coups très distincts rudement frappés à la porte extérieure.
– Va ouvrir, ordonna lord Burydan au Peau-Rouge, mais ne quitte pas ton revolver… Je me demande, par exemple, qui peut bien nous rendre visite à pareille heure, dans ce désert ?
Kloum tira les verrous, et sitôt qu’il eut ouvert la porte, un jeune homme de haute taille et de bonne mine entra précipitamment, soutenant ou pour mieux dire portant dans ses bras une jeune fille à demi évanouie. Tous deux étaient ruisselants d’eau, couverts de boue, et leurs vêtements avaient été lacérés en maints endroits par les ronces des buissons.
– Excusez-nous, messieurs, dit l’inconnu avec un air de franchise et de loyauté qui lui gagna toutes les sympathies, mais nous avons été surpris par l’orage, moi et ma fiancée, miss Ophélia, nous nous sommes égarés, nous avons failli nous noyer dans le Ruisseau Rugissant qui est actuellement débordé, lorsque nous avons aperçu une lumière entre les arbres… Sans savoir qui vous étiez, j’ai pensé que vous ne nous refuseriez pas l’hospitalité pendant quelques heures.
– Vous avez fort bien fait, monsieur, répondit lord Burydan avec un geste de grand seigneur, vous êtes ici chez vous, mais je crois que la première chose à faire serait de s’occuper de cette charmante jeune fille, dont l’état réclame des soins immédiats.
Aussitôt, chacun s’empressa. On jeta de nouvelles bûches dans le feu, on fit chauffer du grog et l’on en fit boire à la belle Ophélia, dont le visage blêmi reprit immédiatement ses couleurs. Oscar Tournesol dénicha dans une armoire du linge de femme et une robe de chambre qui appartenaient à Mme Pasquier, et la jeune fille, qui avait été trempée jusqu’aux os, put changer de vêtements et réparer le désordre de sa toilette.
Ophélia était une blonde au teint délicatement rosé. Ses yeux, d’un bleu limpide, exprimaient la tendresse et la douceur, et son sourire avait le charme d’une caresse. La taille svelte malgré des hanches robustes et cette opulente poitrine qui est une beauté spéciale aux femmes canadiennes, miss Ophélia était belle de la beauté d’une Diane chasseresse qui n’aurait pas renoncé au mariage.
Lord Burydan la contemplait avec admiration. Kloum était littéralement en extase, et il n’était pas jusqu’au pauvre aliéné lui-même qui ne regardât avec un sourire charmé cette ravissante personne.
Oscar seul, tout entier à ses préoccupations, n’avait jeté sur la jeune fille qu’un coup d’œil distrait. Tout à coup, il se tourna vers le jeune homme en ce moment occupé à vider à petits coups un bol de grog :
– Serait-il indiscret, cher monsieur, de vous demander à qui nous avons l’honneur de parler ?
– Nullement, répondit le jeune homme dont la physionomie ouverte et loyale se voila d’un nuage. Je suis parfaitement connu dans ce pays-ci. Je me nomme Noël Fless.
– Seriez-vous parent du baronnet Mathieu Fless ? demanda lord Burydan.
– Je suis son fils, répondit le jeune homme avec un amer sourire.
Denis Pasquier avait fait, on le sait, les plus pressantes recommandations à lord Burydan sur la discrétion qu’il devait garder jusqu’à ce que son identité fût reconnue, mais il n’entrait pas dans le caractère de l’excentrique de s’imposer n’importe quelle contrainte du moment où il y trouvait un amusement. L’idée qu’il se trouvait en face du fils de l’avare le réjouit infiniment.
– Monsieur Noël, répondit-il gracieusement, je suis d’autant plus charmé de vous voir que nous sommes cousins.
– Serait-il possible ?
– Oui, mon cousin. Je suis ce même lord Burydan dont vous avez peut-être entendu raconter les folies.
Noël était en proie à la stupéfaction la plus profonde.
– Mais lord Burydan est mort, protesta-t-il, et mon père est entré en possession de ses immenses domaines.
– Lord Burydan est aussi peu mort que possible, répliqua l’excentrique en se donnant un solide coup de poing sur le thorax. Et il va d’ici peu en donner la preuve à votre honoré père en le priant de lui restituer le château et les terres dont il s’est emparé avec un peu trop de hâte.
Et lord Burydan qui, par tempérament, était l’ennemi inné de toute dissimulation raconta ses aventures à son cousin et lui exposa de la façon la plus nette sa situation. Il termina, d’ailleurs, en priant Noël et miss Ophélia de lui garder le secret.
– Il m’est souvent, par malheur, répondit Noël, arrivé d’être obligé de rougir des agissements de mon père et de mon frère. Et l’on a dû vous dire que je suis brouillé à mort avec sir Mathieu parce que je n’ai pas su me plier à ses manies d’avarice et que j’ai trouvé honteux de le voir vivre comme un mendiant, alors qu’il est riche à millions.
– Alors, fit l’excentrique très amusé, je dois presque voir en vous un allié ?
– Assurément. Je réprouve de toutes mes forces la façon indigne dont on a agi à votre égard, et, en y réfléchissant, je m’aperçois que c’est certainement mon frère, l’attaché d’ambassade, qui a ourdi toute cette machination. Sachez-le, milord, je n’ai pas de pire ennemi que mon frère. Nous sommes nés de deux mères différentes, et, dès notre plus tendre enfance, il y a eu entre nous de la haine et de l’animosité. Mon frère est le plus hypocrite des hommes…
– L’on m’a dit, interrompit lord Burydan, que votre frère était très prodigue ; qu’il aimait à faire la fête et qu’on lui connaissait de nombreuses maîtresses. Il est assez singulier que, dans ces conditions, il reste en bons termes avec le baronnet, dont la… – mettons l’économie – est proverbiale.
– Ce que vous dites est exact, mon frère mène une vie très dissipée ; mais vous ne pourriez soupçonner jusqu’à quelles comédies il s’abaisse pour faire croire à mon père qu’il est aussi avare que lui. Quand il vient dans le pays, il descend à une auberge située à une lieue du château. Là, tout d’abord, il se leste d’un bon repas, puis il échange ses vêtements de correct gentleman contre un vieux complet rapiécé que l’aubergiste lui tient en réserve. C’est dans cet accoutrement qu’il va trouver mon père, auquel il ne parle que de privations, de sobriété et d’économie. Tous deux partagent un repas de croûtes de pain et d’eau claire, puis mon frère gagne sa chambre ; mais dès que tout est endormi dans le château, il saute par la fenêtre et court à l’auberge se dédommager de la maigre chère qu’il a faite par un substantiel souper. Tout le pays connaît cette histoire et s’en amuse.
– J’avoue, dit l’excentrique, que cette aventure est passablement joviale : mais en quels termes êtes-vous avec votre père ?
– Dans les plus mauvais qui soient. J’ai pourtant fait preuve de beaucoup de patience ; mais une rupture devait inévitablement se produire entre nous deux. Quand je lui ai annoncé que j’avais la ferme intention d’épouser miss Ophélia, qui est sans fortune, il est entré en fureur et m’a chassé de chez lui. Je vis en sauvage dans une maisonnette qui me vient de ma mère et qui se trouve à deux lieues d’ici. Les produits du jardin que je cultive moi-même, ceux de ma chasse et de ma pêche, suffisent largement à mes besoins. Il ne manque qu’une seule chose à mon bonheur, c’est de pouvoir m’unir à ma chère Ophélia.
– Pourquoi ne le faites-vous pas ?
– Ma fiancée est orpheline. Elle a été recueillie par une de mes tantes, une vieille femme d’une dévotion exagérée, et celle-ci ne veut consentir à notre mariage que lorsque mon père lui-même y aura donné son consentement, et il ne le donnera jamais, j’en suis sûr, car il me déteste.
– Oh ! oui, murmura tristement miss Ophélia, il nous déteste !
– Mademoiselle, reprit galamment lord Burydan, je bénis cette heure sans laquelle, probablement, je n’aurais pas eu le plaisir de faire votre connaissance.
– La pluie et la tempête, répondit Ophélia, ont été certainement pour quelque chose aussi dans cette présentation. Ma tante, miss Judith, est allée à Montréal, à la suite d’un pèlerinage qui doit lui procurer cent jours d’indulgences ; j’ai profité de cette occasion pour aller passer l’après-midi dans la chaumière de mon cher Noël. J’étais en route pour rentrer à Winnipeg, où je voulais arriver à la tombée de la nuit, lorsque nous avons été surpris par la tempête.
– Il faudra donc, ma chère future cousine, que vous acceptiez notre hospitalité jusqu’à demain matin. La carriole de mon ami Denis Pasquier doit précisément venir nous prendre de bonne heure, vous en profiterez.
Cet arrangement satisfit tout le monde. On donna à miss Ophélia la plus belle chambre et l’on dressa à Noël un lit dans la salle à manger.
On avait veillé si tard que tout le monde dormit d’un profond sommeil et que les habitants de la Maison Bleue ne furent réveillés le lendemain matin que par les joyeux claquements de fouet du domestique de l’homme de loi, qui arrivait avec son véhicule.
En un clin d’œil, tout le monde fut sur pied, et l’on dégusta le café préparé en hâte par les soins de Kloum et de son ami l’aliéné ; puis Noël Fless prit congé de son cousin, pour lequel il ressentait la plus vive sympathie, et tous deux se donnèrent rendez-vous pour le lendemain, afin de causer plus longuement de leurs affaires.
Comme il avait été convenu la veille, Kloum et l’aliéné demeurèrent à la Maison Bleue, tandis que lord Burydan et Oscar prenaient place dans la carriole, aux côtés de miss Ophélia.
Pendant le voyage, qui fut charmant, à travers la campagne rafraîchie par l’orage et baignée de soleil, miss Ophélia se montra plus loquace que la veille et acheva de gagner définitivement les bonnes grâces de lord Burydan. Elle raconta, avec une naïveté délicieuse, comment chez un de leurs amis communs elle avait fait connaissance de Noël, comment tous deux s’étaient juré un amour éternel et s’étaient promis de s’épouser quoi qu’il pût arriver.
– Malheureusement, fit-elle avec un soupir, il y a déjà plus d’une année que nous sommes fiancés et la situation ne semble pas près de se modifier. Et cela, grâce à l’entêtement du vieil avare. Ah ! si je possédais une belle dot, le baron Fesse-Mathieu serait le premier à accorder son consentement…
Et la pauvrette avait presque les larmes aux yeux.
– Ne vous désolez pas, fit lord Burydan, tout s’arrangera d’ici peu. Je vous le promets. Mais je ne puis vous dire encore comment je m’y prendrai pour triompher du vieux grigou.
Réconfortée par cette promesse, si vague qu’elle fût, Ophélia quitta sa mine contrite et, jusqu’au moment où l’on fit halte devant la porte de l’homme de loi, enchanta ses compagnons par son joyeux babil.
Lord Burydan ayant à conférer longuement avec M. Denis Pasquier, qui venait de Londres avec un important courrier, ce fut Oscar qui se chargea de reconduire miss Ophélia jusqu’au cottage qu’elle habitait en compagnie de sa tante et qui était situé dans la banlieue de Winnipeg.
Comme ils traversaient un quartier désert, la jeune fille montra tout à coup au bossu une maisonnette aux volets verts, à la porte de laquelle une plaque de cuivre portait cette inscription : Mme SIBYLLA, et, s’arrêtant brusquement :
– Monsieur Oscar, fit-elle en baissant la voix, je vais vous avouer une chose. J’ai la faiblesse d’être superstitieuse. Il y a un temps infini que je meurs d’envie d’aller consulter Mme Sibylla. Elle me dira peut-être si mon mariage aura bientôt lieu. Mais je n’oserais jamais entrer seule chez la sorcière : car Mme Sibylla est une vraie sorcière dont on raconte toutes sortes de prodiges.
Le bossu, sceptique par nature et par éducation en sa qualité de Parisien, ne put s’empêcher de sourire.
– Vous voudriez que je vous accompagne ? fit-il.
– Je n’osais vous le demander. Mais cela me ferait beaucoup de plaisir. Je sais que c’est un caprice ridicule que j’ai là, mais c’est plus fort que moi.
– Eh bien, soit, allons-y !
D’une main un peu agitée par l’émotion, Ophélia tira le cordon de la sonnette, après s’être assurée d’un rapide coup d’œil que personne ne la voyait entrer dans la maison du diable. L’instant d’après un vieux Noir introduisait les visiteurs dans un salon assez confortablement meublé. Très moderne, Mme Sibylla avait horreur des hiboux empaillés, des crapauds et de tout l’attirail par lequel certaines devineresses essaient d’impressionner leur clientèle. Le seul objet effrayant que l’on vît dans son salon de consultation était une tête de mort, qu’un gros chat blanc paraissait considérer avec la plus complète indifférence. Les meubles étaient américains et toute la pièce d’une scrupuleuse propreté.
Mme Sibylla ne tarda pas à paraître. C’était une femme de trente-cinq à quarante ans, et qui avait dû être fort belle. Avec son nez en bec d’aigle, ses yeux perçants et son visage cuivré, elle paraissait de la race de ces gitanes espagnoles qui sont sorcières de mères en filles depuis de longues générations.
Sans mot dire, elle fit asseoir ses deux visiteurs, et, prenant la main d’Ophélia tout interloquée, elle en contempla attentivement les lignes.
– Mademoiselle, dit-elle enfin, vous aimez et vous êtes aimée. Vous êtes venue me trouver pour savoir quand vous serez unie à votre fiancé.
– C’est vrai, balbutia miss Ophélia, toute surprise de la pénétration de la sorcière.
Mme Sibylla eut un sourire énigmatique.
– Soyez heureuse, dit-elle, vous n’aurez pas longtemps à attendre… Plusieurs personnes, d’un rang distingué, travaillent sans s’en douter à votre bonheur, mais prenez garde, je vois des assassins et des traîtres se mêler de vos affaires. Vos vœux seront exaucés, mais il y aura du feu et du sang… le squelette au linceul noir ébréchera sa faux contre l’épée lumineuse de l’ange blanc à la cuirasse d’argent.
– Aurai-je un fils ? demanda timidement miss Ophélia.
– Prenez garde, répondit la sorcière avec un regard profond, d’être mère avant que d’être épouse !
Ophélia, tout interloquée et rougissante, n’osa demander aucune explication à la devineresse. Celle-ci se retourna alors vers Oscar, qui, en vrai gavroche, souriait d’un air légèrement goguenard.
– Et vous, lui dit-elle, vous ne demandez rien ?
– Non, dit le bossu. Je ne crois pas à toutes ces machines-là.
– Vous avez tort, fit Mme Sibylla, en arrêtant sur lui ses yeux aigus. Je vois un grand danger suspendu sur votre tête… Méfiez-vous d’une automobile, c’est tout ce que je puis vous dire.
– C’est bon, dit Oscar un peu impressionné quand même, je tâcherai de faire attention à ne pas être écrasé. Merci beaucoup du renseignement. Combien vous doit-on, madame ?
– Ce que vous voudrez, fit la gitane avec indifférence.
Et elle tendait la main au bossu, qui y déposa deux dollars.
Une fois sorti de chez la pythonisse, Oscar prit congé de la jeune fille, qui ne se trouvait plus qu’à quelques pas de sa demeure et se hâta de courir au bureau de poste où, comme il le craignait, ne se trouvait aucune lettre à son adresse. Dès lors, sa résolution fut prise, il prendrait le train pour New York le lendemain même. Après avoir déjeuné chez M. Denis Pasquier, Oscar et lord Burydan employèrent une partie de l’après-midi à diverses emplettes et il faisait presque nuit quand ils reprirent à pied le chemin de la Maison Bleue ; lord Burydan annonça à Oscar qu’il était très satisfait, car, grâce aux pièces d’identité venues de Londres, l’homme de loi l’avait informé que son affaire allait avoir une solution immédiate.
Entraînés par la vivacité de leur conversation, les deux amis firent les trois quarts du chemin sans s’en apercevoir. La nuit était tout à fait venue et l’obscurité était encore augmentée par l’ombrage des hauts sapins noirs qui bordaient la route.
Tout à coup, Oscar et son compagnon entendirent derrière eux le ronflement d’une auto. Ils se retournèrent.
La voiture, une gigantesque automobile rouge et noir, arrivait sur eux tous phares allumés avec une vitesse vertigineuse. Ils n’eurent que le temps de se garer sur le talus de la route.
– L’auto fantôme, s’écria Oscar épouvanté, celle de New York !
Il ne put achever. Deux détonations avaient retenti, le bossu roulait à terre en poussant un cri de douleur et lord Burydan entendait siffler une balle à son oreille.
L’auto qui avait un instant ralenti sa marche, pour permettre à ceux qui la montaient de viser plus sûrement, avait repris sa course folle et s’était déjà fondue dans les ténèbres comme une apparition de cauchemar.
CHAPITRE VII
Une mésaventure du baron Fesse-Mathieu
Ce matin-là, Slugh et Sam Porter avaient été faire des fagots dans un des bois du domaine et ils achevaient de les décharger pour les empiler dans la cour du château, lorsqu’un adolescent vêtu de noir et qui n’était autre que le petit clerc de M. Denis Pasquier apparut à l’entrée de la cour. Il déposa une grande enveloppe jaune entre les mains de Slugh, puis il disparut, en courant aussi vite que si le diable l’eût emporté.
– Qu’est-ce encore que cela ? grommela le baronnet, en relevant son bonnet de peau de lièvre pour mieux assujettir sur son nez une vénérable paire de lunettes à monture de corne qui avait dû être fabriquée à l’époque de la mort du général Montcalm.
Mais, sitôt qu’il eut jeté un coup d’œil sur le papier que renfermait l’enveloppe, il eut un geste de colère et se mit à marcher avec agitation de long en large dans la vaste cour.
Slugh et Sam Porter se faisaient du bon sang en regardant le manège de l’avare, et, de temps en temps, l’un ou l’autre des deux bandits passait derrière la charrette de fagots pour s’esclaffer tout à son aise. Une demi-heure s’écoula de cette façon ; mais tout à coup Tom et Fanor jetèrent des aboiements furieux, et Slugh eut beaucoup de mal à les empêcher de s’élancer sur une jeune fille de mise simple et modeste, mais d’une éclatante beauté, qui sortait de l’avenue de sapins et s’avançait vers le château.
– C’est assommant, grommela l’avare. Ici on est dérangé à chaque instant. On n’est plus chez soi, ma parole.
Cette réflexion eût paru d’autant plus humoristique à un témoin impartial que le baronnet, que tous les gens du pays fuyaient comme la peste, restait quelquefois un mois entier sans recevoir la plus insignifiante visite.
L’avare s’était avancé au-devant de la visiteuse.
– Que désirez-vous ? fit-il d’une voix aigrelette. Je n’ai pas de temps à perdre en bavardages.
La jeune fille rougit d’un accueil aussi discourtois, mais elle s’était sans doute armée de courage, car elle répondit, sans montrer aucune émotion :
– Monsieur le baron, il faut absolument que je vous parle.
Et elle ajouta avec une noble simplicité :
– Je suis miss Ophélia, la fiancée de votre fils Noël.
L’avare eut un geste de rage.
– Alors, s’écria-t-il en mettant presque son poing sous le nez de la jeune fille, notre conversation sera vite finie. Vous connaissez mes intentions ? Je n’ai pas changé d’opinion à votre sujet et je n’en changerai jamais ! Je vous trouve passablement effrontée de venir me relancer jusque chez moi !
Et il pirouetta sur ses talons, fit mine de monter les marches du perron délabré. Mais Ophélia avait fait provision d’une dose d’intrépidité extraordinaire.
– Monsieur le baron, murmura-t-elle, je savais que votre décision était immuable, mais la situation maintenant n’est plus la même.
Le vieux Juif errant se retourna avec la prestesse d’un écureuil et une espèce de sourire se dessina sur son visage émacié par le jeûne.
– Auriez-vous hérité, ma belle enfant ? dit-il gracieusement.
– Non, monsieur le baron, répondit Ophélia dont le visage se couvrit de la rougeur de la honte. Mais votre fils m’a rendue mère, et c’est aujourd’hui pour vous un devoir de ne plus vous opposer à notre union.
Cette révélation produisit sur le vieillard le même effet que s’il eût tout à coup mis la main sur une pile électrique. Il bondit, au risque de déchirer le pantalon qu’il portait depuis plusieurs lustres ; il tirailla les touffes de sa longue barbe blanche, comme s’il eût voulu l’arracher par poignées à la façon des prophètes hébreux quand il se produisait quelque calamité publique ; puis il leva les bras au ciel et, montrant d’un doigt aussi décharné que celui d’un squelette l’entrée de l’avenue :
– Allez-vous-en, coureuse, fille de joie ! hurla-t-il. Ce n’est donc pas assez d’avoir débauché mon fils Noël, de l’avoir brouillé avec moi, vous voulez encore qu’il reconnaisse le bâtard que vous allez mettre au jour !
Ophélia, épouvantée de cette grossièreté, s’enfuit en sanglotant. Slugh et Sam Porter, qui avaient assisté de loin à cette scène, demeuraient en proie à la plus vive surprise.
Le baronnet était dans un tel état d’exaspération que, rompant avec toutes ses habitudes de discrétion et d’égoïsme, il s’avança vers ses deux domestiques pour leur faire partager son indignation.
– Quelle guigne, s’écria-t-il, je suis vraiment bien malheureux ! Mon fils mène une conduite indigne. Il me déshonore… Et si ce n’était que cela, ajouta-t-il, en brandissant la lettre qu’il venait de recevoir. Mais voilà qu’un escroc, qu’un bandit, qui a pris le nom de lord Burydan, mon parent, un malfaiteur recherché par la police de New York, un fou, un chenapan de la pire espèce, veut me chasser de mon château, me voler mes domaines !…
Slugh et Sam Porter avaient échangé un regard singulier.
– Mais, dit Slugh d’un air de componction presque attendrie, il faut espérer que ce bandit ne réussira pas.
– Mais c’est que je n’en sais rien. Tout le monde, paraît-il, a pris son parti en Angleterre. Il est défendu par ce Denis Pasquier, qui est un de mes ennemis personnels. Que voulez-vous que fasse un pauvre vieillard contre tant d’ennemis ? Ah ! si je savais seulement où il est, le coquin !
– Monsieur le baron, répondit Slugh, avec une hypocrite compassion, vous savez que je vous suis profondément dévoué. Je vous regarde comme mon bienfaiteur.
– Je sais que vous êtes de braves garçons tous les deux, murmura l’avare avec attendrissement.
– Eh bien, monsieur le baron, voulez-vous me permettre de vous donner, en même temps qu’un utile renseignement, un excellent conseil : en allant hier à Winnipeg, où vous m’avez envoyé, j’ai pu apprendre bien des choses.
– Parlez vite.
– Eh bien, ce pseudo-lord Burydan qui vous fait tant de misères, savez-vous où il habite ? À une demi-heure d’ici, de l’autre côté du torrent, dans le cottage de la Maison Bleue, qui lui a été loué ou prêté par l’homme de loi Pasquier.
– Diable ! murmura l’avare avec une grimace, l’ennemi est à nos portes.
– C’est précisément une circonstance dont vous pouvez tirer le plus grand parti. Cet escroc est recherché par la police américaine. Il a commis un meurtre, il a pillé une maison de santé.
– Eh bien ?
– Il vous suffirait de le dénoncer, pour qu’il soit mis en prison, condamné, ce qui changerait rudement la face des choses.
Le visage de l’avare s’épanouit en un vaste sourire ; il rayonnait.
– Slugh, balbutia-t-il, vous êtes le plus dévoué et le plus intelligent des serviteurs, et, foi de gentilhomme, je vous coucherai sur mon testament. Je cours de ce pas à Winnipeg.
Lorsque la falote silhouette du vieillard eut disparu entre les arbres de l’avenue, Slugh et Sam Porter eurent un bruyant éclat de rire. Ils se tenaient les côtes et se tapaient sur la cuisse comme si cette hilarité ne dût jamais prendre fin.
– Il est réussi, le vieux, fit Slugh. Je me souviendrai toujours du temps que nous avons passé dans ce château. C’est un des bonheurs de ma vie.
– Possible, grommela Sam Porter, mais si nous n’avions pas eu nos provisions à nous, il y a longtemps que nous serions morts de faim…
Et il ajouta d’un ton plus sérieux :
– Mais quel est donc ton projet, avec cette histoire de dénonciation ?
– C’est tout simple. Lord Burydan, le bossu – qu’entre parenthèses tu as été assez maladroit pour manquer l’autre jour –, le Peau-Rouge et l’autre vont être arrêtés, et naturellement nous aiderons à cette arrestation. Ils feront de la résistance, c’est certain. Il faudrait être bien malchanceux si nous ne les tuions pas tous les quatre à la faveur de la bagarre.
– Ah ! je comprends !…
– On nous reprochera peut-être d’avoir montré trop de zèle, mais, somme toute, on nous félicitera. Nous aurons eu dans cette affaire les policemen comme collaborateurs et la Main Rouge ne sera en rien compromise ni même soupçonnée. Ensuite, nous nous occuperons du coffre-fort.
– Cela n’a pas l’air d’être si commode que cela. Ce vieux grigou est méfiant comme un renard. Son revolver ne le quitte jamais. Et, chaque soir, il s’enferme dans sa chambre bardée de fer, dont nous avons vainement essayé de forcer la porte. Toi qui disais que ça serait si facile !
Tout en discutant le meilleur moyen de mettre la main sur le trésor de l’avare, les deux bandits profitèrent de son absence pour se rendre à leur garde-manger secret et y faire un lunch substantiel, copieusement arrosé de « canadian whisky ».
… Quand, trois heures après, le baronnet fut de retour, il trouva ses deux serviteurs modèles dans toute la fièvre du travail, mais c’est à peine s’il y fit attention. Il paraissait atterré.
– Tout est perdu, murmura-t-il ; l’escroc s’est fait reconnaître comme le vrai lord Burydan, et demain on doit me signifier un arrêté d’expulsion. Je vais être obligé de quitter ce beau château, où je comptais finir mes jours, ces vastes domaines que je comptais léguer à mes enfants !
Le bonhomme avait les larmes aux yeux. Slugh parut vivement touché de son chagrin.
– Monsieur le baron, fit-il avec indignation, ce qui se passe est vraiment honteux. Vous êtes victime d’un abominable complot et, à votre place, moi je n’hésiterais pas !… Après tout, vous êtes dans le cas de légitime défense.
– Que voulez-vous dire ?
– Moi, je suis franc comme l’or, je n’y vais pas par quatre chemins. Si vous voulez me laisser faire, je me charge de vous débarrasser de lord Burydan.
– Quel est votre plan ? fit le vieillard, qui se reprenait à espérer.
– Oh ! c’est bien simple. Je vais à la Maison Bleue prier lord Burydan de venir vous parler, sous prétexte d’arrangement. Pour venir ici, il n’y a qu’un chemin, il faut traverser le torrent du Ruisseau Rugissant, sur le pont de bois. Ce pont est passablement vermoulu et, dame, un accident est vite arrivé.
– Je comprends, s’écria l’avare, dont le visage s’illumina. Vous avez là une idée de génie, mon brave Slugh.
– D’autant plus, poursuivit le bandit, qu’il va faire nuit dans une heure. Et, dans les ténèbres, il est facile de faire un faux pas.
Sans donner le temps au baronnet de se repentir de sa décision, Slugh et Sam Porter se munirent d’une hache et d’une pioche, et disparurent dans la direction de la Maison Bleue. Resté seul, le vieillard entra dans la cuisine du château et s’assit sous le vaste manteau de la cheminée, près d’un feu de bois mort, prudemment recouvert de cendres.
Le baronnet était agité et perplexe, il passait ses maigres doigts dans sa longue barbe blanche avec un geste plein d’anxiété, et, toutes les cinq minutes, il se levait et allait jusqu’à la porte pour voir si ses émissaires ne revenaient pas. Mille sentiments contradictoires se heurtaient en lui. À certains moments, il regrettait de s’être confié à Slugh et à Sam Porter, qui étaient, après tout, des inconnus, des coureurs de grands chemins, et à d’autres, il s’applaudissait de sa décision.
Enfin les deux bandits apparurent au seuil de la vaste cuisine, l’air aussi calme que deux honnêtes bûcherons qui reviennent de leur travail.
– Eh bien ? demanda l’avare avec anxiété.
– L’affaire est faite, répondit Slugh. Maintenant vous n’avez plus rien à redouter de lord Burydan.
– Et vous pourrez faire dire des messes pour le repos de son âme, ajouta Sam Porter d’un ton légèrement goguenard.
– Racontez-moi cela, interrogea le baronnet avidement.
– Oh ! cela n’a pas souffert la moindre difficulté, répondit Slugh. Je suis arrivé à la Maison Bleue, j’ai vu le soi-disant lord Burydan, et je lui ai poliment exposé que vous seriez heureux de le voir, pour terminer à l’amiable le différend qui vous sépare. Il a répondu insolemment qu’il ne voulait faire avec vous aucun arrangement, mais qu’il ne serait pas fâché quand même de voir de près un original de votre espèce. Pendant que je faisais cette visite, Sam Porter donnait quelques bons coups de pioche à la base des pieux qui soutiennent le pont, quelques coups de hache dans les poutrelles vermoulues, puis, quand je l’ai eu rejoint, nous nous sommes cachés tous deux dans un fossé pour voir ce qui allait se passer.
– Et alors ? demanda l’avare qui, tout entier au récit de Slugh, ne s’aperçut pas que Sam Porter venait de passer sournoisement derrière le fauteuil où il était assis.
– Tout s’est passé comme je l’avais prévu, lord Burydan et un Peau-Rouge qui lui sert habituellement de garde du corps se sont aventurés sur le pont… ils ont fait trois pas. Je commençais déjà à croire que Sam Porter s’était mal acquitté de sa besogne, lorsque, tout à coup, il y eut un patatras formidable, un grand cri, puis plus rien. Et, vous le savez, un homme qui tombe dans le Ruisseau Rugissant peut être considéré comme perdu.
L’avare poussa un soupir de soulagement.
– Ouf ! s’écria-t-il, voilà qui me tire une fameuse épine du pied…
Le reste de la phrase lui resta dans le gosier, car Sam Porter, obéissant à un coup d’œil significatif de Slugh, l’avait saisi à l’improviste et était en train de l’étrangler.
– Ne serre pas si fort ! s’écria Slugh. C’est idiot, ce que tu fais là. Si tu commences par lui tordre le cou, qui est-ce qui nous ouvrira la porte de la chambre de fer ?
Sam Porter comprit le bons sens de ce conseil et laissa respirer un peu le baronnet, déjà à moitié suffoqué. Slugh avait tiré de sa poche une cordelette et, avec une dextérité toute professionnelle, il garrotta le vieillard si épouvanté qu’il ne prononça pas une parole.
– Mon vieux, lui dit brutalement Slugh, il s’agit maintenant de nous donner la clef de la chambre de fer. Tu comprends bien que ce n’est pas pour ton plaisir que nous sommes restés chez toi à crever de faim et à travailler comme des bêtes de somme.
– La clef ?… Jamais ! murmura l’avare d’une voix rauque.
– Nous allons nous passer de ta permission, dit Slugh, en explorant lestement les poches de la pelisse-robe de chambre, d’où il retira une foule d’objets hétéroclites : des croûtons, des bouts de ficelle, des clous rouillés, et jusqu’à des morceaux de charbon de terre.
Enfin, il brandit triomphalement un trousseau de clefs de toutes les dimensions.
– Ça ne vous servira de rien, bandits, rugit l’avare, je connais seul le moyen d’ouvrir la chambre de fer. Je ne vous le dirai pas. Vous me tueriez plutôt !
– Nous n’allons pas te tuer ! dit Slugh avec un sang-froid épouvantable. Je connais un moyen radical de faire parler les entêtés.
Sam Porter s’était agenouillé près de l’âtre et soufflait de toute la force de ses poumons sur les tisons couverts d’une cendre blanche. Bientôt la flamme crépita joyeusement. Pendant ce temps, Slugh avait enlevé les sabots de l’avare et ses longs bas de laine grise ; deux pieds décharnés apparurent, armés d’ongles aussi recourbés et aussi tranchants que ceux des diables de Goya. L’avare, qui avait compris quel genre de supplice on lui destinait, tremblait de tous ses membres, ses dents claquaient.
– Veux-tu nous dire le secret de la chambre de fer ? demanda Slugh une dernière fois d’un ton menaçant.
– Non, non, mille fois non !
– C’est bien. Sam Porter, approche monsieur le baron du feu.
Saisissant de force les pieds griffus de l’avare, Slugh les posa sur les charbons ardents.
Le vieillard lança un hurlement sauvage.
– Au secours ! À l’assassin ! Grâce ! Pitié ! Laissez-moi !
– Ouvre-nous la chambre de fer, répéta Slugh avec insistance.
– Non ! non. C’est impossible ! Je vous en supplie !…
– Alors ce sera tant pis pour toi.
Et le bandit appliqua de nouveau sur les tisons les pieds de Mathieu Fless, qui poussa un second hurlement de douleur.
Mais, à ce moment, la porte vola en éclats et une troupe d’hommes, revolver au poing, fit irruption dans la cuisine de l’avare.
Une demi-douzaine de détonations retentirent.
Sam Porter, atteint d’une balle en plein front, fut tué net.
Slugh, légèrement blessé, fonça comme un sanglier sur les assaillants, se fraya un passage vers la porte et disparut.
Les nouveaux venus – lord Burydan, Kloum, Noël Fless, Ophélia, Oscar Tournesol, et l’aliéné lui-même – ne songèrent pas à poursuivre le bandit. Ils s’empressèrent de prodiguer leurs secours au vieillard, qui paraissait près de s’évanouir.
Lord Burydan et Kloum, tous deux excellents nageurs, avaient réussi à échapper aux flots du Ruisseau Rugissant. Ils avaient deviné sans peine de quel guet-apens ils venaient d’être victimes.
Revenus en hâte à la Maison Bleue pour y changer de vêtements, ils avaient rencontré, chemin faisant, Noël et Ophélia, qu’ils avaient mis au courant de leur aventure. C’est alors qu’ils avaient décidé de se rendre tous chez l’avare pour lui reprocher sa trahison.
Lorsqu’on eut pansé les blessures du baronnet, lord Burydan lui dit sévèrement :
– Vous allez quitter demain ce château. Vous auriez mérité que je vous procure un autre logement à la prison de Winnipeg, mais je vous trouve suffisamment puni. Je ne porterai donc pas plainte contre vous. Ce sera à la condition expresse que vous signiez séance tenante votre consentement au mariage de Noël et de miss Ophélia, que je me charge de doter.
Honteux et confus, l’avare signa tout ce qu’on voulut, sans mot dire. Et, en reconnaissance de sa bonne volonté, on lui laissa Kloum comme garde-malade pour soigner ses brûlures.
Avant de se retirer, lord Burydan put constater que son château avait été littéralement mis au pillage. Les tableaux de maîtres, les tentures précieuses et les meubles de style avaient été vendus par l’avare et convertis en argent comptant ; mais on remit à plus tard le soin de régler la question des dommages et intérêts auxquels le baron Fesse-Mathieu ne pouvait manquer d’être condamné.
Tout le monde revint à la Maison Bleue, où lord Burydan voulait offrir à ses amis un joyeux souper pour célébrer son triomphe sur son déloyal héritier. Mais, comme ils traversaient la grand-route de Winnipeg, une automobile, lancée à une vitesse furieuse, les frôla et faillit presque les renverser.
C’était une voiture rouge et noir. Elle était montée par un seul homme, dans lequel miss Ophélia crut reconnaître Slugh.
– L’automobile fantôme ! murmura Oscar, dont le bras blessé était encore en écharpe.
– Que nous importent ces bandits ! s’écria lord Burydan. Maintenant que je suis rentré en possession de mon nom et de ma fortune, je vais faire une guerre à mort à la Main Rouge. J’exterminerai les tramps dans leur repaire de l’île des pendus, j’en fais ici le serment solennel !
NEUVIÈME ÉPISODE
Le cottage hanté
CHAPITRE PREMIER
La bodega du
« Vieux-Grillage »
La bodega du « Vieux-Grillage », miraculeusement préservée lors du dernier tremblement de terre, est située dans le quartier de Queen-City, à San Francisco. C’est un des plus anciens établissements de la ville et sa construction remonte à l’époque héroïque et déjà légendaire de l’invasion de la Californie par les chercheurs d’or.
Le vieux grillage qui a donné son nom à la maison se compose de barres de fer grosses comme le poignet, séparant entièrement la salle où se trouvent les buveurs du comptoir des bouteilles d’alcool de toutes provenances.
Au temps où sévissait la fièvre de l’or, où les femmes amenées par des traitants du Chili et du Mexique se vendaient couramment aux enchères, tous les bars étaient pourvus de grillages semblables. Il n’était pas rare, en effet, qu’un homme fût assassiné pour une tranche de jambon ou un verre de whisky ; et l’on comptait, en y comprenant les exécutions sommaires des voleurs, des picks, une moyenne de deux à trois cents meurtres par jour.
Alors, les barmen ne servaient leur clientèle que le revolver à la ceinture ; et ils n’allongeaient la consommation commandée qu’après avoir empoché la poignée de poudre d’or qui en représentait le prix.
Avec le temps, ces mœurs féroces s’étaient modifiées, San Francisco, plusieurs fois reconstruite après des incendies et des tremblements de terre, était devenue une ville de luxe ; mais la bodega, précieusement conservée, avait survécu à tous les changements.
Le grillage, il est vrai, n’est plus là que pour le pittoresque, et le propriétaire actuel de l’établissement avait joint à l’étroit comptoir de jadis une longue salle pourvue d’une estrade pour les représentations de music-hall, bondée chaque soir d’une clientèle disparate, dans laquelle on eût trouvé un échantillon de toutes les races humaines.
Il y avait là des Chinois, des Japonais, des Allemands, des Mexicains et un certain nombre de Papous, de Maoris et de types d’autres races océaniennes, venus en Amérique avec des navires chargés de nacre, de copra et d’écaille de tortue, et reconnaissables à leur teint d’un brun doré, à l’expression douce et pensive de leurs physionomies.
Des chanteuses atrocement maquillées se montraient tour à tour sur l’estrade située au fond de la salle, mais c’est à peine si on les apercevait à travers le nuage épais de la fumée des cigares, si on les entendait, au milieu des chants, des rires, des vociférations qu’un orchestre de guitaristes mexicains n’arrivait pas à dominer.
Ce soir-là, le vaste hall, dont le plafond bas était décoré de drapeaux de toutes les nations, était tellement rempli que les nègres qui faisaient le service avaient de la difficulté à circuler à travers l’étroite allée ménagée entre les tables.
Dans un coin, trois hommes attablés autour d’un bol de punch devisaient avec animation tout en fumant des cigares de Manille.
L’un d’eux prenait à peine part à la conversation. C’était un matelot à la physionomie stupide, mais loyale, aux mains énormes et qui répondait au nom de Hardy.
Quant à ses compagnons, ils formaient entre eux l’opposition la plus complète.
L’un, mis presque avec luxe, avait les allures paisibles d’un employé de banque ou d’un domestique de bonne maison ; ses favoris blonds étaient taillés soigneusement et sa tenue était d’une correction parfaite.
L’autre avait la mine d’un véritable bandit. Sa face basanée était encadrée d’une barbe et de cheveux grisonnants, et ses yeux jaunes avaient la mobilité particulière à ceux des malfaiteurs ; ils exprimaient la ruse, la cupidité et l’inquiétude. Ses vêtements de toile grossière faisaient contraste avec les nombreuses bagues dont ses doigts étaient chargés et le paquet de breloques qui tintinnabulaient à la chaîne de sa montre.
Il se nommait le capitaine Christian Knox, et même dans les bouges de San Francisco où l’on se montre très accommodant sur la question de moralité, il possédait la plus déplorable réputation. Accusé deux fois déjà d’assassinat, mais acquitté faute de preuves, il passait pour se livrer à la piraterie.
– Monsieur Edward Edmond, dit le capitaine à son compagnon, je suis entré aujourd’hui dans le chantier où se construit le fameux yacht, et j’ai pu me rendre compte que vous n’avez rien exagéré.
– C’est que, répondit l’homme aux favoris, on ne ménage pas les bank-notes, je vous prie de le croire. Tout est de première qualité, depuis la coque en acier jusqu’aux machines qui sont munies des derniers perfectionnements.
– D’après ce que j’ai vu, c’est un bateau qui filera facilement ses trente nœuds à l’heure. Mais, par exemple, ajouta le capitaine, dont la curiosité était vivement excitée, je me demande à quoi pourra servir un pareil yacht.
– C’est vrai, approuva le matelot Hardy, on dirait tout à fait un vaisseau de guerre.
– Sur ce sujet, fit Edward Edmond, je n’en sais pas plus long que vous.
– Mais enfin, quelle traversée fera-t-il ? demanda le capitaine avec insistance.
– Je l’ignore.
– Que diable, vous devez pourtant connaître ceux qui le font construire ?
– Cela se pourrait… mais je n’ai le droit de rien vous dire.
– À votre aise, grommela le capitaine Knox d’un ton bourru ; cependant toutes ces cachotteries-là ne me présagent rien de bon. On me dirait que ce yacht-là est destiné à faire la course, à couler bas les jonques chinoises et les voiliers anglais dans les parages de la Polynésie que je n’en serais pas surpris.
– Qui peut vous faire croire une pareille chose ?
Le marin secoua la tête avec méfiance.
– Voyez-vous, moi, murmura-t-il, je suis un vieux macaque à qui l’on ne fait pas prendre les vessies pour des lanternes. Votre damné bateau ne ressemble ni à un yacht de plaisance ni à un vapeur de commerce.
– Alors, cela ne vous dirait rien de vous embarquer avec nous en qualité de premier lieutenant ? Tout le monde sait que vous êtes un homme énergique et un excellent marin.
– Possible ! Mais quand je prends la mer, c’est pour mon compte, sur un bateau à moi. Je ne veux recevoir d’ordres de personne.
– Comme il vous plaira, fit Edward Edmond dont la physionomie exprima le désappointement.
À ce moment, la conversation fut interrompue par les applaudissements des spectateurs qui faisaient ovation à de petites danseuses javanaises, maigres, brunes et frétillantes comme des cigales. Quand le tapage se fut un peu apaisé, Edward Edmond se tourna vers le matelot.
– Et vous, Hardy, lui demanda-t-il, qu’en pensez-vous ? Que diriez-vous d’un engagement de trois mois avec double solde, nourriture de premier choix, et pas trop de fatigue ?
L’homme eut un rire épais.
– Ma foi, acquiesça-t-il, j’en suis. On ne trouve pas tous les jours une occasion pareille. Puis, on ne me fera jamais croire qu’un si beau navire soit destiné à faire la piraterie.
– Alors, c’est entendu, vous passerez demain à mon bureau signer votre engagement, et, bien que le yacht ne doive prendre la mer que dans six semaines, je vous verserai un mois d’avance…
À l’instant précis où Edward Edmond prononçait ces paroles, une main se posa sur son épaule.
Il se retourna avec un brusque mouvement ; mais à l’aspect du nouveau venu, il pâlit et sa physionomie exprima un certain trouble.
– Vous ici, monsieur Slugh ! fit-il avec agitation.
Slugh, un homme de carrure athlétique et dont la barbe grise lui descendait jusqu’à la ceinture, eut un sourire malicieux.
– Comme vous voyez, répondit-il. Charmé de vous rencontrer. J’ai précisément quelque chose à vous dire. Vous avez bien un instant ?
Sans attendre la réponse de son interlocuteur, il le prit familièrement par le bras et l’emmena à deux pas de là, en face d’une table inoccupée.
– Alors, dit Slugh sans préambule, vous n’occupez plus les honorables fonctions de concierge en chef chez le milliardaire Fred Jorgell ? Vous vous êtes fait recruteur de matelots.
– Qui a pu vous dire cela, monsieur Slugh ? riposta l’Irlandais avec embarras.
– N’importe. L’essentiel, c’est que je sois bien informé. Mais je continue… Vous n’avez pas quitté le service du milliardaire, mais comme il a en vous une grande confiance – confiance entre nous assez mal placée –, c’est vous qu’il a chargé de lui trouver des gaillards solides et honnêtes pour une mystérieuse expédition dont le but vous est d’ailleurs parfaitement inconnu.
– Très exact.
– Eh bien, mon cher master Edward, je me suis mis en tête de vous aider dans votre tâche et j’ai des raisons de croire que vous suivrez mes conseils de point en point. Ainsi, par exemple, ce Hardy que vous venez d’embaucher, je n’en veux pas.
– Pourquoi cela ? fit le représentant de Fred Jorgell au comble de la surprise.
– Tout simplement parce qu’il me déplaît.
– Mais…
– C’est comme cela.
Edward Edmond demeura silencieux. Un violent, combat se livrait en lui-même.
– Il ne me sera guère possible, reprit-il, de vous obéir. Ainsi, par exemple, ce Hardy…
– Vous le renverrez en l’indemnisant. D’ailleurs, poursuivit Slugh, vous devez vous douter que vous ne perdrez rien à cette combinaison. Vous touchiez mille dollars par mois pour me laisser examiner le courrier de Fred Jorgell, vous en toucherez deux mille à la condition de n’engager que les marins que je vous désignerai moi-même.
Edward Edmond paraissait hésitant.
– C’est que, balbutia-t-il, je ne fais pas entièrement ce que je veux dans cette affaire : je ne suis pas le maître. Je ne demande pas mieux que de vous être agréable, mais…
– Comme il vous plaira, fit Slugh avec une froideur glaciale.
Et il regardait fixement l’Irlandais qui se sentait frissonner.
Il y eut un long silence.
– Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour vous être agréable, bégaya Edward Edmond profondément troublé.
– Je ne veux pas d’une demi-promesse de cette sorte, répliqua brutalement Slugh. Vous ferez tout ce que je vous dirai exactement, ou vous ne ferez rien du tout, et ce sera tant pis pour vous !…
Entre les deux hommes il y eut encore un silence.
Mais tout à coup les guitaristes mexicains attaquèrent une habanera d’un rythme enragé, l’électricité flamboya, plus aveuglante, et dans un ouragan d’applaudissements et de hourras, la Dorypha parut, un sourire méprisant aux lèvres, sûre qu’elle était de sa puissance sur cette foule.
– Le tango ! criaient les uns.
– Non, non ! répétaient les autres, la mexicana !
– Non ! la habanera !
La Dorypha continuait à sourire énigmatiquement, faisant rouler lentement ses hanches d’un mouvement harmonieux, et son indécision portait à son comble l’enthousiasme et les désirs des spectateurs.
Mais, tout en semblant en apparence indifférente, la danseuse fouillait la salle de son regard aigu ; et tout de suite, elle aperçut Edward Edmond.
Leurs yeux se rencontrèrent et l’Irlandais tressaillit comme s’il eût posé le doigt sur un fer rouge. Cette scène muette n’avait point échappé à Slugh.
– Eh bien ! s’écria-t-il, quelle est votre décision ?
– Je vous obéirai en toute chose, répliqua l’employé de Fred Jorgell avec un fiévreux empressement. Vous n’avez qu’à commander, je suis votre homme.
La présence de la gitane avait suffi pour triompher de toutes les hésitations d’Edward Edmond qui, depuis plusieurs mois, était son amant. Devant la Dorypha, l’Irlandais n’était plus lui-même. Il suffisait d’un seul regard de ses beaux yeux langoureux pour réduire à néant ses résolutions les plus fermes.
– Je suis content de vous voir devenu plus raisonnable, dit Slugh qui ne paraissait nullement surpris de ce revirement. Les hommes que je vous présenterai sont des gaillards solides et en qui l’on peut avoir toute confiance. D’ailleurs, vous pourrez toucher mille dollars d’acompte quand vous voudrez, dès demain si cela vous fait plaisir.
Cependant, la Dorypha, qui avait eu le temps d’échanger avec Slugh un signe imperceptible, avait commencé à danser la habanera, qui était son grand succès, et dans le silence qui tout à coup avait envahi la salle, naguère si bruyante, on n’entendait que le souffle des respirations haletantes de désirs, que le battement de tous les cœurs en débandade.
Slugh prit rapidement congé d’Edward Edmond, et celui-ci alla se rasseoir près du capitaine Christian Knox et du matelot Hardy. Tous deux ne purent s’empêcher de penser qu’il avait quelque préoccupation grave, car tout d’un coup il était devenu taciturne, mélancolique, et ses regards ne quittaient plus la danseuse, qui maintenant, le torse cambré, les seins en avant, la croupe vibrante, semblait s’offrir toute à cette multitude râlante de luxure.
Slugh s’était éloigné tout doucement et, gagnant le fond de la salle, il était entré dans un « parloir » dont la porte s’ouvrait presque en face du fameux comptoir grillagé.
À cet endroit il y avait deux hommes attablés devant un sherry-gobler. Ils ne portaient pas de masques, mais des lunettes de chauffeur d’automobile, des feutres à larges bords et d’amples foulards de soie dissimulaient entièrement leurs traits. Slugh en entrant se découvrit et vint s’asseoir dans une attitude respectueuse en face des deux gentlemen.
– Eh bien, demanda l’un d’eux d’une voix sourde, avez-vous réussi, master Slugh ?
– Oui, milord : l’Irlandais sera désormais le plus fidèle des esclaves de la Main Rouge.
– Alors, il ne s’est pas fait tirer l’oreille ?
– Hum ! il ne paraissait pas très décidé ; mais il a suffi d’un regard de la Dorypha pour le rendre docile. Il est fou de cette fille. Elle lui mangera jusqu’à son dernier dollar et le conduira à la potence !
– C’est bien, Slugh, vous pouvez vous retirer ; demain vous recevrez de nouvelles instructions.
Le bandit salua obséquieusement et disparut. Dès que la porte se fut refermée derrière lui, le plus grand des deux buveurs dit à l’autre :
– Vous savez, mon cher Cornélius, que tout à l’heure, quand j’ai jeté un coup d’œil dans la salle, j’ai vu la danseuse. Tout ce que Slugh en a raconté n’est pas exagéré, elle est véritablement affolante.
– Vous la trouvez belle ?
– Merveilleuse.
– Méfiez-vous, Baruch, avec les préoccupations que nous avons, la question « femme » doit être soigneusement écartée, du moins pour l’instant.
– Oh ! soyez tranquille, docteur ; si je vous ai parlé de cette fille, c’est d’une façon tout à fait désintéressée.
Le docteur Cornélius ne répondit pas. Son attention venait d’être brusquement attirée par un bibelot placé sur la cheminée du parloir ; c’était une simple bouteille en verre verdâtre, mais, par suite d’un long séjour au fond de la mer, elle était recouverte de concrétions pierreuses, de coquillages et de coraux, qui lui donnaient la bizarrerie élégante de quelque vase dû au caprice d’un artiste chinois ou japonais.
– Voilà qui est curieux, dit Baruch.
– C’est plus que curieux, répliqua Cornélius.
– Au point de vue scientifique ?
– Nullement. Mais ce bibelot baroque pourra nous servir dans nos projets…
Cornélius avait appuyé sur un bouton électrique. Un waiter parut.
– Demandez au publicain, fit Cornélius, combien il veut de cette bouteille.
– Je sais qu’il y tient beaucoup, répliqua l’homme.
– C’est bon, qu’il fasse son prix, je ne marchanderai pas.
Le waiter revint cinq minutes après. Le patron voulait quinze dollars.
– Ce n’est pas trop cher, dit le docteur ; voici l’argent, mais tâchez de me trouver une petite boîte de carton pour que je ne détériore pas l’objet en l’emportant.
Cinq minutes après, le docteur Cornélius et son compagnon sortaient de la bodega du Vieux-Grillage aussi mystérieusement qu’ils y étaient entrés, profitant, pour n’être pas remarqués, de l’instant où, sous les hourras frénétiques des spectateurs qui applaudissaient la Dorypha, les murailles branlantes du music-hall semblaient prêtes à s’écrouler.
CHAPITRE II
Une lettre rassurante
L’armateur du yacht dont la construction mettait en rumeur toutes les cervelles des matelots de San Francisco, c’était le milliardaire Fred Jorgell. Nul ne doutait que le spéculateur, célèbre dans toute l’Amérique par ses audacieuses entreprises, ne préparât quelque expédition d’un genre original et grandiose.
Mais, là-dessus, personne n’eût été capable de fournir le moindre renseignement. Le milliardaire et les gens de son entourage observaient envers tout le monde la réserve la plus complète. Les curieux en étaient réduits aux suppositions.
Les uns disaient que Fred Jorgell allait exploiter, sans avoir rempli aucune formalité légale, une mine d’or située dans une île inconnue ; les autres parlaient d’un banc d’huîtres perlières découvert près d’un récif océanien ; pour d’autres encore, il s’agissait d’un gisement de guano plus riche que ceux des îles Chincha.
Le riche Yankee ne démentait aucun de ces bruits, mais il se renfermait dans un mutisme absolu ; et après plusieurs semaines, les indiscrets n’étaient pas plus avancés qu’au premier jour.
Quotidiennement appelé par ses multiples affaires à San Francisco et à New York, le milliardaire faisait sans cesse la navette entre les deux villes ; et le wagon de luxe qui était sa propriété personnelle était attelé, pour ainsi dire en permanence, à l’un des trains rapides du « Central Pacific Railroad », qui coupe dans toute sa largeur le continent américain.
À dix lieues de San Francisco, au milieu d’un site enchanteur, Fred Jorgell avait installé sa fille, miss Isidora, dans un vaste et luxueux cottage où plusieurs amis du milliardaire trouvaient aussi l’hospitalité.
« Golden-Cottage » était véritablement une résidence unique ; bâtie dans une vallée verdoyante, au pied d’une colline boisée où se voyaient encore quelques-uns de ces sequoia gigantea qui atteignent parfois jusqu’à cent mètres de haut, la demeure était construite sur le plan exact d’une de ces villas élégantes et simples que l’on trouve dans la campagne romaine.
– Avec ses galeries à colonnes de marbre blanc, ses balustrades et ses terrasses garnies de précieux vases de faïence qui renfermaient des arbustes rares, Golden-Cottage s’harmonisait parfaitement avec ce ciel californien d’un bleu si doux, et se détachait poétiquement sur le fond sombre des cèdres, des érables et des pins gigantesques confondant leurs branches dans un dôme naturel plus haut et plus magnifique que celui de notre Panthéon.
Le jardin de la villa, dessiné dans le goût de la Renaissance, était peuplé de statues, de fontaines et de grottes de rocaille, entourées de hauts massifs de citronniers, de cédratiers et d’orangers.
Ce superbe cottage était demeuré longtemps sans être habité, son précédent propriétaire étant mort, victime d’un assassinat dont on n’avait jamais pu découvrir les auteurs. Les habitants des haciendas du voisinage prétendaient même que Golden-Cottage était hanté, que l’on y entendait la nuit des bruits sinistres, et enfin qu’il avait porté malheur à tous ceux qui l’avaient occupé ; mais, en Amérique, pays pratique par excellence, les superstitions de ce genre ne sont pas longtemps admises.
Fred Jorgell avait trouvé une magnifique propriété à un prix modéré, dans une situation isolée en pleine campagne – précisément ce qu’il désirait –, et il n’avait pas hésité un seul instant à en faire l’acquisition.
Parmi les hôtes de la villa, on remarquait l’ingénieur Harry Dorgan, fiancé de miss Isidora, et dont le mariage depuis longtemps annoncé par les journaux de l’Union avait été retardé par diverses circonstances.
L’ingénieur passait ses journées à San Francisco, où il dirigeait la construction du yacht la Revanche, et il ne rentrait à Golden-Cottage que le soir. Il s’était d’ailleurs adjoint dans ses travaux deux savants français du plus haut mérite, l’ingénieur Paganot et le naturaliste Ravenel. Eux aussi rentraient chaque soir au cottage où ils retrouvaient leurs fiancées, Andrée de Maubreuil et Frédérique, toutes deux amies intimes de miss Isidora.
Les autres invités du milliardaire étaient l’excentrique lord Astor Burydan, un moment célèbre à Paris sous le nom de milord Bamboche, le secrétaire et l’ami de ce dernier, le poète Agénor Marmousier. Enfin un Peau-Rouge nommé Kloum, attaché à la personne du lord, et un spirituel petit bossu, Oscar Tournesol, ancien protégé de M. de Maubreuil et qui, lui, était l’ami intime de tout le monde.
Le lendemain de la scène dont la bodega du Vieux-Grillage avait été le théâtre, les trois jeunes filles se trouvaient seules au cottage. Comme presque tous les jours, Fred Jorgell était à San Francisco, ainsi que l’ingénieur Dorgan et ses deux collaborateurs français.
Lord Burydan était allé en excursion dans la forêt.
Agénor, le Peau-Rouge et Oscar l’avaient accompagné.
Miss Isidora, Andrée et Frédérique s’étaient abritées de la chaleur du jour dans une salle de verdure garnie de bancs de marbre et que rafraîchissait l’humide poussière d’un jet d’eau.
Sauf Mlle de Maubreuil, toujours un peu mélancolique, les jeunes filles étaient radieuses.
– Savez-vous, mes chères amies, dit miss Isidora, que mon fiancé Harry a reçu ce matin une lettre de son père, et, ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que William Dorgan lui-même est aussi d’avis que je retarde mon mariage ?
– Quelle en peut être la raison ? demanda Frédérique.
– Depuis que mon futur beau-père est réconcilié avec son fils, il a décidé de l’avantager d’une somme aussi considérable au moins que ma propre dot, et, pour en fixer le chiffre, attendant le règlement de comptes trimestriels, il a résolu que notre mariage n’aurait lieu qu’une fois cette question entièrement liquidée.
– Mr. Harry Dorgan doit se trouver heureux d’être rentré dans les bonnes grâces de son père ?
Miss Isidora eut un sourire mélancolique.
– C’est étrange, murmura-t-elle, on dirait qu’une sorte de fatalité s’oppose à mon mariage avec Harry. Au moment où nous croyons qu’il va avoir lieu, il se trouve toujours quelque raison pour le retarder. Ainsi, la date en était fixée, lorsque mon fiancé, empoisonné par les bandits de la Main Rouge, est tombé gravement malade, atteint d’une maladie presque inconnue.
– La « lèpre verte » ! fit Andrée de Maubreuil.
– Sans M. Paganot, c’en était fait de lui.
– Mais, reprit Andrée, puisque Mr. Harry est maintenant rétabli, vous auriez pu vous marier déjà depuis plusieurs semaines.
Miss Isidora prit les mains des deux jeunes filles et les serra affectueusement.
– Je sais bien, dit-elle, que j’aurais pu le faire, mais alors, c’est moi qui n’ai plus voulu. Et mon fiancé et mon père ont entièrement approuvé ma décision. Après l’immense service que vous nous aviez rendu, j’ai déclaré que je ne serais unie à Harry Dorgan que lorsque M. Bondonnat aurait été rendu à la liberté.
– Miss Isidora, murmura Frédérique avec émotion, vous êtes la plus généreuse et la meilleure des amies. Nous n’oublierons jamais le dévouement que vous nous montrez. Et il y a presque de l’égoïsme de notre part à accepter un tel sacrifice. Qui sait, ajouta-t-elle tristement, si nous n’aurons pas à attendre longtemps la délivrance de mon père !
– Non, répliqua chaleureusement l’interlocutrice de Mlle Bondonnat, d’autant plus que, depuis le retour de lord Burydan qui fut lui-même prisonnier dans l’île des pendus, nous possédons des données certaines. L’univers n’est pas si vaste qu’avec les moyens d’action dont nous disposons une île située sous un climat glacial ne soit promptement découverte par nous !
– Dans combien de temps croyez-vous que vous aurez retrouvé mon père ? demanda Frédérique.
– Mais je suis sûre que ce résultat sera rapidement atteint. Je compte, moi, six semaines, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins.
– Ce qui fait, dit Andrée, que nos trois mariages pourront avoir lieu le même jour.
– Mon père et mon beau-père, dit miss Isidora, ont promis de donner à cette occasion des fêtes superbes. Vous allez voir, mes chères amies, que la série des malheurs va enfin se clore et que l’avenir nous dédommagera largement du passé…
– Je n’ai plus le courage de croire au bonheur, murmura Andrée, nous avons éprouvé déjà de si cruelles déceptions ! Ne craignez-vous pas que les bandits de la Main Rouge…
– Ne pensez pas à cela, interrompit miss Isidora, vous savez bien que, depuis les arrestations en masse qui ont été opérées, on n’entend plus parler d’eux. C’est un ramassis de misérables qui ne sont pas de force à lutter contre les milliards de mon père et la science de mon fiancé. S’ils tentaient quelque chose, ils seraient vaincus d’avance.
À ce moment la gouvernante écossaise, mistress Mac Barlott, pénétra dans la salle de verdure. Elle annonçait le retour de lord Burydan et de ses amis, qui ne tardèrent pas à se présenter eux-mêmes pour montrer aux trois jeunes filles le gibier qu’ils avaient tué.
La carabine en bandoulière, le bowie-knife à la ceinture, le lord excentrique et Agénor étaient vêtus de superbes costumes de chasse et coiffés de larges chapeaux de paille mexicains. Le bossu et le Peau-Rouge, plus simplement habillés d’un complet de toile kaki, pliaient sous le poids du gibier.
Ils étalèrent aux regards des jeunes filles des chapelets de ramiers et de perdrix rouges, des paons sauvages, des dindons de prairies et jusqu’à un grand vautour roux que l’infaillible balle de lord Burydan était allé chercher presque dans les nuages.
Les chasseurs reçurent les félicitations auxquelles ils avaient droit. Cette exhibition cynégétique n’était pas terminée, lorsqu’un domestique vint dire à lord Burydan qu’un étranger demandait à lui parler pour « affaire urgente ».
– Eh bien ! qu’il vienne ici, dit l’excentrique, je me demande, par exemple, ce qu’on peut bien me vouloir. Je ne connais personne dans ce pays.
Le domestique revint bientôt suivi d’un personnage à la face basanée, au regard oblique et fuyant, et qui avait l’aspect inquiétant d’un de ces aventuriers, moitié négociants et moitié pirates, qui sont nombreux à San Francisco. Il portait sous le bras une boîte de carton assez volumineuse.
Laissant ses amis un peu à l’écart, lord Burydan s’avança vers le visiteur, qui ne paraissait nullement intimidé par la nombreuse société au milieu de laquelle il venait d’être introduit.
– Qui êtes-vous ? demanda l’excentrique, que la mine et les allures du nouveau venu ne disposaient guère en sa faveur.
– Je suis le capitaine Christian Knox, bien connu à San Francisco et ancien commandant de la goélette la Fusée, qui malheureusement a péri corps et biens, il y a un mois de cela, sur les récifs de coraux qui avoisinent l’île de Pâques. Vous êtes lord Astor Burydan ?
– Parfaitement.
– Alors j’ai quelque chose à vous remettre, en mains propres.
Le capitaine avait ouvert la boîte de carton. Il en retira une bouteille qu’un long séjour au fond de la mer avait recouverte de coquillages et de concrétions calcaires – la même que Cornélius avait achetée au « publicain » de la bodega du Vieux-Grillage. Mais elle avait subi un truquage savant, et une inscription qui paraissait gravée à l’aide de l’acide fluorhydrique, comme les étiquettes des siphons d’eau de Seltz, était encore assez nettement lisible sur un des côtés.
– Qu’est-ce que c’est que cela ? demanda lord Astor avec surprise.
– Ma foi, je n’en sais rien, répliqua l’aventurier, mais ce qu’il y a de sûr, c’est que c’est à vous que c’est adressé. Lisez plutôt.
Lord Burydan prit la bouteille et déchiffra non sans peine les mots gravés dans le verre ; ils étaient tracés d’une écriture cursive aux caractères compacts comme si l’on se fût servi d’un pinceau trempé dans l’acide. Lord Burydan lut à haute voix : Cent dollars de récompense à qui remettra cette bouteille à lord Burydan.
Les deux jeunes filles s’étaient rapprochées et examinaient curieusement le singulier flacon. Mais tout à coup Frédérique jeta un cri de surprise.
– Cette inscription est de l’écriture de mon père, s’écria-t-elle.
– Où avez-vous trouvé cette bouteille ? demanda lord Burydan.
– Au large des côtes du Chili, en péchant autour d’un récif. C’est un de mes matelots qui l’a découverte au milieu d’une masse de plantes marines qui remplissaient notre filet.
– Ce matelot existe encore ? Vous pouvez le faire venir ?
– Hélas ! non, milord, le pauvre diable est mort avec ses camarades dans le naufrage de la Fusée, et c’est une vraie chance que j’aie sauvé cette bouteille qui se trouvait dans mon coffre avec d’autres effets !
– C’est bien, je vous remercie. L’expéditeur de la bouteille promettait cent dollars, en voici deux cents.
Le capitaine Christian Knox empocha la somme avec un sourire satisfait, salua jusqu’à terre et se retira après avoir eu soin de remettre à lord Astor un bout de papier graisseux sur lequel se trouvait l’adresse de la bodega du Vieux-Grillage où le pirate avait installé ses pénates.
L’impatience de tous les témoins de cette scène était à son comble. D’après ce que venait de dire Mlle Bondonnat, ils étaient persuadés que la bouteille contenait un message du vieux savant.
On sait que ce hasardeux moyen de correspondance est depuis des siècles employé par les matelots en péril, et, chose extraordinaire, il est beaucoup plus fréquent qu’on ne se l’imaginerait que de pareilles missives arrivent à destination.
Au milieu d’un solennel silence, lord Burydan gratta avec son couteau de chasse les coquillages qui recouvraient le bouchon et le goulot de la bouteille.
Au-dessous des coquillages, il y avait une capsule de plomb qu’il arracha et qui avait si bien protégé le bouchon que celui-ci n’avait été que très peu endommagé par l’action corrosive des eaux marines. Quand il l’eut enlevé, lord Astor aperçut un objet long et arrondi qu’il fit sortir de la bouteille en la penchant avec précaution.
– C’est un tube de verre fermé aux deux bouts et recouvert de cuir, déclara lord Burydan au milieu d’un silence émotionnant.
– C’est là que se trouve la lettre ! s’écria Frédérique, le cœur palpitant d’angoisse.
Le tube de verre qui avait été scellé à la lampe dut être brisé.
Il contenait un papier minutieusement roulé. Dans son impatience, Frédérique l’arracha presque des mains de lord Burydan et le déplia avec précipitation.
– Mon père ! mon père ! balbutia-t-elle. C’est de mon père ! C’est bien son écriture ! Je ne puis m’y tromper ! Oh ! que je suis heureuse !… Mais je vais vous la lire à haute voix. Et elle lut, d’une voix tremblante d’émotion :
« Milord,
« Je ne sais si cette lettre vous parviendra ; cependant, étant donné la direction des courants que j’ai soigneusement étudiés, cela me paraît très possible. Elle a été recopiée par moi à vingt exemplaires, enfermés en autant de bouteilles mises à la mer à un jour de distance l’une de l’autre. Enfin, j’ai pris les précautions les plus minutieuses pour que l’eau ne puisse altérer le papier ni l’écriture. J’ai même, grâce aux produits dont je dispose dans mon laboratoire, pu graver votre nom dans le verre en promettant une récompense à celui qui vous remettra cette bouteille.
« Si je vous écris, c’est que je suis sûr, étant donné la perfection de mon aéronef, que le brave Kloum sait parfaitement manœuvrer, que votre évasion a réussi.
« Je souhaite et j’espère de tout mon cœur que vous êtes en sûreté avec Kloum et mon bon chien Pistolet. Et je suis certain, s’il en est ainsi, que vous ferez l’impossible pour me tirer des griffes de mes bourreaux. Demeuré seul entre leurs mains après l’insuccès de ma tentative, je craignais qu’ils ne s’en vengeassent en me faisant subir toutes sortes de vexations. Il n’en a rien été heureusement. On s’est contenté de me surveiller plus étroitement, et l’on ne me donne plus, pour m’aider dans mes expériences, que des bandits à figure sinistre près desquels tout essai de corruption serait inutile. Ma santé continue à être assez bonne, en dépit de l’ennui et de l’inquiétude dont je suis torturé.
« Mais venons au fait. Le but de cette lettre, mon cher lord, est de vous donner un renseignement sans lequel vous auriez les plus grandes peines à découvrir mon lieu d’exil. En effet, vous ignorez la latitude et la longitude de l’île des pendus, que j’ai réussi à déterminer et qui sont les suivantes : l’île des pendus se trouve par 110° de longitude est, méridien de Paris, et 50° de latitude sud ; c’est-à-dire approximativement dans le voisinage du cercle antarctique, entre le cap Horn et la Terre de la Désolation… »
– M. Bondonnat, interrompit lord Burydan en se tournant vers Kloum, ne vous avait donc jamais parlé de ces chiffres ?
– Je ne crois pas, répondit le Peau-Rouge en cherchant dans son souvenir. Il me semble pourtant qu’il a prononcé les mots de longitude et latitude, mais il me regardait comme trop ignorant sans doute pour comprendre quelque chose à cela.
– Je reprends ma lecture, dit Frédérique.
« Je suppose qu’avec cette indication précise il vous sera facile de découvrir le repaire des bandits. Je n’ai d’espérance qu’en vous, car je crains bien que, malgré toutes leurs promesses, les coquins qui me détiennent ne me remettent jamais en liberté si on ne les y contraint par la force.
« Je vous prie aussi de faire parvenir de mes nouvelles à ma fille et de la tenir au courant de ce que vous tenterez pour me sauver.
« Croyez à la reconnaissance de votre compagnon de geôle.
« Prosper Bondonnat. »
– Il n’y a pas à dire, s’écria lord Burydan, cette lettre présente tous les caractères de l’authenticité !
– Elle est certainement de mon père ! déclara Frédérique.
– Je le crois aussi, fit Andrée.
– Et moi de même, dit le poète Agénor.
Seuls le bossu et le Peau-Rouge ne disaient rien. Tous deux, sans pouvoir s’en rendre compte, flairaient quelque piège. Mais ils eurent beau examiner la lettre et la bouteille, ils ne trouvèrent aucune objection sérieuse à faire à l’opinion de leurs amis. Et ils furent obligés de convenir que l’arrivée du message n’avait rien, après tout, de plus extraordinaire que tant d’événements auxquels il leur avait été donné d’assister.
Miss Isidora ne cachait pas son enthousiasme.
– Maintenant, s’écria-t-elle, on pourrait presque fixer le jour exact où seront célébrés les trois mariages. C’est Harry qui va être content !
Andrée de Maubreuil réfléchissait.
– Je m’explique maintenant, fit-elle, que la première lettre que nous avons reçue de mon cher tuteur soit partie de La Nouvelle-Orléans. Elle venait du sud évidemment, par la voie chilienne ou péruvienne, et elle avait dû être remise à la poste par un des correspondants de la Main Rouge.
– Pauvre Pistolet, dit tout à coup le petit bossu, M. Bondonnat sera désolé quand il saura que son fidèle compagnon a disparu.
– Ce n’est pas de ma faute, riposta lord Burydan, ni de celle de Kloum. Lorsque notre aéronef est descendu à deux pas d’un village de Noirs et que nous avons été assaillis par eux, Pistolet reçut des pierres et même, j’en ai peur, des balles de revolver. Il s’est enfui absolument affolé et il a dû se cacher dans un champ de cotonniers. Nous étions traqués nous-mêmes, nous n’avons pu aller à son secours !
– On retrouvera Pistolet, dit gaiement miss Isidora qui voyait l’avenir sous les couleurs les plus favorables. Mon père mettra, s’il le faut, d’habiles détectives en campagne pour ramener ce chien, puisqu’il est de vos amis !
On sourit de cette boutade. Tout le monde partageait l’optimisme de la jeune fille. Maintenant qu’on savait l’endroit exact où était détenu M. Bondonnat, on regardait presque sa délivrance comme un fait accompli.
Chacun attendait avec impatience le retour de Fred Jorgell et des trois fiancés pour leur montrer la fameuse bouteille et leur lire la lettre de l’illustre prisonnier.
Les habitants de Golden-Cottage eussent éprouvé la plus amère des déceptions s’ils avaient pu se douter que la lettre qui leur causait une telle satisfaction avait été écrite par un des plus habiles faussaires de la Main Rouge et que le récipient qui la renfermait leur était adressé par leurs plus cruels ennemis.
Le yacht la Revanche allait se diriger vers le pôle austral, tandis que l’île des pendus se trouvait dans les parages du pôle boréal. Qui sait ce qu’il adviendrait de Fred Jorgell et de ses amis égarés par de fausses indications dans les mers désertes du sud, loin de toute côte hospitalière et de tout peuple civilisé !
CHAPITRE III
Les malheurs d’un manager
Installés sur la terrasse de Golden-Cottage, d’où l’on découvrait un des plus beaux paysages du monde, les hôtes de Fred Jorgell savouraient la fraîcheur de la brise embaumée des senteurs de la forêt, et ils écoutaient les mille bruits mystérieux qui montent des campagnes endormies.
Au-dessus d’eux le ciel était d’un bleu de velours tout endiamanté d’astres éblouissants dont rien, dans nos climats humides et crépusculaires, ne saurait évoquer le glorieux éclat.
Miss Isidora était assise près de Harry Dorgan, Frédérique près de Roger Ravenel, Andrée de Maubreuil aux côtés de l’ingénieur Paganot. Chaque couple avait pris une pose presque identique. Les yeux dans les yeux, les mains étroitement enlacées, les fiancés s’abandonnaient au charme de cette belle soirée. Et le grand silence n’était troublé que par le bruit imperceptible d’un soupir ou d’un baiser furtif.
Tout à coup, lord Burydan se leva.
– Sont-ils heureux ! murmura-t-il. Quel malheur que moi aussi je ne sois pas fiancé à une charmante miss ! Mais, en attendant, je crois qu’il serait urgent de prendre quelque distraction. Il y a bien longtemps que je ne suis allé à San Francisco.
– Rien de plus facile, milord, répliqua Fred Jorgell. J’ai soin qu’il y ait toujours ici deux autos toutes prêtes à partir.
– Eh bien, ma foi, c’est une idée. Il n’est guère plus de neuf heures, j’arriverai à Frisco juste au bon moment pour faire une tournée dans les tavernes du port.
– On sait, fit le milliardaire, que vous êtes amateur de pittoresque. Je regrette de ne pouvoir venir avec vous, car je suis un peu fatigué.
– Qui donc m’accompagnera ?
– Moi, milord ! s’écria le bossu avec enthousiasme.
– Moi aussi, dit Agénor. Mais où diable est Kloum ?
– Cet honnête Peau-Rouge est déjà couché, répondit Oscar, d’ailleurs nous pouvons nous passer de lui.
– Eh bien, c’est entendu ! s’écria l’excentrique, tout réjoui à l’idée de cette escapade. Le temps de prendre une arme dans ma chambre et je suis à vous !
Dix minutes plus tard, lord Burydan, Agénor et le bossu filaient à toute vitesse sur une route blanche bordée d’arbres magnifiques à l’extrémité de laquelle on apercevait comme un halo de lumière qui décelait l’approche de la ville de San Francisco.
La capitale du Pacifique n’a point la tristesse des villes puritaines de l’Est et du Centre. C’est une cité de fête et de noctambulisme. Quand lord Burydan et ses amis y arrivèrent, les grandes artères, Market street, California, Hearney et Montgomery street, étaient encore encombrées par une foule affairée et joyeuse.
L’auto fut laissée au garage du gigantesque Palace-Hotel, qui ne compte pas moins de quinze cents chambres et qui est à lui seul toute une ville. Et les trois amis se servirent du cable-car – sorte de funiculaire – qui, pour quelques cents, les conduisit au quartier de Queen-City.
Ils avaient à peine eu le temps de faire quelques pas lorsqu’ils furent abordés par un personnage grave et correctement vêtu. C’était un détective qui, moyennant quarante dollars, leur offrait de leur faire visiter les bouges les plus dangereux : tables d’hôtes de matelots, fumeries d’opium et maisons de filles.
Lord Burydan refusa les services de l’officieux policier.
– Je ne trouve d’intérêt, dit-il, à visiter les mauvais lieux que lorsque je les découvre moi-même et que je vais y courir quelque danger. D’ailleurs, je n’ai rien à craindre, je suis lord Burydan.
– C’est différent, grommela l’inconnu en s’éloignant d’un air mécontent. Je sais que milord Bamboche est bien vu de toute la canaille.
Ce surnom de milord Bamboche, qu’à Paris le populaire avait donné à l’excentrique, s’était trouvé, on ne sait comment, connu à San Francisco où il avait tout de suite fait fortune. Il avait suffi au noble lord de quelques promenades nocturnes pour que milord Bamboche fût devenu aussi sympathique aux aventuriers californiens qu’il l’avait été jadis aux apaches de Paris.
Les trois noctambules, ne s’en rapportant qu’à leur propre inspiration pour découvrir des repaires pittoresques, entrèrent au hasard dans deux ou trois établissements d’aspect sordide ; mais ils n’y trouvèrent que des ivrognes peu intéressants.
Ils furent plus heureux en s’engageant dans un long couloir à l’entrée duquel un nègre vêtu d’une sorte de robe réclamait un shilling d’entrée.
Ils croyaient pénétrer dans quelque music-hall et ils ne changèrent pas d’avis en débouchant dans une salle carrée où un grand nombre de nègres et de négresses s’évertuaient. Accompagné sur le banjo[1], un grand diable noir, en chemise blanche, hurlait avec force gesticulations les paroles d’une chanson dans une langue inconnue et bizarre.
Le Noir se démenait comme un possédé. Milord Bamboche se réjouit fort de ses grimaces et quand il eut fini, il applaudit à tout rompre en réclamant énergiquement du champagne.
Cette démonstration fut fort mal accueillie : ce n’était pas dans un music-hall pour nègres, mais bien dans une chapelle de méthodistes hurleurs que le lord excentrique se trouvait. Tous les Noirs qui composaient l’assistance mirent de côté leur banjo et expulsèrent les intrus avec force bourrades.
– Voilà qui est intéressant, dit Oscar ; continuons nos pérégrinations. Tenez, passons par ici, voilà une ruelle qui doit être curieuse !
Le bossu désignait une étroite venelle où, de place en place, se balançaient des lanternes annonçant des hôtels garnis ou des tavernes de la dernière catégorie.
Ils firent quelques pas sur un pavé raboteux qu’encombraient des tonneaux, des caisses, et toutes sortes d’objets laissés à l’abandon, lorsqu’un ivrogne, assez bizarrement accoutré, car il portait des bottes à revers et un chapeau haut de forme, s’avança au-devant d’eux en titubant.
Il tenait si mal son équilibre qu’en passant près d’Agénor il s’affala sur lui et faillit presque le renverser.
L’ivrogne, comme cela arrive souvent, se figura que c’était lui qui avait été bousculé.
– Imbécile ! cria-t-il au poète.
– Imbécile toi-même, riposta lord Burydan, peu patient de son naturel.
– Idiot !…
– Crétin !…
– Brute !…
– Sac à vin !
Ces épithètes, et d’autres moins gracieuses encore, furent échangées entre l’excentrique et l’homme ivre, mais celui-ci entra tout à coup en fureur.
– Moi, un sac à vin ! beugla-t-il d’une voix éraillée ; heu ! heu !… moi qui ne bois jamais que du gin et… même… avec de l’eau.
Les poings en avant, il se rua sur lord Burydan. Celui-ci, on le sait, était un boxeur émérite. Nonchalamment, il allongea à son adversaire deux ou trois « directs » et autant de « swings » qui eurent pour résultat d’envoyer le buveur malappris rouler à quelques pas de là.
Il se releva en fort piteux état. Le dos de sa houppelande était couvert de boue et son chapeau haut de forme, sur lequel il s’était assis dans sa chute, ressemblait maintenant à un accordéon.
Cette constatation redoubla la fureur de l’ivrogne.
– Et avec quoi, maintenant…, larmoya-t-il, heu ! heu ! pourrai-je me présenter dans le monde… Le vrai gentleman se reconnaît, heu ! heu !… à une tenue impeccable…
Il était tellement exaspéré que, croyant sans doute avoir affaire à quelques-uns de ces escarpes qui pullulent à San Francisco, il dirigea contre Agénor le canon d’un énorme browning
C’est alors qu’Oscar, qui était passé maître dans l’art de la savate, fit, d’un coup de pied, sauter l’arme à quatre pas de là, pendant que lord Burydan, exaspéré à son tour, empoignait l’ivrogne au collet et le traînait jusqu’à une borne-fontaine située à l’entrée de la ruelle.
– Tu as trop bu, mon garçon, lui dit-il, mais je vais t’appliquer un traitement hydrothérapique qui va certainement te faire le plus grand bien.
Méthodiquement, il avait placé la tête de l’ivrogne sous le robinet de la fontaine et il commença par le rafraîchir d’une douche copieuse ; puis, apercevant un gobelet de fer blanc retenu par une chaînette, il le remplit et, pinçant le nez du patient, lui fit avaler une copieuse gorgée.
– Que dis-tu du traitement ? railla lord Burydan.
– Grâce ! grâce ! grâce, milord !
– Non, ce n’est pas suffisant. Tiens, avale encore ce gobelet… et celui-ci… et celui-là…
Entre deux gobelets, l’ivrogne poussa un soupir lamentable.
– Sir, déclara-t-il humblement, vous avez juré ma mort ! Il y a dix ans que je n’ai bu autant d’eau pure, heu ! heu !… j’étouffe !… heu ! heu !
Oscar Tournesol, qui assistait à cette scène en riant de bon cœur, poussa tout à coup un cri de surprise :
– Mais c’est le père Sleary ! s’exclama-t-il, je ne me trompe pas ! Lâchez-le, milord, il est inoffensif ! Que diable peut-il être venu faire à San Francisco ?
– Si c’est un de vos amis, c’est différent, fit l’excentrique, qui rendit à l’infortuné directeur du Gorill-Club la liberté de ses mouvements, en même temps que le bossu lui restituait son chapeau haut de forme et son browning qu’il avait eu soin de ramasser.
– Mais qui êtes-vous donc ? heu ! heu !… demanda avec étonnement Mr. Sleary, que l’eau froide avait à peu près dégrisé.
– Comment, répondit le bossu, vous ne reconnaissez pas Oscar Tournesol, un des plus brillants pensionnaires du Gorill-Club, l’élève favori de l’illustre clown Bombridge ?
Une silhouette féminine venait de paraître au milieu de la ruelle, et une voix criait avec mécontentement :
– Eh ! monsieur Sleary, où êtes-vous donc ? Dépêchez-vous de rentrer ! Vous avez assez bu !
– Voici précisément, dit le manager, miss Régine Bombridge qui me cherche partout ! Mais je vous reconnais parfaitement, master Tournesol !… heu ! Enchanté de vous voir, heu ! heu !… Et moi qui prenais vos amis pour de véritables bandits !…
– Monsieur Sleary ! cria de nouveau la jeune fille.
– Vous voyez, elle s’impatiente… heu ! heu !… allons la rejoindre !… D’autant plus que je ne serais pas fâché de prendre un grog bien chaud… heu ! heu ! J’ai absorbé tellement d’eau tout à l’heure, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, que je suis capable d’attraper une fluxion de poitrine… heu ! heu !…
Tout le monde se rapprocha de la jeune fille, de qui Oscar se fit reconnaître en même temps qu’il la rassura sur les suites du combat singulier où Mr. Sleary avait pris part. Puis on entra dans un modeste bar situé à deux pas de là. Lord Burydan, qui était curieux de connaître les aventures de l’ivrogne, fit apporter une bouteille de champagne.
Pendant qu’on la débouchait, l’honorable directeur du Gorill-Club nettoyait ses vêtements, retapait d’un coup de poing son haut-de-forme et reprenait enfin les respectables allures qu’on lui connaît.
Quant à miss Régine Bombridge, une petite blonde mince et pâlotte, avec de jolis yeux bleus pleins de candeur, elle n’en revenait pas de la rencontre de son directeur avec ces gentlemen si bien mis, qui paraissaient avoir les poches pleines de bank-notes.
Oscar Tournesol fit gravement les présentations, ce qui parut causer un vif plaisir à Mr. Sleary, toujours profondément respectueux des convenances ; puis le bossu s’enquit de l’aventure qui avait conduit à San Francisco le directeur du Gorill-Club. Celui-ci ne répondit d’abord que par un hochement de tête accompagné d’un soupir ; puis, sur les instances réitérées de lord Burydan, il se décida à entamer le récit de ses malheurs.
– Mon établissement du Gorill-Club a été vendu, murmura-t-il avec accablement, heu ! heu !… Je devais trois termes à mon propriétaire… mes pensionnaires étaient tous en retard dans leurs paiements… enfin j’avoue, heu ! heu ! que je n’ai pas été toujours très sage dans mon administration… Je suis un artiste, moi, que voulez-vous… je ne suis pas un homme de chiffres !… heu ! heu !… Mais n’insistons pas sur cette catastrophe !…
– C’est cela, dit Oscar en remplissant la coupe du manager, n’insistons pas et dites-nous comment il se fait que je vous retrouve à San Francisco.
– Tout naturellement, j’ai essayé de me relever… heu ! heu !… et avec l’aide de ceux de mes pensionnaires qui se trouvaient sans emploi – c’était leur cas à presque tous –, j’ai monté une troupe qui, sans m’en vanter, était de tout premier ordre. Nous avons donné à Chicago des représentations assez brillantes, mais vous savez, quand la déveine s’acharne après un homme, tout ce qu’il peut tenter est inutile ! À San Francisco, ç’a été la débâcle ! Notre caissier a mangé la grenouille… on a refusé de nous louer des salles… heu ! heu !…
– Et où en êtes-vous, maintenant ? demanda lord Burydan, très intéressé.
– Au dernier degré de la misère et de la tristesse, répondit Mr. Sleary d’une voix caverneuse. Il y a des moments où je songe au suicide ; aussi, ne soyez pas surpris, milord, de m’avoir rencontré dans un état d’ébriété peu avouable pour un vrai gentleman. Je bois pour oublier mes chagrins !
Cette déclaration eut pour résultat de soulever, même de la part de la blonde miss Bombridge, une tempête de rires qui ne s’apaisa que difficilement. Mr. Sleary, très vexé, vida le reste de son champagne d’un air de dégoût et pinça les lèvres en homme décidé à ne plus prodiguer ses confidences à des gens qui étaient indignes de les entendre. Ce fut miss Régine qui prit la parole.
– La vérité, expliqua-t-elle, c’est que toute notre troupe est prisonnière d’un publicain qui a fait main basse sur nos costumes et sur nos bagages. Il nous accable tous les jours des plus amers reproches et ne nous accorde plus à chaque repas qu’une quantité de nourriture dérisoire. Il prétend que c’est le moyen de stimuler notre génie pour nous faire trouver de brillants engagements qui nous permettent de le payer.
– Allons chez le publicain ! s’écria lord Burydan avec la rapidité de décision qui lui était particulière.
Tout le monde se leva, même le cérémonieux Mr. Sleary, et l’on se rendit jusqu’au misérable hôtel garni – il ne se trouvait qu’à deux pas de là heureusement – où s’étaient échoués les lamentables épaves du Gorill-Club.
Le publicain, un gros homme apoplectique au crâne chauve, aux favoris roux, à l’œil torve et méfiant, se tenait sur le seuil de son établissement, guettant la rentrée de l’infortuné Mr. Sleary, mais quand il le vit en si nombreuse compagnie, sa colère ne connut plus de bornes.
– Gueux d’ivrogne, s’écria-t-il avec un fort accent allemand, non content de te goberger à mes dépens, tu veux sans doute introduire encore chez moi d’autres crève-la-faim ! Mais cela ne sera pas, der Teufel ! Personne ne rentrera ici, s’il n’a de l’argent comptant !
Lord Burydan, en entendant ce langage, sentit la moutarde lui monter au nez. Il eut besoin de toute sa force d’âme pour ne pas infliger séance tenante au malotru une correction exemplaire.
– Combien vous doit Mr. Sleary ? lui demanda-t-il.
– Cent dollars !
– C’est bon, je vais vous les donner ; seulement, je vous préviens que, si vous ne montrez pas envers moi et mes amis la plus exquise politesse, rien ne m’empêchera de vous gratifier de la volée la plus magistrale que vous ayez jamais reçue !
Sur un signe de son ami, Agénor tendit une bank-note au publicain abasourdi et qui, déjà, s’écriait d’un ton mielleux :
– Que Votre Honneur veuille bien m’excuser, je n’ai voulu parler que de ces coquins d’acrobates. Si Votre Honneur veut bien se donner la peine d’entrer !
– Tâchez d’être plus respectueux envers mes amis les acrobates, répliqua l’excentrique. C’est vous-même qui n’êtes qu’un plat coquin ou, comme l’on dit en France, un infâme taulier !
Et sans attendre la réponse de l’homme, il pénétra dans l’intérieur de l’hôtel et suivit Mr. Sleary jusqu’à une salle basse où les membres du Gorill-Club achevaient mélancoliquement leur soirée en jouant au poker des haricots secs, faute d’un enjeu plus sérieux. Un seul bec de gaz, dont le publicain avait baissé la flamme par économie, éclairait cette scène de désolation, laissant dans une sorte de pénombre les physionomies étranges et mélancoliques des acrobates.
– Holà, drôle ! s’écria lord Burydan, de la lumière ! du champagne ! et à souper pour tous ces braves gens, qu’à ce qu’il paraît tu laisses crever de faim ! Et tâche que boissons et victuailles soient de premier choix ou tu auras affaire à moi !…
Cet ordre fut exécuté avec une célérité surprenante. En un clin d’œil, des flots de clarté inondèrent la salle, se mirant joyeusement sur les goulots dorés des flacons et sur l’engageante blancheur des assiettes et le métal des couverts. Les acrobates, même les moins agiles, avaient fait un bond de surprise, et bientôt une acclamation monta de toutes les poitrines.
– Milord Bamboche ! Vive milord Bamboche ! Un triple hourra pour milord Bamboche !
Quand ce gai vacarme eut cessé, l’excentrique put admirer tout à son aise les bizarres figures qui l’entouraient.
Il y avait là Goliath, le briseur de chaînes, l’athlète qui, suspendu par les jarrets à un trapèze, enlevait avec les dents un cheval et son cavalier, Goliath, l’homme le plus fort de l’univers, dont les biceps avaient un mètre de tour ; Fulguras, l’acrobate-salamandre, la torche humaine, aussi à l’aise au milieu du feu que si c’eût été son élément naturel ; Bob Horwett, le nageur émérite surnommé le triton moderne ; Romulus, l’obus vivant qui se faisait charger dans un canon et, projeté par l’explosion vers la voûte de la salle, saisissait au vol un trapèze sur lequel il exécutait les plus périlleux exercices ; les frères Macoco et Cambo, incomparables dans leurs imitations de la gent simiesque ; le prestidigitateur Matalobos ; le jongleur chinois Yan Kaï ; enfin les Robertson, deux clowns maigres, artistes de premier ordre.
Nous allions oublier l’honorable Mr. Bombridge lui-même, le maître et l’exemple de toute cette lignée d’acrobates.
Du côté des dames, nous citerons la belle Nudita, admirable dans ses poses plastiques et dans ses danses lumineuses, l’équilibriste Winny, une Anglaise qui, comme le Français Blondin, avait traversé le Niagara sur une corde tendue, enfin les écuyères Isabelle et Olga et la blonde Régine Bombridge.
Mr. Sleary, dont la mauvaise humeur s’était dissipée comme par enchantement, présenta gravement tous ses pensionnaires à lord Burydan, et il profita de l’occasion pour faire, des talents de chacun, un éloge complet et détaillé. Cette cérémonie de la présentation dura bien une bonne demi-heure, mais les artistes et les dames n’attendirent pas qu’elle fût terminée pour livrer une attaque des plus sérieuses à un vaste plat de choucroute au jambon et aux saucisses de Francfort que le publicain avait déposé au centre de la table.
Le plat de choucroute disparut aussi rapidement que si le prestidigitateur Matalobos lui-même l’avait escamoté dans une de ses manches. Il fut remplacé par une énorme tranche de rosbif froid qui eut le même destin que la choucroute.
Lord Burydan contemplait avec admiration l’appétit de ces braves gens. On eût dit qu’ils n’avaient pas mangé depuis plusieurs semaines. Le publicain, trottinant sans cesse de la salle à manger à la cuisine, les bras chargés de victuailles et de bouteilles, avait les plus grandes peines du monde à se maintenir à la hauteur de son rôle.
Enfin, cette fringale finit par se calmer peu à peu. Goliath seul continuait à s’acharner sur les ruines effondrées d’un vaste pâté, pendant que ses camarades s’engageaient dans une conversation générale.
Tous fêtaient et choyaient le petit bossu, auquel, en somme, ils étaient redevables de cette bombance ; mais Oscar semblait à peine les entendre. Il s’était assis à côté de la blonde Régine, et tous deux avaient entamé à mi-voix une conversation tellement intéressante qu’ils semblaient avoir oublié tout le reste de l’univers.
Cependant, il ne put s’empêcher d’éprouver une certaine émotion quand les deux clowns Macoco et Cambo, qui s’étaient absentés un moment, réapparurent vêtus de leur costume de singe. Légèrement émoustillés par le champagne qu’ils avaient bu, ils se livrèrent à mille facéties dont la plus goûtée de l’assistance consista à sauter sur les épaules du publicain et à le forcer à une partie de saute-mouton en dépit de ses énergiques protestations.
– Dis donc, mon vieil Oscar, fit Macoco, pour nous montrer que tu ne fais pas le fier, tu devrais endosser ton ancien costume !
– Oui, approuva Régine, c’est cela.
– Cela nous rappellera le Lunatic-Asylum.
– Vous n’avez pas besoin de tant me supplier, s’écria le bossu ; vous allez voir que je n’ai pas oublié les leçons du Gorill-Club !
L’instant d’après, il apparaissait en tenue de gorille, et aux hourras enthousiastes de l’assistance, il exécutait par-dessus la table une série de sauts périlleux des plus réussis.
L’allégresse était à son comble. Goliath avait déjà arraché le pied d’un fauteuil pour montrer sa force, la belle Nudita avait bondi sur la table et, s’armant des deux morceaux d’une assiette en guise de castagnettes, elle exécutait une danse de caractère. Fulguras, l’homme incombustible, réclamait à grands cris du punch pour donner une idée de ses talents.
Les clowns faisaient sur la pointe de leur nez des équilibres invraisemblables ; le Chinois avait disparu : on devait ne le retrouver que le lendemain, enroulé dans un tapis où il dormait à poings fermés ; quant au prestidigitateur Matalobos, il faisait disparaître dans ses poches à double fond tout ce qui lui tombait sous la main : couverts, bouteilles et victuailles.
Le publicain, consterné et blême, croyait avoir affaire à une troupe de diables déchaînés. Il n’osait plus élever la plus timide réclamation. Lord Burydan était plongé dans un véritable ravissement. Bien loin de s’opposer aux facéties des acrobates, il leur suggérait mille idées baroques que ceux-ci s’empressaient de mettre à exécution.
Mr. Sleary, qui s’était saoulé de nouveau, avait fini par s’endormir sur sa chaise, son chapeau haut de forme penché sur l’oreille, une bouteille vide entre les bras, mais gardant quand même un air digne.
Cette animation finit cependant par s’apaiser, et le poète Agénor remarqua le premier que les clowns commençaient à bâiller formidablement et que les petites écuyères se frottaient les yeux comme des personnes qui ne seraient pas fâchées de regagner leur lit.
Lord Burydan fit comparaître devant lui le publicain et lui demanda l’addition en même temps qu’une dernière tournée d’extra-dry ; les plus endormis des convives se réveillèrent alors pour porter la santé de l’honorable amphitryon, mais l’excentrique leur imposa silence d’un geste.
– Mes amis, dit-il, je viens de passer en votre compagnie une fort agréable soirée, mais maintenant parlons, si vous voulez, un peu plus sérieusement. J’ai à vous faire une proposition.
Il y eut dans l’assistance une profonde sensation, et ce fut au milieu du recueillement le plus parfait que lord Burydan continua :
– Je sais qu’en ce moment-ci vous êtes sans engagement, que vous avez même des dettes, que vous êtes en somme en assez fâcheuse situation. Eh bien ! il ne tient qu’à vous de sortir de ce mauvais pas de la façon la plus brillante.
– Et comment cela, milord ? demandèrent impatiemment plusieurs voix.
– Il m’est venu la fantaisie de devenir imprésario. Si donc vous y consentez, je vous engage tous, et à des conditions telles qu’aucun de vous n’aura à s’en repentir. Il n’est pas dans mon caractère de marchander. C’est donc vous-mêmes qui fixerez le chiffre de vos appointements.
Une folle acclamation lui couvrit la voix. Les pauvres diables n’eussent jamais osé espérer une pareille aubaine. Assurément, ils acceptaient !
C’étaient des acclamations délirantes, des cris mille fois répétés de « Vive milord Bamboche ! ».
– Un instant, s’il vous plaît, dit l’excentrique, je ne vous ai pas tout expliqué. Il se peut que je vous emmène très loin d’ici, que nous soyons obligés de faire un long voyage…
– Cela nous va, interrompirent impétueusement les clowns, nous acceptons tous ; à quand le départ ?
– Je n’en sais rien moi-même. Il pourra avoir lieu dans trois semaines, dans un mois, peut-être plus tard, mais à partir de demain vous toucherez exactement vos appointements comme si vous étiez déjà entrés en fonction. C’est tout ce que je puis vous dire. Le reste est un secret qui me concerne seul.
Lord Burydan et ses amis ne tardèrent pas à prendre congé des acrobates après les plus vives démonstrations de sympathie d’une part, et de reconnaissance de l’autre.
Très emballé, le petit bossu trouva original de revenir à Golden-Cottage avec son costume de gorille, et c’est dans cet accoutrement qu’il remonta en auto aux côtés d’Agénor et de lord Burydan.
Quand les trois noctambules franchirent les portes du cottage, le plus profond silence y régnait ; tous les habitants en étaient plongés dans le sommeil, ce qui, d’ailleurs, n’avait rien de surprenant, car il était près de quatre heures du matin.
Ce ne fut qu’une fois dans sa chambre qu’Oscar commença à ressentir sérieusement la fatigue de la nuit blanche qu’il venait de passer. Il éprouva brusquement une telle lassitude que, sans prendre la peine de se déshabiller, il se jeta sur son lit où il ne tarda pas à ronfler à poings fermés.
Il fut réveillé deux heures après par un rayon de soleil qui se glissa dans l’entrebâillement des volets demeurés ouverts. Il se frotta les yeux, se secoua, bâilla, s’étira et fut tout d’abord profondément surpris en se voyant si bizarrement attifé.
– Est-ce que je suis changé en singe ? grommela-t-il, ou bien ferais-je encore partie des pensionnaires du Gorill-Club ?
Cette idée lui arracha un franc éclat de rire, et il se rappela tout à coup les incidents de la nuit précédente. Il se sentait la bouche amère et la tête lourde, et ce fut avec une véritable jouissance qu’il aspira l’air frais et pur du jardin en ce moment désert et silencieux, et dont les bosquets et les massifs étaient encore couverts des humides perles de la rosée.
– Tiens, une idée, s’écria-t-il, je vais faire un tour dans les allées. Personne n’est encore levé ; puis, quand j’aurai respiré tout mon content, j’irai prendre un tub et il n’y paraîtra plus.
Par une gaminerie bien excusable à son âge, le petit bossu n’oublia pas de se coiffer du hideux casque de carton qui complétait son déguisement et qui était percé de deux trous à la place des yeux ; puis il descendit tout doucement l’escalier et se faufila à travers les bosquets d’orangers où les oiseaux commençaient à s’éveiller dans un gazouillis joyeux qui se mêlait aux sanglots des fontaines.
Il entra dans une des grottes de rocaille qui se trouvaient à l’extrémité du jardin et où des sièges rustiques étaient creusés dans le rocher. Il se préparait à s’asseoir sur l’un d’eux lorsque miss Isidora, sortant d’un retrait de la grotte, se montra tout à coup à ses yeux.
La jeune fille avait eu la même idée qu’Oscar. Elle était descendue, avant que personne fût levé, faire une matinale promenade.
À la vue du hideux animal, elle avait jeté un cri d’épouvante et elle s’enfuyait éperdue. Oscar courut après elle pour la rassurer ; mais miss Isidora, de plus en plus effrayée, semblait avoir des ailes aux talons ; elle franchissait légèrement les plates-bandes, les petits ruisseaux et les bassins.
– Mais n’ayez donc pas peur, miss ! criait le petit bossu tout essoufflé. C’est moi, Oscar Tournesol !
Enfin la méprise fut expliquée, et la jeune fille rit de bon cœur de la frayeur que le jeune homme lui avait causée.
Tous deux rentrèrent dans la grotte, et Oscar, avec sa verve habituelle, mit la jeune milliardaire au courant de ses aventures de la nuit précédente. Les péripéties du souper offert par lord Burydan à la troupe de Mr. Sleary la divertirent franchement.
– Par exemple, fit-elle, je me demande un peu ce que votre excentrique ami va faire de tous ses clowns et de ses acrobates. Il médite sans doute quelque nouvelle folie.
– Il a, au contraire, un projet très sérieux et il me l’a confié pendant que nous revenions cette nuit en auto. Il veut utiliser tous ces individus, dont la force, l’adresse et l’agilité sont extraordinaires, à faire le siège de l’île des pendus. Il prétend, avec raison, que les nageurs, les hercules seront dans une pareille entreprise les plus précieux des collaborateurs.
– C’est possible, mais il me semble que cette troupe acrobatique tiendra beaucoup de place dans notre yacht.
– Aussi lord Burydan est-il décidé à fréter un autre navire qui marchera de conserve avec le yacht. Son immense fortune lui permet ce sacrifice, et il attend les meilleurs résultats de sa combinaison.
L’entretien du petit bossu et de miss Isidora fut interrompu par l’arrivée de lord Burydan lui-même. Il venait de trouver dans son courrier une lettre timbrée du Canada. Elle était de M. et Mme Noël Fless, installés à la Maison Bleue dont ils étaient devenus propriétaires et qui avaient gardé près d’eux le fou Baruch, dans l’espoir que le grand air, l’exercice physique et les bons soins amèneraient une amélioration dans son état.
Miss Isidora eut la satisfaction d’apprendre que, bien que son état mental demeurât stationnaire, la santé de son frère se maintenait aussi bonne qu’on pouvait le souhaiter.
CHAPITRE IV
Un locataire fantastique
Grâce à sa situation exceptionnelle, Golden-Cottage n’avait pas de voisins immédiats. Il fallait faire près de dix miles pour arriver jusqu’à une ferme à pigeons qui était l’habitation la plus rapprochée.
Les gens du pays avaient éprouvé une vraie satisfaction en apprenant que la propriété si longtemps abandonnée avait été achetée par un milliardaire de New York. Ils s’étaient dit que la contrée allait être enfin débarrassée des tramps, des Peaux-Rouges et des vagabonds de toutes sortes qui, pendant longtemps, avaient fait de Golden-Cottage leur lieu de réunion favori.
Leur joie ne fut pas de longue durée. Après quelques semaines de séjour, le milliardaire et ses amis désertèrent Golden-Cottage d’une façon aussi soudaine qu’ils s’y étaient installés.
Voici pourquoi :
En compagnie d’Harry Dorgan, Fred Jorgell avait dû retourner à New York, où la distribution des dividendes de la Compagnie des paquebots Éclair rendait leur présence indispensable. Antoine Paganot et Roger Ravenel ne quittaient pas San Francisco, surveillant de près le montage des machines du yacht la Revanche.
C’est alors que l’excentrique avait eu l’idée d’une longue excursion en auto jusqu’aux frontières mexicaines. Miss Isidora et les deux Françaises, après quelques hésitations, s’étaient décidées à l’accompagner, et naturellement Agénor, Kloum et le bossu furent invités à cette excursion qui promettait d’être très pittoresque.
Agissant en cela d’une façon toute différente de Fred Jorgell, l’excentrique s’en était rapporté pour la construction de son yacht à une société industrielle avec laquelle il avait passé un traité stipulant la livraison à date fixe du petit navire. De cette façon, il ne se mettait en peine de rien et s’évitait les soucis et la responsabilité qu’avaient assumés l’ingénieur Dorgan et ses deux amis.
Golden-Cottage était donc retombé dans le silence et dans l’abandon.
Les gens du voisinage, qui ne connaissaient rien des projets de Fred Jorgell, ne manquèrent pas de dire que, si le milliardaire avait abandonné une habitation si confortable et si bien située, c’est qu’il avait été poursuivi par des apparitions, qu’il avait entendu dans la nuit des bruits étranges, et plus que jamais le luxueux cottage et le domaine qui l’environnait eurent la réputation d’être hantés par les mauvais esprits.
Grâce à cette télégraphie bizarre dont les vagabonds et les malfaiteurs se servent pour se communiquer rapidement, à de très longues distances, les nouvelles qui peuvent les intéresser, le bruit ne tarda pas à se répandre parmi les tramps que Golden-Cottage était de nouveau sans défenseurs et, de plus, meublé avec une somptuosité qui permettrait de réaliser, sans risques, un opulent butin.
Les tramps sont peu enclins aux superstitions ; ils ne firent que hausser les épaules en apprenant que le cottage était hanté. Cette mauvaise réputation de l’immeuble leur parut une garantie de sécurité dans leurs opérations.
À peine si quelques jours s’étaient écoulés depuis le départ de Fred Jorgell que deux de ces chevaliers de la grand-route escaladaient les murs du jardin et, armés de fausses clefs et de pinces-monseigneur, pénétraient dans l’intérieur du cottage. Mais au moment où ils allaient enfoncer une porte, ils furent assaillis par un animal de forte taille, dont ils ne purent bien discerner l’espèce dans l’obscurité et qui les mordit cruellement aux mollets et à la joue.
Les deux malandrins s’enfuirent à toutes jambes, abandonnant là leur outillage de cambrioleur, et ne sachant que penser.
L’un d’eux était persuadé que l’animal qui les avait mordus n’était autre qu’un de ces pumas, carnassiers américains qui étaient autrefois très nombreux dans la région où ils ont été presque entièrement exterminés.
Le second tramp pensait avec plus de vraisemblance que leur ennemi était tout simplement un chien de garde, ce qui prouvait que la villa n’était pas abandonnée comme ils l’avaient cru. Ce qui restait hors de discussion, c’étaient les terribles morsures que les deux vagabonds avaient reçues et dont ils devaient porter longtemps la marque.
D’autres tramps, mis au courant, tentèrent aussi l’aventure, mais ne furent pas plus heureux ! Ils revinrent, eux aussi, sans aucune espèce de butin et après avoir reçu de dangereuses morsures.
L’animal qui les leur avait infligées ne pouvait pas être un chien, car ils n’avaient entendu aucun aboiement ; de plus, ils s’étaient convaincus, en se renseignant à droite et à gauche, que le milliardaire n’avait laissé dans sa maison de campagne aucun gardien.
Il y avait là quelque chose d’incompréhensible, et la légende du cottage hanté s’enrichit ainsi d’un nouvel épisode. On parla d’un animal diabolique en qui, sans doute, s’incarnait l’âme de l’ancien propriétaire assassiné.
Cette espèce de fantôme ne voulait souffrir personne dans Golden-Cottage. Il était invulnérable. Les balles d’acier des revolvers les plus perfectionnés passaient au travers de sa carcasse sans lui faire le moindre mal. C’était lui qui avait chassé Fred Jorgell et qui chasserait de même tous ceux qui mettraient le pied dans la maison maudite.
Des colons avaient eu l’occasion de passer de nuit sur la route qui longeait le jardin de Golden-Cottage. Ils avaient entendu des gémissements qui n’avaient rien d’humain, des bruits de pas, comme si quelqu’un montait et descendait précipitamment les escaliers.
On en conclut que l’assassiné revenait dans sa maison pour y rechercher quelque objet qui lui faisait faute dans l’autre monde, et qu’il était condamné à découvrir pour avoir le droit de goûter le repos éternel.
Pour les uns, cet objet était un poignard ; pour d’autres, un trésor ; pour d’autres encore, une cassette remplie de papiers mystérieux.
Les imaginations allaient bon train. Il suffit d’un temps court pour faire de Golden-Cottage un lieu de répulsion et d’épouvante près duquel on n’aimait pas à passer et où personne n’eût osé mettre les pieds une fois le soleil couché.
Il y avait bien une part de vérité dans ces légendes, mais l’animal qui les causait n’avait rien de fantastique. C’était un simple chien barbet à l’épaisse toison noire et frisée, de cette race intelligente, fidèle, mais féroce, dont on conte des traits d’une sagacité presque humaine.
C’était ce même Pistolet qui avait été enlevé en aéroplane avec M. Bondonnat et qui, après avoir séjourné à l’île des pendus, en avait été emmené par Kloum et lord Burydan.
Lorsque ces derniers, après avoir atterri heureusement près d’un village de Noirs situé à peu de distance du Mississippi, eurent été obligés de prendre la fuite, Pistolet, séparé de ses amis par une foule hurlante et pourchassé comme eux à coups de pierre et à coups de revolver, n’avait échappé à la mort qu’en se réfugiant dans un champ de cotonniers où il était demeuré jusqu’au soir, mourant de faim et de soif.
À la nuit close, il s’était décidé à sortir de sa cachette et, avec de prudents détours, il avait retrouvé la piste de lord Burydan et de Kloum et l’avait suivie jusqu’au fleuve.
Mais là, le pauvre animal n’avait plus su quelle direction prendre. Il s’était mis à errer à l’aventure.
Que se passa-t-il alors dans son âme de chien ? À quel raisonnement se livra-t-il ? Toujours est-il qu’après deux jours de vaines recherches il se convainquit que ses protecteurs étaient définitivement perdus pour lui. Et courageusement il se mit en marche vers le nord.
Son instinct lui indiquait sans doute que c’est en allant dans cette direction qu’il échapperait à la chaleur, aux moustiques et aux Noirs, trois ennemis qui ne lui donnaient pas de répit.
Chaque fois, en effet, qu’il rencontrait des nègres, ils essayaient de le capturer, et l’on en comprendra la raison lorsqu’on saura qu’il portait, retenue à son collier par une ficelle, une bourse de cuir que M. Bondonnat y avait attachée lui-même. Ce qui faisait croire aux nègres que ce chien errant était porteur d’un trésor.
Pistolet se vengeait à sa façon des persécutions de ses ennemis les Noirs. Il ne se passait guère de nuit qu’il ne leur enlevât un poulet, un lapin ou quelque autre animal du même genre. Une fois, il étrangla un cochon de lait dont il alla se repaître dans un champ de maïs et, chaudement poursuivi par le propriétaire de la bête, il eut l’oreille emportée par une balle de carabine.
L’île des pendus se trouve sous une latitude très froide ; aussi, Pistolet qu’incommodait encore son épaisse toison faillit-il succomber à la chaleur. L’ardent soleil des tropiques le laissait sans force et sans courage, dévoré d’une soif inextinguible ; mais au bout de peu de jours, Pistolet trouva un remède à ses désagréments.
– Puisqu’il fait trop chaud dans la journée, se dit-il sans doute, je dormirai le jour et je ne marcherai que la nuit.
Et il le fit comme il l’avait résolu.
Le savant météorologiste Prosper Bondonnat n’eût pas raisonné avec plus de logique.
Quant aux moustiques, Pistolet trouva le moyen de déjouer leurs attaques. Il se roula dans la boue du fleuve qui, en séchant et en s’emmêlant à ses poils, le dota d’une cuirasse à l’épreuve des aiguillons les plus acérés.
Mais, par exemple, il était hideux. L’oreille coupée, l’air farouche, et montrant les dents à tout ce qui l’approchait, il eût ressemblé à une bête féroce sans la bourse de cuir qui pendillait toujours à son collier.
Au bout de peu de temps, l’intelligent animal s’était fait à cette existence vagabonde.
Nous avons dit que son instinct le faisait tourner le dos aux contrées chaudes et se diriger vers le nord, mais il fut arrêté par un obstacle infranchissable. Il avait laissé à sa droite le Mississippi, et il se trouva bientôt en face d’un de ses affluents les plus importants, le Republican, une rivière à peu près trois fois large comme la Seine. Pistolet eût peut-être réussi à traverser cette étendue d’eau immense pour lui, mais il s’aperçut bien vite que la rivière était peuplée de caïmans.
Un jour qu’il se désaltérait tranquillement, il faillit être dévoré par un de ces sauriens dont il entendit claquer la mâchoire presque à deux doigts de ses oreilles.
Cette aventure fit faire à Pistolet de profondes réflexions. Dès lors, quand il avait soif, il prenait les plus grandes précautions et c’est tout juste s’il ne buvait pas en courant, comme ces chiens du Nil dont parle Hérodote au chapitre des crocodiles, dans sa description de l’Égypte.
Limité à l’est par le Mississippi, au nord par le Republican et fuyant les chaleurs du sud, Pistolet fut donc forcé de prendre la direction de l’ouest. Il longea pendant plusieurs semaines les rives des cours d’eau qui descendent des montagnes Rocheuses pour aller se perdre dans le sein du Père des eaux[2].
Disons-le, cet itinéraire ne déplaisait pas trop à l’élève d’Oscar Tournesol. À mesure, en effet, qu’il remontait vers les hauteurs d’où jaillissent les sources des fleuves, il trouvait une atmosphère plus fraîche, mieux appropriée à ses poumons de barbet français, dont les ancêtres en une longue suite de générations n’avaient connu qu’un climat absolument tempéré.
Il trouvait encore un autre motif de satisfaction dans la disparition absolue de ses ennemis les nègres. En effet, les pentes des montagnes Rocheuses, en cette partie de l’Amérique, ont été surtout colonisées par des Blancs et des métis espagnols. Les fermes, très éloignées l’une de l’autre, sont à une grande distance des chemins de fer et des villes. Pistolet voyageait donc maintenant presque en touriste.
D’ailleurs, il trouvait une pâture abondante en s’emparant subrepticement de quelque agneau sans défiance, car le pays qu’il traversait était un pays de pâturages, et il n’était pas de jour qu’il ne rencontrât d’immenses troupeaux qui paissaient sans gardien l’herbe fine qui tapisse les vallons. Pistolet était devenu décidément un chien quelque peu apache : il ne vivait plus que de meurtres et de rapines.
Cependant il allait toujours droit devant lui, car d’instinct autant que de raisonnement, il savait que vers le sud toute issue lui était fermée. En outre, il avait sans doute conscience qu’il n’eût pas été prudent pour lui de revenir sur le théâtre des meurtres dont il avait sillonné son passage.
Mais bientôt le paysage se modifia : plus de fermes, plus de troupeaux, plus de routes tracées, l’eau même se faisait rare.
Pistolet se trouvait maintenant en pleine montagne. Des landes sauvages, des ravins, des précipices et des rocs abrupts l’entouraient. Quelquefois le chemin lui était barré par de gigantesques massifs de granit ou par d’impétueux torrents qu’il était obligé de contourner. Et, dans ces solitudes désolées, il lui arriva plus d’une fois de souffrir de la faim.
Mais, sous l’aiguillon de la nécessité, ses instincts chasseurs s’étaient réveillés ; son cerveau retrouva le souvenir confus des ruses ancestrales, employées à la poursuite du gibier aux époques primitives. Il réapprit à forcer le lièvre au gîte, à arrêter les perdrix de roche, à saisir dans leurs nids les oiseaux aquatiques des marécages.
De la même façon qu’il avait vécu de pillage, il vécut de chasse. C’est ainsi qu’au Moyen Âge, faute de mécréants et d’hérétiques à pourfendre, les nobles chevaliers se contentaient, pendant les loisirs de la paix, de courir le cerf et de forcer le sanglier.
C’est pendant une de ces chasses que, sans même s’en apercevoir, Pistolet franchit un des défilés situés sur l’un des sommets les plus élevés de la chaîne.
Sur les hauts plateaux des montagnes Rocheuses, le pauvre animal avait eu très froid ; ce fut donc avec une véritable satisfaction qu’il redescendit vers les contrées plus riantes qui s’étendent sur le versant occidental.
La même logique ou, si l’on veut, la même nécessité qui l’avait poussé à remonter vers les sources des affluents du Mississippi, lui fit côtoyer la berge des rivières qui aboutissent au rio Colorado, puis enfin, au Colorado lui-même.
Il eût peut-être suivi ce fleuve jusqu’à l’endroit où il vient se jeter dans le golfe de Californie, si la présence de ses anciens ennemis les crocodiles et l’augmentation de la chaleur ne l’avaient fait brusquement remonter vers le nord. C’est de cette façon qu’il fut amené à franchir la chaîne de la sierra Nevada, encore plus sauvage et plus glaciale que les montagnes Rocheuses.
Mais sitôt qu’il eut redescendu dans la vallée, Pistolet se retrouva en plein pays civilisé. Les villes et les villages se touchaient presque. Les routes et les lignes de chemin de fer abondaient. Le gibier avait considérablement diminué : force fut donc à notre héros de reprendre son existence de rapines et de dormir le jour pour marcher la nuit, en profitant des routes assez bien tracées qui sillonnent l’État de Californie et convergent toutes vers sa capitale, San Francisco.
C’est ainsi que, sans s’en douter, Pistolet se rapprochait de jour en jour de ses amis, obéissant à cette fatalité de la force des choses qui s’exerce aussi bien sur les êtres les plus humbles que sur les intelligences les plus altières.
Une nuit que Pistolet trottinait allègrement sur la route poudreuse en aboyant de temps en temps sourdement vers la lune resplendissante, il tomba tout à coup en arrêt, en poussant un grognement de stupeur et de plaisir qui attestait la profonde émotion qu’il venait de ressentir.
Il était resté immobile, les narines frémissantes, les yeux mi-clos, agité d’une inquiétude solennelle.
C’est que, dans les imperceptibles corpuscules qu’apportait la brise à ses papilles olfactives, il venait de reconnaître des émanations connues. Tous ceux auxquels le pauvre animal s’était attaché, et qui avaient été bons pour lui, avaient passé dans cet endroit depuis peu de temps et, dans son raisonnement de chien, il dénombrait lord Burydan, Kloum, le petit bossu, Andrée, Frédérique, Roger Ravenel et Antoine Paganot.
Il poussa vers le ciel un aboiement de triomphe, puis il se mit à tourner en rond, à bondir et à gambader en signe de satisfaction, la queue frétillante et son unique oreille toute droite.
Ce moment d’exaltation ne dura guère. En chien pratique, il avait réfléchi qu’il fallait au plus vite retrouver ses amis et, le nez dans la poussière, il suivait patiemment leurs traces. Entre toutes il discernait mieux celles de lord Burydan et de Kloum. Elles le conduisirent jusqu’à un petit bois où le lord excentrique et son serviteur avaient chassé peu de jours auparavant. Le bois était bordé par une haie de cactus épineux que Pistolet franchit non sans quelques égratignures, et il se trouva dans un magnifique jardin qui n’était autre que celui de Golden-Cottage.
Toute cette nuit-là, Pistolet l’employa, mieux que n’eût pu le faire un détective de profession, à démêler et à suivre les pistes qu’il avait découvertes. Malheureusement, tous les habitants de la villa y étaient venus et en étaient repartis en automobile, et il arrivait fatalement un instant où la piste était coupée net et où Pistolet, grondant de désappointement et de fureur, était obligé de revenir sur ses pas.
Au petit jour, le fidèle animal était harassé de fatigue. Il avait tourné en cercle, toute la nuit, comme dans un invisible labyrinthe. Il alla dormir dans une des grottes de rocailles qui ornaient le jardin, et à la nuit suivante il reprit, sans plus de succès que la veille, ses investigations.
La troisième nuit, la faim força Pistolet à gagner un village voisin où faute de mieux il se contenta de quelques os glanés dans les tas d’ordures ; mais après ce repas improvisé, il se hâta de revenir à Golden-Cottage où, désormais, il se trouvait prisonnier comme ces chevaliers de la légende qui ne pouvaient sortir d’un cercle enchanté. Toute la nuit il tournait à travers les jardins comme une âme en peine, revenant sans cesse sur ses pas, se condamnant ainsi lui-même à un supplice qu’un Dante de race canine eût certainement placé dans l’enfer cynégétique.
Mais, jusqu’alors, Pistolet n’avait pu pénétrer dans l’intérieur de Golden-Cottage, et bien des fois il avait gratté aux portes pendant des heures en parlant plaintivement. Les tramps cambrioleurs qu’il mit en fuite une première fois après les avoir mordus, lui donnèrent le moyen de pénétrer dans l’habitation par la porte qu’ils avaient fracturée.
Pistolet parcourut toutes les pièces du cottage, avec aussi peu de résultat, on le devine, qu’il en avait exploré les jardins. Décontenancé, mais non découragé, il installa son quartier général dans une sorte de mansarde où il trouva une gerbe de paille de maïs et, dès lors, son existence s’organisa régulièrement.
Après une sieste qui durait toute la journée, il se mettait en chasse au coucher du soleil, et sitôt qu’il avait trouvé une pâture quelconque, il revenait se livrer à ses inutiles et patientes perquisitions.
Devenu presque sauvage, Pistolet faisait comme on l’a vu une guerre acharnée aux maraudeurs dont il reconnaissait de loin l’odeur suspecte déjà flairée à l’île des pendus. Il se couchait à terre sitôt qu’on faisait le geste de le mettre en joue, aussi ne fut-il jamais blessé, ce qui accrédita la légende de son invulnérabilité.
Pistolet en était à la troisième semaine de son séjour à Golden-Cottage, lorsqu’il se produisit un fait qui amena une certaine modification dans ses habitudes et dans son genre de vie.
Un jour, dans le passage d’une haie épineuse, la ficelle qui attachait à son collier la bourse de cuir qui avait tant excité la curiosité des Noirs se rompit. Le sac tomba à terre. Et Pistolet, qui avait sans doute compris que cet objet avait une certaine importance, le saisit entre ses dents et le rapporta jusqu’à sa niche. Là il se mit à jouer avec, le lançant en l’air et le rattrapant comme eût pu le faire un footballeur de profession.
Cet exercice violent eut pour résultat de relâcher la ficelle serrée autour du col du sac de cuir. Celui-ci s’ouvrit enfin, et les vingt-quatre lettres de l’alphabet découpées dans des planchettes par M. Bondonnat à l’île des pendus s’en échappèrent avec bruit et s’éparpillèrent sur le plancher.
Pistolet était demeuré immobile. Tout un travail se faisait dans sa cervelle. Il se rappelait les patientes leçons que lui avaient données d’abord Oscar Tournesol, puis M. Bondonnat lui-même.
Tout à coup, obéissant à la secrète impulsion de l’habitude, il se mit à former des mots, qu’il effaçait ensuite avec sa patte pour en former d’autres, tout en aboyant joyeusement.
CHAPITRE V
Le guet-apens
Malgré le zèle d’Harry Dorgan et des deux Français qui l’assistaient, les travaux de construction et d’aménagement de la Revanche avaient d’abord marché avec une extrême lenteur.
En dépit de l’or jeté à pleines mains par Fred Jorgell, rien ne marchait au gré de l’ingénieur. Il n’était pas de jour où il ne se produisît quelque contretemps ou quelque accident. Tantôt c’étaient des pas de vis qui n’étaient pas de calibre et qu’il fallait changer, tantôt des pièces d’acier qui présentaient une paille ou une défectuosité quelconque.
– Je ne me dissimule pas, disait Harry Dorgan, que ces contretemps doivent venir de la Main Rouge. Malgré toutes les précautions que nous avons prises, les bandits ont dû deviner le but de notre entreprise et ils cherchent par tous les moyens possibles à nous causer des retards.
Maintes fois avant le départ de lord Burydan pour son excursion, l’ingénieur avait eu à répondre aux boutades et aux plaisanteries de l’excentrique.
– Vous voyez, lui disait-il, que c’est moi qui ai choisi la bonne méthode ! Mon yacht l’Ariel, dont j’ai confié la construction à l’industrie privée sans souffler mot à personne de mes intentions, a été mis en chantier bien longtemps après le vôtre et cependant il est tout aussi avancé et il sera terminé en même temps.
– Parbleu, répliquai Harry Dorgan, il y a à cela une raison excellente, c’est que l’Ariel est d’un tonnage moitié moins fort que la Revanche, qui ne jauge pas moins de deux mille tonneaux.
– La Revanche sera notre cuirassé de premier rang, notre dreadnought, et l’Ariel nous tiendra lieu de croiseur. Ce n’est pas trop de deux unités aussi puissantes pour faire le siège de l’île des pendus qui, j’ai pu m’en rendre compte par moi-même, est admirablement fortifiée.
– Mr. Fred Jorgell, reprit l’ingénieur, avait l’intention de demander qu’on mît à sa disposition un cuirassé de la marine américaine, mais les directeurs du ministère se sont jusqu’ici refusés à lui donner satisfaction. Ils sont persuadés que l’île des pendus n’existe pas ou n’a pas l’importance qu’on veut lui attribuer.
– Je ne serais pas surpris que la Main Rouge ne possédât quelques affidés parmi les hauts fonctionnaires de la marine comme elle en possède dans toutes les grandes administrations.
– Pour moi, ça ne fait pas l’ombre d’un doute !
– Eh bien, tant pis ! Nous nous passerons des cuirassés de l’État, voilà tout. Si tout le monde montrait la même initiative dont nous faisons preuve, il y a longtemps que les bandits de la Main Rouge auraient été exterminés.
C’était toujours à peu près sur cette conclusion que se terminaient les conversations entre lord Burydan et l’ingénieur Harry.
Cependant, grâce à l’énergie de ce dernier, qui expulsait des chantiers pour la moindre peccadille les ouvriers soupçonnés de sabotage et stimulait par de fortes primes le zèle des ouvriers sérieux, les travaux avançaient maintenant avec une grande rapidité. Harry Dorgan, qui avait cru d’abord que le yacht ne serait terminé qu’en janvier, constata avec satisfaction que la Revanche serait prête à prendre la mer dès la fin de décembre.
Il écrivit immédiatement à lord Burydan pour lui apprendre cette bonne nouvelle, et l’excentrique, qui excursionnait alors sur les frontières de l’Arizona et du Mexique, s’empressa d’abréger la durée de son voyage et se hâta de reprendre le chemin de New York où il avait différentes affaires à régler.
Andrée et Frédérique, que pilotait miss Isidora dans les magasins, employèrent huit jours entiers à toutes les emplettes nécessaires à la longue croisière qu’elles allaient entreprendre, car, dès le début, Mlle de Maubreuil, aussi bien que son amie, avaient affirmé avec insistance qu’elles ne se sépareraient pas de leurs fiancés et qu’elles contribueraient pour leur part à la délivrance de M. Bondonnat, quelque danger qu’elles dussent courir.
À New York, elles retrouvèrent Fred Jorgell en ce moment accablé de besogne à cause de l’extension qu’il venait d’imprimer à la Compagnie des paquebots Éclair qui, maintenant, ne possédait pas moins de cinquante grands navires sur l’Atlantique.
Le départ de l’expédition avait été fixé à la seconde quinzaine de janvier. Il fut convenu que les deux Françaises ainsi que lord Burydan et ses amis se reposeraient une quinzaine de jours à Golden-Cottage afin d’être mieux en état de supporter les fatigues d’un long voyage. Miss Isidora, Frédérique, Andrée, ainsi que lord Burydan, Oscar, Kloum et Agénor devaient voyager dans le wagon-salon qui était la propriété personnelle de Fred Jorgell et qui, à cause des fréquents voyages du milliardaire, faisait pour ainsi dire perpétuellement la navette entre New York et San Francisco. Fred Jorgell, dont les affaires étaient presque terminées, devait les rejoindre le surlendemain.
Mais, la veille du départ des jeunes filles, Mlle de Maubreuil reçut une convocation du consulat français où elle était mandée pour la législation de certains papiers de famille.
En effet, à la suite de la disparition de M. Bondonnat, son tuteur légal, elle avait demandé à être émancipée et à s’occuper elle-même de la gérance de sa fortune, ce qui lui avait été accordé sans difficulté.
Andrée montra la convocation qu’elle venait de recevoir à miss Isidora et à Frédérique.
– Nous serons obligées de t’attendre un jour ou deux, dit celle-ci.
– Pourquoi m’attendre ? répliqua Mlle de Maubreuil. Il y a un moyen bien plus simple d’arranger les choses.
– Et comment ?
– Partez aujourd’hui comme cela est convenu, et moi je ferai route avec Mr. Fred Jorgell une fois mes affaires réglées.
– C’est cela, approuva miss Isidora. De cette façon, nous ne ferons pas attendre nos fiancés qui sont prévenus.
Les choses étant ainsi arrangées, Andrée de Maubreuil prit congé de ses amies qu’elle accompagna jusqu’à la gare du Central Pacific Railroad. Elle devait les rejoindre à Golden-Cottage sitôt qu’elle aurait achevé de remplir les formalités indispensables au consulat. Mais Fred Jorgell se trouva retenu plus longtemps qu’il ne l’avait pensé par le règlement de ses affaires. Il conseilla à la jeune fille de l’attendre, à moins qu’elle ne préférât partir seule.
Ce fut à ce dernier parti qu’elle s’arrêta. Mlle de Maubreuil s’était déjà accoutumée quelque peu aux mœurs américaines, et l’on sait qu’aux États-Unis les jeunes filles, et quelquefois même les enfants, accomplissent de longs voyages sans être accompagnées de personne, défendues par le seul respect dont la femme est universellement entourée en Amérique.
Le milliardaire voulut installer lui-même la jeune fille dans un pullman-car[3] retenu à l’avance pour elle et pour mistress Mac Barlott, la gouvernante écossaise de miss Isidora, qui devait servir de chaperon à Andrée et lui tenir compagnie pendant ce long voyage. Les deux femmes devaient descendre à la station de Juwilly, située à une heure de distance de San Francisco et qui était la gare la plus rapprochée de Golden-Cottage.
Cependant, une fois arrivées à San Francisco, miss Isidora et Frédérique ne se hâtèrent pas de regagner la villa. Sur les instances d’Harry Dorgan et de Roger Ravenel, auxquels se joignit lord Burydan, les deux jeunes filles décidèrent de séjourner pendant une huitaine au Palace-Hotel, pour visiter en détail la ville et ses environs où les sites pittoresques abondent.
Andrée de Maubreuil fut prévenue de cette décision par une dépêche de l’ingénieur Paganot qui l’avertissait de ne pas descendre à Juwilly comme il avait été primitivement convenu, mais bien à San Francisco même, où ses amis viendraient au-devant d’elle à la gare.
Malheureusement, cette dépêche n’arriva pas à sa destination. Les agents de la Main Rouge, toujours aux aguets, l’avaient interceptée et l’avaient transmise à Baruch qui, sous l’aspect et sous les traits de Joe Dorgan, était l’un des lords directeurs de la redoutable association.
Le train par lequel l’ingénieur Paganot attendait Mlle de Maubreuil arrivait à San Francisco à onze heures vingt-cinq du soir. Miss Isidora et Frédérique avaient accompagné le jeune homme pour assister à l’arrivée de leur amie, mais la cohue des voyageurs franchit les guichets et se perdit dans le vaste hall de la gare sans que Mlle de Maubreuil eût paru.
D’abord étonnés de ne pas trouver Andrée, les trois jeunes gens ne tardèrent pas à concevoir de son absence les plus graves inquiétudes.
– Comment se fait-il qu’elle ne soit pas venue ? murmura l’ingénieur. Sa dernière lettre m’annonce que toutes ses affaires sont terminées au consulat et me recommande d’être exact à son arrivée.
– Elle a dû recevoir notre dépêche, dit miss Isidora.
– D’ailleurs, ajouta Frédérique, si pour une raison ou pour une autre elle avait manqué le train, elle nous aurait prévenus télégraphiquement.
– Pourvu, murmura Paganot qui osait à peine aller jusqu’au bout de sa pensée, que la Main Rouge…
– Ne dites pas cela, s’écria Frédérique avec épouvante, je ne veux pas soupçonner un seul instant que ma pauvre Andrée soit tombée entre les mains de ces bandits.
– Renseignons-nous, dit l’ingénieur en s’efforçant de dominer l’inquiétude qui l’envahissait.
– Oui, approuva miss Isidora, adressons-nous au chef de train ; peut-être pourra-t-il nous donner quelque utile information.
Comme tous les fonctionnaires de ce genre sur les lignes de chemin de fer américaines, le chef de train était un mulâtre – un coloured man – que le nom de Fred Jorgell, appuyé d’un royal pourboire, rendit tout de suite obséquieux et docile.
Quand on lui demanda s’il n’avait pas remarqué que dans un pullman-car une jeune fille vêtue de noir, aux yeux bleus et aux cheveux d’un blond cendré, accompagnée d’une dame d’une quarantaine d’années aux traits un peu virils et au large chapeau décoré de pivoines, il se rappela parfaitement que deux personnes répondant à ce signalement étaient montées à New York.
– Je les ai d’autant mieux remarquées, fit-il, qu’en cours de route j’ai eu l’occasion de leur rendre quelques petits services dont elles m’ont récompensé par de généreux pourboires…
– Et où sont-elles descendues ? demanda anxieusement l’ingénieur.
– Un peu avant d’arriver à San Francisco, à une petite station qui se nomme Juwilly.
– Plus de doute possible, s’écria Frédérique, Andrée n’a pas reçu le télégramme. Elle nous croit toujours à Golden-Cottage où elle n’a dû trouver personne !
– Il ne s’agit peut-être que d’un accident tout naturel, dit miss Isidora, moins rassurée au fond qu’elle ne voulait le paraître. Il arrive tous les jours qu’un télégramme s’égare !
– Non, fit l’ingénieur en secouant la tête, je crains bien qu’il n’y ait là-dessous quelque chose de plus grave !
– En tout cas, déclara Frédérique, même s’il ne s’agit que d’un simple malentendu, il faut partir pour Golden-Cottage !
– Et cela sans perdre un instant ! s’écria miss Isidora. En ne voyant personne à la gare de Juwilly pour l’attendre, notre amie a dû se trouver dans un grand embarras.
– Peut-être, dit Frédérique, s’est-elle réfugiée dans quelque hôtel jusqu’au passage du train suivant ?
– C’est que ce train est le dernier ?
Mortellement inquiets, tous trois remontèrent en auto et se firent conduire au Palace-Hotel pour prévenir lord Burydan et Roger Ravenel, qui, sans hésiter, déclarèrent qu’ils voulaient aller, eux aussi, à Juwilly. Oscar insista pour se joindre à eux et tout le monde s’entassa tant bien que mal dans l’auto, qui partit en troisième vitesse dans la direction de la petite station de banlieue.
En y arrivant, ils trouvèrent la gare déserte et les employés partis. Seul le chef de la station n’était pas encore couché. On accabla de questions ce fonctionnaire, et il se rappela parfaitement, lui aussi, que deux voyageuses, dont le signalement correspondait à celui d’Andrée de Maubreuil et de mistress Mac Barlott, étaient descendues du rapide de New York.
– Elles paraissaient de très bonne humeur, dit-il, et elles sont montées dans une luxueuse automobile qui stationnait devant la gare et dont le conducteur semblait les attendre.
– Mon Dieu ! s’écria Paganot avec angoisse, cette auto ne peut appartenir qu’à la Main Rouge ! Andrée est perdue !
Tous se regardèrent consternés, ayant le pressentiment de quelque catastrophe. Ils savaient parfaitement que la villa était déserte, qu’il n’y restait plus aucune auto et qu’aucun chauffeur ne pouvait avoir reçu l’ordre d’aller au-devant de la jeune fille. Ce qui mettait le comble à leur perplexité, c’était d’apprendre qu’Andrée fût montée sans hésitation dans cette voiture inconnue.
– Cela n’est que trop évident, murmura l’excentrique, Mlle de Maubreuil a été victime d’un guet-apens !
– Courons vite à Golden-Cottage, s’écria miss Isidora !
– Qui sait si nous y trouverons Andrée ! murmura Frédérique avec angoisse.
– Je tremble que nous n’arrivions trop tard, ajouta Paganot d’une voix à peine perceptible.
On remonta dans l’automobile qui, pilotée par lord Burydan, se lança à une allure folle sur la route qui aboutissait à Golden-Cottage.
Les renseignements fournis par le mulâtre et par le chef de gare étaient parfaitement exacts.
Andrée de Maubreuil et mistress Mac Barlott, descendues à la gare de Juwilly, avaient aperçu la grande auto verte de Fred Jorgell, qui faisait ordinairement le trajet de la gare au cottage. Le chauffeur leur en ouvrit obséquieusement la portière et elles y montèrent sans faire la moindre observation.
– Je suis un peu surprise, dit Andrée, que Frédérique ou M. Paganot ne soient pas venus au-devant de moi.
– Cela n’a rien d’étonnant, répondit mistress Mac Barlott, au moment même où l’auto accélérant sa vitesse laissait derrière elle les lumières du village qui entourait la station. Mlle Frédérique et miss Isidora ont pu être retenues au cottage par l’arrivée de quelques visiteurs. Quant à M. Paganot, vous savez qu’il est presque toujours à San Francisco.
– Cela m’étonne pourtant qu’il ne soit pas venu, murmura Andrée…
Le voyage se continua silencieusement, Golden-Cottage n’était pas très éloigné de la gare. Au bout d’un quart d’heure on apercevait les lumières de l’habitation, et bientôt l’auto franchissait la grande grille de fer forgé, qu’intentionnellement sans doute on avait laissée ouverte, et venait stopper en face du perron.
Le chauffeur ouvrit la portière, les deux femmes descendirent et gravirent les marches du perron, pendant que l’auto, après un virage savant, se dirigeait lentement vers la grille, qui se referma aussitôt qu’elle fut sortie.
Il y avait à Golden-Cottage un garage spacieux. En toute autre circonstance les deux femmes eussent peut-être été surprises de voir partir de nouveau en pleine nuit la voiture qui les avait amenées, mais elles ne prêtèrent aucune attention à ce détail qui aurait dû leur sembler suspect. Avant tout elles avaient hâte de revoir leurs amis.
L’Écossaise, qui marchait à quelques pas en avant d’Andrée, ouvrit la porte du vestibule. À sa grande surprise, il n’était pas éclairé ; mais elle y avait à peine pénétré que quelque chose de glacial comme eût pu l’être une poignée de neige se posa sur son visage, en même temps que deux bras robustes l’empoignaient.
Elle tomba inanimée entre les bras de l’agresseur qui l’avait épiée dans l’ombre et qui venait d’appliquer sur son visage un masque rempli de chloronal, ce terrible chloroforme sans odeur inventé par le docteur Cornélius.
L’homme jeta ce corps inerte et pareil à un cadavre sous une draperie de velours qui le dissimulait entièrement et s’avança au-devant de Mlle de Maubreuil.
Toute cette scène s’était passée si rapidement, mistress Mac Barlott avait été en quelque sorte escamotée avec tant de prestesse, que c’est à peine si la jeune fille, qui avait monté les marches, avait eu le temps d’atteindre le vestibule. Elle fut, elle aussi, très étonnée de se trouver tout à coup en pleines ténèbres.
– Mistress Mac Barlott ! cria-t-elle, où êtes-vous donc ? Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de lumière. Pourquoi Frédérique n’est-elle pas là ?
Nerveusement, Andrée avait ouvert une des portes, qui se trouvait devant elle et qui donnait sur un salon.
La pièce était vide. Mais à la clarté des lampes électriques, qui l’inondaient d’une lumière crue, Andrée aperçut en face d’elle un homme de robuste stature dont le visage était recouvert d’un étrange masque de caoutchouc mince.
La jeune fille jeta un cri terrible et se recula précipitamment ; mais l’homme l’avait saisie par les poignets.
– Mademoiselle, dit-il rudement et d’une voix dont le timbre la fit frissonner, d’une voix qu’il lui sembla avoir entendue déjà, mistress Mac Barlott ne viendra pas ni votre amie Frédérique non plus… Nous sommes seuls dans cette maison.
– Au secours ! s’écria Andrée, qui, après avoir failli s’évanouir de peur, puisait de l’énergie dans l’excès même de sa terreur.
– Inutile de crier, fit l’homme, qui continuait à la maintenir d’une étreinte inflexible ; on ne vous entendra pas ! Je vous dis qu’il n’y a personne ! Il faudra bien que vous m’écoutiez !
– Non, jamais ! Au secours ! Au secours !
Andrée réfléchit tout à coup qu’elle se trouvait en présence d’un bandit. Comme précisément elle avait touché à New York quelques jours auparavant une somme importante, elle pensa qu’elle avait peut-être à sa disposition le moyen de se débarrasser de l’audacieux malfaiteur.
– Voulez-vous de l’argent, bégaya-t-elle d’une voix étranglée, j’ai là dans un portefeuille dix mille dollars en bank-notes ; prenez-les, mais, je vous en supplie, laissez-moi !
– Je n’ai pas besoin de vos dollars ! répliqua l’homme en arrêtant longuement sur elle son regard dur, impérieux et fascinateur. Ce que je veux, c’est que vous m’écoutiez ! Je ne suis pas ce que j’ai l’air d’être ! Je vous aime follement. Il faut que vous veniez avec moi, et, de gré ou de force, vous y viendrez, car vous êtes en mon pouvoir !
– Jamais ! Plutôt mourir !…
La jeune fille lança vers la campagne déserte un cri d’appel déchirant. Et, cette fois, il lui sembla qu’un cri lointain avait répondu à sa voix.
– Épargnez-vous donc ces cris inutiles ! s’écria le bandit avec impatience, personne ne viendra ! Personne ne peut venir à votre secours ! Il faut que vous me suiviez ! C’est le seul moyen d’échapper à un danger terrible qui menace tous vos amis !…
Il essayait d’entraîner la jeune fille du côté de la porte, mais elle se débattait avec une énergie désespérée. Et, en face de cette résistance inattendue, l’homme masqué perdait tout sang-froid, bégayait des phrases sans suite, tout en bousculant brutalement sa victime qui continuait à appeler au secours de toutes ses forces.
– J’aurais dû vous enlever d’abord, grommela-t-il, je vous aurais expliqué mes projets après !… Je vous en prie, écoutez-moi donc !
Folle de terreur, Mlle de Maubreuil ne prêtait aucune attention à ses paroles. Elle continuait à appeler à l’aide, d’une voix aiguë et plaintive qui résonnait étrangement dans le silence de la campagne endormie.
Mais cette fois, elle en était sûre, elle avait distinctement entendu une voix qui répondait à la sienne. Il lui semblait qu’on avait crié « courage ! » ou « tenez bon ! ». Elle n’eût pu préciser, mais certainement, on allait venir à son secours. Ranimée par cet espoir, elle se débattait plus furieusement sous les étreintes du bandit.
– Tais-toi ! s’écria-t-il avec rage. Te tairas-tu !
Et lâchant un des poignets de la jeune fille, il lui appuya sa large paume sur la bouche, lui broyant les lèvres, la réduisant ainsi, meurtrie et pantelante, au silence.
– Tu vas venir, maintenant ! rugit-il.
Il la traîna violemment jusqu’à l’entrée du vestibule. Mais là un grondement sourd le fit reculer.
Avant qu’il eût eu le temps de se mettre en défense, une sorte de bête fauve s’élançait au fond des ténèbres, et, le mordant à la main, le forçait à lâcher Mlle de Maubreuil. Puis, revenant à la charge, elle sautait à la gorge du bandit et lui enfonçait ses crocs en pleine chair.
Andrée, obéissant à une impulsion instinctive, avait pris la fuite, mais après avoir fait quelques pas, elle s’arrêta.
Dans le hideux animal cuirassé de boue, amputé d’une oreille, qui venait si étrangement de prendre sa défense, elle avait cru reconnaître le chien emmené en même temps que M. Bondonnat par les bandits.
Un coup d’œil jeté sur le collier de cuivre alors vivement éclairé par la lumière électrique ne lui laissa plus de doute.
– Pistolet ! s’écria-t-elle.
Le chien répondit par un aboiement joyeux, ce qui laissa une seconde de répit à son adversaire.
Mais en entendant ce nom de Pistolet, le bandit masqué avait paru frappé d’une stupeur et d’une épouvante indicibles.
D’un effort désespéré, il s’arracha aux crocs de son ennemi, bondit vers la porte et se perdit dans les ténèbres.
Pistolet aboyait furieusement et se lançait déjà à la poursuite du coquin, mais Andrée de Maubreuil le rappela :
– Ici, Pistolet, balbutia-t-elle d’une voix défaillante, ne me quitte pas, mon bon chien, reste là pour me défendre !…
Le fidèle animal obéit, et vint lécher doucement les mains de sa maîtresse.
Épuisée par la lutte qu’elle venait de soutenir, Andrée eut encore la force de se traîner en chancelant jusqu’à la porte du vestibule, dont elle poussa les lourds verrous : ainsi elle se trouvait à l’abri d’un retour offensif de son agresseur.
À ce moment, les sons stridents d’une trompe d’automobile se firent entendre, la grille d’entrée grinça sur ses gonds, et bientôt Andrée de Maubreuil voyait avec un immense bonheur ses amis descendre de la voiture qui les avait amenés. La joie lui rendit des forces. Elle rouvrit la porte du vestibule qu’elle venait de fermer et se jeta dans les bras de Frédérique accourue la première.
Mais cette succession d’émotions violentes était au-dessus des forces de la jeune fille. Elle perdit connaissance entre les bras de son amie ; elle fût tombée si Frédérique ne l’avait soutenue en la prenant par la taille pour la déposer doucement sur un sofa.
L’ingénieur Paganot lui fit immédiatement respirer un flacon de lavander-salt dont il avait eu soin de se pourvoir.
Andrée ouvrit les yeux, et son visage pâli s’éclaira d’un faible sourire. Tous attendaient avec impatience qu’elle fût suffisamment remise pour leur donner des explications.
Mais déjà Pistolet et le petit bossu renouaient connaissance, et c’était, de part et d’autre, un concert d’aboiements joyeux et d’exclamations attendries.
– Ce pauvre Pistolet ! Comme il est sale ! Il n’a plus qu’une oreille ! C’est certainement lui qui vient de sauver la vie à Mlle Andrée !
Le brave chien fut tour à tour choyé, caressé et félicité par toutes les personnes présentes.
C’est au milieu de ces scènes émotionnantes que lord Burydan crut entendre un profond soupir derrière une des luxueuses draperies de velours de Venise. Il alla voir d’où partait ce bruit et il ne fut pas peu étonné en trouvant à terre le corps inanimé de mistress Mac Barlott, que, dans le désarroi de tous ces événements, on avait complément oubliée.
L’ingénieur Paganot était là, heureusement. Il n’eut pas de peine à reconnaître que l’Écossaise avait été victime du même mode d’empoisonnement dont avaient failli périr Andrée et Frédérique au Preston-Hotel, par les manœuvres des chevaliers du chloroforme.
Grâce à la pharmacie du cottage qui était parfaitement garnie, il put appliquer à l’infortunée gouvernante une énergique médication ; au bout de deux heures de soins, l’Écossaise ne se ressentait presque plus des stupéfiants effets du chloronal.
Andrée de Maubreuil avait été heureusement beaucoup moins longue à reprendre ses esprits ; de la lutte qu’elle avait soutenue contre le bandit masqué, il ne restait plus d’autres traces que des cernures bleuâtres aux poignets et une large déchirure à la manche de son corsage.
Elle raconta avec détails la façon dont elle avait été victime du guet-apens et comment, grâce à Pistolet, elle avait pu miraculeusement en sortir saine et sauve.
Lord Burydan, qui avait suivi son récit avec une extrême attention, n’eut pas de peine à persuader à ses amis qu’on se trouvait cette fois encore en présence d’un complot des mystérieux bandits de la Main Rouge. L’habileté avec laquelle il avait été combiné montrait combien ils étaient redoutables et bien informés, et l’on décida à l’unanimité de prendre des mesures de précaution encore plus sévères que par le passé, pour éviter toute surprise.
Cette conversation se prolongea très avant dans la nuit. Il était trop tard pour retourner à San Francisco, l’on campa donc au petit bonheur dans les appartements de Golden-Cottage sous la garde de Pistolet, auquel le rôle de sentinelle avait été officiellement départi.
Tout le monde cette nuit-là reposa paisiblement. Seul Oscar ne put fermer l’œil. C’est que, dans la soirée, sur la route du cottage, le petit bossu avait aperçu, allant en sens inverse de la voiture où il était monté, cette automobile rouge et noir qu’il appelait l’automobile fantôme, et dont l’apparition à New York, à Tampton, au Canada avait toujours précédé ou suivi quelque catastrophe.
CHAPITRE VI
Un chien détective
Dans une de leurs dernières réunions, les trois Lords de la Main Rouge, Cornélius, Fritz Kramm et Baruch, avaient décidé que tous les membres de l’expédition organisée contre l’île des pendus seraient impitoyablement anéantis.
Ils ignoraient, il est vrai, que lord Burydan fît construire un yacht pour son propre compte, mais cela n’empêchait pas que le lord excentrique et ses amis ne dussent fatalement tomber sous les coups des sectaires de la Main Rouge.
Aussi, certains d’exterminer leurs ennemis en une seule fois, les trois Lords les avaient laissés, ces derniers temps, parfaitement tranquilles.
– Sur leur yacht, avait déclaré Cornélius, ils seront à notre merci et cela sans que nous ayons à courir aucun risque. Une fois dans les mers du Sud, où va les entraîner la fausse lettre de Bondonnat trouvée dans la bouteille, ils n’auront plus de secours à espérer de personne. L’Océan qui avoisine le cercle antarctique est absolument désert. Là, nous serons les maîtres de l’heure.
Et longuement, méticuleusement, le docteur avait développé un infaillible plan combiné par lui et qui devait amener l’irrémissible perte de lord Burydan et de ses amis.
Baruch, bien qu’avec une arrière-pensée, avait fini par se ranger à l’opinion de ses pairs ; pourtant, et c’était là la raison de son mécontentement secret, il lui déplaisait qu’Andrée de Maubreuil fût condamnée à périr. S’il l’avait osé, il eût pris la défense de la jeune fille comme il l’avait fait une fois déjà à bord du yacht l’Arkansas.
L’amour de Baruch pour Andrée, qui n’avait d’abord été qu’une sorte de caprice, était devenu une véritable passion, passion étrange où il se mêlait autant de haine que d’affection. Il eût voulu avoir à sa discrétion cette orgueilleuse beauté qui, autrefois, ne lui avait montré que du mépris, alors qu’il était préparateur de M. de Maubreuil dans le laboratoire de chimie du Manoir aux Diamants.
Il eût aimé à voir Andrée, vaincue et suppliante, se traîner à ses genoux et implorer sa pitié, et il eût payé très cher ce triomphe de son amour-propre et de sa rancune.
Tenu minutieusement au courant, par ses espions, de ce que faisaient Fred Jorgell et ses amis, il lut le premier le télégramme par lequel Andrée était priée de se rendre directement à San Francisco et ce fut en le lisant que tout un plan germa dans sa tête. Ce fut lui qui, par ses agents, suscita à Fred Jorgell des affaires capables de le retenir à New York, afin que Mlle de Maubreuil partît seule.
Très méfiant cette fois, Baruch ne mit personne dans la confidence de ses projets. Le chauffeur dont il avait eu besoin pour conduire les deux femmes de la gare de Juwilly à Golden-Cottage n’était au courant de rien, et, habitué comme tous les membres de la Main Rouge à une obéissance passive, il ne s’était même pas demandé dans quel but on faisait appel à ses services.
On lui avait ordonné de se procurer une auto verte d’une telle marque et d’un tel nombre de chevaux, c’est-à-dire exactement pareille à l’une de celles de Fred Jorgell, et il avait obéi sans chercher à en savoir plus long.
Comme on l’a vu, Baruch avait failli réussir.
S’il avait eu un peu plus de sang-froid, s’il n’avait pas perdu la tête devant la résistance de Mlle de Maubreuil, si enfin il s’était contenté de la chloroformer comme il l’avait fait pour mistress Mac Barlott, il se fût certainement emparé d’elle.
L’intervention de Pistolet, ce chien maudit qui lui apparaissait jusque dans ses cauchemars et qu’il n’avait jamais pu réussir à tuer, avait achevé de lui faire perdre toute sa présence d’esprit. Il avait couru jusqu’à son auto et s’était enfui sans oser regarder derrière lui.
Ç’avait été, d’ailleurs, une chance, car si lord Burydan et ses amis l’avaient trouvé dans le cottage, aux prises avec Mlle de Maubreuil, ils l’eussent certainement lynché sans autre forme de procès.
Une autre chance pour Baruch ç’avait été de n’être pas étranglé tout net par le chien, lorsque, seul dans la villa, il attendait la venue des deux femmes.
Arrivé à la nuit, il avait franchi la grille d’entrée en se servant d’une fausse clé, puis, trouvant ouverte la porte que les tramps avaient défoncée – et qui avait donné à Pistolet lui-même accès dans l’intérieur du cottage –, il était entré, et, réfléchissant que Mlle de Maubreuil serait peut-être surprise en ne voyant aucune lumière, il avait tourné la clé des commutateurs électriques dans deux ou trois pièces.
Pendant ce temps, Pistolet était parti en maraude vers une ferme lointaine, et ce n’est qu’après avoir substantiellement dîné d’un caneton étranglé par surprise qu’il était revenu vers son cottage juste au moment où Andrée, à bout de force, allait être enlevée par le bandit.
Nul doute que, si Pistolet eût été là quand Baruch avait franchi la grille, il n’eût satisfait sa vieille rancune contre le meurtrier de M. de Maubreuil.
Andrée et ses amis s’étaient, en y réfléchissant, rendu parfaitement compte de l’immense reconnaissance qu’ils devaient au courageux animal. Aussi fut-il accablé de gâteries de toute espèce et tout d’abord on le baigna, on le peigna, on le parfuma ; et il reprit figure de chien civilisé.
Avec sa sagacité habituelle, Pistolet comprit bien vite qu’il n’aurait plus désormais à s’occuper de chasse et de maraude et qu’il avait acquis des droits à l’oisiveté et au bien-être, et il ne témoigna pas la moindre surprise en se voyant apporter des soupes délicieuses et de succulentes carcasses de volailles.
Pistolet, du même coup, avait renoué connaissance avec tous ses anciens amis, depuis le petit bossu jusqu’au Peau-Rouge Kloum, sans oublier lord Burydan qui avait pour lui une estime toute particulière. D’ailleurs Pistolet s’était promptement familiarisé avec miss Isidora, Agénor et l’ingénieur Harry Dorgan.
À Golden-Cottage, on ne le considérait pas comme un simple barbet. Il avait ses grandes et petites entrées dans toutes les pièces et, gravement assis sur son derrière, il assistait à toutes les discussions auxquelles on eût cru qu’il allait prendre part, tant sa mine était pensive et réfléchie.
C’est ainsi qu’un jour il fut question de la latitude et de la longitude de l’île des pendus.
Les mots longitude et latitude éveillèrent sans doute dans l’âme du chien un souvenir précis, car tout à coup, il poussa trois aboiements brefs et, tirant impérieusement le petit bossu par la manche de son veston, il lui fit comprendre, en son langage, qu’il voulait lui montrer quelque chose.
Oscar n’eut garde de ne pas répondre à cette invitation. Il suivit Pistolet qui, après avoir gravi rapidement l’escalier du cottage, le conduisit dans une soupente où le bossu n’avait jamais pénétré.
Là, il y avait une botte de paille de maïs et, à terre, les vingt-quatre lettres de l’alphabet découpées par M. Bondonnat et les débris du sac de cuir où elles avaient été renfermées.
– Je vois, dit joyeusement le bossu, que tu n’as pas oublié mes leçons d’autrefois. Kloum m’a d’ailleurs raconté que M. Bondonnat te les avait continuées. Allons, mon brave Pistolet, montre-nous un peu tes talents.
Et, tout en parlant, il caressait doucement la fourrure bouclée de son fidèle camarade.
Pistolet ne se fit pas prier.
Après avoir derechef poussé trois aboiements brefs, il étendit les pattes et, avec une rapidité due à de longs et patients exercices, il composa le mot longitude.
Oscar demeura muet de surprise et, retenant son souffle, il suivit avec attention les moindres mouvements du chien, se demandant anxieusement ce que signifiait le choix d’un pareil mot.
Pistolet qui, on le sait, était admirablement entraîné ne mit qu’un instant à composer la phrase suivante :
LONGITUDE NORD, QUARANTE-SEPT
– Qu’est-ce que cela signifie ? s’écria Oscar bouleversé, ce n’est pas là le chiffre que nous avons trouvé dans la bouteille, il y a là-dessous quelque mystère.
Et caressant de nouveau Pistolet, il ajouta :
– Continue, mon vieux, la latitude maintenant ?
Imperturbablement, le chien composa :
LATITUDE OUEST, CENT SOIXANTE ET UN
– Ça, par exemple, s’écria le bossu stupéfié, c’est renversant !
Il nota promptement les deux chiffres sur un carnet et dégringolant quatre à quatre l’escalier, il se précipita dans le salon pour faire part de l’étonnante découverte qu’il venait de faire.
– Je me souviens parfaitement, dit Kloum, que M. Bondonnat avait appris à Pistolet ces mots de longitude et de latitude. Il avait essayé de m’expliquer ce que c’était, mais voyant que je ne comprenais rien, il ne m’en avait plus parlé.
L’instant d’après, tout le monde envahissait le galetas de Pistolet qui, devant cette nombreuse assistance, recommença ses exercices.
Quand la même lettre se rencontrait deux fois dans un mot, il la reprenait après l’avoir placée en laissant un vide à la syllabe du commencement. Ce détail excita l’admiration de tout le monde car, de cette façon, l’érudit animal n’avait besoin que d’un seul alphabet pour composer une infinité de mots.
Cependant, les paroles de Kloum avaient été pour lord Burydan un trait de lumière.
– By God ! s’écria-t-il, nous sommes tous des crétins stupides ! des huîtres ! des imbéciles ! des idiots !
– Pourquoi donc, milord ? demanda le bossu avec surprise.
– Je dis que nous sommes tous des ânes bâtés et que les bandits de la Main Rouge sont cent fois plus intelligents que nous !
– Comment cela ?
– Vous ne comprenez donc pas que la bouteille soi-disant trouvée dans la mer que nous a apportée cette espèce de pirate était une frime, une fausse indication destinée à nous entraîner dans les glaces du pôle Sud ! Je suis persuadé que la lettre de M. Bondonnat est fausse ; je la regarderai à la loupe tantôt, et Mlle Frédérique me prêtera une des anciennes lettres de son père pour que je puise confronter les écritures.
– Nous allons examiner cela à l’instant même, s’écria la jeune fille.
Une minute après elle revenait avec la lettre trouvée dans la bouteille et une ancienne lettre du savant.
Il suffit à lord Burydan d’un rapide examen à la loupe pour se convaincre que le document vendu deux cents dollars par le capitaine Christian Knox était l’œuvre d’un habile faussaire.
– Sans Pistolet, grommela l’excentrique, nous étions dans de beaux draps.
L’assistance entière était plongée dans la stupéfaction la plus profonde, mais tous furent obligés de reconnaître, après un instant de réflexion, que lord Burydan était dans le vrai et que l’indication donnée par Pistolet était bien la seule exacte.
Fred Jorgell, Harry Dorgan et les deux Français, qui revinrent de San Francisco le soir, furent entièrement de cet avis.
C’est seulement dans le voisinage du cercle arctique qu’il fallait chercher Prosper Bondonnat, et non ailleurs. Mais, pour parer à de nouvelles machinations des bandits de la Main Rouge, il fut décidé que le secret serait jalousement gardé sur la découverte qu’on venait de faire.
Le départ des deux yachts fut irrévocablement fixé au vendredi 13 janvier.
DIXIÈME ÉPISODE
Le portrait de Lucrèce Borgia
CHAPITRE PREMIER
Balthazar Buxton, collectionneur
Fritz Kramm, le richissime marchand de tableaux, achevait de déjeuner paisiblement en compagnie de son frère, le docteur Cornélius, si célèbre à New York sous le nom de sculpteur de chair humaine, lorsqu’un domestique lui remit un télégramme ; il le décacheta et se mit à sourire.
– Devine qui est-ce qui m’écrit ? dit-il au docteur.
– Ma foi, je ne sais pas !
– C’est Balthazar Buxton.
– Le maniaque, l’amateur de tableaux, l’homme au labyrinthe ?
– Lui ; même. Il y a plus d’un an que je n’avais eu de ses nouvelles. Je le croyais brouillé avec moi.
– Pourquoi donc ?
– Il prétendait que je lui avais fait payer trop cher un vase d’argent attribué à Benvenuto Cellini, mais dont l’authenticité est loin d’être prouvée.
– On dit qu’il est très riche ? fit tout à coup Cornélius Kramm.
– Excessivement riche, répliqua Fritz, qui avait pénétré la pensée de son frère, mais c’est un homme d’une grande prudence et son argent est à l’abri de toute espèce de coup de main.
– Tant pis ! Te dit-il pourquoi il désire te voir ?
– Non, mais c’est facile à deviner. Il veut sans doute que je lui procure quelque tableau qui manque à sa collection. Comme tu le sais, cet original n’a pas d’autre passion que les œuvres d’art et surtout les tableaux. Il possède des pièces de toute beauté et que pourraient envier le Louvre de Paris, la National Gallery de Londres et les Uffizi de Florence. D’ailleurs, il est aussi jaloux de ses toiles qu’un sultan asiatique le peut être des odalisques de son harem. Ceux qui peuvent se vanter d’avoir visité sa galerie sont rares.
– Et sans doute que tu es de ce nombre ?
– Oui, et j’avoue que la collection de Mr. Buxton est digne d’un prince.
Cette conversation se prolongea encore quelque temps, puis le docteur Cornélius, se rappelant que deux malades l’attendaient à son laboratoire, se hâta de prendre congé et, peu de temps après, Fritz Kramm montait en auto et se faisait conduire chez le vieil amateur.
Balthazar Buxton habitait dans William street – une des rares voies de New York qui ne soit pas désignée par un numéro – un vaste et magnifique hôtel entouré de jardins. Il n’avait jamais voulu se défaire de cette propriété ni faire édifier sur son emplacement une maison de rapport, bien qu’en cette partie de la ville le terrain eût acquis une valeur de plus de deux mille dollars par mètre carré. On racontait sur cette habitation les histoires les plus extravagantes ; et ceux à qui il avait été donné de la visiter disaient que la vérité laissait bien loin derrière elle les plus chimériques suppositions.
Lorsque Fritz Kramm fut descendu de voiture, il alla sonner à une grande porte cochère qui s’ouvrait à la base d’une haute muraille surmontée de lances aiguës. Au bruit de la sonnette, un judas grillé s’entrouvrit et le concierge demanda au visiteur d’une voie bourrue qui il était et ce qu’il désirait.
Après avoir parlementé pendant quelque temps avec ce gardien plein de défiance, et lui avoir montré le télégramme de Balthazar Buxton, Fritz Kramm fut enfin introduit de l’autre côté de la porte, qui était munie de plus de serrures et de verrous qu’une porte de prison.
– On va vous conduire, dit le concierge à Fritz, mais je vous recommande de ne vous écarter ni à droite ni à gauche, de ne pas faire un pas sans qu’on vous y ait autorisé, autrement vous vous exposeriez à un réel danger.
L’antiquaire ne répondit rien et ne manifesta nulle surprise de ce bizarre avertissement. Il avait déjà eu l’occasion de rendre visite à Mr. Buxton et il savait de quelles précautions s’entourait le vieillard, dont l’hôtel était machiné comme la scène d’un théâtre de féeries.
Le concierge fit retentir un coup de sifflet strident. À ce signal, un personnage silencieux, grave et entièrement vêtu de noir, apparut au tournant du chemin de ronde qui faisait intérieurement le tour de la muraille d’enceinte.
– Voici votre guide, dit le gardien.
Le nouveau venu s’inclina avec une politesse glaciale et fit signe au visiteur de le suivre. Fritz s’aperçut alors que son conducteur portait par-dessous ses vêtements une sorte de cotte de mailles qui donnait à tous ses gestes une raideur presque automatique.
Au bout d’une dizaine de pas, le chemin était barré par une énorme grille. L’antiquaire allait machinalement toucher à l’un des barreaux, mais son guide l’en empêcha d’un geste.
– Si votre doigt avait seulement effleuré cette grille, que traverse un courant de plusieurs milliers de volts, vous étiez mort ! Vous receviez une décharge capable de foudroyer un bœuf !
– Diable ! murmura Fritz en se reculant, mais il me semble que cette grille n’existait pas l’année dernière.
– Non. Il n’y a guère plus de trois mois qu’elle est posée. Mais depuis qu’il a été victime d’une tentative de vol, Mr. Buxton a perfectionné tous ses moyens de défense.
Tout en parlant, le guide avait pris une clef minuscule dans sa poche et l’avait introduite dans une serrure encastrée dans la muraille à une certaine distance de la grille. La clé tourna, déclenchant le ressort d’un mécanisme compliqué, et aussitôt la grille s’enleva en l’air à la façon de la herse d’un château fort gothique, en glissant dans deux rainures de fer.
Fritz et son guide se hâtèrent de passer. Instantanément, la grille descendit et reprit sa place.
Vingt pas plus loin, il y avait une autre grille, qui fut franchie avec le même cérémonial ; puis le guide ouvrit une petite porte de fer, juste assez large pour livrer passage à une seule personne, et les deux hommes se trouvèrent dans la cage d’un ascenseur, ou, comme on dit à New York, d’un « élévateur », qui au bout de quelques minutes les déposa au seuil d’une vaste salle de style assyrien. Le plafond en était très élevé et les poutres apparentes, peintes et dorées, étaient soutenues par de grosses colonnes aux chapiteaux formés par des bœufs ailés d’une dimension colossale.
Les prunelles de ces animaux renfermaient des lampes électriques qui jetaient une fantastique lumière rouge et vert dans cette salle où on ne voyait ni porte ni fenêtres.
Fritz ne put même découvrir ce qu’était devenu l’ascenseur.
Le sol de la salle était uniformément recouvert dans toute son étendue d’une riche mosaïque de marbre.
Après avoir marché pendant quelque temps dans ce vestibule d’un aspect grandiose, l’homme qui conduisait M. Kramm fit halte devant une des colonnes, il appuya sur la fleur dorée d’un des lotus qui en ornaient les cannelures, et aussitôt la colonne pivota sur elle-même, découvrant l’entrée d’un étroit escalier de fer où les deux hommes s’engagèrent ; à mesure qu’ils descendaient, la colonne reprenait lentement et automatiquement sa place.
L’escalier aboutissait à un long couloir, à l’extrémité duquel il y avait un autre ascenseur. Fritz et son compagnon s’y installèrent et, après avoir descendu pendant quelques minutes, ils se trouvèrent dans une salle assyrienne, si absolument pareille à celle qu’ils venaient de quitter qu’il eût été impossible de les distinguer.
Pendant trois quarts d’heure, les deux hommes continuèrent à franchir des passages secrets, à monter et à descendre, tantôt par des escaliers, tantôt par des ascenseurs, et traversèrent une quantité de salles toutes richement décorées, mais désertes et privées de fenêtres.
Il eût été difficile à Fritz Kramm de dire s’il se trouvait dans un souterrain ou au dixième étage du vaste palais, dont les pièces, enchevêtrées de couloirs, d’escaliers et de galeries tortueuses, formaient le plus compliqué des labyrinthes.
Enfin, l’antiquaire et son conducteur débouchèrent dans un spacieux corridor circulaire, où quatre hommes montaient la garde. Ils étaient armés jusqu’aux dents, la carabine en bandoulière, le sabre au côté, et les revolvers à la ceinture.
Le guide, alors, frappa d’une façon convenue à un petit guichet de fer où apparut une seconde une face étique et jaunâtre ; l’instant d’après, une porte à coulisse glissait dans ses rainures et, sans autre formalité, Fritz Kramm était introduit dans le hall où se tenait habituellement l’honorable Balthazar Buxton.
Ce hall était une vaste pièce de forme ronde, terminée par une coupole de cristal qui laissait arriver à tous les objets une vive et éclatante lumière. Des rideaux de velours pourpre, maintenus par de gros cordages de soie et d’or, permettaient de ménager à volonté l’ombre et la lumière dans cette somptueuse pièce.
Quand on y était parvenu, on s’expliquait presque les précautions qu’avait prises son propriétaire contre les malfaiteurs et contre les intrus.
L’immense salle renfermait un amoncellement de chefs-d’œuvre qui avaient dû coûter des millions.
Au centre, la statue de la Vengeance de Michel-Ange, que l’on avait crue perdue et qui avait été retrouvée dans un château de Moravie, tordait vers le ciel, dans une attitude douloureuse, ses mamelles de bronze noir ; puis, sur toutes les parois, dans de larges cadres d’or aux riches sculptures, c’étaient des chefs-d’œuvre de toutes les écoles : une jeune fille, de Raphaël, un Enfer, de Fra Angelico, des Commères, de Rubens, une Sorcière, de Goya, un Paysage, de Poussin, etc.
Les modernes n’avaient pas été oubliés. Il y avait des Rude, des Falguière, des Rodin, des Aristide Rousaud, la fleur de la sculpture contemporaine. Et parmi les peintres : des Besnard, des Henner, des Claude Monet, des Degas, des Crébassa, etc.
Le mobilier était digne des chefs-d’œuvre qui l’entouraient : d’admirables crédences gothiques, des bahuts italiens du XVIe siècle, aux curieuses incrustations, des fauteuils espagnols en ébène et cuir de Cordoue, des tables de Boulle et de Riesener supportant d’uniques pièces de porcelaine de Saxe et de Sèvres, des orfèvreries curieuses, tout un monde de bibelots rares et précieux. Cette pièce bondée de trésors de tout genre eût été digne d’un pape de la Renaissance.
Le propriétaire de toutes ces merveilles paraissait avoir au moins quatre-vingt-dix ans. Il était si sec, si ratatiné, si maigre, que l’on eût presque dit une momie momentanément rendue à l’existence par quelque artifice de la science ; son visage squelettique, complètement rasé, était effrayant à voir. La peau jaunâtre était presque collée sur les os, le sourire était funèbre, découvrant une dentition étayée de plaques d’or, qui suggéraient invinciblement l’inquiétante impression que ce singulier vieillard n’était peut-être qu’un automate habilement fabriqué.
Le nez était mince et presque diaphane. Seuls les yeux, couleur d’or, avaient un éclat et une jeunesse extraordinaires. On aurait dit que toute la vitalité s’était réfugiée dans ses larges prunelles qui scintillaient dans la pénombre, comme celles de certains chats.
La maigre carcasse du vieillard était drapée dans une robe de chambre de velours noir, et une toque également en velours abritait le crâne chauve et donnait à Balthazar Buxton l’aspect de quelque doge de Venise ou de quelque médecin, comme on en voit dans les tableaux de Rembrandt ou de Gérard Dow.
Cet étrange nonagénaire s’était levé pour aller au-devant de son visiteur en lui tendant une main petite et sèche comme la serre d’un oiseau de proie.
– Comment allez-vous, monsieur Fritz ? demanda-t-il d’une voix chevrotante. Il y a bien longtemps que je n’avais eu le plaisir de vous voir !
– Cela va bien, et je vois avec joie que votre santé est, aussi, excellente, mais si vous ne me voyez pas plus souvent, convenez que c’est un peu de votre faute. Il y a plus d’un an que vous ne m’aviez fait demander.
– C’est de ma part, certainement, de la négligence, mais que voulez-vous, quand je suis enfermé avec mes chefs-d’œuvre, j’oublie tout l’univers et le temps passe pour moi avec une rapidité surprenante.
– Vous ne vous ennuyez pas ?
– Jamais !
Fritz Kramm poussa tout à coup un cri de surprise. Grâce au reflet d’une glace de Venise, il venait d’apercevoir une jeune femme d’une beauté extraordinaire qu’il n’avait pas vue en entrant, car il lui tournait le dos. Cette jeune femme, décolletée jusqu’à la pointe brune de ses seins, parée de riches colliers de perles, était assise dans un grand fauteuil aux bras d’ivoire où elle gardait une immobilité de statue.
Lorsque l’antiquaire fut un peu revenu de sa surprise, il ne put s’empêcher de dire :
– Je comprends, monsieur Buxton, qu’en si charmante compagnie vous n’ayez pas une minute d’ennui.
– N’est-ce pas, dit le vieillard avec un rire macabre, je vous présente la signora Lorenza, qui a bien voulu mettre aujourd’hui son merveilleux pouvoir à ma disposition.
La jeune femme s’était levée, avait salué de la tête et souri, puis s’était rassise silencieusement.
– Quel pouvoir ? demanda Fritz en regardant la signora Lorenza avec émerveillement.
– Il n’est pas permis, reprit Balthazar Buxton, à un homme tel que vous, monsieur Kramm, d’ignorer la personnalité de la signora Lorenza, la célèbre « guérisseuse de perles », que tout dernièrement encore l’empereur de Russie et la reine d’Angleterre firent venir à leur Cour pour faire appel à sa mystérieuse puissance.
– J’avoue mon ignorance, murmura Fritz.
– Vous savez, poursuivit le vieil amateur, que pour conserver son éclat, la perle doit être portée par une personne vivante et, de préférence, par une femme, autrement elle se décolore, elle perd de son orient, elle meurt ; ce n’est plus qu’un morceau de nacre opaque.
– Je savais cela. Alors, je le devine, la signora Lorenza a le pouvoir de ressusciter les perles mortes.
– Oui, en les portant sur elles, sur sa chair même, pendant quelque temps.
Fritz regarda la jeune femme qui demeurait aussi indifférente, aussi impassible que si elle n’eût pas servi de thème à la conversation.
– À quoi donc attribuez-vous ce merveilleux pouvoir ?
– C’est que, reprit le vieillard de sa voix aigre et comme fêlée, la signora Lorenza est plus femme que les autres femmes. Il s’exhale de son corps une électricité vivante qui crée autour d’elle une atmosphère spéciale. Ses nerfs sont d’une impressionnabilité dont rien ne peut donner l’idée. Le goût, le toucher, l’odorat, tous les sens atteignent chez elle un degré de perfection qu’on ne rencontre chez aucune femme.
Fritz Kramm écoutait avec stupeur, se demandant, à part lui, si le vieux Balthazar n’était pas tout à coup devenu fou ; cependant il se souvenait maintenant parfaitement d’avoir lu dans les journaux que lady Dudley, qui possède la plus belle collection de perles qui soit au monde – plus belle que celle de feue la reine Victoria –, avait été forcée de faire venir la guérisseuse de perles pour ressusciter quelques-unes de celles qu’elle possédait et, qui, bien qu’enfermées, comme le conseillent certains joailliers, dans des coffrets de racine de frêne, avaient perdu de leur éclat.
– La signora Lorenza, reprit Balthazar Buxton avec enthousiasme, est née à Florence. Il n’y a, d’ailleurs, que dans ce pays que l’on rencontre ces tempéraments féminins si exquisément organisés. Elle exerce sur toute la création ce pouvoir dominateur que dut posséder Ève, la première femme. Son haleine est embaumée d’une odeur de violette et la moiteur même de sa peau exhale un délicieux parfum d’iris et d’amandes fraîches. Il rayonne de son être de si puissants effluves que tous les animaux mâles viennent frôler sa robe, caressants et domptés. Des lions se sont couchés à ses pieds et les oiseaux mâles eux-mêmes viennent se percher sur son épaule et becqueter ses cheveux. Il n’est pas jusqu’aux végétaux qui ne subissent ce mystérieux pouvoir : les sensitives en sa présence éploient plus largement leurs rameaux nerveux et entrouvrent tout grands leurs pétales. Enfin, les perles reprennent toute leur splendeur dès qu’elles sont en contact avec sa chair[4].
Malgré son prosaïsme et ses brutaux et cupides instincts, Fritz Kramm, lui aussi, commençait à subir le charme prestigieux de la belle Lorenza. Ses regards ne pouvaient se détacher de ce beau visage, dont le pur ovale était encadré par une lourde chevelure noire comme la nuit, de ce noir qui a les métalliques reflets de l’aile du corbeau.
La signora Lorenza était grande et svelte et sa physionomie exprimait la douceur, la bonté, unies à une fierté tranquille. Son teint était d’une blancheur éblouissante, ses lèvres, d’un arc parfait, n’avaient point cette épaisseur qui indique les penchants de la gourmandise et de la luxure, et ses grands yeux bleus, qu’ombrageaient de longs cils d’une ténuité idéale, étaient d’un bleu limpide qui faisait un étrange et délicieux contraste avec la sombre chevelure.
Il y eut quelques moments de silence. Lorenza, gênée par les regards de Fritz, avait baissé les yeux et ses joues s’étaient colorées d’une roseur imperceptible ; quant à Balthazar Buxton, il jouissait de la surprise et de l’admiration de son hôte.
– Mais, enfin, demanda Fritz, y aurait-il de l’indiscrétion à vous demander pourquoi la signora se trouve chez vous ?
– Nullement, répondit le petit vieillard en frottant nerveusement ses mains sèches qui craquèrent comme si les os en eussent été montés sur fils de fer à la façon de certaines pièces anatomiques. La signora Lorenza se trouve ici parce que je me plais à la voir au milieu de mes œuvres d’art. N’est-elle pas elle-même un vivant chef-d’œuvre ?
– Le plus beau de tous ! s’écria Fritz.
– Puis, en sa présence, je ne sens plus les glaces de l’âge. Il me semble qu’il rayonne d’elle une puissance rajeunissante ! Tant qu’elle est devant mes yeux, je suis heureux !
Balthazar regardait la jeune femme avec une admiration éperdue.
Lorenza ne put s’empêcher de sourire.
– Voilà, dit-elle, des compliments bien exagérés.
Sa voix, en prononçant ces quelques mots, avait des vibrances cristallines d’une si pénétrante douceur que Fritz sentit son cœur battre plus vite et comprit l’exactitude des expressions « une voix de sirène, une voix d’or ».
– Je suis seulement venue ici, continua-t-elle, pour soigner quelques beaux colliers de perles qui étaient gravement malades, car, vous le savez, la perle est un être vivant. Ce n’est pas une personne, a dit Michelet, mais ce n’est pas une chose. Il y a là une destinée. La perle aime, de sa petite âme de pierre précieuse, celle qui la porte sur son sein.
– J’avais toujours, murmura Fritz, considéré cette mystérieuse vitalité qu’on prête aux perles comme une poétique légende, faite surtout pour charmer l’imagination des dames.
Balthazar Buxton se récria :
– Rien n’est plus exact, fit-il, plus scientifique que la vie des perles. C’est tellement vrai qu’il y a quelques jours ce beau collier que porte en ce moment la signora Lorenza n’était plus qu’un assemblage de morceaux de nacre ternes, grisâtres et sans aucun reflet.
– Il y a mieux, dit la jeune femme. Les perles ont leurs préférences. Les bleues se plaisent sur la poitrine des rousses et des blondes, les noires aussi, et les perles orangées et jaunes brillent mieux autour du cou des femmes brunes.
– Voilà, répliqua Fritz, une théorie curieuse et charmante que je ne connaissais nullement. Je suis sûr qu’elle intéresserait fort mon docte frère Cornélius.
– Vous pourrez la lui exposer.
– Mais j’y pense, s’écria tout à coup l’antiquaire, j’ai dans mes coffrets un grand nombre de perles absolument mortes dont quelques-unes viennent de ce fameux temple de Taloméco, bâti par le roi Montezuma et qu’on pouvait dire construit tout à fait de perles, car de longues guirlandes de ces pierres précieuses pendaient de la voûte de l’édifice jusqu’à terre, ou formaient des arabesques le long des murs. La signora pourrait essayer sur elles son merveilleux pouvoir.
– Je ne demande pas mieux, répondit Lorenza, mais vous savez que je prends très cher, car la résurrection d’un collier ou d’un bracelet m’inflige parfois de grandes fatigues. C’est chaque fois un peu de mon fluide vital, à moi, qu’il faut que je leur cède.
– M. Fritz Kramm est en état de vous récompenser dignement, fit Balthazar.
– Certes, la question de prix n’offre à mes yeux qu’une importance secondaire.
– Alors, c’est entendu, dit Lorenza, nous prendrons rendez-vous pour la semaine prochaine.
Balthazar frappa sur un vaste gong chinois qui se trouvait à portée de sa main. Un serviteur apparut, sortant de la trappe d’un ascenseur placé au centre de la pièce et si habilement dissimulé que l’on n’eût pu tout d’abord en soupçonner l’existence.
– John, ordonna le vieillard, apporte quelques rafraîchissements à mes hôtes. J’ai de délicieux vins d’ananas que la signora apprécie tout particulièrement. J’ai aussi d’antiques liqueurs créoles telles que le Kombaya, le Vangassaye et le Jamrosa, et de ce délicieux Pulqué mexicain que l’on obtient par la distillation des racines de yucca.
Lorenza et Fritz ne purent s’empêcher de sourire.
– Je m’aperçois, dit la jeune femme, que Mr. Buxton collectionne aussi les liqueurs précieuses et rares.
– Oui, avoua le vieillard, c’est, j’en conviens, une de mes faiblesses ; quand quelque chose est peu connu ou difficile à trouver, il faut absolument que je me le procure.
Le serviteur était déjà de retour avec un plateau de vermeil que surchargeaient des flacons curieux, de beaux fruits, d’appétissantes sucreries, sans oublier un seau de glace et un compotier plein de ces confitures introuvables que les Canaques fabriquent avec certaines baies des forêts vierges.
Lorenza et Fritz Kramm firent honneur à ce goûter délicat et Balthazar lui-même trempa ses lèvres dans une coupe d’aventurine remplie de Vangassaye, la meilleure et la plus rare des liqueurs créoles.
– Le temps passe vite en votre compagnie, dit tout à coup l’antiquaire, mais vous ne m’avez pas encore appris ce que vous attendez de moi.
– Tout à l’heure, dit le vieil amateur, nous avons bien le temps, que diable !
– Messieurs, interrompit Lorenza en jetant un coup d’œil sur une petite montre insérée dans le bracelet de perles qu’elle portait à la main droite, il est l’heure que je me retire.
– Ce n’est pas au moins, répliqua Fritz, ma présence qui vous chasse ?
– Nullement, croyez-le. Mais je suis attendue. Vous recevrez d’ailleurs ma visite, comme il est convenu, la semaine prochaine.
– Quel jour, signora ?
– Vendredi, si vous le voulez bien.
La jeune femme assujettit sur sa tête un vaste chapeau orné d’une précieuse touffe de plumes d’aigrette, revêtit, avec l’aide de Fritz, un grand manteau de soie beige et prit congé.
Mais, arrivée devant la porte à coulisse qui aboutissait à la galerie circulaire, elle dut attendre un instant que Balthazar eût passé lui-même par un guichet, à l’un des hommes de garde, un jeton de cuivre qui était le laissez-passer, le Sésame, sans lequel il eût été impossible de sortir du labyrinthe.
Restés seuls, l’antiquaire et l’amateur se regardèrent quelque temps en silence.
– Que pensez-vous de Lorenza ? questionna Balthazar.
– Elle est admirable !
– Oui, murmura le nonagénaire en levant vers la voûte ses yeux couleur d’or, elle est ensorcelante. On dirait qu’autour d’elle il règne une atmosphère de bonheur et de force !
– Mais, demanda Fritz de nouveau, quelle est donc l’affaire au sujet de laquelle vous m’avez fait demander ?
– Voilà, répondit Balthazar. Il y a un tableau que je veux avoir à tout prix. C’est le portrait de Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, par le Titien.
– Impossible ! dit nettement l’antiquaire.
– Pourquoi cela ?
– Le portrait de Lucrèce Borgia, comme vous le savez sans doute, se trouve à Venise. Il est estimé à plus de deux millions et il est la propriété du gouvernement italien qui ne s’en dessaisira à aucun prix.
Balthazar Buxton eut un petit ricanement.
– Votre érudition est ici en défaut, mon cher maître, gouailla-t-il, le portrait qui se trouve à Venise n’est qu’une réplique, une copie de la main même du Titien. L’original a été enlevé pendant que Venise était sous la domination de l’Autriche et il est devenu la propriété d’un diplomate hongrois, le baron Czarda, qui, lui-même, l’a cédé il y a quatre ans pour une somme énorme au milliardaire William Dorgan.
– Je connais William Dorgan. Je possède même dans son trust des intérêts importants et je puis vous assurer qu’il ne consentira jamais à se défaire de sa Lucrèce Borgia. Il n’a qu’un petit nombre de tableaux, mais ils sont de premier ordre et il y tient beaucoup.
Balthazar eut un geste d’impatience qui fit craquer les os de ses mains décharnées.
– Il me faut ce portrait ! murmura-t-il d’une voix tremblante d’émotion. Je l’ai vu une fois et jamais il n’est sorti de mon souvenir ! C’est le chef-d’œuvre du Titien ! Ah ! si vous voyiez ces belles chairs nacrées qui se perdent dans l’ombre rousse des cheveux, ce sourire voluptueux et mystérieux à la fois, et ces prunelles pleines de rêve ! Jamais on n’a rien fait de plus beau !…
– Malheureusement, c’est impossible ! répliqua Fritz d’un ton sec et tranchant, je ne puis vous faire une promesse qu’il me serait impossible de tenir !
– Je suis assez riche pour en offrir un million de dollars, dit simplement Balthazar Buxton.
Fritz Kramm ne put s’empêcher de tressaillir.
– Un million de dollars, balbutia-t-il, eh bien, j’essayerai ! Je ferai l’impossible ! Je tâcherai de persuader William Dorgan.
– Alors j’y compte ? s’écria le vieillard en grimaçant un sourire.
– Je ne puis m’engager à rien. Tout ce que je vous promets, c’est de faire mes efforts pour acheter en votre nom la précieuse toile.
– Eh bien, c’est cela. Je suis sûr que vous réussirez ! Et quant au chiffre de la commission, vous le fixerez vous-même.
– Entendons-nous, reprit Fritz qui avait reconquis tout son sang-froid, c’est à moi que vous achèterez, en cas de succès, bien entendu, le portrait de Lucrèce Borgia. Vous n’aurez pas affaire à William Dorgan mais à moi seul !
– Eh bien, soit ! faites comme vous l’entendez. Tant mieux pour vous si vous ne payez à William Dorgan la Lucrèce que la moitié du prix que je vous en offre !
– C’est bien ainsi que je le comprends !
Un quart d’heure plus tard, Fritz se retirait, non sans avoir vu Balthazar passer par le guichet le jeton de cuivre qui tenait lieu d’exeat pour sortir du mystérieux palais.
CHAPITRE II
Le chèque
Mr. Steffel, directeur de la police de New York, se trouvait dans son cabinet, fort occupé à parcourir un rapport que venait de déposer sur son bureau le sergent Grogmann, celui-là même qui avait été chargé d’opérer l’arrestation des évadés du Lunatic-Asylum à la buvette du Grand Wigwam.
– Ce Grogmann est vraiment stupide, grommelait-il entre ses dents, il croit tout ce qu’on lui raconte ! Si je n’avais que de pareils agents pour opérer la destruction de l’association de la Main Rouge, je crois que je serais longtemps avant d’y arriver…
À ce moment, le garçon de bureau remit à Mr. Steffel une carte de visite :
« Lord Astor BURYDAN
« Présente ses respects à Mr. Steffel et serait heureux d’avoir avec lui quelques instants d’entretien au sujet des bandits de la Main Rouge. »
Le directeur de la police remit brusquement en place dans un cartonnier le rapport de Grogmann qui lui apparaissait maintenant dénué de toute espèce d’intérêt.
– Lord Burydan, dit-il au garçon de bureau ébahi, faites entrer immédiatement !
Et il ajouta en aparté :
– Lord Burydan, mais c’est cet Anglais excentrique qui a donné tant de fil à retordre à mes agents et contre lequel j’ai dû cesser toutes poursuites par ordre supérieur. Il doit avoir des choses intéressantes à me raconter.
La minute d’après, lord Burydan entrait dans le cabinet du policier, accompagné du poète Agénor, dont il ne se séparait guère depuis qu’après tant de périlleuses aventures il avait eu la satisfaction de le retrouver. Mr. Steffel accueillit courtoisement ses visiteurs, leur indiqua des sièges et attendit qu’ils prissent la parole pour les communications qu’ils avaient à lui faire.
– Je ne suis pas un inconnu pour vous, mon cher monsieur Steffel, dit malicieusement lord Burydan.
– Mais non, répondit le policier en souriant. J’ai même sur vous un dossier passablement volumineux. C’est vous qui, entre autres facéties, jetez les chauffeurs en pâture aux crocodiles ; c’est vous qui mettez en révolution les asiles d’aliénés où l’on vous enferme…
– Et le plus drôle, répliqua lord Burydan sans s’émouvoir, c’est qu’en me livrant à toutes ces démonstrations plus ou moins joviales j’étais absolument dans mon droit.
– Il faut bien le croire, puisque j’ai reçu l’ordre formel de ne plus vous inquiéter ; mais je vous avoue qu’il est resté, dans toute cette histoire, bien des points obscurs pour moi.
Et Mr. Steffel arrêtait sur l’Anglais ce regard spécial aux gens de police qui sont toujours prêts à voir des criminels dans tous ceux avec lesquels ils se trouvent en rapport.
– Cela tombe à merveille, répliqua l’excentrique avec un imperturbable sourire. Je ne suis précisément venu vous trouver que pour élucider avec vous ces points obscurs auxquels vous faites allusion.
Et lord Burydan raconta dans le plus grand détail, en reprenant les faits à partir du naufrage de la Ville de Frisco, sa captivité à l’île des pendus, son évasion, sa captivité au Lunatic-Asylum, enfin de quelle manière audacieuse il était parvenu à rentrer en possession de ses biens, et il termina son récit en narrant à Mr. Steffel comment il avait pu découvrir la latitude et la longitude de l’île qui servait de repaire aux bandits de la Main Rouge.
Mr. Steffel avait écouté son interlocuteur sans l’interrompre ; seulement, d’un geste rapide, il avait furtivement noté les chiffres exacts de la longitude et de la latitude.
– Je vous remercie beaucoup, milord, dit-il ; les renseignements que vous me donnez là sont précieux, et je compte bien en tirer tout le parti possible pour arriver à l’arrestation des chefs de la bande.
– J’ai regardé comme un devoir de vous faire cette communication. Je ne me trouve à New York que pour quelques heures encore et j’en ai profité pour venir vous voir avant de partir en expédition.
– Vous avez fort bien fait. Et si je puis vous être utile de quelque façon…
– Il n’y en aurait qu’une, ce serait de faire en sorte que le gouvernement de l’Union mît à notre disposition un navire de guerre pour nous aider à faire une descente dans l’île des pendus.
Le policier prit un air grave.
– Milord, répondit-il, je vous promets de faire tout ce que je pourrai pour obtenir l’envoi d’un cuirassé. Je vais, dès aujourd’hui même, demander une audience au directeur de la marine, en lui faisant part de vos révélations qui changent complètement la face de l’affaire.
L’entretien se prolongea pendant plus d’une heure, et ce ne fut qu’après avoir répondu à une foule de questions que lui posa Mr. Steffel que lord Burydan se retira, respectueusement reconduit par ce dernier jusqu’à l’auto qui l’avait amené.
Une fois rentré dans son cabinet, le policier réfléchit un instant, puis, tout à coup, il sonna le garçon de bureau.
– Faites en sorte, lui dit-il, de me procurer le plus tôt possible l’atlas de l’état-major, édité par les soins du département de la guerre.
– C’est que, repartit le garçon avec embarras, cet atlas est volumineux ; comme vous le savez, il renferme un grand nombre de feuilles et il constitue presque à lui seul une vraie bibliothèque.
– C’est juste, mais je n’ai besoin pour l’instant que de la carte du Klondike et des îles voisines.
– Bien, monsieur le directeur.
Une demi-heure après, le garçon de bureau était de retour avec l’atlas demandé. S’armant d’un crayon, Mr. Steffel repéra soigneusement sur la carte la latitude et la longitude que lui avait indiquées lord Burydan et il trouva sans peine l’île Saint-Frédérik, appartenant aux États-Unis. Évidemment, c’était bien cette île Saint-Frédérik qui était l’île des pendus, la capitale secrète des bandits de la Main Rouge.
Un dictionnaire de géographie fournit au policier quelques renseignements complémentaires :
« L’île Saint-Frédérik est située un peu au sud des îles Aléoutiennes, à cent kilomètres environ de l’île Sakhaline. Elle fut découverte au XVIIIe siècle par des navigateurs allemands qui l’appelèrent l’île Saint-Frédérik. Depuis, comme elle ne se trouve sur le passage d’aucun navire, elle a été complètement oubliée non seulement par les marins, mais encore par la plupart des géographes.
« À un moment donné, elle fut l’objet d’un échange de notes diplomatiques entre la Russie et le gouvernement des États-Unis, mais ce territoire glacé paraissait à tout le monde si peu intéressant que la question ne fut définitivement tranchée qu’en 1901. À cette époque, elle fut officiellement adjugée à l’Amérique qui, depuis, l’a concédée à un riche particulier. »
Mr. Steffel eut un malicieux sourire.
– Hum ! fit-il, je crois que, quand je connaîtrai le nom du « riche particulier » en question, j’aurai fait un sérieux pas en avant dans la connaissance des secrets de la Main Rouge.
Mr. Steffel avait saisi le récepteur de l’appareil téléphonique, il demanda la communication avec le ministre des Colonies et, grâce aux déclenchements automatiques dont sont munis les téléphones new-yorkais, il obtint cette communication presque instantanément.
– Allô !
– Qui me parle ?
– C’est moi, Mr. Steffel, le directeur de la police ! Voulez-vous prier M. le chef du bureau des concessions coloniales de venir à l’appareil ?
– Me voici, dit une seconde voix quelques instants après. Qu’y a-t-il pour votre service, monsieur Steffel ?
– Oh ! un simple renseignement. Je voudrais savoir le nom de la personne à laquelle a été concédée une petite île, qui s’appelle l’île Saint-Frédérik, dans les parages du Klondike.
– Très facile. L’île Saint-Frédérik appartient à l’heure actuelle à l’un de nos concitoyens, Mr. Fritz Kramm, le fameux marchand de tableaux, qui y a fait, d’ailleurs, sans beaucoup de succès, je crois, une tentative d’élevage des phoques à fourrure.
– Très bien, merci, c’est tout ce que je désirais savoir.
Et Mr. Steffel accrocha le récepteur de l’appareil.
En entendant le nom de Fritz Kramm, le policier avait cru avoir un éblouissement. Confusément la vérité lui était apparue comme dans un éclair.
Mr. Steffel, grâce aux notes de ses agents, n’ignorait pas les fâcheux antécédents des deux frères Cornélius et Fritz. Il savait que l’antiquaire avait été maintes fois soupçonné de servir de receleur aux détrousseurs de musées et aux voleurs internationaux. Dès lors, sa conviction était faite. Il ne s’agissait plus maintenant pour lui que de découvrir les preuves matérielles, ce qui, sans doute, ne serait pas difficile.
Disons-le en passant, la mentalité des policiers américains diffère beaucoup de celle des policiers français. Il était arrivé maintes fois à Mr. Steffel lui-même de toucher la forte somme de la part de tenanciers de maisons de jeu, ou même de riches criminels auxquels on permettait, moyennant finances, de gagner l’ancien continent.
Le directeur de la police, après mûres réflexions, résolut de ne point brusquer les choses ; peut-être après tout y aurait-il moyen de conclure une transaction avantageuse avec le propriétaire de l’île Saint-Frédérik.
En proie à ces préoccupations, Mr. Steffel se fit conduire immédiatement chez Fritz Kramm qui habitait un luxueux hôtel dans le voisinage de Central Park.
L’antiquaire était absent. Il était allé, à ce que dit le domestique, rendre visite à son frère, le docteur Cornélius. Mr. Steffel remonta en auto et se fit conduire chez Cornélius où l’Italien Léonello l’introduisit cérémonieusement dans le grand salon d’attente de style Louis XIV.
Dès qu’ils connurent la présence du haut fonctionnaire de la police, Cornélius et Fritz accoururent le sourire aux lèvres, la main tendue, mais ils furent décontenancés par la mine grave et presque menaçante de Mr. Steffel.
– Sirs, dit-il d’une voix brève, ce n’est pas une simple visite de politesse qui m’amène, et je crains bien d’avoir à remplir aujourd’hui près de vous une pénible mission.
Le policier guettait du coin de l’œil l’effet de ses paroles sur les deux frères, mais ils ne bronchèrent pas.
– De quoi s’agît-il ? demanda Fritz d’un ton parfaitement naturel.
Mr. Steffel résolut de brusquer les choses.
– Je ne vous cacherai pas, monsieur Fritz Kramm, dit-il, que de graves soupçons pèsent sur vous. C’est bien vous, n’est-ce pas, qui êtes propriétaire de l’île Saint-Frédérik, plus connue dans le monde des bandits de la Main Rouge sous le nom de « l’île des pendus » ?
Fritz était devenu blême ; pourtant, ce fut avec assez d’assurance qu’il répondit :
– Il est parfaitement exact que je suis propriétaire de l’île Saint-Frédérik, mais il y a bien des années que je l’ai entièrement abandonnée et je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec vos pendus !
– Drôle d’histoire, murmura doucement Cornélius, mais tout en parlant il jetait sur Mr. Steffel de si étranges regards derrière les vitres de ses lunettes d’or que le policier ne put s’empêcher de frissonner.
Il se rappela les bruits qui avaient couru sur les laboratoires souterrains du sculpteur de chair humaine.
– Notez bien ceci, crut-il bon de dire, c’est que, si je subissais de votre part la moindre voie de fait au cours de cette visite, les documents que je possède contre vous, et qui sont en mains sûres, paraîtraient ce soir même dans trois des plus grands journaux de New York.
– Il n’est pas question de voies de fait, dit le docteur Cornélius toujours parfaitement calme, nous tenons seulement à avoir quelques explications sur l’étrange accusation que vous faites peser sur mon frère.
– Je crois, interrompit Fritz, que Mr. Steffel est en train en ce moment-ci de commettre une lourde bévue. Est-ce que des gens comme moi et mon frère, dont la fortune est considérable, qui possédons même une part dans le trust de William Dorgan, pouvons avoir quelque chose de commun avec les bandits de la Main Rouge ?
– Protestations inutiles, s’écria Mr. Steffel avec emportement, je sais tout ! Vous et votre frère faites partie des Lords de la Main Rouge. J’ai contre vous des témoignages précis.
Fritz et Cornélius échangèrent un coup d’œil rapide. La situation était évidemment embarrassante.
– C’est vous, poursuivit le policier, qui avez enlevé le savant français, M. Bondonnat, que vous séquestrez encore à l’heure qu’il est ; c’est vous qui avez longtemps retenu prisonnier l’honorable lord Burydan. Mais prenez garde ! Le gouvernement de l’Union va expédier un cuirassé contre l’île des pendus, et ce repaire de bandits sera complètement anéanti. Tenez, ajouta-t-il après un silence, le meilleur parti que vous ayez à prendre serait d’avouer carrément, de me donner les noms de tous vos complices, et peut-être qu’à cette condition je pourrais obtenir que vous ne soyez pas poursuivis.
Le docteur Cornélius eut un sourire ironique.
– Je connais cette vieille ruse de guerre, dit-il, mais nous serions fort embarrassés, mon frère et moi, de vous révéler les noms de nos complices, puisque nous n’en avons pas et que d’ailleurs nous ne sommes coupables d’aucun crime !
– Parbleu ! s’écria Fritz, je devine d’où part cette dénonciation. Elle émane sans doute de ce lord Burydan tout fraîchement évadé du Lunatic-Asylum, après avoir assassiné un citoyen américain.
– L’honorable lord Burydan, reprit Mr. Steffel en pesant lentement ses paroles, ignore encore que c’est Mr. Fritz Kramm le propriétaire de l’île Saint-Frédérik. Je n’ai pas encore jugé à propos de l’en informer.
– Vous êtes libre de le faire. Je ne suis pas responsable, moi, de ce qui se passe dans une île déserte et glaciale où je ne suis pas allé depuis des années.
– Savez-vous ce qui se produira si je mets lord Burydan au courant de la chose ? C’est qu’il sollicitera et obtiendra immédiatement l’envoi d’un cuirassé. Dans tous les cas, cette affaire vous causera un tort considérable, même en admettant que vous ne soyez pour rien dans les agissements de la Main Rouge.
Fritz et Cornélius commençaient à comprendre où voulait en venir Mr. Steffel.
– Je vous affirme, dit le docteur, que mon frère n’a absolument rien à se reprocher, et l’enquête que vous mènerez avec votre sagacité habituelle établira certainement son innocence.
– Ce que vous dites est possible, reprit le policier avec hésitation, mais qui me dit que vous ne chercherez pas à vous soustraire à l’action de la justice ?
– Tenez, dit Cornélius, je vais vous donner une preuve de ma bonne foi. Je vais déposer entre vos mains une caution de cinquante mille dollars ; comme cela, vous serez sûr que ni mon frère ni moi ne chercherons à nous échapper.
– Évidemment, fit Mr. Steffel, qui avait amené ses interlocuteurs au point où il voulait les voir, cette proposition milite en votre faveur. Il est possible après tout qu’une erreur ait été commise à votre sujet. Avant de déchaîner un scandale tel que celui que causerait votre arrestation, je veux élucider cette affaire en toute impartialité.
– Vous reconnaîtrez bien vite que l’on s’est trompé en nous dénonçant. Attendez un instant, je vais vous signer le chèque de cinquante mille dollars.
Le docteur Cornélius traça sur une feuille de son mémorandum quelques lignes en caractères hiéroglyphiques, puis il sonna Léonello et lui remit le papier. Une minute après, l’Italien revenait avec un carnet de chèques dont Cornélius et Fritz contresignèrent une feuille en y inscrivant le chiffre de cinquante mille dollars.
Mr. Steffel s’en saisit, enchanté d’avoir si bien conduit une aussi délicate négociation.
– Au revoir, sirs, dit-il en se retirant. Plus je réfléchis, plus je suis persuadé que vous avez été victimes d’une dénonciation calomnieuse. Ce n’est pas des hommes comme vous qui sont affiliés à l’association de la Main Rouge ! Décidément, cette accusation est absurde et je vais classer l’affaire.
– N’oubliez pas, monsieur Steffel, fit Cornélius avec un sourire plein de sous-entendus, que, s’il arrivait qu’on nous accusât de nouveau, nous sommes toujours prêts à fournir caution.
– Entendu, au revoir, mes chers amis.
Et tous trois échangèrent une cordiale poignée de main.
Tout en traversant le magnifique jardin qui entourait l’hôtel du docteur, Mr. Steffel se disait qu’il serait bien sot de s’en tenir à ce premier acompte, et il se proposait de continuer son enquête dans le plus grand secret, quitte à opérer une arrestation en masse de tous les chefs de la Main Rouge sitôt qu’il serait parvenu à connaître leurs noms.
– Je sais bien, parbleu, songeait-il, qu’ils ne me réclameront jamais ces cinquante mille dollars, et que je me suis tacitement engagé à laisser la Main Rouge tranquille, mais on n’est pas forcé de se montrer honnête avec de pareils bandits ! Si Cornélius et Fritz étaient innocents, ils n’auraient pas essayé d’acheter mon silence au prix d’une somme aussi considérable.
Le policier remonta en auto, en criant à son chauffeur :
– À la Central Bank ! Et mettez de l’avance à l’allumage pour que j’arrive à temps pour toucher un chèque !
Sitôt que le policier se fut retiré, Cornélius et Fritz se regardèrent anxieusement.
– Nous l’avons échappé belle ! murmura l’antiquaire.
– Le danger reste le même, répliqua le docteur. Je n’ai aucune confiance dans ce Steffel, qui est un maître chanteur sans scrupules. Je suis sûr que, maintenant qu’il nous a tiré cette plume de l’aile, il n’aura rien de plus pressé que de nous trahir !
– Que faire ?
– J’ai déjà donné des ordres à Léonello, sous prétexte de me faire apporter le carnet de chèques.
– Je m’étais bien aperçu que tu griffonnais quelque chose, mais je n’avais pas vu de quoi il s’agissait !
– Avec des gaillards de la trempe de Steffel, il faut riposter du tac au tac. En ce moment même, Slugh est déjà en route avec la grande automobile, et il se peut que d’ici une heure nous soyons débarrassés de ce malencontreux policier.
– N’est-ce pas imprudent, murmura Fritz avec inquiétude, et si Steffel a, comme il s’en vante, mis en mains sûres la dénonciation qui nous concerne ?
– Mais non, je connais Steffel. Il est bien trop rusé pour s’être confié à qui que ce soit. Il sait fort bien que, du moment où il aurait révélé à quelqu’un le nom du véritable propriétaire de l’île des pendus, il ne serait plus le maître de la situation.
– Ceci dans tous les cas est une leçon, reprit Fritz. Il est indispensable que l’île des pendus ne soit plus à mon nom. Je vais m’occuper de faire une vente fictive. Je dirai que je me suis débarrassé de cette île glaciale dont il est absolument impossible de tirer parti.
– Il y a longtemps que cette précaution aurait dû être prise. Nous devons en ce moment, ne l’oublie pas, redoubler de vigilance. Jamais nous n’avons traversé une période de malchance pareille !
– Rien n’est encore perdu !
– Non, mais il va falloir déployer beaucoup d’énergie. La Main Rouge a fait des pertes d’argent considérables, beaucoup de nos affiliés sont en prison et notre prestige diminue ; enfin, nous n’avons réussi aucune affaire importante depuis longtemps. Baruch lui-même a si mal dirigé sa barque que William Dorgan s’est réconcilié avec son fils Harry et a refait un testament où il partage également ses biens entre ses deux fils. Par conséquent, impossible pour le moment de faire disparaître le vieux milliardaire et d’entrer en possession du trust.
– Non, il faut attendre. Je tiens à avoir l’esprit en repos au sujet de l’expédition qu’organisent contre l’île des pendus Fred Jorgell et ses amis.
– Je suis moi-même un peu à court, reprit le docteur ; j’ai dépensé, ces temps derniers, des sommes énormes en expériences, et je n’ai pas obtenu les résultats que j’espérais.
– J’ai une intéressante affaire en vue, et qui pourrait faire rentrer dans nos caisses une somme d’un million de dollars !
– By God ! cela en vaut la peine ! De quoi s’agit-il !
Fritz mit son frère au courant de la proposition que lui avait faite la veille Balthazar Buxton. Les deux bandits échafaudèrent minutieusement le plan qui devait les mettre en possession du célèbre tableau du Titien, le portrait de Lucrèce Borgia, actuellement dans la galerie du milliardaire William Dorgan. C’était sur la complicité de Baruch qu’ils comptaient pour arriver à atteindre leur but.
Cependant, les deux frères jetaient de temps à autre des regards impatients sur la grande horloge de Boulle en ébène incrusté de cuivre et d’écaille qui se dressait au fond du salon.
– Slugh ne revient pas vite, grommela Cornélius.
– Malheureusement, je ne puis l’attendre, répliqua Fritz, j’ai chez moi un rendez-vous important.
– Eh bien, va ! Je te téléphonerai s’il y a quelque chose de nouveau.
– Je voudrais bien que cette affaire soit terminée. Je tremble que, si nous ne nous débarrassons pas de Steffel, lord Burydan et ses amis ne viennent à connaître l’exacte situation de la capitale de la Main Rouge !
– Ne sois donc pas si poltron. Les renseignements que j’ai reçus de San Francisco sont excellents, en ce sens que Fred Jorgell et sa bande sont toujours persuadés que notre île se trouve dans le voisinage du pôle Sud. D’ailleurs, quoi qu’il arrive, toutes nos précautions sont prises. Il faut que pas un des passagers de la Revanche n’échappe au naufrage que je lui prépare !
Les deux frères prirent enfin congé l’un de l’autre ; chose extraordinaire entre de pareils bandits, ils s’étaient toujours parfaitement entendus entre eux ; jamais ils n’avaient eu une discussion sérieuse. D’ailleurs, l’antiquaire professait à l’égard du savant un véritable culte et s’inclinait toujours très docilement devant ses décisions.
CHAPITRE III
Un déplorable accident
Fritz Kramm s’était tout à coup rappelé qu’il avait donné rendez-vous à Lorenza, la guérisseuse de perles, et aussitôt toutes les préoccupations que lui donnaient les sinistres complots de la Main Rouge avaient disparu comme par enchantement. Il n’avait plus qu’un seul souci en tête : retrouver la jeune femme un instant entrevue dans la fastueuse galerie de Balthazar Buxton.
Chemin faisant, il stimulait le zèle de son chauffeur et tremblait à la seule pensée de se trouver en retard et de manquer de quelques minutes la charmante visiteuse.
– Personne n’est encore venu ? demanda-t-il à son valet de chambre en pénétrant en coup de vent dans un petit salon mauresque, meublé de divans bas recouverts de peaux de tigre et orné de panoplies d’armes orientales.
– Si, lui fut-il répondu. M. Grivard est dans l’atelier et il s’est mis au travail en vous attendant.
– Bien. Je vais le rejoindre. Si une dame vient me demander, vous l’introduirez immédiatement.
La pièce que Fritz avait désignée sous le nom d’atelier était une petite salle située à côté du magasin principal, et qui servait de resserre et de débarras ; là se trouvaient empilés des tableaux sans cadre, des châssis à clef, des toiles roulées, tout cela entassé au hasard dans un désordre qui n’avait rien d’artistique.
Installé devant un grand chevalet qui supportait une scène d’orgie du Pinturicchio, un jeune homme à la chevelure d’un blond doré, à la barbe soyeuse et rousse, travaillait avec ardeur. Sous les touches rapides de son pinceau, le torse satiné d’une belle courtisane endormie semblait peu à peu sortir de la pénombre. Les seins aux pointes roses se gonflaient de nouveau et tendaient le velours du corsage saccagé dans d’amoureux ébats ; le cou d’une blancheur de lait retrouvait sous l’effort laborieux de l’artiste ses veinules d’azur.
Cette restauration était si parfaite que les fragments surajoutés se reliaient harmonieusement au reste de la composition sans qu’il fût possible de distinguer les solutions de continuité.
Fritz Kramm, qui était entré sur la pointe du pied, contempla quelque temps le tableau en silence, puis, frappant à l’improviste sur l’épaule du peintre :
– Vraiment, monsieur Grivard, lui dit-il en français, vous êtes un homme admirable ; vous avez le génie de vous approprier le style des maîtres de toutes les époques, et le Pinturicchio lui-même reconnaîtrait pour sien ce beau torse de femme endormie qui semble avoir succombé il y a un instant à peine à d’amoureuses fatigues.
– Vous êtes trop indulgent, monsieur Kramm, répondit le peintre d’un ton mélancolique, je vous assure que ce n’est pas difficile, pour un homme qui connaît un peu son métier, de mener à bien un semblable travail.
– Ce n’est pas mon avis. Jusqu’ici je n’ai trouvé personne qui fût en état de s’en acquitter aussi bien que vous.
– C’est sans doute pour cela, reprit l’artiste avec amertume, que vous tenez à me conserver près de vous ?
Fritz eut un sourire sardonique.
– Mais oui, fit-il, je tiens énormément à vous conserver ! Que vous manque-t-il, en somme, près de moi ? Ne vous payé-je pas suffisamment ?
– Certes, oui.
– Ne vous laissé-je pas la liberté de faire ce qui vous plaît ?
– Sans doute, murmura le jeune homme, mais vous me retenez à New York par une violence morale que je ne veux pas qualifier, et vous m’empêchez de revoir la France où m’attendent le bonheur et la gloire !
– Patientez encore ! Un jour viendra où vous me remercierez de la contrainte que je vous impose…
À ce moment, le valet de chambre entra et remit à Fritz une mignonne carte de visite.
– La signora Lorenza ! s’écria joyeusement l’antiquaire, faites-la entrer ici ! Mais ayez soin de la faire passer par la grande galerie et par les deux salons.
Et, se tournant vers l’artiste, il ajouta :
– Monsieur Grivard, vous allez voir une belle personne ! Une jeune femme digne en tout du pinceau des vieux maîtres que vous admirez !
Presque aussitôt la porte s’ouvrit et Lorenza, dans un bruissement de soie, pénétra dans la pièce avec cette démarche harmonieuse et noble que les poètes anciens prêtaient aux déesses, et qui faisait ressortir sa taille souple et svelte au-dessus des hanches voluptueusement balancées. L’artiste s’était levé pâle et éperdu d’admiration. Son premier sentiment, instinctif et irréfléchi, fut qu’il se trouvait en présence d’une princesse ou d’une reine ; et il s’inclina vers la jeune femme avec un profond respect.
Fritz s’était hâté d’offrir un fauteuil à la signora Lorenza en s’excusant de ne pas l’avoir reçue dans un des riches salons qu’elle venait de traverser.
– Cette pièce est plus intime, fit-il, et je n’y admets que les amis. Je vous présente M. Grivard, un artiste du plus haut talent !… La signora Lorenza ! la magicienne des perles ! celle qui a reçu le don merveilleux de leur rendre la vie et la splendeur !
L’artiste demeurait silencieux, si intimidé qu’il ne trouvait aucun compliment qui lui parût digne de la jeune femme. Il avait la sensation que cette admirable Lorenza appartenait à une race supérieure à la simple humanité, et qu’elle allait peut-être s’évanouir comme ces profils mystérieux que l’on croit apercevoir dans la pénombre des clairs de lune et qui, dès qu’on s’approche, s’effacent dans la nuit.
Lorenza elle-même se trouvait tout émue et toute confuse. Avec son exquise délicatesse de sensation, elle s’était vite aperçue de l’impression qu’elle produisait sur l’artiste et elle était profondément touchée de cette muette et respectueuse admiration.
Du premier coup, elle se sentait entraînée vers le jeune homme par une étrange sympathie. Cette physionomie, qui respirait la franchise, l’intelligence et la bonté, l’avait charmée.
Les regards de l’artiste, dont les grands yeux bleus avaient une expression très douce, avaient rencontré ceux de Lorenza et les deux jeunes gens avaient ressenti au cœur une étrange commotion. Un trouble inconnu les envahissait. Ils avaient compris que dans cette mystérieuse seconde il s’était passé quelque chose d’irrévocable comme si chacun d’eux venait de pénétrer dans un monde inconnu.
Fritz Kramm, qui ne s’était point aperçu de ce rapide échange de coups d’œil, s’empressait autour de la jeune femme vers laquelle il était invinciblement attiré.
– Vous savez, signora, dit-il, que j’aurai beaucoup de travaux à vous confier. J’ai des quantités de perles anciennes sur lesquelles votre merveilleux pouvoir pourra s’exercer tout à son aise. Voulez-vous que je vous en fasse voir quelques-unes ?
– Volontiers.
– Tenez, dit-il en ouvrant un coffret d’acier qu’il avait pris dans un bahut, voici des colliers et des bracelets, des pendentifs et des aigrettes qui datent de toutes les époques de l’histoire. Voici des pendants d’oreilles trouvés dans un sarcophage égyptien ; leurs perles sont sans doute contemporaines de celle qu’avala la reine Cléopâtre après l’avoir fait dissoudre dans le vinaigre. En voici d’autres qui ornèrent le pourpoint de Charles le Téméraire et plus tard le toquet des mignons de Henri III. Celles-ci, jaunes et bleues, paraient la garde du poignard de Tippo-Sahib, un radjah indien…
Tout en continuant cette savante énumération, Fritz Kramm posait sur les genoux de Lorenza d’anciens bijoux aux curieuses montures d’or ou d’argent, mais les perles qui les ornaient, privées de leur orient, devenues absolument mates et ternes, faisaient songer aux prunelles sans regard des aveugles.
Tout à coup la sonnerie du téléphone se fit entendre dans la pièce voisine.
– Vous m’excuserez, dit Fritz furieux d’être dérangé, je reviens dans un instant.
Son absence, en effet, ne se prolongea que quelques minutes, mais quand il reparut dans l’atelier, sa physionomie avait revêtu une expression maussade.
– C’est assommant, dit-il, il faut absolument que je passe chez mon frère. Heureusement qu’avec l’auto je n’en ai pas pour plus d’un quart d’heure. J’espère que la signora Lorenza voudra bien attendre mon retour, en compagnie de M. Grivard.
– Certainement, répondit la jeune femme. En votre absence j’examinerai ces beaux bijoux. Ils sont tous très curieux.
– Oui, j’ai là quelques pièces assez rares. Distrayez-vous le mieux possible avec ces bibelots, et à tout à l’heure…
Fritz Kramm sauta dans son auto en jetant au chauffeur l’adresse de son frère, mais, à quelques pas de l’hôtel, son attention fut attirée par un crieur de journaux dont la foule s’arrachait les feuilles encore tout humides de la presse.
– Le chef de la police de New York victime d’un accident grave ! Nouveaux détails !
Fritz fit signe au camelot en lui montrant de loin un dollar. L’homme se hâta d’accourir, enchanté de l’aubaine, et remit à l’antiquaire, en échange de la pièce d’argent, un numéro d’une édition spéciale du New York Herald.
Le regard de Fritz alla tout de suite à l’article de tête composé en caractères très apparents.
LE CHEF DE LA POLICE DE NEW YORK
VICTIME D’UN ACCIDENT MORTEL
FATALE IMPRUDENCE D’UN CHAUFFEUR
UNE ERREUR IMPARDONNABLE
« Le chef de la police de notre ville, l’honorable Mr. Steffel, se rendait, il y a quelques heures, à la Central Bank pour y toucher le montant d’un chèque ainsi qu’il l’avait dit à son chauffeur, lorsqu’en traversant la Cinquième avenue l’auto où il était monté fut violemment heurtée par une grande automobile de course, une cent chevaux, pilotée par un seul homme et lancée à une allure vertigineuse.
« La voiture de Mr. Steffel fit panache et le chef de la police, grièvement blessé à la tête, aux bras et à la poitrine, alla rouler inerte sur la chaussée.
« L’auteur de l’accident, redoutant sans doute la terrible responsabilité qu’il avait encourue, n’eut pas honte de disparaître et ne put être rejoint par les voitures de la police municipale qui s’étaient lancées à sa poursuite. Le chauffeur de Mr. Steffel, qui n’a heureusement reçu que des blessures insignifiantes, s’empressa de venir au secours de son maître et, avec l’aide de plusieurs témoins de l’accident, le transporta dans une pharmacie voisine où les soins les plus empressés lui furent prodigués.
« Ce zèle, hélas ! devait être fatal au blessé.
« En l’absence du pharmacien, l’honorable Mr. Wells, le garçon de laboratoire de ce dernier lui fit absorber le contenu d’un flacon qu’il supposa rempli d’éther et qui, en réalité, contenait une potion éthérée additionnée d’une forte dose de morphine.
« L’employé s’aperçut presque aussitôt de son erreur, mais, en dépit des soins énergiques qu’il prodigua au chef de la police, le malheureux ne tarda pas à succomber sans avoir repris connaissance.
« Détail singulier : le chèque dont Mr. Steffel avait dit être porteur n’a pu être retrouvé, non plus que son portefeuille. Ce larcin s’explique aisément par la présence de la foule de curieux qui, en dépit des policemen, avait envahi la pharmacie.
« Une enquête a été immédiatement ouverte sur ce double et déplorable accident.
« La bonne foi du garçon de laboratoire, un certain Smith, natif de New Jersey, ne peut être soupçonnée. Cependant il sera poursuivi pour homicide par imprudence. »
À la suite de cet article venait une notice biographique où l’on célébrait pompeusement le courage, l’intelligence, l’habileté et les autres vertus du chef de la police, en énumérant les arrestations sensationnelles auxquelles il avait collaboré.
Après avoir terminé la lecture de ce fait divers impressionnant, Fritz Kramm se sentit délivré d’un poids énorme. Une fois de plus, la Main Rouge venait de triompher d’un de ses plus redoutables ennemis ; le crime avait été commis avec une si foudroyante rapidité que certainement Mr. Steffel n’avait pu faire de confidences à personne. Tout était donc pour le mieux. Et ce fut avec la mine souriante et paisible qui lui était habituelle que Fritz Kramm pénétra chez le docteur Cornélius de qui il brûlait d’apprendre des détails complets.
C’était à Slugh et à Léonello que revenait tout l’honneur de la criminelle expédition. C’était Slugh qui, d’une habileté extraordinaire comme chauffeur, avait très volontairement culbuté le chef de la police et c’était Léonello qui avait transporté le blessé chez un pharmacien affilié à la Main Rouge et avait présidé en personne à l’empoisonnement du malheureux policier.
C’était encore Léonello qui avait dérobé le chèque de cinquante mille dollars et le portefeuille de la victime.
Fritz Kramm ne demeura chez son frère que le temps strictement indispensable. Maintenant qu’il était délivré des inquiétudes que lui avaient causées les menaces de Steffel, il avait hâte de rentrer chez lui et de retrouver la belle Lorenza dont il était passionnément épris.
– Je n’ai jamais aimé aucune femme, songeait le bandit, jamais je n’ai ressenti un trouble pareil à celui que j’éprouve en ce moment !… Oui, je veux que Lorenza soit à moi, dussé-je dépenser des millions ! Dussé-je me marier avec elle ! Dussé-je même abandonner la Main Rouge et me séparer de mon frère !
Malheureusement pour Fritz, il n’était guère probable que la belle Italienne répondît jamais à sa passion. Avec cette délicatesse des sens qui arrivait presque à la divination, Lorenza avait eu vite fait de deviner, sous les apparences correctes du gentleman, l’homme rusé, brutal, hypocrite et sans foi qu’était le second Lord de la Main Rouge.
Elle éprouvait pour lui une des ces antipathies irraisonnées qui mettent en défense les êtres faibles contre ceux qui pourraient leur nuire. En revanche, elle avait tout de suite été gagnée par les manières à la fois franches et timides du bel artiste.
Pendant l’absence de Fritz Kramm, tous deux causèrent doucement, tout en examinant les bijoux et les œuvres d’art dont l’hôtel de l’antiquaire était bondé de la cave au faîte. Ils s’entretenaient de choses indifférentes, mais il y avait dans leurs opinions, même sur les points de détail les plus insignifiants, une concordance absolue ; ils se comprenaient d’un mot, d’un geste, parfois même d’un simple sourire.
– Mr. Kramm va revenir, dit enfin Grivard, et je vais vous laisser discuter avec lui de la guérison de ses perles, mais j’aurais été bien heureux de vous revoir.
– Rien ne s’y oppose, murmura la jeune femme qui rougit imperceptiblement.
– Signora, je voudrais demander une grande faveur, celle de faire votre portrait.
– Bien volontiers, répondit Lorenza. Retenez mon adresse. J’habite un petit hôtel situé au n° 333 de l’avenue Broadway. Je suis chez moi tous les matins ; mais surtout pas un mot à Mr. Kramm, il n’a pas besoin de savoir que nous sommes tout de suite devenus si bons amis.
– Soyez tranquille, je serai discret. Adieu, signora !
Mettant un genou en terre, Louis Grivard déposa un respectueux baiser sur la main blanche et fine que lui tendait Lorenza, et se retira l’âme extasiée, le cœur débordant d’une joie qu’il n’avait jamais connue.
CHAPITRE IV
Un drame de la misère
L’esthétique mobilière du Yankee pur sang est totalement différente de celle de l’Européen, même si ce dernier est anglo-saxon : le Yankee recherche avant tout ce qui est immédiat et pratique, et il bannit, par principe, toute ornementation. Par exemple, un milliardaire new-yorkais se fera une loi de n’avoir que des meubles simples, sans moulures ; il se fera confectionner un fauteuil sur mesure, il dépensera huit ou dix mille dollars pour une adduction d’eau ou d’électricité, mais on ne verra chez lui ni un tableau ni une statue.
En revanche, il possédera des classeurs archiperfectionnés, un téléphone haut-parleur, et tout le service de sa table se fera automatiquement.
Si l’on trouve chez lui quelque tableau de maître, sa présence sera surtout due à la vanité. En général – car il y a d’honorables exceptions –, un milliardaire possède des tableaux ou des statues parce que c’est la mode d’en avoir, parce qu’un tel, qui est très riche, en possède et qu’il faut faire comme tout le monde, parce qu’enfin les tableaux et les statues sont une affirmation et une preuve de la richesse, parce qu’ils coûtent cher et qu’ils représentent un capital susceptible de s’accroître.
Nous avons connu un milliardaire qui avait payé quatre-vingt-douze mille francs un superbe Corot et l’avait fait placer dans son salon, mais qui n’avait jamais eu le temps de le voir.
On a des tableaux, dans le monde des Cinq-Cents, comme certaines femmes ont des bijoux. L’essentiel n’est pas de goûter une sensation esthétique, d’ailleurs accessible à bien peu de personnes, mais de faire crever de dépit les amis et connaissances qui ne peuvent se payer un objet aussi coûteux.
Des financiers qui, dans le secret de leur âme, admirent les pires chromos ou les navrantes statues de la rue Saint-Sulpice ont une galerie de chefs-d’œuvre pour la même raison que certains parvenus qui, adorant le ragoût de mouton et le veau aux carottes, se repaissent à contrecœur de truffes, de caviar et de homard à l’américaine parce que ce sont des mets chics que l’on paie cher.
Le milliardaire Fred Jorgell se rattachait par certains côtés à cette catégorie de richards vaniteux et fermés à tout véritable sentiment artistique ; mais il n’en était pas de même de son rival financier William Dorgan.
Le père de l’ingénieur Harry, anglais de naissance, aimait et comprenait les belles choses. L’hôtel qu’il occupait et qu’il avait fait reconstruire après l’incendie de la Trentième avenue était exactement copié sur un château du temps de la reine Elisabeth, à l’architecture emphatique et maniérée. Ce n’était partout que tourelles, clochetons et arcades fleuries de sculptures.
William Dorgan possédait une galerie composée surtout de tableaux de l’école anglaise de la fin du XVIIIe siècle et de quelques Français modernes. Il n’avait que peu ou point de tableaux anciens. Il avait fallu que le hasard d’une occasion lui permît d’acheter le portrait de Lucrèce Borgia, œuvre incontestablement plus belle que ce portrait de César Borgia qui appartient à Rothschild et se trouve actuellement au château de Ferrières[5].
Le portrait de Lucrèce Borgia avait été placé dans un salon spécial, orné de meubles italiens de l’époque de la Renaissance. C’est là que, depuis quelques jours, Louis Grivard travaillait à faire une copie aussi exacte que possible du chef-d’œuvre.
Il était tout à son travail, un matin, lorsqu’il entendit la porte s’ouvrir et qu’il aperçut le fils aîné de William Dorgan, le fameux trusteur Joë Dorgan – ou, comme on le sait, l’assassin Baruch qui avait usurpé sa personnalité. Comme il le faisait souvent, il venait jeter un coup d’œil sur les travaux de l’artiste et s’entretenir quelques instants avec lui.
Bien que le fils du milliardaire montrât envers lui la plus grande courtoisie, Louis Grivard ne ressentait pour lui aucune sympathie, et leur conversation se bornait souvent à quelques phrases de politesse ; mais, ce matin-là, Baruch paraissait en veine de causerie :
– Ce que vous faites là est admirable, dit-il au peintre. Il faut certainement être un connaisseur d’une grande habileté pour distinguer de l’original une copie aussi bien exécutée.
– Je tâche de faire de mon mieux. En tout cas j’ai pris les plus minutieuses précautions pour que la reproduction soit aussi exacte que possible.
– De quelles précautions parlez-vous ?
– Ainsi, par exemple, la toile dont je me sers est de l’époque.
– Vous n’avez pu sans doute faire de même pour les couleurs ? Quoique je sois assez ignorant, je sais que le Titien ne pouvait employer nos couleurs modernes qui sont toutes dues à la chimie et, d’ailleurs, beaucoup moins solides que les couleurs des anciens.
– C’est ce qui vous trompe, fit Louis Grivard. Pour exécuter ce tableau je ne me sers, comme le Titien lui-même, que de terres broyées avec de l’huile et qui sont absolument inaltérables. Mon bleu d’outremer est fabriqué d’après l’ancien procédé, avec du lapis-lazuli finement broyé, et j’ai banni de ma palette les laques et les oxydes si sujets à se ternir.
– Voilà qui est très intéressant ! Mais savez-vous à qui est destinée cette copie ?
Une ombre passa sur le visage expressif de l’artiste.
– Je l’ignore, répondit-il. Je suis aux gages de Mr. Kramm, je fais ce qu’il me commande et je n’en sais pas plus long !
– Je ne serais pas étonné que mon ami Mr. Fritz Kramm, qui est lui-même un amateur distingué, ne gardât cette belle copie pour sa propre galerie.
– Je vous l’ai dit, je ne puis vous renseigner à cet égard.
– En tout cas, je suis heureux du hasard qui m’a permis de faire votre connaissance, et j’ai donné des ordres pour que vous soyez admis, chaque fois que vous le désirerez, à visiter les tableaux que possède mon père.
– Je ne sais si je pourrai d’ici longtemps profiter de votre aimable permission. La copie de la Lucrèce Borgia est terminée. Il ne me reste plus que quelques glacis à poser et ce sera fini.
– Vraiment, s’écria Baruch en se reculant pour mieux juger de l’effet, il est impossible de faire une copie plus parfaite !
Et ses regards se portaient de l’un à l’autre des deux tableaux, dans une muette admiration.
La belle princesse courtisane qui fut la maîtresse de son père, le pape Alexandre VI, et de son frère César avait été représentée par le Titien, négligemment assise dans un grand fauteuil de Venise, de forme raide. Ses beaux cheveux blonds, séparés sur le front en deux bandeaux, étaient serrés par un jaseron d’or que retenait, juste au-dessus des sourcils, une grosse émeraude. Une robe de velours vert accusait la souplesse de sa taille et laissait à découvert ses bras blancs et sa gorge ronde aux seins menus et placés un peu haut. Mais ce qu’il y avait de prestigieux, c’était le sourire innocent de ce beau visage aux yeux purs et limpides, à la bouche enfantine. Pourtant à l’époque où ce portrait avait été fait, Lucrèce, trois fois veuve et mère une fois déjà, avait épouvanté les contemporains par ses crimes et ses orgies.
Les deux hommes s’entretinrent quelques instants encore de cette énigmatique Lucrèce, dont lord Byron fut amoureux par-delà la mort et les siècles révolus, et dont il garda longtemps une boucle de cheveux arrachée au tombeau de Ferrare et acquise pour une somme immense.
Ce n’était pas par désœuvrement ou par simple curiosité que Baruch avait fait preuve de tant d’intérêt pour l’œuvre de Louis Grivard. Il avait surveillé le travail de ce dernier de très près, et pour des raisons qui n’avaient rien de commun avec les préoccupations artistiques.
Fritz et Cornélius l’avaient mis au courant de la proposition faite par Balthazar Buxton, et comme tous trois savaient fort bien que William Dorgan ne consentirait jamais à se défaire de son tableau, il avait été décidé entre eux que le portrait de Lucrèce Borgia serait volé dans des conditions telles que le larcin ne pût jamais être découvert.
Pour y réussir, Fritz avait songé à faire appel au talent de Louis Grivard. Il avait été convenu que l’artiste ferait du tableau une copie fidèle et qu’au dernier moment il remplacerait par la copie l’original qui, lui, serait livré à Balthazar Buxton.
Ce plan avait les plus grandes chances de réussir, William Dorgan se trouvant précisément absent, parti en tournée d’inspection pour visiter les immenses domaines du trust des cotons et maïs dont il était le directeur.
Fritz Kramm avait des raisons de croire l’artiste entièrement à sa discrétion et, malgré les protestations indignées de celui-ci, il lui avait intimé l’ordre d’opérer la substitution. Louis Grivard avait feint d’accepter, se réservant de trouver, au dernier moment, un stratagème qui lui évitât de se faire complice d’une action déshonorante.
Baruch ne voulait paraître en rien dans l’affaire, mais c’est lui qui avait introduit l’artiste dans le palais paternel et avait rendu possible le vol du chef-d’œuvre.
Après avoir longtemps résisté aux suggestions de ses deux complices, il commençait à croire que le larcin aurait un plein succès. L’exactitude de la copie rendait la chose très vraisemblable. Fritz Kramm, de son côté, se croyait sûr que l’artiste obéirait à ses intentions avec la docilité la plus aveugle.
En quittant Louis Grivard, Baruch se rendit chez Fritz pour lui dire que les choses marchaient à souhait et que sans doute la Main Rouge ne tarderait pas à encaisser le million de dollars promis. Fritz n’était pas chez lui ; il venait de se rendre chez la guérisseuse de perles, dont il était de plus en plus épris, Baruch dut donc se diriger vers la demeure de Cornélius, qu’il tenait à mettre au courant.
Demeuré seul dans le magnifique salon italien aux meubles de cuir doré, au plafond orné d’un lustre en verre de couleur de la fabrique de Murano, Louis Grivard travailla deux heures encore avec ardeur, s’enthousiasmant de plus en plus pour son œuvre à mesure qu’il avançait dans sa besogne. Tout à coup, il jeta ses pinceaux dans un élan de vive satisfaction.
– Je n’y donnerai pas une touche de plus, s’écria-t-il, jamais je ne suis arrivé à une imitation aussi parfaite ! Je crois, dussé-je dire un blasphème, que le Titien lui-même, s’il revenait sur terre, ne pourrait distinguer son tableau du mien !…
L’artiste demeura quelque temps plongé dans une profonde rêverie.
Puis, distraitement, il se mit à feuilleter un album rempli de croquis, et il s’arrêta à une page où il y avait un profil de Baruch, tracé de verve en quatre coups de crayon.
– Singulière physionomie, que celle de Joë Dorgan, murmura-t-il, je n’en ai jamais vu de semblable. Aucun des muscles ne se trouve à sa place.
On dirait que ce visage a été trituré, retravaillé en sous-main. Ce Joë est décidément inquiétant ! Il a deux ou trois expressions de visage toutes différentes l’une de l’autre et, sous l’empire de quelque passion, ses traits ordinaires disparaissent pour faire place à d’autres, comme s’il y avait en lui deux individualités distinctes. Il y a là, décidément, un étrange mystère !
Tout en suivant le cours de ses pensées, Louis Grivard avait remis en place son chevalet et sa boîte à couleurs, puis il quitta son vêtement de travail et sortit rapidement de l’hôtel du milliardaire.
Il savait que, comme presque tous les jours, il était attendu par Lorenza, et il n’avait que le temps de déjeuner rapidement pour se trouver à l’heure indiquée chez la belle Florentine.
Le Yankee, qui passe sa journée dans les bureaux et les offices des immenses maisons à trente étages, se retire généralement le soir dans un petit cottage à lui, entouré d’un jardin et situé dans une rue tranquille. La nuit, les monstrueux gratte-ciel sont à peu près inhabités ; aussi la banlieue et certains faubourgs de New York sont entièrement peuplés de ces maisonnettes toutes construites sur un modèle identique, avec une cour protégée par une grille, un parterre de géraniums, trois marches de pierre blanche et une porte sur laquelle le nom de l’habitant de la maison resplendit sur une large plaque de cuivre ou de nickel.
C’était une habitation de ce genre qu’avait choisie Lorenza ; c’est là que Louis Grivard allait chaque jour passer tout le temps dont il disposait en dehors de ses travaux.
Il s’était établi entre les deux jeunes gens une de ces soudaines amitiés qui seraient inexplicables si elles n’étaient presque toujours le début d’un ardent et durable amour.
Il semblait à Louis et à Lorenza qu’ils se connaissaient déjà depuis des années. Ils n’étaient heureux que lorsqu’ils se trouvaient réunis, et leur mutuelle confiance était si grande qu’ils n’avaient entre eux aucun secret.
Une vieille femme, à la mine débonnaire, au visage sillonné de milliers de rides, mais dont les yeux demeuraient encore vifs sous le foulard de couleur voyante qui entourait ses cheveux blancs, ouvrit la porte à Louis Grivard et l’introduisit dans le petit salon où Lorenza se tenait habituellement.
C’était une pièce gaie et claire, tendue de toile écrue à fleurettes d’or et toute remplie de fleurs et de bibelots charmants. Près de la fenêtre, des tourterelles roucoulaient dans une grande cage de filigrane d’argent et, à côté d’elle, il y avait un pied de mimosa dans une caisse de faïence bleue. Les meubles, ornés d’arabesques de nacre, étaient de ce mauvais goût italien qui est parfois exquis. On voyait, d’ailleurs, que la belle Lorenza avait pour la nacre une vraie passion.
Il y en avait partout : des coupe-papier de nacre, des étagères de nacre et, sur la cheminée, une collection de beaux coquillages aux reflets chatoyants.
Lorenza portait elle-même un superbe collier de perles, à peine plus éclatant que la blanche poitrine sur laquelle il s’étalait.
À la vue de l’artiste, la jeune femme s’était levée et était accourue la mine souriante.
– Comment allez-vous, mon cher Louis ? lui dit-elle, Je suis contente de vous voir. Figurez-vous que cette nuit j’ai rêvé que vous étiez malade.
– Je vous assure, ma belle amie, que je me porte parfaitement !
– Mais comme vous avez l’air préoccupé !
– Mais non ! protesta faiblement le jeune homme.
– Vous ne savez pas mentir. Vous devez avoir quelque ennui ! Je suis très superstitieuse, je crois beaucoup aux rêves ! Il doit y avoir un peu de vérité dans celui que j’ai fait la nuit dernière !
Louis ne put s’empêcher de sourire.
– Vous êtes une vraie magicienne, fit-il. Eh bien, je l’avoue, je suis, en ce moment-ci, un peu préoccupé… On ne peut rien vous cacher, ma chère Lorenza !
– Il faut me raconter cela ! Tenez, asseyez-vous là, près de moi, et, si je suis satisfaite de votre franchise, je vous permettrai de m’embrasser.
– Soit. Mais je veux être payé d’avance.
Avec une simplicité et un manque de coquetterie qui prouvaient sa candeur et la pureté de ses intentions, Lorenza baissant les yeux offrit, d’un geste gracieux, sa joue au jeune homme qui y déposa un long baiser.
Ils s’étaient assis l’un près de l’autre et Louis avait pris dans ses mains les mains de Lorenza, sans que celle-ci songeât à les retirer.
– Maintenant, murmura-t-elle, je vous écoute.
La physionomie de l’artiste s’était rembrunie.
– Ce que j’ai à vous dire est sérieux, commença-t-il, et je ne ferais pas une pareille confidence à d’autres que vous.
Très brièvement, il raconta dans quel embarras il se trouvait, maintenant que le portrait de Lucrèce Borgia était terminé.
– Il m’est impossible, conclut-il, de me rendre complice d’un vol. Je ne m’y résoudrai jamais ! Et d’un autre côté, si je n’obéis pas à ce misérable Fritz Kramm, je m’expose à de terribles représailles !
– Comment donc se fait-il, demanda la jeune femme, toute soucieuse, que cet homme exerce sur vous un tel empire ? Si vous lui devez de l’argent, je vous en prêterai pour le payer. Ne suis-je pas votre amie ?
– C’est qu’il ne s’agit pas seulement d’argent, murmura Louis d’un air sombre.
Puis il ajouta, comme s’il prenait une brusque décision :
– Je vais tout vous dire, il vaut mieux que vous connaissiez la vérité… Mon père était un grand industriel français. Il était à la tête d’une usine d’automobiles et d’aéroplanes, dans les environs de Paris. Jusqu’alors, les affaires avaient marché admirablement ; mais, l’an dernier, un banquier, auquel mon père avait confié tous ses capitaux, passa à l’étranger en laissant un déficit de plus de trois millions…
« Nous étions ruinés. Pour faire honneur à ses échéances, mon père dut vendre ce qu’il possédait, céder son usine ; mais nos créanciers furent désintéressés jusqu’au dernier sou. C’est alors que je commençai à organiser des expositions, et, peu à peu, mon nom fut connu des amateurs et des marchands… Nous étions résolus, mon père et moi, à lutter courageusement contre l’adversité, mais, comme on dit, les malheurs vont par troupe… Ma mère et ma sœur moururent ; mon père, désespéré, prématurément vieilli par le chagrin, mais non vaincu, réunit, avec mon secours, quelques milliers de francs et s’embarqua pour New York où, grâce à sa compétence d’ingénieur et d’industriel, il espérait recommencer sa fortune.
– Je devine qu’il n’y réussit pas, interrompit Lorenza en serrant affectueusement les mains de son ami.
– Hélas ! au bout de trois mois, une dépêche m’apprenait que mon père venait de se suicider après avoir vu s’évanouir ses dernières ressources. Je vendis tout ce que je possédais et je partis pour New York. J’emportais avec moi mes tableaux. Un grand marchand parisien m’avait fourni les moyens d’organiser ici une exposition, dont les bénéfices devaient me servir à rembourser l’argent que j’avais dû emprunter pour subvenir aux frais de mon voyage et à ceux de la sépulture de mon père…
– C’est là une douloureuse histoire ! murmura la jeune fille, dont les yeux étaient humides de larmes.
– Mais il faut que j’aille jusqu’au bout de mon récit. Malgré les droits de douane très élevés dont les tableaux sont frappés en entrant en Amérique, mon exposition eut du succès et nous laissa une somme assez rondelette à l’organisateur et à moi. C’est alors que je fis la connaissance de Fritz Kramm. Il avait acquis, sans marchander, deux ou trois de mes toiles, et il avait hautement manifesté son admiration pour l’habileté toute spéciale dont je suis doué pour les copies des maîtres anciens ; aussi ne fus-je pas étonné quand je reçus un mot de lui, m’invitant à passer à son hôtel pour une affaire qui ne souffrait pas de retard.
– Il a dû vous faire tomber dans quelque traquenard ?
– Vous allez en juger :
« Après m’avoir fait entrer dans son cabinet, il tira brusquement de son portefeuille une lettre qu’il me mit sous les yeux. Je devins pâle en reconnaissant l’écriture de mon père, et c’est le cœur étreint par l’angoisse que je lus ces terribles mots :
« Ruiné, vieux et malade, il ne me reste plus qu’à mourir. C’est librement et volontairement que je me donne la mort.
« J’ai volé cinquante mille francs à M. Fritz Kramm et je ne puis survivre à mon déshonneur.
« Jérôme Grivard »
« J’étais atterré. Les caractères de la fatale lettre dansaient devant mes yeux.
« – Que comptez-vous faire, monsieur ? me demanda Fritz Kramm sans me donner le temps de réfléchir, rien ne vous oblige, vous le savez, à reconnaître la dette de votre père !
« – Monsieur, répliquai-je vivement ému, vous serez intégralement remboursé ; seulement, il me faudra du temps, hélas ! Il ne me reste presque rien du produit de ma vente.
« – Je suis charmé de vous voir si bien disposé, reprit-il avec satisfaction, ces sentiments de haute probité vous font le plus grand honneur, je vais vous indiquer comment vous pourrez vous acquitter envers moi. J’ai pu apprécier votre talent, qui est très grand. Un restaurateur de tableaux de votre habileté me serait très utile. Entrez donc chez moi à des appointements raisonnables, dont le chiffre sera réduit chaque année – du moins en partie, car il faut bien aussi que vous viviez – du total de la dette de votre père. Dans quelques années vous serez quitte envers moi.
– Mais à combien se montent ces appointements ? demanda la jeune fille avec émotion.
L’artiste eut un geste de colère.
– À trois mille dollars. Et même en usant de la plus stricte économie, je suis obligé d’en dépenser au moins mille pour ma nourriture et mon entretien.
– De sorte qu’il vous faudra cinq années pour vous libérer entièrement.
– Si encore je devais réellement cette somme, reprit le jeune homme avec une irritation croissante, mais j’ai la conviction que mon père, qui était l’honneur et la probité mêmes, n’a jamais pu voler cinquante mille francs à ce misérable !
– Cela me paraissait, à moi aussi, bien invraisemblable !
– Le lendemain même du jour où j’avais signé à Fritz Kramm une reconnaissance de cinquante mille francs et un contrat en bonne forme me liant pour cinq ans, je reçus de Paris une lettre qui s’était croisée avec moi en chemin et qui venait me joindre à New York d’où elle était partie.
« C’était une lettre de mon père ! Dans quatre pages d’une écriture serrée où se voyaient encore des traces de larmes, le malheureux homme m’expliquait qu’à bout d’énergie et de ressources il se décidait à mourir. Et il insistait sur ce point, qu’il mourait sans devoir un sou à personne et que son fils aurait le droit de respecter sa mémoire comme celle d’un honnête homme !
Louis Grivard ajouta d’une voix mouillée de sanglots :
– Je vous ferai lire un jour cette lettre, chère amie. Mon père y met à nu ses douleurs les plus poignantes et me raconte les suprêmes déboires qui l’ont amené à sa fatale résolution. Mais, en même temps, il me donne les plus nobles conseils. Il me recommande de demeurer plutôt toujours pauvre et inconnu que d’obtenir le succès et la fortune par un moyen déloyal !…’
– Votre père n’a donc pas volé Fritz Kramm ! Que signifie alors cette lettre ? Un faux, sans doute ?
– Non, pas entièrement. À force de réfléchir et de m’informer, je crois être arrivé à découvrir la vérité. Les premières lignes sont bien de mon père, mais Fritz Kramm a dû profiter de ce qu’il y avait un blanc entre le texte et la signature pour y ajouter une phrase imitant habilement l’écriture.
– C’est abominable !
– Fritz Kramm a ainsi trouvé le moyen de se procurer à bon compte un esclave. J’estime à plus de dix mille dollars la somme que mes travaux ont dû lui rapporter pendant l’espace d’une année.
– Il y a là un point obscur, fit Lorenza, réfléchissant. Comment le billet écrit par votre père a-t-il pu tomber entre les mains du marchand de tableaux ? Voilà ce qui me paraît malaisé à expliquer.
– J’ai fini par découvrir de quelle manière. Le médecin appelé pour constater le décès de mon malheureux père n’était autre que le docteur Cornélius, le sculpteur de chair humaine. Il a dû s’emparer à tout hasard du billet que son frère a utilisé quelques jours plus tard, lorsque mon exposition lui a permis de constater que j’étais tout à fait l’homme qu’il lui fallait.
– Vous n’avez jamais fait part de vos découvertes à Mr. Fritz ?
– Mais si. Nous avons eu à ce sujet une très violente explication, mais il m’a soutenu avec un sang-froid glacial que la lettre qu’il avait entre les mains n’était nullement un faux, et il m’a démontré avec une cruelle ironie que personne ne tiendrait compte de ma réclamation, puisque j’avais reconnu implicitement l’authenticité de l’écriture de mon père en signant la reconnaissance de cinquante mille francs.
« Enfin, il ajouta que toute tentative de ma part pour me soustraire au paiement m’exposerait à un procès et à la publication de la lettre dans les journaux français. Je compris que, même si j’obtenais gain de cause, la mémoire de mon père n’en serait pas moins déshonorée et je me soumis !…
– Ce Kramm est décidément un grand misérable !
– Vous ne le connaissez pas encore entièrement. Il y a quelque temps, il est revenu sur sa menace de publier la lettre et il m’a ordonné d’exécuter la copie du portrait de Lucrèce Borgia et de la substituer à l’original. Tel est le scélérat auquel nous avons affaire !
Le beau visage de Lorenza était devenu rose d’indignation. Les ailes de ses narines étaient gonflées par la colère et ses noirs sourcils froncés donnaient à sa physionomie l’expression majestueuse d’une déesse irritée.
– Maintenant, demanda Louis, que me conseillez-vous de faire ?
– Il faudrait rentrer en possession de votre contrat et de la reconnaissance de cinquante mille francs. Je ne vois pas encore, malheureusement, par quel moyen y parvenir.
– Mais pour le tableau ?
– Contentez-vous d’apporter à Kramm la copie que vous avez faite en lui disant que c’est l’original. Croyez-vous qu’il prendra le change ?
– J’en suis sûr. Ma copie est très bonne. De plus, je vais passer une couche de vernis que je laisserai s’écailler au soleil, et le tableau aura tout à fait l’air d’être de l’époque.
« Mais, poursuivit l’artiste avec angoisse, je ne voudrais pas non plus que Mr. Buxton fût volé. Vous le voyez, la situation est inextricable !
– Ne vous découragez pas, je vais réfléchir à tout cela. Ne portez que demain votre copie à Kramm, cela nous fait toujours gagner un peu de temps ; d’ici là, j’aurai trouvé !
Malgré les promesses de sa charmante amie, Louis Grivard demeurait sombre et silencieux. Lorenza mit tout en œuvre pour l’égayer et le consoler.
– Je vois, dit-elle avec son apaisant sourire, que nous ne travaillerons pas encore aujourd’hui à mon portrait.
Et elle montrait, dans le fond de la pièce, un chevalet dissimulé sous une épaisse draperie.
– Je vais m’y mettre, si vous le désirez, fit l’artiste sans enthousiasme.
– Non. Aujourd’hui vous êtes mal disposé. Vous ne feriez que de la mauvaise besogne ; puis, regardez comme vous êtes peu galant, vous n’avez même pas songé à me réclamer le baiser que je vous ai promis.
Louis ne put s’empêcher de sourire.
– Il est toujours temps, s’écria-t-il en jetant ses bras autour de la taille de Lorenza, qui faisait la coquette et se reculait.
Enfin, elle consentit à tendre son front. Mais, par suite d’on ne sait quel faux mouvement, ce fut sur la bouche de Lorenza que les lèvres brûlantes de Louis se posèrent, dans un long et voluptueux baiser.
CHAPITRE V
Un feu de joie
À la suite des confidences de Louis Grivard, Lorenza avait passé une nuit d’insomnie. Mille projets se présentaient à son esprit, mais elle les repoussait l’un après l’autre comme inexécutables.
Les premiers rayons du jour pénétraient déjà par l’interstice des rideaux de velours lilas, doublés de soie orange, qui protégeaient le sommeil de la jeune femme, qu’elle n’avait pas encore fermé l’œil. Son visage avait pâli, ses yeux étaient légèrement cernés par la fatigue, mais elle paraissait satisfaite.
Elle sonna sa bonne, la vieille Graziella, qui lui apporta le chocolat matinal et lui demanda maternellement des nouvelles de sa santé.
– J’ai mal dormi, répondit la jeune femme, mais n’importe, approche de mon lit le petit bureau de citronnier, je veux griffonner un télégramme.
La vieille obéit. Lorenza, se penchant dans une pose mal commode, mais qui eût ravi d’aise un sculpteur, traça quelques lignes d’une écriture fiévreuse et mit sur l’enveloppe l’adresse de Mr. Fritz Kramm, le marchand de tableaux.
– Tu porteras cela à la poste tout de suite, dit-elle à Graziella, mais auparavant tire les rideaux, que je ne sois pas incommodée par le soleil. Il faut que je dorme jusqu’à midi.
La vieille femme s’empressa et, laissant la chambre plongée dans d’épaisses ténèbres, sortit sur la pointe des pieds pour ne revenir qu’à midi.
Lorenza avait bien dormi, et ces quelques heures de repos avaient suffi pour rétablir complètement ses forces. Le collier de grosses perles qui ne la quittait pas, même pendant son sommeil, rayonnait d’un doux éclat. Elle les flatta, distraitement de la main, leur parla comme à des êtres animés.
– Je vois, fit-elle, mes chères petites, à la beauté de votre orient ce matin que mon sommeil m’a été profitable. Je possède tout mon sang-froid et je suis prête à entamer la lutte.
Lorenza se leva, s’habilla et, après avoir pris son bain, déjeuna très légèrement. Elle avait donné rendez-vous à Fritz Kramm pour trois heures de l’après-midi. Elle l’attendit avec un peu d’impatience nerveuse, s’occupant à relever sur un mignon carnet à couverture de nacre les heures de départ des paquebots et des trains qu’elle trouvait dans un volumineux indicateur.
Elle s’interrompit de ce travail pour appeler Graziella.
– Que désire la signora ? demanda la vieille.
– Tu vas m’allumer du feu dans cette cheminée.
– Bien, signora.
– Tu jetteras aussi quelques pastilles de senteur dans le brûle-parfum et tu mettras à rafraîchir dans un seau à glace deux flacons de ce moscato-spumante que j’ai reçu de Florence le mois dernier ; puis tu t’occuperas de faire nos malles.
Et comme la vieille Graziella réprimait mal un geste de surprise :
– Oui, dit la jeune femme, il se peut que nous partions ce soir ou demain pour une assez longue excursion.
« Ah ! j’oubliais ! Il faut faire disparaître cette toile et ce chevalet. Tu les monteras à ma chambre.
Graziella se hâta d’obéir, et bientôt ces divers préparatifs furent terminés. Lorenza s’était étendue sur le divan de cuir de Venise à grandes arabesques d’or, dans une pose adorablement féline. Ses bras nus sortaient des manches d’un large peignoir de soie pourpre, tout brodé de chimères japonaises, et, sous le casque sombre de sa lourde chevelure, ses yeux bleus où passait de temps en temps une lueur étaient profondément pensifs.
Trois heures venaient de sonner lorsque Fritz Kramm, avec une ponctualité toute yankee, se présenta à la porte du cottage. Graziella l’introduisit immédiatement.
Dès le seuil du petit salon, le marchand de tableaux aspira avec délices l’atmosphère subtile et pénétrante qui régnait dans cette pièce ; les cassolettes exhalaient des fumées de bois d’aloès et d’encens, les grands bouquets de fleurs dans les vases se pâmaient dans la tiédeur de l’air et, de Lorenza elle-même, montaient d’alanguissants et capiteux effluves, comme si tout son corps n’eût été qu’une grande fleur de chair plus délicatement embaumée. Fritz eut la sensation de pénétrer dans la caverne enchantée de quelque Circé, son cœur battait au galop, ses mains tremblaient et il comprenait obscurément qu’il ne pourrait rien refuser de ce que lui demanderait cette femme.
Lorenza tout de suite le mit à l’aise par une gaieté, une vivacité de reparties qu’il ne lui avait encore jamais vues.
– Vous m’avez écrit, balbutia-t-il d’une voix tremblante d’émotion ; est-ce que vous seriez décidée à vous montrer moins cruelle ?
Lorenza eut un franc éclat de rire.
– Pas si vite, signor Kramm, murmura-t-elle, votre imagination vous entraîne trop loin.
– Pourquoi donc m’avez-vous fait venir ?
– Le sais-je moi-même ? reprit Lorenza en riant de plus belle. Mettons, si vous voulez, que ce soit parce que je n’avais rien à faire cet après-midi, ou encore parce que je voulais vous faire goûter mon excellent muscat.
– Quoi qu’il en soit, répliqua Fritz très troublé, je vous suis profondément reconnaissant de votre gracieuse invitation !
La jeune Florentine s’était levée ; elle posa elle-même sur un guéridon le plateau et les coupes roses et dorées qui bientôt se couronnèrent de la mousse blonde et pétillante du précieux vin.
– Que trouvez-vous de mon muscat ?
– Il est exquis, signora !
– Toute à votre service ! Ma cave, sans être aussi bien garnie que celle des Fred Jorgell et des William Dorgan, est entièrement à votre disposition !
La conversation se continua quelque temps encore sur un ton de futilité. Fritz enrageait de ce badinage, et ses yeux luisants ne quittaient pas la belle jeune femme dont les moindres mouvements semblaient avoir l’élasticité de ceux d’une panthère.
– Écoutez, signora, dit-il en se levant brusquement, c’en est assez de ces plaisanteries ! Cessez de jouer avec moi comme le chat joue avec la souris !… Vous savez que je vous aime !… que je suis fou de vous !…
– Malheureusement, s’écria la jeune femme dans un éclat de rire qui montra ses dents éblouissantes, c’est une passion que je ne partage pas !
Le visage de Fritz s’était empourpré, ses prunelles luisaient.
– Je ne vous demande pas, supplia-t-il, de m’aimer du jour au lendemain… Mais ayez seulement pour moi un peu de bonté, d’affection, et je vous rendrai la plus heureuse des femmes !…
Il s’était jeté aux genoux de l’Italienne, qui continuait à le regarder avec un sourire moqueur.
– Relevez-vous, dit-elle. Voilà que maintenant vous me faites des déclarations en règle ! Fi donc, c’est abuser de mon hospitalité ! Tenez, asseyez-vous et buvez encore un verre de muscat. On dit en Italie que c’est un vin qui a le goût des baisers !
– Mais, enfin, s’écria Fritz Kramm avec désespoir, que voulez-vous ? que demandez-vous ?… Je vous le donnerai ! Voulez-vous que je vous épouse ?
De la tête et de l’index levés malicieusement, Lorenza fit un signe négatif.
– Désirez-vous quelque bijou, quelque parure ? Parlez ! Exprimez une volonté quelle qu’elle soit, elle sera accomplie !
Fritz était haletant.
Tout son sang-froid l’abandonnait. Il brûlait de fièvre. Machinalement, il but coup sur coup deux coupes de ce vin volcanique qui charriait comme de la flamme dans ses veines.
– Lorenza, bégaya-t-il d’une voix suppliante, Lorenza, sois à moi et je mettrai à tes pieds des monceaux d’or et de bank-notes !
– Voilà qui est beaucoup promettre, répliqua la jeune femme d’un ton de persiflage. Je suis sûre que, si je vous demandais seulement les bank-notes que vous avez dans ce portefeuille que je devine dans la poche intérieure de votre smoking, vous y regarderiez à deux fois !
Fritz eut un cri de triomphe. Ces paroles ne lui indiquaient-elles pas que l’Italienne était une femme vénale comme les autres, qu’elle n’avait fait tant de façons que pour mettre ses faveurs à un taux plus élevé, et qu’elle serait à lui pourvu qu’il y mît le prix ? D’un geste enthousiaste, il avait tiré le portefeuille de sa poche et le tendait à Lorenza.
– Tiens, lui dit-il, prends. Il y a là plusieurs milliers de dollars, ils sont à toi ! Tiens, garde tout, et je t’en promets encore bien davantage !…
Sans cesser de sourire, Lorenza avait pris nonchalamment le portefeuille, l’avait ouvert et, tout en faisant mine de compter les bank-notes qu’elle froissait entre ses doigts, elle regardait d’un œil scrutateur les quelques autres papiers qui se trouvaient avec les billets de banque.
– Pourvu, songeait-elle avec angoisse, que la lettre soit là ! Si ce misérable l’avait serrée dans quelque coffre-fort, tout serait perdu !
Mais son regard fureteur avait discerné un papier couvert de quelques lignes écrites à l’encre violette. D’un coup d’œil elle vérifia la signature : Jérôme Grivard. C’était là sans nul doute la lettre fatale dont lui avait parlé l’artiste.
D’un geste rapide, elle s’en saisit et la fit glisser dans son corsage. Elle s’empara de même de la reconnaissance dont Louis lui avait parlé.
Fritz, lui, était tellement persuadé que Lorenza n’en voulait qu’à ses bank-notes qu’il souriait stupidement en dégustant à petites gorgées une coupe de muscat.
Cependant, Lorenza avait pris deux bank-notes, elle les avait tortillées et, les ayant jetées dans la cheminée, elle s’amusait à les voir brûler.
À cette vue, le bandit sursauta.
– Que fais-tu donc ? demanda-t-il, mais c’est stupide ! Tu brûles des bank-notes, maintenant ?
Lorenza haussa les épaules et, pour toute réponse, jeta tranquillement au feu deux ou trois autres billets de banque.
Il y avait, dans les claires prunelles de la jeune femme, on n’aurait pu dire quoi de haineux et de gouailleur à la fois, qui rendit Fritz Kramm vaguement inquiet.
– Après tout, balbutia-t-il, brûle-les si cela te fait plaisir, je te les ai données !
– J’espère que vous ne les regrettez pas, railla-t-elle, en jetant d’un coup cinq ou six bank-notes dans les flammes.
– Non ! non ! fit-il, elles sont à toi, je t’en promets d’autres ! Mais rends-moi les papiers qui se trouvent avec !… Ce sont des lettres auxquelles je tiens.
– Des lettres de femmes, sans doute, cria-t-elle avec une joie fébrile, je suis jalouse, moi ! Au feu les lettres de femmes, au feu toutes les paperasses !
Continuant à rire, d’un rire nerveux et strident, d’un rire de folie, elle vida entièrement le contenu du portefeuille dans les flammes.
Fritz était devenu blême. Il s’était élancé pour arracher quelques-uns de ces papiers à l’incendie, mais Lorenza, qui feignait toujours de plaisanter, le maintint en respect avec une espèce de torche faite de bank-notes flambantes qu’elle lui approchait du visage.
Déjà il était trop tard, bank-notes et papiers ne formaient plus qu’un grand tas de cendres noires au milieu desquelles couraient des étincelles pareilles à des insectes de feu.
L’antiquaire était abasourdi. Il ne comprenait pas cette conduite bizarre. Il était à cent lieues de soupçonner que Lorenza, dans le cours de sa nuit d’insomnie, avait froidement et minutieusement prémédité ses moindres gestes.
Au moment où elle avait jeté les papiers au feu, il eût voulu l’étrangler, mais, dans le même moment, il la trouvait adorable.
– Vous êtes terrible ! s’écria-t-il avec une mauvaise humeur qu’il essayait de dissimuler. Vous voyez – il n’osait plus la tutoyer – que j’ai supporté sans trop me fâcher la perte de mes billets de banque et de mes papiers.
– Vous n’étiez déjà pas si gracieux tout à l’heure. Si vous m’aimez autant que vous le dites, il faut montrer à mes volontés une soumission absolue et entière !
– J’essayerai, fit-il piteusement, mais ne m’avez-vous pas promis, ajouta-t-il avec humilité, que vous seriez moins cruelle ? J’ai fait ce que vous me demandiez, somme toute.
– Vous y avez mis trop de mauvaise grâce. N’allons pas si vite en besogne. D’ailleurs, je ne vous ai rien promis, je ne suis pas encore assez sûre de votre affection !
Tout en parlant, elle était redevenue calme et souriante.
De nouveau il se sentait sans force devant son sourire ensorceleur.
– Écoutez, dit-elle, j’avoue que j’ai été un peu étourdie. Il faut me pardonner cette gaminerie, je suis très nerveuse. Revenez demain, je vous récompenserai comme vous le méritez, soyez-en sûr, et surtout n’oubliez pas de m’apporter des bank-notes !
Cette phrase avait été calculée assez habilement pour rendre espoir au bandit.
– Pourquoi ne voulez-vous pas que je revienne ce soir ? insista-t-il suppliant.
– Non, pas ce soir, j’ai à sortir. D’ailleurs, il faut que je réfléchisse, je ne suis pas tout à fait décidée.
Entortillé dans toutes sortes de phrases captieuses, Fritz Kramm finit par se retirer, mais en se promettant une éclatante revanche pour le lendemain.
Sitôt que Lorenza eut, de sa fenêtre, vu disparaître, dans le lointain, l’auto qui emportait Fritz Kramm, sa physionomie se détendit et exprima une béatitude et une satisfaction profondes : son visage rayonnait de bonté et de douceur.
– Pauvre Louis, murmura-t-elle, comme il va être heureux !
– Graziella ! appela-t-elle, laisse les malles. Tu les finiras tout à l’heure ; va au plus vite me chercher un taxi-cab.
Pendant que la dévouée Italienne exécutait cet ordre, Lorenza jeta en toute hâte un manteau sur ses épaules et un chapeau sur sa tête.
Quelques minutes plus tard, elle montait en voiture en jetant au chauffeur l’adresse de Balthazar Buxton.
CHAPITRE VI
La main
Fritz Kramm rentra chez lui en toute hâte. Il venait tout à coup de se souvenir qu’il avait donné rendez-vous à Louis Grivard qui devait lui faire livraison du tableau volé chez William Dorgan et que l’heure de ce rendez-vous était passée.
– M. Grivard n’est pas venu ? demanda-t-il au domestique.
– Si, mais il vient de partir. Il a laissé pour vous une caisse que j’ai déposée dans le grand hall.
– Je sais ce que c’est. Ouvrez-la avec précaution. Car elle renferme un tableau que je veux voir avant d’aller le porter moi-même.
Fritz vit ouvrir la caisse plate qui renfermait le portrait de Lucrèce Borgia et il ne put s’empêcher d’être émerveillé de la splendeur du chef-d’œuvre éblouissant de jeunesse sous le sombre vernis craquelé par le temps dont il était recouvert.
Il n’eut pas un instant la pensée que c’était la copie et non l’original qu’il avait devant ses yeux.
– Bon, murmura-t-il, le Français a tenu parole. Il est un peu naïf. Tant qu’il croira que je possède encore la fameuse lettre que Lorenza vient de réduire en cendres, je le tiendrai sous ma coupe ! Il n’est que cinq heures, le vieux Balthazar m’attend à six. J’arriverai encore à temps, malgré le retard que m’a causé ma visite à la gentille sorcière d’Italie.
Comme on le voit, Fritz avait très légèrement pris son parti de l’aventure des lettres brûlées. Il remonta en taxi après avoir fait placer la caisse qui renfermait le portrait à côté de lui sur un coussin.
À peu de distance de l’hôtel de l’amateur, son auto croisa un taxi-cab dans lequel se trouvait une femme qui, à sa vue, se rejeta vivement en arrière.
Il n’avait pas reconnu la signora Lorenza qui, l’instant d’auparavant, sortait de chez Balthazar Buxton.
Il descendit en face du mystérieux palais et il en parcourut le labyrinthe suivant le cérémonial habituel, passant sous des herses, traversant des salles sans fenêtres et d’une bizarre décoration ; enfin, il atteignit la galerie circulaire sur laquelle s’ouvrait la porte à coulisse qui donnait accès dans le hall du vieil amateur et où des hommes armés montaient la garde.
Sa visite étant annoncée, il fut aussitôt introduit. Le petit vieillard squelettique, frileusement entortillé dans sa robe de chambre de velours noir, le reçut avec son affabilité habituelle ; les yeux d’or du maniaque semblaient frétiller de convoitise en examinant la caisse où se trouvait le tableau. Pourtant, Fritz crut s’apercevoir qu’il était plus préoccupé et moins cordial que de coutume.
– Voyons, dit-il avec impatience, cette admirable Lucrèce, ce chef-d’œuvre de son sexe, qui fut aimée de tant de princes, célébrée par tant de poètes, immortalisée par tant d’hommes de génie !
– Vous allez être satisfait, répliqua Fritz qui, à l’aide d’un ciseau qu’il avait apporté, enlevait rapidement les légères planches de peuplier qui constituaient l’emballage du tableau.
– Vous savez, ricana Balthazar Buxton, que vos chèques sont tout préparés. J’en ai là cinq de chacun deux cent mille dollars, payables à la Central Bank.
– Oh ! dit Fritz obséquieusement, on sait que vous êtes solide. Vous êtes le seul milliardaire assez riche pour ne pas même se donner la peine d’augmenter sa fortune.
– C’est que je suis si vieux ! murmura Balthazar en cambrant son torse étique avec une coquetterie macabre qui démentait ses paroles.
Fritz avait tiré le tableau de sa caisse ; il le posa en équilibre sur un bahut, de façon à ce que la lumière tombât d’aplomb sur la toile.
Mme Lucrèce Borgia apparut souriante, toujours jeune, de l’éternelle et vivante jeunesse des chefs-d’œuvre.
Balthazar était devenu grave. Il s’était arrêté à trois pas de la toile et il la considérait silencieusement de ses yeux aigus.
Une longue minute s’écoula. Fritz Kramm, sans savoir pourquoi, se sentait péniblement impressionné. Il souriait toujours de ce sourire obséquieux que l’on a appelé « commercial », mais une crainte vague commençait à l’envahir.
Sans mot dire, Balthazar Buxton rejeta dans un tiroir entrouvert son carnet de chèques, puis il se rassit dans son fauteuil de cuir et n’eut plus un regard pour la Lucrèce.
Fritz n’osait rompre le premier ce silence gros de menaces.
– Monsieur Kramm, dit enfin le vieillard d’un ton sévère, vous êtes un voleur ou un imbécile, choisissez !
– Moi ! balbutia le marchand qui devint livide.
– Oui, si vous m’avez apporté en connaissance de cause cette copie, d’ailleurs assez bonne, pour un original, vous êtes un voleur ! Si, au contraire, vous avez acheté cette toile en la croyant du Titien, vous ne connaissez pas votre métier et vous êtes un imbécile !
C’était la signora Lorenza qui, en quittant Fritz Kramm, était allée prévenir le vieil amateur de la substitution dont il allait devenir victime et, celui-ci, par vanité de connaisseur, avait dissimulé jusqu’au dernier moment, voulant qu’on n’attribuât qu’à sa seule science la découverte du faux.
– Monsieur Kramm, ajouta-t-il en foudroyant l’interpellé d’un regard chargé de mépris, vous me ferez le plaisir d’emporter de chez moi, au plus vite, cette toile et de ne jamais remettre les pieds dans ma demeure !
Fritz sentait la fureur le gagner. Ainsi donc, cette superbe aubaine si patiemment préparée allait lui échapper, il ne toucherait pas le million de dollars qui devait remettre à flot la Main Rouge. C’était trop fort ! Il résolut de payer d’audace.
– Monsieur Buxton, dit-il avec un calme affecté, ce n’est pas ainsi que les affaires s’arrangent. Il se peut que vous soyez un fin connaisseur, mais vous êtes sujet à erreur comme tout le monde. Je ne sais qu’une chose, moi ! Vous m’avez commandé ferme de vous acheter un tableau qui appartenait à Mr. William Dorgan, je l’ai acheté et payé…
– Pas bien cher, je suppose ? interrompit le sarcastique vieillard.
– Cela ne vous regarde pas ! Mais vous m’avez promis un million de dollars, vous me les devez, je les veux ! Je les aurai ! Je suis sûr, moi, que ce tableau est bien du Titien !
– Ou d’un barbouilleur à votre solde.
– Je refuse de remporter mon tableau. Les tribunaux apprécieront ! Le plus piquant, c’est que Fritz était en partie de bonne foi. Il était persuadé que c’était bien l’original de la Lucrèce que Louis Grivard lui avait fait parvenir.
Il ne songeait évidemment pas à faire sérieusement appel aux tribunaux, car il eût été obligé de citer en témoignage William Dorgan, ce qui eût été fortement embarrassant, mais il espérait intimider Balthazar.
Une discussion très vive s’éleva entre eux, et le petit vieillard qui, d’après les ordres de son médecin, devait fuir toute émotion violente ne tarda pas à trouver excessive l’importunité du déloyal marchand.
– Monsieur Kramm, lui dit-il, je ne suis pas si jeune que vous et je ne puis crier aussi fort, mais vous me fatiguez ! Allez-vous-en ! Vous vous adresserez aux tribunaux si cela vous convient ! Emportez ou n’emportez pas votre copie, je m’en moque !…
Ces paroles portèrent à son comble la fureur de Fritz. Il voulut répliquer, mais Balthazar étendit la main vers un bouton électrique pour appeler ses gens et faire jeter dehors l’intrus.
Fritz saisit la main du vieillard au moment où elle effleurait le bouton électrique et d’une poussée, il le rejeta brusquement en arrière en lui disant à l’oreille d’une voix sourde et menaçante :
– On ne me chasse pas comme cela, moi ! Il me faut mon argent ! Donnez-moi les cinq chèques, et tout de suite !…
– Non ! murmura le vieillard avec entêtement, vous êtes un misérable !… Laissez-moi, ou j’appelle au secours !
– Ne fais pas cela ou je t’étrangle !
Joignant le geste à la parole il saisit Balthazar à la gorge entre ses mains aux pouces énormes.
Fritz voyait rouge.
Il sentait que ses mains en cette seconde agissaient pour ainsi dire d’elles-mêmes comme si elles eussent possédé une volonté distincte de la sienne.
Une épouvante atroce se refléta dans les yeux d’or de Balthazar Buxton. Il jeta un cri aigu et frêle, comme un vagissement d’enfant.
Ce fut son dernier cri.
Fritz en proie au démon du meurtre serrait, serrait toujours plus fort ; le cou grêle comme un cou d’oiseau s’aplatissait sous les pouces énormes de l’assassin ; les prunelles d’or chavirèrent et s’éteignirent au fond de leurs orbites ; il y eut un craquement d’os brisés !
Balthazar était mort !
Fritz rejeta en arrière, d’un geste brusque, le cadavre aux yeux révulsés, à la face d’épouvante déjà teinte de sang aux commissures des lèvres ; puis il ouvrit le tiroir, prit le carnet de chèques, l’engloutit dans une de ses poches et, dans un mouvement instinctif de bête traquée, il se rua vers la porte.
Il n’avait pas fait trois pas qu’il s’arrêta net, la face envahie d’une pâleur mortelle.
Il ne s’était plus rappelé que, pour permettre à ses visiteurs de sortir, Balthazar Buxton passait lui-même par un guichet un jeton spécial qui servait de sauf-conduit pour sortir de l’inextricable labyrinthe.
L’assassin n’avait pas songé à cela. Il était pris au piège, bêtement.
On le trouverait enfermé avec le cadavre ! Ah ! certes, il ne fallait pas songer à s’échapper de l’hôtel, où, sans guide, on aurait pu errer un mois entier avant de découvrir une issue !
Le bandit eut un accès de rage froide. Les dents serrées, les yeux injectés de sang, il tournait autour de la luxueuse rotonde, comme un loup pris au traquenard. D’un geste impulsif, il pulvérisa d’un coup de poing une fragile statuette d’albâtre ; plus loin, il creva d’une ruade un tableau.
Comment sortir ? Il fallait pourtant sortir ! Il fallait trouver promptement la bonne idée car on s’inquiéterait de ce long entretien, on viendrait !
Fritz se prit la tête à deux mains ! Il essaya de réfléchir, il se força à raisonner.
Impossible ! Il ne trouvait rien.
Le tic-tac monotone d’une grande horloge d’ébène lui tenaillait le cerveau. Il avait la sensation matérielle de la fuite précipitée, galopante, échevelée des heures, des minutes et des secondes.
Tout à coup ses regards se portèrent sur le cadavre, qui, la tête renversée en arrière, semblait le contempler avec un ricanement vengeur ; et de nouveau, une formidable colère s’empara de lui.
– Non, cria-t-il, ce ne sera pas toi qui triompheras, vieux squelette ! Je n’ai pas peur de toi ! C’est moi qui serai le plus fort !
Fiévreusement il se mit à fouiller dans les poches de la robe de velours, et bientôt il poussa un cri de joie, en découvrant le jeton qui permettait de sortir du labyrinthe.
Mais ce jeton, c’était le vieillard lui-même qui avait l’habitude de le passer par le guichet et la main de Balthazar Buxton était reconnaissable entre toutes, aussi bien à son osseuse maigreur qu’à sa couleur brune et à l’énorme émeraude qu’il portait à l’annulaire. La difficulté demeurait toujours la même.
Fritz essaya d’arracher la bague, mais elle semblait faire partie intégrante des doigts du mort ! D’ailleurs, elle était si étroite que, l’eût-il arrachée, il n’eût pu songer à l’enfiler dans un de ses gros doigts.
Le problème paraissait insoluble, et l’aiguille était là, inflexible, avançant toujours sur le cadran !
L’heure du lunch de Balthazar Buxton était arrivée. On viendrait, on allait venir d’une minute à l’autre peut-être.
Dans la surexcitation du péril ou de l’angoisse, l’assassin eut une inspiration désespérée et macabre.
Il tâta le cadavre. Il était encore chaud, tiède plutôt, mais ce n’était pas encore le froid glacial des morts.
Eh bien, oui, ce serait Balthazar Buxton lui-même qui tendrait à travers le guichet le jeton libérateur ! C’était là le seul moyen, il n’y en avait pas d’autre ! Et encore fallait-il se hâter !
Il empoigna ce petit cadavre léger comme une plume, il le rapprocha du guichet, donnant à la main, encore souple, la forme qu’il fallait, engageant – à peine – entre les deux doigts le jeton pour qu’il tombât facilement, et, en proie à une angoisse atroce, il se cacha derrière le cadavre qu’il soutenait sous les aisselles d’une main ; de l’autre main il tenait le poignet du mort, tout prêt à le pousser d’un coup sec, assez rapide pour que le jeton tombât.
Fritz avait frappé au guichet en imitant de son mieux Mr. Balthazar Buxton, dont il avait maintes fois observé les allures et la façon de procéder en pareille circonstance.
Par la plus inconcevable chance, ce stratagème, qui confinait de près aux imaginations maladives de la folie, eut un succès complet.
Le gardien vit d’un coup d’œil distrait la main squelettique pousser le jeton et se retirer précipitamment. Il ne songea même pas à regarder par le guichet qui se referma aussitôt.
Les gardiens du couloir circulaire avaient vu tant de fois ce même geste machinal qu’ils n’y prêtaient plus aucune attention.
L’instant d’après, la porte à coulisse s’ouvrait, et Fritz Kramm, guidé par un des hommes, arrivait sans encombre jusqu’à l’auto qui l’attendait.
Il n’avait eu garde d’oublier les cinq chèques de chacun deux cent mille dollars, payables à la caisse de la Central Bank.
CHAPITRE VII
Déception
Fritz Kramm songea d’abord à quitter New York au plus vite. Il lui semblait voir déjà son hôtel cerné par les policemen.
Mais, en y réfléchissant, il se dit qu’après tout, les domestiques de Balthazar Buxton ne connaissant pas son nom, il y avait grande chance pour qu’il ne fût pas découvert. Ne pourrait-il d’ailleurs soutenir qu’il était innocent. Balthazar lui-même lui ayant donné de sa main – les gardiens du couloir pourraient en témoigner – l’exeat nécessaire !
Un peu rassuré, il se rendit chez Cornélius, qu’il mit au courant des faits, sans omettre la plus légère circonstance. Le « sculpteur de chair humaine » pensa lui aussi que le péril n’était pas urgent et, plus audacieux encore que son frère, il alla jusqu’à envisager la possibilité de toucher les chèques ; après une longue conversation, ils résolurent de ne rien faire jusqu’au lendemain. Leur décision dépendrait de la tournure que prendraient les événements.
Fritz venait de se réveiller, après une nuit des plus agitées, lorsque Cornélius entra dans sa chambre ; il tenait à la main une feuille du matin.
– Tout s’arrange, déclara-t-il avec satisfaction, le feu a pris chez Balthazar, dont on a retrouvé le cadavre carbonisé. Tableaux et objets d’art sont en cendres, et la plupart des serviteurs ont été asphyxiés en essayant de s’échapper du labyrinthe.
– Comment expliquer cela ? murmura Fritz avec stupeur. C’est à croire vraiment qu’une Providence diabolique nous protège.
– Rien n’est plus simple. Afin d’être mieux servi, de ne donner à ses gens aucune raison de souhaiter sa mort, Balthazar – il me l’a raconté lui-même – leur donnait des gages très élevés, qu’il doublait encore chaque année, mais il ne devait rien leur laisser par testament ; de cette façon ils avaient intérêt à ce qu’il vécût le plus longtemps possible.
– Je comprends qu’ils aient dû être furieux en trouvant son cadavre.
– Non seulement cela, mais ils ont dû avoir peur d’être soupçonnés, et ils ont risqué le tout pour le tout. Il est évident pour moi qu’ils n’ont dû allumer l’incendie qu’après avoir fait main basse sur ce qu’il avait de plus précieux.
– Mais ceux qui ont été asphyxiés ?
– C’était ceux qui n’étaient pas du complot ; les autres ont mis leur butin en sûreté, cela ne fait pas l’ombre d’un doute.
– Et le portrait de Lucrèce Borgia ?
– Brûlé, anéanti…
– Tout va bien, s’écria Fritz gaiement, nous allons pouvoir toucher nos chèques.
– Et cela d’autant plus aisément que Balthazar a dû aviser la banque du versement important qu’elle aurait à effectuer.
Les deux bandits se séparèrent, enchantés de la tournure inespérée qu’avaient prise les événements. Fritz Kramm déjeuna de bon appétit ; débarrassé de toutes préoccupations, il ne songea plus qu’à se rendre chez la belle Lorenza qui, sans doute, allait cette fois se montrer moins farouche.
Avenue de Broadway, une déception l’attendait. Le cottage de la guérisseuse de perles était désert, les volets hermétiquement clos et un écriteau, house to let (maison à louer), se balançait au-dessus de la grille.
Les voisins, interrogés, racontèrent que l’Italienne et sa bonne étaient parties avec de nombreux bagages la veille au soir pour une destination inconnue.
Furieux et décontenancé de ce qu’il appelait une trahison, Fritz remonta en auto et jeta au cocher l’adresse de Louis Grivard. C’était l’artiste qui allait essuyer sa colère et qui serait obligé de donner des explications sur le faux tableau du Titien ; n’était-ce pas en somme ce misérable barbouilleur qui était la cause de la mort de Balthazar ?
Mais chez Louis Grivard, comme chez Lorenza, Fritz Kramm trouva porte close et visage de bois.
– Une jeune dame brune d’une beauté admirable est venue le chercher en auto, hier soir, à la tombée de la nuit, expliqua la concierge.
– Vous ne savez pas où ils sont allés ?
– M. Louis, à ce qu’il semble, a donné au chauffeur l’adresse de la gare maritime des transatlantiques.
Fritz remonta en voiture sans prononcer une parole. Il avait compris qu’il était joué, mais il possédait un étonnant empire sur lui-même ; maintenant toute sa colère était tombée ; ce fut d’un ton parfaitement calme qu’il jeta à son chauffeur l’adresse de Cornélius.
Laissant de côté toute autre préoccupation, les deux bandits devaient partir pour San Francisco le lendemain, pour veiller en personne à l’exécution du plan qui devait amener la perte du yacht la Revanche et de tous ses passagers.
ONZIÈME ÉPISODE
Cœur de gitane
CHAPITRE PREMIER
T. S. F.
Dix heures du soir venaient de sonner à peine distinctes dans l’épais brouillard qui ensevelissait, comme d’un linceul d’ouate grise, les docks, les édifices et les navires du port de Vancouver.
La ville déjà livrée au sommeil, les quais déserts étaient plongés dans le silence.
C’est à travers la solitude des rues où, dans l’épaisseur de la brume, il était à peine possible de reconnaître son chemin qu’une dizaine d’hommes se hâtaient, s’arrêtant de temps à autre pour déchiffrer les inscriptions placées à l’angle de chaque voie et difficilement lisibles sous le halo bleuâtre des becs électriques.
Ces étranges promeneurs étaient tous uniformément vêtus de cabans de gros drap et chacun d’eux portait à la main une valise. C’étaient assurément des voyageurs, mais si quelque curieux se fût avisé de les espionner, il eût été fort surpris de voir qu’ils tournaient le dos à l’importante gare du Canadian Pacific Railroad et qu’ils s’éloignaient des quais où sont amarrés les paquebots en partance pour le Klondike, le Japon et les Grandes Indes.
Bientôt, ils laissèrent derrière eux les dernières maisons de la ville dont les lumières n’étaient plus qu’une tache blafarde dans les ténèbres humides, et ils longèrent la côte basse et sablonneuse où soufflait un vent glacial et où venaient déferler les lames du Pacifique.
Jusqu’alors ils avaient marché sans prononcer une parole ; mais, arrivés devant un bouquet de sureaux et de saules nains qui semblait leur servir de point de repère, ils firent halte et se réunirent en cercle pour tenir conseil.
– Je me demande un peu où l’on va nous emmener, murmurait un homme d’une colossale stature, un véritable géant, à un maigre personnage sur l’épaule duquel il s’appuyait familièrement.
– Je n’en sais rien, mon brave Goliath, répondit l’autre, mais tout cela me semble, en effet, assez mystérieux !
– Qu’est-ce que cela peut faire ? dit un troisième, puisque nous sommes payés d’avance.
– D’ailleurs, interrompit une jeune fille à la voix grêle et perçante, c’est notre ami Oscar Tournesol, le sympathique bossu, qui nous a engagés dans cette affaire et il est incapable de nous jouer un mauvais tour.
– Possible, grommela le géant Goliath, mais il fait un froid de chien et, avec cette brume, du diable si nous sommes capables d’apercevoir le signal !
– Heu ! heu ! toussota une voix plaintive, je boirais bien un verre de gin pour me réchauffer ! Tu aurais dû emporter une gourde de voyage, ma petite Régine.
– Vous boirez tout à l’heure, Mr. Sleary, un peu de patience !
– Le signal, cria tout à coup Goliath ; et, de sa main énorme, il montrait, dans la nuit livide, une tache lumineuse qui semblait grandir en se rapprochant.
Aussitôt, Mr. Sleary tira de sa poche une lanterne électrique dont il fit jouer le commutateur. Une vive lumière éclaira la grève déserte et la vague écumeuse et grise.
Deux minutes s’écoulèrent, puis le signal ayant sans doute été aperçu, la lumière lointaine disparut brusquement et aussitôt Mr. Sleary éteignit lui-même sa lanterne.
Dix minutes plus tard, le bruit cadencé des avirons se faisait entendre et une yole, montée par quatre rameurs, venait s’échouer doucement sur le sable ; au gouvernail était assis un personnage chétif, légèrement bossu qui, tout de suite, sauta à terre et mettant un doigt sur ses lèvres :
– Pas de bruit, fit-il, que tout le monde embarque dans le plus grand silence ! Il est très important que personne ne vous voie et qu’aucun policeman, aucun douanier ne s’avise de vous demander où vous allez !
Tous parurent comprendre la valeur de cette recommandation et ce fut sans prononcer un mot que la petite troupe prit place sur les bancs de la yole. Régine s’était assise aux côtés du bossu et se serrait frileusement contre lui.
Tout le monde étant embarqué, les rameurs se courbèrent sur leurs avirons et la légère embarcation, si chargée qu’elle enfonçait presque jusqu’au bordage, fila entre les hautes vagues.
Fouillant les ténèbres de ses prunelles aiguës, le petit bossu corrigeait de temps en temps la direction d’un coup de barre, guidé à travers le brouillard par les appels stridents d’une sirène à vapeur.
À mesure qu’on s’éloignait du rivage, les vagues devenaient plus hautes et, de temps en temps, déferlaient sur la yole et couvraient ses passagers d’un nuage d’écume. Le bossu voyait grelotter Régine à côté de lui. Enfin, la masse sombre d’un navire à la mâture élancée se profila dans la nuit ; la yole accosta par la hanche de tribord, un escalier mobile fut jeté et bientôt les passagers montèrent un à un sur le pont du navire.
Un personnage luxueusement vêtu d’une pelisse de renard bleu et coiffé d’un bonnet de la même fourrure accueillit les nouveaux venus et les fit entrer dans un confortable salon meublé d’un divan circulaire et d’une vaste table de roulis où se trouvaient disposés tous les éléments d’une collation.
– Messieurs, dit-il quand chacun eut pris place, permettez-moi de vous faire les honneurs du yacht l’Ariel, qui doit nous conduire à notre destination. Pendant que vous prendrez un grog bien chaud, ce qui n’est pas une précaution inutile par ce terrible brouillard, je vous expliquerai le but d’un voyage qui doit vous sembler à tous quelque peu mystérieux !
– Heu ! heu ! milord, dit Mr. Sleary, je crois, en effet, qu’un grog bien chaud est une précaution indispensable, heu ! heu ! Mais nous vous écoutons, milord !
Le gentleman au bonnet de fourrure se débarrassa de sa pelisse, choisit dans une boîte un cigare de La Havane bien sec qu’il alluma tranquillement, puis, au milieu d’un silence attentif il commença en ces termes :
– Je me nomme, comme vous le savez, lord Astor Burydan, et ma principale occupation est de dépenser, de la façon la plus intéressante qu’il soit possible, l’immense fortune que je possède. Je n’ai jamais reculé devant aucune excentricité pourvu qu’elle soit amusante, et c’est sans doute ce qui m’a valu, aussi bien en Amérique que sur le vieux continent, le populaire surnom de milord Bamboche.
Et lord Burydan, avec une grande clarté d’expressions et un grand luxe de détails, raconta comment il avait fait naufrage dans une île inconnue qui servait de repaire aux tramps et qu’ils appelaient entre eux l’île des pendus. Là on l’avait gardé captif de longs mois, ainsi qu’un vieux savant français, le célèbre Prosper Bondonnat et un brave Peau-Rouge nommé Kloum.
L’excentrique et Kloum avaient réussi à s’évader dans un aéronef, construit d’après les données de M. Bondonnat, mais le vieux savant était demeuré prisonnier des bandits.
– Vous devez comprendre, conclut lord Burydan après un long récit de ses aventures, que, désormais, je n’ai et ne puis avoir qu’un but : délivrer M. Bondonnat, exterminer les habitants de l’île des pendus. C’est pour atteindre ce but que j’ai fait construire dans le plus grand secret ce yacht, l’Ariel, à bord duquel nous nous trouvons. Il est monté par quatre-vingts hommes d’équipage et formidablement armé.
Les assistants avaient suivi avec un vif intérêt le récit du noble lord, ils commençaient à entrevoir la vérité.
– Mes amis, continua-t-il, lorsque, à San Francisco, je vous ai dit que j’avais le caprice d’être imprésario, je vous ai trompés ! La vérité est que j’ai eu l’idée d’utiliser vos talents d’acrobates pour faire le siège de la capitale de la Main Rouge. C’est à vous de me dire maintenant si cette entreprise vous convient ! Ceux auxquels il répugnerait de m’accompagner n’ont qu’à le dire. Ils vont être immédiatement reconduits à Vancouver après avoir, bien entendu, comme cela est légitime, touché l’indemnité convenue. Que ceux qui veulent rester en Amérique lèvent la main !
Personne ne bougea.
– Milord, dit le géant Goliath prenant la parole au nom de tous, personne ne veut vous quitter, vous avez été notre bienfaiteur, nous sommes prêts à vous suivre partout où il vous plaira de nous conduire. Et s’il y a des dangers à courir, tant mieux ! Nous sommes des artistes et nous aimons les entreprises nobles et aventureuses !
Un sourire de satisfaction s’esquissa sur la physionomie de l’excentrique. Il se préparait à répondre, mais le petit bossu ne lui en laissa pas le temps.
– Mes chers camarades, s’écria-t-il, je n’en attendais pas moins de votre courage ! Vous soutenez l’antique renommée du Gorill-Club dont nous sommes tous fiers de faire partie. Avec votre collaboration précieuse, nous sommes sûrs de triompher ! Et, interpellant tour à tour chacun des artistes, il ajouta :
– Il faudra que la garnison de l’île des pendus soit vraiment forte, vraiment rusée, pour résister à une armée qui va compter dans ses rangs Goliath, l’homme le plus fort de l’univers, qui brise d’un seul coup des chaînes d’acier comme si ce n’étaient que des fils d’étoupe ; Goliath dont les biceps ont un mètre de tour ! Goliath qui, les jarrets suspendus à un trapèze, enlève avec les dents un cheval et son cavalier.…
« Fulgaras, l’acrobate salamandre, la torche humaine, aussi à l’aise au milieu des flammes que si c’était son élément naturel !…
« Bob Horvett, le nageur émérite, surnommé le Triton moderne !…
« Romulus, l’obus vivant, qui se fait charger dans un canon et, projeté dans les airs par l’explosion, saisit au vol un trapèze !…
« Nos camarades Makoko et Kambo, aussi robustes et aussi agiles que les gorilles et les orangs-outangs dont ils empruntent le costume !… »
Le bossu fut plusieurs fois interrompu par des applaudissements frénétiques et des toasts portés en l’honneur de milord Bamboche. Mais, pareil au héros du vieil Homère, il tenait à faire une complète énumération des paladins du Gorill-Club.
– Comment, continua-t-il, la Main Rouge résisterait-elle à la dextérité de notre ami Matalobos, le fameux prestidigitateur, qui mettrait dans sa manche, s’il lui en prenait envie, un cheval et son cavalier, une locomotive ou un troupeau de moutons ?… Au Chinois Yan-Kaï, le tireur au coup d’œil infaillible ? Au clown Robertson, aux jarrets d’acier, aux muscles de caoutchouc, capable de franchir d’un seul bond les fossés et les ponts-levis ?
Oscar Tournesol présenta de la même façon élogieuse le clown Bombridge, professeur d’acrobatie, le maître et l’exemple de toute cette lignée d’artistes et le manager Mr. Sleary, le fondateur du Gorill-Club et le directeur de la troupe.
À ce moment, les acrobates s’aperçurent que le yacht était agité d’un violent mouvement de roulis et de tangage et que la trépidation des machines augmentait.
Lord Burydan eut un sourire.
– Oui, mes amis, dit-il, l’Ariel est déjà en route vers l’île des pendus. Pendant que vous écoutiez Oscar, j’ai crié un ordre au mécanicien par le tube acoustique. On a, pour gagner du temps, coupé les amarres et dans trois quarts d’heure nous aurons perdu de vue la côte américaine.
« J’avais mes raisons pour que notre départ s’opérât dans le plus grand mystère ! J’ai fait annoncer dans les journaux que je me rendais en Angleterre ; j’ai même fait prendre un billet en mon nom sur un paquebot de New York. Enfin, depuis huit jours, personne ne m’a vu. Je pense, grâce à toutes ces précautions, avoir échappé aux espions de la Main Rouge. Il était de la plus haute importance qu’ils ne connaissent pas notre départ. Maintenant, je suis sûr de les avoir dépistés !
– D’ailleurs, reprit Oscar, nous ne sommes pas seuls à tenter cette expédition ! C’est demain, vendredi 13 janvier, que part de San Francisco un yacht plus puissant et mieux armé que celui-ci, la Revanche. Il est équipé par les soins du milliardaire Fred Jorgell et doit rester, grâce à la télégraphie sans fil, en constante communication avec nous. Vous voyez que, dans ces conditions, les risques sont de beaucoup diminués et le succès certain.
– Vous comprenez, maintenant, reprit lord Burydan, la raison qui m’a empêché d’emmener avec nous les dames du Gorill-Club, miss Winy, l’équilibriste, la belle Nudita et les charmantes écuyères Olga et Isabelle…
Lord Burydan s’était interrompu et son visage exprimait un certain mécontentement ; il venait d’apercevoir la blonde Régine Bombridge qui, jusqu’alors, s’était dissimulée derrière la vaste carrure du géant Goliath.
– Je vois, dit l’excentrique, qu’une de ces dames a trouvé bon de passer outre et de s’embarquer en fraude !
Miss Bombridge s’était levée toute confuse.
– Milord, murmura-t-elle d’une voix émue, j’espère que vous voudrez bien me pardonner cette supercherie, mais je n’ai pas voulu me séparer de mon père. D’ailleurs, je passe pour une écuyère habile et je pourrai, j’espère, vous rendre des services. Enfin, si je ne suis bonne qu’à cela, je remplirai les fonctions d’infirmière. Ce sera moi la Croix-Rouge et je soignerai les blessés.
– Espérons qu’il n’y en aura pas, dit lord Burydan qui avait fini par prendre son parti de la présence de la jeune fille à bord.
– Puis, ajouta le bossu avec vivacité, il serait bien difficile de renvoyer mademoiselle, maintenant que l’Ariel est en marche.
Lord Burydan acquiesça de bonne grâce.
Aux regards qu’échangeaient le bossu et la petite écuyère, il avait compris qu’Oscar n’était pas étranger à la supercherie qui avait permis à la jeune fille de se glisser parmi les membres de l’expédition.
À ce moment, un grand barbet noir aux poils frisés vint se jeter impétueusement sur les genoux d’Oscar et le couvrit de caresses.
– À bas, Pistolet, dit lord Burydan, en caressant le fidèle animal, va plutôt me chercher Kloum !
– Oui, ajouta Oscar en regardant le chien d’une certaine façon, va trouver Kloum et dis-lui de venir !
Pistolet s’élança, rapide comme une flèche, et revint bientôt suivi du Peau-Rouge, impassible et grave à son ordinaire.
– Kloum, dit lord Burydan, comme il n’est pas loin de minuit, je pense que ces messieurs seraient peut-être bien aises d’aller se reposer. Veux-tu, s’il te plaît, les conduire à leurs cabines !
Cette proposition fut accueillie avec joie, car tous étaient plus ou moins fatigués. Les uns après les autres, les acrobates prirent congé du lord excentrique. Bientôt tout le monde dormit sur l’Ariel, et l’on n’entendit sur le pont du yacht que le pas monotone des hommes de quart et la trépidation des machines mêlés aux sifflements de la bise et au grincement mélancolique des cordages sur leurs poulies.
La nuit s’écoula sans incident. Le lendemain, en montant sur le pont, lord Burydan trouva tous ses passagers acrobates déjà levés et s’amusant des ébats d’une troupe de marsouins qui suivaient le navire en faisant la roue ; le brouillard était moins épais que la veille, l’Ariel faisait route sur une mer grise, sous un ciel pâle, qui semblaient présager quelque averse de neige. D’ailleurs le froid n’était pas excessif. En somme, c’était un temps excellent pour une navigation paisible.
Lord Burydan présida lui-même le repas pris en commun dans la salle à manger du bord et il en profita pour expliquer divers plans d’attaque qu’il avait formés, et pour montrer à ses alliés une carte de l’île des pendus, dressée de souvenir, et qui devait être à peu près exacte.
Acrobates et clowns montraient d’ailleurs un excellent appétit et s’accommodaient parfaitement du régime du lord. Personne ne s’était encore plaint du mal de mer, pas même la délicate miss Bombridge.
La jeune fille ne quittait guère Oscar Tournesol, qui se faisait un plaisir de lui expliquer l’usage de tous les objets du navire ; entre le bossu et l’écuyère, il s’était établi une de ces sympathies instinctives, qui sont souvent le prélude d’une affection plus sérieuse.
D’un tempérament très sentimental, la blonde écuyère avait été profondément touchée des attentions du bossu, et elle ressentait une grande pitié pour ce pauvre être disgracié de la nature, pour lequel les autres femmes du Gorill-Club n’avaient eu jusqu’ici que des sourires méprisants.
Dans l’après-midi, ils étaient entrés tous deux dans le poste de télégraphie sans fil, installé près de la dunette, et Oscar avait de son mieux démontré le fonctionnement de l’appareil, puis peu à peu la conversation avait pris un autre tour.
– Hélas ! soupira le bossu, j’ignorerai sans doute toujours ce que c’est que l’affection d’une femme adorée ! Je ne saurai jamais ce que c’est que la tendresse et les câlineries d’une compagne. Quelle est la jeune fille qui voudrait unir son sort à celui d’un misérable bossu ?
– Ne parlez pas ainsi, murmura Régine profondément émue, vous me faites de la peine !
– Je suis laid, chétif, contrefait ! Tout le monde se moque de moi et personne ne m’aime…
– Voilà qui est faux, par exemple, répliqua vivement la jeune fille, vous êtes adoré de tous vos camarades… Par exemple croyez-vous que moi je ne vous aime pas ?
– Oui, je sais, soupira le pauvre Oscar, vous m’aimez comme une amie, comme une sœur, mais pas comme je le voudrais.
– Je vous assure, mon cher Oscar, que je vous trouve beaucoup de qualités et que j’ai pour vous une réelle affection !
Régine en prononçant cette phrase, quelque peu ambiguë, était devenue rouge comme une cerise.
– Régine, murmura le jeune homme avec amertume, vous ne me comprenez pas. Vous avez beaucoup d’amitié pour moi, mais jamais vous ne consentiriez à m’accorder votre main.
– Qui sait ! murmura la jeune écuyère d’une voix presque imperceptible.
Tous deux se regardèrent en silence. Oscar avait pris doucement la petite main de Régine dans les siennes et la jeune fille n’eut pas le courage de la retirer.
Mais, à ce moment, le timbre d’appel de l’appareil de télégraphie sans fil se mit à résonner. Oscar et Régine se levèrent précipitamment, comme deux écoliers pris en faute, et se hâtèrent de sortir de la cabine pour aller prévenir lord Burydan.
L’excentrique accourut en hâte et se rendit à l’appareil, dont il connaissait parfaitement le maniement.
Quelques minutes après, il revenait avec une dépêche rassurante que Fred Jorgell et Harry Dorgan venaient de lui expédier de San Francisco.
Le yacht la Revanche avait pris la mer dans d’excellentes conditions et, avant son départ, les ingénieurs qui le montaient en avaient soigneusement vérifié la machinerie, les agrès et la coque. Enfin l’équipage, très bien discipliné, paraissait animé de bonnes intentions. Suivant un plan concerté d’avance, on avait répandu le bruit que c’est vers le sud que se dirigeait le yacht ; de cette façon l’on avait quelques chances sérieuses d’éviter les complots des bandits de la Main Rouge.
Lord Burydan s’empressa de répondre à ce marconigramme, en rendant compte à ses amis de la situation de l’Ariel. Il leur rappela qu’ainsi qu’il avait été convenu longtemps à l’avance il entrerait le lendemain en communication avec le poste sans fil installé à bord de la Revanche, et que, cette communication une fois établie, les deux yachts échangeraient des nouvelles d’heure en heure, jusqu’à ce qu’ils eussent opéré leur jonction, qui devait avoir lieu à un point du Pacifique, exactement déterminé à l’avance, à une dizaine de lieues marines de l’île des pendus.
– Pourquoi donc, demanda Oscar, n’est-ce pas aujourd’hui même que vous télégraphiez à nos amis de la Revanche ?
– J’ai pour cela une raison excellente. En attendant que la Revanche soit beaucoup plus rapprochée de l’Ariel, je diminue le risque de voir nos messages interceptés par un des postes installés sur la côte et par suite transmis à la Main Rouge. Il est convenu, toujours pour la même raison, que je ne communiquerai de nouveau avec San Francisco qu’en cas d’absolue nécessité.
– S’il en est ainsi, il eût été même plus prudent de ne pas communiquer aujourd’hui.
– C’est juste. Mais avouez que nous aurions bien de la malchance si notre premier message, qui sera peut-être le seul, tombait entre les mains des chefs de la Main Rouge.
Oscar et lord Burydan discutaient encore cette question en se promenant à pas lents sur le tillac, lorsque la sonnerie du récepteur retentit de nouveau dans la cabine.
Lord Burydan s’élança, vaguement inquiet de ce nouvel appel. Il resta plus d’une demi-heure enfermé dans la cabine. Quand il en ressortit, il était très pâle.
– Que se passe-t-il donc ? demanda Oscar anxieusement.
– Quelque chose de terrible ! La Main Rouge est déjà au courant de nos projets.
– Mais c’est impossible ! Comment pouvez-vous le savoir ?
– Je viens d’intercepter un message, ou plutôt un fragment de message, adressé d’une des stations de la côte à l’île des pendus. Vous savez que, quand les ondes lancées d’un poste rencontrent en chemin un autre appareil que celui auquel elles sont adressées, il est très facile à l’opérateur qui se tient à l’appareil intermédiaire de happer, pour ainsi dire au vol, le message transmis, et cela sans que les correspondants placés aux deux bouts de la ligne puissent s’en apercevoir. C’est ce que j’ai fait.
– Eh bien ?…
– Voici la phrase, l’unique phrase malheureusement, que j’ai pu surprendre :
… Mettre tous forts en état de défense… doubler les sentinelles… faire rondes fréquentes… visiter les torpilles… l’île des pendus peut être attaquée…
– Que concluez-vous de là ? dit Oscar.
– Cela est malheureusement trop clair ! Les espions de la Main Rouge sont au courant de nos intentions. Au lieu de surprendre la garnison de l’île des pendus, nous la trouverons sur le qui-vive !
– C’est impossible qu’ils soient si bien informés !
– Les faits sont là ! Et je m’explique même qu’ils aient pu deviner notre secret.
– Je ne vois pas comment ?
– Je le vois, moi. Je suis d’autant plus furieux que c’est de ma faute ! N’ai-je pas eu la sottise, lors de mon dernier voyage à New York, d’aller prévenir Steffel, le chef de la police, et de lui donner la latitude et la longitude exactes de l’île !
– Ce n’est pas lui qui a pu vous trahir. Il a d’ailleurs, été victime d’un accident, le jour même de votre visite.
Lord Burydan réfléchit.
– Qui sait, fit-il, si ce n’est pas précisément parce qu’il en savait trop long qu’on l’a fait disparaître. Pour moi, il est évident que c’est Steffel qui nous a trahis ! Tout le monde sait, à New York, que les hauts fonctionnaires de l’administration sont loin d’être incorruptibles !
– Ne seriez-vous pas d’avis, dit le bossu, de prévenir immédiatement Messrs. Fred Jorgell et Harry Dorgan ?
– Non, votre idée ne vaut rien ! Mon message serait certainement intercepté, comme l’a peut-être été déjà celui que je viens d’envoyer. Ah ! je suis furieux d’avoir été assez naïf pour m’adresser au policier !
À ce moment-là, la cloche du dîner se fit entendre.
– Surtout, dit lord Burydan en se dirigeant avec Oscar vers la salle à manger, pas un mot de tout ceci à nos braves acrobates ! Ce serait les décourager inutilement !
– Soyez tranquille, milord, je serai discret !
Chacun prit place autour de la table, servie avec autant de luxe que d’abondance, mais les acrobates remarquèrent que lord Burydan paraissait moins gai que de coutume. Le repas se ressentit de ses préoccupations et l’on se sépara de meilleure heure que la veille.
Lord Burydan passa une nuit très agitée ; levé un des premiers, il se rendit aussitôt à la cabine télégraphique pour se mettre en communication avec ses amis de la Revanche, mais, à sa grande surprise, il n’obtint aucune réponse.
Après deux heures d’efforts inutiles, il dut y renoncer. En dépit de la beauté du temps et de la puissance des ondes émises, la Revanche ne donnait pas signe de vie.
CHAPITRE II
Le courrier
Une grande auto stoppa brusquement à l’angle de California et de Montgomery street à San Francisco. Trois gentlemen, mis avec la plus grande élégance, en descendirent et pénétrèrent dans l’imposant édifice qui s’élève à l’angle des deux rues et qui porte, en gigantesques lettres d’or, cette inscription : California Safe Deposit and Trust Company[6].
Ce bâtiment, dont les murs ont cinq mètres d’épaisseur et sont bâtis avec de grosses pierres de taille reliées par des ancres de fer, n’a que de rares fenêtres, grillées d’énormes barreaux d’acier.
Les trois gentlemen pénétrèrent dans un grand hall, décoré des statues de Crésus et de Plutus, qui faisaient pendants à celles de deux milliardaires californiens, Messrs. Stanford et Fload. Ils suivirent un couloir à la voûte et aux murs d’acier, au bout duquel se trouvait un bureau, protégé par un grillage solide.
Le premier des gentlemen s’approcha du guichet et dit à l’employé, en lui tendant une carte d’identité :
– Mr. le docteur Cornélius Kramm, de New York.
– Well, sir ! répondit l’homme en tendant par le guichet un jeton de nickel perforé de trois numéros disposés en triangle.
Le second gentleman s’avança alors.
– Mr. Fritz Kramm, de New York, dit-il.
Et comme le premier, il reçut un jeton de nickel.
Puis ce fut au tour du troisième, qui déclara se nommer Mr. Joë Dorgan, de New York.
Tous trois se trouvèrent dans un large corridor, dont le sol, la voûte et les parois étaient également en acier, et qui était coupé par trois grilles, près de chacune desquelles se tenait un employé, qui vérifia et pointa soigneusement chacun des numéros des jetons de nickel ; après ces formalités, qui rappelaient à Fritz Kramm, quoique d’une façon moins originale, le palais-labyrinthe de Balthazar Buxton, les trois hommes furent admis à descendre le gigantesque escalier qui conduisait aux caves de la banque et deux employés, armés d’un trousseau de clefs, se mirent à leur disposition.
Les caves monumentales sont entièrement construites en fer et en acier, mais elles sont décorées de statues de chevaliers du Moyen Âge, aux armures dorées, casque en tête et bouclier au poing.
À côté de ces guerriers de bronze, vingt policemen athlétiques, armés jusqu’aux dents, montent nuit et jour la garde dans le couloir extérieur et sont relevés d’heure en heure.
Les trois gentlemen s’étaient arrêtés en face de leurs coffres-forts respectifs, qui se trouvaient placés l’un à côté de l’autre.
Après avoir ouvert les serrures, les employés se retirèrent, laissant le docteur Cornélius et ses deux compagnons libres de remplir ou de vider leurs coffres-forts.
– Combien avons-nous en caisse ? demanda Cornélius.
– Chacun trois cent mille dollars environ, répondit Fritz, mais nous n’avions ici, bien entendu, que les sommes provenues de l’affaire Balthazar Buxton. Il est prudent de ne pas mettre tous nos capitaux dans la même banque. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
– Vous parlez d’or, fit le troisième personnage avec impatience, mais vous savez qu’aujourd’hui nous sommes pressés. De combien avons-nous besoin ?
– Je crois, mon cher Baruch, ou plutôt mon cher Joë, répondit le docteur avec un ricanement, que trente mille seront suffisants, prenons-en donc dix mille chacun.
Les trois associés comptèrent chacun une liasse de bank-notes, qu’ils glissèrent dans leur portefeuille. Dix minutes plus tard, ils remontaient en auto et se faisaient conduire au Palace-Hotel, où ils dînèrent rapidement dans un salon spécial, retenu pour eux à l’avance. Il faisait presque nuit lorsqu’ils regagnèrent leur voiture, mais cette fois ce fut pour entreprendre un véritable voyage. Pendant deux heures, ils filèrent à toute allure à travers les routes poussiéreuses de la banlieue de San Francisco. Enfin le chauffeur stoppa dans un lieu absolument désert. C’était, à quelques miles du bord de la mer, une lande sauvage hérissée de broussailles, coupée de marées stagnantes couvertes de roseaux.
Tous trois paraissaient parfaitement connaître ce site désolé. Laissant leur chauffeur sur son siège, ils s’engagèrent délibérément dans un étroit sentier qui serpentait entre les mares et les buissons. Le chauffeur, l’Italien Léonello, les suivit quelque temps du regard ; mais, bientôt, ils se perdirent dans les ténèbres, et, n’ayant sans doute aucune inquiétude sur leur compte, Léonello rentra philosophiquement dans l’intérieur de la voiture pour se mettre à l’abri d’une petite pluie fine qui commençait à tomber.
Les trois hommes continuaient leur chemin ; mais, à quelque distance de l’auto, chacun d’eux avait appliqué un masque de caoutchouc sur son visage et vérifié son browning.
Le sentier qu’ils suivaient les mena jusqu’à une excavation profonde, qui paraissait une carrière abandonnée. Ils s’apprêtaient à y descendre, lorsqu’un homme se dressa devant eux pour leur barrer le passage ; mais Cornélius n’eut qu’un mot à prononcer, et l’homme s’effaça respectueusement.
Ils dépassèrent ainsi sans accident une deuxième, une troisième et une quatrième sentinelle ; ils se trouvaient maintenant tout au fond du vaste trou, sans doute creusé autrefois par les mineurs au temps de la belle époque des placers. Là, adossée au roc, il y avait une chaumière faite de blocs informes, couverte d’un toit de roseaux, et qui n’offrait d’autre issue qu’une porte basse. Ils poussèrent le loquet et entrèrent ; l’intérieur de la cabane présentait plus de confort qu’on n’eût pu s’y attendre dans un pareil lieu. Un bon feu brûlait dans la cheminée d’argile et, sur une table, il y avait deux bougies dans des chandeliers de cuivre.
Deux hommes, à la mine farouche, assis de chaque côté du feu sur des escabeaux, se levèrent avec respect à la vue des visiteurs, pour lesquels sans doute ces préparatifs avaient été faits ; puis ils se retirèrent.
Cornélius, Fritz et Baruch s’étaient assis en face de la table.
Ils étaient à peine installés que quatre coups, régulièrement espacés, furent frappés à la porte extérieure.
– Entrez ! cria Cornélius.
Une sorte de cow-boy, aux bottes boueuses, à la chemise de flanelle rouge, s’avança, son large chapeau de feutre à la main.
– Milords, dit-il d’un ton respectueux mais sans obséquiosité, voilà la chose.
Et il posa sur la table un carré de papier sur lequel étaient tracés quelques signes hiéroglyphiques. Au bas, se voyait une main grossièrement dessinée à l’encre rouge et dans l’angle de gauche une main semblable, mais plus petite.
Cornélius et Fritz examinèrent soigneusement le papier.
L’homme attendait.
– C’est trois cents dollars, dit Cornélius.
– Trois cents dollars, répéta Fritz.
Baruch prit dans son portefeuille trois bank-notes de cent dollars chacune et les tendit à l’homme qui les prit, salua et se retira sans mot dire.
Cette scène se renouvela un grand nombre de fois, exactement pareille, à quelques variantes près.
Enfin, Cornélius déclara que tous ceux à qui la Main Rouge devait de l’argent étaient payés.
– Alors nous allons partir ? dit Fritz.
– Pas encore, dit Baruch. Nous attendons des nouvelles importantes.
Un quart d’heure se passa. On n’entendait que les huées du vent qui faisait rage sur la mer. Le feu commençait à s’éteindre. Tout à coup on frappa de nouveau à la porte ; l’homme qui entra sur l’injonction de Cornélius était couvert de boue jusqu’à la tête. Il avait de larges éperons mexicains à ses bottes.
Il était facile de voir qu’il venait de faire une longue course à cheval, et son visage ruisselait de sueur et de pluie.
– Milords, fit-il en se découvrant, voici les lettres.
Il déposa sur la table une large enveloppe de toile scellée de cire rouge.
Fritz brisa le cachet et retira de l’enveloppe une foule de papiers de tous formats. Les uns étaient couverts d’une écriture fine et serrée, les autres ne portaient que quelques mots péniblement tracés au crayon. Il y avait, dans ce tas de paperasses, plusieurs lettres et plusieurs télégrammes non décachetés.
Silencieusement, les trois Lords de la Main Rouge se mirent en devoir de trier cette masse de documents ; c’étaient les rapports de tous les espions de l’Association dans la région ; ils étaient concentrés entre les mains d’hommes sûrs, qui les faisaient parvenir directement aux chefs suprêmes.
Jetant au feu les choses insignifiantes, ils mettaient soigneusement de côté les messages intéressants, et quand ils en trouvaient un plus important que les autres, ils se le communiquaient immédiatement.
Ils étaient presque arrivés à la fin de ce travail, lorsque Baruch mit la main sur un billet d’une maladroite écriture féminine et qui ne portait pour signature qu’un D majuscule.
– Diable, fit-il en passant le billet à Cornélius, voilà qui est grave ! Il paraîtrait que Paganot et Ravenel connaissent exactement la situation de l’île des pendus. Ils n’auraient ajouté aucune créance au message trouvé dans la bouteille, et s’ils nous laissent croire qu’ils se dirigent vers le sud, ce n’est que pour nous donner le change !
– Mais d’où vient ce renseignement ? demanda Fritz. Voilà qui va modifier notre plan !
– Il nous parvient d’une gitane nommée Dorypha, une danseuse qui est la maîtresse d’Edward Edmond, l’homme de confiance du milliardaire Fred Jorgell. Elle nous est toute dévouée. Et, d’après le conseil de Slugh, elle est entrée comme femme de chambre au service des deux Françaises pour toute la durée du voyage.
– On peut ajouter confiance à ses affirmations ? demanda Baruch.
– Je le crois.
Tout en parlant, Cornélius avait décacheté deux des télégrammes. Il eut tout à coup un murmure de mécontentement.
– C’est complet ! grommela-t-il. Ce fameux lord Burydan, qui ne donnait plus signe de vie et que nous croyions reparti pour l’Angleterre, a, lui aussi, équipé un yacht à destination de l’île des pendus. Il emmène avec lui le Peau-Rouge Kloum et ce damné bossu qui nous a tant de fois mystifiés ; les renseignements viennent de Vancouver. Nos agents n’ont été prévenus que trop tard. Lord Burydan a mis à la voile hier soir. Nous ne pouvons nous opposer à son départ et, ce qui est grave dans cette affaire, c’est que son équipage, recruté avec grand mystère, ne renferme pas un seul des membres de l’Association !
– Cela devient sérieux, murmura Baruch.
Les trois bandits se regardèrent un instant avec une sorte de consternation. Ce fût Cornélius qui, le premier, recouvra sa présence d’esprit.
– Un peu de calme, fit-il, ne nous affolons pas. Rien n’est encore perdu ! Il s’agit d’examiner froidement la situation.
– Il faut, dit Fritz, prendre des mesures !
– Elles sont tout indiquées ! Je vais, dès ce soir, expédier à la garnison de l’île l’ordre de se tenir sur le qui-vive. Lord Burydan a beau être rusé, il faudra toujours bien que, pour aborder dans nos possessions, il franchisse la ceinture des torpilles qui entoure l’île. D’un autre côté, que la Revanche se dirige vers le sud ou vers le nord, il n’en reste pas moins acquis que presque tout son équipage nous est dévoué, corps et âme. Vous voyez, en y réfléchissant bien, que le péril n’est pas si grave qu’il nous a paru tout d’abord.
– On pourrait, proposa Fritz, lancer à la poursuite de Burydan le yacht de la Main Rouge !
– Je ne suis pas de ton avis, riposta Cornélius. Notre navire à nous n’est pas muni de chaudières à pétrole inventées par Harry Dorgan et il arriverait beaucoup trop tard. D’ailleurs, je ne crois pas prudent, en ce moment-ci, d’attirer l’attention sur notre yacht !
– Quelle décision, demanda Baruch, allons-nous prendre au sujet de Fred Jorgell et de sa bande ?
– Laissons, pour le moment, Fred Jorgell tranquille, dit Cornélius. Ni lui, ni son futur gendre Harry, ni sa fille Isidora ne font partie de l’expédition dirigée contre nous. Nous nous occuperons d’eux plus tard, quand nous serons débarrassés des Français.
– En somme, il n’y a à bord de la Revanche, remarqua Fritz, que Paganot, Ravenel, leurs fiancées, Andrée de Maubreuil et Frédérique Bondonnat, et cet autre Français, Agénor Marmousier, qui a aidé Burydan à s’évader du Lunatic-Asylum.
– Il me semble, déclara Cornélius, que, pour ces cinq personnages, il n’y a pas d’hésitation à avoir ! Il y a assez longtemps qu’ils embarrassent notre route. Il faut en finir avec eux, une fois pour toutes.
Baruch s’était levé, en proie à une singulière émotion.
– Permettez-moi, fit-il, de donner mon opinion personnelle sur la question. Je tiendrais beaucoup à ce qu’Andrée de Maubreuil fût sauvée !
– Vous êtes amoureux décidément, mon cher, ricana Fritz. Vous ne pourrez donc jamais surmonter cette faiblesse ?
Baruch lui riposta avec aigreur :
– C’est bien à vous de parler, quand, il y a huit jours à peine, vous avez mis en péril l’Association et compromis ses intérêts en vous amourachant d’une aventurière italienne, qui s’est moquée de vous de la plus belle manière. Il ne s’en est pas fallu de beaucoup que Lorenza, la guérisseuse de perles, ne vous envoie siéger – et nous avec vous – dans le fauteuil d’électrocution !
– Laissons de côté cette sotte histoire, murmura le marchand de tableaux d’un air mécontent. Remarquez d’ailleurs que je me suis tiré de ce mauvais pas avec un remarquable sang-froid.
– Il faut absolument, reprit Baruch, qu’Andrée de Maubreuil soit exceptée du massacre, et cela non seulement parce que je me suis juré qu’elle serait à moi, mais parce que mon union avec elle est la base d’un projet que je vais vous exposer.
« Supposons les autres Français disparus. Je sauve Mlle de Maubreuil, je me réconcilie avec mon frère Harry, et je vais délivrer moi-même le vieux Bondonnat, qui alors sera forcé de se montrer plein de gratitude à mon égard.
– Je ne vois pas où vous voulez en venir ? dit Cornélius.
– Patience ! Bondonnat n’ayant plus d’autre famille qu’Andrée, qui est sa pupille, la fera son héritière. Et nous serons ainsi, sans violence et d’une façon toute naturelle, possesseurs de toutes les découvertes du vieux savant ! Mon plan est grandiose ! Il ne nous restera plus ensuite qu’à nous débarrasser d’Isidora et d’Harry, puis, plus tard, de Fred Jorgell et de William Dorgan, pour concentrer entre nos mains deux ou trois trusts et autant de milliards !
– Certes, s’écria Cornélius, le projet est admirable ! Mais il est audacieux ! Pour ma part, je ne vois pas grande objection à y faire.
– Permettez, protesta Fritz, n’est-il pas à craindre que Bondonnat reconnaisse Baruch, qu’il a entrevu dans sa nouvelle personnalité de Joë Dorgan lors de l’enlèvement en aéroplane ?
Baruch haussa les épaules.
– L’argument ne tient pas debout, fit-il. Bondonnat m’a à peine entrevu dans un moment où il était beaucoup trop ému pour prêter attention à ma physionomie. D’ailleurs, j’ai beaucoup changé depuis ! Et il suffira d’une légère modification – par exemple, de laisser pousser mes moustaches – pour dérouter les souvenirs du bonhomme ; puis il est absolument impossible qu’il s’avise de reconnaître dans le fils du milliardaire Dorgan, dans l’homme qui l’aura arraché aux bandits de la Main Rouge, celui-là même qui l’a conduit à l’île des pendus.
Cornélius approuva cette façon de voir, et Fritz lui-même finit par se rendre à ses raisons. Le nouveau plan élaboré par Baruch était aussi ingénieux qu’il était hardi. Les trois bandits convinrent donc qu’il serait suivi de point en point.
– Seulement, conclut Cornélius en se levant après avoir jeté au feu le restant des papiers, il faut nous hâter. La Revanche doit prendre la mer un peu après minuit, et j’ai rendez-vous avec Slugh vers dix heures et demie, à la bodega du Vieux-Grillage. C’est là qu’il doit prendre nos dernières instructions.
Les trois bandits s’empressèrent de sortir. Un quart d’heure plus tard ils remontaient dans leur automobile, qui filait en quatrième vitesse dans la direction de San Francisco.
CHAPITRE III
Une soubrette compromettante
La Revanche était un magnifique navire d’un tonnage presque double de celui de l’Ariel. Édifié d’après les plans de l’ingénieur Harry Dorgan, encore améliorés par Roger Ravenel et Antoine Paganot, il était muni d’une coque en nickel extra-légère et de chaudières au pétrole qui lui permettaient d’atteindre une prodigieuse vitesse.
Il était, en somme, construit d’après le même système que les paquebots Éclair de la compagnie fondée par Fred Jorgell et qui faisaient en quatre jours la traversée de New York au Havre, il était armé de canons de soixante millimètres à frein hydropneumatique du modèle le plus récent ; enfin, il possédait un tube lance-torpilles.
Il comptait cent cinquante hommes d’équipage, pourvus de carabines Winchester à répétition.
Fred Jorgell avait surtout tenu à ce que les matelots de la Revanche eussent servi comme soldats ou comme marins de l’État, et il avait recommandé à Edward Edmond, spécialement chargé de l’embauchage, de recruter de préférence des hommes qui auraient déjà assisté à une guerre, comme, par exemple, l’expédition des îles Philippines.
Malheureusement, Edward Edmond n’avait eu aucune difficulté à concilier les recommandations du milliardaire et les ordres de la Main Rouge. La plupart des hommes qu’il avait engagés, et qui pouvaient montrer des certificats de présence au corps, appartenaient à la redoutable Association.
Quant au capitaine, ce n’était autre que Slugh l’ex-tramp, l’homme de confiance de Cornélius, l’ancien gouverneur de la garnison de l’île des pendus.
L’audacieux bandit, qui avait navigué dans sa jeunesse à bord d’un brick de pirates, avait suffisamment de connaissances nautiques pour diriger un navire ; d’ailleurs, il s’était adjoint, en qualité de second, un loup de mer expérimenté, un fin matelot, en la personne du capitaine Christian Knox ; le vieux forban avait fini par se décider à accepter les brillantes propositions qui lui étaient faites et, en modifiant sa coupe de barbe et s’affublant de lunettes, il s’était suffisamment « camouflé » pour n’être pas reconnu des jeunes filles, qui lui avaient vu apporter à Golden-Cottage la fameuse bouteille trouvée au fond de la mer.
Slugh, pour arriver à ce résultat, avait présenté à Fred Jorgell des certificats de premier ordre, et Edward Edmond avait enlevé l’affaire en déclarant qu’il le connaissait personnellement.
Slugh, d’ailleurs, avait complètement modifié – lui aussi – son aspect physique. Il s’était débarrassé de sa longue barbe de chemineau, pour ne conserver qu’une touffe de poils à la partie inférieure du menton, à la mode yankee. Son visage, aux traits anguleux et rudes, sa peau tannée par le grand air et le soleil lui donnaient tout à fait les apparences d’un capitaine de marine un peu brusque mais loyal ; sa carrure imposante se dessinait sous un superbe uniforme bleu à galons dorés, et il avait, ma foi, fort bonne mine.
On voit combien avaient été terribles les conséquences de la trahison d’Edward Edmond ; sur cent cinquante hommes de l’équipage, cent vingt appartenaient à la Main Rouge. Comme Slugh l’avait dit à Cornélius quelques heures avant le départ, il n’aurait qu’un geste à faire, qu’un doigt à lever, pour se trouver entièrement maître du yacht.
La Revanche appartenait à la Main Rouge depuis le capitaine jusqu’au chauffeur, en y comprenant même le maître d’hôtel et le cuisinier, et jusqu’à l’employé, spécialement embauché, qui devait faire fonctionner l’appareil de télégraphie sans fil.
Edward Edmond avait eu l’imprudence de faire engager la gitane Dorypha, sa maîtresse, comme femme de chambre, au service d’Andrée de Maubreuil, une petite Écossaise nommée Ketty, cousine éloignée de mistress Mac Barlott, remplissant les mêmes fonctions auprès de Frédérique.
L’Irlandais avait eu, d’abord, beaucoup de peine à décider la danseuse à remplir un pareil rôle, puis, finalement, l’imprévu de l’aventure avait triomphé de ses hésitations. D’ailleurs, Edward Edmond et Slugh lui-même lui avaient fait de magnifiques promesses ; Dorypha s’était rappelée qu’elle avait été autrefois, à Grenade, au service de la femme d’un corregidor, et il lui avait paru amusant de jouer de nouveau ce rôle.
Sur la recommandation d’Edward Edmond, la gitane avait tout de suite été acceptée, et cela d’autant plus aisément que toutes les filles de service auxquelles on s’était adressé avaient refusé nettement de s’engager dans une expédition aussi mystérieuse et qui ne paraissait pas sans danger.
Dorypha était une comédienne admirable. Laissant de côté les toilettes tapageuses, les audacieux décolletés et l’effronté maquillage, elle avait revêtu un costume tailleur de drap noir, d’une coupe sévère, et ses beaux cheveux blonds se cachaient sous un bonnet tuyauté, qui lui donnait une petite mine hypocrite et puritaine des plus réjouissantes.
Trouvant le nom de Dorypha trop compromettant, la gitane s’était présentée sous celui de Mercédès. Andrée l’avait acceptée de confiance, tout en remarquant qu’elle avait l’air très déluré.
– Cette Mercédès ne semble pas avoir froid aux yeux, avait-elle dit.
– De fait, avait ajouté le naturaliste Ravenel, elle a des yeux qui brasillent comme des charbons d’enfer sous ses grands cils de velours noir.
Mais la gitane, souple, câline et prévenante, pleine d’attentions pour sa maîtresse qu’elle avait prise en amitié, n’avait pas tardé à faire oublier cette première impression ; elle s’acquittait de son service avec une habileté exemplaire, et sa gaieté, son air bon enfant l’avaient rendue sympathique à tout le monde.
On n’avait, d’ailleurs, aucun reproche à lui faire sur sa tenue et sa conduite. Et, dans ce milieu d’intellectuels d’une urbanité raffinée, cette fille du ruisseau, élégante d’instinct et de race, trouvait moyen de ne pas faire tache. Dorypha, répétons-le, était une comédienne admirable.
Nul ne se fût douté que cette soubrette, au sourire fripon, qui apportait d’un air modeste et respectueux le chocolat ou le courrier de ces demoiselles sur un plateau d’argent, était la même effrontée drôlesse que l’on avait vu lever la jambe dans les bouges à matelots, et balancer sa croupe comme une pouliche du haras de Cordoue.
À bord de la Revanche, l’installation des passagers était luxueuse et les cabines confortables. Dès le premier jour de la traversée, Andrée et Frédérique pensèrent que le voyage serait des plus agréables. Grâce à l’armement formidable du yacht et à la collaboration de lord Burydan, elles regardaient la délivrance de M. Bondonnat comme une chose certaine. Il leur paraissait impossible que la garnison de l’île des pendus pût faire une résistance sérieuse et, pour elles, l’expédition s’annonçait comme une véritable partie de plaisir.
L’ingénieur Paganot, le naturaliste Ravenel et le poète Agénor n’étaient pas loin de partager cette manière de voir.
Comment auraient-ils eu quelque chose à redouter sur ce beau navire, si formidablement armé, qui, sous un ciel bleu, par un soleil magnifique, fuyait à toute vitesse sur la calme surface de l’océan Pacifique ? Rien qu’à voir les faces basanées des hommes de l’équipage, qui, dans leurs uniformes neufs, avaient l’air de vieux braves, d’honnêtes héros blanchis dans les combats, ils se sentaient rassurés.
– Ce sont de solides gaillards, répétait Paganot.
– Très solides ! ajoutait Agénor.
– Et je crois qu’on peut avoir confiance en eux à tous les points de vue, concluait le naturaliste Ravenel.
Les trois Français commettaient là une lourde erreur, mais, comment auraient-ils pu soupçonner qu’ils étaient victimes d’une pareille machination ? Leur confiance était telle qu’ils s’en remettaient entièrement à l’honnête capitaine Slugh, qui, admis à leur table, charmait tout le monde par ses pittoresques anecdotes, aussi bien que par son robuste appétit.
Il arrivait bien quelquefois que le capitaine laissât échapper quelque expression crapuleuse, mais on mettait cela sur le compte de la « rude franchise » particulière aux vieux loups de mer.
Un fait qui eût dû éveiller les soupçons des deux ingénieurs, c’était la taciturnité subite du capitaine, sitôt que la conversation tombait sur quelque question technique. Slugh savait bien conduire un navire par routine, à la façon des pirates et des marchands de copra des îles de corail, mais il se fût embrouillé tout de suite si on l’avait poussé à fond au sujet de la latitude, et il eût été parfaitement incapable, à lui tout seul, de relever le point pour établir la situation exacte du bâtiment.
C’était le capitaine Knox qui se chargeait de ce soin et lui remettait chaque jour les chiffres exacts de la longitude et de la latitude, relevés sur les feuilles de son carnet.
D’ailleurs, Slugh n’avait manifesté aucun étonnement, et pour cause, lorsqu’une fois en dehors de la rade de San Francisco l’ingénieur Paganol, délégué officiel de Fred Jorgell, avait donné l’ordre d’orienter le navire vers le nord.
Le premier jour de la traversée, l’ingénieur commanda au télégraphiste d’entrer en communication avec le poste de San Francisco, pour annoncer à Fred Jorgell et à Harry Dorgan que tout allait bien ; au bout de peu de temps, l’employé vint apporter la réponse du milliardaire, qui faisait les meilleurs vœux pour le succès de ses amis. Mais, dans la même journée, des matelots, en abaissant trop rapidement une vergue, s’y prirent avec une telle maladresse que l’énorme pièce de bois vint frapper obliquement la cabine vitrée où se trouvaient les appareils et les faussa presque tous.
Les Français n’attachèrent pas une importance par trop grande à cet accident, étant donné, surtout, que le télégraphiste leur promit de réparer, tant bien que mal, le dégât, ce qui ne demanderait pas plus de deux jours de travail.
Tous avaient donc pleine confiance et nul ne soupçonnait l’orage qui s’amoncelait au-dessus de leur tête.
Cependant, Andrée avait remarqué qu’Edward Edmond, qui, promu au grade de commissaire du bord, mangeait à une table à part avec le personnel de service, paraissait de fort mauvaise humeur ; mais la jeune fille avait attribué ce mécontentement au dérangement que lui causait le voyage et elle n’avait pas remarqué les étranges regards, à la fois ardents et irrités, que l’Irlandais jetait à la jolie camériste espagnole, chaque fois qu’elle apparaissait sur la dunette.
Edward Edmond, en effet, était furieux d’avoir entrepris ce voyage et presque autant d’avoir amené avec lui la Dorypha ; l’Espagnole ne quittant sa maîtresse ni le jour ni la nuit, car elle occupait la cabine contiguë à celle d’Andrée, l’Irlandais ne pouvait avoir que de rares et furtives relations avec sa maîtresse.
Dorypha, qui, en réalité, n’était nullement éprise de lui, s’amusait de cette situation et se plaisait à le taquiner de mille façons ; quand elle passait sur le pont, à quelques pas de lui, elle avait une façon ironique de sourire, qui mettait Edward Edmond en fureur.
Quelquefois elle s’approchait de la cabine qu’il occupait, s’avançant à pas de loup et regardant avec précaution autour d’elle, puis, quand il croyait qu’elle allait y entrer donner enfin satisfaction à ses désirs éperdus, elle s’échappait en riant, vive et légère comme une oiselle.
Elle l’aguichait de mille façons. Parfois elle lui tendait ses lèvres dans un coin sombre, puis brusquement se dérobait au baiser et se sauvait en criant : « Mademoiselle… je vois mademoiselle qui me cherche. »
Par contre, la gitane montrait toute l’amabilité possible envers le naturaliste Roger Ravenel. Très expérimentée dans les choses de la passion, elle trouvait le naturaliste très bel homme, sa physionomie intelligente et donquichottesque, avec son nez énorme, ses petits yeux bruns et vifs et ses moustaches en bataille, était allée droit au cœur de la gitane.
– Celui-là a vraiment l’air d’un homme, songeait-elle parfois, et je crois que je l’aimerais bien, au moins pendant huit jours !…
Elle appréciait moins, à ce point de vue spécial, l’ingénieur Paganot. Avec sa face rose et entièrement rasée, l’ingénieur, pour elle, ressemblait trop à tous ces Yankees qu’elle ne pouvait souffrir. Pour elle, un homme sans moustaches n’existait pas, c’était là un principe absolu.
Cependant, parmi les hommes de l’équipage, il s’en trouvait un certain nombre qui avaient eu l’occasion d’admirer la Dorypha dans ses danses capiteuses, à la bodega du Vieux-Grillage, ou dans d’autres bouges du même genre. Elle n’avait pas tardé à être reconnue.
Son nom avait volé de bouche en bouche et, maintenant, quand la gitane apparaissait sur le pont, les matelots formaient de petits groupes pour mieux la regarder, les uns ricanant bêtement, d’autres les yeux allumés de luxure.
Vicieuse comme une vraie fille du diable, la Dorypha, quand elle croyait n’être pas vue, décochait aux marins des œillades moqueuses, ou, parfois, elle traversait lentement le pont en balançant imperceptiblement la croupe et les hanches, comme si elle eût été sur le point d’attaquer une de ces habaneras, un de ces tangos, qui faisaient bondir et hurler toute une salle en folie.
Quand il pouvait la pincer entre deux portes, Edward Edmond lui adressait d’amers reproches de cette conduite, mais elle ne faisait que rire de ses sermons et de sa colère.
– Ils peuvent tirer la langue, répondait-elle, mais ils ne m’auront pas ! Je ne suis qu’à toi seul, querido mio, alma de mi corazon[7].
Elle donnait une petite gifle sur les oreilles rouges de l’Irlandais et s’esquivait.
Dès le second jour, Slugh n’avait pas été sans s’apercevoir de l’influence démoralisatrice qu’exerçait la présence de la gitane, et il avait dû, plusieurs fois, dissiper lui-même les groupes que formaient les marins en extase dès que paraissait l’Espagnole ; lui aussi avait voulu semoncer la Dorypha, mais la drôlesse n’en faisait jamais qu’à sa tête, et les menaces ni les promesses n’avaient aucun effet sur elle.
Ce n’était pas là le plus grave sujet de préoccupation de Slugh. Habitué depuis de longues années à commander aux tramps et connaissant sur le bout du doigt la psychologie spéciale de cette sorte de gens, il s’apercevait tout à coup que cet équipage, qu’il aurait cru avoir parfaitement en main, montrait déjà des tendances à l’indiscipline. Quelques-uns des bandits restaient sur leurs couchettes à fumer et à boire, en jouant aux cartes, et rien ne pouvait les faire changer d’attitude. D’autres tenaient dans les coins des conciliabules mystérieux.
Le premier jour même, comme on avait à peine perdu de vue la côte américaine, Slugh avait été obligé de faire un exemple ; dans le poste de l’équipage, un matelot nommé Wallis, ivre à ne pas tenir sur ses jambes, l’avait insulté grossièrement, le traitant de « sanglant coquin », de « maudit pirate du diable », et autres semblables épithètes. En toute autre circonstance, Slugh aurait brûlé à bout portant la cervelle de l’insolent, mais comme, sous aucun prétexte, il ne fallait éveiller les soupçons des Français, le capitaine se contenta d’assommer son insulteur d’un coup de poing.
Il y eut un bruit d’os et de chair broyés et l’homme tomba à terre le crâne fracassé, les yeux vitreux et la langue pendante. La mort avait été instantanée.
– Qu’on cache cette charogne dans un coin, ordonna Slugh, et à la nuit tombante, on le jettera à la mer ; il ne manque pas de requins dans ces parages !
Un silence de mort accueillit ces paroles. Deux hommes s’empressèrent d’emporter le cadavre de l’ivrogne, mais Slugh avait compris qu’en prenant le commandement de la Revanche il avait assumé une lourde responsabilité.
En y réfléchissant, il trouva bientôt la cause de cette propension à la révolte qu’il remarquait parmi ses hommes. Il ne pouvait en accuser une autre personne que le capitaine Christian Knox qui, depuis qu’il était à bord où ses talents nautiques le rendaient indispensable, prenait de petits airs ironiques, montrant à Slugh une déférence exagérée et gouailleuse, lui donnant cent fois par jour le titre de capitaine sous les prétextes les plus futiles.
Slugh se repentit alors amèrement d’avoir embauché ce vieux pirate capable de toutes les trahisons, et qui, certainement, avait dû s’assurer à l’avance de nombreux partisans parmi les hommes de l’équipage.
Il résolut de surveiller de près le vieux coquin et de lui brûler la cervelle à la première occasion.
Knox, cependant, paraissait ne se soucier en rien de la mauvaise humeur, pourtant très visible, du capitaine en titre. Il sifflotait gaiement en se promenant sur le gaillard d’avant, les mains dans les poches, le cigare à la bouche, en homme qui se sent chez lui et qui se considère comme le maître de la situation.
Knox était précisément un de ceux qui, lorsque la Dorypha paraissait, lui envoyaient des œillades ou s’extasiaient sur sa prestance.
Slugh lui fit remarquer, avec beaucoup de calme, que ce n’était pas à lui de donner le mauvais exemple aux hommes, et Knox parut accepter cette observation d’assez bonne grâce. Mais le pirate avait ses projets. Un impérieux désir le poussait vers la danseuse, pour laquelle il éprouvait un de ces coups de fièvre, une de ces ardeurs de sang, qui sont irrésistibles chez des tempéraments impulsifs comme le sien et comme lui brûlés d’alcool.
Ce soir-là, Andrée de Maubreuil, qui décidément était de plus en plus satisfaite des soins de sa nouvelle camériste, lui avait fait cadeau d’une jolie bague ornée d’une opale qu’elle avait achetée lors de son passage à La Nouvelle-Orléans.
Andrée s’était tout à coup rappelé la haine qu’avait son père pour les pierres précieuses et, se repentant de son achat, elle avait donné la bague à sa fidèle Mercédès.
Celle-ci, qui depuis longtemps convoitait le bijou, avait remercié sa maîtresse avec toutes les exagérations de l’emphase espagnole, lui baisant les mains et lui jurant un dévouement éternel. Andrée de Maubreuil s’était beaucoup amusée de cette scène. Peu de temps après, se sentant fatiguée, la jeune fille était rentrée dans sa cabine et, après avoir souhaité le bonsoir à Frédérique, sa voisine immédiate, elle s’était fait déshabiller par Dorypha et s’était mise au lit.
Quand la gitane put se croire bien sûre que sa maîtresse dormait et qu’elle ne vit plus aucune lumière chez les autres passagers, elle se risqua, comme elle le faisait souvent, à monter sur le pont.
Pieds nus dans de mignonnes pantoufles, elle sortit du couloir des cabines sans avoir été vue de personne. Elle gagna le pont, s’assit sur un banc et, la tête renversée en arrière, les seins cambrés, presque nue sous son mince peignoir, elle se laissa aller à une voluptueuse détente de tout son être, offrant toute sa chair frissonnante à la fraîche caresse de la brise nocturne.
Tout à coup, elle poussa un cri étouffé.
Un homme, jusqu’alors caché derrière un rouleau de cordages, venait de bondir sur elle et, la saisissant au cou d’une main, fourrageait brutalement de l’autre les splendeurs de son corsage entrouvert.
À dix mètres de là, les hommes de quart, évidemment complices, tournaient le dos et sifflotaient en faisant mine de ne rien voir.
– Si tu cries, je t’étrangle ! murmura d’une voix rauque le capitaine Knox à l’oreille de la gitane.
Comme elle n’essayait pas de se dégager, il continua :
– Viens dans ma cabine, je te donnerai dix dollars !
Dorypha ne répondait toujours pas.
– En veux-tu vingt ? tu les auras ! Je te veux et tu seras à moi !
Il avait quelque peu desserré son étreinte mais, brusquement, la gitane se redressa, comme un arc dont on a brisé la corde. Et le capitaine Christian Knox ressentit au bras une douleur aiguë.
Pendant les quelques secondes où il l’avait crue immobile, consentante peut-être, la Dorypha avait sournoisement cherché le stylet toujours attaché à sa jarretière, et maintenant, ricanante et moqueuse, ne se donnant même pas la peine d’appeler au secours, elle lui tenait tête, le lardant de la pointe aiguë de son arme, à petits coups.
Le capitaine écumait de rage.
– Maudite gueuse ! râla-t-il. J’ai envie de te crever la peau !
Tout en battant en retraite devant la gitane il cherchait son couteau, mais, au moment où l’ayant enfin trouvé il s’apprêtait à l’ouvrir, il se sentit rudement empoigné au collet, et Dorypha profita aussitôt de cette intervention inattendue pour le désarmer en s’emparant du couteau, non sans avoir fait prestement disparaître son stylet dans son corsage.
Exaspéré jusqu’à la fureur, Knox se rua sur ce nouvel adversaire dans lequel, à la clarté de la lune, il reconnut Roger Ravenel. Mais il avait affaire à forte partie ; le naturaliste, sportsman émérite, était de première force à la boxe. Avant d’avoir pu se rendre compte de ce qui lui arrivait, Knox reçut sur la mâchoire un coup qui faillit lui couper la langue et lui fit sauter deux dents. Il roula à terre en crachant le sang et en jurant comme un possédé.
Les hommes de quart s’avançaient, mais presque en même temps qu’eux, Slugh parla et, tout bouleversé de cette scène dont il redoutait les conséquences, demanda ce qui s’était passé. Roger Ravenel le mit au courant en peu de mots, Slugh exprima la plus véhémente indignation et, avec une courtoisie qui eût été parfaitement grotesque en toute autre circonstance :
– Si je ne craignais de réveiller ces dames à une heure pareille, je brûlerais la cervelle de ce coquin à l’instant même ! Mais soyez tranquille, monsieur Ravenel, il va être mis aux fers ! Allons, Sprinter, Kolbak ! Empoignez-moi ce gaillard-là, désarmez-le et descendez-le à fond de cale dans les locaux disciplinaires !
Sprinter et Kolbak, deux anciens pensionnaires de l’île des pendus, étaient des hommes dévoués sur qui Slugh pouvait compter absolument ; en un clin d’œil, Christian Knox, malgré ses hurlements et ses coups de pied, fut solidement ligoté et emporté.
Slugh prit congé du naturaliste en le priant de garder le silence sur ce petit drame, afin de ne point causer de scandale et en lui affirmant d’un air digne qu’il veillerait à ce qu’un aussi regrettable incident ne se reproduisît plus.
Dorypha avait assisté à toute cette scène dans une pose indolente, nullement émue et plutôt amusée de la succession des péripéties ; mais, quand elle se retrouva seule avec Roger Ravenel, sa physionomie prit une expression apeurée et douloureuse.
– Vous n’avez pas été blessée, mademoiselle ? demanda le naturaliste avec sollicitude.
– Non, murmura la gitane d’une voix très douce, en portant la main à son cœur comme pour en comprimer les battements. J’ai eu très peur !… Ah ! Sainte Vierge ! il me semble que je vais me trouver mal !…
Elle étendit les mains, chancela, et vint s’abattre dans les bras de Roger Ravenel qui s’était avancé pour la soutenir. En même temps, comme si dans son égarement elle n’eût plus su ce qu’elle faisait, elle avait pris le naturaliste par-dessus le cou, sa joue s’appuyait contre sa joue et le jeune homme sentait tout contre lui ce beau corps tiède et frémissant, presque nu sous l’étoffe légère.
Roger Ravenel perdait la tête. Une étrange émotion l’envahissait, et pour retenir la gitane toujours prête à tomber, il fut obligé de la prendre par la taille. Elle en profita pour nouer plus étroitement ses bras autour de son cou. Leurs lèvres se rencontrèrent et le jeune homme ressentit la brûlure délicieuse d’un baiser.
Le naturaliste, faisant violence aux désirs fous dont il était consumé, avait reculé sa bouche loin de celle de la sirène, puis il la déposa sur le banc et relâcha doucement l’étreinte des beaux bras frais qui l’enlaçaient.
Déjà la gitane ouvrait les yeux en souriant avec un soupir qui n’avait rien de douloureux.
– Je vous demande mille pardons, monsieur Ravenel, dit-elle avec un sourire délicieux, mais je crois que je viens d’avoir un étourdissement ! Ce ne sera rien. Je vais déjà mieux !
– Vous n’avez plus besoin de mes soins ? demanda-t-il poliment.
– Merci, fit-elle, railleuse, ce sera pour une autre fois. Je vais très bien. Bonsoir, monsieur Ravenel.
Le naturaliste regagna sa cabine, à la fois mécontent et charmé de cette aventure, mais ni Dorypha ni lui n’avaient aperçu la face haineuse de l’Irlandais Edward Edmond qui, tapi dans l’ombre du couloir, avait été témoin de toute cette scène.
Il attendit la nuit et se mit aux aguets, épiant la gitane qui, souvent, ses maîtres couchés, son service fini, montait sur le pont pour respirer la fraîcheur de la brise.
CHAPITRE IV
Jalouse !
Frédérique venait de terminer sa toilette. Ses cheveux d’un blond ardent, presque roux, se massaient sous un élégant chapeau en fibres de Panama, qui donnait à sa physionomie enjouée un air plein de désinvolture, et ses formes agréables se dessinaient dans un léger pyjama à raies vertes et bleues.
Le visage de la jeune fille n’offrait pas cette beauté classique qui induit à de sévères méditations. Elle était plus jolie que belle et plus gracieuse encore que jolie. Son nez était légèrement retroussé, sa bouche un peu grande, mais son teint délicatement rosé offrait cette fraîcheur admirable que l’on ne rencontre guère que dans certains pays scandinaves. Ses yeux étaient d’un gris très doux et toute sa physionomie respirait la bonté, la tendresse, la joie de vivre ; un aimable embonpoint ajoutait encore à ses charmes.
On devinait en elle, du premier coup d’œil, une prédisposition à tirer des éléments que nous offre la vie tout le bonheur qu’ils sont susceptibles de procurer ; heureuse, Frédérique devait aimer à faire des heureux autour d’elle.
Un observateur aurait cependant remarqué – léger défaut auprès de tant de perfections – que la lèvre supérieure, un peu forte et retroussée, indiquait une certaine prédisposition à la jalousie, mais quelle femme n’est pas un peu jalouse de ceux qu’elle aime ?
La jeune fille se préparait à descendre à la salle à manger où, déjà, sans doute, ses amis avaient dû la précéder. Elle achevait de ranger le joli nécessaire de toilette dont elle venait de faire usage, et elle regardait l’azur profond de la mer, étale comme un lac, étincelant sous les rayons du soleil. Il commençait à faire très chaud et Frédérique ne put s’empêcher de le remarquer.
– C’est singulier, songea-t-elle, je ne sais si je me trompe, mais on dirait que plus nous avançons vers le nord, plus la chaleur augmente ! Il faudra que j’en parle à Roger.
À ce moment, on frappa légèrement à la porte de la cabine.
– Entrez ! cria la jeune fille.
Frédérique s’attendait à voir son amie Andrée ou sa femme de chambre Ketty. Elle éprouva quelque surprise en reconnaissant, dans ce visiteur matinal, l’Irlandais Edward Edmond, un des hommes de confiance du milliardaire Fred Jorgell. Il entra en saluant respectueusement, mais Frédérique remarqua tout de suite que ses manières paraissaient hésitantes et gênées.
– Mademoiselle, fit-il, excusez-moi de vous déranger, mais j’aurais quelques mots à vous dire en particulier.
– Parlez, monsieur Edmond, dit Frédérique, dont la curiosité était vivement excitée.
– Vous savez, reprit-il, que Mr. Fred Jorgell a pour moi une certaine estime et qu’il m’a chargé tout spécialement de veiller au bon ordre du bord, à la bonne tenue du personnel.
– Je ne vois pas où vous voulez en venir. J’espère que vous n’avez eu à vous plaindre de personne ? La conduite de tous les gens de service me semble, jusqu’ici, absolument correcte.
– Permettez-moi de vous dire, mademoiselle, que ce n’est pas tout à fait mon opinion. Pour vous parler franchement, la conduite de Mercédès, la femme de chambre de Mlle de Maubreuil, est absolument scandaleuse !
– Elle a des allures un peu vives, il est vrai, mais c’est une bonne fille ! Et je la crois incapable de se mal conduire ; puis, enfin, monsieur Edmond, cela ne me regarde pas ! C’est plutôt à mon amie Andrée que vous devez vous adresser, ce me semble !
– Vous verrez que c’est vous, surtout, que la chose intéresse.
– Comment cela ? s’écria la jeune fille qui commençait à s’impatienter de toutes ces précautions oratoires. Dites-moi vite quel crime a commis cette pauvre Mercédès ?
– Elle lance continuellement des œillades aux matelots, mais cela ne serait rien. Hier soir, elle avait, à ce que j’ai supposé, donné rendez-vous à l’un de ces hommes. Une discussion s’est élevée entre eux. Le marin a tiré son couteau et, sans l’intervention de M. Roger Ravenel, qui a mis l’ivrogne à la raison, ce rendez-vous galant aurait peut-être fini de la façon la plus sanglante.
Frédérique se sentit le cœur serré.
– M. Ravenel est intervenu ? répéta-t-elle d’une voix faible.
– Oui, mademoiselle. Il a désarmé le brutal et il a porté secours à Mercédès qui s’est évanouie dans ses bras. Elle l’avait pris par-dessus le cou et, soit qu’elle ne sût plus ce qu’elle faisait, ce qui est possible, soit qu’elle voulût lui prouver à sa façon sa reconnaissance, elle l’embrassait, et M. Ravenel a eu les plus grandes peines du monde à s’en débarrasser.
Le visage de Frédérique était devenu rose d’indignation et de colère, un sanglot lui montait à la gorge, et ses yeux gris, si doux habituellement, lançaient des flammes.
– C’est une infamie ! s’écria-t-elle. Je suis sûre, moi, que M. Ravenel n’a pas embrassé cette fille…
L’Irlandais demeurait tout interloqué de la fureur de la jeune fille.
– Remarquez, mademoiselle, répliqua-t-il, que je n’ai pas dit que M. Ravenel avait embrassé Mercédès. C’est le contraire qui a eu lieu ! Elle était affolée par la peur, il n’a pas pu l’en empêcher.
Frédérique fit un héroïque effort pour refouler les larmes qui lui montaient aux yeux.
– C’est bien, monsieur Edmond, balbutia-t-elle d’une voix saccadée. Je vais voir M. Ravenel. Je suis certaine que dans cette occasion il n’a fait que ce qu’il devait faire.
– Ne trouvez-vous pas, mademoiselle, dit encore l’Irlandais, qu’une fille de ce genre ne peut demeurer au service de Mlle de Maubreuil, et qu’il serait prudent de la reléguer dans les cabines du personnel où je pourrais surveiller plus aisément ses faits et gestes ?
Il ajouta, après un moment de silence :
– Je ne me permettrais pas, mademoiselle, de vous donner un conseil ; pourtant, ne croyez-vous pas qu’il serait préférable d’éloigner, comme je vous l’ai dit, Mercédès sous un prétexte, et de ne rien dire à M. Ravenel ?
La colère de Frédérique ne demandait qu’un prétexte pour déborder.
– Que voulez-vous insinuer par là ? s’écria-t-elle, le visage pourpre d’indignation. Craignez-vous donc que M. Ravenel ne prenne la défense de cette fille ?
– Mademoiselle…
– Je ne veux plus entendre parler de cette affaire !… Et, d’ailleurs, n’est-ce pas vous, monsieur Edmond, qui avez arrêté cette Mercédès et qui vous êtes porté garant de sa moralité ?
L’Irlandais baissa piteusement la tête.
– Je me suis lourdement trompé, bégaya-t-il en battant en retraite, Mercédès possède d’excellents certificats !
– Retirez-vous, monsieur. Je vous ai dit que je ne voulais plus rien entendre.
La jeune fille, exaspérée, ferma brusquement la porte au nez d’Edward Edmond, qui se retira tout décontenancé ; pourtant, il était au fond enchanté de sa ruse. Il ne doutait pas qu’après une pareille dénonciation Dorypha ne fût envoyée avec les gens de service et ne vînt habiter une de ces cabines qui se trouvaient près de la sienne et où il pourrait l’avoir à sa disposition et l’empêcher de lui faire des infidélités.
Restée seule, libre de s’abandonner à son chagrin, Frédérique pleura à chaudes larmes.
– Roger ne m’aime pas !… balbutiait-elle entre deux sanglots. Il fait la cour à cette fille !… Ce coquin d’Irlandais ne m’a pas tout dit !… Mais j’en sais assez !… C’est indigne !… Si Roger a fait cela, il mériterait que je rompe avec lui… et je romprai ! Mon Dieu, que je suis malheureuse !
Après avoir versé un torrent de larmes, Frédérique finit par se calmer un peu mais elle demeurait mortellement triste ; la révélation de l’Irlandais l’avait atteinte en plein cœur.
Elle lava ses yeux rougis pour qu’on ne s’aperçût pas qu’elle avait pleuré, et descendit enfin à la salle à manger.
– Comme tu as l’air de mauvaise humeur, lui dit Andrée de Maubreuil. Je te trouve, ce matin, la figure toute chiffonnée.
– J’ai très mal dormi cette nuit ! répliqua Frédérique pour couper court à toute explication.
– On dirait que vous avez pleuré, vous avez les yeux rouges, dit à son tour Roger Ravenel.
– Pourquoi voulez-vous que j’aie pleuré ? lui fut-il répondu d’un ton glacial, auquel il ne comprit rien.
Cependant, au milieu de l’animation générale, la préoccupation de Frédérique fut à peine remarquée et le déjeuner s’acheva gaiement, comme de coutume. Ensuite les convives se séparèrent et la plupart d’entre eux se rendirent sur le pont pour y prendre le frais.
Roger Ravenel se disposait à suivre ses amis Agénor et Paganot, lorsque Frédérique l’arrêta d’un geste.
– Monsieur Roger, lui dit-elle d’un ton grave auquel il n’était pas accoutumé, j’aurais quelques mots à vous dire.
– À vos ordres, mademoiselle, répliqua le naturaliste en s’effaçant pour laisser passer la jeune fille, qui le précéda jusqu’à un petit salon-bibliothèque, en ce moment désert.
Frédérique essaya d’abord de conserver le ton cérémonieux et froid qu’elle avait pris tout d’abord.
– Monsieur Ravenel, commença-t-elle, il est venu à ma connaissance des faits très graves…
Mais elle ne put soutenir longtemps ce rôle, la vivacité du naturel l’emporta.
– Roger, s’écria-t-elle, déjà prête à pleurer de nouveau, ce que vous avez fait est très mal, vous me brisez le cœur ! Comment, vous me trompez avec une femme de chambre !
– Je vous assure, Frédérique, protesta le naturaliste en rougissant.
– Vous l’avez embrassée ; je le sais. Vous la teniez dans vos bras ! Allez donc dire que ce n’est pas vrai, si vous l’osez !
Roger Ravenel aimait Frédérique de toute la puissance de son âme. Devant une pareille accusation, qui pouvait mettre à néant ses espérances les plus chères, il demeura atterré et comme anéanti ; Frédérique n’était pas moins émue.
– Mais défendez-vous donc ! s’écria-t-elle, vous ne protestez même pas !… Alors, c’est donc vrai ? Roger, vous me percez le cœur !…
Mais ces quelques secondes avaient donné au jeune homme le temps de se ressaisir.
– Frédérique, s’écria-t-il la main tendue dans un geste solennel. Je vous jure que je n’ai rien à me reprocher, rien, vous m’entendez ! Mais il ne doit exister entre nous rien qui ressemble à un mensonge. Vous allez connaître l’exacte vérité.
Très loyalement, Roger Ravenel conta dans tous leurs détails les scènes dont le pont de la Revanche avait été le théâtre, la veille. Pendant ce récit, Frédérique pâlissait et rougissait tour à tour, mais elle n’interrompit pas une seule fois le narrateur. Quand il se tut, sa physionomie s’était complètement rassérénée et un sourire de bonheur brillait de nouveau dans les yeux de la jeune fille.
– Roger, dit-elle, j’ai eu bien du chagrin. J’étais persuadée que vous étiez l’amant de Mercédès… J’en ai pleuré de dépit… Cette fille m’est odieuse ! Que ce soit volontairement ou non qu’elle vous ait embrassé, je ne veux pas la revoir ! Il faut qu’aujourd’hui même elle quitte sa cabine pour aller avec les gens de service.
– Voulez-vous que je lui donne immédiatement des ordres à ce sujet ?
– Non, pas du tout. Je ne veux pas que vous lui parliez ! Cette fille vous aime peut-être, qui sait ?
– Jalouse !
– On n’est jaloux que de ce que l’on aime !
– Vous m’aimez donc un peu ?
– En doutez-vous, méchant !
Et Frédérique, dans un geste adorable et pudique, tendit son front à Roger qui l’effleura d’un chaste baiser.’
À cet instant, Andrée de Maubreuil entrait en coup de vent dans le petit salon.
– Ah ! dit-elle en riant, je vous y prends, les amoureux !
Frédérique se recula, toute confuse.
– Nous étions en train de nous réconcilier, murmura-t-elle.
– Il ne faut pas que ma présence empêche que la réconciliation soit complète ! s’écria Andrée en faisant mine de se retirer.
– Reste, au contraire, ma chère amie, répliqua Frédérique, il faut précisément que je te parle.
– Alors, je vous laisse, mesdemoiselles, fit Roger, qui, au fond, n’était pas fâché d’esquiver une seconde réédition des aventures de Mercédès.
Andrée écouta patiemment les confidences détaillées de son amie.
– Tu comprends, lui dit celle-ci en terminant, qu’après ce qui s’est passé Mercédès ne peut plus demeurer à ton service.
– Tu as raison, répondit Andrée. Je vais à l’instant même lui signifier son congé. Et pourtant, c’est dommage, car elle m’était très dévouée. Veux-tu venir avec moi ?
– Non, car je ne serais pas capable de me contenir ! Je lui dirais des injures, à cette fille qui s’est permis d’embrasser mon Roger !
– Eh bien, soit, reste ici ! Je vais seule me charger de cette corvée.
Andrée de Maubreuil retourna dans sa cabine et sonna la soubrette, qui accourut aussitôt.
Très calme, Mlle de Maubreuil lui expliqua que, tout en étant, pour son compte personnel, très satisfaite de son zèle, elle se trouvait forcée, à cause de la scène de la veille, de se priver de ses services.
En entendant cet arrêt la danseuse pâlit ! Elle était à la fois humiliée et désolée, car elle était très sincèrement attachée à Mlle de Maubreuil, qui, la commandant sans rudesse, lui faisant de temps en temps de petits présents, avait su gagner son amitié.
– Moi qui avais tant d’affection pour Mademoiselle, murmura Dorypha. Vrai, j’ai le cœur gros de quitter Mademoiselle de cette façon-là ! Mais croyez-vous que, si je faisais mes excuses à M. Roger, on ne me permettrait pas de rester près de vous ?
– Impossible, ma pauvre Mercédès ! Mr. Edward Edmond lui-même a exigé que vous alliez désormais habiter dans la partie du yacht réservée au personnel.
Au nom d’Edward Edmond, la gitane avait bondi. Ses sombres yeux noirs lançaient des éclairs.
– Comment, c’est lui ! s’écria-t-elle d’une voix rauque, le poing sur la hanche, dans une pose qui eût rappelé ses attitudes favorites sur les planches des music-halls. Le misérable !… Eh bien, puisqu’il en est ainsi, je vais vous apprendre une chose… Edward Edmond est mon amant… et cela, depuis longtemps… Et c’est pour ne pas se séparer de moi qu’il m’a fait entrer à votre service !
Elle ajouta, en cambrant son torse dans un mouvement plein de fierté :
– Est-ce que j’ai l’air d’une femme de chambre, moi ! Je suis une danseuse, une gitane, une fille de joie, tout ce que l’on voudra, mais je ne suis pas une servante !…
Sa voix prenait des intonations crapuleuses et stridentes que Mlle de Maubreuil ne lui connaissait pas ; la jeune fille était stupéfaite de cette soudaine transformation.
– Oui, continua la gitane de plus en plus irritée, si Edward Edmond veut que je revienne près du personnel, c’est pour m’avoir près de sa cabine et pour se glisser le soir dans mon lit, quand tout le monde dormira !
– Taisez-vous ! s’écria Andrée de Maubreuil, toute rougissante de cette crudité d’expression.
Mais il eût été aussi impossible de faire taire la Dorypha que d’arrêter dans son cours un torrent déchaîné. Elle parlait avec une volubilité increvable, accablant l’Irlandais d’injures en toutes les langues collectionnées par elle dans tous les bouges de l’univers.
Andrée était abasourdie de ce déluge de mots argotiques, dont le sens, heureusement, lui échappait en grande partie. La danseuse était comme secouée des pieds à la tête d’une épouvantable fureur. Elle s’arrêtait quelques secondes pour reprendre haleine, puis elle se lançait de nouveau dans une kyrielle d’invectives.
À la fin, pourtant, Andrée réussit à la faire taire en l’assurant qu’elle garderait toujours un bon souvenir d’elle. Elle lui remit la somme convenue pour ses gages et, en même temps, elle lui fit cadeau d’une petite montre de femme en argent dont la gitane avait depuis longtemps grande envie.
Cette munificence toucha profondément la danseuse.
– Je ne suis pas digne de vos bontés, mademoiselle, murmura-t-elle humblement. Je vous ai trompée, mais vous avez été très bonne pour moi et je ne l’oublierai jamais ! Avant de vous quitter, je vais vous donner un conseil et vous révéler un secret. Méfiez-vous d’Edward Edmond et des autres. Il y a, sur le yacht, des gens de la Main Rouge qui vous veulent beaucoup de mal. Soyez sur vos gardes, c’est tout ce que je puis vous dire !…
Avant qu’Andrée de Maubreuil, atterrée, ait songé à lui poser de nouvelles questions, Dorypha pirouetta sur ses talons et sortit de la cabine.
Andrée demeura quelques minutes plongée dans le silence de la consternation ; elle était persuadée que la danseuse n’avait pas menti et maintenant, une foule de petits faits, auxquels elle n’avait pas d’abord fait attention, lui apparaissaient sous leur véritable jour.
– Il faut, murmura-t-elle, toute palpitante d’angoisse, que j’aille prévenir de tout cela M. Ravenel, M. Paganot et M. Agénor.
Sans perdre un instant, elle se dirigea vers le salon de lecture où se tenaient les trois Français.
CHAPITRE V
Le punch
Lorsque Andrée de Maubreuil pénétra dans le petit salon-bibliothèque, l’ingénieur Paganot lui fit signe de garder le silence un instant car lui-même et ses deux compagnons, Agénor et Roger Ravenel, étaient chacun pour sa part plongés dans des calculs compliqués.
Au bout de cinq minutes, tous trois se communiquèrent le résultat de leurs travaux, et Roger, qui était un mathématicien de premier ordre, énonça les chiffres obtenus par une dernière opération ; son visage annonçait la consternation et l’inquiétude.
– Savez-vous, dit-il, quelle est actuellement la situation du navire ? la Revanche se trouve en ce moment par 40 degrés de latitude nord et 170 de longitude est.
– C’est-à-dire, s’écria Paganot, que nous sommes à plus de deux cents lieues de l’endroit où nous devrions être ; nous n’avons pas cessé de marcher vers l’ouest, quand nous aurions dû remonter vers le nord.
– J’ai été des premiers à m’apercevoir, dit Agénor, qu’il faisait une chaleur excessive. Et Mlle Frédérique a fait la même remarque que moi !
Agénor sonna. La petite femme de chambre écossaise apparut.
– Ketty, dit l’ingénieur, voulez-vous prier Mr. Edward Edmond de venir me dire un mot, j’ai un renseignement à lui demander.
La soubrette s’éclipsa et revint cinq minutes après, la mine décontenancée.
– Mr. Edward Edmond, fit-elle, a dit qu’il n’avait pas le temps de venir, qu’il était très occupé ! Il m’a presque envoyée promener.
– C’est bien, Ketty, je vous remercie, dit Roger. Vous pouvez vous retirer.
Et il ajouta :
– Cette insolence de l’Irlandais ne justifie que trop nos soupçons. Il faut absolument sortir d’une situation aussi fausse. Avec la Main Rouge, on peut s’attendre à tout ! Nous pouvons être nuitamment égorgés avant d’avoir eu le temps de nous mettre en défense, nous pouvons être jetés sur quelque récif du Pacifique… Ah ! pourquoi faut-il que Fred Jorgell ait eu l’imprudence de s’en rapporter à ce traître d’Irlandais pour le recrutement des matelots ?
– Heureusement, fit l’ingénieur, que nous avons eu aujourd’hui la bonne idée de relever le point. Si nous ne l’avions pas fait, nous étions entraînés Dieu sait vers quelle rive inconnue.
– Inutile de revenir sur ce qui est passé, déclara Roger d’une voix ferme. Il s’agit maintenant de prendre des résolutions énergiques et de tirer de la situation le meilleur parti possible.
« Voici ce que je propose : la Revanche, vous ne l’ignorez pas, est divisée par des cloisons étanches en tôle de nickel. La première chose à faire, ce me semble, doit être d’isoler du reste du navire la partie que nous occupons en fermant intérieurement les portes de métal de la cloison. Comme cela, du moins, nous serons sûrs que les bandits ne pourront pas pénétrer chez nous. C’est M. Agénor qui va bien vouloir se charger immédiatement de cette opération.
« Pendant ce temps, l’ami Paganot et moi, nous irons trouver Slugh et nous lui demanderons des explications catégoriques, en le mettant au courant de ce que nous venons d’apprendre. Nous verrons tout de suite s’il est de bonne foi. Et dans ce cas, nous prendrons, de concert avec lui, les mesures nécessaires, comme par exemple de faire mettre aux fers sans le moindre délai tous les marins d’une allure suspecte et, certes, ils sont nombreux à bord.
– Et moi, demanda Andrée, que ferai-je ? En quoi puis-je vous être utile ?
– D’abord, vous mettrez au courant Mlle Frédérique de la situation, mais en évitant de l’effrayer. Et pendant notre courte absence, vous veillerez toutes les deux à ce que personne, sous quelque prétexte que ce soit, ne pénètre dans le quartier des cabines.
Ces résolutions furent approuvées de tout le monde, et on se mit en devoir de les mettre à exécution sans le moindre retard.
Andrée alla rejoindre Frédérique. Agénor courut fermer les portes de nickel de la cloison étanche, et l’ingénieur et le naturaliste, après avoir vérifié soigneusement l’état de leurs brownings, se mirent à la recherche du capitaine Slugh.
La nuit tombait. Le soleil se couchait derrière un amoncellement de nuages couleur de sang et sur ce fond tragique, les silhouettes des matelots, groupés sur le pont et discutant avec animation, prenaient une apparence sinistre.
Les deux Français remarquèrent tout d’abord que personne, parmi les gens de l’équipage, ne s’occupait d’un travail quelconque. Tous étaient là, la pipe ou le cigare à la bouche, et rien ne ressemblait moins que cette cohue débraillée à un équipage bien discipliné.
– Je crois, murmura Roger Ravenel, que la situation est encore plus grave que nous ne l’avions cru. Tous ces hommes ont des mines de bandits. Jamais je ne m’en suis rendu compte aussi clairement.
– Silence, fit Paganot ; j’aperçois justement Slugh en train de pérorer au milieu d’un groupe.
Les deux jeunes gens s’avancèrent. À leur aspect, ceux qui entouraient Slugh s’étaient dispersés. Le capitaine s’avança avec son habituel et débonnaire sourire.
– Qu’y a-t-il pour votre service ? demanda-t-il. Quel temps magnifique ! Il n’y a pas un souffle de vent ! On peut bien dire que ces dames sont favorisées. J’ai rarement effectué de traversée aussi calme.
– Il ne s’agit pas de cela ! répliqua Roger d’une voix nette. Nous avons à vous parler, capitaine. Il se passe ici des choses que vous ne devez pas tolérer.
– Hein ? fit Slugh avec surprise.
– Comment se fait-il, poursuivit le jeune homme, qui avait grand-peine à demeurer maître de lui, que la Revanche continue à faire route vers l’ouest au lieu d’aller vers le nord, comme nous en avons donné l’ordre ?
– Hum ! répondit Slugh interloqué, je vous expliquerai cela. Il y a des aires de vent plus favorable que nous avons dû suivre et qui nous ont forcés à un léger écart vers l’ouest, puis il fallait éviter les icebergs flottants.
Slugh se perdit dans une explication confuse et très embrouillée, dont une seule chose ressortait clairement : c’est qu’il était très embarrassé de la question qu’on venait de lui poser.
– Passons, continua Roger, nous reviendrons tout à l’heure sur ce sujet, mais j’ai une autre question à vous poser. C’est au sujet de l’appareil de télégraphie sans fil… Comment se fait-il que dès le début du voyage il se soit trouvé inutilisable ?
– On travaille à le réparer ! Je vous assure…, protesta le capitaine avec le ton d’indignation d’un homme injustement soupçonné.
Pendant cette conversation, les matelots s’étaient petit à petit rapprochés du groupe formé par le capitaine Slugh et les deux Français, et leur attitude n’était rien moins qu’agressive. Ils écoutaient ce qui se disait avec une tranquille impudence.
Au moment où Slugh dit qu’on s’occupait de réparer l’appareil de télégraphie, un murmure menaçant lui couvrit la voix :
– Tais-toi, Slugh ! criaient les marins. Ce n’est pas la peine de donner tant d’explications à ces gens-là ! Tu n’as qu’à leur dire qu’ils sont prisonniers de la Main Rouge, c’est tout ce qu’ils ont besoin de savoir !
– Silence, vous autres ! clama Slugh d’une voix tonnante.
– Silence toi-même ! ripostèrent plusieurs voix.
– Oui, tais-toi !
– Pas tant de façons avec les Français. On dirait que tu prends parti pour eux !
– Vive la Main Rouge ! beugla un troisième, dont l’acclamation fut répétée par une cinquantaine de voix.
Le tumulte était à son comble. Roger Ravenel et Paganot voyaient le moment où ils allaient être cernés par la foule sans cesse grossissante des bandits. On n’écoutait même plus Slugh ; un groupe de forcenés l’avait bousculé, aux cris de : « À bas Slugh ! Vive le capitaine Knox ! Nous voulons le capitaine Knox ! »
Les partisans de Slugh, qui se ralliaient aux cris de : « Vive la Main Rouge ! » vinrent à son secours. Il s’ensuivit une bagarre, où les coups de poing et les coups de revolver se succédaient sans relâche. Les deux Français en profitèrent pour battre en retraite du côté des cabines, mais ce ne fut pas sans avoir entendu plusieurs balles siffler à leurs oreilles. Ils n’en auraient sans doute pas été quittes à si bon compte si la Dorypha, qui décidément avait jeté aux orties le tablier à bavette et le bonnet tuyauté des caméristes, n’avait tout à coup paru sur le pont. Elle portait un ruban rouge dans les cheveux et son corsage largement décolleté laissait apercevoir une gorge opulente. Par une brusque métamorphose, elle était redevenue la danseuse acclamée des music-halls et des tavernes.
Son arrivée produisit une sensation profonde et fit diversion à la poursuite engagée contre les Français. Et comme quelques-uns menaçaient de passer outre, elle les prit vivement à partie.
– Ne vous occupez donc pas des passagers ! s’écria-t-elle. Est-ce qu’ils s’occupent de vous ? Ceux qui essayeront de les embêter auront affaire à moi ! Et d’abord je ne danserai plus si on ne laisse pas les Français tranquilles !
Ce fut une acclamation générale.
– Vive la Dorypha !
– Il faut qu’elle danse !
– Au diable les Français !
– Nous sommes les maîtres, dit un athlétique matelot aux bras tatoués. Il faut nous amuser !
Cette proposition rallia toutes les opinions. On eût dit que la présence de la Dorypha avait affolé tous ces hommes. Au milieu du tapage, Slugh n’arrivait plus à se faire entendre et les partisans de Knox, qui réclamaient sa délivrance avec tant d’ardeur quelque temps auparavant, ne songeaient plus à lui.
En quelques minutes l’orgie s’organisa.
Deux hommes apportèrent sur le pont un tub en fer émaillé trouvé dans une cabine ; on défonça une barrique de rhum, on se procura du sucre à la cuisine, et bientôt, du tub transformé en gigantesque bol à punch, une grande flamme bleue et livide monta dans l’atmosphère tranquille du soir.
Armés de leurs bidons de fer-blanc, les matelots puisaient à même la liqueur brûlante et quand le tub menaçait de se vider, on le remplissait de nouveau.
Bientôt, l’ivresse atteignit à son paroxysme. Un grand nombre hurlaient des chansons à boire ; d’autres, déjà assommés par l’alcool, ronflaient à poings fermés, à plat ventre sur le pont ; mais la grande majorité avait formé une ronde gigantesque qui tournait autour du punch avec une vertigineuse rapidité.
Dorypha avait pris place au centre, tout près de la flamme qui, l’éclairant de ses fantastiques reflets, la faisait paraître tour à tour bleue et verte et donnait à sa beauté quelque chose de spectral.
Elle apparaissait alors comme une des mortes sacrilèges dont parle la légende et qui s’arrachent de temps à autre au sommeil du tombeau pour apparaître de nouveau sur le théâtre de leurs anciennes débauches.
Elle dansait avec une ardeur infatigable, déployant tour à tour toutes les richesses de son répertoire de gambades excitantes et de poses lascives. On eût dit qu’elle avait du feu dans les veines. Et la ronde échevelée continuait à tourner autour d’elle, avec des contorsions et des rires démoniaques, dans un ouragan de vertige.
De temps à autre, elle s’arrêtait, essoufflée, et se reposait une minute, haletante, le front moite, son corsage de soie traversé de sueur aux aisselles ; alors la ronde s’arrêtait aussi et chacun buvait à longs traits, puis la danse reprenait de plus belle, aux acclamations mille fois répétées de : « Vive la Dorypha ! »
C’est dans un de ces brefs intermèdes qu’Edward Edmond, à qui cette orgie ne plaisait qu’à demi, s’approcha de la danseuse la bouche en cœur et voulut l’embrasser, mais une maîtresse gifle le rappela au sentiment des convenances et l’envoya rouler à trois pas de là, à la grande joie des assistants.
La vue de l’Irlandais avait ranimé toute la colère de la gitane contre lui.
– Va-t’en, lui cria-t-elle, je ne veux plus te voir ! Je te déteste ! Tu es un traître ! un coquin ! Tu es laid ! tu es bête ! va-t’en !
Cette scène amusait infiniment les matelots et ils prodiguaient à la Dorypha toutes sortes d’encouragements bruyants.
L’hercule aux bras tatoués, qui le premier avait eu l’idée de faire du punch, s’était approché de la danseuse qu’il couvait d’un regard chargé de désirs, d’un regard humble et implorant.
– Señora, balbutia-t-il, enhardi par l’énorme dose de punch qu’il venait d’ingurgiter, je vous aime, moi ! Est-ce que, si je vous le demandais, vous me refuseriez un baiser ?
La Dorypha toisa le solliciteur d’un coup d’œil. Sa carrure athlétique, ses joues fraîches lui plurent et la mine furieuse de l’Irlandais dans son coin acheva de la décider.
– Eh bien, soit, balbutia-t-elle en baissant les yeux avec un sourire de fausse pudeur.
Et elle tendit ses lèvres au matelot qui les broya d’un baiser, brutal et goulu comme une morsure.
La Dorypha porta la main à son cœur.
– Tu m’as fait mal, murmura-t-elle, mais c’est bon ! Viens que je t’embrasse encore !
Les yeux mi-clos, elle se laissa aller à la renverse dans les bras de l’homme qui l’embrassait avec frénésie.
Mais cette scène avait réveillé les passions endormies de la multitude. Un cri, puis mille cris s’élevèrent.
– Et moi, Dorypha, tu ne m’embrasses pas ?
L’hercule aux tatouages, un Flamand nommé Pierre Gilkin, ne l’entendit pas ainsi ; la Dorypha lui avait laissé entendre qu’elle l’aimait et personne d’autre que lui ne toucherait à la danseuse. Il y était fermement résolu.
Les poings serrés, il s’était placé en face d’elle et les premiers qui voulurent approcher allèrent rouler à quelques pas de là, la mâchoire quelque peu endommagée.
– Que personne ne bouge ! criait Gilkin, ou je lui mets les tripes au vent !
Pour appuyer ses dires, il sortit de sa poche un bowie-knife, long et luisant comme une épée.
Les amis du Flamand, et il en comptait un certain nombre à bord, se rangèrent autour de lui. Une tuerie allait certainement avoir lieu.
Dorypha, un poing sur la hanche, contemplait ce spectacle en souriant, comme devait sourire la belle Hélène en voyant les Grecs et les Troyens s’entre-tuer pour la possession de sa beauté.
C’est alors qu’un vieux marin, plein de prudence, s’avança jusqu’auprès du tub à punch et, d’une voix qui domina le tumulte des cris et des jurons :
– Camarades, dit-il, tenez-vous tranquilles ! La Dorypha est bien libre de sa peau ! Elle a le droit d’en faire ce qu’elle veut ! Si elle aime Gilkin, eh bien, tant pis pour vous et tant mieux pour lui !
Ce discours, plein de sagesse, obtint l’approbation d’une grande partie de l’assistance et des cris nombreux de :« Silence ! Écoutez-le ! » engagèrent l’orateur à continuer.
– On dansait, on buvait, fit-il, on s’amusait gentiment… pourquoi ne pas continuer ? On a bien assez d’occasions de s’embêter dans la vie !
Le matelot philosophe eut gain de cause ; une minute après, les chants et les danses, les rires et les trépignements avaient repris comme si rien ne s’était passé.
La fête se prolongea fort avant dans la nuit. Vers deux heures du matin, l’aspect du pont de la Revanche était celui d’un champ de bataille. Aux dernières lueurs du punch agonisant, les matelots, vautrés dans la posture où l’ivresse les avait surpris, dormaient presque tous d’un accablant sommeil ; Dorypha, épuisée, essuyait son front mouillé de sueur ; Pierre Gilkin la couvait des yeux, comme un avare son trésor.
Puis, tout à coup, il saisit la gitane dans ses bras, la souleva de terre comme si elle n’eût pas été plus pesante qu’une enfant et l’emporta jusqu’à sa cabine.
Avouons-le, Dorypha ne lui opposa pas la moindre résistance.
CHAPITRE VI
La révolte à bord
Lorsqu’ils eurent regagné les cabines de l’arrière, l’ingénieur Paganot et Roger Ravenel se mirent aussitôt en devoir de barricader les deux couloirs qui aboutissaient au pont, de façon à n’être pas victimes d’une surprise.
Ils étaient bien armés et ils avaient des munitions en abondance. Ce qui les inquiétait le plus, pour le moment, c’était la question des vivres. Les cuisines et les cambuses se trouvaient en dehors du compartiment que protégeait la cloison étanche et, d’un autre côté, il ne fallait pas songer à traverser le pont. C’eût été courir à une mort certaine. Heureusement qu’il se trouvait encore, dans les armoires de la salle à manger, des boîtes de conserve, des caissettes de gâteaux secs et quelques bouteilles de vin et d’eau minérale. Il fallut, ce soir-là, se contenter de ce menu.
Tous firent contre mauvaise fortune bon cœur et mangèrent avec plus de gaieté et d’appétit que l’on n’aurait pu s’y attendre.
On prit le thé et on se coucha à l’heure habituelle, mais, par mesure de prudence, les trois Français montèrent la garde tour à tour, et ils assistèrent de loin à la fangeuse orgie dont le pont de la Revanche fut le théâtre.
Au matin, l’aspect du yacht était lamentable. Le pont était couvert d’immondices de toutes sortes et encore jonché d’ivrognes qui avaient passé la nuit à la belle étoile. On eût dit un navire de pirates.
Les trois Français se dirent qu’à la faveur de ce désordre il leur serait peut-être facile de se rendre jusqu’à la cambuse et d’en rapporter des vivres pour plusieurs jours. Ils risquèrent donc une sortie, se faufilant le long des bastingages et se cachant dans tous les angles propices, mais ils avaient à peine dépassé le pied du mât de misaine qu’ils étaient découverts. Ils n’eurent que le temps de regagner l’arrière sous une grêle de balles.
Ce matin-là, on se partagea les dernières miettes des gâteaux secs et le fond des bouteilles ; la situation apparaissait dans toute son horreur. Le repas fut morne et silencieux.
Quand il fut terminé, ce qui ne demanda pas beaucoup de temps, Andrée et Frédérique se retirèrent dans leur cabine, pendant qu’Agénor, Paganot et Ravenel tenaient conseil. Une pareille situation ne pouvait se prolonger. Tout moyen d’en sortir, fût-il périlleux, désespéré même, serait le bienvenu.
Pendant que les trois Français étudiaient, tour à tour, cent projets plus impraticables les uns que les autres, le pont de la Revanche était le théâtre de nouvelles scènes de désordre. Les coups de revolver avaient réveillé la plupart des ivrognes. Vite remis d’aplomb, en gens qui ont l’habitude de ces sortes d’excès, ils n’avaient pas tardé à se grouper, les uns autour de Slugh, les autres autour du capitaine Knox qu’une main inconnue avait remis en liberté dans le courant de la nuit, et la discussion de la veille recommençait, rendue plus âpre et plus ardente par la présence du vieux pirate.
C’était ce dernier qui réunissait le plus grand nombre de partisans, car il était doué d’une éloquence persuasive, et les promesses qu’il faisait étaient beaucoup plus brillantes que celles de Slugh.
– Camarades, s’écriait Knox, si vous ne suivez pas mes conseils, vous laissez passer une occasion unique, une occasion qui ne se représentera jamais ! Nous avons sous les pieds un magnifique navire, bien pourvu, bien approvisionné, avec lequel nous pouvons naviguer trois mois sans faire escale.
« Je ne vous en demande pas plus, moi, pour faire votre fortune à tous. Je connais, Dieu merci, sur le bout du doigt les moindres îlots de l’Océanie. Je sais où se trouvent les pêcheries de perles, les magasins de copra et d’écaille ; je connais tous les comptoirs allemands et anglais, depuis Malacca jusqu’à la Nouvelle-Zélande. Et où trouverez-vous un capitaine qui connaisse son affaire aussi bien que moi ?
« Slugh se moque de vous. Ça lui est bien égal, à lui, que vous restiez gueux toute votre vie, ou que vous vous fassiez trouer la peau pour le service de la Main Rouge. Il est largement payé, lui ! C’est un des chefs de la bande et, à côté de lui, vous n’existez pas ! Vous n’êtes que de pauvres imbéciles, bons, tout au plus, à recevoir les coups.
Il y avait dans ces allégations tant de vraisemblance que le nombre des partisans du capitaine Knox, qui se livrait à une propagande infatigable, allait croissant d’heure en heure.
Slugh avait pourtant aussi ses fidèles. À ceux-là, il promettait que la Main Rouge les récompenserait royalement, tandis qu’elle réservait de terribles châtiments à ceux qui voudraient faire les mutins.
– Quel avenir vous attend avec Knox ? répétait-il, celui d’être pendus haut et court à la vergue d’un croiseur. Le capitaine croit donc que les choses se passent comme il y a trente ans ? Je puis vous prédire à l’avance tout ce qui aura lieu. Vous pillerez quelques méchants navires de commerce, quelques entrepôts de copra, puis le bruit se répandra qu’il y a des pirates dans tels parages, on fera marcher le télégraphe, deux ou trois navires de guerre se mettront à votre poursuite, vous serez pris – vous connaissez la loi : aussitôt pris, aussitôt pendus.
Les deux bandes rivales ne s’en tinrent pas aux paroles. Des coups de revolver furent échangés, mais, chaque fois, Slugh et Knox lui-même intervinrent pour que ces combats singuliers ne fussent pas le signal d’une mêlée générale.
Chacun des deux chefs se croyait intéressé au maintien du statu quo.
Knox se disait que plus on attendrait, plus le nombre de ses partisans s’augmenterait, et Slugh, de son côté, pensait qu’en gagnant du temps il trouverait quelque stratagème qui le rendrait maître de la situation.
Cependant, aucun des deux partis ne tenait à être désarmé ou privé de vivres et d’alcool ; aussi Knox et Slugh firent-ils placer des sentinelles à la porte de la soute aux vivres et du magasin d’armes.
La question du sort réservé aux Français avait été aussi agitée dans les deux camps ; Slugh, conformément aux ordres qu’il avait reçus, voulait qu’ils fussent massacrés, sauf Andrée de Maubreuil.
Par esprit de contradiction, dès qu’il connut les intentions de son rival, Knox déclara que la vie des Français et des Françaises était sacrée. À eux seuls, ils représentaient une fortune. N’étaient-ils pas les amis du milliardaire Fred Jorgell ? Il suffirait de les enfermer dans quelque îlot désert et de ne leur rendre la liberté que moyennant une énorme rançon.
Le vieux pirate attachait une telle importance à la capture des Français que, dans l’après-midi, il essaya de s’en emparer en dirigeant une attaque en règle contre les cabines.
Slugh le laissa faire, se disant que, s’il y avait quelqu’un des savants de tué, ce serait autant de besogne de faite pour la Main Rouge.
Mais le capitaine Knox eut une réception à laquelle il était loin de s’attendre. Le premier de ses hommes qui essaya de s’approcher des cabines de l’arrière roula à terre, le crâne fracassé d’une balle. Un second puis un troisième eurent le même sort.
Knox était furieux, comprenant que le trépas de ses partisans allait porter une grave atteinte à sa popularité.
D’un autre côté, à cause de la rançon, il voulait prendre les Français vivants.
Ceux-ci ne semblaient nullement disposés à se laisser faire. Ils dirigeaient contre leurs ennemis un feu bien nourri, car Agénor aussi bien que le naturaliste et l’ingénieur étaient d’excellents tireurs, et Frédérique et Andrée, aidées de la femme de chambre écossaise, rechargeaient et nettoyaient les armes au fur et à mesure, avec un sang-froid héroïque.
Knox et ses partisans finirent par se retirer du côté de l’avant pour tenir conseil, et malgré les rires et les huées que ne leur ménageaient pas les partisans de Slugh, ils se préparaient à une seconde attaque, mieux combinée que la première, lorsqu’il se produisit une intervention inattendue.
Le Flamand Pierre Gilkin, entouré d’une douzaine d’amis, s’avança tout à coup vers Knox, et, lui mettant sur l’épaule son poing énorme :
– Toi, lui dit-il, si tu ne laisses pas ces gens tranquilles, je t’aplatis le crâne comme une noisette !
Knox lâcha un juron, mais battit en retraite. Il avait compris que, s’il se mettait à dos le Flamand et sa bande, c’en était fait de son pouvoir.
Aussi prit-il à part Pierre Gilkin pour lui expliquer que c’était Slugh qui voulait tuer les Français, et que lui, Knox, ne voulait que les mettre à rançon.
Après une longue discussion, Knox promit de laisser les passagers de l’arrière tranquilles jusqu’au lendemain, à condition que les gens de sa bande ne prissent pas parti pour Slugh.
C’était à Dorypha qu’était dû ce protecteur inespéré. Devenue maîtresse en titre de Pierre Gilkin, elle faisait de lui ce qu’elle voulait. Elle n’avait eu aucune peine à lui persuader qu’il avait tout à gagner en prenant le parti du milliardaire Fred Jorgell.
– N’écoute que moi, querido mio, lui avait-elle dit, et tu t’en trouveras bien. Il est plus facile à Fred Jorgell de donner à quelqu’un un paquet de bank-notes qu’à toi de gagner un dollar.
Ces remontrances, ponctuées de baisers et d’affolantes caresses, avaient eu tout le résultat qu’elle en espérait.
Il y avait maintenant sur la Revanche trois partis bien distincts, et chacun gardait ses positions en attendant que la bataille décisive s’engageât.
Le reste de l’après-midi se passa sans incident. Les matelots s’étaient remis insoucieusement à boire, à jouer et à fumer ; à la nuit tombante, ils descendirent prendre leur repas, que les cuisiniers avaient apprêté à l’heure habituelle.
Slugh avait mis à profit cette espèce de trêve. Il avait réuni autour de lui quinze des plus fidèles et des plus anciens affidés de la Main Rouge, une élite sur laquelle il pouvait compter absolument, car presque tous avaient déjà fait un séjour à l’île des pendus. Il leur avait exposé son projet.
Il s’agissait tout simplement de fuir dans le grand canot après avoir mis le feu au navire, il suffirait pour cela de renverser un ou deux bidons de pétrole près des cabines de l’arrière, dont le bois et les peintures offraient un aliment facile à la flamme.
Pendant que Knox essayerait d’éteindre ce premier foyer d’incendie, un second, disposé à l’avant près de l’endroit où se trouvaient les poudres, achèverait l’œuvre de destruction.
Le canot était vaste, solide. Il serait pourvu des vivres nécessaires, et l’on savait qu’il se trouvait de nombreuses îles à moins de deux jours de distance.
Slugh finit par persuader tous ses hommes auxquels il promit, de la part de la Main Rouge, d’exceptionnelles récompenses.
Cet audacieux projet n’avait qu’un défaut aux yeux de Slugh, c’est qu’il impliquait la mort d’Andrée de Maubreuil, que les Lords lui avaient recommandé d’épargner. Mais il se dit qu’après tout le principal serait fait et qu’il trouverait bien un moyen de s’excuser.
Au repas du soir, il annonça son intention de passer une bonne nuit et se retira dans sa cabine. Ses hommes firent de même, et Knox, trompé par cette comédie, alla se reposer à son tour ; la présence des sentinelles placées près des cambuses et du magasin d’armes le rassurait pleinement sur la façon dont se passerait la nuit.
Bientôt le plus profond silence régna à bord de la Revanche. Les lumières étaient éteintes, tout le monde dormait ou faisait semblant de dormir.
Vers dix heures du soir, les quinze hommes de Slugh sortirent silencieusement de leurs hamacs, et, chargés de caisses de vivres, de tonnelets de rhum dont ils s’étaient précautionnés pendant la journée, se dirigèrent vers l’avant, où se trouvait le grand canot suspendu à ses portemanteaux.
Ils empilèrent dans l’embarcation les objets nécessaires à un long voyage. Ils n’eurent garde d’oublier une boussole, des munitions et quelques vêtements de rechange.
Slugh veillait en personne à ces préparatifs. Ce n’est que quand il fut bien sûr que rien d’essentiel ne serait oublié qu’il s’éloigna pour aller préparer lui-même les foyers d’incendie que devaient allumer des mèches d’une longueur calculée à l’avance.
CHAPITRE VII
La gitane héroïque
Dans le camp des Français, la journée s’était tristement terminée. Andrée et Frédérique n’avaient dîné que d’une tablette de chocolat, découverte par Agénor dans sa cabine, et que les deux jeunes filles s’étaient partagée ; quant aux hommes, ils n’avaient pris que quelques gorgées d’eau minérale ; encore cette ressource était-elle sur le point de leur manquer.
Il avait fait, l’après-midi, une chaleur accablante. Il était évident que les bandits qui s’étaient emparés du navire l’orientaient vers le sud-ouest, sans doute pour aborder dans quelqu’une des petites îles du nord de la Polynésie, et cette constatation donnait de grandes inquiétudes à l’ingénieur et à ses amis.
Après une soirée mélancoliquement passée, tout le monde, sauf Agénor qui était de faction, songea à se retirer dans sa cabine. On se souhaita le bonsoir, et Andrée et Frédérique embrassèrent leurs fiancés plus tendrement que de coutume. Elles avaient besoin de tout leur courage pour retenir les larmes qui leur montaient aux yeux ; et, avant de se séparer, une fois seules dans la cabine d’Andrée, elles se jetèrent en pleurant dans les bras l’une de l’autre.
– Chère Frédérique !
– Chère Andrée !
– Je sens que je ne vais pas fermer l’œil cette nuit. Je tremble qu’il n’arrive malheur à Roger.
– Oh ! moi, je suis sûre aussi de ne pas dormir. Si tu restais avec moi dans ma cabine, il me semble que j’aurais moins peur !
– Eh bien, oui, cela vaut mieux ainsi !… Mais tais-toi donc, il me semble que j’ai entendu parler…
Les deux jeunes filles écoutèrent avec attention.
Mlle de Maubreuil ne s’était pas trompée. Bientôt une voix – celle de Dorypha – se fit entendre dans le silence, appelant d’un ton précautionneux :
– Mademoiselle de Maubreuil ! Mademoiselle de Maubreuil !
– C’est vous, Mercédès ?
– Oui, mademoiselle.
– Mais où êtes-vous ?
– Dans la cabine voisine de la vôtre. Mettez-vous à la fenêtre, mais parlez bas !
– Qu’y a-t-il donc ?
– Faites ce que je vous dis ! Allongez la main !… Bien. Maintenant, prenez le paquet que je vous tends ! Faites attention… c’est assez lourd !
– En effet, mais qu’est-ce que c’est que cela ?
– Ne dites rien, c’est du jambon. Je sais que vous êtes réduites à la famine. Mais attendez, ce n’est pas fini ! Voici encore une caisse de conserves… vous la tenez bien ?
– Oui, mais je ne sais comment vous remercier.
– Prenez toujours… Vous me remercierez après. Voici du pain, du chocolat, maintenant. Ça va être le tour des bouteille car on ne peut pas manger sans boire, n’est-ce pas, señora ?
Et la gitane, toujours insouciante, eut un joyeux éclat de rire.
À ce moment, Andrée et Frédérique entendirent comme un bruit de lutte, puis le hublot de la cabine de Dorypha se referma avec un bruit sec, et elles distinguèrent, de l’autre côté de la cloison, les accents d’une brutale voix d’homme.
– Mon dieu, murmura Frédérique, la pauvre fille a été victime de son dévouement ! Elle vient d’être surprise par un de ces misérables ! Ils ne lui pardonneront pas d’avoir essayé de venir à notre secours !
Tremblantes d’angoisse, les deux jeunes filles essayèrent d’entendre la discussion qui avait lieu dans la cabine voisine et qui se poursuivait avec de grands éclats de voix, mais elles n’arrivaient qu’à saisir des bribes de phrases et des mots entrecoupés.
Au moment où la gitane se préparait à passer les bouteilles de vin dont elle avait parlé à Andrée de Maubreuil, elle s’était sentie brusquement saisie par les épaules, elle s’était retournée et elle s’était trouvée en face de l’Irlandais qui, furieux de se voir abandonné, n’avait cessé de l’espionner depuis la veille.
– Je t’y prends ! ricana le misérable, c’est toi qui fournis des vivres aux gens des cabines. Je vais prévenir tout le monde de ta trahison !
La gitane se débattait comme une hyène pour s’arracher à l’étreinte de l’Irlandais ; comme il ne la lâchait pas assez vite, elle lui planta dans les joues les ongles de ses dix doigts, le sang coula, Edward, furieux, hors de lui, criant de toutes ses forces :
– À moi, Slugh ! À moi, ceux de la Main Rouge ! Vous êtes trahis !… Au secours !… Venez vite !…
– Te tairas-tu, vile crapule !… gronda la gitane, qui d’une main impatiente et fiévreuse, cherchait son poignard.
La lutte entre Dorypha et son ex-amant se continuait, implacable et sourde, dans les ténèbres de la cabine.
Mais les cris de l’Irlandais avaient été entendus. Aux mots de Main Rouge et de trahison, tout le monde fut sur pied en un clin d’œil. L’électricité fut rallumée et les gens de la bande du capitaine Knox arrivèrent sur le pont au moment même où les partisans de Slugh commençaient à manœuvrer les palans qui retenaient la grande chaloupe sur ses portemanteaux. Ce fut de part et d’autre une explosion de rage.
– Personne ne touchera à cette chaloupe, déclara Christian Knox. Elle appartient au bâtiment et c’est moi, le capitaine, qui ai seul le droit d’en disposer.
– Le seul capitaine ici, c’est moi ! hurla Slugh, se départant pour une fois de son flegme habituel. Un peu de nerf, vous autres, dit-il à ses hommes, n’écoutez pas ce qu’il vous chante et halez ferme sur les palans !
– Je défends qu’on touche à cette chaloupe ! cria Knox en faisant jouer le déclic d’un gros revolver.
– On y touchera si l’on veut ! répliqua Slugh en exhibant à son tour un énorme browning.
– C’est ce que nous allons voir !
– C’est tout vu !
Slugh, d’un geste rapide, avait pressé sur la gâchette de son arme avant que Knox eût eu le temps de se mettre en défense.
Le vieux pirate tomba comme une masse, la poitrine trouée d’une balle. Il avait été atteint en plein cœur, tué net.
– Voilà comme je traite les ennemis de la Main Rouge ! s’écria Slugh d’un air terrible ; et maintenant, à qui le tour ?
Personne ne broncha et ce fut au milieu d’un profond silence que Slugh ordonna :
– Vous autres, laissez cette embarcation tranquille ! Ce n’est plus la peine ; maintenant que ce chenapan a cassé sa pipe, j’espère que tout le monde ici va marcher droit…
Il n’eut pas le temps d’achever sa phrase. Une gerbe de flammes venait de jaillir des cabines de l’arrière, illuminant tout le navire d’une lueur sanglante.
– By God ! jura le bandit. Le feu que j’avais oublié ! J’ai dû mal calculer la longueur de la mèche ! Mais vite, que quelqu’un aille éteindre le foyer de l’avant, près de la soute aux poudres.
– La soute aux poudres !
Ces mots terribles donnèrent des ailes aux moins ingambes ; en un clin d’œil, dix matelots, armés de seaux d’eau, se ruaient dans l’entrepont et arrivaient juste à temps pour éteindre la mèche du second foyer d’incendie. Les autres, Slugh en tête, couraient du côté des cabines d’arrière, dont le bois résineux, couvert d’une épaisse couche de peinture, brûlait avec de sinistres crépitements.
Du milieu des flammes, on entendait s’élever des cris de femmes.
Slugh, que son sang-froid n’avait pas abandonné une minute, ordonna de faire jouer les pompes et bientôt des torrents d’eau tombèrent au milieu du brasier.
Mais le feu, qui trouvait un aliment dans une foule de matières éminemment combustibles, ne paraissait pas diminuer d’intensité. On entendait les cris déchirants des Français, grillés vifs dans leurs cabines.
Slugh lui-même, par une contradiction qu’un psychologue se chargera d’expliquer, était sincèrement ému et donnait des ordres pour activer le sauvetage des passagers. Il voulait bien assassiner ces jeunes gens, qui ne lui avaient jamais fait de mal, mais il ne voulait pas les faire rôtir à petit feu, cela n’était pas dans ses ordres.
Disons-le, tout l’équipage, armé de seaux, de haches et de barres de fer, travaillait avec ardeur.
Un cri immense s’éleva de toutes les poitrines lorsqu’un homme aux vêtements en cendres, à la barbe brûlée, apparut au seuil d’une des cabines. C’était le poète Agénor, qui venait d’arracher aux flammes la petite femme de chambre écossaise.
Presque au même moment, Roger Ravenel, tenant dans ses bras Frédérique, tombait évanoui entre les mains des matelots qui se portaient à son secours.
Un peu après, l’hercule aux bras tatoués, Pierre Gilkin lui-même, retira des flammes le corps inanimé de l’ingénieur Paganot. On lui prodigua toutes sortes de soins, mais dès qu’il eut ouvert les yeux, il poussa des cris déchirants :
– Andrée, où est Andrée ? je veux la sauver !
Mais le malheureux, les mains et le corps atrocement brûlés, était incapable de faire un mouvement.
– Andrée, répétait-il, sauvez Andrée !
À ce moment, Dorypha, la gitane, fendit la foule des matelots. Après une longue lutte, elle avait enfin réussi à terrasser Edward Edmond et à lui glisser son stylet entre deux côtes. Elle souriait, heureuse.
– C’est moi qui sauverai Mlle de Maubreuil ! s’écria-t-elle, et, s’emparant d’un caban de matelot, elle le trempa dans un seau d’eau et le jeta sur ses épaules, puis, sans hésitation, elle se lança au milieu des flammes.
Pendant dix secondes il y eut un silence de mort. On n’entendait que le crépitement de l’incendie et le sifflement de l’eau immédiatement volatilisée au contact des charbons ardents.
Dorypha avait disparu derrière le rideau des fumées rousses, pailletées d’étincelles.
– Elle ne reviendra pas ! cria une voix dans le silence de la foule haletante.
– Qui a dit cela ? s’écria Pierre Gilkin. Je vais aller la chercher, moi !
Bousculant tous ceux qui voulaient le retenir, l’hercule s’avança vers le brasier, mais au moment où il allait y pénétrer, Dorypha reparut, portant sur son épaule, entortillé dans le vêtement mouillé dont elle s’était munie, un corps inerte. Il y eut une acclamation générale.
– Vive la Dorypha !
Tous s’empressaient pour la voir, pour la débarrasser de son fardeau et, en cet instant, elle eût fait ce qu’elle eût voulu de tous ces hommes.
Andrée de Maubreuil avait été déposée sur la couchette d’une des cabines des gens de service. L’ingénieur Paganot lui prodigua les soins les plus dévoués et il souffrait lui-même de cruelles brûlures. Il avait avalé en hâte une gorgée de whisky, et une sorte de fièvre l’empêchait d’avoir conscience de la douleur cuisante qu’il éprouvait.
Andrée de Maubreuil, dont la cabine se trouvait toute proche de la cloison étanche, n’avait presque pas souffert du feu, mais, au moment où la danseuse l’avait saisie, elle était déjà à demi asphyxiée.
L’ingénieur, auquel s’étaient joints Agénor et le naturaliste, maintenant rassuré sur le compte de Frédérique, appliquèrent à la jeune fille l’énergique traitement usité en pareil cas. On pratiqua des tractions rythmées de la langue et la respiration artificielle et Dorypha, dont la blonde chevelure avait été seulement un peu roussie, fit preuve envers son ex-maîtresse d’un dévouement infatigable, mais ce ne fut qu’après deux heures de soins qu’Andrée put être considérée comme hors de danger.
À ce moment, les matelots étaient maîtres de l’incendie, dont l’eau seule n’eût pas eu raison, mais qui avait fini par céder devant les bombes extinctrices dont Paganot avait heureusement emporté une provision.
Les luxueuses cabines de l’arrière, la salle à manger, les salons avaient été complètement détruits. Il n’en restait que des poutres noircies et à demi calcinées. Encore était-ce une chance inouïe que le feu n’eût pas atteint les réserves de pétrole destinées aux machines de bord et qui ne se trouvaient qu’à peu de distance de là.
Ce drame avait été si rapide que c’est à peine si les Français, un peu revenus à eux-mêmes, commençaient à se rendre compte de l’épouvantable danger qu’ils venaient de courir. Dorypha les mit au courant, sans oublier de faire un éloge très senti de son nouvel amoureux, Pierre Gilkin.
– Il faut absolument, dit tout à coup l’ingénieur, que je parle à Slugh. Maintenant qu’il a reconquis toute son autorité, j’espère que les choses vont changer d’aspect.
– Je vais avec vous, dit Agénor.
Tous deux s’avancèrent dans le couloir qui séparait les cabines, mais là ils se heurtèrent à deux matelots qui montaient la garde, la carabine sur l’épaule et la baïonnette au canon.
– On ne passe pas ! cria l’un d’eux aux Français.
– Mais je veux voir le capitaine, dit Agénor.
– On ne passe pas. Rentrez, ou je fais feu.
Du seuil de la cabine, Dorypha avait assisté à cette scène.
– Caramba ! s’écria-t-elle, nous allons voir si je ne vais pas passer, moi !
Elle marcha hardiment vers le matelot et, se campant effrontément en face de lui :
– C’est vrai que tu veux m’empêcher de passer ? fit-elle.
– Mes ordres ne vous concernent pas, répondit l’homme.
– C’est bien heureux ! Mais à tout à l’heure, je vais revenir.
Son absence fut assez longue. Quand elle se présenta de nouveau à l’entrée du couloir, elle était accompagnée de Pierre Gilkin et de cinq ou six de ses plus robustes camarades. Slugh venait à quelque distance en arrière, l’air mécontent. Les deux sentinelles de la Main Rouge cédèrent la place sans difficulté.
– Désormais, dit la danseuse aux Français, ce sont mes amis qui se chargent de veiller à votre sûreté. Vous allez vous installer le plus confortablement possible dans les cabines vides, et je vous jure, foi de gitane, que vous ne manquerez de rien !
« Le capitaine Slugh a compris que, s’il voulait faire le méchant, les amis de Pierre Gilkin, réunis aux anciens partisans du capitaine Knox, ne le laisseraient pas longtemps tranquille. Il a été convenu que Slugh nous débarquerait au premier port où nous voudrons atterrir. Après, lui et ses hommes iront au diable, s’ils le veulent, avec la Revanche. Voilà le seul moyen que j’aie trouvé d’arranger les choses.
– Nous ne demandons rien de plus, répondit l’ingénieur Paganot, parlant au nom de ses amis ; pourvu que nous soyons en sûreté avec les jeunes filles qui nous sont confiées.
– De cette façon, fit Slugh avec son sourire de bonhomie auquel personne ne se laissait plus prendre, tout le monde sera content.
Le bandit dissimulait mal son ironique satisfaction.
Une heure auparavant, grâce à la collaboration des deux plus anciens matelots du bord, il avait relevé la position exacte de la Revanche et ordonné au timonier de mettre le cap vers le nord.
– Dans deux ou trois jours, songeait-il, nous serons arrivés à l’île des pendus. Ma mission sera remplie. Je mettrai à terre les Français et leurs petites bonnes amies, et les Lords de la Main Rouge en feront tout ce qu’ils voudront. Pour moi, je m’en lave les mains ! Je crois que, dans des circonstances aussi difficiles, je n’ai pas mal mené ma barque…
Les Français se trouvaient hors d’état de déjouer une pareille ruse. L’incendie les avait privés des instruments nécessaires pour relever la position du yacht, puis ils étaient complètement absorbés par les soins que nécessitaient l’état de Frédérique et surtout celui d’Andrée. Enfin, ils avaient confiance dans la protection de Dorypha, qui avait été pour eux comme un bon génie.
Après tant de péripéties, la traversée leur semblait devoir s’achever dans les conditions les plus paisibles.