
Paul d’Ivoi
LE SERGENT SIMPLET
À TRAVERS
LES COLONIES FRANÇAISES
Voyages excentriques – Volume II
Librairie
Furne, Jouvet et cie, 1895
Illustrations Lucien Métivet
Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/
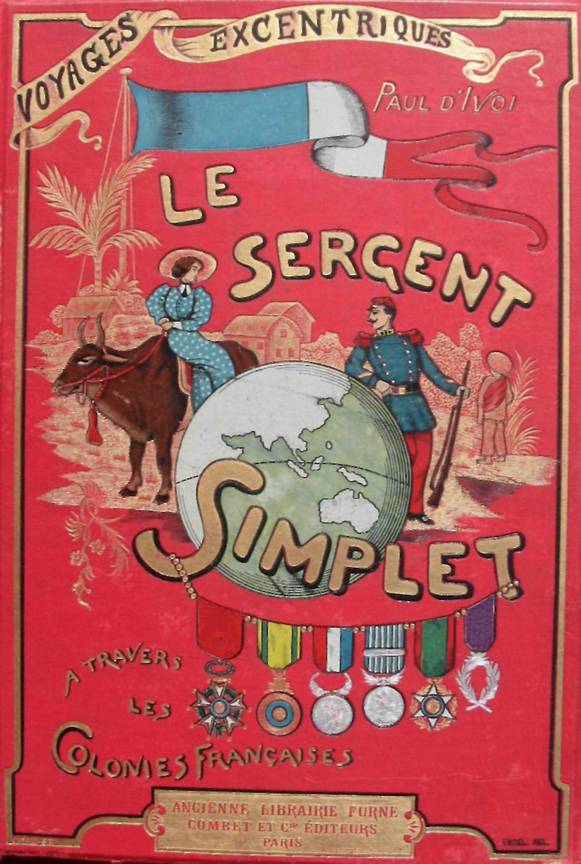
Table des matières
V PREMIÈRES HEURES HORS DE FRANCE
XVIII TROIS MILLE KILOMÈTRES DANS UN CYCLONE
XIX LE PAYS DES PIERRES PRÉCIEUSES
XXVIII SIMPLET DEVIENT CHIMISTE
XXXI LA REVANCHE DE GIRAUD-CANETÈGNE
À propos de cette édition électronique

Texte établi d’après l’édition Combet et cie Ancienne librairie Furne (sans date, probablement 1905)
I.
DEUX SOUS-OFFS
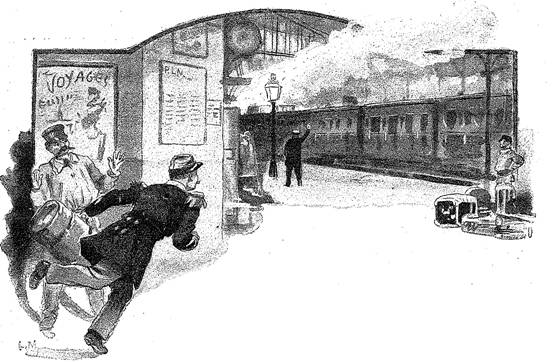
L’horloge de la gare de Grenoble marquait trois heures. Sur la voie montante le train pour Lyon était formé. Les employés pressaient les voyageurs retardataires et, courant le long du train, fermaient les portières avec violence.
Un coup de sifflet retentit.
Soudain un sergent d’infanterie de ligne parut à la porte des salles d’attente. Il courait tout essoufflé, une valise à la main.
Écartant un agent qui prétendait l’arrêter, il s’élança vers le convoi déjà en marche, ouvrit la portière d’un compartiment de seconde classe dans lequel il s’engouffra en coup de vent.
– Ouf ! quelle course, fit-il en allant tomber dans le seul coin inoccupé. Il posa sa valise à côté de lui et regarda ses compagnons de voyage.
À l’autre extrémité du wagon, deux hommes grands, à la face rougeaude, mi-bourgeois, mi-paysans, causaient à haute voix, avec l’importance de gens bien nourris à qui les écus ne manquent point.
En reportant ses yeux en face de lui, le jeune homme murmura :
– Tiens un autre pied de banc !
En effet son vis-à-vis se trouvait être un sergent d’infanterie de marine, aussi brun qu’il était blond, aussi bronzé qu’il l’était peu.
C’était sa vivante antithèse.
Alors que le lignard, de taille moyenne mais bien prise, avait l’œil bleu très doux, la moustache blonde relevée en crocs, la figure pleine ; le marsouin était grand, maigre, et des yeux noirs, durs, trouaient son visage cuit par le soleil.
Lui aussi portait la moustache ; mais les pointes pendaient mélancoliquement de chaque côté de la bouche, à la façon des vieux Celtes ou des modernes Chinois.
Il ne parut pas s’apercevoir de l’examen dont il était l’objet. Immobile, la tête renversée en arrière, il semblait absorbé par une pensée triste.
Un bruyant éclat de rire le fit tressaillir.
Les « pékins » se tordaient dans un accès de folle gaieté. L’un avait sans doute fait une remarque plaisante à l’adresse du sous-officier, car leurs yeux ne le quittaient point.
Il fronça le sourcil. Les rires redoublèrent. Du coup il se redressa et d’une voix sèche :
– Pardon, messieurs, ne pourriez-vous rire sans regarder de mon côté ?
– Cela vous gêne ? répliqua lourdement le plus jeune paysan.
– Énormément. Votre attitude, d’ailleurs, me donne à penser que je ne suis pas étranger à votre hilarité.
Ils ne répondirent pas. Ils riaient de plus belle, la bouche fendue jusqu’aux oreilles.
Puis celui qui n’avait pas encore parlé, une sorte de colosse, reprit :
– Vous avez mauvais caractère.
– C’est possible, je ne plaisante qu’avec mes amis.
– Oui, et parce que vous portez la livrée militaire…
– L’uniforme, rectifia le soldat en se soulevant légèrement.
– Vous croyez faire peur aux autres. Vous faites l’avale-tout-cru. Pas la peine avec nous, on est rustique. Allez, calmez-vous, ça vous évitera une mauvaise querelle.
Le marsouin était devenu blême ; il fit un mouvement pour s’élancer vers ses interlocuteurs.
Mais le rustre souleva un gros bâton sur lequel s’appuyaient ses mains calleuses et goguenard :
– Oh ! vous savez, sergent, vous n’êtes pas de force. Un contre deux qui en valent bien quatre.
Et pointant son gourdin en avant, il continua :
– Avec ces camarades-là… Qu’est-ce que vous pouvez ?
Jusque-là le lignard avait assisté à la scène sans un geste.
À ce moment, il étendit vivement la main, saisit la canne et d’une saccade l’arracha au paysan, tout en disant d’une voix tranquille :
– C’est bien simple, maintenant nous sommes trois de ce côté, y compris le camarade gourdin, et si vous ne vous excusez pas de votre insolence, nous vous battrons.
L’attitude calme et résolue du fantassin en imposa aux deux hommes, car en même temps ils s’écrièrent :
– Eh ! on ne se moquait pas de lui.
– Je veux le penser, mais on en avait l’air.
– Vous croyez ?
– Parfaitement !
– Ben quoi ! on vous fait des excuses alors.
– C’est bon !
Et tendant la canne au paysan tout penaud.
– Reprenez cela. Quand on a l’honneur de porter l’uniforme, on n’a pas besoin d’un morceau de bois pour se faire respecter.
Puis sans s’inquiéter davantage de ses adversaires, il se tourna vers le marsouin. Les jeunes gens se serrèrent la main.
– Je vous remercie, mon cher collègue, commença celui-ci.
Il l’interrompit :
– Oh ! c’est tout simple. Vous pouvez, du reste, me causer un grand plaisir en échange.
– Parlez !
– Parler précisément. J’ai horreur du voyage solitaire et muet. Si vous jugez la glace rompue… ?
– Fondue, mon cher collègue – et se levant à demi – Claude Bérard, sergent au 1er régiment d’infanterie de marine, libéré après la campagne au Dahomey et deux mois de convalescence à Toulon.
– Et moi, Marcel Dalvan, sergent au 35e de ligne, libéré en garnison d’Embrun, il y a quatre jours. Présentement propriétaire qui vient de s’occuper de vendre ses propriétés à Grenoble, et se dirige vers Lyon. Mais vous-même… ?
– Je me rends à Lyon… probablement à Paris ensuite. Pas propriétaire du tout, je suis en quête d’un emploi.
– Ah ! avez-vous une préférence quelconque ?
– Oui, le commerce.
– Bravo !
– Pourquoi bravo ?
– Parce que j’ai, à Lyon, des amis qui font la commission coloniale, et par eux je pense bien…
– Me trouver quelque chose ?
– Justement.
Le marsouin saisit la main du jeune homme et la serra énergiquement.
– Décidément, vous êtes mon sauveur !
– Pas du tout. Ça se rencontre comme cela. Et puis un sous-officier offre des garanties. On le prend de préférence à un civil, c’est bien simple.
– Il vous plaît à dire. Mais vous êtes en bons termes avec…
– Les négociants dont je parle ? Oh !… depuis deux ans je ne les ai pas vus. Mais c’est égal, si mon ami Antonin Ribor m’avait oublié, sa sœur Yvonne, ma sœur de lait à moi, aurait meilleure mémoire.
Et d’une voix émue :
– Si vous saviez comme elle est gentille et bonne ! C’est ma mère qui nous a nourris tous deux, puis élevés. Le père Ribor, voyageur infatigable, était toujours à trois mille lieues de ses enfants. Ah ! c’est une jolie fille, avec ses cheveux châtains, sa figure rieuse, ses grands yeux bruns et une voix, une vraie musique. Je serais allé au bout du monde, quand elle disait, en me regardant comme cela : Simplet.
– Simplet ? interrompit Claude Bérard.
– Un sobriquet. J’ai un tic. Il paraît que c’est un tic. Tout me semble simple. Alors…
– Simplet s’explique. Et elle, comment l’appeliez-vous ?
– Yvonne.
Claude sourit :
– Vous l’aimez beaucoup ?
– Je n’ai qu’elle.
– Et l’amitié avec une brave fille conduit au mariage.
Marcel Dalvan eut un soubresaut.
– Au mariage ! Ah bien ! si vous disiez ça devant elle, je vous garantis qu’elle rirait de bon cœur. M’épouser, elle !
Il riait, un peu gêné, un brouillard plus rose montant à ses joues.
– Le mariage, reprit-il. Depuis deux ans, elle ne m’a pas écrit.
– Pas une lettre ?
– Non. J’étais en garnison à Granville, on m’a expédié à Embrun…
– Ce n’est pas une raison.
– Je me suis montré négligent. Durant plusieurs mois, je n’ai pas écrit, puis je me suis décidé. Seulement elle devrait être vexée ; aucune réponse.
– Diable !
– C’est qu’elle a sa petite tête. Mais soyez tranquille, cela ne nous empêchera pas de nous embrasser avec plaisir.
Les stations se succédaient. Avec la confiance de la vingt-troisième année, les sous-officiers se racontaient leur existence.

Claude, orphelin, devenu à force de travail petit commis chez un éditeur. Puis le tirage au sort, 18e arrondissement (Montmartre). Le passage en Tunisie, au Tonkin, au Dahomey. Les joies et les souffrances des héros obscurs aboutissant à la libération, à la rentrée plate dans la vie de la métropole. Il disait son embarras, sa tristesse de se sentir seul, et à l’idée d’avoir rencontré un ami, la satisfaction qui faisait briller ses yeux, qui illuminait son visage grave.
La voix des employés criant : Lyon-Perrache, tout le monde descend, surprit les soldats.
Le voyage s’était accompli rapidement.
– Déjà ! firent-ils en même temps.
Puis tout réjouis, ils sautèrent sur le quai, traversèrent la salle d’attente remplie d’hommes, de femmes, d’enfants, attendant des voyageurs aimés et sortirent de la gare.
La nuit était venue, hâtive ; nuit de novembre.
Dans cette partie de la ville, conquise autrefois sur le Rhône et la Saône par le sculpteur Perrache, mais toujours humide, un brouillard épais régnait.
– Où allons-nous ? demanda Claude.
– Chez mes amis, parbleu. C’est à deux pas, rue Suchet.
– Mais c’est l’heure du dîner et je ne sais si…
– S’ils nous inviteront ? Vous allez voir ça. La maison de commission A. Ribor et Cie est hospitalière, et vous, qui venez des colonies, serez doublement bien reçu.
Tous deux marchaient d’un bon pas, frissonnant un peu sous le manteau froid de la brume, mais heureux à la pensée du gîte tout proche, des hôtes aimables.
– Voilà le progrès, murmura Marcel.
– Où cela ?
Le lignard se prit à rire.
– Je continuais à haute voix une pensée commencée tout bas.
– Ah ! pardon.
– Ce n’est plus un secret depuis que les savants s’en sont occupés. Je me disais : En l’an 500 avant Jésus-Christ.
– Pristi ! interrompit Bérard, vous êtes bien renseigné, vous.
– C’est de l’érudition locale simplement. Les Gaulois – que nous considérons comme des barbares – savez-vous où ils avaient établi leur oppidum, Lugdunum, – la colline du Corbeau – embryon de la cité actuelle ?
– Ma foi non.
– Sur les hauteurs de Croix-Rousse, mon cher, où le brouillard est inconnu. Les modernes sont venus s’installer juste au confluent des fleuves, dans un marécage. Est-ce un progrès ?
– Certes non. Et le choix de leur demeure prouve leur infériorité.
– Comment ?
– Il est évident qu’un monsieur perché sur une colline a les idées plus élevées que lorsqu’il est en plaine !
Les jeunes gens éclatèrent de rire.
– Ah ! voici la rue Suchet, reprit Marcel au bout d’un moment. Tournons à gauche ; c’est la troisième maison. Tenez, une voiture stationne devant la porte.
En effet un fiacre fermé, lanternes allumées, était arrêté à quelques pas.
Les voyageurs parvinrent à une haute porte cochère.
Un des battants était entr’ouvert.
– Nous sommes arrivés, déclara Marcel en baissant la voix. J’ai le cœur qui bat. Songez donc, mes seuls amis ! Tiens, mais voici la plaque de la maison, A. Ribor et Cie.
Il désignait un large panneau appliqué sur le mur à droite de l’entrée.
Pour laisser à son compagnon le temps de se remettre, Claude parut considérer la plaque.
– Mais vous vous trompez, fit-il tout à coup.
Simplet l’interrogea du regard :
– Sans doute. Ce n’est pas la maison Ribor.
– Vous avez la berlue.
– Voyez vous-même.
Avec un haussement d’épaules, Dalvan rejoignit le sous-officier. Il jeta les yeux sur le panneau et eut un geste de surprise :
– Canetègne et Cie, murmura-t-il. Qu’est-ce que cela signifie ? Puis se frappant le front :
– Ils ont peut-être déménagé. Depuis deux ans, ils en ont eu le temps. Informons-nous.
Il se dirigea vers la porte.
Mais comme il allait en franchir le seuil, le battant entr’ouvert fut brusquement tiré en arrière. Deux hommes parurent, maintenant une femme qui se débattait.
L’un ouvrit la portière du fiacre et d’un ton tranchant :
– Montez, mademoiselle, notre consigne est de vous arrêter… Si vous résistez, tant pis pour vous.
– Mais c’est une infamie, gémit la prisonnière.
– Cette voix, bredouilla Marcel en se cramponnant au bras de son camarade.
Il tremblait.
– Montez, mademoiselle, répéta l’homme qui déjà avait parlé.
Comme malgré lui le sous-officier fit un pas en avant. La clarté de la lanterne frappa en plein son visage pâle.
La captive l’aperçut. D’un effort surhumain elle s’arracha des mains de ces gardiens, et se réfugia dans les bras de Marcel :
– Simplet, s’écria-t-elle, Simplet, sauve-moi !
– Yvonne, répondit le jeune homme, toi !
Les agents, étonnés d’abord, intervinrent :
– Allons, allons, assez de simagrées. En voiture et lestement.
Les yeux de Dalvan eurent un éclair. Yvonne le vit.
– Non, dit-elle vivement, ne me défends pas. Reste libre. Il le faut pour me protéger. Écoute : je suis arrêtée comme voleuse sur la dénonciation de M. Canetègne, l’ancien associé de mon frère qu’il a ruiné. Antonin a la preuve de mon innocence.
– Bon ! où demeure-t-il ?
– Hélas ! il est parti depuis un an. Il parcourt le monde. Je n’ai pas de ses nouvelles.
Elle allait continuer. L’un des policiers lui appuya la main sur l’épaule.
– La belle enfant, il se fait tard.
Et narquois :
– Vous savez, sergent, vous pourrez la voir en prison. Une simple demande à présenter. L’administration est paternelle.
Marcel eut un mouvement comme pour se ruer sur ce personnage, mais Yvonne l’arrêta :
– Simplet, je n’ai que toi !
Il redevint calme.
– Cela suffira, petite sœur. On t’accuse injustement. Je prouverai la fausseté de tes ennemis. Compte sur moi.
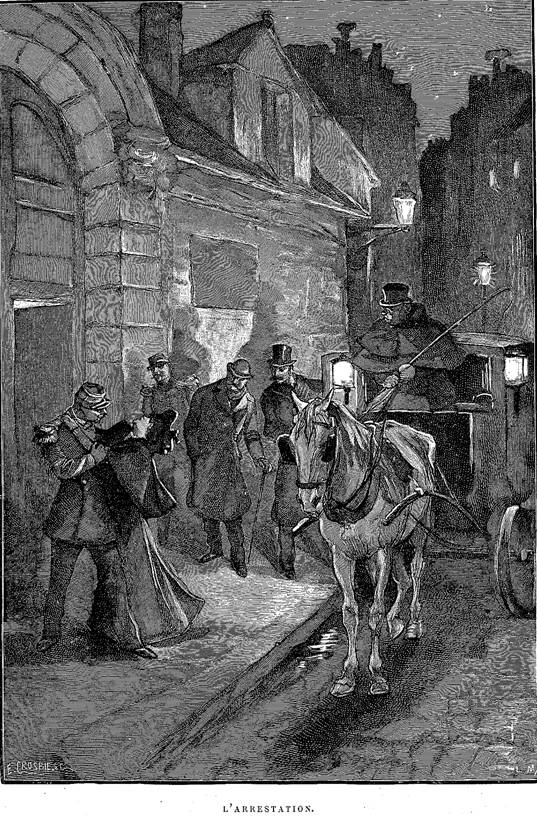
L’un des agents avait pris place dans le fiacre avec la prisonnière. L’autre se hissait sur le siège.
– Hue, gronda le cocher.
Comme la voiture s’ébranlait, la jeune fille mit la tête à la portière et avec un accent déchirant :
– Adieu, Simplet.
– Au revoir, répondit-il, au revoir.
Les sous-officiers restèrent seuls sur le trottoir.
Très troublé, Claude se taisait, n’osant interrompre la rêverie où son ami était plongé. Il éprouvait le contre-coup de la douleur cuisante qui frappait le pauvre garçon.
Deux mots lui avaient fait comprendre l’étendue de l’affection dont Yvonne et Simplet étaient unis.
En parlant d’elle, le sous-officier avait dit :
– Je n’ai qu’elle.
En le voyant, la jeune fille s’était écriée :
– Je n’ai que toi !
Et le marsouin grommelait entre ses dents :
– En voilà une tuile !
La phrase était vulgaire, mais le ton profondément sympathique.
– Ah ! fit tout à coup Marcel, parlant haut sans en avoir conscience. Antonin est au diable et Yvonne va en prison. Le plus pressé est de l’en faire sortir. Seulement, voilà… dans cette ville où je ne connais personne, où je suis seul…
Claude lui toucha le bras.
– Pardon, nous sommes deux.
Le jeune homme leva la tête.
– Oui, poursuivit Bérard. Tantôt vous avez pris mon parti, sans m’avoir jamais vu, poussé uniquement par l’idée de justice. C’est mon tour maintenant, et je répète après vous : nous sommes deux.
Dalvan essuya une larme, puis simplement :
– Merci, frère, j’accepte.

II.
LA TOILE D’ARAIGNÉE

Le lendemain vers dix heures, Marcel était assis pensif dans la chambre d’hôtel où il avait passé la nuit. On frappa à la porte.
– Entrez, dit-il.
Claude parut et demanda :
– Eh bien, comment ça va-t-il ce matin ?
Dalvan eut un sourire :
– Bien…
– Oui, mais l’affaire de Mlle Yvonne ?
– J’y pense.
– J’en suis sûr. Seulement qu’allons-nous faire ?
Le jeune homme indiqua une chaise à son ami :
– Il faut qu’Yvonne soit libre. Or elle peut l’être de deux façons : son innocence prouvée, ou par évasion. Pour l’instant, il s’agit de comprendre l’affaire. Pourquoi et dans quelles circonstances a-t-elle été accusée ?
Bérard ricana :
– À qui demander cela ? Moi je ne connais rien à la police.
– Moi non plus, mais je désire voir Yvonne. À qui cela peut-il déplaire ?
– Comment déplaire ?
– Sans doute. C’est de celui-là que je dois obtenir l’autorisation, puisque seul il songerait à la refuser.
Le marsouin inclina la tête et gravement :
– C’est vrai ! rien de plus logique, mais ça n’indique pas le personnage qui…
– Au contraire. Qui instruira le délit ?
– Un juge.
– C’est donc lui qui a intérêt à ce que ma pauvre petite sœur soit au secret.
– En effet, s’écria Claude en riant, le raisonnement est simple.
– Tout est simple, affirma gravement Marcel.
Un hochement de tête de son compagnon l’interrompit :
– Quoi encore ? dit-il.
– Où trouver l’adresse du juge, son nom ?
– Au Palais de Justice.
– Au fait, c’est évident. Pour rencontrer un garçon de recettes, on irait à la banque qui l’occupe ; de même pour un magistrat. Alors en route.
Quelques instants plus tard les jeunes gens quittaient l’hôtel, s’informaient au premier passant et, sur ses indications, gagnaient le quai qui longe la Saône.
Bientôt ils atteignirent le Palais de Justice, monument assez médiocre, malgré la colonnade corinthienne dont il est orné. Le concierge renvoya les sous-officiers au greffe, où un employé leur apprit que l’instruction du vol reproché à Mlle Ribor était confiée à M. Rennard, domicilié place Saint-Nizier, en face la curieuse église de ce nom.
Nanti de ce renseignement, Marcel entraîna son ami vers la demeure du magistrat.
Celui-ci, un brave homme grassouillet, à la figure paterne, accueillit le soldat avec bienveillance. Il parut ému par le récit de son affection pour Yvonne, et ne fit aucune difficulté de lui signer un permis de visiter la prisonnière.
Seulement, quand Marcel lui déclara qu’il apporterait les preuves de l’innocence de la malheureuse enfant, M. Rennard secoua doucement la tête sans répondre. Évidemment il la croyait coupable.
Après un déjeuner sommaire, les soldats se séparèrent. Bérard retourna à l’hôtel, tandis que le lignard s’acheminait vers la prison, située vis-à-vis l’ancien quai de la Vitriolerie.
Le laisser-passer du juge d’instruction était en règle, et le jeune homme fut bientôt introduit dans la chambre occupée par Yvonne. Munie d’un peu d’argent, la captive avait obtenu sans peine d’être soumise au régime de la « pistole ». Elle n’était d’ailleurs que « prévenue ».
– Simplet ! s’écria-t-elle comme la veille.
– Moi, tu ne m’attendais pas ?
– Comment es-tu arrivé jusqu’ici ? J’étais triste et maintenant il me semble que mon malheur va prendre fin.
Rapidement il la mit au courant de ses démarches. Le visage de la jeune fille exprima la stupéfaction et d’un ton hésitant :
– Comment ! c’est toi qui as eu l’idée de tout cela ?
– Oui, répondit-il sans paraître remarquer l’air singulier d’Yvonne, moi avec mon ami Claude Bérard.
– Ah ! bon !
Il y avait dans ces deux mots une foule de révélations. Au fond, la détenue ne prenait pas « au sérieux » son frère de lait. Son exclamation signifiait clairement :
– C’est ton ami qui t’a guidé, car livré à toi-même tu n’aurais pas trouvé cela.
L’affection a de ces injustices. Il n’est pas, dit-on, de grand homme pour son valet de chambre ; encore moins pour ses amis ou ses parents. Et dans ce surnom de « Simplet », Yvonne avait mis, sans le savoir, toute la supériorité protectrice qu’elle pensait avoir le droit de marquer au jeune homme.
– Voyons, poursuivit Marcel, mettons à profit les instants. Y a t-il moyen de démontrer la fausseté de l’accusation qui pèse sur toi ?

Elle secoua la tête :
– Non, ou plutôt il y en aurait un, si Antonin était auprès de nous.
– Tu m’as déjà dit cela hier soir. Si je suis venu, c’est pour t’encourager et te prier de me raconter ce qui s’est passé depuis que je ne t’ai vue. Pour te défendre, il est indispensable que je sache de quoi tu es menacée.
Du même ton d’ironie douloureuse :
– Tu veux me protéger, Simplet ?
Marcel lui prit les mains :
– Oui, petite sœur.
– Oh ! je sais bien, reprit-elle d’une voix tremblante, touchée par l’affection du soldat. Je sais bien que, si tu le pouvais, tu me tirerais d’ici ; mais hélas ! comment réussirais-tu ? Contre moi se dressent des charges accablantes…
Doucement, il lui coupa la parole :
– C’est égal, raconte tout de même, je t’en supplie.
– Soit, fit-elle. Quand tu partis au régiment, Antonin avait fondé depuis plusieurs mois sa maison de commission coloniale.
– Et Canetègne n’était-il pas son associé ?
– Si. Tu ignores comment cette association fut signée ?
– En effet.
– Oh ! ce fut une infamie. Dans la famille, les hommes sont des « inquiets de mouvement ». C’est de l’atavisme, n’est-ce pas ? Notre bisaïeul, au début du siècle, fit la course. Le corsaire audacieux laissa une certaine fortune que son fils, notre grand-père, augmenta. Il était ingénieur dans le Sud-Américain. Notre père, lui, fut explorateur et ses découvertes géographiques réduisirent notre patrimoine. À sa mort, pauvre papa, il nous restait quatre cent mille francs. Antonin aurait bien couru le monde comme les autres.
– Mais tu étais là. Il se devait à toi, petite sœur.
– Oui. Aussi ne pouvant se déplacer lui-même, il voulut au moins s’occuper des lointains pays dont l’idée le hantait.
– Et sur mon conseil, conseil que je regrette, va, il se lança dans la commission coloniale.
Yvonne à son tour enferma dans les siennes la main du sous-officier.
– Ne t’accuse pas. Ta pensée était bonne, mais Antonin n’entendait rien aux affaires. Il avait engagé tous nos capitaux dans l’entreprise. La maison marchait bien, mais il avait oublié une chose : conserver un fonds de roulement suffisant. Si bien qu’à la sixième échéance, avec des affaires superbes, il se vit dans l’impossibilité de tenir ses engagements. C’était la liquidation judiciaire, la faillite…
Marcel eut un haut-le-corps :
– Et vous ne me l’avez pas dit ?
– À toi !
– Je possède une centaine de mille francs. Votre fonds de réserve était tout trouvé. C’était bien simple.
Les yeux de la prisonnière devinrent humides :
– Tu trouves, mon bon Simplet ; je ne suis pas de ton avis. J’ai défendu à Antonin de t’apprendre la situation. Il était inutile de t’entraîner dans notre ruine.
– C’est mal…
– Peut-être as-tu raison, après tout. Enfin, ce qui est fait est fait. Laisse-moi continuer.
– Je t’écoute.

– La veille de l’échéance, il nous manquait vingt mille francs. Notre papier allait être protesté. Après dîner, mon frère et moi étions assis dans le salon l’un en face de l’autre. À ce moment, notre petite bonne nous annonce que Mlle Doctrovée demande à nous parler.
– Mlle Doctrovée, votre employée ?
– Précisément. Elle était chargée de la manutention.
– Je me souviens. Une femme d’une quarantaine d’années, grande, brune de peau et de cheveux, maigre…
– C’est cela même. Eh bien ! cette femme entra, nous accabla de protestations, nous confia qu’un M. Canetègne, dont elle se disait l’amie, attendrait Antonin le lendemain et lui compterait la somme qui lui faisait défaut. À huit heures du matin, mon frère courait chez M. Canetègne, qui lui offrit l’argent promis, mais le pria en échange de signer un petit papier.
– Un papier ?
– C’était un acte d’association reconnaissant au prêteur la moitié de l’avoir social.
– Bigre !…
La prisonnière leva les yeux au ciel :
– Attends pour te récrier. Parmi les clauses de l’acte se trouvaient celles-ci : chacun des associés touchera mensuellement mille francs ; chaque année, il sera procédé à un inventaire, et en cas de perte constatée, l’un des associés aura droit de demander la liquidation de la société.
Le visage de la jeune fille se contracta ; elle poursuivit avec un léger tremblement dans la voix :
– Les conditions étaient léonines, mais Canetègne, cet Avignonnais rusé, connaissait bien notre situation. À toutes les objections d’Antonin il se borna à répondre : C’est ma manière de traiter l’affaire. Je ne vous force pas. Vous préférez la faillite, à votre aise ! Et mon pauvre frère signa.
– Ah ! grommela le sous-officier avec colère. Tout cela plutôt que de s’adresser à moi.
Puis se radoucissant soudain :
– Petite sœur, tu es trop malheureuse pour que je te gronde ; continue.
– C’était notre ruine qu’il venait de signer. À la fin de la première année : inventaire. Lui trouve dix-huit mille francs de gain ; Canetègne, six mille francs de perte.
– Comment cela ?
– Tu vas l’apprendre. Cet homme d’affaires retors demande la liquidation. Son compte est jugé exact par le tribunal.
– Ton frère s’était trompé !
– Non, mais il n’avait pas considéré les appointements des patrons, soit vingt-quatre mille francs, comme des dépenses.
– Je conçois, M. Canetègne les faisant figurer au compte « frais généraux », l’écart de six mille francs…
– Bref, il fut décidé que la maison serait vendue chez un notaire. Sa mise à prix était de cent mille francs… Elle devait être adjugée sur une seule enchère.
Et interrompant le jeune homme qui ouvrait la bouche :
– Tu vas me dire que là encore nous avons été coupables de ne pas faire appel à ton amitié. C’est vrai, je le reconnais ; mais épargne-nous, nous sommes tellement à plaindre !
Pour toute réponse Marcel porta à ses lèvres la main de la captive.
– Oh ! Antonin se démena. Deux ou trois amis s’étaient intéressés dans ses affaires. Il alla les voir, leur proposer de lui avancer l’argent nécessaire au rachat de la maison. Par l’acte d’association il représentait 50 p. 100 de la valeur de l’entreprise ; donc, en payant cinquante mille francs à son associé, plus les frais de vente, il se retrouvait seul propriétaire… Mais une surprise l’attendait. Exagérant la déconfiture, M. Canetègne avait racheté à vil prix les créances. Une explication s’ensuivit. Dès les premiers mots l’Avignonnais éclata de rire : Mon ami, dit-il, vous êtes nul en affaires. Je vous sauve malgré vous. Aujourd’hui je représente 80 pour 100 de l’opération, et vous seulement 20. Par conséquent, si vous vouliez me disputer l’entreprise, vous auriez à payer quatre-vingts francs, alors que je n’en débourserais que vingt. Or, j’ai trouvé un commanditaire qui m’autorise à prendre la maison à deux cent mille francs. Voulez-vous en verser huit cent mille ? Eh bien ! je vous fais une offre sérieuse. Laissez-moi maître de la situation. Avec une enchère de dix mille francs j’enlève la vente. Je vous remets intégralement la mise à prix : vingt-deux mille francs comptant, et un chèque de soixante-dix-huit mille francs payable dans dix-huit mois. Vous y gagnez, mon commanditaire aussi. Tout le monde est content. Et comme Antonin le considérait avec stupeur, il ajouta : Avec l’argent touché, vous vous embarquez, vous parcourez les colonies françaises, et me revenez avec des documents, des relations qui décuplent notre chiffre. Je vous alloue 10 pour 100 sur les affaires, et en quelques années je refais votre fortune.
– Tiens, tiens, fit le sous-officier ; c’est presque gentil, cela.
Yvonne fronça le sourcil.
– Il mentait comme toujours. Il exploitait l’humeur aventureuse des Ribor, dont Antonin a hérité. Le pauvre accepta. En son absence Canetègne me gardait comme caissière, aux appointements de deux mille francs. Tout se passa comme il l’avait décidé. Antonin quitta la France en me laissant le chèque de 78,000 francs. Mais poussé par une défiance trop justifiée, hélas ! il photographia ce papier, sans savoir à quoi pourrait servir la reproduction. Malheureusement Antonin est, j’ignore où, et il a emporté cette preuve qui confondrait mes lâches accusateurs.
Elle avait pâli en prononçant ces paroles. Une émotion violente la secouait ; sa voix s’étranglait dans sa gorge. Brusquement elle jeta ses bras autour du cou de Marcel et appuyant sa tête sur son épaule :
– Mon pauvre Simplet ! Après… oh ! après, j’ai subi toutes les tortures. Antonin m’écrivit pendant six mois. Il visita l’Algérie, la Tunisie. Il gagna le Sénégal. De Saint-Louis une dernière lettre me parvint. Le cher voyageur m’annonçait son intention de remonter au nord du fleuve. Et puis, plus rien. J’ai écrit là-bas. Pas de réponse. Pour comble d’infortune, tandis que je me désespérais, hantée par l’atroce pensée que mon frère était mort, M. Canetègne manifesta l’intention de m’épouser.
– Lui !
– Oui lui, répéta la prisonnière. Durant des mois, j’ai subi ses sollicitations… J’étais seule, sans fortune, n’ayant pour vivre que mes appointements. Je n’osais pas abandonner mon emploi. J’avais peur de mon isolement dans la ville populeuse.
– Comme tu crois peu à mon affection, tu ne m’as pas appelé.
– Pardon, je croyais être bientôt délivrée. L’échéance du chèque approchait. Quand je l’aurai touché, pensais-je, je quitterai la maison Canetègne ; je serai libre. Folle ! L’échéance atteinte, je présente l’effet, et je déclare à cet homme que je ne continue plus à faire partie de son personnel. Il tente de me retenir. Il a des paroles mielleuses ; mais il ne peut plus me tromper. Avec ma fortune, je rentre chez moi. C’est fini, je suis affranchie.
Elle parlait avec exaltation, dans une sorte d’ivresse. Et devant elle, Marcel joignait les mains, comprenant sa longue peine.
– Soudain, reprit Yvonne avec amertume, un abîme s’ouvre sous mes pieds. Des agents de police envahissent ma demeure. Ils font main-basse sur l’argent. Ils m’accusent d’avoir volé cette somme.
– Eh bien, il était facile de prouver…
– Ah ! je l’ai cru, Simplet. J’ai dit la vérité. Alors ils m’ont traînée chez M. Canetègne. Horreur ! c’est lui qui a porté plainte. Il nie l’existence du chèque, et sur mes livres il montre des surcharges, des ratures, que je n’ai jamais faites, je te le jure…
– Je te crois, petite sœur.
Yvonne se blottit contre lui et avec une reconnaissance infinie :
– Tu me crois, toi. Tu devines qu’une honnête fille ne devient pas voleuse, qu’elle ne falsifie pas ses livres pour piller la caisse qui lui est confiée. Eux, cela ne les étonne pas. Tout crime leur paraît naturel. Canetègne affirme que je suis coupable. Sa parole fait foi. J’en appelle à Mlle Doctrovée. Elle déclare tout ignorer. Tu voulais me sauver ; tu vois bien que c’est impossible !
Depuis une minute Marcel semblait avoir oublié où il se trouvait. La figure immobile, les yeux perdus dans le vague, une ride profonde coupant le front entre les sourcils, il était absorbé par une pensée. Mais aux derniers mots de la jeune fille il sortit de sa préoccupation.
– Le premier moyen m’a l’air de ne rien valoir, fit-il lentement, nous emploierons le second.
Et comme elle le regardait avidement, les lèvres ouvertes pour l’interrogation :
– C’est bien simple, reprit-il, tu ne démontreras pas ton honnêteté. La trame est trop bien ourdie. Donc tu t’évaderas, et à nous deux nous rejoindrons ton frère.
– Mais personne ne sait où il est !

– Nous le trouverons… D’ailleurs il n’y a pas autre chose à faire. Il a la preuve. Il nous la faut, car tu ne peux vivre déshonorée.
Le gardien entrait pour avertir le sous-officier que sa visite avait assez duré. Tendrement Marcel embrassa sa sœur de lait et lui murmura à l’oreille :
– À bientôt !
Puis il sortit après un geste brusque dont, ni la prisonnière, ni le geôlier, ne comprirent le sens. Il se jurait d’arracher Yvonne à l’injuste justice.
III
UNE IDÉE DE SIMPLET

Mlle Doctrovée, dont il vient d’être question, mérite les honneurs du portrait. Elle avait « coiffé sainte Catherine » depuis quelques années, avouait-elle. Or, chacun sait que ladite Catherine est une fée fantasque qui tantôt fait de la vieille fille un être dévoué, tantôt tout le contraire. La vérité nous oblige à confesser que Doctrovée appartenait à la seconde catégorie.
Maigre, sèche, revêche, elle affectait, selon l’expression d’un professeur de mathématiques de la ville, la forme d’un polyèdre irrégulier dont les angles masquaient les faces.
Sa caractéristique était un nez long, à l’extrémité perpétuellement écarlate. Oh ! ce nez ! Il avait récréé la ville entière ! Sitôt qu’elle se mouchait dans un magasin, un salon, un lieu public, il se trouvait un mauvais plaisant pour s’écrier :
– Personne n’a vu le maréchal Ney ?
Ce à quoi la foule répondait en chœur :
– Pardon ! il fait des armes avec Pif de la Mirandole.
On juge du fiel amassé chez Mlle Doctrovée, et l’on comprend facilement qu’elle se fût mise à haïr Yvonne Ribor, qui non seulement avait la gentillesse, l’amabilité, la grâce refusées à son employée, mais qui de plus était la patronne.
Pour Doctrovée elle synthétisa l’univers, devint responsable de toutes ses mésaventures. De là à lui nuire, il n’y avait qu’un pas. Il fut fait.
L’employée connaissait un M. Canetègne, son cousin à la mode de la forêt de Bondy. Cet homme d’affaires au regard bleu-faïence, aux cheveux blonds, rares au sommet de la tête, souriant, insinuant, bedonnant, orné d’un grasseyant accent venaissin, mais dépourvu de scrupules, jugea à demi-mot l’alliée que la fortune lui amenait.
Renseigné par elle, il se substitua facilement à Antonin Ribor et l’éloigna sous le prétexte de lui faire visiter les colonies.
Yvonne restait seule à Lyon. M. Canetègne réfléchit qu’elle serait une agréable compagne, et que de plus, en l’épousant, il ferait rentrer dans sa caisse le chèque de soixante-dix-huit mille francs consenti à son ex-associé. La résistance de la jeune fille le surprit. Excité par Doctrovée, il considéra son refus de lui accorder sa main comme une injure grave. Il s’énerva, enragea, voulut la séquestrer moralement. À cet effet, il écrivit au directeur des Postes du département du Rhône une lettre par laquelle sa caissière était censée demander que ses correspondances lui fussent adressées au domicile particulier du négociant, 6, rue Perrache.
Voilà pourquoi Yvonne n’avait plus reçu de nouvelles de son frère. M. Canetègne interceptait les lettres. Il apprit ainsi qu’Antonin, capturé par les Touareg, au nord de la boucle du Niger, pouvait recouvrer la liberté en payant rançon. Il se garda, bien entendu, d’en parler à qui que ce soit.
Mais Yvonne ne se montrait pas plus clémente à son égard. L’échéance du chèque arriva. Alors voyant du même coup son argent et ses projets matrimoniaux compromis, il eut recours à l’odieux stratagème dont Yvonne avait été victime.
Le chèque détruit, les livres grossièrement falsifiés, l’innocente fut jetée en prison.
Or le sergent Simplet, après avoir quitté sa sœur de lait, se tint le raisonnement que voici :
– Il faut délivrer Yvonne, puis retrouver Antonin. Nous avons un atout dans notre jeu. M. Canetègne songeait à donner son nom à la pauvre petite. Le mariage perdit Troie, il peut bien perdre aussi un simple enfant d’Avignon.
Sur cette réflexion il retourna à Grenoble, se fit faire par son notaire une forte avance sur ses propriétés dont, on s’en souvient, il voulait se débarrasser, et de retour à Lyon il se rendit, 6 rue Perrache, au domicile du négociant. Claude l’accompagnait.
En quelques mots il conta à l’Avignonnais l’histoire du chèque photographié, l’inquiéta juste assez pour le rendre maniable, puis conclut en déclarant qu’il ne croyait pas à cette imagination.
– Personne du reste, dit-il avec le plus grand sérieux, n’admettra qu’un commerçant notable risque de compromettre sa situation par de tels agissements.

Brusquement il abandonna ce sujet désagréable et parla mariage. Si le commissionnaire voulait s’y prêter, Yvonne serait bientôt remise en liberté. Il suffirait que tous deux déclarassent à l’instruction leur désir de se marier. Les surcharges des livres, la somme trouvée chez la jeune fille ; tout s’expliquerait par une querelle de fiancés. La justice, maternelle quoi que prétendent les cambrioleurs, se ferait un plaisir de réunir des êtres faits pour finir leurs jours en commun. La solution – qui calmait les craintes de Canetègne – fut adoptée par lui. Il fut convenu que l’on obtiendrait du juge d’instruction, M. Rennard, une confrontation du négociant avec Yvonne ; confrontation pendant laquelle ils débiteraient la fable imaginée par Simplet, frère de lait affectueux et ennemi des bisbilles.
On se serra la main. Mais une fois dehors, Dalvan murmura à l’oreille du « Marsouin » :
– Vous voyez comme c’est simple. Maintenant ma sœur est libre.
– Pas encore.
– Oh ! il s’en faut de si peu !
Le lendemain Marcel se rendit au Palais de Justice, où se trouvait le cabinet du juge d’instruction. Il plongea M. Rennard dans l’ahurissement en lui contant la fable convenue.
Peut-être le magistrat n’en crut-il rien, mais il affecta d’être persuadé. Puisque tout le monde était d’accord, à quoi bon se donner des airs de rabat-joie ? Pour la forme il convoqua Mlle Doctrovée, Canetègne, Claude Bérard, qui de près ou de loin « tenaient » à l’affaire.
Dalvan s’était institué son piqueur. Durant deux jours il fut sans cesse en mouvement. Du Palais de Justice il courait au magasin de la rue Suchet, à l’appartement de la rue Perrache, à la prison. Les concierges et employés du « Temple de Thémis » le saluaient d’un air de connaissance. Nul ne s’inquiétait de lui voir parcourir les couloirs et les escaliers du monument. Et cependant le jeune homme prenait parfois des chemins détournés, pour gagner le cabinet de. M. Rennard. Il se glissait partout, inspectait les portes, se pénétrait de la topographie de l’édifice.
Le soir du deuxième jour il revint à l’hôtel en fredonnant.
– Ah ! ah ! fit Claude, vous êtes content ?
– Oui. La porte des caves où l’on met le combustible est fermée par une simple barre.
– Parfait !
– Par cette voie on évite les concierges et le quai. Et vous ?
– J’ai suivi vos instructions à la lettre. J’ai acheté des vêtements : un pantalon chez un marchand, un veston chez un autre.
– Et ?
– Tout est en sûreté près de la gare de Perrache, dans un pavillon que j’ai loué pour un mois. Il existe une entrée particulière, qui permet d’échapper aux curiosités des voisins.
– Bon. Nous sommes prêts, on peut interroger Yvonne.
Au matin Dalvan apprit au Palais de Justice que la jeune fille serait extraite de prison dans l’après-midi et conduite devant M. Rennard.
Nanti de cette nouvelle, il ne fit qu’un bond jusqu’à l’hôtel.
Il prit une bonbonnière de verre bleu dont le couvercle était orné d’une figurine en relief. À travers les parois transparentes de petits losanges blancs s’apercevaient.
– Les fameux bonbons ! remarqua Claude. Pourvu qu’ils soient efficaces.
– C’est un de mes amis de Grenoble, pharmacien, qui les a préparés, ainsi…
– Je le sais ; mais c’est égal, je serai plus tranquille après.
– Alors, rendons-nous au Palais de Justice.
Les deux jeunes gens se mirent en route aussitôt et atteignirent rapidement le but de leur promenade.
Gaiement Marcel salua le concierge, qui lui apprit que M. Rennard était déjà enfermé dans son cabinet, où il attendait la prisonnière.
– Ah ! pas encore arrivée ?
– Non, mais elle ne tardera pas. La preuve, tenez. Un fiacre s’arrêtait en face de l’entrée. Un gendarme et Yvonne en descendaient.
– Pauvre petite, soupira le sous-officier, on lui a épargné la voiture cellulaire !
– Dame ! c’est à vous qu’elle le doit, fit le concierge d’un air entendu, paraît que vous avez joliment débrouillé son affaire.
– J’ai fait de mon mieux.
À ce moment Mlle Ribor, suivie par son gardien, arrivait devant Simplet. Son visage pâli, ses yeux cernés d’un cercle bleuâtre, disaient son angoisse.
– Bonjour, petite sœur, fit Marcel, aie courage. Tout s’arrangera. Surtout dis bien la vérité.
Puis s’adressant au gendarme :
– Vous voulez bien que je l’embrasse, la pauvre mignonne ?
– Allez-y. Entre soldats, il faut se faire une politesse.
L’uniforme du « lignard » disposait en sa faveur le représentant de la force publique. Simplet prit la jeune fille dans ses bras, et tout en appliquant sur sa joue un baiser sonore, il lui glissa rapidement à l’oreille :
– Ne t’étonne de rien. Un mouvement de surprise nous trahirait.
Il recula d’un pas.
– Merci, gendarme, vous êtes un brave homme.
– On fait pour le mieux. Quand la consigne et le sentiment peuvent se concilier…
La fin de la phrase ne venant pas, il s’engagea dans l’escalier, dont Yvonne gravissait déjà les premières marches.
– Je les suis, déclara Dalvan au concierge.
– À votre aise, mais vous devrez rester dans l’antichambre.
– Bah ! je préfère me trouver là… tout près de ma sœur. Il me semble que l’interrogatoire lui en paraîtra moins pénible.
Entraînant Claude stupéfait de sa liberté d’allure, il s’élança sur les traces de la prisonnière. Dans l’antichambre du juge il la rejoignit. Elle allait être introduite chez le magistrat.
– Je ne bouge pas d’ici, lui dit-il. Songe qu’une mince cloison nous sépare seule et sois forte.
Elle le remercia du geste, incapable de prononcer une parole. Violente était l’émotion qui l’étreignait. Son frère de lait allait tenter de la sauver. – Il l’en avait informée. – Par quel moyen ? Elle l’ignorait, car il avait obstinément refusé de l’éclairer sur ce point. Et ses yeux se portaient alternativement du sous-officier au gendarme.
Celui-ci considérait la scène d’un œil paterne. Installé sur une des banquettes de velours qui entouraient la pièce, il avait rejeté son grand manteau en arrière. Sous son bicorne ses yeux brillaient. Positivement l’affection de Marcel pour la captive l’émouvait.
Le carillon d’une sonnerie électrique fit tressaillir Yvonne. L’heure de l’interrogatoire était venue. La jeune fille échangea un long regard avec Dalvan, et, frissonnante, elle pénétra dans le cabinet de M. Rennard.
La porte retomba sur elle. Claude, Marcel et le gendarme demeuraient seuls dans l’antichambre.
– Broum ! Broum ! grommela celui-ci dans sa moustache. Elle est gentille, la pauvre demoiselle.
Simplet se rapprocha de lui.
– N’est-ce pas ?…
– Oh ! oui, bien gentille et elle a l’air si attristé.
– Voyez-vous : si on la condamnait, elle en mourrait.
Le gendarme toussa encore. Décidément il était ému.
Feignant de prendre l’air ahuri du Pandore pour une interrogation, Dalvan lui raconta le roman imaginé par Canetègne. Il ne lui faisait grâce d’aucun détail, et voyait sans rire les gestes apitoyés de son interlocuteur. Tout en parlant, il avait tiré de sa poche la bonbonnière de verre dont il s’était muni. Il l’ouvrit. Elle contenait des losanges blancs assez semblables à de la pâte de guimauve.
– Vous êtes enrhumé ? demanda le bon gendarme.
– Non, je suis gourmand.
– Je ne saisis pas.
– Goûtez un de ces petits carrés, et vous comprendrez. C’est une pâte que mon ami a rapportée du Sénégal.
– Oui, appuya Claude entre ses dents. Ce sont les noirs qui la fabriquent.
– Ça ne l’empêche pas d’être blanche, remarqua le gendarme avec un gros rire.
Et il étendit les doigts vers la bonbonnière. Une flamme brilla dans les yeux de Simplet, mais d’une voix très calme :
– Prenez-en deux ou trois, ils sont si petits !
– Non, je ne veux pas abuser.
– Vous n’abusez pas, j’en ai d’autres.
– Alors c’est pour vous faire plaisir.
Et le brave homme engloutit une série de losanges. Il eut une légère grimace :
– Ce n’est pas mauvais, mais cela vous a un goût bizarre.
– En effet, seulement on s’y habitue.
En conscience, le brave homme mastiqua la préparation du pharmacien de Grenoble et parut éprouver une vive satisfaction en l’avalant.
– En voulez-vous davantage ? demanda Marcel souriant malgré lui.
Le gendarme fit un geste de dénégation.
– Je vous remercie. Entre nous, c’est curieux parce que cela vient du Sénégal, mais j’aime mieux autre chose.
La conversation reprit de plus belle. Bientôt cependant l’interlocuteur de Simplet se frotta les yeux. Sa prononciation devint pâteuse. Il bredouilla :
– Il fait chaud ici.
D’un coup d’épaules il fit glisser son manteau sur la banquette. Il s’appuya au mur, et peu à peu sa tête se pencha sur sa poitrine.
– Trop chaud, répéta-t-il.
Puis il demeura immobile. Sa respiration régulière indiquait qu’il était endormi. Alors Marcel vint à Claude et d’un ton railleur :
– Les pastilles à base de belladone ont produit leurs effets. Aidez-moi à endosser ceux du gendarme.
Une minute plus tard Simplet, couvert de l’ample manteau et coiffé du bicorne, était assis à la place de l’infortuné serviteur de la loi. Ce dernier ne s’était pas aperçu de la substitution.
Mollement couché sur le plancher, derrière la banquette, il dormait profondément.
– Pour enlever Yvonne, plaisanta Dalvan, il était nécessaire d’endormir son gardien. C’est fait. Maintenant allez me chercher une voiture, qui attendra derrière le Palais de justice.
– Mais, vous ?
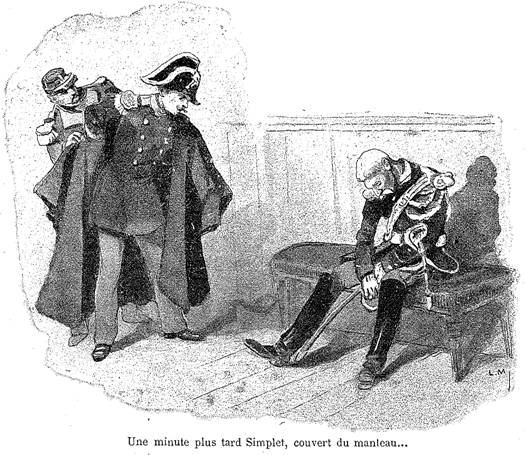
– Ne vous inquiétez pas. Je vous rejoindrai tout à l’heure.
Bérard, conquis par la placidité de son ami, quitta la pièce et le bruit de ses pas s’éteignit bientôt.
– Pourvu qu’il ne survienne aucune anicroche ! murmura Simplet. Jusqu’à présent tout marche à souhait.
Il achevait à peine que la porte donnant sur l’escalier s’ouvrait et Canetègne paraissait sur le seuil.
Le faux gendarme sentit une sueur froide mouiller son front, mais le négociant n’avait aucun soupçon.
– M. Rennard est dans son cabinet ? interrogea-t-il sans regarder le soldat.
– Oui.
– Bon ! Et sans façon il se précipita chez le juge.
Quelques minutes s’écoulèrent, puis de nouveau la sonnerie électrique retentit.
Dalvan devina que l’interrogatoire de la prisonnière était terminé. Il se leva. Yvonne était devant lui, accompagnée d’un greffier.
– Ramenez Mademoiselle, ordonna cet employé.
Simplet s’inclina sans répondre, et se dirigea vers la sortie. La captive promenait autour d’elle des regards désolés. Elle n’avait point reconnu son frère de lait, et elle s’épouvantait de sa disparition. Sur le palier, il lui dit d’un ton bref :
– Pas un cri, c’est moi, viens.
– Toi ?
– Silence, suis-moi.
Et saisissant la main de la jeune fille prête à défaillir, il la conduisit à travers un dédale de couloirs et d’escaliers. Ils parvinrent aux caves. Là, Marcel se dépouilla du manteau et du bicorne, atteignit la porte de service qu’il avait remarquée. La barre céda sans difficulté ; les fugitifs se trouvèrent dans la rue.
À dix pas stationnait une voiture. À la portière se montrait la tête inquiète de Bérard. Yvonne y monta, et Dalvan prit place à côté d’elle, après avoir crié au cocher :
– Gare Perrache !

IV
DE LYON À ÉTAPLES

Durant quelques instants Yvonne garda le silence, puis un sanglot la secoua. Elle tendit les mains à ses sauveurs :
– Libre, libre, bégaya-t-elle, et par vous ! merci !
Marcel arrêta net ces démonstrations.
– Ne pleure pas, petite sœur ; cela te rougirait les yeux et nous ferait remarquer.
Elle refoula ses larmes, dominée par le ton du jeune homme, et timidement.
– Où allons-nous ?
– Dans une retraite que Claude a dénichée. À propos, vous n’avez jamais été présentés officiellement. Je comble cette lacune. Claude Bérard, mon ami et mon complice ; Yvonne Ribor, ma sœur. Voilà qui est fait, je reprends. Nous quittons la voiture à Perrache.
– Pourquoi ?
– Parce que l’on va s’apercevoir de notre fuite. On supposera que notre première pensée a été de nous éloigner. Dans quelle direction ? Vers l’Italie ; la frontière est proche. On retrouvera notre cocher. Il dira où il nous a conduit et l’on enverra immédiatement des télégrammes à Modane.
Claude et Yvonne considéraient le sous-officier avec stupeur.
– Mais, hasarda la jeune fille, tu nous barres la route.
– Jamais de la vie. Pour échapper à ceux qui nous poursuivent, il faut faire précisément ce qui ne leur viendra pas à l’idée.
Et tranquillement :
– J’ai étudié l’indicateur. On cherchera trois personnes, deux hommes et une femme. Nous allons nous séparer. On nous cherche sur la route de Modane. Adoptons-en une autre. Voici ce que j’ai décidé. Une fois déguisés, Yvonne et moi, nous nous rendons à Saint-Rambert ; nous prenons le train, et à Dijon, nous quittons la ligne de Paris ; nous filons sur Amiens, par Is-sur-Tille ; d’Amiens nous gagnons Étaples et de là, l’Angleterre.
– L’Angleterre quand à deux pas, la Suisse, l’Italie !…
– Je vous répète que la surveillance s’accroît en raison des facilités qu’ont à leur disposition les fugitifs.
Bérard intervint :
– Je crois que vous avez raison ; mais moi, qu’est-ce que je deviens ?
– Vous, vous quittez Lyon à pied. Vous marchez jusqu’à Venissieux. Là vous montez dans un train pour Chambéry. De cette ville, vous remontez vers Mâcon, par Culoz, et vous nous rejoignez à Étaples. Seulement vous séjournerez à Chambéry le temps nécessaire pour jeter à la poste une lettre que ma petite sœur écrira tout à l’heure.
– C’est pour cela que nous nous séparons ?
– Pour cela, et pour ne pas voyager ensemble.
Le fiacre s’arrêtait devant la gare de Perrache. Marcel fit descendre ses amis, paya le cocher et pénétra dans les salles d’attente. Mais il guettait la voiture.
Quand elle se fut éloignée, il fit un signe à ses compagnons, et tous gagnèrent le pavillon loué par Bérard.
À ce moment même M. Canetègne, après une longue conférence avec le juge d’instruction, se levait pour prendre congé. L’Avignonnais paraissait enchanté.
– Ainsi, disait-il, voilà qui est convenu. Un rapport très bénin, des conclusions favorables ; je compte sur vous.
– Absolument, répondait le magistrat avec un sourire malicieux. Il n’y a plus délit. Un simple roman. Voleuse et volé inscrivant le mot « Hyménée » sur les pages du code.
– Eh oui. Une prière encore, mon cher juge. Je serai absent deux ou trois jours. Des clients à visiter hors Lyon. S’il se produisait quelque incident nouveau, soyez assez bon pour me prévenir. Un mot au magasin. On me le ferait tenir, et s’il le fallait, je reviendrais immédiatement.
– Je vous le promets.
– À la bonne heure donc. Il n’est point de serviteur de Thémis plus aimable. Ne vous dérangez pas, je connais les êtres.
Le négociant, d’un pas léger, franchit le seuil du cabinet et traversa l’antichambre.
Tout à coup il poussa un cri. En même temps il trébuchait et roulait à terre. Au bruit M. Rennard accourut.
– Que vous arrive-t-il ?
Canetègne se releva en se frottant les reins.
– Je ne sais pas ; j’ai buté contre un obstacle là…
Il s’arrêta stupéfait. À l’endroit qu’il désignait, un bras humain s’allongeait sur le parquet, sortant de dessous la banquette occupée naguère par le gendarme.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? murmurèrent les deux hommes.
Mû par un sentiment de prudence, le magistrat appela son greffier pour déplacer le siège, qui masquait la victime de Marcel, dormant paisiblement.
– Un gendarme ! clama le négociant.
– Un gendarme ! redit le juge avec surprise.
– Celui qui accompagnait la prisonnière, déclara le greffier.
Du coup M. Rennard sursauta :
– Vous êtes certain de ce que vous avancez ?
– Absolument. Je le connais d’ailleurs, c’est le père Cobjois.
– C’est bon ! c’est bon ! réveillez-le. Il nous expliquera…
Oubliant sa grandeur, le magistrat aida son subordonné à soulever le dormeur et se prit à le secouer.
Peine inutile, Cobjois n’ouvrit pas les yeux. Le juge y mit de l’acharnement. Il ne réussit qu’à arracher au pauvre diable un ronflement sonore. Cela devenait inquiétant. Les trois hommes échangèrent un regard.
– Ce sommeil n’est pas naturel, formula enfin M. Rennard.
– J’allais le dire, appuya Canetègne.
Le greffier se contenta d’opiner du bonnet.
– Et l’accusée qu’est-elle devenue ?
La question demeura sans réponse. Le scribe, pressentant une bourrasque, songea à en détourner les effets et d’une voix insidieuse :
– Je cours chez le concierge, monsieur, si vous le permettez. Il a dû la voir passer.
– Oui, allez.
– Ah ! çà, demanda Canetègne lorsqu’il fut seul avec le magistrat, est-ce que vous croiriez ?…
– À une évasion ?
– Oui.
– C’est possible !
M. Rennard prononça ces deux mots avec une sourde irritation ; la colère de l’homme de loi battu sur son terrain. Pour le commissionnaire, il blêmit. Yvonne libre ! C’était le renversement de ses plans. Et tous deux piétinaient autour du soldat ronflant de plus belle.
L’arrivée du concierge ne laissa subsister aucun doute. La prisonnière n’avait pas franchi le seuil du Palais de Justice.
Alors, sur les ordres brefs du juge, une véritable battue commença. Tous les employés présents furent réquisitionnés. On fouilla les bâtiments, les caves, et, en fin de compte, on découvrit le manteau et le bicorne du gendarme auprès de la porte de service entr’ouverte.
La captive s’était évadée. Avec cette certitude, M. Rennard parut retrouver le calme. Imposant silence au commissionnaire qui, furieux, congestionné, faisait du bruit comme quatre.
– Le frère de lait de Mlle Ribor était ici pendant l’interrogatoire de l’accusée ?
– Oui, répliquèrent le cerbère et le greffier.
– C’est donc lui qui a protégé sa fuite. Un soldat à peine libéré ; nous le reprendrons facilement.
– Vous pensez ? interrogea Canetègne haletant.
– Je l’affirmerais. Seulement les conclusions de mon enquête seront modifiées par cette aventure. Rentrez chez vous, monsieur. Ces jeunes gens se sont moqués de nous. Une dépêche au commissaire central nous les ramènera bientôt confus et repentants.
Sur ces paroles, le magistrat, appelant du geste ses subordonnés, disparut avec eux dans son cabinet. Il allait prendre ses dispositions pour ressaisir la proie qui échappait à la justice.
Rentré chez lui, le commissionnaire colonial donna cours à sa rage. Lui, si économe et si rangé, brisa un service de « terre de fer ». Hélas ! cet acte de vigueur ne lui procura pas le sommeil. Toute la nuit il se retourna sur son lit, s’assoupissant parfois, mais brusquement éveillé par un horrible cauchemar. Il voyait autour de lui danser une armée de sous-officiers et de jeunes filles, tenant tous une photographie du chèque Ribor.
Une visite matinale à Mlle Doctrovée ne le rassura pas. Son associée parut épouvantée. Yvonne libre, tous les malheurs étaient à craindre.
Soudain la servante de Doctrovée vint annoncer à sa maîtresse que M. Martin demandait à lui parler. Le visage de la maigre personne s’éclaira.
– Lui !… priez-le d’attendre un instant.
Et la bonne sortie, elle vint se planter devant le négociant.
– Mon cher ami, commença t-elle, vous êtes comme moi. Pas confiance en la police, hein ?
Il secoua la tête avec énergie.
– Bien, reprit Doctrovée. Alors, voyons Martin. Un ancien policier révoqué pour une peccadille et, mon ami.
– Soit donc. Après tout, où nous en sommes, nous n’avons pas le choix.
Le négociant se laissa conduire par sa complice dans le salon, où le policier attendait.
C’était un homme d’une trentaine d’années, aux épaules larges, au corps bien d’aplomb sur des jambes solides.
Le personnage avait la face blême percée de deux yeux clignotants, un front bas surmonté de cheveux rudes taillés en brosse. Il s’inclina devant l’Avignonnais.
– Monsieur Canetègne, enchanté de vous voir. Je me suis présenté chez vous. En apprenant votre sortie matinale, j’ai pensé vous rencontrer ici.
– Comment cela ? balbutia l’Avignonnais interloqué.
– Comment ? Mlle Ribor a pris sa volée hier. Il m’a paru naturel que vous vinssiez faire part de cet événement à la meilleure de vos amies.
Il coulait vers son interlocuteur un regard pénétrant. Ce dernier baissa les yeux.
La tournure que prenait l’entretien le gênait visiblement. Doctrovée vint à son secours :
– Dites toute votre idée, monsieur Martin. Il est possible qu’elle nous convienne.
Le visiteur répondit par un signe de tête approbateur.

– Un aveu d’abord. J’aime la bonne chère, les appartements élégants, les fêtes, et j’en suis sevré depuis des années. Aussi dès que j’ai su l’arrestation de Mlle Ribor, je me suis intéressé à elle ; car je tenais la bonne affaire longuement attendue.
Doctrovée eut un rire engageant :
– Allez toujours.
– Je savais son innocence. J’ai déploré sa pauvreté, car sans cela je lui aurais fait rendre la liberté. Mais il faut vivre, et l’on n’y peut arriver qu’au service de ceux qui ont de l’argent. Je me suis logé dans le même hôtel que les sous-officiers, ses amis. Une chambre voisine de la leur m’a permis de suivre toute l’intrigue. La cloison n’interceptait pas leur voix. Bref, j’ai connu le plan d’évasion simple et ingénieux, imaginé par ces jeunes gens.
– Et vous ne m’avez pas averti ? clama Canetègne.
– Vous avertir ? vous n’y songez pas.
– Mais si, je vous aurais récompensé.
– Oui, vingt-cinq louis. Cela ne constitue pas une affaire. J’aime mieux la situation actuelle.
Sans prêter la moindre attention aux gestes furibonds du commissionnaire, Martin continua :
– Voici ce que je vous propose : Je me suis enquis de votre situation financière. Vous possédiez à la date d’hier cinq cent vingt-cinq mille trois cent quarante-deux francs, soixante-douze centimes, déposés chez MM. Fulcraud, Barrot et Cie, banquiers, cours Bellecour.
– Ah ! souligna la manutentionnaire.
Canetègne voulut esquisser un geste de dénégation, mais le policier l’arrêta :
– J’ai vu votre compte.
Et après un silence :
– Votre maison brûle ; – c’est une figure – un homme se présente pour aller à travers les flammes sauver votre coffre-fort. Sans lui vous perdez tout. Il me semble qu’en vous demandant 20 pour 100 de votre fortune, il est modéré.
– 20 pour 100 ! gémit l’Avignonnais.
– Pas même. Cent mille francs payables le jour où je retrouve les fugitifs.
– Vous m’assassinez.
– Pas le moins du monde. Mon prix ne vous convient pas, je me retire.
Déjà M. Martin reprenait son chapeau.
Le négociant, partagé entre l’avarice et la peur, céda à la seconde.
– Laissez-moi le temps de réfléchir, vous avez une impétuosité.
– Toute naturelle. Vos adversaires ne réfléchissent pas, ils filent.
L’argument décida Canetègne.
– Soit !… Cent mille si vous les trouvez. Rien si c’est la police.
– Naturellement, fit l’agent d’un ton goguenard. Maintenant ne perdons pas une minute ; passons à votre magasin. De là, nous irons chez votre banquier – vous y prendrez quelque argent et préparerez un chèque à mon nom. – Enfin je vous montrerai quelque chose que la police n’a pas encore découvert.
Il salua Mlle Doctrovée d’un air amical et, suivi du négociant, il quitta la maison. Jusqu’à la rue Suchet, les deux hommes n’échangèrent pas une parole.
– Pourquoi sommes-nous venus ici ? demanda l’Avignonnais.
– Pour voir votre courrier.
– Mon courrier ?
– Voyez toujours, vous comprendrez.
Obéir était le plus simple. Pénétrant dans le compartiment réservé à la caisse, le commissionnaire se mit à dépouiller le paquet volumineux de correspondances entassées sur son bureau. Soudain il eut un cri.
– L’écriture d’Yvonne !
– La lettre vient de Chambéry, n’est-ce pas ? questionna l’agent sans paraître étonné.
– Comment le savez-vous ?
– Peu importe. Je le sais.
D’un geste impatient, Canetègne déchira l’enveloppe et d’une voix tremblante lut ce qui suit :
Monsieur,
Vous n’appréciez que les choses qui se vendent. L’honneur vous semble sans valeur. Aussi avez-vous essayé d’en priver une pauvre fille dont c’est toute la fortune. Pour cette chose vague, cette fumée comme vous l’appelez, d’autres sont capables de tous les sacrifices. J’espère revenir victorieuse de la lutte à laquelle vous m’obligez. Alors vous ne douterez plus.
Yvonne Ribor.
Sa lecture terminée, il regarda l’agent :
– Eh bien ?
– La lettre est conçue dans un noble esprit.
– Ce n’est point votre appréciation sentimentale que je sollicite. Le timbre de la poste de Chambéry ne vous paraît-il pas un renseignement ?
Le policier le considéra narquoisement :

– Vous inclinez donc à penser ?
– Que mon ex-caissière se dirige sur Modane.
– Et comme la frontière est gardée, vous vous réjouissez. Vous n’aurez plus à me verser cent mille francs.
– Précisément, je l’avoue. M. Martin fit entendre un petit rire sec.
– Cela ne fait rien. Passons chez votre banquier.
– Vous voulez, après cette lettre…
– Plus que jamais. Il est neuf heures moins le quart, nous avons le temps, car nous prendrons le train de 9 h. 41 pour Mâcon.
Et frappant familièrement sur l’épaule de l’Avignonnais qui ouvrait des yeux effarés.
– Cette lettre-là, c’est une ruse pour vous dépister.
– Allons donc ! Si vous me prouvez cela.
– C’est ce que je ferai si vous m’accompagnez. À une condition seulement. C’est que vous me garderez le secret. Je tiens à gagner votre argent, et je ne vous pardonnerais pas de m’en empêcher.
Le ton dont il prononça ces paroles était clair. Canetègne ne s’y trompa pas. Il fallait agir loyalement – une fois par hasard – avec un homme qui connaissait son histoire.
Dans la rue, le policier héla une voiture et donna au cocher l’adresse de la banque Fulcraud, Barrot et Cie.
Chez les banquiers, l’Avignonnais se fit remettre vingt mille francs et annonça qu’il serait peut-être présenté à l’encaissement un chèque de cent mille. Un employé prit note de cette déclaration. Puis toujours flanqué de M. Martin, le négociant remonta en voiture.
– 9 h. 3, murmura l’agent, c’est juste !
Bientôt le véhicule s’arrêta devant le pavillon où Yvonne et ses amis avaient passé la veille. Le policier tira de sa poche une clef qu’il introduisit dans la serrure.
– Qu’est cela ? demanda Canetègne.
– La première cachette de vos ennemis. J’ai pris une empreinte à la cire et me suis fait fabriquer une clef, ce qui nous permet d’entrer comme chez nous.
Sur ces mots il ouvrait la porte et pénétrait dans le pavillon. Il faisait sombre, et durant quelques secondes le commissionnaire ne distingua rien. Mais ses yeux s’accoutumèrent à la pénombre, il vit sur le plancher des vêtements d’hommes et de femme.
– C’est ici, déclara l’agent, que les fugitifs ont changé de costumes. Ici également que, grâce à un indicateur pointé au crayon, j’ai pu reconnaître la route choisie par eux.
Il s’interrompit :
– 9 h. 30, ne manquons pas le train ; décampons.
À 9 h. 38, les deux hommes s’installaient dans un compartiment de première classe, et bientôt le convoi les emportait vers Mâcon.
De son côté, Claude Bérard, après une nuit passée à Chambéry, avait fait route sur Culoz, et laissant cette gare en arrière, filait à toute vapeur sur la même destination.
Il n’accordait qu’une attention distraite au paysage. Ni Ambérieu avec sa jolie rivière l’Albarine, ni Bourg, dominée par le clocher de l’église de Brou, ne lui semblèrent dignes de remarque. Sa pensée était ailleurs. Elle volait, précédant le chemin de fer trop lent, vers Étaples où il devait rejoindre ses amis. Le jeune homme s’exaspérait à chaque arrêt du train. Polliat, Mézériat, Vonnas, Pont-de-Veyle eurent tour à tour leur part dans ses malédictions. Enfin la machine ralentit pour la dernière fois.
– Mâcon, Mâcon, crièrent des voix d’employés.
Claude bondit sur ses pieds, empoigna sa valise couchée dans le filet, sauta sur le quai et traversa la gare d’un pas pressé.
Il heurta violemment un homme au visage glabre qui se tenait près de la sortie, regardant curieusement les voyageurs. Il n’y prit pas garde. Celui qu’il avait heurté n’en parut pas formalisé, au contraire. Sa bouche s’ouvrit dans un rire silencieux.
– Le voici, dit-il seulement à un personnage qui se dissimulait derrière lui.
– Ce blond ? interrogea l’individu.
– Mais oui, mon bon monsieur Canetègne. J’ai omis de vous prévenir. Le brun est devenu blond. Il s’agit maintenant de ne pas le perdre de vue.
Et d’un ton intraduisible, tout en s’élançant sur les traces de Bérard :
– Il m’est cher ce jeune homme. Il représente le tiers de mon chèque.
La réflexion ne plut pas au négociant. Une grimace le prouva, mais il allongea les jambes pour se maintenir à hauteur de son compagnon. La course ne fut pas longue. Le sous-officier atteignit le guichet de distribution des billets. Ses ennemis l’entendirent demander un ticket pour Paris.
– Dans une heure, monsieur, répondit le receveur. Le premier train est à 2 heures 54.
Le voyageur frappa le sol d’un talon impatient, puis il se décida, quitta la gare et pénétra dans un café voisin. Le policier n’avait pas perdu un de ses mouvements.
– Attendons comme lui, fit-il.

L’heure venue, ils retournèrent à la gare sur les pas de Claude et prirent place dans le train de Paris. À 10 h. 37 du soir ils atteignaient enfin la capitale. Toujours suivant Claude qui ne se doutait de rien, ils traversèrent en bourrasque les salles d’attente et gagnèrent la cour que les réverbères, les lanternes de voitures et d’omnibus constellaient de lueurs dansantes. Le sous-officier héla un fiacre. Aussitôt, Martin poussa l’Avignonnais dans un autre véhicule, et s’y engouffra après avoir bouleversé le cocher par ces paroles magiques :
– Deux louis pour toi, garçon, si tu ne perds pas de vue ce « sapin ».
À trente mètres de distance les voitures s’ébranlèrent, se dirigeant vers la Bastille. Elles allaient grand train. Elles passèrent à droite de la colonne de Juillet, longèrent le canal, parcoururent le boulevard Voltaire, la place de la République, le boulevard Magenta et s’arrêtèrent, à dix secondes d’intervalle, devant la haute façade de la gare du Nord.

Onze heures sonnaient.
Claude, son automédon payé, se mit à courir. Martin et Canetègne trottèrent dans ses pas. Comme lui, ils se munirent au guichet de billets pour Étaples, et sautèrent dans le train de 11 h. 5 sur Creil, Amiens, Abbeville et Calais.
Il était temps, la longue file de wagons s’ébranlait.
– Nous allons à Étaples, dit l’agent, rien ne nous empêche de dormir. Bonsoir, monsieur Canetègne.
Sur ce, il s’accota dans son coin et ferma les yeux. Le négociant, brisé par les émotions de cette journée, lutta un instant contre le sommeil ; mais le convoi était à peine à hauteur de Saint-Denis que sa tête se pencha en avant et qu’un ronflement nasillard annonça sa défaite.
Au moment où le train quittait Abbeville, une secousse le rappela au sentiment de la réalité.
Il ouvrit les yeux et aperçut M. Martin souriant, qui lui présentait une paire de lunettes bleues et un cache-nez.
– Pour n’être pas reconnu ? dit seulement le policier.
– Reconnu, par qui ?
– Par ceux que nous poursuivons.
– Où sont-ils ?
– Je l’ignore encore, mais mon instinct m’avertit que nous les rencontrerons à Étaples.
Canetègne n’en demanda pas davantage. Il cacha ses yeux sous les verres bleus et jeta le cache-nez sur ses épaules. À 7 h. 58, on entrait en gare d’Étaples, et presque aussitôt l’agent en observation à la portière s’écriait :
– Les voici !
Il désignait un homme aux cheveux bruns et une jeune femme abominablement rousse qui attendaient sur le quai. L’Avignonnais se précipita pour descendre, mais son compagnon l’arrêta :
– Un instant. Inutile de les effaroucher, tout serait à recommencer.
Claude Bérard avait rejoint ses amis et tous trois s’éloignaient.
– À notre tour, reprit Martin, qui saisit le bras du commerçant et le contraignit à régler son pas sur le sien.
Tout en marchant, il parlait :
– Mon cher monsieur, j’ai tenu ma promesse ; j’ai retrouvé les fugitifs. À vous de tenir la vôtre en faisant passer de votre poche dans la mienne, le petit papier que vous savez.
Canetègne poussa un soupir désolé.
– Cent mille francs, c’est cher !
– Vous refusez, bon. Je cours prévenir ces jeunes gens.
– Non, ne faites pas cela, je me résigne. Mais quand on a amassé un petit pécule dans les affaires…
– Les affaires, c’est l’argent des autres. Supposez que vous restituez.
Sans relever l’impertinence, le négociant tira de son portefeuille le chèque préparé à Lyon et le remit au policier.
– À la bonne heure, dit celui-ci dont les yeux brillèrent, vous devenez raisonnable. Tenez, notre gibier niche à l’hôtel de la gare. On va se raconter les péripéties du voyage. Profitons-en pour courir au télégraphe. Nous prierons M. Rennard d’expédier le mandat d’amener au commissaire central de la localité. Il est 8 h. 10 ; à midi sa réponse arrivera et le tour sera joué.

V
PREMIÈRES HEURES HORS DE FRANCE

Cependant Marcel et Yvonne avaient conduit Claude dans une chambre de l’hôtel de la gare.
– Reposez-vous, conseilla Dalvan, car la soirée sera fatigante.
– Comment cela ?
– Nous ferons une promenade en mer. Un patron de barque nous emmène à la pêche. On part à trois heures.
Le « Marsouin » voulut obtenir une explication, mais Simplet quitta la chambre. Puis laissant Yvonne s’enfermer chez elle, il s’en alla flâner par la ville.
Bientôt il gagna la rive de la Canche, dont l’embouchure forme le port d’Étaples, et il descendit vers la mer.
Une cabane dressait son toit de chaume à quatre ou cinq cents mètres de lui. Des « chaluts », soutenus par des perches, séchaient à l’entour. Sur la porte un homme de cinquante ans, dont la barbe grisonnante paraissait presque blanche à cause du hâle du visage, fumait une courte pipe. En voyant le jeune homme, il souleva son bonnet de laine.
– Bonjour, patron, fit le sous-officier. Ça tient toujours notre partie de pêche ?
– Bien sûr, monsieur. Si vous êtes à bord de la Bastienne à l’heure du jusant, je vous emmènerai certainement. C’est une bonne barque allez. Tenez, regardez-la, là-bas, comme elle roule. On dirait qu’elle a hâte de partir.
– Nous ne la ferons pas attendre, soyez tranquille.
Marcel serra la main du patron et revint vers son logis. Comme il passait devant la maison du commissaire central, il entendit un bruit de voix ; le nom de « Ribor » lui parvint distinctement.
Il s’arrêta net. Ribor ! Yvonne s’appelait ainsi. Qui donc prononçait ces deux syllabes. Puis il sourit. Évidemment il ne s’agissait pas d’elle, mais d’autres Ribor. Quelle apparence que l’on s’occupât de la jeune fille chez le magistrat ?
Pourtant, il ne pouvait se décider à s’éloigner. Immobile sur le trottoir, il prêtait l’oreille, concentrant toute son attention pour saisir les paroles qui s’échappaient par la porte entre-bâillée. Il se rapprocha de l’ouverture. Les sons lui arrivèrent plus nets, et avec stupeur il surprit les répliques suivantes :
– Vous me dites que le mandat d’arrêt m’arrivera de Lyon vers midi ?
– Oui.
– Alors, je serai tout à votre disposition, et nous procéderons à l’arrestation de cette fille.
– Devançons un peu le moment.
– Je ne le puis. Plainte a été portée devant les autorités lyonnaises, et je ne veux agir que sur avis d’elles. Question d’égards. Après tout, votre voleuse ne s’envolera pas. Tenez, je vais vous montrer ma bonne volonté. Je vous donnerai un de mes agents pour surveiller l’hôtel de la gare et pour s’opposer au départ de cette personne.
– Parfait !
Un bruit de chaises remuées indiqua à Simplet que les interlocuteurs se levaient. D’un bond il quitta son observatoire et s’élança de toute la vitesse de ses jambes dans la direction de l’hôtel.
Claude et Yvonne causaient.
Le « Marsouin », qui avait bien dormi en wagon, s’était contenté de réparer le désordre de sa toilette, puis il avait rejoint la jeune fille. Ils furent terrifiés quand Dalvan leur apprit ce qu’il venait de surprendre. Mais le sous-officier étouffa leurs exclamations :
– Il faut décamper. Prenons dans nos valises ce qui a une valeur ; abandonnons le reste et partons.
– Mais où ? gémit Yvonne éperdue.
Marcel, qui déjà se livrait à un tri des objets enfermés dans son sac de voyage, releva la tête.
– C’est bien simple.
– Toujours simple, clama la jeune fille avec une nuance de colère.
– Évidemment. On va d’abord nous chercher loin d’ici, cachons-nous donc à deux pas.
– C’est facile à dire…
– Et à faire. La cabane du père Maltôt est proche. Sous couleur de déjeuner, nous y attendons l’heure de la marée. En route Claude, que personne ne connaît en ville, achètera un jambonneau, du saucisson, du pain et quelques bouteilles. À trois heures, toutes voiles dehors, nous sortirons du port.
– Mais il faudra revenir, la pêche terminée.
Dalvan eut à l’adresse de sa sœur de lait un regard plein de reproche.
– Essaye donc d’avoir confiance en moi, commença-t-il. Puis changeant de ton : Y êtes-vous, Bérard ?
– Je vous attends.
– Bien, venez donc.
Sans affectation les fugitifs descendirent, traversèrent la cour de l’hôtel et s’échappèrent par une porte s’ouvrant sur une ruelle qui longeait les derrières de l’établissement.
Il était temps. Canetègne, flanqué de M. Martin et de l’agent mis à sa disposition par le commissaire central, paraissait sur la place du Chemin-de-Fer. Fort de la présence de son nouvel allié, le négociant se présenta à la grande entrée de l’hôtel de la Gare. Les précautions devenaient inutiles, il s’enquit de ceux qu’il poursuivait.
– Ces messieurs et cette dame sont dans leurs chambres, répondit l’hôtesse qui n’avait pas vu sortir Marcel et ses amis. Si vous le désirez, je vais les faire prévenir.
– Inutile, s’empressa de répliquer l’Avignonnais. Veuillez seulement nous donner à déjeuner. Nous les verrons plus tard.
Et il se plaça dans la salle commune, de façon que nul ne pût franchir le seuil de la maison sans être aperçu.
Il rayonnait. Enfin il allait reprendre Yvonne. Ses craintes cesseraient aussitôt. Sa vie calme et confortable recommencerait. Il continuerait à dérober aux Lyonnais leur considération et leur argent.
Telle était sa satisfaction qu’il oubliait de quel prix exorbitant il la payait. La face épanouie du policier ne lui rappelait pas ce chèque de cent mille francs que cet autre honnête homme lui avait extorqué. Il mangea comme un loup, but ainsi qu’une éponge. Tout était parfait : poisson ou rôti, cidre ou vin. L’eau-de-vie de pommes de terre, qu’on lui servit avec le café, lui parut même exquise. Jamais, il ne s’était senti si gai, si léger. Martin du reste, content de son opération, non plus que l’agent, ravi du bon repas, n’engendraient la mélancolie.
Bref, en dégustant le moka douteux, le trio devisait avec de grands éclats de rire ; quand le commissaire central fit irruption dans la salle. Sous sa redingote, on apercevait son écharpe.
– J’ai la dépêche de M. Rennard, dit-il. À ces paroles magiques, tous se levèrent.
– Procédons immédiatement à l’arrestation, continua le magistrat, et s’adressant à l’aubergiste qui regardait toute émue par sa présence. Quelles chambres occupent les gens que nous cherchons ?
La bonne femme leva les mains au ciel.
– Quels gens ?
– Ceux dont nous parlions avant déjeuner, expliqua le négociant.
– Qu’est-ce que vous leur voulez donc ?
– Les mettre à l’ombre. Ce sont des voleurs.
– Des voleurs chez moi… Et ils ont couché ici ? C’est affreux !
La commère, effarée, s’assit sur une chaise, sa face bouffie devenue blême.
– Répondez donc… quelles chambres ?
– Au premier : 5, 7 et 9.
Elle fit un effort pour se remettre sur ses pieds.
– Je vais vous conduire.
Mais elle chancelait. Le commissaire l’arrêta.
– Inutile, nous n’avons pas besoin.
Suivi de ses compagnons, il s’élança dans l’escalier. Au premier, courait un long couloir bordé de portes numérotées.
– Un homme au haut de l’escalier, dit-il.
– Voilà, fit Martin, se plantant à l’endroit désigné.
Alors, d’un pas posé, ses talons sonnant sur le carrelage du corridor, le magistrat s’avança vers les portes numérotées 5, 7, 9, auxquelles il frappa successivement.
Canetègne se frottait nerveusement les mains. Dix secondes s’écoulèrent. Pas de réponse.
– Au nom de la loi, ouvrez ! dit le commissaire d’une voix forte.
Toutes les portes, sauf celles que l’Avignonnais dévorait des yeux, tournèrent aussitôt sur leurs gonds, et les voyageurs montrèrent leurs têtes étonnées.
– Ah ! s’écria un petit homme rond en sortant du 8 ; c’est aux personnes d’en face que vous avez affaire. Elles sont en promenade.
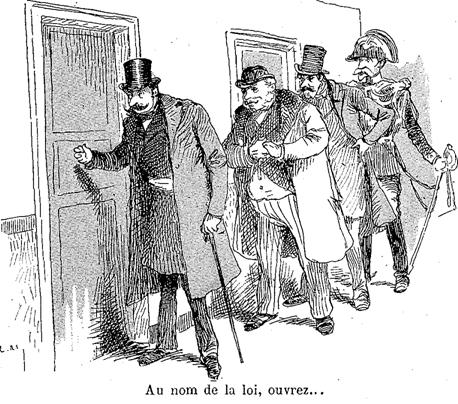
– En promenade, rugit Canetègne. Puisque l’hôtelière nous a affirmé qu’elles n’étaient pas sorties.
– Moi je les ai vues descendre il y a une heure à peu près.
Le commissaire regarda l’agent. Celui-ci tourna les yeux vers le négociant.
Martin avait disparu. Presque aussitôt il revint.
– J’ai pris les clefs au bureau. Voyons si nos « clients » ne se sont pas envolés.
Il ouvrit la porte de la chambre de Claude.
– Ils reviendront, déclara-t-il. Voyez, la valise est là… Nous n’avons qu’à les attendre.
L’observation paraissait juste ; on s’y conforma. Les quatre personnages retournèrent dans la salle commune.
Les petits verres rendaient la faction moins rude, pourtant Canetègne et ses acolytes tournaient la tête au moindre bruit. À chaque instant, quelqu’un se levait, allait à la fenêtre et fouillait la place du regard. Peine inutile. Les fugitifs ne se montraient pas et pour cause.
Une heure, deux heures sonnèrent. Martin, qui réfléchissait, quitta brusquement sa place et entra dans le bureau. Pour la dixième fois le commissaire central collait son visage aux vitres de la croisée, quand le policier lyonnais se montra à la porte de la pièce.
– Messieurs, dit-il froidement, nous sommes joués. Nos voleurs ne reviendront pas.
Un cri d’indignation échappa à Canetègne.
– C’est comme je vous l’affirme, poursuivit Martin. Les valises abandonnées étaient une ruse ; j’aurais dû me défier. Je viens de les ouvrir. On y a pris un certain nombre d’objets, c’est aisé à constater.
– Où sont-ils ? interrogea le commissionnaire d’une voix qui n’avait rien d’humain.
– Je n’en sais rien ; mais ils n’iront pas loin, si monsieur le commissaire veut bien courir à la gare et télégraphier sur la ligne.
Le magistrat bondit vers la sortie.
– J’y vais !
Un quart d’heure après il était de retour. À la gare, nul n’avait vu les fuyards. Sûrement ils s’étaient dirigés vers la campagne.
– Alors, déclara Martin, il faut avertir la gendarmerie, mettre sur pied les agents disponibles et organiser une battue. La petite ne marchera pas longtemps. Je parcours la ville en m’informant. Rendez-vous sur le port.
Tous se dispersèrent. Pour Canetègne, il s’accrocha désespérément au policier et le suivit à travers la cité. Nulle part on ne les renseigna. Pas un instant l’agent ne songea à entrer dans les magasins, où Claude avait fait emplette. Il ne pouvait lui venir à l’esprit que les jeunes gens, pressés de gagner la campagne, avaient perdu en achats un temps précieux. Logique était son raisonnement, mais faux son point de départ. Aussi ramena-t-il le commerçant sur le port sans avoir obtenu le moindre éclaircissement.
Furieux et penaud, il malmenait l’infortuné Canetègne ; lui faisant remarquer que ses démarches, il les accomplissait bénévolement, par-dessus le marché. Par leur contrat, il n’y était pas tenu, etc.
À l’instant où ils rejoignaient le commissaire et ses subordonnés, un bateau de pêche, incliné sous ses misaines, franchissait lentement l’entrée du port.
C’était la Bastienne ! Masqués par le bordage, les passagers : Yvonne et ses amis, considéraient le groupe hostile massé sur le rivage, et la pauvre caissière, en fuite sans avoir mal agi, frissonnait en voyant son bourreau Canetègne se démener furieusement. Comme l’avait décidé Marcel, on avait déjeuné chez le père Maltôt ravi de rencontrer des touristes si aimables, et l’heure venue, on avait embarqué sans encombre.
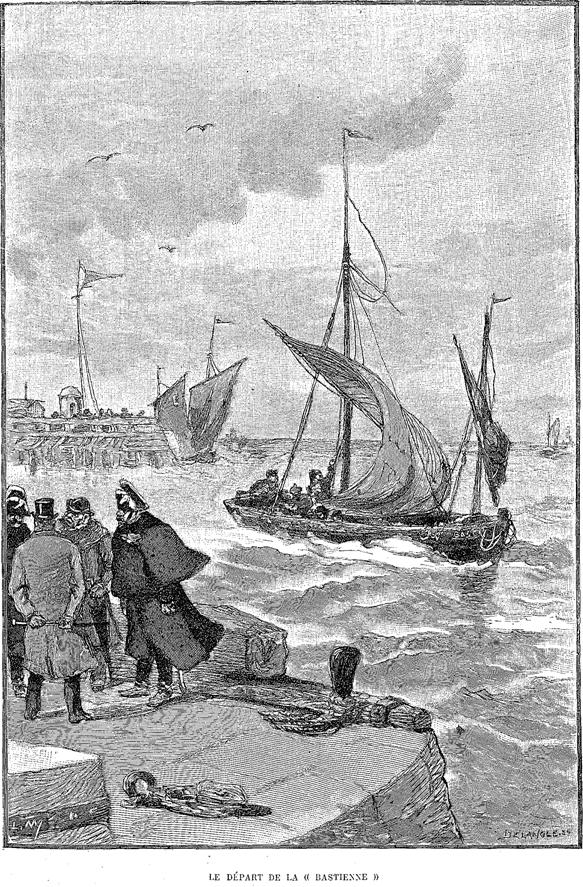
– Oui, murmura Mlle Ribor, nous sommes sauvés pour l’instant ; mais demain, quand nous reviendrons…
– Tu crois que nous serons en danger ?
C’était Dalvan qui répliquait ainsi. Yvonne le toisa.
– Tu ris, quand nous sommes plus prisonniers dans cette barque que dans l’hôtel d’où nous venons.
– Oui, parce qu’il y a un moyen bien simple de n’être pas capturés au retour.
– Lequel ?
– Ne pas revenir.
La jeune fille poussa une exclamation joyeuse :
– C’est vrai !
Mais son visage se rembrunit aussitôt :
– Et impossible, acheva-t-elle. Comment décider le patron de ce bateau ?
– Avec du sentiment, car c’est un brave homme, et un peu d’argent, car il est pauvre. Seulement il est indispensable que tu dises comme moi.
– Je te le promets.
La couleur remontait au visage d’Yvonne ; l’espoir brillait dans ses yeux fixés sur ceux de son interlocuteur. Le sous-officier sourit :
– Tout ira bien. Écoute. Nos parents s’opposent à notre mariage.
– À notre mariage, redit-elle d’un ton moqueur, tandis que le rose de ses joues devenait plus vif.
– Oui ; nous fuyons ces parents sans entrailles. Nous comptons nous marier en Angleterre, faire légaliser cette union au consulat, et revenir en France. En priant bien le patron je suis sûr qu’il nous conduira à la côte anglaise !
– Eh bien, dit Claude, tentez la démarche.
De nouveau, Yvonne parut surprise. Le « Marsouin » s’effaçait devant Marcel. Avec son entêtement de femme elle se cramponnait à l’idée préconçue. Elle avait décidé que Bérard, brun, aux traits énergiques, devait avoir l’initiative ; et il s’en remettait à son ami.
Le jeune homme répondit :
– Non, pas maintenant.
– Tu hésites ?
– J’attends seulement que nous ayons atteint la haute mer.
La côte française apparaissait encore nettement, mais elle rapetissait à vue d’œil, s’enfonçant sous l’horizon de mer sans cesse élargi. Bientôt les couleurs perdirent leur netteté. La terre prit l’apparence d’une ligne violacée, puis grise. Maintenant ce n’était plus qu’un brouillard léger, flottant sur l’eau verte. Quelques encablures encore et les fugitifs eurent l’illusion d’être seuls, sous l’immense cloche nuageuse du ciel posée sur le plateau mouvant de l’Océan. Alors, Dalvan se leva et rejoignit le patron Maltôt.
Autour d’Étaples une véritable chasse à l’homme était organisée. Gendarmes, agents de police battaient les environs avec ardeur, excités par l’appât d’une prime de mille francs, promise par Canetègne à qui arrêterait les « voleurs évadés ».
Les vagabonds, les « roulants » ont conservé le souvenir de cette journée. Tous ceux dont les papiers n’étaient pas suffisamment en règle, furent arrêtés ; la prison se trouva trop petite pour les recevoir tous. On occupa militairement la maison de ville et l’école transformées en lieux de détention.
Cent onze malheureux furent logés aux frais de l’État ; mais ceux qui causaient tout ce remue-ménage demeuraient introuvables. L’Avignonnais écumait. Vers le soir, n’y pouvant plus tenir, il sortit d’Étaples et courut sur les routes comme un renard en chasse. Il allait, dans la nuit, flairant le vent, proférant de sourdes menaces.
Tout à coup le terrain manqua sous ses pas. Une tranchée coupait la route jusqu’au milieu de la chaussée. Le négociant ne l’avait pas remarquée, et il avait roulé au fond du trou. Pour comble de malheur, de l’eau provenant d’infiltrations remplissait la cavité.
Trempé, bouleversé, le commissionnaire avala quelques gorgées du liquide boueux, réussit à se redresser et, les vêtements collés au corps, couvert de glaise jaunâtre, il parvint à remonter sur la route.
Rentrer à Étaples pour changer d’habits était sa pensée. Afin d’éviter la fluxion de poitrine, il prit le pas gymnastique. Des pas lourds donnèrent derrière lui sur le revêtement du chemin. Des voix impérieuses lui crièrent :
– Arrêtez !
Peu brave par nature, démoralisé d’ailleurs par son accident, Canetègne s’affola. Il crut être poursuivi par des brigands. Ses jarrets se détendirent ainsi que des ressorts, et une course folle, vertigineuse, commença.
Les cris continuaient en arrière, le cinglant comme des coups de cravache. Il bondissait ; son cœur faisait dans sa poitrine de brutales embardées ; l’air s’engouffrait dans ses poumons avec des sifflements. Son sang affluait à la tête, ses tempes palpitaient, et dans le grossissement de l’épouvante, les poursuivants lui paraissaient approcher dans un roulement de tonnerre. Les premières maisons de la ville se montraient. Le négociant se crut sauvé, mais une ombre se dressa brusquement au milieu de la voie.
– Halte-là !
À cette vue, Canetègne s’arrêta net, la respiration lui manqua, ses jambes plièrent et il s’abattit à terre sans connaissance.
Quand il revint à lui, il s’aperçut qu’il était couché sur le dos, dans une pièce basse qu’un rayon de lune éclairait vaguement. En suivant la traînée lumineuse, il se rendit compte qu’elle pénétrait par une fenêtre garnie de barreaux. Il se passa la main sur le front, et comme il est d’usage au sortir d’un évanouissement.
– Où suis-je ? bégaya-t-il.
Des ricanements lui répondirent. Dans tous les coins de la chambre des ombres s’agitèrent.
– Qu’est-ce que c’est que ça ?
– Ça, mon vieux, fit une voix rauque, c’est le clou. Quand on n’a pas de papiers, l’État vous offre l’hospitalité.
– Comment ! je suis en prison ?
– Comme nous. Après ça, si ça ne convient pas à monsieur, il n’a qu’à parler, on lui retiendra un appartement à l’hôtel.
Un éclat de rire ponctua la plaisanterie. L’Avignonnais se demanda s’il ne rêvait pas.
L’aventure était simple. Deux gendarmes, revenant sur la route, avaient remarqué son allure désordonnée. En le voyant disparaître dans la tranchée, ils avaient pensé qu’il cherchait à se cacher, s’étaient précipités, l’avaient poursuivi et arrêté, grâce à un collègue embusqué aux abords de la ville. Aucun n’avait reconnu dans cet homme souillé de glèbe, aux cheveux trempés de sueur, le « notable » à la prime de cinquante louis, et, fidèles à leur consigne, ils avaient transporté leur prise dans une des salles de l’école, occupée déjà par plusieurs autres habitants.
– En prison, reprit le négociant, mais c’est de la folie.
Chancelant, il se leva, gagna la porte qu’il frappa à coups redoublés. Un agent se montra aussitôt.
– Monsieur, s’écria l’Avignonnais, mon arrestation est le résultat d’une erreur.
– C’est pour me conter cela que vous me dérangez, grommela le gardien moitié fâché, moitié railleur.
– Sans doute, je suis monsieur Canetègne.
– Vraiment ?
– À preuve que je dois payer une prime de mille francs à celui qui ramènera…
L’agent eut un large rire.
– Vous expliquerez cela au commissaire, demain matin.
– Mais…
– Et surtout restez tranquille. C’est un conseil que je vous donne. La porte se referma au nez du commerçant ahuri.
Il n’eut pas le loisir de se plaindre. Une main s’appuya lourdement sur son épaule. Il se retourna. Devant lui, ses compagnons de captivité étaient debout.
– Tu viens d’affirmer que tu es Canetègne, gronda le premier ; que tu as promis une prime à la rousse, est-ce vrai ?
– Parfaitement.
– Alors, c’est à cause de toi que l’on nous a ramassés ?
Le danger de sa confidence pénétra l’Avignonnais.
– Je vais vous expliquer…
– Pas besoin, c’est compris. Ah ! tu tracasses le pauvre monde, tu couvres d’or les gendarmes. Tu es seul maintenant, nous allons voir si tu déchantes.
Et prenant la position du boxeur, l’homme ajouta :
– Gare-toi. Je t’offre le duel des zigs, à un pas, autant de coups de poing que l’on veut. Y es-tu ?
– Mais, monsieur, gémit le négociant terrifié.
– Monsieur ! as-tu fini. Je te dispense de mettre des gants.
La main du vagabond s’avançait menaçante. Canetègne se recula et, d’une voix étranglée par l’émotion, cria :

– Au secours !
Il n’acheva pas. Son adversaire l’avait frappé en pleine figure. Durant quelques instants une grêle de taloches s’abattit sur lui. Aveuglé, contusionné, il tomba à genoux, cachant son visage de ses bras relevés.
La nuit parut longue au commissionnaire. À chaque minute il tremblait de recevoir une nouvelle correction. Blotti dans un coin, car les prisonniers ne lui permettaient pas de s’étendre auprès d’eux, il attendit le jour avec angoisse. Enfin l’aurore entr’ouvrit les portes de l’Orient ; mais pendant de longues heures encore, le malheureux dut subir les quolibets de ses voisins.
Extrait de la prison et conduit au commissariat, il eut peine à se faire reconnaître. Les yeux pochés, le nez gonflé, la face meurtrie, il ne rappelait en rien le commerçant de la veille. Le magistrat, convaincu cependant par ses explications, le remit en liberté. Il poussa même la délicatesse jusqu’à lui donner la formule d’une lotion excellente pour bassiner les plaies contuses. Boitant et pestant, Canetègne se rendit à l’hôtel et étendit ses membres endoloris dans un lit moelleux. Mais il était écrit que le séjour à Étaples ne lui procurerait aucune satisfaction. Le marché se tenait sous ses fenêtres. Les hennissements des chevaux, les appels des marchands faisaient un tintamarre tel qu’il ne lui fut pas possible de fermer l’œil.
Et, pour comble de disgrâce, vers trois heures de l’après-midi, M. Martin vint lui annoncer que la Bastienne entrait au port, ayant transporté les fugitifs en Angleterre, et que lui-même, estimant son rôle terminé, partait pour Lyon où, grâce à son chèque, il comptait se donner du bon temps. C’était trop. Le négociant pensa étouffer de rage. Ses ennemis lui échappaient. Il perdait cent mille francs. Il retrouva des forces pour vomir des imprécations qui eussent épuisé le souffle des héros d’Homère.
Pourtant, le lendemain, en dépit d’une forte courbature, il se rendit à la gare et monta dans le train pour Paris. À l’arrivée il déjeuna copieusement, puis sautant dans une voiture qui passait.
– Cocher, dit-il, au Petit Journal !
Et se laissant aller sur les coussins, il murmura avec un accent intraduisible :
– Tout n’est pas perdu. Ils se croient sauvés. Nous verrons bien !
VI
ORIGINAL YOUNG LADY
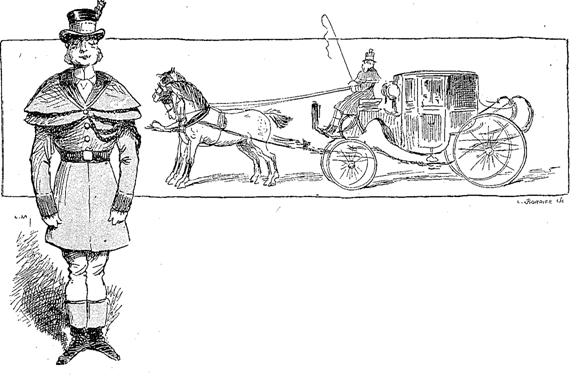
Marcel et ses amis avaient été déposés sur le rivage anglais par le patron Maltôt. Descendus à Hastings, ils avaient obéi à l’instinct des êtres poursuivis, en cherchant à augmenter la distance qui les séparait de leurs ennemis.
La station du South-Coast-Railway était proche. Par le premier train, les jeunes gens avaient filé à toute vapeur sur Brighton et Portsmouth ; puis par Salisbury, Bristol, Gloucester, Birmingham, Stafford, Stoke et Manchester, ils gagnèrent Liverpool, cet immense entrepôt commercial, situé au bord du profond estuaire de la rivière Mersey, à quelques kilomètres de la mer d’Irlande.
Dans ce voyage encore, Simplet guidait ses compagnons.
– Tout le monde est attiré par Londres, avait-il dit. Pour dépister la police, il suffit de tourner du côté opposé.
Et c’est ainsi que, le 2 décembre, les trois Français entrèrent en gare de Liverpool, tête des lignes de London, Manchester, Preston et Southport. De leurs perruques ils s’étaient débarrassés en route, et ils avaient repris, non sans satisfaction, leur apparence habituelle.
Ils suivaient à petits pas la file des voyageurs. Auprès des employés recevant les tickets, un domestique était debout, considérant avec un sourire bon enfant ceux qui passaient sous ses yeux. Sous ses yeux est l’expression juste, car il avait plus de six pieds.
Blond, rose, sanglé dans une superbe livrée à deux nuances, marron sur marron, le colosse continuait son inspection. Ses regards se fixèrent sur les Français. Il les scruta des pieds à la tête, eut un clignement des paupières et s’avança vers eux.
– Gentlemen, fit-il du ton le plus respectueux, lady, vous êtes attendus, s’il vous plaît, sur le Fortune. La voiture à votre disposition stationne dans la cour.
Tous trois s’entre-regardèrent.
– Le Fortune, qu’est-ce ? demanda tout bas Yvonne.
– Un hôtel sans doute, répliqua Marcel.
Claude gonfla ses joues :
– Mâtin ! s’il est tenu comme ce domestique…
– Il fait notre affaire. Les milieux élégants sont moins surveillés.
Et sur cette réflexion, Dalvan se tourna vers le géant qui attendait et lui dit :
– Marchez devant, mon ami.
Dans la cour, une calèche élégante stationnait. Le domestique ouvrit la portière.
– Sapristi ! grommela Bérard, un huit-ressorts ! Gare à l’addition !
À l’intérieur se tenait un monsieur grave, cravaté de blanc, lequel s’empressa de s’asseoir sur le strapontin pour faire place aux voyageurs. Ceux-ci installés, il salua, et de l’air le plus aimable :
– Before going into the Fortune, I wan visit two chops Allow-mo.
Marcel fit signe qu’il ne comprenait pas. Le personnage sourit.
– Êtes-vous Français ? dit-il presque sans accent.
– Oui. Et c’est heureux, car sans cela nous risquerions de ne pouvoir converser.
– Du tout, je sais également l’allemand, l’italien et l’espagnol.
Et sans paraître remarquer le mouvement de surprise de ses interlocuteurs, il poursuivit :
– Je vous demandais la permission d’entrer dans deux magasins tout en vous conduisant au Fortune.
– Accordée.
– Je vous remercie.
– Une question, je vous prie. À qui ai-je l’honneur de parler ?
– À William Sagger, licencié ès sciences géographiques, intendant de miss Diana Pretty, propriétaire du Fortune.
Les Français échangèrent un regard ahuri. Le factotum de l’hôtelière, de cette miss Diana Pretty, était licencié. Et pour la troisième fois revenant à son idée, Bérard mâchonna entre ses dents cette phrase désespérée.
– Quelle addition, mon empereur !
La voiture avait stoppé devant un superbe magasin de maroquinerie. William Sagger y entra. Cinq minutes après il revenait, et la calèche continuait sa route, longeant un vaste parc bordé de grilles.
– Le Sefton park, dit l’intendant, un des plus spacieux du monde, car il ne contient pas moins de cent soixante hectares.
– À la bonne heure, souligna Marcel, vous connaissez la ville.
– J’y suis arrivé avant-hier pour la première fois.
– Bah !
– Oui, mais j’ai parcouru le monde dans les livres. Et tenez, savez-vous où nous sommes en ce moment ?
Le véhicule traversait une place formée par deux bâtiments dont l’un occupait trois côtés à lui seul. William le désigna.
– La Bourse de Liverpool.
Puis étendant la main vers l’autre monument agrémenté d’un portique corinthien et surmonté d’un dôme couronné par une statue assise de Minerve :
– L’hôtel de ville, inauguré en 1754, mais restauré et considérablement augmenté depuis.
Un peu plus loin, il fit remarquer aux jeunes gens une construction basse, d’aspect triste :
– L’hôpital des Enfants-Bleus, où l’on recueille les orphelins.
Il se constituait décidément le cicerone des voyageurs.
– Ville curieuse, disait-il, et féconde en institutions étranges : ainsi le Saint-Georges-Hall, monument énorme au portique formé de seize colonnes de dix-huit mètres de haut, est affecté à la fois aux assises, aux concerts et aux meetings. Le Sailor’s Home est une hôtellerie monstre où les matelots trouvent à bon marché le vivre et le couvert. Le cimetière Saint-James, ancienne carrière de pierre rouge, a vu ses galeries transformées en catacombes.
Marcel et ses compagnons écoutaient charmés. William Sagger, avec une mémoire imperturbable, leur citait les noms des soixante-seize églises anglicanes, dépeignait la procathédrale de Saint-Pierre, les théâtres, les collèges, Royal Institution school et University-college.
Un second arrêt de la voiture coupa court à sa conférence, puis on repartit. Enfin on atteignit une station de chemin de fer, et l’intendant invita les voyageurs à descendre.
– Nous sommes arrivés ? demanda Yvonne.
– Pas encore, lady. Nous nous rendons à Birkenhead, le faubourg de la rive gauche de la Mersey. La traversée en bateau est ennuyeuse à cause du brouillard perpétuel qui couvre la rivière. Le chemin de fer supprime cet inconvénient, car il suit le tunnel creusé sous le lit du cours d’eau.
Pendant le trajet, il ne manqua pas d’apprendre à ses compagnons que le tunnel, éclairé à l’électricité, date seulement de 1880.
– À propos, interrompit Marcel, et la voiture qui nous a amenés ?
– Ne vous en inquiétez pas ; elle a sa remise à Liverpool.
Le sous-officier ne dissimula pas une grimace. L’hôtel de miss Diana Pretty lui paraissait vraiment trop luxueux.
– Bah ! pensa-t-il. Nous n’y séjournerons pas.
Le train déposa William et ceux qu’il guidait à Birkenhead presque au bord de la Mercey. L’intendant avait dit vrai. Un épais brouillard couvrait la surface du fleuve et débordait sur la rive. Gris, lourd, opaque, il limitait la vue à quelques mètres et les Français avaient peine à ne pas perdre leur conducteur. Bientôt celui-ci leur montra un escalier étroit s’enfonçant entre deux murailles de pierre.
– Dans deux minutes nous serons à bord.
– À bord, répétèrent les jeunes gens, c’est donc un navire ?
– Le Fortune est en effet un bateau de plaisance ; mais il se distingue de tous ceux que vous avez pu voir comme le soleil d’une chandelle.
– Allons donc voir le soleil, gouailla Bérard en s’engageant derrière William dans l’escalier.
Sur la dernière marche un homme se tenait debout, un pied appuyé sur l’avant d’un canot dont la silhouette se dessinait vaguement dans la brume.
– Le Fortune est à l’ancre à deux encablures ; ce bassin est le Great float le plus étendu de Birkenhead.
C’était, bien entendu, Sagger qui formulait ce renseignement. Tous prirent place dans l’esquif, qui aussitôt s’éloigna du quai.
– Tiens, murmura Marcel, il file bien et avec un seul homme d’équipage.
En effet, le matelot qui les avait reçus paraissait seul à l’arrière :
– Bateau électrique, déclara William.
– Ah !
Doucement Claude tira son ami par la manche et d’une voix navrée :
– Un canot électrique maintenant. Informez-vous des prix. On va nous demander tout ce que nous possédons.
– Peuh ! j’ai cent mille francs sur moi.
– Pour faire le tour du monde, pas pour visiter Liverpool. Sous prétexte de nous mener à la Fortune, cet English m’a l’air de nous conduire à la ruine.
L’inquiétude du « Marsouin » commençait à gagner Simplet. Il se pencha vers William.
– Que désirez-vous, gentleman ? questionna celui-ci.
– Apprendre de vous quels sont les tarifs du Fortune ?
– Les tarifs ?
La bouche de l’Anglais s’ouvrit en accent circonflexe. Ses traits exprimèrent la surprise.
– Les tarifs ? redit-il.
– Oui, sur le Fortune, on prend une chambre ?
– Pardon, une cabine.
– Soit ! une cabine. On déjeune, on dîne ?
– Aussi parfaitement qu’il est possible de manger.
– Je n’en doute pas ; mais quel est le prix pour tout cela, service compris ?
– Vous voulez demander combien vous devez payer ?
– C’est cela même.
– Rien du tout.
À son tour, Marcel fut stupéfait.
– Quel singulier hôtel ! laissa-t-il échapper.
L’intendant prit un air gourmé :
– Le Fortune n’est pas un hôtel. C’est un yacht appartenant à miss Diana Pretty, citoyenne de la libre Amérique et unique héritière de feu Gay-Gold-Pretty, que l’on avait surnommé le roi de l’acier.
Avant que le sous-officier fût revenu de son étonnement, le canot arrivait auprès du yacht. La ligne élégante du navire s’estompait dans le brouillard. Un escalier mobile se déroula, affleurant de son extrémité le bordage de l’embarcation.
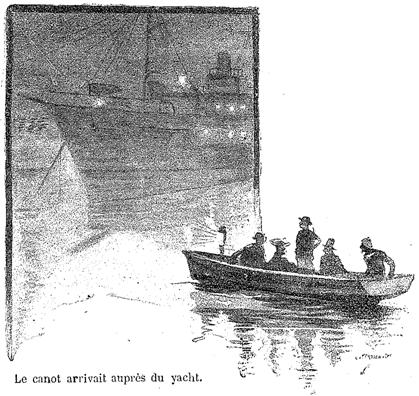
En quelques secondes les passagers se trouvèrent sur le pont et le canot fut fixé à ses palans.
– Joli navire ! murmura Bérard : du bois de teck comme plancher et les bastingages plaqués d’arek et de cèdre rouge.
Cependant William menait les hôtes de miss Diana à leur cabine, un double boudoir avec porte de communication ; le tout ménagé dans l’entrepont. Après quoi il les laissa sur ces mots :
– Après le voyage un peu de toilette repose. Quand vous serez disposés, veuillez sonner.
Les Français regardaient autour d’eux. Les tapis, les meubles artistiques, les bronzes rares, originaires d’Europe ou de Chine, les palmiers nains s’élançant jusqu’au plafond, les vases énormes du plus pur japon ; tout cela, au sortir de la ville anglaise brumeuse, prenait un aspect de rêve.
Mais il ne fallait pas faire attendre la princesse des Mille et une Nuits, qui les recevait si magnifiquement. Yvonne s’enferma donc dans l’un des salons, tandis que ses amis prenaient possession de l’autre. Des armoires à glissoires contenaient des lavabos de marbre blanc.
Tous les ustensiles de toilette d’or et d’argent, les boîtes, les flacons de cristal taillé, enchâssés de bronze précieusement travaillé, enchantaient les jeunes gens. Et sur chaque objet, ils retrouvaient les lettres D. P. Diana Pretty, qui leur rappelaient l’enchanteresse dont ils étaient les convives. Une sorte d’émotion les prenait en songeant qu’ils seraient présentés à cette jeune fille, si colossalement riche.
Le nom de Gold-Pretty leur avait causé un éblouissement. Tout le monde le connaissait, ce gigantesque industriel américain.
Les journaux en avaient assez entretenu leurs lecteurs. C’était lui qui, un jour que le Conseil fédéral des États-Unis lui refusait une concession de mines, avait décidé qu’aucun train ne circulerait sur ses voies ferrées jusqu’à ce que les difficultés pendantes fussent aplanies. Durant quatre fois vingt-quatre heures le commerce de la République transatlantique s’était vu arrêté, et le Conseil avait cédé. Puis ce tout-puissant du milliard était mort, et les feuilles publiques, évaluant sa fortune, avaient fait ruisseler dans leurs colonnes des cascades de chiffres à ébranler le plus solide cerveau.
L’héritière de cette fabuleuse fortune était à bord du yacht. Elle attendait les voyageurs. Malgré eux, ils se sentaient embarrassés. Pourtant il fallut mettre un terme à leurs ablutions. Après tout, c’était trop naïf. Deux soldats français, une honnête fille, n’avaient point à rougir d’être moins riches que l’Américaine. Sur cette conclusion, Yvonne appuya le doigt sur la sonnerie électrique. Le tintement avait à peine cessé qu’un laquais, revêtu de la livrée marron, se montra sur le seuil.
Les jeunes gens se mirent en marche sur ses pas, et par les coursives gagnèrent un délicieux réduit ménagé à l’arrière. Deux larges sabords s’ouvraient à droite et à gauche permettant de voir des deux côtés du navire. Au plafond un globe dépoli montrait la moitié de sa sphère et indiquait le mode d’éclairage nocturne de la pièce.
– Miss Diana prie ces gentlemen et lady de l’attendre un instant, fit le laquais d’un ton monotone.
Après quoi il disparut, laissant les voyageurs dans « le parloir ».

Partout des causeuses, des poufs, des crapauds se coudoyaient, invitant à la causerie. Au centre un divan circulaire entourait une vasque nacrée emplie de fleurs. Sous des vitrines s’étalaient mille trésors arrachés à l’Océan : coquillages bizarres, perles d’un admirable orient, coraux ; puis des pièces de monnaie, des fragments de métaux portant des étiquettes, et sur celles-ci des noms qui évoquaient de grandes catastrophes maritimes : Vigo, où coulèrent les galions chargés d’or ; Vanikoro, tombe de corail des navires de Lapérouse.
– Sans doute, dans ses voyages, remarqua Marcel, miss Diana met des dragues à la remorque. C’est ainsi qu’elle a pu former cette remarquable collection.
Le grincement léger d’une porte qui s’ouvrait avertit les Français qu’ils n’étaient plus seuls. D’un même mouvement ils tournèrent la tête, et demeurèrent immobiles dans une muette contemplation.
Sur le seuil une jeune fille de vingt ans à peine venait de se montrer. Des cheveux blond cendré, un teint éblouissant, une taille svelte et gracieuse rehaussée encore par la simplicité de sa mise : une robe de tulle agrémentée de mignonnes roses ; telle était miss Diana Pretty.
Ce qui frappait surtout en elle, c’était l’expression singulière de sa physionomie. Elle était jolie incontestablement avec ses grands yeux d’un bleu profond, son nez droit aux narines délicates, sa bouche bien dessinée ; mais sur ces traits charmants, une ombre s’épandait ; l’ombre des esprits moroses. Le regard clair était froid ; sa lèvre rose était dédaigneuse.
Elle considérait ses convives inconnus avec une persistance gênante, et dans ses cheveux un diamant énorme, – seul bijou de la milliardaire, – semblait un œil supplémentaire lançant des flammes.
Le premier, Claude, se sentit agacé par le silence. Il salua.
– Miss Diana Pretty, sans doute, dit-il.
L’Américaine inclina la tête.
– Elle-même. Enchantée de vous voir.
– Un instant, reprit Bérard, nous avons le grand plaisir de vous connaître maintenant ; permettez-moi de compléter la présentation – et désignant Yvonne – Mademoiselle…
Diana l’interrompit :
– Inutile. Demain matin vous retournerez à terre ; je ne vous reverrai jamais… à quoi bon des noms ?
Il y avait dans ses paroles une indifférence qui piqua le sous-officier.
– À quoi bon ? à n’être pas soupçonnés s’il vous manquait un couvert.
La jeune fille eut un petit rire sec.
– Le saurais-je seulement ? Du reste, avant votre départ on offrira à chacun de vous une bourse d’or contenant cent livres.
– Cent livres ? répéta le « Marsouin ».
Elle se méprit sur le sens de l’exclamation, et avec cet accent dédaigneux qui lui semblait habituel :
– C’est l’usage à bord du yacht Fortune !
Claude avait rougi. Il allait répliquer, Marcel le prévint.
– Mademoiselle, dit-il d’une voix ferme, vous êtes trop bonne mille fois. Permettez-moi de vous adresser une prière.
– Je permets.
– Veuillez faire remettre à l’eau votre canot ; je donnerai cent livres au matelot qui nous conduira à quai.
Claude et Yvonne ajoutèrent en même temps :
– Nous vous en serons fort obligés, mademoiselle.
Diana ne répondit pas tout de suite. Un instant elle regarda fixement les Français.
L’on eût cru que ses yeux se faisaient plus doux. La riposte un peu vive des jeunes gens paraissait lui causer une surprise agréable. Enfin elle ouvrit la bouche.
– Je ne puis déférer à votre désir, d’abord parce que l’embarcation n’est pas parée et ensuite…
Elle eut une légère hésitation, mais elle acheva cependant :
– Je tiens à vous garder à dîner, maintenant.
Et profitant du mutisme de ses hôtes, étonnés de la tournure que prenait l’entretien :
– Comme preuve, je renonce à mes habitudes, je vous demande de vous nommer. Vous, mademoiselle, voulez-vous ?
Sa voix avait une caresse. Yvonne fit un pas vers l’Américaine.
– Yvonne Ribor, mon frère de lait Marcel Dalvan, et son ami Claude Bérard, tous trois voyageant…
Ici un temps d’arrêt. On ne pouvait apprendre la vérité à miss Diana…
– Pour votre plaisir, acheva celle-ci ?
– Oui.
– Ah ! vous êtes riches ! très bien.
La sœur de lait de Marcel frémit. La phrase de son interlocutrice la cingla comme une insulte. La millionnaire supposait que l’on avait refusé ses cent livres, uniquement parce que l’on était muni de la forte somme.
– Pas riches du tout, mademoiselle, fit-elle vivement. Je ne voudrais pas acheter votre considération par un mensonge. Une accusation déshonorante pèse sur moi. Mon frère Marcel a réuni toute sa fortune, cent mille francs, et aujourd’hui, avec son ami M. Claude Bérard, il va risquer sa vie et sa liberté pour confondre mes accusateurs.
Miss Pretty hocha doucement la tête.
– Ah ! murmura-t-elle seulement.
L’entrée d’un laquais mit fin à la conversation. Il venait annoncer que le dîner était servi. L’Américaine s’écria joyeusement :
– Passons à la salle à manger.
Et gracieuse, toute différente de ce qu’elle était tout à l’heure, elle s’avança vers Claude encore renfrogné :
– Voulez-vous m’offrir le bras, monsieur Bérard ?
Le moyen de résister à pareille sirène ? Le « Marsouin » s’exécuta. Une minute après tous étaient assis autour de la table. À voir les cloisons de vieux chêne tendues de cuir frappé, la vaisselle d’argent, les cristaux renvoyant en éclairs les feux des lampes électriques, les hôtes du yacht Fortune se demandaient s’ils étaient éveillés, s’ils se trouvaient bien à bord d’un vaisseau perdu sous le brouillard de la Mersey.
Diana se mit en frais. Très instruite, intelligente, douée d’un esprit original, elle charma ses invités, les amena à se départir de leur réserve.
Au dessert, les vins de première marque aidant, – tous des compatriotes de Bourgogne, Champagne ou Bordelais, avait fait remarquer miss Pretty, – les Français étaient gagnés. Yvonne surtout s’abandonnait à une sympathie qu’elle ne s’expliquait pas pour la jeune citoyenne des États-Unis.
Pressée par elle, elle lui contait son histoire, n’omettant aucun détail malgré les gestes suppliants de Marcel. Il était bien imprudent de se confier ainsi à une inconnue de la veille ; mais Mlle Ribor n’en avait pas conscience. D’ailleurs, l’Américaine prenait à tâche d’appeler sa confiance. Sa raideur s’était évanouie. Elle parlait, s’expliquait : elle disait sa tristesse à la mort de son père, peu tendre cependant, mais son seul parent ; son éblouissement en se voyant, au sortir du pensionnat, une des plus riches héritières du globe. Puis la douleur cuisante qui la frappait lorsqu’elle comprenait son isolement.
Pas d’amis autour d’elle, mais des courtisans, avides de mordre à belles dents à sa fortune, la flattant jusqu’à l’exaspérer. Elle avouait que le monde, composé de fripons et de plats adorateurs de l’argent, lui était devenu insupportable. La misanthropie l’étreignait.
Alors, pour échapper à la meute des affamés, elle avait eu l’idée de vivre sur mer, entourée d’un équipage sûr. Elle allait de port en port, jetant l’ancre où il lui plaisait. Elle avait ainsi trouvé le bonheur relatif. De la société elle prenait le plaisir en écartant les ennuis. Son intendant se rendait dans les gares, sur les promenades, choisissait des gens de visage agréable. Elle les recevait à dîner sans les connaître, les renvoyait de même.
– La première fois, déclarait-elle, les personnes bien élevées sont toujours supportables. J’écrème le meilleur de l’humanité, j’ignore le reste.
– Tant pis pour vous, fit Claude à ce point de ses confidences.
Elle l’interrogea du regard.
– Parce que vous ne connaissez pas tout ce que cette humanité a de bon au fond. Vous avez vu les agents d’affaires, les parasites, et vous avez jugé l’homme sur ces tristes modèles. Il y a de braves gens, miss, et plus qu’on ne le croit. Seulement ceux-là restent chez eux, et pour les rencontrer, il faut prendre la peine de les chercher.
Elle souriait sans trop d’incrédulité.
– Peut-être, poursuivit-il, n’avez-vous pas besoin d’affection.
– Oh si ! si !
– Alors acceptez un conseil. Livrez-vous à la recherche des nobles, des courageux, des droits ; de ceux qui préfèrent l’idée au coffre-fort, l’étoile au louis. Rêveurs, disent les autres. Honneur d’un pays, répondrai-je. Ceux-là, c’est l’officier qui meurt pour le drapeau ; le marin qui s’engloutit avec son navire ; le savant qui use sa vie à résoudre un problème ; l’artiste qui jette son âme sur le papier, sur la toile, dans le marbre ; les modestes qui se privent de tout pour apprendre à leurs enfants le moyen de vivre avec probité.
– Où sont-ils ceux-là ?
– Partout où l’on travaille, non pas à empiler des écus, mais à créer, à inventer, à arracher un secret à l’inconnu.
La conversation devint générale, tantôt gaie, tantôt sérieuse, et vers onze heures, quand les voyageurs rentrèrent dans leurs cabines, ils eurent une impression de vide, de réveil pénible après un songe heureux.
Au jour, ils s’apprêtèrent à partir. Ils devaient quitter le yacht sans revoir sa propriétaire. Sans se l’avouer, ils en éprouvaient un regret. Claude surtout avait peine à cacher son mécontentement, et grommelait sans cesse des aphorismes comme celui-ci :
– Quand on ne veut pas recevoir les remerciements des gens, on ne les dérange pas pour leur faire un tas d’amabilités.
Comme on le voit, les premières minutes d’entrevue étaient oubliées ; les dernières en avaient effacé la trace.
Munis de leur mince bagage, les Français montèrent sur le pont et vinrent se poster près du canot, en attendant le moment du départ. La brume s’était envolée. Il faisait froid ; mais le soleil pâle d’hiver animait le paysage et permettait de distinguer la flottille de navires de commerce, de ferry-boats sillonnant dans tous les sens le grand bassin de Birkenhead. À l’est le cours de la Mersey se dessinait, et sur la rive droite, une forêt de mâts indiquait l’emplacement des divers bassins de Liverpool.
– C’est un superbe port ! fit derrière eux une voix.
C’était William Sagger déjà vêtu de noir, déjà cravaté de blanc. Après une inclination, il reprit :
– Mais, hélas ! combien de misères à côté de cette prospérité ! Croiriez-vous, gentlemen, que sur les cinq cent quatre-vingt mille habitants de la ville, un trentième demeure dans les caves, sans air et sans clarté ? Croiriez-vous que cette cité si riche lésine pour se procurer de bonne eau potable ; que sur dix mille enfants qui naissent, la moitié à peine atteint l’âge de cinq ans ?
Et d’un ton pénétré :
– Aussi la débauche, le crime fleurissent. Chaque année la police opère, à Liverpool, cinquante mille arrestations. Songez un peu, un cinquième de la population totale. En aucun pays du monde on ne rencontre pareille proportionnalité.
Lancé sur ce terrain, le licencié ès sciences géographiques aurait continué longtemps. Par bonheur, un domestique parut sur le pont et vint lui murmurer quelques paroles à l’oreille. William laissa échapper un geste d’étonnement, regarda les voyageurs en roulant des yeux effarés, s’éloigna de quelques pas avec le laquais et, finalement, revint aux passagers.
– Gentlemen, lady, une communication invraisemblable, mais vraie cependant. Miss Diana Pretty vous prie de vous rendre au salon d’arrière où elle vous attend.
– Cela vous étonne ? interrompit Claude dont le visage s’illumina. Il me semble tout naturel d’être admis à présenter nos adieux à votre maîtresse.
– C’est que vous ne savez pas ?
– Quoi donc ?
– Cela ne s’est jamais fait !
– Ne prolongeons pas l’attente de miss Pretty, dit Yvonne. Répondre par quelque empressement à une exception flatteuse est obligatoire.
– C’est juste !
Et les voyageurs se dirigèrent vers l’arrière. L’Américaine était déjà au parloir.
En les apercevant, elle vint à eux les mains tendues :
– Asseyez-vous, je vous prie, j’ai à vous parler.
Ils obéirent.
– Si j’ai bien compris votre récit, miss Yvonne, fit-elle alors, vous partez à la recherche de votre frère qui détient le précieux document…
– Dont la production me réhabilitera. C’est exact.
– Étant donnée votre situation… particulière vis-à-vis de la justice de votre pays, vous devez éviter de naviguer à bord de bateaux français, bien qu’ils aient les services les plus rapides pour le Sénégal. C’est vers cette région, n’est-ce pas, que vous vous dirigez ?
– Oui, puisque c’est là que mon frère a cessé de m’écrire.
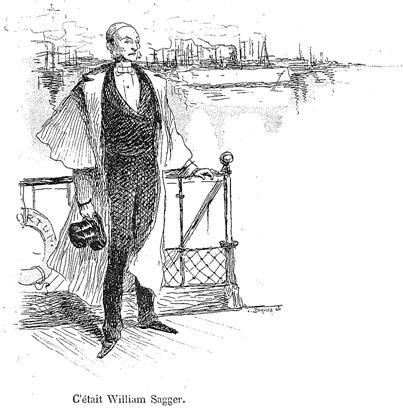
– Vous prendrez donc passage sur un steamer anglais.
– Affrété pour Sierra-Leone ou une colonie voisine.
– Tenez-vous absolument à être couverts par les couleurs de la Grande-Bretagne ?
– Pourquoi cette question ?
– Pour savoir si vous auriez une aversion insurmontable pour un autre pavillon.
– Un autre ?
– Celui de l’Union, par exemple.
D’un même mouvement, les Français se dressèrent. Calme, Diana poursuivit :
– Mon yacht est bon marcheur, et vous arriverez aussi vite.
Puis avec expansion :
– Acceptez, vous me ferez plaisir. C’est un service que je sollicite de vous. Ma cervelle est peuplée d’idées noires ; aidez-moi à les chasser.
Et malicieuse, regardant Claude en face :
– Voilà le fruit de vos conseils d’hier soir, monsieur Bérard. Cherchez les honnêtes gens, m’avez-vous dit. Chercher… c’est dur, je suis si paresseuse ! J’en ai trouvé sans me donner de peine, je préfère m’y tenir.
Elle coupa court aux remerciements des voyageurs :
– Maintenant vous êtes chez vous. S’il manque quelque chose dans vos cabines, il vous suffira d’en avertir William. Ici est le salon commun. Nous quitterons Liverpool après-demain.
Les yeux d’Yvonne étaient humides. Elle fit un pas vers l’Américaine. Celle-ci lui sourit, les jeunes filles s’enlacèrent et échangèrent un affectueux baiser.
– Nous serons amies, affirma miss Pretty.
– Certainement, répliqua Mlle Ribor.

Quand le personnel du bateau sut que le Fortune prenait des passagers, ce fut une surprise générale ; mais on se garda d’en rien faire voir. Seulement tous les domestiques, depuis Sagger jusqu’au cuisinier Jobson, tout l’équipage, depuis le blond capitaine Maulde et le gros lieutenant Follway, jusqu’au mousse Jack, firent assaut de prévenances. Tous s’ingéniaient à charmer les étrangers assez heureux pour avoir changé l’humeur de la millionnaire Diana.
Un mouvement inaccoutumé se produisit à bord. Des provisions, du charbon, des armes, des munitions s’empilèrent dans les soutes. On se préparait au départ.
Le lendemain matin en entrant au parloir, Marcel et Claude poussèrent une exclamation de joie. Tout un assortiment d’armes était rangé sur la table : des winchester à répétition, des rifles à balles explosibles pour la chasse au gros gibier, des revolvers, etc.
Auprès, un paquet de journaux du jour. À côté des feuilles anglaises, de l’américain New-York-Herald, des papiers français le Petit Journal, le Figaro.
– Ah ! murmura Yvonne en prenant le premier. Miss Diana est adorable, elle nous gâte.
– Certes, appuya Marcel, et j’en éprouve quelque confusion.
Claude ne dit rien, mais il eut, à l’adresse de l’absente, une mimique expressive.
Tout en parlant, Mlle Ribor déployait le journal et le parcourait des yeux, heureuse, après deux journées d’Angleterre et de Saxons, de contempler ces colonnes où les mots de la langue maternelle se pressaient en lignes serrées. Soudain elle tomba en arrêt sur un sous-titre.
– Tiens ! s’écria-t-elle.
Au même instant, Marcel qui tenait le Figaro le lui tendit :
– Regarde, petite sœur.
Elle lui désigna le Petit Journal. Dans les deux la même note s’étalait en première page. Elle était ainsi conçue :
Diego-Suarez, 1er décembre 1892.
L’explorateur Antonin Ribor vient d’arriver ici, après un voyage des plus mouvementés à travers le continent noir.
Parti de Saint-Louis (Sénégal), il a visité les tribus touareg du désert ; puis, revenant par le Tchad et le Soudan, il a gagné la région des lacs et la côte de Mozambique.
Aucun des prédécesseurs du courageux voyageur n’a effectué parcours aussi long dans l’intérieur des terres africaines.
Bien que très fatigué par les fièvres, M. Ribor compte, après quelques jours de repos, poursuivre sa route.
On sait, en effet, qu’il visite les colonies françaises, en vue de s’assurer de visu des débouchés que le commerce de la métropole peut trouver dans chacune d’elles.
Yvonne parcourut cette dépêche, puis subitement pâlie, elle la lut d’une voix altérée.
– À Madagascar, termina-t-elle, c’est là qu’il faut aller. Mon frère, mon pauvre frère !
La secousse était violente. La jeune fille pleurait, lorsque Diana survint.
– Tant mieux, s’écria-t-elle après explication. Le Sénégal c’était trop près, Madagascar me va, je vous posséderai plus longtemps.
Le 4, de grand matin, le Fortune, actionné par son hélice, quitta le bassin de Birkenhead et gagna la Mersey.
Lentement, pour éviter les collisions avec les nombreux vapeurs qui incessamment évoluent d’une rive à l’autre, il descendit le cours du fleuve, rasa le Floatingpier, colossal quai flottant construit en 1857, brûlé en 1874 et réédifié depuis.
Un instant les passagers purent embrasser sa surface, qui n’a pas moins d’un hectare et demi et qui perpétuellement est encombrée de caisses, de balles de coton, de café, de colis expédiés de tous les points du globe.
Ils admirèrent les sept ponts qui relient au rivage ce quai sans rival, puis ils le laissèrent en arrière, saluèrent en passant la ligne interminable des docks, les chantiers de construction, puis le faubourg de Bootle.
Enfin le Fortune doubla la pointe de New-Brigthon que couronne un phare et s’élança à toute vapeur dans la mer d’Irlande.
Presque à la même heure, le paquebot Tropagine, de la Compagnie havraise péninsulaire, fendait les flots de la Méditerranée à la hauteur de la Sardaigne.
Sur le pont un voyageur se promenait songeur.
C’était Canetègne.
– Pourvu, mâchonnait-il entre ses dents, que la note que j’ai remise au Petit Journal et au Figaro leur ait passé sous les yeux ! Ah ! c’est probable. La petite lit son journal chaque jour, et ceux-là se trouvent facilement en Angleterre. S’ils l’ont lue, ils viendront à Madagascar, et là…
Le négociant fit claquer ses doigts d’une façon menaçante.
– Je voudrais être arrivé !
Pour des raisons différentes, les passagers du Fortune exprimaient la même pensée, et Diana, qui les écoutait d’un air attendri, murmura si bas qu’ils ne l’entendirent point :
– Mon Dieu ! mon Dieu ! comme je m’ennuierai, après !

VII
OBOK

– William Sagger, mon intendant… Mais c’est un gentleman, M. Bérard.
– Alors, si je comprends qu’il soit licencié,… un autre problème se pose.
– Lequel ?
– Pourquoi gentleman et intendant ?
– Vous êtes curieux de le savoir ?
– Je l’avoue.
– Écoutez donc.
Ces répliques échangées, miss Diana sourit à ses auditeurs assis autour d’elle sur le pont du Fortune.
Le yacht avait contourné les côtes de France et d’Espagne, franchi le détroit de Gibraltar et filait, au sud de la Sicile, sur les flots bleus de la Méditerranée. Aucune aventure n’avait troublé le voyage. Claude et Simplet avaient seulement décidé qu’ils se tutoieraient désormais, et ils se donnaient du « tu » à qui mieux mieux.
À quelques pas du groupe, le factotum de l’Américaine, penché sur le bastingage, semblait absorbé par la contemplation des remous de l’hélice.
– Monsieur William Sagger ! appela doucement Diana.
Il se retourna aussitôt.
– Vous désirez, miss ?
– Approchez, je vous prie.
Et quand il eut obéi.
– Mes passagers, reprit-elle, ne sont pas des indifférents. J’ai été amenée à leur dévoiler votre qualité de gentleman. Ils me pressent de questions, trouvez-vous bon que je leur dise tout ?
– Si vous le jugez à propos, miss.
– Asseyez-vous donc.
Puis s’adressant aux Français, Diana commença ainsi :
– Vous saurez donc que sir William – pour un instant, je lui rends l’appellation qui lui convient – que sir William, dis-je, est un homme qui n’a pas de chance.
– Comme moi, murmura Yvonne.
– Comme moi, répéta Claude.
– Moi, fit à son tour Marcel, j’en ai et c’est…
Mlle Ribor l’interrompit.
– Tout simple. Nous connaissons le refrain. Je vous en prie, miss, continuez.
– Géographe des plus distingués, membre de la plupart des sociétés savantes d’Amérique, il avait épousé une femme charmante qu’il adorait. Une scierie à vapeur lui rapportait, bon an, mal an, quinze mille dollars. Il possédait deux enfants. Il était heureux.
Sagger détournait la tête, ses joues tremblotaient.
– Une nuit le feu consuma l’usine et, sous les décombres noircis, on chercha longtemps trois cadavres : mistress Sagger et ses babies surpris pendant leur sommeil…
– Permettez que je m’éloigne, demanda William. C’est trop pénible.
Il était pâle. Sur un signe de miss Pretty, il se leva, et à grandes enjambées, gagna l’avant du navire.
– Pauvre homme ! dit Yvonne d’une voix émue.
– Attendez. Le notaire, chargé de ses intérêts, avait négligé d’acquitter la prime d’assurance de la scierie. Sir Sagger se trouva donc isolé, ruiné et sans courage pour les luttes à venir. Il réfléchit et, seul en face de lui-même, résolut de mourir. Ainsi il fuirait sûrement la misère, et il rejoindrait peut-être les chers disparus.
Tous les yeux étaient humides.
– Alors, poursuivit l’Américaine avec un accent tremblé, un duel étrange s’engagea entre lui, pressé d’en finir, et la mort qui ne voulait pas de lui. Il essaya de tout. En vain ! Le pistolet rata ; la carabine éclata sans lui faire aucun mal ; la corde se rompit ; le poignard rencontra une côte et se brisa. Il s’était fusillé, pendu, poignardé pour arriver à se faire une égratignure ! La camarde résistait ; mais sir William est entêté. Sans armes il s’enfonça dans le Far-West, parcourut les territoires des Indiens insoumis. Surpris de son audace, ceux-ci le déclarèrent grand sorcier. Le poteau du supplice, le scalp se métamorphosèrent en présents. Un jour il aperçoit une bande de bisons migrateurs. Ces animaux renversent tout sur leur passage. – Enfin, pense le désespéré, voici le trépas ! Résolument il se campe en face de la colonne beuglante dont le galop ébranle la terre. Malédiction ! les bisons s’arrêtent à dix pas de lui et s’agenouillent. Ce n’était pas pour l’adorer, je me hâte de vous le dire ; mais pour lécher plus commodément des plaques de sel gemme qui affleuraient le sol ; ils en sont friands. Furieux, notre ami continue sa route. Les pieds et les mains solidement attachés, il se laisse tomber dans le Missouri. Il va se noyer. Erreur ! Une bande de pécaris, poursuivie par un jaguar, cherche un refuge dans les eaux et entraîne avec elle sur l’autre rive l’amant malheureux du suicide.
– Une déveine carabinée ! fit Marcel en riant.
– Lassé, découragé, conclut Diana, il se fit présenter à moi par une agence. Je recrutais le personnel de mon yacht ; je l’engageai, sans me douter qu’il espérait mourir par mes soins.
– Par vos soins ?
– Mon Dieu oui. On me disait folle. – Une jeune fille très riche qui fuit le monde, vous comprenez ? – Sir William avait pensé qu’un bateau conduit par une lunatique ne naviguerait pas longtemps. Il m’a tout avoué plus tard, lorsque les brises saines de la mer eurent ramené le calme dans son esprit.
Et avec une grâce charmante, miss Pretty s’inclina devant son auditoire muet :
– Maintenant, vous savez pourquoi sir William est intendant.
Le steamer se trouvait alors par le travers de l’île de Malte.
Le 13 décembre, le phare d’Alexandrie fut signalé ; le lendemain, le Fortune traversait la rade de Port Saïd à l’entrée du canal de Suez et, bientôt halé par un remorqueur, il glissait mollement sur les eaux du chenal. Il passa à Suez et s’engagea sur les flots de la mer Rouge.
Le cinquième jour, au matin, le pavillon français de l’île Doumeïrah apparut. Le navire entrait dans les eaux du territoire d’Obok.
– Obok et non Obock, remarqua Sagger, bien que l’on ait l’habitude d’écrire incorrectement ce nom suivant la dernière orthographe.
En face, à l’extrême pointe de la péninsule Arabique, les voyageurs aperçurent le petit territoire de Cheik-Saïd, acheté mais non encore occupé par la France. Rangeant les îles Dzesirah-Soba, le steam longea les bancs du Curieux et du Surcouf qui ferment le port d’Obok, et reçut à son bord le pilote-major qui le guida à travers la passe du Sud.
Bientôt il s’arrêtait sur une ancre, en face du plateau des Gazelles, dominé par les habitations des fonctionnaires de la colonie, et près du dépôt de charbon de la pointe Obok. Ce voisinage était utile, car le steamer avait besoin de refaire du combustible.
L’escale en ce point n’avait pas d’autre but.
– Ma foi, dit Marcel, puisque nous sommes immobilisés pour vingt-quatre heures, visitons le pays. À nous, exilés de France, il sera doux de fouler une terre française. Et puis, ajouta-t-il après réflexion, depuis notre départ de Liverpool, il a pu arriver des nouvelles de Madagascar.
Aussi, au point du jour, les voyageurs, accompagnés par miss Diana et William Sagger, prirent-ils place dans le canot du Fortune, qui les conduisit à la côte, en face du village indigène établi entre la résidence du gouverneur et la mer.
D’un même mouvement tous regardèrent du côté du large. Un superbe spectacle s’offrait à eux. Fuyant vers l’est, les falaises du Ras-Bir venaient mourir au pied du plateau des Sources, qui borde au nord la rade d’Obok et supporte la factorerie Mesnier et la Tour Soleillet. À l’ouest, dans la dépression qui sépare les collines des Sources et des Gazelles, la vallée des Jardins, luxuriante oasis arrosée par la rivière d’Obok et limitée par une rangée de palétuviers penchés sur la mer.
Les voyageurs montèrent lentement la rampe du plateau des Gazelles. Bientôt ils atteignirent les premières maisons du quartier arabe, et pénétrèrent dans l’unique rue dont il est composé. De chaque côté s’alignaient les maisons en pierres ou en terre glaise, revêtues d’une couche de chaux.
La ville rapidement parcourue, les promeneurs se rapprochèrent des établissements du gouvernement, élevés au sud du plateau. Ils visitèrent l’hôpital, les casernes, les magasins, les mess des officiers et des fonctionnaires ; baraques provisoires à charpentes de fer appuyées sur des piliers de maçonnerie.
Ils achevaient cette rapide promenade quand un personnage, qui débouchait de l’avenue de l’Hôpital, s’avança vers les voyageurs. Un pantalon de toile, un veston de surah ouvert sur une chemise large serrée aux flancs par une ceinture de flanelle, indiquaient sa qualité de blanc ; la façon dont il salua de son casque colonial trahit celle de civilisé.
– Mesdames, messieurs, dit-il, j’ai été averti, un peu tard, que des touristes visitaient nos établissements. N’importe, j’ai tenu à me mettre à votre disposition. Je suis le gouverneur.
Et comme tous ébauchaient un remerciement, il les arrêta :
– Si vous saviez combien cela m’est agréable. Ils sont rares ceux qui s’aventurent sur notre plage, et je leur suis obligé de leur visite.
Puis, changeant de ton :
– À la guerre comme à la guerre. Présentons-nous, et permettez-moi de vous offrir à dîner à la Résidence, sans façon. Je le répète, vous m’enchanterez. Votre nationalité m’est déjà connue ; le pavillon américain flotte à la corne de votre steamer.
Claude ouvrit la bouche pour répondre ; Marcel le prévint et avec un flegme très saxon :
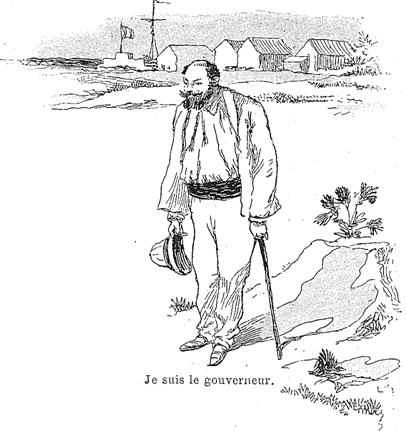
– Yes, sir, fit-il.
Après quoi, il présenta ainsi ses compagnons :
– Miss Diana Pretty. – Le gouverneur s’inclina, il avait sûrement ouï parler de la riche Américaine. – Miss Mable, sa sœur.
Yvonne, désignée ainsi, ouvrit des yeux effarés. Simplet poursuivit :
– Sir William Sagger, notre ami ; sir Claudio, et moi sir James, cousins de miss Diana.
Le fonctionnaire répétait ses saluts. Enfin offrant le bras à Diana, il la guida vers son habitation.
Yvonne retint son frère de lait en arrière.
– Pourquoi toutes ces inventions ?
– Parce que, petite sœur, dans notre situation alors même qu’aucun danger n’apparaît, il convient d’être prudent. C’est tout…
– Simple, acheva la jeune fille avec un peu d’impatience. Mais permets-moi de te le dire. En ce moment ta simplicité m’a l’air d’une complication.
– C’est possible. Souviens-toi seulement que tu es Mable ; Claude, Claudio ; et moi, James.
Le gouverneur était marié. Sa femme, gracieuse mais loquace personne, se surpassa. Elle était enchantée de pouvoir débiter comme nouvelles de vieilles histoires usées dans le cercle habituel de la colonie.
Elle mit les « petits plats dans les grands ». L’outarde et la gazelle figurèrent sur la table, assaisonnées de récits incroyables, où la faune du pays jouait un rôle un peu exagéré sans doute. Rencontres avec les guépards, tigres minuscules ; chasses à l’âne sauvage, à l’autruche, au chacal, à l’hyène ; tout y passa.
La flore même eut son tour. Madame la gouverneur la décrivit, ne faisant grâce d’aucun détail. Elle vanta le mimosa dont le feuillage court, sous le nom de kabata, nourrit les troupeaux ; les palétuviers, les genêts, les euphorbes. Et pour finir en artiste qui ménage ses effets, elle laissa tomber cette phrase :
– Ah ! mes chers hôtes, que je suis heureuse de vous savoir Américains ! Dire que si vous étiez Français, je ne pourrais vous recevoir sans arrière-pensée.
Marcel lança un regard à Yvonne.
– Et pourquoi donc ? demanda-t-il tranquillement.
– Je vais vous l’apprendre. Mon mari me fait les gros yeux, mais cela m’est égal. Voilà-t-il pas un mystère ! Figurez-vous que le parquet de Lyon nous a envoyé, en même temps qu’aux fonctionnaires de toutes les colonies françaises, l’ordre d’arrêter trois Français : deux hommes et une femme, accusés de vol, d’évasion.
– Mais, ma chère amie, interrompit le gouverneur, cela n’a aucun intérêt.
– Aucun intérêt. Est-ce la fonction d’un résident d’arrêter les voleurs ? Mes chers hôtes, je vous fais juges.
Tous demeuraient immobiles, pétrifiés par la révélation de l’aimable femme. Canetègne, qu’ils avaient cru vaincu, les pourchassait au delà des océans, ayant la justice française pour servante !
– Et comment se nomment ces misérables ? questionna Simplet.
Sa voix était calme.
– Je ne me souviens plus. Ah si ! Yvonne Ribor, Marcel Dalvan et Claude Bérard.
– Pauvres diables ! je vous remercie, madame.
Le repas terminé, on se sépara avec de grandes effusions. Le gouverneur accompagna ses hôtes jusqu’à leur canot. L’embarcation quitta le rivage se dirigeant vers le Fortune, dont la silhouette élégante se découpait dans la pénombre bleutée de la nuit. Alors Marcel murmura :
– Nous sommes gentils maintenant ! La police nous guette sur toutes les terres françaises, et précisément nous n’avons à faire que là ?
– La main de la justice est sur nous, gémit Yvonne. Le sous-officier l’empêcha de continuer sur ce ton.
– Tu sais ce que l’on fait pour éviter une main menaçante ?
– Non !
– C’est bien simple. On glisse entre ses doigts.
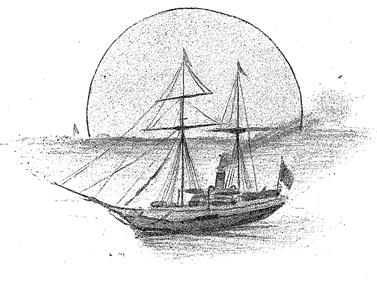
VIII
CANETÈGNE S’OCCUPE
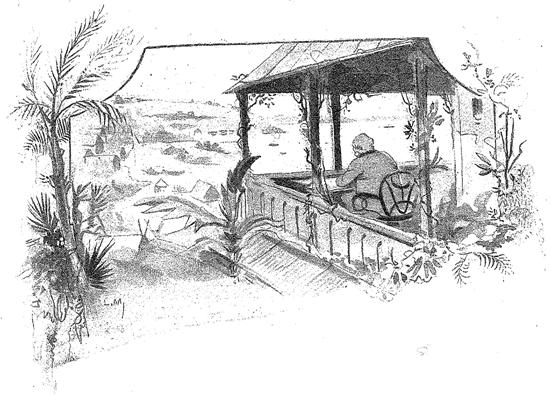
Sous une véranda de bois, dont les piliers légers étaient emprisonnés dans un fouillis de vanilles, d’ibokas, de haricots odorants, M. Canetègne écrivait.
Sur la table de bambou, plusieurs feuillets de papier couverts d’une écriture commerciale, régulière et froide, attestaient le labeur du négociant. Enfin sa plume cessa de courir. Il prit son mouchoir, s’épongea le front et, se renversant dans son fauteuil de rotin, il promena les yeux autour de lui.
Certes, le panorama était fait pour séduire. S’étageant en gradins, les toitures des maisons d’Antsirane semblaient un escalier géant descendant jusqu’à la mer.
Plus bas s’étendait le golfe de Diego Suarez, ce port merveilleux creusé par la nature au nord de l’île de Madagascar.
Du vaste lac bleu, profond, émergeaient des îles verdoyantes, allant rejoindre avec des serpentements de farandole l’îlot de la Lune, – Nossi-Volane, – sentinelle avancée qui garde le chenal du port. De larges estuaires s’ouvraient à droite, à gauche, baies creusées dans le pourtour du golfe où pourraient s’abriter les marines du monde : Dourouch-Foutchi, Dourouch-Varats, Dourouch-Vasah, baies des Cailloux, du Tonnerre, des Français. Plus loin, le bassin de la Nièvre et enfin le cap de Diego que dominent l’artillerie, l’hôpital, le casernement des disciplinaires, la gendarmerie de la colonie.
En se tournant vers la droite, M. Canetègne apercevait la hauteur de Madgindgarine, couronnée d’un fortin, et les baraquements primitifs où campent les volontaires sakalaves, nos alliés malgaches.
De temps à autre, un coup de sifflet aigu déchirait l’air. Il annonçait le départ d’un convoi. Car Antsirane possède un chemin de fer, à voie étroite et à traction de mules, il est vrai, mais qui compte douze kilomètres et met la ville en communication avec Mahatsinso.
L’Avignonnais hocha la tête, s’essuya le front derechef, puis rassembla les feuilles éparses sur la table et les classa. Après quoi, il se mit à lire à haute voix, de l’air satisfait d’un bon élève dont le devoir est primé.
Antsirane, ce 29 décembre 1892.
Ma chère demoiselle Doctrovée,
J’espère que cette nouvelle lettre vous trouvera en bonne santé. Pour moi, je ne suis pas encore revenu de mon étonnement.
Comme je vous l’écrivais à l’escale d’Obok, c’est à ne pas croire combien les pays que je vois sont différents du nôtre. À ne pas croire, je vous dis. Moi, qui fais la commission coloniale, je ne me doutais pas de ce que sont nos colonies.
Si on le savait en France, je vous donne mon billet qu’un tas de gens, qui traînent la misère, s’expatrieraient et viendraient chercher la fortune où elle est, c’est-à-dire ici.
Mais procédons avec ordre.
Après notre départ d’Obok, quelques jours de pleine mer ; puis les escales successives des Comores, chapelet d’îles qui réunit Madagascar à la côte d’Afrique.
La grande Comore avec son énorme volcan actif Caratala ou Djoungou-dja-Dsaha (marmite de feu).
J’ai l’air très fort en géographie. Ne vous en étonnez pas, c’est le capitaine qui m’a enseigné tout cela.
Nous avons reçu la visite d’une princesse du pays, noire mais superbe. Vêtue de nattes multicolores, la tête couverte d’une sorte de capuchon percé à hauteur des yeux d’un trou carré, elle est venue à bord, sur son boutre.
Qu’est-ce qu’un boutre, direz-vous ? C’est un bateau à la poupe très élevée, en usage dans toute la région.
La princesse voulait surveiller l’embarquement d’une équipe de femmes maçons. Vous avez bien lu, les limousins du pays appartiennent exclusivement au sexe joli.
Il faisait chaud sur le pont. Aussi bientôt cette grande dame se dépouilla de ses nattes. Elle portait, tatoué sur le dos, un soleil rayonnant.
Cet enjolivement, m’a appris l’interprète, indique que la personne est de souche royale et descend d’une certaine Douhani, de la race des Bé-Tsi-Mitsaraks, qui eut, d’après la légende, l’insigne honneur d’être distinguée par le dieu-Soleil Zanahar, lequel s’établit sur la terre pour l’épouser. Mais après quelques jours de ménage, Zanahar dut retourner au ciel, parce qu’il incendiait tout autour de lui. C’est de cette époque que datent les déserts.
Nous avons pris dans l’île un passager qui se rend à Sainte-Marie. Djazil est son nom. Retenez-le, car notre rencontre est des plus heureuses. Je vous dirai le pourquoi dans une prochaine lettre.
Puis nous avons gagné Anjouan où furent déportés, en 1801, Rossignol et ses complices dans le complot de la machine infernale. Aperçu de loin, l’île Moheli ; fait une promenade dans l’île Mayotte, une autre à Nossi-bé.
Pays merveilleux, verdoyants, bien arrosés, où réussissent à souhait le café, la canne à sucre.
Nous avons doublé le cap d’Ambre ou d’Amb à l’extrême nord de Madagascar, et tandis que nous voguions vers Diego Suarez, le capitaine nous parla cyclones. C’est très rassurant. Ainsi le 24 février 1885, au moment où la France s’établissait à Antsirane, un ouragan détruisit ou jeta à la côte le transport l’Oise, le vapeur Arya et le voilier la Clémence de la flotte de la Réunion, le navire américain Sara-Burk et l’Armide de l’île Maurice. Plus récemment le naufrage du Labourdonnais est dû à la même cause.
Enfin je foule le sol malgache, et de suite les habitants me deviennent sympathiques. Ils sont « processifs » comme nos paysans normands.
Quand ils s’abordent, au lieu de se dire :
– Comment vous portez-vous ?
– Pas mal et vous ?
Ils se saluent cérémonieusement et prononcent :
– Akouré kabar ?
– Tsichi kabar.
Ce qui peut se traduire par :
– Avez-vous des procès ?
– Je n’ai pas de procès.
Une nation animée de cet esprit est appelée à un brillant avenir. J’espère l’aider à l’atteindre. On m’a entretenu d’une affaire de premier ordre. Je vous en parlerai longuement plus tard. J’attends en ce moment le personnage avec lequel je dois opérer.
Travaillez bien ; car nos ennemis pris, je compte séjourner quelque temps à Diego Suarez avant de rentrer en France, et la maison ne saurait péricliter.
Avec mes sentiments très distingués, recevez, ma chère demoiselle Doctrovée, mes meilleurs souhaits de santé.
Signé : Canetègne.
P. S. – Pourvu qu’ils aient lu les journaux, et que bientôt je sois délivré du cauchemar qui me hante.
Sa lecture terminée, le négociant demeura pensif.
– Oui murmura-t-il, l’idée de faire annoncer l’arrivée de Valentin Ribor à Madagascar était bonne. Maintenant le numéro est-il tombé entre leurs mains ? Tout est là. Si oui, ils arriveront sûrement par le prochain paquebot. Si non…
Il donna un coup de poing sur la table.
– Si non, mes transes redoublent, car, il n’y a pas à se le dissimuler, il suffit d’un rien pour me perdre.
Canetègne s’était levé. À grands pas il arpentait la veranda.
– Mousié, fit une voix, le vertueux Ikaraïnilo demande s’il peut parler avec toi ?
Un Cafre, reconnaissable à sa toison laineuse, à ses lèvres épaisses, à son nez écrasé, venait de paraître.
C’était le domestique du négociant. Domestique sans livrée ; un simple pagne, fixé par une ficelle à la ceinture, le couvrait des reins aux genoux.
– Ikaraïnilo, répéta Canetègne dont le visage s’éclaira. Amène-le ici. Apporte aussi du vin de palmier.
Le cafre sortit et reparut au bout d’un instant, chargé d’un plateau sur lequel vacillaient des verres et un carafon empli d’une liqueur rosée du plus alléchant aspect. Un homme d’une cinquantaine d’années le suivait. Malais de type, les cheveux grisonnants, le nouveau venu était sec, nerveux ; ses yeux vifs, perçants, étaient toujours en mouvement. Aussi le regard insaisissable ne se prêtait jamais à l’observation.
Tout décelait en lui l’astuce, la fourberie. Il toucha la main de Canetègne et s’assit, entr’ouvrant sa veste soutachée. Il allongea béatement ses jambes, autour desquelles flottait une sorte de pantalon large, fait d’une lamba, – jupe – serrée aux chevilles.
L’Avignonnais avait pris place en face de lui. Tous deux demeurèrent un instant sans parler, chacun attendant l’autre. Le premier, le négociant rompit le silence.
– Ikaraïnilo a à me parler ?
– Le Hova Ikaraïnilo a à te parler, répliqua le visiteur.
Une nouvelle pause eut lieu. Agacé, Canetègne commença.
– Sur le bateau qui m’a amené ici, dit-il, j’ai rencontré ton associé Djazil.
– Il l’était, en effet.
– Obligé de partir pour se fixer à l’île Sainte-Marie, il m’a vanté les opérations qu’il faisait avec toi.
– C’est bien là ce qu’il m’a affirmé.
– Il m’a promis de nous mettre en rapport. Il a tenu parole. Maintenant jouons cartes sur table.

Ikaraïnilo avança un peu son siège.
– Va, j’écoute.
L’Avignonnais eut un vague sourire :
– Tu es puissant parmi les Hovas, reprit-il. Tu crains de risquer ta situation car, général commandant les troupes qui cernent la léproserie d’Antananarivo, capitale des pays Hovas, et empêchent les lépreux d’en sortir, tu gagnes sûrement de vingt à vingt-cinq mille thalaris.
Le Malgache ne bougea pas.
– D’autre part, comme la loi des tiens admet que toute la terre appartient à la reine, et que nul autre n’a le droit de posséder, tu n’es pas fâché d’avoir des ressources ignorées pour acheter du terrain dans la grande Comore. Tu rêves de résilier un jour tes grades, – tes honneurs, comme vous appelez cela, – pour devenir propriétaire et indépendant.
Un imperceptible signe de tête encouragea l’orateur à continuer. Le commerçant ne se fit pas prier.
– Or, avec Djazil, tu as eu l’idée ingénieuse d’exploiter une superstition de tes compatriotes. Ils se figurent qu’un mort a de grosses dépenses à faire dans l’autre monde. Ils enterrent donc leurs défunts avec une forte somme. Souvent ils n’ont pas l’argent nécessaire, et ils l’empruntent à gros intérêts. Tu fais le prêt aux héritiers.
– Tu es au courant, murmura le Hova.
– Né malin, tu as perfectionné la profession. Prêter, toucher des intérêts exorbitants, c’est bien. Tu vas plus loin. Les sépultures sont au milieu des forêts, nul ne les surveille. Alors que fais-tu’? Au milieu de la nuit qui suit l’inhumation, tu déterres le mort ; tu l’allèges de la somme dont ses parents l’ont, avec piété et bêtise, inutilement chargé ; si bien que tu supprimes tous les risques de l’opération.
– Tais-toi, si on entendait.
– On n’entend pas. Tandis que tu paradais à Antananarivo, Djazil accomplissait la besogne utile que je viens de dire. Lui parti, tu désires un autre associé. L’affaire me convient, j’accepte.
Un instant le regard d’Ikaraïnilo se fixa sur l’Européen.
– Tu acceptes ?
– Oui, aux mêmes conditions. Partage par moitié des bénéfices. Grâce à ta situation, tu fournis les meilleurs clients, tu me protèges au besoin.
– Oseras-tu commettre le sacrilège ?
– Tiens ! Bon pour les esprits faibles d’hésiter. Les morts n’ont besoin de rien, et les vivants doivent lutter pour la vie.
– Alors tu veux remplacer Djazil ?
– Oui.
Le Malgache sembla réfléchir. On eut dit qu’il hésitait encore. Pourtant il se décida :
– Écoute.
– Je ne demande pas mieux, cela me reposera de parler.
– Notre association commence dès ce moment.
– Adjugé !
– Mais je veux te voir à l’œuvre.
– Le plus tôt sera le mieux.
– J’ai un prêt à deux jours de marche, à Port-Louquez, sur les bords de la rivière Andrezijama. Veux-tu partir avec moi ce soir ?
– Je serai revenu pour l’arrivée du prochain paquebot ?
– Sûrement.
– Car tu le sais, je dois livrer au gouverneur des criminels venant de France.
– Je le sais.
– Partons donc. Puis ma tâche remplie ici, je te rejoindrai à Antananarivo.
Le général de la léproserie se leva.
– À ce soir.
– À ce soir.
– Nous voyagerons par mer en suivant la côte. Mon boutre attendra à la pointe Diego.
De nouveau les dignes associés se serrèrent la main, et Canetègne, se frottant les paumes, reconduisit jusqu’à la porte extérieure le seigneur Ikaraïnilo.
Comme l’Avignonnais l’avait écrit à Mlle Doctrovée, sa rencontre avec Djazil était heureuse. L’ex-associé du Hova, après avoir visité ses propriétés des Comores, s’était embarqué sur le même steamer que le négociant ; car la course du navire se terminait à Sainte-Marie de Madagascar, où il se rendait pour ses propres affaires.
Le loup sent le loup, le vautour appelle le vautour. Avant même de s’être adressé la parole, Canetègne et Djazil s’étaient reconnus. Ils différaient de couleur, de coutumes, de langage ; mais ils étaient confrères en affaires louches. L’intimité s’établit vite, et la conversation qui précède en a fait concevoir les bienfaisants résultats.
À la nuit, l’Avignonnais quitta sa demeure, traversa les rues endormies d’Antsirane et, longeant le bord de la mer, contourna le cap Diego. À la pointe du promontoire une pirogue l’attendait. Elle le conduisit à bord du boutre du général Ikaraïnilo.
Le navire, tanguant lourdement sous sa voilure, se mit en marche. On fit une station assez longue, le lendemain, dans la rade d’Ambavarano ; et le second jour, vers deux heures, le boutre jeta l’ancre à Port-Louquez. Ikaraïnilo chargea l’Avignonnais d’un sac de toile contenant une pioche et une bêche démontées. C’étaient les armes du fossoyeur.
Sur le rivage, une vingtaine de volontaires sakalaves, garnison de la ville, commandés par un sous-officier d’infanterie de marine, se tenaient sur deux rangs, l’arme au pied.
– Que font-ils ? demanda Canetègne en prenant place dans la pirogue avec le général.
– Ils s’apprêtent à me rendre les honneurs.
– À vous ?
– Sans doute. La flamme blanche à cercle bleu qui flotte au mât du boutre indique ma qualité ; il est d’usage que vos soldats nous reçoivent comme leurs officiers, et alors…
– Je comprends.
En effet, quand les voyageurs débarquèrent, les sakalaves présentèrent les armes, tandis qu’un mauvais clairon sonnait aux champs. Puis le sous-officier s’avança vers Ikaraïnilo, et lui demanda s’il désirait être escorté pendant son séjour à terre.
À la grande surprise du négociant, le général répondit affirmativement. Aussitôt dix soldats se détachèrent et le suivirent, tandis que l’autre moitié de la garnison regagnait les baraquements, pompeusement décorés du nom de casernes.
– Pourquoi t’être embarrassé de ces hommes ? grommela l’Avignonnais.
– Pour n’être pas détroussé par des rôdeurs. Les populations sont très hostiles aux Hovas qui les ont vaincues.
– Oui, mais pour notre affaire ?
– Eh bien ?
– Les Sakalaves nous gêneront.
– Du tout, ils nous aideront.
– Eux ? Tu veux leur confier… ?
– Rien du tout. Seulement, écoute. L’endroit où l’on a enterré notre client est à deux heures de marche de la côte. C’est un bois de ravenalas et de fougères arborescentes. L’escorte montera la garde autour ; comme cela nous ne serons pas dérangés.
– Mais que leur diras-tu ?
– Que je vais saluer la tombe d’un frère.
Canetègne fit la grimace. Au fond, il aurait préféré moins nombreuse compagnie, mais il était trop tard pour discuter. Il se résigna.
Comme son associé, il se rendit chez les parents du mort, leurs débiteurs ! Ceux-ci parurent reconnaissants de la visite, et selon l’usage du pays, convièrent les voyageurs à venir insulter la veuve du défunt.
Dans une case isolée la malheureuse était enfermée, revêtue de ses plus beaux atours. L’akantzou de soie brodée, sorte de veston court, le lamba de même étoffe, les gorgerins, les bracelets contrastaient avec sa tignasse ébouriffée, ses joues tachées de meurtrissures. Elle frissonna en entendant les visiteurs.

Il y avait de quoi. Chacun à son tour lui administra un soufflet. Pour ne pas se faire remarquer, Canetègne frappa aussi fort que les autres ; puis la bande se retira en insultant la pauvre créature.
– C’est ainsi que l’on traite les veuves à Madagascar ? interrogea l’Avignonnais.
– Sans doute.
– C’est pour leur faire regretter leur mari ?
– Non, pour marquer que la femme est l’être pernicieux qui abrège les jours de l’homme. Ainsi elle porte le deuil pendant des semaines, des mois, parfois des années. Après quoi les parents prononcent le divorce, afin qu’elle n’ait plus rien de commun avec le trépassé.
Le négociant murmura :
– À leur place je ne me marierais pas.
– Personne ne les y contraint, répliqua Ikaraïnilo. Jusqu’au jour où il lui plaît de se choisir un maître, la jeune fille malgache est aussi libre que les jeunes hommes. Si elle se marie, c’est que la liberté lui pèse, voilà tout.
Avec de grandes démonstrations les visiteurs prirent congé de la famille en larmes, et reprirent ostensiblement le chemin de Port-Louquez. Mais lorsque le village eut disparu à leurs yeux, le Hova donna un ordre, et la petite troupe, obliquant à droite, suivit une sente difficile qui serpentait au flanc d’un massif rocheux.
Des lianes aux fleurs rouges, dont la corolle mesurait au moins vingt centimètres de diamètre, poussaient dans les interstices et se déroulaient sur les parois de granit. Canetègne allongea la main pour cueillir un de ces superbes calices rubescents, mais un Sakalave lui saisit le poignet et le repoussa en arrière avec ce mot :
– Freadilavar !
Étonné, le négociant l’interrogea du regard.
– La plante-tonnerre, expliqua Ikaraïnilo. Quand on la touche, on ressent une commotion électrique quelquefois assez forte pour déterminer la mort.
– Bigre ! fit le commissionnaire en s’écartant prudemment des lianes.
– Dans la saison sèche, continua le général, la freadilavar jaunit, s’étiole. On peut alors en faire la récolte. Elle sert à combattre la fièvre sous forme d’infusion.
– Une infusion de tonnerre ! Merci, je préfère la bourrache.
À l’horizon le soleil était près de disparaître.
Le crépuscule n’existant pas dans les contrées intertropicales, la nuit allait venir dans quelques minutes.
– On n’y verra plus, et on risquera de frôler une de vos satanées plantes, grommela le négociant.
– Nous sommes arrivés, répondit le Hova.
Le sentier débouchait sur un plateau boisé. Des fougères lançaient à sept ou huit mètres de haut leurs panaches verts découpés en dentelle ; des ravenalas aux larges feuilles, dont les naturels tirent leurs toitures et leur vaisselle, s’étalaient en parasols sombres supportés par des troncs trapus. Sur le sol une herbe courte, épaisse, raide, s’écrasait sous les pieds avec un claquement sec.
– Destre malo ! ordonna le général.
L’escorte fit halte. Puis après un colloque rapide avec Ikaraïnilo, l’un des Malgaches prit le commandement, et les soldats, se déployant en tirailleurs, disparurent dans le fourré.
– Maintenant, fit le Hova, à l’ouvrage, mousié Canetègne.
Et désignant un arbre voisin :
– Notre client dort sous son ombre.
Le négociant ne put se défendre d’un frisson. Il allait débuter dans la carrière de violateur de sépultures. Si peu chargé de scrupules qu’il fût, il se sentit mal à l’aise. Mais le général le regardait. Il fallait faire bonne contenance. Et puis l’appât du gain facile l’encourageait.
– Allons, dit-il.
Il se débarrassa du sac de toile qu’il portait en bandoulière depuis son départ du boutre, et en tira la bêche démontée. Il ajusta manche et fer, puis marcha vers l’arbre indiqué. Comme pour faciliter sa tâche, la lune remplaçait le soleil éteint, et glissait à travers les branches des rayons argentés.
Légèrement oppressé, Canetègne commença à creuser la terre. Bien qu’elle eût été fraîchement remuée, elle lui semblait lourde à retourner. Ses bras engourdis par l’appréhension ne donnaient pas l’effort dont ils étaient capables. Le Hova regardait impassible, les traits contractés par un ironique sourire.
Ce fut un coup de fouet pour son associé. Brusquement il retrouva le calme ; l’anxiété dont il était étreint s’évanouit, et il attaqua sa besogne avec une sorte de rage.
En peu d’instants un trou profond d’un pied, long de deux mètres se creusa devant lui. Un choc sonore le fit tressaillir. La bêche avait heurté le cercueil. Bientôt celui-ci fut dégagé.
– Assez, commanda Ikaraïnilo. Décloue le couvercle.
Sans hésitation maintenant, le commissionnaire glissa son couteau entre les planches. Une pesée les écarta. Par l’ouverture il introduisit la bêche, et grâce à ce levier improvisé la partie supérieure de la bière se souleva lentement.
Une odeur âcre saisit le négociant aux narines. Les aromates, dont le cadavre était enduit, dégageaient leur senteur pénétrante. Mais il n’interrompit pas son travail. Un dernier effort et le couvercle joua sur ses charnières, découvrant le mort enroulé dans un pagne de lin.
La lune frappait en plein son visage bronzé, lui prêtant un caractère presque surnaturel. On eût dit une de ces apparitions étranges que relatent les légendes. Et de fait, ces deux hommes penchés sur la fosse violée, face à face avec le malheureux dont ils troublaient le dernier sommeil, formaient un tableau terrifiant.
– À sa droite, au fond. L’argent est dans un sac de peau.
Prononcés presque à voix basse par le Hova, ces mots sonnèrent lugubrement. Canetègne promena autour de lui un regard effaré. Il lui semblait que, sur l’aile du vent, le son s’éloignait grossissant toujours, allant porter au loin la nouvelle du crime.

– À droite, au fond, répéta le général.
Les lèvres serrées, le cœur tournant follement dans sa poitrine, l’Avignonnais se pencha ; sa main frôla le corps. Il laissa échapper un gémissement épouvanté. Pour un peu il se serait relevé et à toutes jambes aurait fui.
– Eh bien ? demanda Ikaraïnilo.
Le négociant tendit ses nerfs, honteux de son trouble. Il empoigna la sacoche de cuir et la tendit à son complice. Puis il rabattit le couvercle et se mit en devoir de combler le trou. Mais soudain il resta immobile, comme pétrifié.
Un faible cri avait retenti auprès de lui.
– C’est le mort, bégaya-t-il, le mort qui se plaint.
– Quelqu’un nous épiait ! gronda le général.
– Quelqu’un ?
– Oui. N’avez-vous pas entendu ? Et tenez, il s’éloigne, emportant notre secret.
Un bruit de branches brisées arrivait aux deux hommes.
– Il faut empêcher ce curieux de nous trahir.
D’un bond le Malgache gagna le fourré, et après un long cri d’appel, il s’élança à la poursuite de l’ennemi inconnu qu’il venait de dépister.
Une seconde Canetègne hésita sur la conduite à tenir. La crainte de rester seul l’emporta. Abandonnant ses outils, il suivit son associé.
Du reste, la poursuite était aisée. L’espion, si c’était un espion, devait être embarrassé ; car il se frayait bruyamment un chemin à travers les arbustes.
Un cri résonna dans la nuit, aigu, éperdu, cri de femme apeurée. Des exclamations gutturales répondirent, suivies d’un bruit de lutte. Les poursuivants s’arrêtèrent. Puis d’une allure plus lente, évitant de froisser les feuillages, ils rampèrent vers l’endroit où des voix confuses s’élevaient.
Bientôt ils atteignirent la lisière d’une clairière que la lune inondait de clarté. Leur escorte était réunie en cet endroit. Des soldats achevaient de garrotter des prisonniers : deux hommes et une femme. D’autres entravaient un mulet portant une selle grossière.
D’un coup d’œil le Hova se rendit compte de la situation, et entra dans l’espace éclairé. Canetègne l’imita. Aussitôt le chef du détachement vint à eux. Avec de grands gestes il leur expliqua ce qui venait de se passer : les Sakalaves étendus sur l’herbe, dormant pour la plupart ; la brusque irruption des étrangers, leur attitude belliqueuse. Heureusement le mulet sur lequel était juchée la femme avait buté ; il était tombé sur les genoux, et tandis que les hommes s’efforçaient de le relever, on avait pu les entourer et s’en rendre maître. En terminant, le Malgache déclara que c’étaient des gens d’Europe.
– Des gens d’Europe ? redit l’Avignonnais.
Le général fronça le sourcil. Des Européens connaissaient son secret. Seul avec eux en cet endroit, il eût chargé son poignard de le garantir contre toute révélation dangereuse.
La présence des soldats le gênait. Alliés des Français, ils n’eussent pas empêché le crime, mais ils le publieraient ensuite ; et alors il serait nécessaire d’entrer dans des explications qui ne satisferaient sûrement pas tout le monde.
Des réflexions du même genre tracassaient le négociant. Sans avoir conscience de son mouvement, il se rapprochait peu à peu du groupe formé par les captifs. Il les dévorait du regard. Soudain il se passa la main sur les yeux :
– Je rêve, dit-il.
Il fit encore un pas, regarda de nouveau. Un hurlement de triomphe s’échappa de ses lèvres, et appelant le général stupéfait :
– Les criminels que j’attendais ! cria-t-il.
Ceux qu’il désignait ainsi s’étaient retournés.
– Monsieur Canetègne ? firent-ils d’une seule voix.
– Lui-même, qui vous tient, mademoiselle Yvonne Ribor ; qui vous tient aussi, messieurs Marcel Dalvan et Claude Bérard.
C’étaient en effet les fugitifs que le hasard venait de jeter dans les griffes de leurs ennemis.
– La Providence nous abandonne ! gémit Yvonne.
Elle regardait Claude, semblant attendre de lui un expédient, un moyen d’échapper à la fatalité. Le « Marsouin » secoua la tête avec découragement, et ce fut Simplet qui répondit à la jeune fille :
– Tu voudrais bien être libre ?
– Cette question ?
– Tu le seras dans cinq minutes.
– Ne plaisante pas.
– Je suis très sérieux. M. Canetègne nous arrête, il est tout naturel qu’il nous remette en liberté.
Et avec l’expression narquoise qui lui était habituelle :
– Monsieur Canetègne, appela-t-il.
– Hein ? fit le négociant, qui parlait avec animation à son associé.
– Venez donc, j’ai à vous dire deux mots.
– Tout à l’heure, quand j’aurai le temps.
– Non, tout de suite… Si vous refusez, je prie mon ami Claude, qui a été en garnison à Madagascar et écorche le malgache tout comme un autre, de narrer notre rencontre sous un ravenala.
– Je suis à vous, exclama l’Avignonnais.
Et, d’un pas pressé, il courut vers les prisonniers.
– Là, plaisanta Marcel. Tu vois bien, petite sœur, il fait déjà des concessions.
IX
DANS LA BROUSSE
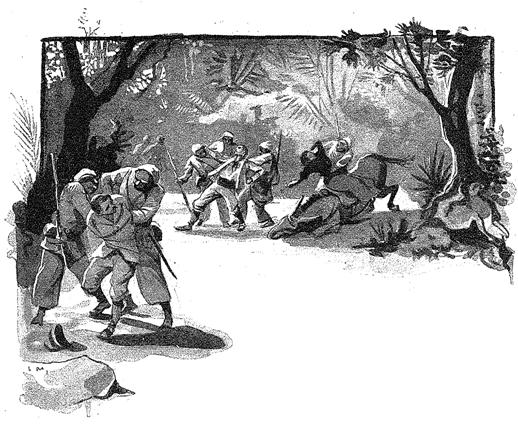
Comment les voyageurs s’étaient-ils trouvés à huit kilomètres de Port-Longuez, tout exprès pour se faire arrêter par les Sakalaves d’Ikaraïnilo ?
En quittant Obok, le yacht Fortune, laissant de côté les escales des Comores, avait piqué droit vers la côte orientale de Madagascar. Avertis qu’ils étaient signalés à l’autorité judiciaire dans les diverses colonies françaises, les jeunes gens n’avaient pas voulu atterrir à Diego-Suarez.
– On nous guette du côté de la mer, avait dit Marcel. Faisons une chose toute simple, arrivons par terre.
Le steamer avait donc déposé ses passagers à la Pointe-aux-Îles, un peu au sud de Port-Louquez. Après des adieux touchants à miss Diana Pretty, ceux-ci avaient bravement fait route vers Antsirane, les hommes à pied, Yvonne assise tant bien que mal sur une mule achetée à un fermier Betsimisarak.
Ils marchaient de nuit, sans perdre de vue la mer. De cette façon ils évitaient toute chance d’insolation et ne risquaient point de s’égarer.
Or, ils avaient passé la journée du 31 décembre à l’autre extrémité du plateau boisé, sur lequel Canetègne avait débuté comme vampire, et la lune ayant allumé son flambeau, ils s’étaient mis en route vers le nord. Comme aux étapes précédentes, Mlle Ribor veillait sur son frère de lait. Pour elle, il était resté enfant en quelque sorte. Elle le plaignait d’avoir à supporter de telles fatigues.
– Monsieur Bérard, expliquait-elle, a fait son congé dans l’infanterie de marine ; il est habitué à la vie coloniale, tandis que Simplet n’y connaît rien. J’ai peur de tout pour lui : les serpents, les caïmans, les bêtes féroces et surtout la maladie. Ah ! si cela avait été possible, je l’aurais laissé à bord du navire. Mais c’eût été trop exiger de la gracieuse Américaine. Elle avait déjà changé sa voie pour nous être agréable. La forcer à attendre là, la fin de nos démarches aurait été un comble d’indiscrétion.
Et elle sermonnait Marcel, qui la laissait dire. Toujours calme, il continuait à penser que tout est simple. De fait, après les marches nocturnes à travers les rochers ou les marécages, il s’endormait au matin d’un sommeil aussi paisible que s’il eût été couché sur le plus doux des lits. Il conservait son teint rosé et sa confiance.
Contournant les massifs d’arbustes, la petite caravane avançait allègrement. De temps à autre, Yvonne donnait un conseil à son frère de lait pour escalader un bloc de granit ou pour éviter une plante épineuse. Il la remerciait tranquillement, nullement agacé par sa surveillance protectrice.
Claude, lui, haussait parfois les épaules. Autrement que la jeune fille, il jugeait son compagnon de voyage ; mais il n’avait point à intervenir, Dalvan ne se plaignant pas.
– Chut ! fit-il en s’arrêtant soudain. N’entendez-vous rien ?
Simplet prêta l’oreille.
– Si, et – la supposition est folle sur ce plateau désert – on jurerait qu’un ouvrier travaille la terre.
– Encore une de tes idées, railla Yvonne.
– Encore, petite sœur. Et plus j’écoute, plus je me persuade que je ne me suis pas trompé.
Avec prudence, tous s’avancèrent dans la direction du son. Bientôt le doute ne fut plus possible. Le choc du fer sur le sol se percevait distinctement.
– Qui diable cultive à cette heure ? grommela Bérard.
– Allons voir, répliqua Simplet.
La mule attachée à un arbre, tous trois se faufilèrent entre les broussailles et arrivèrent à quelques pas de l’endroit où Canetègne, surveillé par Ikaraïnilo, accomplissait sa lugubre besogne.
Tout d’abord, ils ne comprirent pas. Mais l’Avignonnais, tenant le sac de monnaie, démasqua le mort dont la face immobile se montra sous un rayon de lune.
Yvonne ne put retenir un cri d’horreur. Brusquement Marcel la saisit par la main, la ramena en courant à la place où avait été laissée sa monture, la mit en selle et, tenant l’animal par la bride, fila droit devant lui, dans une course folle, accélérée encore par l’appel dont Ikaraïnilo fit retentir la brousse. Ni les uns ni les autres n’avaient reconnu le travailleur.
– Le tonnerre emporte les femmes ! maugréait Claude. Nous voilà sur les bras une affaire avec des gens qui, à en juger par leur occupation, sont exempts de scrupules.
Il galopait comme son ami. Avec lui, il déboucha dans une clairière, où une dizaine d’hommes armés de fusils étaient étendus.
– Des Sakalaves ! fit-il… et en service encore. Tout va bien.
À ce moment, la mule s’abattit sur les genoux. Avant que les sous-officiers eussent pu la remettre sur pied, ils furent saisis, garrottés et couchés sur l’herbe à côté de leur compagne de voyage. Les Malgaches avaient perçu le signal lancé par le Hova, et ils traitaient en ennemis ces inconnus qui semblaient fuir.
Tandis que Claude et Yvonne désespéraient, Simplet, ayant reconnu Canetègne, venait de lui intimer l’ordre d’avoir à l’écouter.
– Tu vois bien, petite sœur, avait-il déclaré en riant ; l’ogre fait déjà des concessions.
C’était vrai. L’Avignonnais se souvenait du petit soldat, qui l’avait si joliment berné à Lyon. Il avait démêlé dans son accent comme une menace, et il s’empressait de le joindre. Sans plaisir d’ailleurs, à en juger par le ton rogue dont il demanda :
– Qu’est-ce que vous voulez ?
– Vous voir, monsieur Canetègne.
– Je vous préviens que je ne suis pas en humeur de plaisanter.
– Moi non plus. Causons donc. Il est probable que nous nous entendrons.
– Vous croyez ?
L’air dégagé du prisonnier déplaisait à son interlocuteur.
– En tout cas, faisons vite.
– À vos ordres, monsieur Canetègne. Une question d’abord : À quoi devons-nous le plaisir de cette rencontre inattendue ?
Le commissionnaire hésita. À ce sous-officier qui paraissait le défier, il aurait eu joie à conter le piège tendu ; mais le jeune homme allait être mis en présence de juges ; on l’interrogerait. Il était inutile de l’éclairer, car le procédé de M. Canetègne eût semblé inexplicable aux magistrats. Il se décida donc à biaiser.
– Ma foi ! j’ai lu une dépêche du Petit Journal annonçant l’arrivée, à Diego-Suarez, de M. Antonin Ribor.
– Comme nous ! soupira Yvonne.
– Et vous êtes accouru pour qu’il nous soit plus facile de vous confondre ?
Le négociant grimaça :
– Pour l’éloigner uniquement. Ce à quoi j’ai réussi. Si bien que je puis sans crainte vous conduire à Diego-Suarez et vous remettre aux mains des autorités.
– Lesquelles, continua Dalvan, nous renverront en France où l’on nous emprisonnera comme voleurs, complices d’évasion, etc.
– Précisément !
– Très bien imaginé, monsieur Canetègne.
– N’est-ce pas ? Les choses se passeront comme vous le dites, à moins…
– À moins… cher monsieur Canetègne ?
– Que Mlle Ribor ne consente à m’accorder sa main.
– Vous pensez encore à cela ?
– Toujours. Dans ce cas, j’arriverais à étouffer l’affaire et tout le monde serait content.
– Excepté ma sœur de lait.
– Oh ! vous savez, je l’aime beaucoup. Elle serait heureuse et…
– Malheureusement, monsieur Canetègne, elle préfère sa liberté…
– La seule chose que je ne puisse lui offrir.
– Oh ! que si.
– Oh ! que non.
– La preuve est que vous allez la lui donner.
– Moi ? Si je vois cela…
– Pas de propos téméraires. Asseyez-vous, cher monsieur Canetègne, et prêtez-moi, – pas d’argent, c’est trop cher chez vous, – simplement un peu d’attention.
Dominé, l’Avignonnais obéit. Quant à Yvonne, elle paraissait stupéfaite. Ses regards allaient de Marcel au négociant ; elle pensait rêver. Comment ! c’était son frère de lait qui parlait ainsi, qui se faisait écouter ?
– Cher monsieur, reprit Simplet, vous raisonnez faux, parce que votre point de départ est faux. Vous nous considérez comme vos prisonniers.
– Mais il me semble, hasarda le commissionnaire ahuri…
– Il vous semble mal, voilà tout. C’est vous qui êtes mon prisonnier.
– Moi ?
Yvonne leva les yeux au ciel. Le sous-officier lui paraissait s’enferrer.
– Vous même, continua celui-ci, et vous allez être de mon avis.
– Pour cela, non.
– Supposez que j’appelle les soldats sakalaves qui m’ont arrêté, que je leur dise, – par l’organe de mon ami Claude, il parle le malgache, – à quelle opération vous vous livriez quand nous vous avons aperçu.
Canetègne ne répondit pas :
– Il est aisé de prouver. Votre compagnon – la tête de pain d’épice – a le sac d’argent. On vous arrête tous deux. Vous êtes jugés, condamnés pour violation de sépulture. Votre cas est plus grave que le nôtre ; vous avez plus à perdre que nous. Donc, c’est vous qui êtes en notre pouvoir.
– Bravo ! souligna Claude.
– Mais c’est qu’il a raison, murmura Mlle Ribor. Qui l’aurait cru capable de trouver cela ?
– Monsieur Canetègne, fit Marcel d’une voix insinuante, vos soldats ont serré les cordes qui me lient les bras et les jambes ; déliez-moi.
Et comme le commissionnaire, maté par son raisonnement, s’empressait de le satisfaire, le sous-officier ricana :
– Ça me rappelle la Tour de Nesle. Buridan enchaîné et… Oh ! non, vrai, il n’a rien de Marguerite de Bourgogne !
Puis, plus gracieusement encore :
– Rendez donc le même service à mes amis.
Le négociant eut un geste de révolte. Cela l’ennuyait d’être joué.
– Violation de sépulture ! susurra Simplet.
L’Avignonnais s’exécuta puis, rouge de colère :
– Enfin, où voulez-vous en venir ?
– C’est bien simple, cher monsieur Canetègne. – Le jeune homme lança un coup d’œil à Yvonne ; elle n’avait pas sourcillé cette fois en entendant la locution favorite de son frère de lait. – C’est bien simple, nous pouvons réciproquement nous faire emprisonner ; il est moins bête de nous rendre mutuellement la liberté. Expliquez à vos Sakalaves qu’il y a erreur, que nous sommes des gens paisibles. Nous tirons de notre côté, emportant le secret dangereux pour vous.
Les poings du négociant se crispèrent. Il était pris dans la logique du jeune homme, comme la mouche dans la toile de l’araignée. Mais si sa raison rendait pleine justice à celle de l’adversaire, le sentiment de son impuissance le rendait furieux. Après tout, il n’y avait pas à hésiter.
– Soit, dit-il. Mais vous garderez le silence ?
– À une condition cependant.
– Encore ?
– Vous ne nous dénoncerez pas, j’en suis certain. Seulement, votre complice serait peut-être moins bienveillant. Je tiens à le connaître et à le tenir.
– Cela se peut. Vous vous livreriez en nous livrant ; aussi j’ai confiance. Mon associé est le général hova Ikaraïnilo, commandant la garde de la léproserie d’Antananarivo.
– Bien.
Le négociant fit un pas vers les soldats qui assistaient de loin à la conférence. Marcel l’arrêta :
– Un petit mot.
– Dites vite.
– Vous avez éloigné Antonin Ribor. Vous l’avouiez tout à l’heure ?
– Oui.
– Soyez assez complaisant pour m’indiquer où vous l’avez expédié.
Un instant Canetègne garda le silence, puis un sourire étrange flotta sur ses lèvres.
– Cela, non. Vous comprendrez les motifs de ma réserve. Tout ce que je puis vous apprendre, c’est qu’il a quitté Diego-Suarez, qu’il s’est rendu à Antananarivo, et que maintenant il navigue vers une colonie où il espère retrouver sa sœur.
– Vous l’avez saturé de mensonges. Ce bon monsieur Canetègne ! Cela suffit. Faites que nous nous séparions, notre rencontre a trop duré.
Sans relever l’impertinence du sous-officier, l’Avignonnais rejoignit ses compagnons et, après une courte conférence, s’éloigna avec sa troupe, laissant les jeunes gens seuls dans la clairière.

Mais tout en marchant, il racontait au général ce qui venait de se passer.
– Tu es puissant à Antananarivo, conclut-il. Je leur ai désigné cette ville dans l’espoir que tu m’aiderais à les écraser. Je pars avec toi.
– Tu as bien fait, répondit tranquillement le Hova. Dans notre capitale ils trouveront la mort.
Et sur un signe interrogateur :
– Tu es lié à moi par notre crime commun. Je n’ai rien à te cacher. Nous sommes las de la domination française. Dans un mois, nos guerriers seront armés, grâce à nos amis d’Angleterre, et alors pas un de nos maîtres n’échappera à notre vengeance.
– Bigre ! interrompit le commissionnaire, je ne t’accompagne plus.
– Non. Tu sais et tu dois par conséquent rester auprès de moi. Tu n’as rien à craindre d’ailleurs, je te protège.
Tandis que Ikaraïnilo faisait planer sur les Français cette menace de soulèvement, Marcel et ses amis tenaient conseil. Se rendre à Diego-Suarez, maintenant était inutile. Autant gagner Antananarivo. Le résident, installé dans la capitale Hova, aurait sûrement vu Antonin. Peut-être saurait-il vers quelle contrée l’explorateur s’était dirigé.
Le mieux était de revenir à la Pointe-aux-Îles. Si le Fortune y était encore, les voyageurs demanderaient à miss Pretty de les conduire à Tamatave, d’où ils atteindraient en huit jours la ville d’Antananarivo.
– Et si le yacht est parti ? demanda Yvonne.
– Nous suivrons la côte et chercherons une embarcation indigène qui nous transporte, voilà tout !
Sur ces mots, la jeune fille fut hissée sur sa mule, et la petite troupe quitta la clairière.
Marcel voulut repasser près de la sépulture violée, et Yvonne elle-même l’approuva lorsqu’il lui montra la bêche oubliée par Canetègne, et surtout le sac où l’instrument avait été enfermé. Sur la toile des caractères latins se dessinaient en bleu, formant des mots que Bérard traduisit ainsi :
– Ikaraïnilo, xvie honneur.
– Seizième honneur, répétèrent les amis du « Marsouin », cela signifie ?
– Général, tout simplement. Au lieu de grades, on a des honneurs. Les généraux vont de douze à vingt-deux. Les Tsimandos, ou courriers royaux, qui en réalité font la police, sont neuvième honneur. Le premier ministre et son épouse la reine occupent le sommet de l’échelle avec trente trois honneurs.
Après cette explication, sac et bêche, placés sur la mule, la marche fut reprise.
À la Pointe-aux-Îles, une première désillusion attendait les voyageurs. Le yacht Fortune n’était plus au mouillage. Les indigènes des environs déclarèrent n’avoir pas de pirogues assez grandes pour tenir la mer.
Ils semblaient affligés de ne pouvoir rendre service aux Européens. On sentait dans leurs paroles comme une hésitation. En réalité, ils obéissaient à un mot d’ordre donné. Depuis quelques jours, les Tsimandos de la reine Hova parcouraient le pays, annonçant aux populations les plus terribles représailles si elles entraient en contact avec les blancs. Ils disaient ces derniers atteints d’un mal redoutable, dont serait frappé quiconque les recevrait. Sous couleur d’hygiène ils faisaient le vide autour de nous.
Les voyageurs ignoraient cette situation. Ils crurent donc les Malgaches. La route de la mer leur était fermée, ils se contenteraient de la voie de terre. Bravement ils se mirent en route à travers la forêt continue, qui va de la côte aux premières rampes des plateaux du centre. Sous le feuillage des baobabs, des tecks, des ébéniers, ils allaient, arrêtés à chaque instant par l’un des innombrables ruisseaux qui se jettent dans l’océan entre Diego-Suarez et la baie d’Antongil.
Plus ils avançaient, plus le mauvais vouloir des indigènes s’accentuait. Maintenant on les fuyait ; on leur refusait les vivres dont ils avaient besoin.
Pendant la cinquième journée de marche, une flèche lancée par un ennemi invisible frappa la mule d’Yvonne au défaut de l’épaule. Marcel et Bérard battirent le fourré sans découvrir aucune trace. La pauvre bête étant morte, Mlle Ribor dut suivre ses compagnons à pied.
Tout le jour suivant elle chemina sans une plainte ; sa fatigue se trahissant seulement par la contraction de son visage. Au soir elle se coucha sur le sol, brisée, grelottant de fièvre.
Dans le sac léger qu’il portait sur le dos, Marcel avait heureusement une petite provision de quinine, ce remède universel dans les pays intertropicaux. Cette fois encore, la panacée triompha du mal. Quand l’aurore se montra, la fièvre avait disparu ; mais il était évident qu’elle guettait sa victime, et qu’à la moindre fatigue elle reparaîtrait. Il fallait à tout prix trouver une monture à la jeune fille.
Celle-ci se lamentait, désolée d’être un embarras pour ses amis. Alors Marcel la gronda doucement, lui fit promettre d’être bien sage ; et la laissant à la garde du campement, établi au bord d’un ruisselet murmurant, se mit avec Claude en quête d’un moyen de transport.
Un bois de pandanus vacoua, dont la fibre se prête au tissage, s’élevait à peu de distance. Ils s’enfoncèrent sous son ombre. Autour des troncs, de grandes orchidées aux fleurs éclatantes s’enroulaient en interminables spirales, lançant des rejets d’une branche à l’autre, formant au-dessus de la tête des Français un dôme odorant. Un battement d’ailes, un bruissement rapide dans les herbes indiquaient seuls la présence d’êtres vivants, dérangés dans leur tranquillité par le passage des jeunes gens.
Puis les arbres s’espacèrent, se firent plus rares, et les voyageurs débouchèrent dans une prairie dont un étang occupait le centre.
À la surface de l’eau, l’ouvirandrona balançait ses feuilles découpées à jour en fine dentelle, et dans les joncs géants de formidables froissements décelaient la présence de caïmans.
Les sous-officiers ne s’arrêtèrent pas. Au fond d’un vallonnement ils avaient aperçu une ferme. Là, ils trouveraient des porteurs, ou bien on leur vendrait un zébu de selle ; car ici comme dans l’Hindoustan, leur pays d’origine, ces superbes buffles sont des bêtes de somme appréciées. On les élève par centaines de mille, et ils représentent une des principales richesses de la grande île africaine.
Des travailleurs étaient épars dans la plaine. Marcel avait hâté le pas. Soudain un cri d’épouvante déchira l’air :
– Aïbar Imok !
Et les indigènes s’enfuirent à toutes jambes vers les huttes de bois et de limon, dont l’ensemble représentait la ferme.
– Qu’est-ce qui leur prend ? fit Simplet.
– Je ne sais, riposta Bérard. Aïbar Imok signifie : la peste. Pourquoi ce cri ? Pourquoi cette épouvante ? Mystère.
– Approchons toujours ; ils nous le diront.
Mais à cinquante mètres des habitations il fallut s’arrêter. Les Malgaches, debout sur le seuil des cabanes, brandissaient des fusils d’un air menaçant. Un homme, qui paraissait être le chef, s’avança, et à distance respectueuse, adressa aux voyageurs un discours dont ils ne comprirent pas un mot. Les gestes en revanche étaient clairs. Ils signifiaient nettement :
– Allez-vous-en, ou nous tirons sur vous.
– Ils sont tous fous dans l’île, murmura Dalvan tout en obéissant à cette injonction peu parlementaire. Eh bien ! je les trouve gentils, les protégés de la France ! Après cela, c’est l’histoire universelle ; les protecteurs sont partout détestés.
Et sur cette réflexion empreinte de philosophie il prit le large, suivi de Claude qui mâchonnait furieusement sa moustache.
Dans deux autres agglomérations des scènes identiques se renouvelèrent. C’était à se briser la tête contre un arbre. Vouloir acheter un zébu, et n’obtenir que des imprécations ou des menaces !
Avec cela la journée s’avançait. Les jeunes gens éprouvaient une vague inquiétude en songeant à leur compagne restée seule, sans défense, dans cette région agitée par un démon hostile.
Ils reprirent le chemin du campement. Comme ils atteignaient le bois de Pandanus traversé le matin, un bruit sourd les cloua sur place. On eût dit la chute d’un corps pesant. Presque aussitôt une exclamation gutturale parvint jusqu’à eux, étouffée par un formidable grincement de dents. Les voyageurs armèrent leurs revolvers.
– Que se passe-t-il ? fit Marcel.
Des grondements, des cris humains bourdonnaient à leurs oreilles.
– Allons voir.
Tous deux s’élancèrent éventrant les buissons, et subitement ils s’arrêtèrent.
Sur le sol un groupe hurlant se tordait. Au bout d’un instant ils distinguèrent un indigène enlacé par un lémurien géant. Quadrumane comme le singe, mais armé de griffes redoutables, l’animal cherchait à étouffer l’homme.

Celui-ci s’efforçait d’éviter son étreinte, et les bras lacérés, le visage sanglant, luttait. Mais déjà la fatigue l’avait abattu sur le sol où son ennemi l’appuyait de tout son poids.
Sans hésiter, Marcel s’avança et déchargea son arme dans l’oreille du lémurien. Foudroyée la bête eut une contraction qui la fit bondir à plusieurs pas, puis elle s’aplatit à terre sans mouvement. Rapide comme l’éclair, le Malgache s’était relevé :
– Des blancs ! dit-il en considérant ses sauveurs.
Il fit mine de fuir, mais se ravisant il vint à Marcel, le flaira cérémonieusement – c’est ainsi que les Hovas se saluent – et dans un français émaillé de mots anglais et malais :
– Tu as sauvé la vie de Roumévo, courrier de la reine ; tu es blanc, donc ennemi. Cependant, tu n’as plus rien à craindre, car Roumévo est reconnaissant. Il veut faire avec toi le serment de sang.
– Accepte, souffla Bérard à son ami. Ce moricaud va nous sauver.
– Faisons le serment de sang.
– À la halte, chez le chef, afin qu’il soit garant que nous devenons frères. Viens chercher la jeune fille blanche qui voyage avec toi, puis nous gagnerons le village tout proche de Sambecoïré.
Le sous-officier avait tressailli.
– Tu sais qu’une jeune fille…
– T’accompagne ? Oui. Roumévo sait beaucoup de choses. Sans plus, il courut au lémurien, sorte de maki haut de un mètre cinquante, au pelage noir et gris. À l’aide de son couteau il l’eut tôt écorché. Il choisit alors quelques morceaux de viande – les plus savoureux sans doute – les enroula dans la dépouille sanglante qu’il jeta sur son épaule et s’adressant aux Français :
– Venez, il nous faut arriver avant la nuit.
Tout en marchant, il expliquait à Dalvan comment il avait été surpris par le maki. Suivant l’habitude de ses congénères – Madagascar en compte dix-huit espèces dont la plus petite a la taille d’une souris – l’animal était perché sur une maîtresse branche lorsque Roumévo l’avait aperçu. Lui envoyer une flèche avait été l’affaire d’un instant. Mais sur une liane le projectile avait dévié, blessant la bête sans l’atteindre dans les œuvres vives.
Furieux, le lémurien s’était laissé tomber. Surpris par son mouvement, le Hova s’était senti étreint par ses bras vigoureux avant d’avoir songé à l’éviter. Il était perdu sans l’intervention du blanc. Des confidences l’indigène passa à l’interrogation :
– Où vas-tu ?

– À Antananarivo.
– Bien. J’y retourne moi-même ; tu verras qu’un frère peut aplanir la route de son frère.
– Décide les habitants à nous vendre des provisions et…
– Je les déciderai.
– Tu sais pourquoi ils refusent ?
Roumévo eut un rire railleur.
– Oui.
– Et c’est ?…
– Je ne dois pas parler avant le serment de sang. Après je n’aurai plus de secrets pour toi, car ta langue se refuserait à répéter les confidences de ton frère malgache.
– Vois-tu, expliqua Claude à son compagnon, le serment dont il te parle est sacré. Fourbe, menteur, voleur, le Hova devient loyal quand il l’a prêté. Il accorde à son « frère » la confiance la plus absolue, et lui-même mérite qu’on ait foi entière en lui.
– Qu’est ce serment ?
– Tu le verras.
On atteignait le campement, et Yvonne, inquiète de la longue absence de ses fidèles, accourait au-devant d’eux.
En dix minutes la petite troupe fut prête à partir. Longeant le lit du ruisseau voisin, elle se dirigea, guidée par Roumévo, vers le village de Sambecoïré. Une promenade de trois quarts d’heure la conduisit en face d’une cinquantaine d’habitations, aux toits pointus couverts en ravenala et supportés par des poutres formant véranda tout à l’entour.
Établies au fond d’une vallée riante, où le ruisseau élargi formait un lac miniature, les maisons coquettement groupées s’abritaient sous des cocotiers au tronc flexible, des arbres à pain, des sagoutiers dont la moelle séchée fournit une excellente farine. Des rafias énormes, au tronc trapu, aux palmes découpées en mille folioles, suspendaient à dix mètres de hauteur leurs grappes de fruits lourdes de cent à cent cinquante kilogrammes. Et sans craindre la chute de ces régimes dangereux pour le promeneur, des indigènes couchés à l’ombre écoutaient un sekaste, qui chantait en s’accompagnant de la guitare à une corde.
Vêtu ainsi qu’une femme, le visage fardé, le musicien prenait des attitudes bizarres, faisait des effets de hanches.
– Un troubadour, murmura Claude.
– Ce singe ?
À l’exclamation de Marcel le « Marsouin » répliqua :
– Comme tu le dis. Ce singe va de village en village. Il improvise un chant de guerre, d’amour ; il conte les luttes des dieux. Tu le sais, les Malgaches sont superstitieux en diable. On l’héberge, on lui fait des présents. Avec les troubadours, cela ne se passait pas autrement.
Un certain mouvement se manifesta parmi les auditeurs du sekaste. Les blancs avaient été aperçus. Mais Roumévo partit en avant, parla longuement au chef et enfin fit signe à ses compagnons d’approcher.
Cette fois personne ne les insulta. Plusieurs hommes débarrassèrent une cabane. On l’offrit aux voyageurs. Puis des jeunes filles leur apportèrent des noix de coco emplies de vin de palme, du filet de sanglier, des boules vertes de l’arbre à pain cuites sous la cendre. De bon appétit ils dînèrent. Comme le repas touchait à sa fin, Roumévo s’adressa à Marcel :
– Viens, c’est l’heure du serment.
Sur un signe de Bérard, Marcel tendit la main au Malgache, et tous deux, suivis par leurs amis, se dirigèrent vers la place centrale du village.
Déjà tous les habitants y étaient rassemblés. Assis en cercle, ils avaient laissé libre un assez large espace, au milieu duquel était un vase de terre.
À l’arrivée des héros de la cérémonie tous poussèrent un cri guttural.
Puis il se fit un grand silence. Le chef du village se leva. Pour faire honneur à ses hôtes il avait noué sur ses épaules la fourrure du maki, dont Roumévo lui avait fait présent. Il prononça quelques paroles et aussitôt un ombiache – espèce de sorcier – drapé dans une pièce d’étoffe rouge, entra dans le cercle. À sa ceinture une sagaie, un couteau triangulaire et une petite pochette de cotonnade jaune se balançaient. Il portait une cruche à la main. Dans le vase posé à terre il vida l’eau contenue dans le récipient. Deux fois il en fit le tour en prononçant une incantation bizarre, et prenant la sagaie, il en trempa la pointe dans le liquide. Sur son invitation, Marcel et Roumévo saisirent la hampe de l’arme à pleines mains.
La foule semblait pétrifiée. Pas un mouvement, pas un murmure.
Le silence impressionnait le sous-officier. Il avait craint de rire d’abord, maintenant, à l’attitude de tous, il comprenait que Bérard lui avait dit vrai : le serment du sang est chose sacrée.
Cependant l’ombiache, puisant dans son sac jaune, en tirait des pièces de monnaie d’argent, de la poudre, des pierres à fusil, des balles, de petits morceaux de bois. Après quoi, il se prosterna dans la direction de chacun des points cardinaux, ramassant chaque fois une pincée de terre, qu’il jeta avec tout le reste dans l’eau.
À cet instant, les guerriers de la tribu entre-choquèrent leurs armes, et le sorcier, empoignant son couteau triangulaire, en frappa à petits coups la hampe de la sagaie que tenaient Roumévo et Marcel. Son visage se contracta ; ses yeux eurent des lueurs, et, comme inspiré, d’une voix surhumaine, il appela les divinités de la nuit, les chargeant de punir celui des deux contractants qui enfreindrait les obligations du serment.
Les assistants courbaient la tête. Sous les arbres, les échos endormis s’éveillaient pour renforcer les imprécations de l’ombiache. Il se tut enfin.
Alors Roumévo prit le couteau, s’incisa légèrement la poitrine et fit tomber quelques gouttelettes de sang dans un cornet contenant de l’eau puisée au vase. Marcel procéda de même. Échangeant alors leurs cornets, ils burent leur contenu, s’infusant ainsi le sang l’un de l’autre.
Une clameur joyeuse s’éleva. Le serment du sang était juré. Dalvan et le Hova devenaient frères. Quant à Bérard, il se frottait les mains, expliquant à Yvonne toute émue par la solennité de la représentation, que les liens ainsi formés sont plus respectés que ceux de la fraternité de naissance. Deux frères de sang doivent partager leur fortune, se soutenir dans le danger, mettre en commun tous les biens et les maux de la vie. En cas de guerre, alors même qu’ils appartiennent à deux tribus ennemies, ils sont tenus de se protéger, de s’entr’aider. Si l’un pensait que l’autre pût tomber dans une embuscade tendue par les siens, il le préviendrait, trahissant la tribu plutôt que la fraternité.
Des danses terminèrent la cérémonie, et chacun s’en fut dormir.
Au jour la caravane, augmentée de Roumévo et d’un superbe zébu vendu par le chef du village, prit congé de ses hôtes.
Le buffle portait Yvonne, toute joyeuse maintenant. Sa joie devait croître encore. Partout on les recevait avec déférence. Il suffisait au Hova de montrer le cachet rouge, insigne des courriers de la reine, pour que tous les indigènes se missent en frais d’amabilité. Ils montraient une sorte de respect effrayé. C’est que tous connaissaient les Tsimandos. Ils savaient la terrible puissance de ces émissaires qui parcourent les provinces, correspondent directement avec le premier ministre hova et condamnent sans appel l’homme qu’ils désignent comme suspect.
On passa la nuit dans un village dont la plus belle case fut donnée aux étrangers.
– Dans vingt-quatre heures nous atteindrons la baie d’Antongil, dit Roumévo au moment du départ. Là nous trouverons de grandes pirogues pour aller à Tamatave.
Un seul incident se produisit dans la journée. De peu d’importance en soi, il amena une conversation dont Marcel tira profit.
Vers midi, la petite troupe avait fait halte à l’ombre d’un bouquet de bananiers. Engourdis par la chaleur, tous s’abandonnaient au sommeil, quand des chants appelèrent leur attention. Des Betsimisaraks s’avançaient processionnellement, braillant à tue-tête ce refrain :
– Kalamaké ! Kalamaké ! Arouné !
Roumévo imposa silence aux chanteurs qui s’éloignèrent.
– Pourquoi les renvoyer ? demanda Dalvan.
Le courrier secoua la tête :
– Parce qu’ils insultaient mon frère de sang.
– Eux ?
– Sans doute. La complainte qu’ils récitaient se nomme : « les Ennuis du peuple ».
– J’en suis donc ?
– Les ennuis sont les blancs.
– Ah !
– Et leur refrain est : « Il sera bon de les manger avec des haricots. »
– L’amour de la musique ! Attends un peu ; je vais leur montrer qu’un blanc ne se mange pas comme cela.
Le jeune homme s’était levé. Roumévo l’obligea à se rasseoir.
– Ne t’éloigne pas, tu serais en danger.
– En danger ?
– De mort.
– Écoute, interrogea Dalvan, il se passe quelque chose d’insolite dans cette région. On nous fuit, on nous tracasse. Toi, au contraire, tu es choyé. Réponds. Qu’y a-t-il ?
La question parut embarrasser le Tsimando. Pourtant après un instant :
– Tu es mon frère, commença-t-il, je te dois la vérité. Mais laisse-moi t’apprendre d’abord que si tu avouais la tenir de moi, je serais décapité.
Il avait un ton solennel. Marcel répliqua :
– Tu es mon frère. Jamais par ma faute le malheur ne t’atteindra.
– Je parle donc.
Et baissant la voix :
– Frère, depuis trois siècles les Français se sont établis dans l’île pour asservir les peuples qui l’habitent. Les noms de leurs chefs rappellent de sanglants combats. Pronis, La Case, de Flacourt, de Maudave, Benyouski, l’amiral Pierre. Ils nous ont canonnés, fusillés. Sous la terre, nos morts nous appellent aux armes. Un seul n’a pas fait couler le sang ; c’est M. Le Myre de Vilers, mais il nous a diminués plus que tous les autres. Alors la reine a appelé ses courriers et leur a dit : « Il faut que les Hovas soient maîtres de Madagascar. Je vais rassembler mes guerriers. Vous, partez. Allez chez les Sakalaves, les Betsimisaraks, les Antankares. Ordonnez-leur de cesser toutes relations avec les envahisseurs. Et s’ils hésitent, apprenez-leur que les blancs répandent la peste autour d’eux, que leur contact est mortel.
– Et ? fit Marcel stupéfait mais prodigieusement intéressé.
– Nous avons obéi. Les populations que nous avons visitées sont plus nombreuses que nous. Elles aiment les Français, mais elles nous craignent. Par peur elles obéissent. Tu as pu t’en convaincre.
– C’est vrai. Et que compte faire la reine ?
Le Tsimando hésita encore :
– Bon ! murmura Marcel d’un air bon enfant, tu peux parler sans crainte. Tout cela ne me regarde pas.
– Que veux-tu dire ?
– Je ne suis pas Français.
– Pas Français, toi qui parles leur langue ?
– Dans mon pays on l’apprend ; je suis né en Suisse.
– Qu’est-ce que la Suisse ?
– Une région montagneuse, où l’on vit pauvre mais libre.
– Ah ! frère, tu me causes une grande joie. J’étais triste de devoir trahir ma souveraine ; tu me rends le repos de l’esprit. Pas Français ! Sache donc qu’un jour prochain notre reine Razatindrahety donnera le signal du massacre des Français. Tous seront exterminés et les Hovas achèveront la conquête de Madagascar.
Pas un muscle du visage de Marcel ne bougea. Il renfonça son émotion, apaisa les battements de son cœur et souriant par un prodige de volonté :
– C’est très bien imaginé, tout cela. Mais, sapristi ! vous devriez bien faire des distinctions entre les blancs. Si je ne t’avais rencontré, nous étions exposés à mourir de faim.
Le soleil descendant vers l’horizon était moins chaud. La marche fut reprise.
– Nous approchons de la mer, s’écria tout à coup Bérard. Je sens cela.
Il aspirait bruyamment l’air.
– Ton compagnon a raison, affirma le courrier. Dans une heure nous serons sur la côte d’Antongil.
Le vent arrivait par bouffées fraîches chargées d’effluves salins. Le sol devenait rocailleux.
Les voyageurs s’engagèrent dans une sente pierreuse, qui descendait en pente rapide à travers une véritable forêt de fougères. Soudain Marcel glissa et disparut à moitié dans un trou que la verdure l’avait empêché d’apercevoir. Un cri de douleur lui échappa et il bondit hors de la cavité en secouant ses mains avec une sorte de rage. Le courrier s’élança vers lui, sa face bronzée devenue grise.
– Un serpent ? interrogea-t-il.
– Je ne sais pas, mais je souffre. C’est intolérable ; j’ai du feu sur les mains.
Il les tendait au Tsimando. Celui-ci les considéra et poussa un soupir de soulagement.
– Ce n’est rien que le zapankare.
– Le zapankare ?
– Oui. Tu vois ces petites épines blanches, presque transparentes, implantées dans la peau ; je les retire, la douleur cesse aussitôt. Elles appartiennent à une ortie sur laquelle tu es tombé. De danger, aucun. Seulement il te viendra, à l’endroit des piqûres, des taches rouges semblables à celles qui indiquent le début de la lèpre. Au bout d’un mois, elles disparaîtront.
Puis avec un regard ironique :
– Un ami à moi, condamné aux fers, s’est servi de cette apparence pour se faire enfermer à la léproserie d’Antananarivo. La nuit il s’est enfui. Il n’y avait pas de gardes alors ; on en a mis depuis et on a creusé des fossés.
– Brrr ! j’aimerais mieux les fers que la société des lépreux.
– Tu ignores ce que c’est, attends avant de te prononcer.
Quelques pas encore en avant et le rideau d’arbres s’ouvrit, démasquant la surface verte de l’océan.
– La baie d’Antongil, prononça lentement Roumévo.
X
LE CHEMIN DE TANANARIVE

Comme l’avait annoncé le Tsimanclo, les voyageurs se procurèrent facilement une grande pirogue creusée dans le tronc d’un seul arbre et huit rameurs habiles. L’embarcation n’aurait pu tenir la haute mer ; mais comme elle devait seulement longer la côte, elle avait une stabilité suffisante, et le 12 janvier 1893, on se confia aux flots.
Après avoir noté au passage Mananara, l’un des plus anciens établissements français, Isvaviharivo-Mora, Volabel et Tintingue, ils atteignirent, le 15, le port d’Amboudifote, situé dans l’île Sainte-Marie, laquelle n’est séparée en cet endroit de la grande terre que par un canal de sept kilomètres.
Ils y séjournèrent deux heures, non pour visiter la ville aux légères maisons de bois entourées de jardins. Ils ne déambulaient pas en touristes, hélas ! Ils n’eurent pas un regard pour l’îlot aux Forbans où furent déportés les condamnés de la Réunion lors du complot Timagène-Houat. S’ils mirent le pied sur le second îlot englobé dans le port – l’îlot Madame – c’est qu’il contient, outre son phare, la demeure de l’Administrateur de la colonie, et qu’ils désiraient s’assurer que ce fonctionnaire n’avait aucun renseignement à leur fournir au sujet d’Antonin.
De leur visite il résulta clairement que le frère d’Yvonne n’avait jamais atterri dans l’île.
Alors, ils se rembarquèrent, sans même songer à franchir les deux ponts, sur pilotis et bateaux, qui relient l’îlot à la côte.
De nouveau leur pirogue longea le rivage : Ténériffe, Mahambo, Foulepointe défilèrent devant eux. Enfin, une semaine après leur départ d’Antongil, ils se trouvèrent en vue de Tamatave.
Congédiant leurs rameurs, ils contournèrent la ville et gagnèrent le chemin de Tananarive, appelée par les indigènes Antananarivo, c’est-à-dire les mille villages.
Ils allaient escalader les rampes du plateau central par une route qui ne mesure pas moins de trois cent cinquante kilomètres. Route difficile au possible ! Presque partout c’est un simple chemin bordé de précipices, de lacs de boue.
Sur le conseil du courrier, les voyageurs louèrent des filanzanes ou fitacons, litières bizarres du pays.
Sur deux longues perches est installé un siège grossier ; le patient y prend place. Aussitôt quatre porteurs saisissent les extrémités des perches, les posent sur leurs épaules et partent au trot, riant, sifflant. En cinq ou six jours ils effectuent le trajet.
Le voyage se fit rapidement. Parfois on rencontrait un troupeau de bœufs que des agriculteurs conduisaient à la côte pour les embarquer. Alors il fallait s’arrêter et laisser passer la foule beuglante. D’autres fois, c’étaient des soldats escortant la dîme prélevée pour la reine, et durant de longues heures, le défilé coulait lentement devant les jeunes gens enragés par ces retards.
Le pays devenait de plus en plus accidenté. Toute l’ancienne activité volcanique de l’île se décelait dans les amoncellements titanesques des rochers couverts d’une chevelure verdoyante d’arbres, de lianes, de mousses. Le chemin avait alors une altitude de mille mètres, et à la température ardente de la côte avait succédé une fraîcheur relative.
Marcel en était enchanté, car l’ortie zapankare, qui l’avait si malencontreusement piqué, continuait son œuvre : ses mains, ses bras se couvraient de larges plaques rouges, au centre blanchâtre, sur lesquelles la peau commençait à se détacher en bandes sèches. Et quoi qu’en eût dit le Tsimando Roumévo, la douleur était agaçante. La brise plus fraîche calmait en partie la démangeaison, les picotements dont se plaignait le sous-officier.
Le sixième jour, au départ, le courrier annonça à ses amis que vers midi ils seraient à Tananarive. Réconfortés par cette assurance, tous plaisantaient gaiement, quand ils se trouvèrent en présence d’une lamentable caravane.
Une dizaine d’hommes la composaient. Ils empierraient la route défoncée en cet endroit ; mais, détail horrible, chacun avait le col entouré d’un lourd collier de fer, auquel se rattachait une barre de même métal descendant jusqu’à mi-cuisse, et rattachée par un anneau à deux autres tiges rivées à des carcans entourant les chevilles. Tous étaient liés ensemble par leurs colliers. Pâles, hâves, la figure convulsée par la souffrance et le désespoir, ces infortunés travaillaient sous le bâton d’un surveillant.

– Qu’est-ce ? questionna Marcel.
Roumévo secoua la tête.
– C’est la peine à laquelle l’ami dont je te parlais l’autre jour a préféré quelques heures de léproserie. Les fers ! Chacun de ces pauvres diables porte vingt kilos de chaînes ; il travaille toute la journée. Au soir on l’enferme, sans le débarrasser de son appareil, dans une sorte de dortoir. On ne le nourrit pas, et si quelques parents ne lui apportent de quoi manger, il meurt de faim. Alors on lui coupe la tête et les pieds pour le retirer des fers, et les autres continuent à porter l’attirail du défunt.
– Horrible ! murmura le jeune homme. Et pour quelle faute est-on condamné à ce supplice ?
– Pour avoir volé, incendié, commis un faux, conspiré, fait provision de poudre sans autorisation de la reine, insulté celle-ci ou l’un des objets dont elle se sert. Parfois, quand le délit est politique, le condamné obtient une commutation de peine. On le conduit au sommet de la montagne Analamanga sur laquelle est bâtie Tananarive. À la crête même s’élève le palais de la reine, dominant un abîme de trois cents mètres. L’homme s’y précipite et meurt en quelques secondes au lieu de souffrir longuement.
Pendant cette digression criminelle, les porteurs couraient toujours, et à un coude de la route, les Français poussèrent un cri d’admiration. Tananarive était devant eux.
Étagée sur les gradins de la montagne, la ville avait un aspect de civilisation, qui les satisfaisait après leurs pérégrinations dans les contrées barbares. Partout des maisons à l’européenne, et tout en haut, semblant planer sur les constructions vassales, le palais de la reine se découpait dans le ciel bleu.
Avec ses pavillons d’angle, ses balcons, ses innombrables fenêtres, on eût dit un de ces châteaux d’Asie, transporté sur le roc par quelque génie malfaisant des contes des Mille et une Nuits. Même par l’architecture, l’origine malaise des Hovas se trahissait.
Contrairement aux pronostics du courrier, le 25 janvier, à midi, la troupe dut faire halte à deux kilomètres de la ville, dans un vallon verdoyant. Une véritable armée passait sur la route et les filanzanes eussent été infailliblement renversées si les porteurs s’étaient obstinés à remonter le courant.
Tous mirent pied à terre et s’installèrent au bord d’un petit torrent qui bondissait à grand bruit entre les pierres, dont sa route était obstruée. En face d’eux un mur de basalte se dressait, régulièrement stratifié, figurant des colonnes. Une ouverture sombre, sorte de porche haut de dix mètres, creusait un trou de nuit dans la paroi baignée de soleil.
– C’est sans doute une grotte ? demanda curieusement Yvonne.
Roumévo fit « non » de la tête.
– C’est le temple des Bienfaisants.
– Des Bienfaisants ?
– Oui, ceux qui sont chargés de maintenir l’ordre et la prospérité du pays.
– Des esprits ?
– Les prêtres le disent. Chaque année, la reine s’y retirait autrefois et se plongeait dans l’eau claire qui remplissait une baignoire naturelle.
– La fête du Bain, compléta Claude. La reine se baigne, asperge ses sujets avec l’eau que son précieux corps a touchée. Cette cérémonie donne lieu à des bousculades terribles, car les Hovas sont convaincus que celui qui reçoit une goutte du liquide est heureux toute l’année. La chose certaine est que, chaque fois, il y a un certain nombre de bras cassés et de têtes fendues. C’est ce que l’on appelle la cérémonie du bain de la reine.
– Oui, compléta le Tsimando, mais la civilisation a pénétré chez nous. La fête fut qualifiée de sauvage, et maintenant la cérémonie du bain a lieu dans une salle du palais royal.
Yvonne s’était levée.

– Allons voir, dis, Simplet, veux-tu ? Pour la première fois, c’est de son frère de lait qu’elle sollicitait une permission. Depuis le serment du sang, il avait fait un pas dans sa considération.
– Allons, petite sœur.
Roumévo suivit ses compagnons. Tous pénétrèrent dans la caverne sans prendre garde à quelques soldats hovas qui, assis à proximité de l’entrée, jouaient au badok, sorte de jeu d’osselets.
Un phénomène cosmique avait fait tous les frais de premier établissement. Les murailles, aux cristaux étrangement encastrés les uns dans les autres, les colonnes trapues ou les élégantes colonnettes jaillissant du sol au plafond, s’infléchissant en arcades, se ramifiant en nervures, disaient la part du volcan.
Puis l’homme était venu. Semant des ors, des bleus, des rouges sur la pierre, il avait transformé le temple plutonique en œuvre d’art. De la réalité, issue des feux souterrains, il a fait un rêve de poète bercé par le haschich. Et dans le silence de la crypte les jeunes gens marchaient, impressionnés par la répercussion du bruit de leurs pas. Dans la pénombre, un groupe s’agita devant eux. Une voix, trop connue hélas ! résonna à leurs oreilles.
– Té ! disait-elle. C’est beau certainement, mais que d’argent dépensé inutilement, avec lequel on aurait pu faire des affaires !
C’était M. Canetègne qui, arrivé depuis plusieurs jours à Antananarivo, se promenait avec le général Ikaraïnilo.
Apeurée, Yvonne se serra contre son frère de lait. Mais celui-ci, tranquille comme toujours, salua le négociant et d’un air aimable :
– Cher monsieur Canetègne, enchanté de vous rencontrer. Je vous souhaite fortune et mémoire ; mémoire surtout, car il serait bien fâcheux pour vous d’oublier nos petites conventions. Silence pour silence !
L’Avignonnais grommela des paroles que l’on n’entendit pas et s’éloigna avec son compagnon.
À peu de distance Ikaraïnilo l’arrêta :
– Tu es bien un blanc impatient, dit-il. Que t’importent les railleries de ton ennemi ; il vient lui-même se livrer. Sous trois jours la révolution éclatera et, comme tous les Français, toi seul excepté, il mourra. Il rit, il périra.
Cette parodie du mot de Mazarin : « Ils chantent, ils payeront », ne dérida pas le commissionnaire :
– Je voudrais sauver la jeune fille, murmura-t-il.
– Pourquoi ?
– Parce que ses dédains m’ont piqué et que je souhaite l’avoir pour femme. Privée de ses défenseurs, elle serait impuissante à résister à ma volonté.
– La sauver seule est possible ; j’ai des soldats qui m’obéissent aveuglément.
– Seule, bien entendu. Que les deux hommes disparaissent ; eux, je les hais. Quand je songe au mal qu’ils m’ont fait !…
Il serrait les poings, frappait le sol du pied. Ikaraïnilo ricana :
– Toujours rageur. Sois paisible ; il sera fait ainsi que tu le désires.
Tandis que les dignes acolytes conspiraient, Marcel se plantait devant une sorte de grand tableau de basalte poli, sur lequel s’alignaient en creux d’interminables lignes d’écriture.
– Ciel ! fit-il. Les tablettes d’un romancier !
Le courrier, après une révérence profonde au tableau, répliqua :
– C’est la gravure sur pierre du premier code écrit, édicté le 29 mars 1881 par la reine de Madagascar.
– Ma foi, dit Marcel, j’en veux prendre copie. Traduis-moi cela, frère Roumévo.
Et rapidement il écrivit sous la dictée du courrier.
– Maintenant, fit gravement Roumévo sa traduction achevée, venez voir le bain de la reine, puis rejoignons nos porteurs. Les troupes ont sans doute fini de défiler.
Une galerie sinueuse conduisit les voyageurs dans une salle régulière à ciel ouvert. En y pénétrant, ils s’arrêtèrent stupéfiés d’admiration. Les parois verticales, s’élevant à la hauteur d’une maison de cinq étages, étaient littéralement couvertes de figurines en relief, rehaussées des couleurs les plus vives. C’était l’histoire fouillée dans la pierre du Coq blanc, l’oiseau qui porte bonheur et est consacré au géant Derafif, enfant aimé du bienfaisant génie Zanahary.
Au centre, un trou elliptique se creusait dans le sol.
– Le bain ! dit seulement le courrier.
Tous se rapprochèrent.
– Mâtin ! fit Marcel. Elle est profonde, la baignoire ; je comprends que lorsqu’elle est remplie d’eau, on puisse asperger le peuple.
Et par réflexion :
– Mais la reine devait s’y tenir debout ; un mètre soixante de creux au moins.
Avant que personne eût pu prévoir son mouvement, le jeune homme, à l’appui de sa démonstration, sautait légèrement dans la baignoire naturelle.
Roumévo eut un cri d’angoisse. Sa figure se contracte ; un tremblement convulsif le secoue.
– Qu’avez-vous ? demande Yvonne troublée par ces signes de terreur.
Le courrier n’a pas le temps de répondre. De toutes parts des hululements douloureux s’élèvent. Des prêtres, à la tunique blanche agrémentée de vertes passementeries, font irruption dans la salle.
– Fuis ! hurle le Tsimando d’une voix rauque. Tu as commis un sacrilège ; c’est la mort ou les fers à perpétuité.
D’un bond Marcel est hors de l’excavation. Il s’élance, renversant les indigènes qui veulent l’arrêter.
Il gagne le couloir, mais là de nouveaux ennemis le saisissent, le maintiennent et l’entraînent hors du temple.
Éperdus, ses compagnons suivent la meute hurlante des prêtres. Livides, ils se regardent, se reconnaissant à peine sous la lumière crue du soleil. Des lames brillantes étincellent. Marcel va tomber, frappé de mille coups. Roumévo tire son poignard recourbé. Il doit défendre son frère de sang.
Tout à coup un mouvement se produit. Les prêtres reculent avec des hoquets d’épouvante. Ils se montrent les mains du sous-officier, avec les taches rouges, les squames pelliculaires. De leurs lèvres blêmies un mot s’échappe :
– Ourvati !… la lèpre !
Un sourire éclaire le visage du courrier. Il remet son poignard au fourreau et, profitant de la stupeur générale, il vient à Marcel.
– Ils croient que tu as la lèpre.
– Ah !
– Ils te conduiront à la léproserie.
– Moi ! mais c’est horrible ! Je ne veux pas.
– Fais comme mon ami. Moi, je m’emploierai à te sauver.
Les prêtres ont aperçu Ikaraïnilo et ses soldats, les mêmes qui jouaient aux osselets, et auxquels ni Marcel ni ses compagnons n’avaient pris garde. On court à eux ; on les amène.
– Général, conduisez cet homme à la léproserie !
Comme chez tous les peuples où existe encore l’atroce maladie, elle cause aux populations malgaches une sorte de terreur superstitieuse.
Canetègne, flanquant toujours le général, a un ricanement de triomphe. Le hasard le venge cruellement. Yvonne aussi a entendu, compris. Elle veut parler ; Roumévo lui impose silence. Un mot perdrait Marcel que l’on peut encore sauver.
– Allons, suivez-nous ; ordonne au prisonnier le général.
Déjà les soldats l’ont entouré. Brusquement Simplet redevient souriant. Il écarte d’un coup d’épaule le soldat le plus proche, se penche vers le Tsimando. Il lui montre Yvonne et Bérard.
– Je te les confie, dit-il à voix basse ; emmène-les chez toi. Ce soir je serai libre.
Et s’éloignant de Roumévo stupéfait, il reprend sa place au milieu des soldats, et docilement se met en marche avec son escorte.
XI
LA CITÉ DE LA LÈPRE
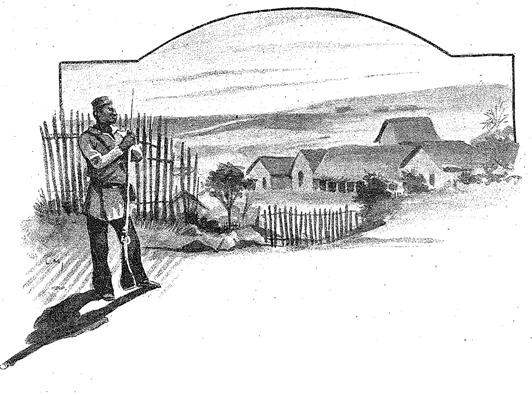
Au lieu de reprendre la route de Tananarive, le prisonnier et ses gardes suivirent la vallée, qui contourne la montagne où la ville est juchée.
Bizarre, cette vallée formée de prairies minuscules, reliées entre elles par d’étroites passes déchirant le massif rocheux.
Tous allaient muets, l’esprit assiégé d’un rêve sombre.
Car il est affreux de se dire : au-dessus de cette île merveilleuse, peuplée d’hommes intelligents, énergiques, parmi les piaillements d’oiseaux multicolores, parmi les parfums des fleurs, un fantôme errant va, cherchant sa proie. Rien ne le désarme, ni les nuits lumineuses, ni le flot voluptueux s’allongeant en une longue caresse sur la grève. Dans les bruissements de la forêt, dans le scintillement d’étoiles, dans les soupirs de la mer, il marche sans trêve, sans repos, acharné à la destruction. Il est le mangeur d’hommes. Il a pour nom : la lèpre !
Les blancs en sont rarement atteints. Une hygiène bien comprise les en défend ; mais les indigènes, les Hovas surtout, sont sa proie favorite. Toutes les mesures prises pour enrayer le mal avaient échoué avant l’occupation française, car la police sanitaire était mal faite. Pour un malade que l’on enfermait dans les léproseries, dix, avec l’aide de leurs parents, de leurs amis, dissimulaient leur terrible affection et devenaient, en se promenant libres parmi leurs concitoyens, de véritables foyers de contamination.
Depuis l’établissement de notre protectorat, et grâce à la surveillance de nos résidents, le nombre des lépreux a sensiblement diminué. L’époque n’est point éloignée où la maladie chinoise – ainsi nommée en souvenir de sa patrie d’origine – n’existera plus à Madagascar qu’à l’état de souvenir.
Il a suffi pour cela de tenir la main à ce que toute personne atteinte du fléau fût séparée du reste des humains. Devoir pénible sans cloute ; le malheureux que l’on interne dans la léproserie entre dans une tombe anticipée, dont il ne sortira que mort ; mais devoir supérieur.
L’escorte avançait toujours. Enfin après avoir franchi un dernier défilé, on atteignit une sorte de cirque fermé de toutes parts par des murailles de granit verticales. Occupant le centre, une agglomération de cabanes entourées de fortes palissades de bois et d’un fossé profond. Ceux qui sont enfermés là doivent perdre tout espoir d’en sortir. Un pont-levis, levé en ce moment, permet seul d’accéder à l’intérieur.
C’était la léproserie. Des factionnaires se promenaient de distance en distance. Alors, Marcel appela Ikaraïnilo.
– Éloigne un peu tes soldats, général, et entends mes paroles.
Le Hova fit ce que le prisonnier demandait. Il ordonna même une halte. Puis se plantant à deux pas du sous-officier.
– J’attends, dit-il.
Le jeune homme cligna des yeux, sourit et débuta ainsi :
– Puisque je devais être arrêté, je suis charmé que ce soit par toi.
– Tant mieux !
– Car toi, tu n’ignores pas que, près de Port-Louquez, au bord d’une tombe profanée, tu as abandonné dans ta précipitation une bêche.
– Peuh ! une bêche ne prouve rien. Tu essayes de m’intimider bien inutilement.
– Très juste, observa Simplet goguenard. Mais tu as oublié également un sac de toile, sur lequel on lit : Ikaraïnilo, xvie honneur.
Le Hova tressaillit.
– Ce sac, continua le sous-officier, ainsi que d’autres preuves recueillies aux environs, sont entre les mains de mes amis. À cette heure, ils sont à Antananarivo et ils les ont mises en lieu sûr.
Puis d’un air engageant :
– Tu serais désolé qu’elles fussent placées sous les yeux de ta souveraine. Moi je n’y tiens pas. Seulement mes compagnons, inquiets de me voir arrêté, m’ont déclaré que, si demain matin je n’étais pas auprès d’eux, ils agiraient.
– Demain ?
– Ils savaient que tu commandes à la léproserie et ils ont pensé sagement que tu ne m’y enfermerais pas.
– Ils ont mal pensé, bredouilla Ikaraïnilo. Ces soldats qui m’entourent sont autant d’espions. Si j’enfreignais la loi, le premier ministre en serait aussitôt informé et ma tête vacillerait sur mes épaules.
– Ah !
Un nuage passa sur le visage de Simplet. Ses regards se fixèrent avec une vague expression d’épouvante sur les palissades enceignant le village des lépreux. Il lui fallait donc pénétrer dans cet enfer !
Mais le petit sous-officier avait l’âme vigoureusement trempée. Bien vite il domina la révolte de sa chair et reprenant l’entretien :
– Soit ! tu vas m’enfermer là. Mais, cette nuit, je m’évaderai avec ton aide.
– C’est également impossible, commença le général.
Marcel l’interrompit impétueusement :
– Prends garde ! Que mes amis ne me voient pas demain matin et tu es sûrement perdu.
La menace troubla le Hova. Ses lèvres eurent un frémissement.
– Comment pourrais-je t’aider ? Des factionnaires veillent autour des fossés. L’unique entrée, ce pont-levis que tu aperçois, s’ouvre seulement pour laisser passer les malheureux atteints de la contagion, ou sortir ceux que le trépas a guéris. Les vivres sont hissés par-dessus la palissade au moyen de cordes et dans des paniers que les captifs brûlent après les avoir vidés.
Marcel riait.
– Tu ne me crois pas ?
– Si ; mais permets-moi une question. Comment êtes-vous avisés des décès qui se produisent ?
– Chaque semaine on ordonne aux malades de se tenir enfermés dans leurs cabanes à une certaine heure. Un de mes lieutenants ou moi entrons dans la cité. Chaque hutte est à claire-voie afin que l’air y circule librement. Il est donc facile de se rendre compte de l’état des habitants. Sur nos indications, des condamnés à mort enlèvent les défunts et les ensevelissent dans ce bois, en face du pont-levis.
Dalvan se frottait les mains :
– Parfait. Je m’évade cette nuit.
– Tu n’as donc pas compris ?
– Au contraire. C’est très simple : cette nuit, vers onze heures, tu fais toi-même la reconnaissance dont tu me parlais.
– Ce n’est pas le jour fixé.
– Cela m’est égal. À onze heures donc, le pont s’abaisse. Je me charge du reste.
– Mais…
– Plus de détours, mon brave général : ma liberté cette nuit ou ta tête demain matin.
On ne résiste pas à certains arguments. Ikaraïnilo céda.
– Soit ! je ferai ce que tu désires.
– Bien.
Et avec un frisson le jeune homme conclut :
– Conduis-moi dans ce village de misère.
Cinq minutes après Marcel franchissait le pont, qui se relevait derrière lui. Il était prisonnier dans la cité de la lèpre.
Cependant le général fort soucieux s’éloignait avec sa troupe. Canetègne marchait à ses côtés, très intrigué par sa longue conversation avec le Français. Il attendait une explication ; elle ne vint pas. Il dut se décider à la provoquer. À sa première question, le Hova répondit par le récit de ce qui venait de se passer. On juge de la colère de l’Avignonnais.
– Et tu vas obéir à ce drôle ?
– Sans doute. Il s’agit de sauver ma tête. Au surplus, qu’il s’évade cette nuit, il n’échappera pas aux coups du peuple révolté. C’est quarante-huit heures d’existence que je lui donne en échange de ma sécurité.
Il s’arrêta. Le commissionnaire secouait la tête.
– Tu protestes ; ce n’est pas juste. Voyons, parle, que pouvais-je faire ?
– Oh ! tu n’avais qu’à exaucer ses vœux.
– Tu le reconnais ?
– Oui. Mais rien ne t’empêche de lui ménager une surprise pour ce soir.
Le général regarda son associé en face :
– Il faut qu’il soit réuni à ses amis avant le jour, sinon…
– Au diable ! tu as raison.
Canetègne habitait un pavillon dépendant du palais d’Ikaraïnilo. Il rentra chez lui furieux, et seul donna carrière à sa mauvaise humeur.
– Cet imbécile de général se sauve ! grommelait-il. Mais il embrouille ma situation. Libre, ce Marcel est bien capable de quitter la ville avant que la révolution éclate, et alors cela me fait une belle jambe, leur révolution ! On massacre tous les Français, hormis ceux qui me sont nuisibles.
Et, le sentiment du danger aidant, l’homme d’affaires se sentit devenir patriote.
– C’est absurde de laisser occire tous les Français. La base de ma fortune est la commission coloniale ; si nos colonies se séparent de la métropole, plus de commission. Je serais donc l’artisan de ma ruine !
Cette idée l’exaspéra davantage.
– L’ennui, voilà. Ce damné Marcel et sa sœur de lait connaissent mes relations financières avec les trépassés, sans cela la chose marcherait toute seule. Ce soir, une fois Ikaraïnilo parti, j’emmènerais vers la léproserie quelques soldats, qui ne demanderaient pas mieux que de tuer le lépreux évadé. Et d’un. Seulement les deux autres dénonceront Ikaraïnilo et moi du même coup. C’est dommage. Quelle belle balle à jouer ! Une occasion unique d’attraper la décoration. Aller trouver le résident général, l’aviser de la conspiration ourdie par les Hovas. Honneur et patrie ! Va te faire lanlaire ! Yvonne et Claude parleront.
Il eut un geste violent, puis se calmant soudain :
– Mais non… Cela n’est pas certain du tout ; en parlant, ils se livrent eux-mêmes. Oui, mais pour venger leur ami… C’est un cercle vicieux.
Tout à coup il se frappa le front :
– Je suis bête !… Qu’est-ce que cela me fait qu’ils parlent, si j’ai pris les devants ? Je n’y songeais pas. Comme on est obtus parfois ! J’écris au résident : je m’accuse d’avoir aidé Ikaraïnilo à violer une tombe ; si j’ai commis ce sacrilège, c’était pour découvrir les rouages de la conjuration. Pour la gloire de son pays, que ne ferait-on pas ! Eurêka !
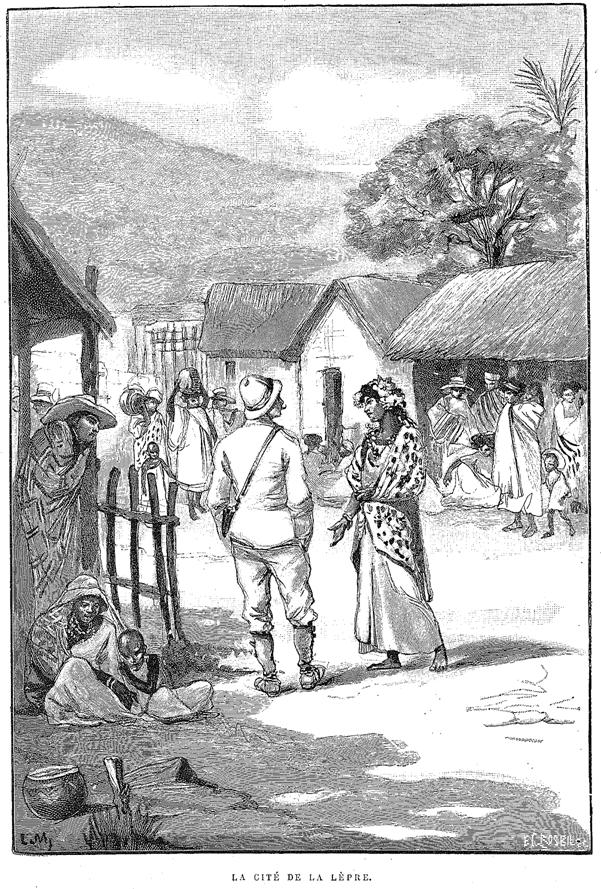
La face illuminée, M. Canetègne s’installa devant une table, et sur une feuille de papier traça, d’une magistrale écriture, ces mots :
« À Son Excellence Monsieur le Résident général de la République française, à Tananarive. »
Il exultait, et il lui faut rendre cette justice, il trahissait son associé hova avec la même désinvolture qu’un compatriote.
Tandis que l’Avignonnais ourdissait sa trame, Marcel, angoissé, parcourait le village des lépreux. La vaste enceinte était pleine d’animation. Dans les avenues, sur le seuil des cabanes bien alignées, la population vaquait à ses occupations. Des hommes passaient munis, qui d’un balai, qui d’une brouette ; d’autres arrosaient les gazons. Les femmes travaillaient aussi, épluchant des légumes, façonnant des plats artistement découpés dans des feuilles de ravenala, débarbouillant les enfants.
Le jeune homme fut surpris. Autour de lui il sentait le mouvement d’une ville de vivants. Mais la réalité le prit aux yeux. Les faces marbrées, tuméfiées, les yeux louches, les traits bouffis d’œdème indiquaient que tous étaient condamnés.
Son arrivée fit sensation. Les mains dans les poches, il se promenait, et derrière lui un groupe de badauds se formait.
– Quel est celui-là ? se demandaient-ils.
Avec son teint rose, sa mine fraîche, ses yeux clairs, le nouveau-venu ne pouvait être un malade. Alors que venait-il faire en ce lieu ? On ne rend pas visite à ceux qui ne sont déjà plus.
Au premier rang une jeune fille, à la peau dorée, fixait sur le sous-officier le regard triste de ses yeux noirs. Elle rayonnait de beauté ; la maladie à sa première période était encore localisée.
Le mal n’avait attaqué que le bras droit, marqué d’une large tache blanchâtre. Drapant son lamba bleu, arrangeant les fleurs piquées dans sa chevelure – presque toutes les femmes étaient ainsi ornées, l’amour de la parure survivant en dépit du mal – elle tâchait d’attirer l’attention du nouveau venu.
Marcel allait toujours, la poitrine serrée par l’angoisse de ce qu’il voyait.
Assise devant sa porte, une femme coiffait un baby ; elle lui sourit. Jeune et déjà hideuse, la face grimaçante, l’œil gauche demi-rongé, elle lui tend l’enfant, gentil, mignon, potelé, l’œil étonné comme les idoles égyptiennes ; il semble bien portant, mais sur la jambe, un peu au-dessus du genou, se montre une tache rosée de la grosseur d’un pois. Le stigmate de la lèpre !
Le sous-officier a vu. Une immense pitié lui serre le cœur. Ce tout petit déjà marqué par le fléau le bouleverse. Il étend les mains en avant comme pour repousser l’affreuse vision. Un murmure satisfait part du groupe de badauds. Ils ont aperçu les plaques dont les mains de Marcel sont marbrées. Ils s’éloignent ; celui-là est des leurs.
Seule, la jeune fille demeure. Ses yeux douloureux ont une lueur. Elle s’élance dans les traces de Simplet, qui s’en va très vite, haletant.
Et tout à coup, à l’oreille du prisonnier, dominant les bourdonnements dont elle est assourdie, une voix pure, cristalline, résonne ainsi qu’une harmonie :
– Frère, dit-elle, Rara Houva te salue.
Le jeune homme tressaille. Ce timbre si pur dissipe ses noires visions. Avec reconnaissance il se tourne vers celle qui a parlé. Enfin il a sous les yeux un visage humain.
Mais son regard se porte sur le bras de la pauvrette. La marque hideuse étend son disque sur l’épiderme doré. L’horrible angoisse étreint de nouveau Marcel, et sans pouvoir parler, ressaisi plus impitoyablement par l’horreur de ce qui l’entoure, il reste immobile, les prunelles fixées sur la trace odieuse du fléau, souverain maître de la bourgade des lépreux.
La jeune fille se méprend à ce silence. Une teinte rosée s’épand sur ses joues ; dans ses longs cils perle une larme ; et d’une voix plaintive, hésitante, elle répète :
– Frère, Rara Houva te salue !
Dalvan se sent ému. La pitié lui donne la force de dominer ses nerfs. Ses lèvres tremblantes répondent :
– Je te salue, Rara Houva !
Le visage de la malade s’éclaire. Ainsi qu’une brume légère chassée par le vent, le chagrin cesse de planer sur ses traits juvéniles. Le sourire refoule les pleurs prêts à jaillir. Elle se rapproche du Français.
Ses paupières s’abaissent, étendant sur ses joues brunes la frange sombre de ses cils, et doucement, dans une sorte de gazouillis hésitant, elle dit :
– Écoute, frère. Ne m’interromps pas. La gazelle a envie de fuir, mais elle est retenue parce qu’elle sait ses heures comptées. Je suis belle aujourd’hui. Dans un an le mal terrible me fera laide, et puis, quelques mois plus tard, viendra la seconde des adieux sans retour !
Elle parlait simplement, sans trouble, de cet avenir menaçant. Et Simplet écoutait. Rara Houva reprit :
– Qu’importe le temps si, durant une seconde seulement, on a connu le bonheur ?
Comme Dalvan esquissait un geste :
– Ce bonheur, il est à portée de notre main.
Puis très vite, comme pressée de dire toute sa pensée :
– Mon père est ministre de la reine ; il est 27e honneur. J’étais son enfant préférée, mais maintenant il ne me verra plus. Il serait heureux, j’en suis sûre, de m’accorder la joie suprême que je solliciterais de lui.
– Que puis-je à cela ? hasarda le sous-officier, bouleversé par l’étrangeté de la scène.
– Tu peux tout, frère, car c’est sa volonté que je confirme être la mienne.
Sans laisser à Simplet le loisir d’exprimer son étonnement, elle poursuivit avec cette poésie troublante des êtres condamnés au hâtif trépas :
– Ainsi que moi, frère, tu es voué à la mort cruelle. Vivant, tu portes le germe des tortures. Un cycle d’épouvante nous environne. Eh bien ! mets ta main dans la mienne. Jetons des fleurs sur notre détresse, chantons dans le sépulcre ; du malheur sans bornes tressons la chaîne infinie des félicités.
Elle s’arrêta, respira longuement ; enfin elle acheva très bas :
– Frère ! sois mon époux.
De la tête aux pieds, Dalvan frissonna. Au-dessus du front courbé de l’infortunée, il crut voir apparaître le spectre hideux du funèbre faucheur ricanant à l’agonisante qui osait songer à l’hyménée, à la marche triomphante et blanche des fiancées. Son cœur battait par brusques soubresauts. Que répliquer à cette enfant qui le jugeait, ainsi qu’elle-même, captif en la cité fatale jusqu’à l’heure dernière ?
– Dis un mot, fit-elle encore. Je parlerai à l’instituteur.
– L’instituteur, bégaya le sous-officier. Il y a un instituteur ici ?
– Oui. Il transmettra ma prière à mon père, et sous trois jours, nous pourrons être unis.
– Il transmettra ? dis-tu. Est-il donc libre de sortir ?
– Non pas. Il s’est enfermé ici volontairement pour instruire les enfants, nous consoler tous, il n’est point atteint par le mal. Aussi il peut écrire ; ses lettres sont acceptées au dehors.
Puis souriante :
– Consens, je t’en prie, frère. Comprends que l’un près de l’autre nous vaincrons le désespoir. Vois-tu ! le maître m’a appris qu’au pays des blancs, bien loin, par delà les mers, il existe un insecte dont l’existence entière est enfermée dans quelques minutes.
– L’éphémère.
– Tu l’as nommé, frère.
Et douce, insouciante, persuasive :
– Accepte. Quitte ce visage grave. Pourquoi pleurer sur nous ? Nous sommes des éphémères, voilà tout.
Ses grands yeux imploraient. Marcel n’osa la dissuader. D’ailleurs pour le faire, il eût été forcé de lui dire la vérité. Il répondit par un geste vague, et, joyeuse, elle le quitta avec ces mots :
– Je parlerai au maître. Avant trois jours il aura la permission du gouvernement.
Dalvan, navré, poursuivit sa promenade. Comme il passait devant la maison d’école, il vit un homme qui parlait à une fillette de cinq ou six ans, couverte d’un long sarrau de calicot à raies jaunes et blanches. Debout devant un tableau noir, l’enfant écrivait avec un bâton de craie.
Le sous-officier s’avança. L’instituteur leva la tête, aperçut Marcel et lui adressa un regard plein de douceur. Le promeneur comprit. Il se trouvait devant celui dont Rara Houva lui avait parlé, devant ce héros obscur qui avait sacrifié sa vie pour instruire les lépreux. Il le salua respectueusement et alla plus loin. La journée lui parut interminable. Chaque minute apportait une horreur nouvelle. Il était pris de vertige au milieu de la foule. Partout des épidermes fendus, des tumeurs éclatées, des ongles noircis et presque détachés. Tous les tableaux de lumière, de joie, de famille parodiés par des êtres faits de hideur. Jamais dans ses imaginations les plus folles, dans ses ivresses les plus pesantes, aucun peuple ne rêva aussi épouvantable cauchemar. À cinq heures, le prisonnier eut un instant de détente. Un ordre avait été jeté du dehors par-dessus la palissade, et un héraut le proclamait par la cité. Les habitants étaient invités à s’enfermer chez eux à partir de dix heures, le général Ikaraïnilo devant visiter l’enceinte. Le Hova tenait sa promesse, et Dalvan lui en sut un gré infini. Il allait fuir, quitter ce lieu de désolation ! Et avec un tremblement de terreur, il murmurait :
– S’il avait manqué à son engagement aujourd’hui ; demain il aurait été trop tard. Je serais devenu fou !
À l’heure prescrite, il se retira dans une case libre ; mais lorsque tout bruit se fut éteint, il se glissa dans la rue et, rampant le long des murs, il gagna le pont-levis. Son cœur battait avec violence, mais la gaieté lui revenait. Enfermé dans un des cercles de Dante, il remontait vers la clarté du jour.
Tapi contre le tablier vertical de l’étroite passerelle, il tendait l’oreille au moindre bruit, n’entendant encore que le pas régulier du factionnaire qui, de l’autre côté du fossé, accomplissait sa garde.
– Ce soldat me gênera, pensa Marcel. Il s’agit de le rendre inoffensif.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikaraïnilo, précédant une dizaine de ses guerriers, pénétrait à cette heure dans le cirque où s’élève la léproserie.
Entre les files des soldats, des hommes chargés de fers portaient péniblement des civières. C’étaient les condamnés qui allaient procéder à l’enfouissement des trépassés.
À chacun de leurs mouvements, ils rendaient un cliquetis sinistre. Cependant dans leurs yeux aucune crainte. La contagion n’était pas pour les effrayer. Le sacrifice de leur existence était fait. N’ayant plus rien à attendre de ce monde, ils considéraient la mort comme une amélioration de leur sort.
Dans le petit bois, cimetière où dormiront tous ceux que la cité de douleur enferme dans ses palissades, la troupe s’arrêta et le général continua sa marche vers l’entrée. Presque aussitôt, une ombre accroupie derrière un buisson se redressa et courut aux guerriers. Sous la lune claire, le visage du nouveau venu apparut, gras, rond, auréolé de cheveux blonds, rares au sommet de la tête. M. Canetègne commençait à mettre son plan à exécution. Dans les traces du Hova, il avait quitté Tananarive, évitant de se faire voir.
Les soldats sautèrent sur leurs armes, mais reconnaissant l’ami de leur chef, ils reprirent leur attitude de repos.
Très vite, l’Avignonnais leur expliqua que le blanc arrêté dans la journée devait tenter de s’évader. Il avait appris la chose à l’instant. Il avait couru pour rejoindre Ikaraïnilo. Trop tard il arrivait, puisque le Hova entrait en cet instant dans le village des lépreux, assez tôt cependant pour les avertir et les mettre à même de frapper sans pitié le malade récalcitrant.
Un murmure de colère accueillit ce discours.
Canetègne se frotta les mains – tic familier indiquant chez lui l’intérieure jubilation. Évidemment Marcel allait passer un mauvais quart d’heure.
Le général était arrivé près du pont-levis. Correctement, le factionnaire lui rendit les honneurs, puis, déposant à terre son remington, baïonnette au canon, il saisit la poignée de la manivelle servant à manœuvrer du dehors le tablier mobile. Absorbé, les yeux baissés, Ikaraïnilo attendait. Une anxiété indéfinissable pesait sur lui. Il tournait sa consigne, risquait sa vie et sa fortune ; les morts malgaches dépouillés par lui avaient trouvé un vengeur.
Et ce vengeur, ce Français maudit, qu’allait-il faire ?
S’il avait levé les yeux, il aurait, certes, poussé un cri de stupeur.
Le pont descendait lentement.
Dépassant le bord des planches, une tête railleuse se montrait. C’était Simplet qui riait en découvrant ses dents blanches.
Lassé d’attendre, s’aidant des chaînes, il avait grimpé sur la passerelle. De cet observatoire, il avait suivi tous les mouvements de ses ennemis.
D’abord, à l’apparition de l’escorte, une grimace de mécontentement crispa ses traits, puis il murmura :
– Au fait, ce sera plus drôle.
Et maintenant, allongé sur les planches, il se rapprochait peu à peu.
Penché sur la manivelle, le soldat ne se doutait de rien. Il tournait la mécanique d’un air lassé, ses gestes rythmés par le décliquement de l’engrenage. Le pont était à un mètre de terre quand Marcel s’enleva brusquement à la force des poignets et tomba à cheval sur les reins du guerrier.
Renversé par le choc, celui-ci n’eut pas le loisir d’appeler. Bâillonné, ligoté avec les cuirs de son fourniment, il roula, demi-assommé, dans le fossé. Et Dalvan, ramassant son remington, se planta devant le général ahuri :
– Voilà !
Mais des cris gutturaux déchirèrent l’air ; l’escorte avait tout vu de loin. Sur la lisière du bois, les soldats se montraient ; ils accouraient brandissant leurs armes.
– Toi, dit Simplet à son compagnon, à la manivelle, remonte le pont.
Le Hova, déconcerté, exécuta l’ordre du jeune homme, tandis que ce dernier, d’un pas alerte, marchait à la rencontre de ses adversaires.
La lune versait des torrents de rayons argentés sur la prairie. Il faisait clair comme en plein jour. À portée de la voix, Simplet fit halte.
Amoureusement, il passa ses mains sur la baïonnette, et d’un ton de commandement :
– Halte et demi-tour ! cria-t-il.
Les guerriers hésitèrent, surpris.
– La lèpre me dévore, reprit le Français ; au contact de ma peau, ma baïonnette s’est empoisonnée, celui que la lame égratignera est perdu.
Avec une énergie sauvage, il clama :
– En avant !
Et il fonça sur les guerriers. Ce fut un sauve-qui-peut général.
Ces soldats, fort braves, en somme, s’enfuirent comme des lièvres devant la menace de la lèpre. Dans leur déroute, ils entraînèrent les condamnés qui abandonnèrent leurs civières, et tous, hurlant, se poussant, troupeau aveuglé par la panique, disparurent bientôt au loin.
Dalvan se tenait les côtes ; subitement il redevint grave.
– Ce n’est pas le tout de rire, prononça-t-il entre haut et bas, il faut tâcher de sauver mes compatriotes menacés. Je ne saurais trahir moi-même la confiance de mon frère de sang Roumévo. Je lui ai promis le silence, mais Ikaraïnilo parlera pour moi.
Il revint au général, qui, sa besogne terminée, promenait autour de lui des regards effarés.
– Ikaraïnilo, tu vois cette baïonnette ? elle donne la lèpre maintenant que je l’ai touchée : si tu me désobéis, je te frappe !
Tremblant, pris de la même terreur que ses subordonnés, le Hova bégaya :
– Qu’exiges-tu de moi ?
– Ordonne d’abord aux factionnaires voisins qui se rapprochent de retourner à leur poste.
Et, la chose faite :
– À présent, conduis-moi au palais du Résident général.

XIII
À LA RÉSIDENCE[1]
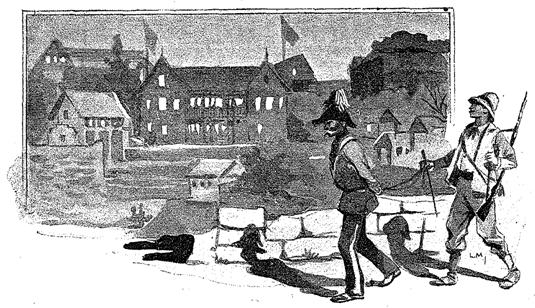
Le général se fit prier. Mais de la logique des faits, il résultait qu’il était l’esclave de Marcel. Aussi bientôt il se rendit et se mit en marche, suivi, à longueur de fusil, par le Français.
Au bout d’une demi-heure, tous deux passaient entre les tours de brique qui défendent la « Porte dite de Tamatave » et s’engageaient dans les étroites ruelles de la ville.
Ruelles ne donne pas une idée de ce que sont ces sentiers établis au bord des gradins de granit sur lesquels Antananarivo se développe en étages. Sinueuses, encombrées de pierrailles, côtoyant des ravines et des précipices, elles sont les voies de communication les plus incommodes que l’on puisse voir. Le peuple qui les a établies semble avoir joué la difficulté.
Afin d’ôter à son guide et prisonnier toute envie de fuir, Dalvan le débarrassa du mince baudrier au bout duquel ballottait son sabre, lui attacha les poignets et conserva en main l’extrémité de la lanière de cuir. Durant cette opération, le général se lamentait.
Les doigts du sous-officier avaient effleuré son épiderme, et il gémissait :
– Tu me communiques la lèpre.
– Tais-toi ! ordonna Simplet. Tu n’es pas sûr d’être malade ; mais si tu geins encore, tu peux être certain que je t’embroche.
– Ah ! maudit soit le jour où les méchants esprits m’ont jeté sur ta route !…
Un coup de crosse coupa la parole au malheureux Hova, qui repartit, tenu en laisse par Marcel.
Tout en avançant avec précaution, il maugréait in petto. En somme, son mécontentement était excusable : un général, habitué à parler en maître à ses soldats, réduit tout à coup à l’état de chien d’aveugle ! La métamorphose n’avait rien de récréatif.
De détours en détours, les promeneurs atteignirent la rue Centrale, large voie allant du bas de la montagne au palais de la reine. Là encore, Dalvan fit halte.
Passant son fusil en bandoulière, après avoir retiré la baïonnette, il prit celle-ci de la main droite, détacha son captif et lui passa amicalement la main gauche sous le bras.
– Dans cette grande avenue, dit-il, on peut rencontrer du monde. Il est inutile que l’on s’attroupe autour de nous. En avant ! mon gros Hova. Tu sais que ma baïonnette te menace !
Certes, Ikaraïnilo ne considérait la lame triangulaire qu’avec un respect voisin de l’effroi, mais le contact de son compagnon lui causait une répugnance aussi grande. Il eut une velléité de résistance.
Une bousculade le calma sur-le-champ. Il se soumit encore. Après tout, en rentrant chez lui, il se ferait désinfecter, brûlerait ses habits, de façon à se débarrasser de toutes souillures.
L’ascension commença.
L’avenue centrale est une succession de paliers et de pentes raides, qui ne présentent qu’une lointaine ressemblance avec nos rues les plus accidentées.
Enfin les deux hommes débouchèrent sur la place d’Andohalo, où se tiennent les kabars et les foires de Tananarive. À leur droite s’élevait une construction d’aspect élégant.
– La Résidence, prononça le général.
Tenant le bras de son captif, Dalvan lit une courte station. Toutes les fenêtres étaient brillamment éclairées, et les accords d’un orchestre passaient dans l’air en bouffées joyeuses.
– Ah çà ! on danse’?
Le Hova ne répondit pas. En regardant mieux, on apercevait dans l’ombre une foule grouillante, plèbe tananarivienne prenant sa part de la fête.
– Arrive ! et surtout pas un mouvement pour t’échapper.
Sur cet ordre, entraînant son compagnon, Simplet fendit le flot de curieux et parvint auprès du factionnaire qui gardait la porte.
– Camarade, où est le chef de poste ? demanda-t-il.
Le soldat sourit en entendant la langue maternelle.
– Sous le porche, à gauche.
– Bien !
Quelques pas encore et le jeune homme se trouva devant un sous-lieutenant, commandant la garde du Résident.
– Mon lieutenant, commença-t-il, l’homme qui m’accompagne est mon prisonnier. Il faut que tous deux nous voyions Son Excellence le Résident sur l’heure, car nous avons à lui apprendre des choses si graves que tout retard mettrait en danger, non seulement la vie des Français établis dans l’île, mais encore la domination de la France elle-même.
L’officier esquissa un geste d’incrédulité.
– Croyez-moi, mon lieutenant. En septembre dernier, j’étais sergent en activité. Si je vous trompais d’ailleurs, il vous serait aisé de me punir.
Il parlementa et déploya tant d’éloquence que le chef de poste se laissa persuader. Il conduisit Marcel et le Hova dans un salon d’attente.
– Restez là. Je préviens le Résident.
– Sans attirer l’attention des invités, je vous en prie, recommanda encore Dalvan.
Le lieutenant inclina la tête et sortit. Simplet était ravi. Mais le sentiment d’Ikaraïnilo paraissait tout autre. Les sourcils froncés, la tête basse, il ne bougeait non plus qu’un terme. Un rictus farouche tirait ses lèvres, découvrant ses dents aiguës noircies de laque, selon l’usage hova.
– Général, tu peux t’asseoir, fit malicieusement le sous-officier en lui avançant un siège.
À ce moment la porte s’ouvrit, et dans l’encadrement un homme d’une cinquantaine d’années, grand, à la figure bonne et énergique, élargie par des favoris gris, se montra. Marcel rapprocha les talons et salua militairement :
– Vous avez demandé à me parler, dit lentement le nouveau personnage.
– Pardon, Excellence, il y a erreur.
– Erreur ?
Le Résident eut un regard sévère.
– Parfaitement, continua le jeune homme sans se troubler. J’ai sollicité la faveur d’une audience, afin de faire parler ce singe que je vous présente.
Et pointant sa baïonnette vers le Hova.
– Lève-toi devant Son Excellence. Bien… Monsieur le Résident, je vous amène Ikaraïnilo, 16e honneur, général chargé de la surveillance de la léproserie.
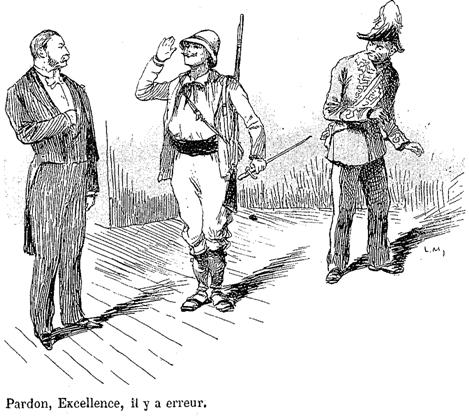
Il fit une pause, puis avec un accent si profondément gouailleur que le représentant de la France à Madagascar comprit qu’il se jouait devant lui une comédie dont la clef lui manquait, il termina :
– La léproserie d’où je sors – il étendit ses mains en pleine lumière. – Vous le voyez, j’ai les mains en triste état… La lèpre, Excellence, l’affreuse lèpre !
Il tournait le dos au général et montrait au résident un visage souriant, qui contrastait avec ses paroles lamentables. Changeant de ton :
– Excellence, veuillez prendre place. Ce que va vous apprendre mon compagnon est d’une importance capitale, et peut-être…
– Je reçois ce soir et ne puis vous donner longtemps… Le premier ministre Rainilaiarivony est au nombre de mes invités.
– Lui ! s’écria Dalvan, vraiment c’est une chance !
– Que voulez-vous dire ?
– Vous allez comprendre, Excellence.
Et revenant au général, la baïonnette menaçante :
– Ikaraïnilo, ordonna-t-il d’une voix grave en scandant bien ses paroles, raconte à M. le Résident de quelle façon les Français doivent être égorgés, au signal qui partira du palais de la reine.
Il s’interrompit. Le plénipotentiaire était près de lui, les yeux étincelants :
– Quels mots avez-vous prononcés ?
– Ceux qui expriment la vérité… N’est-ce pas qu’elle est intéressante ? Mais vos minutes sont brèves… Hâtons-nous… Allons, général, parle.
Le Hova leva ses paupières, un défi dans le regard.
– Non, articula-t-il nettement.
– Non ?
– Non.
– Alors, une piqûre !… Une simple piqûre…
Et brandissant son arme, Dalvan fit mine de transpercer son adversaire. Celui-ci poussa un cri étranglé.
– Non, pas cela, pas cela !
– Parle donc.
– Oui, je parlerai.
Ses velléités de résistance étaient vaincues. La lame empoisonnée qui miroitait devant lui en avait eu raison.
Le Résident assistait à la scène, sans la comprendre ; mais sa sympathie était pour le jeune allié qui lui apportait la preuve du complot. Dans son cerveau un travail rapide se faisait. Il n’avait rien appris des préparatifs homicides du gouvernement hova. Quelle responsabilité eût injustement pesé sur lui devant l’histoire, si les Malgaches, imitateurs inconscients des Siciliens, avaient eu leurs vêpres madécasses !
Maté, Ikaraïnilo parlait :
– Après-demain, à la nuit, une fusée verte s’élèvera au-dessus du palais. De montagne en montagne le signal sera répété, portant à tous les soldats l’ordre de courir sus aux Européens. Les troupes, cantonnées à peu de distance, marcheront sur Antananarivo ; des réserves de poudre et de plomb remplissent les caves du palais. Elles seront distribuées aux guerriers.
Le Résident tira le cordon d’une sonnette. Le lieutenant entra aussitôt.
– Lieutenant, commanda-t-il, faites prier le premier ministre de me rejoindre ici. Avec quatre hommes vous vous tiendrez prêt à venir à mon premier appel. Que nul ne sorte de cette habitation.
L’officier s’éloigna pour exécuter ces ordres.
– Le premier ministre ! gémit le général, je suis perdu !
– Non pas, riposta vivement Marcel. De ce jour, tu es protégé Français. Je suis certain que Son Excellence ne me contredira pas.
– Et vous avez raison.
Ikaraïnilo parut soulagé d’un poids énorme. Décidément le faux lépreux avait du bon, puisqu’il veillait à la sûreté de ceux qui servaient ses desseins.
La porte se rouvrit, livrant passage au premier ministre malgache Rainilaiarivony. Grand, maigre, le crâne dénudé, le visage sillonné d’innombrables rides, l’œil inquiet, fuyant, le grand dignitaire était revêtu d’un uniforme couvert de broderies, de décorations.
– Qu’est-ce donc ? vous me demandez en grand mystère, mon cher Résident ?
Sa voix aigrelette sonna faux dans le silence.
– Il se passe des choses graves, répliqua froidement le plénipotentiaire français.
Le ministre leva au ciel ses bras maigres.
– Des choses graves ! Aurait-on molesté quelqu’un de vos protégés ? Dites-le. Justice sera faite.
Un sourire éclaira le visage du Résident :
– Je suis heureux de vous entendre parler ainsi.
– J’ai donc deviné juste ?
– Presque…
– Je ne saisis pas bien…
– Pourquoi je dis presque ? Je m’explique. Ce n’est pas un de mes protégés qui est menacé, mais tous mes protégés de Madagascar et la France elle-même, dont je suis le représentant.
Les paupières de Rainilaiarivony papillotèrent, son regard parcourut la salle avec l’expression effarée d’un renard traqué. Mais déjà le Résident barrait la porte, et Marcel, appuyé contre la fenêtre, jouait avec la baïonnette de son remington.
Le Malgache essaya de ruser. Ses mains se serrèrent, sa physionomie prit le masque de la stupéfaction.
– Que me contez-vous là ? fit-il, les Français courraient un danger ?
– Terrible. Demain à la nuit, la population se levant en masse doit les assaillir traîtreusement et les anéantir.
L’accusation était nette ; mais il est dans le caractère hova de mentir.
Le dignitaire haussa les épaules.
– Contes à dormir debout. La population n’agirait que sur l’ordre de sa reine et…
– Et le mouvement a été préparé par la reine et par celui qui, d’après la Constitution, est forcément son mari. Vous, monsieur le premier ministre.
– Moi ?
– Vous-même.
– Et vous croyez cela ?
Le Résident ne répondit pas tout de suite. Rainilaiarivony se figura qu’il hésitait :
– Non, vous ne le croyez pas. C’est tellement absurde de penser que nous, qui aimons les Français et vous particulièrement, nous allons vous tendre un guet-apens… C’est un fou, ou un malheureux ivre de vin de palme qui vous a fait ce rapport. En toute autre circonstance, je mépriserais pareil adversaire, mais cette fois, l’allégation est trop grave ; il faut qu’il soit puni. Amenez-le en ma présence, que je le confonde…
Sur un signe du Résident Marcel s’avança :
– Ce misérable est présent, c’est moi, et il vous défie de le confondre.
Le Hova s’était arrêté court au milieu de sa tirade. Ses paupières tremblotaient de plus en plus…
– Quoi ! c’est vous qui ?…
– Moi-même.
– Mais cette comédie est odieuse, clama Rainilaiarivony, s’adressant au Résident. J’accepte votre hospitalité. J’entre dans votre maison, aussi confiant que si elle était mienne. Et vous, que je croyais mon ami, vous auquel j’étais lié d’affection comme l’eau et le riz…
La comparaison malgache, la plus haute expression de l’amitié puisque le riz croît et cuit dans l’eau, fit long feu.
– Vous soudoyez des aventuriers pour m’insulter, continua le sec personnage, et vous pensez que je mettrai ma parole en opposition avec celle de cet individu ? Détrompez-vous. L’injure part de trop bas pour que je daigne me défendre.
Dalvan avait interrogé son supérieur du regard. Celui-ci fit un mouvement de tête qui pouvait s’interpréter :
– Allez !
Aussitôt, le sous-officier s’inclina, et d’un ton respectueusement ironique :
– Vous vous méprenez, monsieur le premier ministre, on ne vous demande pas de vous défendre.
– Ah bah !
– Ce serait trop difficile. Il vous sera plus aisé de vous accuser.
– Leno-Reno ! gronda le Malgache.
– Cela veut dire ? interrogea Simplet.
– Drôle !
– Fort bien. Le plus drôle des deux ce sera vous, quand vous avouerez votre petite combinaison assassine.
– Avouer cela, moi ? jamais !
– Jamais… Serment d’amoureux, cela n’a aucune valeur politique. Voyons, voulez-vous, oui ou non, vous exécuter ?
Rainilaiarivony haussa les épaules, mais étendant une main menaçante vers le Résident :
– Monsieur, dit-il, je me plaindrai à votre gouvernement. Je doute qu’il approuve les procédés dont vous usez.
– Il fait le malin, interrompit Marcel, cela ne durera pas longtemps. Il parlera.
– Comment ?
C’était le Résident, quelque peu inquiet des suites de l’aventure, qui posait la question.
– Vous allez voir. C’est simple comme bonjour.
Et en aparté :
– Quand un truc est bon pour des soldats et des généraux, il ne peut pas être mauvais pour un Ministre.
Sur ce, il fit un pas vers l’accusé et lui mit ses mains sous les yeux. Aussitôt l’effet accoutumé se produisit. L’époux de la reine poussa un cri et, la face convulsée par le dégoût, se jeta précipitamment en arrière.
– Bon, déclara le sous-officier, premier point acquis : j’ai la lèpre ; second point, faites bien attention. Je mets ma baïonnette en contact avec mes plaies. Ceux qu’elle blessera seront sûrement la proie du fléau… Ceci posé, monsieur le ministre, je vous enferme dans ce dilemme : ou bien vous garderez le silence et je vous embrocherai, ou bien vous parlerez et vous éviterez la lèpre.
Négligemment il se rapprochait de Rainilaiarivony terrifié.
– Grâce ! bredouilla celui-ci.
– Volontiers, avouez.
Puis faisant osciller la lame aiguë, ce qui provoquait de la part du Malgache les plus amusantes contorsions :
– Je vais vous aider. Est-il vrai que, sur votre ordre, les milices hovas mobilisées sont réunies à peu de distance de la ville ?
Le ministre grinça des dents, il se ramassa comme pour bondir sur son interlocuteur, mais la baïonnette s’approcha de sa poitrine.
– Oui, fit-il d’une voix rauque.
– Bien. Est-il vrai que le signal de la destruction des Français doit partir du palais ?
– C’est vrai.
– Que ce signal est une fusée verte ?
– Oui encore… Ah ! qui donc nous a trahis ?
– Que les caves sont bondées de poudre et de balles pour les soldats ?
– Oui.
– À la bonne heure. Reposez-vous – et souriant au Résident qui écoutait – Vous le voyez, Excellence, mes renseignements sont exacts.
Le représentant français hocha la tête d’un air songeur.
– Oui, murmura-t-il, comme se parlant à lui-même, le complot est évident. Il n’aura pas lieu à la date fixée, mais dans quelques semaines il éclatera soudain. Comment réduire ces gens à l’impuissance ?
– C’est bien simple.
Il leva la tête. Dalvan était auprès de lui, les lèvres encore ouvertes du passage de son axiome favori.
– Votre Excellence veut-elle me continuer sa confiance pendant cinq minutes ?
– Ma foi, au point où nous en sommes, il y aurait injustice de ma part à me défier de vous. Je vous donne carte blanche.
– Si vous vouliez y ajouter du papier de même couleur, des enveloppes, de l’encre et un porte-plume ?
Sur un coup de sonnette du Résident, on apporta les objets réclamés par le sous-officier. Celui-ci les disposa sur la table, plaça une chaise devant et appela Rainilaiarivony.
– Monsieur le ministre, prenez donc la peine de vous asseoir ici, dit-il en balançant son arme d’une façon significative.
Et le Hova ayant obéi.
– Vous êtes le mari de la reine ?
– Parfaitement.
– Veuillez donc lui écrire une lettre très tendre, non une froide épître d’époux blasé, mais un poulet galant de fiancé. Priez-la de venir vous rejoindre ici.

– Mais ce n’est pas l’usage…
– Ce n’est pas l’usage non plus de communiquer la lèpre à l’aide d’une baïonnette, et cependant… Mais je ne veux pas réitérer mes menaces, je suis persuadé de votre bon vouloir. Allons, écrivez gentiment à votre chère femme… et surtout trouvez un prétexte assez adroit pour qu’elle se décide à se mettre en route au milieu de la nuit, car si elle hésitait, votre position deviendrait extrêmement dangereuse.
Rongeant son frein, Rainilaiarivony écrivit à sa royale moitié un billet dont le Résident prit connaissance.
– Êtes-vous satisfait, Excellence ? demanda Simplet.
– Oui, ceci est parfait.
– Alors continuons.
Il allongea la main vers le ministre qui faisait mine de se lever et qui, à ce simple geste, se rassit précipitamment.
– Je désire de vous encore un petit autographe. Écrivez au chef de vos Tsimandos d’expédier, au reçu de ce papier, des courriers vers tous les généraux commandant les troupes. Ils leur porteront l’ordre de se rendre à la Résidence française pour y déposer leurs armes.
– Écrire cela ? gronda le ministre.
– Par la vertu de ma baïonnette, dépêchez-vous.
Et tandis que le Hova, fou de rage impuissante, traçait l’ordre qui désarmait ses régiments et rendait toute révolte impossible pendant de longs mois, Marcel, que le Résident remerciait avec effusion, l’interrompit :
– Ne parlons plus de cela, Excellence, cela n’en vaut pas la peine. Expédiez le petit mot à la reine. Elle viendra. Vous la garderez prisonnière, ainsi que ce vilain magot de ministre, jusqu’à ce que vous ayez procédé au désarmement de l’armée ennemie. Alors vous les laisserez libres sous la condition qu’ils fassent transporter à Tamatave, pour être remises à nos navires de guerre, les provisions d’explosifs et de projectiles accumulées dans les souterrains du palais. J’ai l’air de vous donner des conseils, pardonnez-moi ; vous savez mieux que moi ce qu’il convient de faire… mais j’étais emporté par le raisonnement.
Trois quarts d’heure s’étaient à peine écoulés, que la reine arrivait avec une faible escorte et apprenait avec stupeur qu’elle était prisonnière. Aussitôt un exprès quittait la Résidence, chargé de la dépêche adressée au chef des courriers.
Les invités du Résident, auxquels on avait fait dire que le premier ministre était parti accompagné de son hôte, s’étaient retirés en se demandant quel événement avait pu déterminer cette brusque retraite. Après les explications indispensables, le représentant des droits français à Madagascar allait donner l’ordre de conduire ses prisonniers dans les appartements où ils seraient gardés à vue.
– Excellence, un instant encore, implora Dalvan.
Son interlocuteur le questionna du regard.
– Oh ! simple amour-propre d’auteur. La pièce qui s’est déroulée devant vous aurait pu être un drame. Nous en avons fait un vaudeville, il faut donc qu’elle finisse gaiement.
Et venant à Ikaraïnilo, immobile à côté du premier ministre :
– Messieurs, dit-il, dans cette soirée où j’ai eu l’honneur d’entrer en relations avec vous, il est advenu à diverses reprises que mes mains ont effleuré vos vêtements. Ces pauvres mains sont en pitoyable état et, sans nul doute, vous vous proposez de brûler vos habits afin d’éviter le microbe de la contagion. Je prétends vous épargner cette dépense. Messieurs, ce que vous avez pris pour l’effrayante lèpre est tout simplement la trace des épines de l’ortie zapankare.
Du coup le Résident éclata de rire. Quant aux indigènes, rien ne peut rendre l’expression de leurs physionomies. C’était de la colère, de la honte. Le sous-officier les avait bernés, bafoués. Il les avait amenés à se livrer pieds et poings liés en les épouvantant avec une piqûre d’ortie.
On les entraîna dans les salles de la Résidence transformées en prison. Marcel demeura seul en face du Résident. Ce dernier s’avança vers lui, les mains tendues.
– Monsieur, dit-il lentement, aujourd’hui vous avez fait acte de grand patriote et d’homme d’esprit. La France a contracté une dette d’honneur envers vous. Elle la payera, je m’y engage pour elle. Veuillez m’apprendre le nom du sauveur du protectorat.
Mais Dalvan secoua la tête.
– De nom, je n’en ai plus depuis que je me suis imposé une mission de justice – puis les lèvres distendues par un sourire – mais j’espère mener ma mission à bonne fin, alors, je reprendrai mon nom, et dame ! il ne me serait pas désagréable qu’il fût un peu honoré… Comment faire ?
Il se frappa le front :
– Ah !… un moyen. Excellence, vous me laisserez partir tout à l’heure. Vous consentirez, n’est-ce pas, à me donner un guide pour me conduire à la demeure du Tsimando Roumévo, mon frère de sang ? Demain, j’aurai quitté la ville. Alors faites venir un homme qui habite Antananarivo. C’est mon ennemi mortel, mais il sait mon nom ; il vous le dira… et si le succès couronne ma mission…
– Vous pourrez compter sur moi comme sur vous-même… Il sera fait ainsi que vous le désirez.
Un coup discret fut frappé à la porte.
– Qu’est-ce encore ? grommela le Résident. Entrez.
Un soldat parut ; il tenait à la main une lettre.
– C’est un soldat de la léproserie qui vient de l’apporter pour Votre Excellence.
– Donnez… C’est bien, allez.
Le troupier se retira et le Résident, ouvrant la missive, chercha la signature :
– Canetègne, dit-il.
Simplet poussa une exclamation.
– Ah !
– Qu’avez-vous ?
– Ce Canetègne… Monsieur le Résident, vous m’avez promis de me renvoyer tout à l’heure.
– Et je tiendrai ma promesse. Après le service que vous m’avez rendu ce soir, je ne me reconnais pas le droit de vous contrecarrer en rien.
– Je vous remercie. Eh bien donc, ce Canetègne est l’ennemi mortel dont je vous parlais à l’instant.
– Lui ?
– Oui, Excellence.
– Alors, je connais votre nom.
– Vous…
– Oui : blond, teint rose… Marcel Dalvan ; j’ai votre signalement. Vous accompagnez une jeune fille, coupable d’un vol que…
Une pâleur subite décolora les joues de Simplet. D’une voix frémissante :
– Vous blasphémez, monsieur le Résident… elle, voleuse ?
Et rapidement, en phrases hachées, ardentes, il raconta l’odyssée de sa sœur de lait, l’infamie du négociant, la recherche d’Antonin Ribor, détenteur de la preuve de l’innocence d’Yvonne.
Tandis qu’il parlait, le Résident parcourait la lettre de l’Avignonnais. Elle relatait le complot. Dans un style amphigourique, le commissionnaire narrait complaisamment au prix de quels dangers il l’avait surpris. Il insistait sur l’horrible métier de violateur de sépultures qu’il lui avait fallu faire. Marcel se tut. Son interlocuteur lui tendit la missive.
– Lisez et déchirez. La prose de ce personnage ne mérite pas un autre sort. Pour vous, monsieur Dalvan, croyez à ma gratitude et à ma profonde estime. Je souhaite que vous réussissiez à confondre votre ennemi, à rendre l’honneur à cette jeune fille que, sur une note de justice, j’ai injustement accusée comme les autres.
Et défaisant le ruban rouge fixé à sa boutonnière, il l’attacha à la vareuse de Simplet.
– Excellence… vous n’y songez pas, bredouilla le jeune homme tout troublé.
– Si, demain, je télégraphierai le récit sommaire des événements. Un inconnu a sauvé le protectorat français d’un désastre. J’ai attaché à sa boutonnière, assuré d’être approuvé par le gouvernement, le ruban de la Légion d’honneur. Cette nomination figurera sur les listes de l’Ordre, jusqu’au jour où la mention « Inconnu » sera remplacée par le nom d’un brave.
Il prit le jeune homme par le bras, l’accompagna jusqu’au corps de garde, et après avoir désigné un soldat pour le guider vers l’habitation de Roumévo :
– Allez, monsieur, dit-il, et bonne chance. C’est un ami qui vous serre la main.
Un moment plus tard, Simplet, suivant de près son conducteur, s’enfonçait de nouveau dans les ruelles sombres de Tananarive.
Marcel venait de réduire les Hovas à l’impuissance pour près de deux années, donnant ainsi à la République française, le temps de préparer l’expédition qui devait nous rendre maîtres de Madagascar[2].
XIV
EN MARCHE VERS LE SUD

Juste au-dessous du palais, bordant un chemin que continue hors de la cité l’une des rares sentes qui contournent la montagne, s’élevait une maison basse dont le toit couvert de tuiles – luxe digne d’envie dans le pays – se prolongeait en auvent. C’est là que le guide de Marcel le quitta. Le jeune homme était arrivé. Au premier coup dont il heurta la porte, celle-ci s’ouvrit. Roumévo parut, les bras ouverts. Toute la nuit, il avait attendu son frère de sang, et l’énergie de son accolade en disait long sur ses inquiétudes.
– Tes amis reposent. Tu dois être las ; viens, ta natte est préparée. Si tu as faim, voici des fruits, des bananes, du poulet froid. Demain tu me raconteras comment tu as pu tenir ta promesse : être libre cette nuit.
Après une rapide collation, dont le besoin se faisait impérieusement sentir, Dalvan s’allongea sur sa natte et s’endormit du sommeil profond des hommes d’action. Au matin, après s’être plongé avec délices dans un bassin naturel, qu’alimentait un ruisselet traversant le jardin du Tsimando, le Français regagnait l’habitation. Une voix qui le fit frissonner prononça son nom :
– Marcel !
Les pieds subitement cloués au sol, il regarda. Yvonne accourait, rayonnante de bonheur, toute rose d’émotion :
– Sauvé, libre !
Elle jeta ses bras autour du col de son frère de lait, et ses lèvres fraîches firent claquer des baisers sur ses joues. Puis elle s’éloigna un peu, le considérant :
– Pas de blessures, rien… quelle chance !
Ses yeux se fixèrent à ce moment sur la poitrine de Dalvan. Le ruban attaché par le Résident y dessinait sa ligne rouge.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda-t-elle.
Son doigt curieux effleurait l’insigne.
– Ça, répondit Simplet, c’est la Légion d’honneur.
– Tu es donc décoré ? murmura-t-elle saisie.
Ses paupières s’ouvraient toutes grandes, ses narines étaient agitées de petits frissonnements.
– Qui t’a décoré ?
– Le Résident général.
– Ah !… et pourquoi ?
– Parce que je l’ai averti d’un complot ourdi par le gouvernement malgache ; nous avons pincé la reine, le premier ministre, actuellement prisonniers à la Résidence. Nous avons ri comme des fous. Et le ministre de France, s’étant bien amusé, m’a octroyé le ruban rouge. Voilà !
Puis taquin :
– J’ai faim, tu sais. Allons déjeuner.
Mais elle ne l’entendait pas ainsi. Elle voulait savoir, et Simplet dut lui narrer par le menu les aventures de la veille.
Devant lui, elle écoutait, rendue muette par la surprise. Lui, souriant, disait ses petits moyens, éclatait de rire au souvenir de la mine terrifiée des Hovas en face de sa baïonnette, ne semblant point soupçonner qu’il avait couru un danger.
– Tiens, conclut-elle, tu es brave, adroit, mais tu n’es pas sérieux.
– Tu dis ?
– Je dis que tu t’exposes inutilement, que tu m’oublies, moi. S’il t’arrivait malheur, que deviendrais-je ?
– Tu continuerais ton voyage, petite sœur, avec Claude ; tu n’as pas besoin de moi.
Un flot de sang empourpra le visage de la jeune fille, ses yeux se remplirent de larmes.
– Tiens, fit-elle d’une voix entrecoupée, tu es méchant !
Et elle s’enfuit vers la maison, laissant Simplet tout interloqué par ce brusque accès de mauvaise humeur. Bientôt Bérard le rejoignit. Il lui fallut recommencer le récit de ses aventures, et l’incident s’effaça de son esprit. Le déjeuner rassembla tout le monde autour de la table de Roumévo.
On agita la question du départ.
De l’entrevue de Marcel avec le Résident il ressortait clairement qu’Antonin Ribor, s’il était venu à Tananarive, n’avait point visité le délégué français. Donc, il importait de retourner à Tamatave. Là on s’embarquerait à destination d’une autre colonie. Antonin était parti pour l’une d’elles, suivant la déclaration de Canetègne. Dût-on les parcourir toutes, on découvrirait le jeune explorateur. Dalvan l’affirmait sans hésiter. Il déclarait même que cette recherche d’un homme à travers les cinq parties du monde était chose fort simple.
– Songez donc, disait-il à l’appui de sa thèse, nous cherchons qui ? Un explorateur, un personnage qui ne vit pas comme aucun autre, et qui par conséquent est remarqué. À peine aurons-nous posé le pied sur le sol où il pérégrine, qu’il nous sera signalé de toutes parts. Le problème est donc celui-ci : Trouver le pays… C’est bien facile, étant donné surtout qu’il s’agit d’une terre française. Or, j’élimine tout de suite la terre de Kerguelen située à la limite de l’océan Antarctique et nos colonies d’Afrique ; la première, parce qu’elle est inhabitée ; les secondes parce que Antonin les a visitées tout d’abord. Que reste-t-il : La Réunion, les établissements de l’Inde, l’Indo-Chine, la Nouvelle-Calédonie, les archipels Polynésiens, la Guyane, les Antilles, Terre-Neuve avec les îles Saint-Pierre et Miquelon, soit : huit parcelles du globe. Un véritable jeu.
Bérard s’amusait, et Yvonne elle-même, secouant l’embarras qui depuis l’origine du repas semblait peser sur elle, se déridait aux saillies de Simplet.
Tout à coup un bruit éclatant résonna au dehors.
– Le bimbao, expliqua le courrier.
Tous se portèrent aux fenêtres. Au milieu de la ruelle un indigène, revêtu d’un manteau bleu garni de broderies, tenait dans chaque main une demi-sphère de bois creuse. Il choquait ces castagnettes gigantesques, et produisait ainsi le son qui avait attiré l’attention des voyageurs.
– C’est un héraut, reprit Roumévo, il va proclamer sans doute une ordonnance du gouvernement.
En effet, le Malgache interrompit son assourdissant concert et clama avec un organe sonore :
– Ordre du Ministre de la justice, 22e Honneur, 3e colonne de l’édifice gouvernemental.
« À tout citoyen il est enjoint de demeurer enfermé en sa maison, tandis que les agents de l’ordre vont perquisitionner. Un lépreux s’est enfui hier soir. Il convient de l’arrêter. »
– C’est de toi qu’il s’agit, murmura Roumévo en serrant le bras de Marcel.
– Probablement !
Le jeune homme avait pâli. La pensée de retourner dans l’enceinte de la léproserie, de reprendre l’horrible rêve dont le souvenir faisait perler à ses tempes une sueur glacée, lui causait une épouvante bien justifiée. Comment le poursuivait-on encore ? Ikaraïnilo était captif.
Il se souvint alors de M. Canetègne, entrevu dans la déroute de l’escorte du général.
Le coup devait partir de là. Le raisonnement était exact. Canetègne, après avoir fui éperdu, avait retrouvé le calme.
Envoyant par un des soldats sa dénonciation à la Résidence, il s’était fait mener de grand matin chez le ministre de la justice. L’annonce du héraut résultait de cette visite. Yvonne avait pris la main de son frère de lait :
– Tu ne retourneras pas parmi les lépreux, fit-elle frissonnante, nous allons partir.
– Il faut traverser toute la ville pour gagner la route de Tamatave.
– La route de Tamatave, interrompit le courrier… Mais vous seriez repris avant la nuit. C’est le seul chemin par lequel un Européen puisse quitter Antananarivo. Aussi, votre disparition constatée, est-ce là que se centraliseront les recherches.
Tous baissèrent la tête. Ils sentaient la vérité de l’observation.
– Alors je n’ai plus qu’à me laisser arrêter ?
– Non. Tu es mon frère de sang, je te sauverai. La rue que j’habite est continuée par un sentier qui contourne la hauteur et conduit dans les ravins du plateau de l’Ankaratra. Seuls les Tsimandos connaissent le dédale rocheux qui s’étend au loin. Pendant des journées nous marcherons dans un chaos de granit, et quand nous en sortirons, nous serons dans le pays des Betsileos. Toujours en guerre avec mon peuple, ils t’accueilleront, toi proscrit, et ils t’aideront à atteindre la côte.
Peu de minutes suffirent aux préparatifs du départ. Roumévo s’aventura le premier dans la ruelle. Elle était déserte. Nulle silhouette menaçante n’apparaissait à l’horizon. À l’appel du courrier, Yvonne et ses amis sortirent à leur tour et suivirent l’indigène. Celui-ci marchait en avant, se tenant aussi loin que possible de l’extrémité du gradin longé par la route. Ses regards perçants se fixaient partout à la fois. Veillant à tout, le Tsimando avait à ce moment, selon l’expression populaire, des yeux derrière la tête. Le chemin faisait un coude. L’angle d’une habitation s’avançait presque au bord de la pente.
Soudain les fugitifs virent Roumévo, qui les précédait d’une vingtaine de pas, s’arrêter brusquement. De la main il les appela près de lui. Et dissimulés derrière le mur, ils aperçurent à cinquante mètres, un soldat hova qui, le fusil sur l’épaule, montait la garde sur le chemin.
– La police a pris ses précautions, fit le Tsimando dans un souffle. Les issues de la ville sont gardées.
– Alors nous sommes bloqués ?
Roumévo réfléchit un instant. Les veines de son front se gonflèrent ; ses traits exprimèrent l’indécision, et soudain il sembla prendre son parti :
– Frère, dit-il, mon premier devoir est de te sauver. Attendez-moi là, je vais déblayer la route.
Et il franchit l’angle du mur. Prenant sa place, Marcel avança la tête et assista à un terrible spectacle. À la vue du courrier, le soldat avait croisé la baïonnette ; mais Roumévo montra le cachet rouge distinctif de sa fonction, et le guerrier reprit une attitude pacifique. Bientôt les deux hommes furent l’un près de l’autre. Ils conversaient comme de bons amis ; seulement le Tsimando, à petits mouvements, tournait autour du factionnaire de façon à ce que ce dernier fût enfermé entre lui et l’abîme.
Tout à coup, les bras de Roumévo se détendirent, ses mains s’appuyèrent avec une vigueur irrésistible sur les épaules du soldat. Sous ce choc, le malheureux recula d’un pas, son pied se posa dans le vide… Il essaya de se retenir, un hurlement étranglé sortit de ses lèvres, et comme une masse, frôlant la pente rocailleuse, il alla s’écraser sur le gradin inférieur, cent mètres plus bas. Marcel, suivi de ses amis, courut à Roumévo.
– Pourquoi pas un coup de poignard, dit-il, cette chute dans l’abîme est horrible.
Le Tsimando eut un sourire triste.
– Le poignard dénoncerait des fugitifs. La chute n’est qu’un accident fréquent dans la cité. Ne me reproche rien… C’est pour ton salut que j’ai agi. Mais hâtons notre marche, tout péril n’a pas disparu.
La ruelle se rétrécissait ; bientôt le chemin praticable fut réduit à une largeur de trente centimètres à peine. À droite, une muraille perpendiculaire montait jusqu’aux terrasses du palais.

À gauche, un abîme s’ouvrait. C’était la corniche dans toute son horreur.
Tout alla bien d’abord ; mais au bout d’un instant, Yvonne, avec un faible cri, se laissa glisser sur les genoux. Si Claude ne l’avait retenue, elle eût glissé dans le précipice.
Elle était prise de vertige !
La caravane fit halte. Tous les fronts étaient soucieux. Le vertige, sur l’étroit sentier bordant le précipice, devenait une effrayante complication.
La jeune fille, étendue sur le sol, semblait morte. Le visage exsangue, les paupières closes, les lèvres crispées découvrant les dents nacrées, elle ne faisait aucun mouvement.
– Encore un kilomètre à descendre ainsi, grommela Roumévo. Plus loin la route est moins périlleuse.
– Oui, mais il faut l’atteindre.
Il y avait du découragement dans cette phrase de Bérard. Marcel ne disait rien. Il songeait. Tout à coup il releva le front.
– Un clou chasse l’autre, dit-il. Une peur en fait oublier une autre… Attendez.
Passant avec précaution par-dessus le corps de sa sœur, il remonta le sentier.
– Où vas-tu ? lui cria Claude.
– Je cherche une issue.
– Tu déraisonnes.
– Pas le moins du monde.
Et sur ces mots, il disparut au détour de la corniche. À cet instant, Yvonne rouvrit les yeux ; ses regards se fixèrent aussitôt sur le vide et, avec un gémissement, elle appliqua les mains sur ses paupières.
– Allons, mademoiselle, un peu de courage, pria le « Marsouin », le plus fort est fait. Relevez-vous.
Elle secoua la tête avec une expression de souffrance.
– Je ne peux pas ; je sens auprès de moi ce trou immense. Il me semble que les rochers m’y poussent, m’y tirent… C’est affreux !… Je ne peux pas ; je ne peux pas !
Un coup de feu se fait entendre, répercuté par les échos du ravin. Claude et le courrier tressaillent. Yvonne, comme galvanisée, bondit sur ses pieds. Et en arrière Dalvan reparaît. Il descend la pente avec rapidité.
– Alerte ! crie-t-il, des soldats hovas sont à notre poursuite.
Roumévo n’en demande pas davantage ; à grandes enjambées, il dévale la sente. Claude, la jeune fille, le suivent. Simplet ferme la marche.
Du vertige, plus personne n’a cure ; on n’a pas le temps d’y songer. En courant, les fugitifs prêtent l’oreille. Ils croient entendre au loin les pas précipités des poursuivants. Ils courbent les épaules, craignant de recevoir une balle. Ils sont essoufflés ; leurs tempes battent ; leur cœur saute éperdument dans leur poitrine. Ils marchent toujours. Et le sentier, cessant de suivre le précipice, se glisse entre deux hautes murailles de granit.
– Halte ! crie Marcel.
– Mais ils vont nous rejoindre, proteste Yvonne.
– Les Hovas ?
– Oui.
– Rassure-toi, petite sœur, il n’y en a jamais eu.
– Comment ?… Que dis-tu ?
– Que j’ai chassé le vertige par la peur des fusils, voilà tout. C’est bien simple.
Elle le regarde. Elle comprend. Une fois encore, il a tiré ses amis d’une situation terrible.
Alors, il s’approche d’elle, il l’enserre dans ses bras. Une larme brûlante tombe sur son visage.
Les yeux de la jeune fille se rivent sur ceux de Dalvan.
– Tu pleures ? dit-elle.
– Oui, répond-il, en s’efforçant de cacher son émotion sous un sourire, j’ai eu si peur que tu n’aies pas assez peur…
Et il donne le signal du départ. Escaladant les rocs superposés en escaliers gigantesques, se glissant dans d’étroites fentes où ils ont peine à passer, suivant des gorges sauvages désolées, lits de torrents à sec, les voyageurs s’éloignent d’Antananarivo.
Yvonne ne paraît pas sentir la fatigue. Muette, elle marche comme en songe. Mais, de temps à autre, ses paupières s’ouvrent ainsi qu’un écrin sur des pierres précieuses, laissant filtrer son regard bleu qui va se poser, avec une expression étrange, sur Marcel éclairant la route avec Roumévo.
À la nuit, on campa dans une caverne.
Durant une longue semaine, les mêmes paysages dénudés défilèrent devant les Français. Ils tournaient, montaient, descendaient dans ce prodigieux massif de l’Ankaratra, notant au passage les sources de l’Onibé qui finit dans l’océan Indien, près d’Ambodibarina et celles de la rivière Italambo.
Passant à l’est de Betafo, ville frontière du pays hova, ils gagnèrent la fertile vallée de Valavato, traversèrent le fleuve Ambositra.
Là, ils étaient en sûreté sur le territoire des Betsileos. Le voyage y fut aisé. Les tribus de noirs superbes – véritables carabiniers en deuil, comme les appela plaisamment Bérard – se montrèrent hospitalières. Après les fatigues de la montagne, les voyageurs se délectaient à parcourir ces plaines élevées, où l’air était doux, la végétation luxuriante, les habitants bienveillants.
À chaque halte, ils se régalaient de légumes frais, de viandes savoureuses qu’ils arrosaient de betsabesse étendu d’eau. Ce breuvage, composé de jus de canne à sucre, de riz fermenté et d’écorces amères, leur avait été désagréable tout d’abord ; maintenant ils y étaient faits et, ainsi que les indigènes, en usaient avec plaisir.
Suivant le conseil de Roumévo, ils se dirigeaient vers une passe, qui coupe la cordillère parallèle à la côte Est et débouche en face, du petit port de Vatomasina. De ce point, ils pourraient quitter l’île.
Mais le sort en avait décidé autrement.
Le treizième jour, après leur départ de Tananarive, (le chiffre fatidique eut-il une influence dans leur aventure ?) ils s’arrêtèrent dans un petit village couché au pied de mamelons, sentinelles avancées de la chaîne qu’ils avaient à franchir. Selon la coutume, le chef leur fit un cordial accueil et mit à leur disposition une case.
Or, tous commençaient à s’endormir, quand un bruit léger attira leur attention. On eût dit le grattement d’un rat dans la muraille.
Celle-ci étant de bois, l’animal s’en donnait à cœur joie. Il rongeait, grignotait avec une telle ardeur que bientôt une plaque de la cloison se détacha, laissant une ouverture carrée, large de deux pieds au moins et, avec stupeur, Marcel et Roumévo, éveillés par le tapage, aperçurent une silhouette humaine se glissant dans la cabane. Le rat était un voleur.
Mais les voyageurs ne tenaient pas à être volés. Aussi, échangeant un regard, le Hova et le Français se levèrent d’un bond, happant chacun un bras du dévaliseur. Un cri étouffé, une courte lutte et l’homme fut couché à terre, solidement maintenu par ses ennemis.
Bérard, accouru au bruit, alluma la torche de résine – éclairage primitif des indigènes – et à sa fumeuse clarté, on put voir le prisonnier. Celui-ci souriait ironiquement :
– Vous me faites souffrir, dit-il, mais vous expierez ce crime.
– Il a du toupet ! s’écria Dalvan à qui Roumévo venait de traduire cette phrase ; il vient nous voler et…
Son frère de sang lui imposa silence du geste et s’adressant au captif :
– Tu te trompes. Tu seras puni comme voleur.
– Comme voleur ? Que t’ai-je pris ?
– Rien, parce que le temps t’a manqué. Mais ta façon d’entrer dans notre cabane ne laisse aucun doute.
– Tu n’es pas du pays, cela se voit. Je dirai aux miens : « J’ai percé la muraille, car j’avais entendu le Scarabée rouge bourdonner, et je voulais l’éloigner de nos hôtes par la puissance du Coq blanc. » Pour cette incantation qui doit chasser l’esprit du mal, on ne peut pénétrer dans une habitation par les ouvertures habituelles.
– Tu te moques de moi.
– Non, mais je suis le sorcier de la tribu.
– Eh bien, nous dirons le contraire, nous, et le chef croira ses hôtes.
– Tu te trompes encore. Il doutera et ordonnera l’épreuve du tanghin.
Roumévo frissonna. Le tanghin, plante vénéneuse de l’espèce des strychnos, sert aux épreuves judiciaires. Deux hommes sont en procès, le juge ordonne l’épreuve. Celui que le poison terrasse est réputé avoir tort. Les naturels, dès l’enfance, s’accoutument à mâcher la feuille vénéneuse, si bien que sa toxicité s’amoindrit et s’annihile pour eux. – Toujours les poisons de Mithridate.
Mais de ce fait résultait pour Marcel une infériorité marquée.
Il succomberait au poison végétal, et le sorcier larron serait proclamé victime d’une erreur. En dix secondes, le courrier entrevit les conséquences de la situation. Il les développa à ses compagnons. Il fallait faire la paix avec le voleur, lui rendre la liberté sous peine d’ennuis incalculables.
– Eh bien ! dirent les jeunes gens, lâchons-le.
Roumévo revint au prisonnier qu’il avait attaché et le délia.
– Tu as dit vrai, sans doute. Nous te croyons et le prouvons en te permettant de t’en aller avec nos mille et mille souhaits heureux.
L’autre secoua la tête :
– Ton discours est incomplet. Si tu es prompt à l’accusation, nous ne sommes point pressés de pardonner.
– Parle plus clairement.
– Je le veux bien. Vous m’avez terrassé, heurté contre terre. Tout cela sans raison. Et moi, je suis demeuré calme, je n’ai pas cherché à me défendre, désireux de conserver intact mon bon droit.
– Nous le reconnaissons, appuya le Tsimando.
Il avait hâte de se débarrasser de l’indigène ; seulement sa condescendance n’était pas le moyen d’arriver à un bon résultat. Il s’aperçut de sa faute – trop tard – quand le sorcier reprit :
– Vous avouez vos torts ; je serai donc clément et me contenterai d’une indemnité peu importante.
– Une indemnité !
Roumévo esquissa un geste violent, mais une réflexion rapide le calma et paisiblement :
– Qu’exiges-tu ?
– Presque rien.
– Mais encore ?
– J’aurais le droit, continua le voleur, qui semblait s’amuser de l’impatience de son interlocuteur, de vous demander de l’argent, des thalaris sonnants et trébuchants, ou bien l’une de vos armes, dont les Hovas, nos ennemis, nous ont appris l’usage. Mais je ne prétends pas abuser. Je me contenterai d’un objet sans valeur.
Roumévo respira. Ses amis attendaient, mis au courant par lui à mesure que la conversation avançait.
– Enfin que veux-tu ?
– Tu n’as pas compris ?
– Eh ! non.
– Tu oublies donc l’adage des Betsileos : « Qui est moins qu’un chien ? Un Hova. Moins qu’un Hova ? Rien. Moins que rien ?… Une femme. »
– Une femme ? répéta le courrier, tellement absorbé par sa fonction de négociateur qu’il ne songea pas à s’irriter contre l’homme, qui lui lançait en plein visage ce proverbe, suprême outrage à la nation hova.
– Eh bien ? interrogea le sorcier.
– Tu demandes ?
– La femme qui t’accompagne. Je la consacrerai au culte de nos divinités.
Du doigt il désignait Yvonne. Demi-soulevée sur sa natte, la jeune fille écoutait appuyée sur le coude.
– Il veut ta sœur, fit Roumévo à Marcel.
Elle eut un petit cri de frayeur.
– Que ça ?
– Consens tu ? questionna le larron.
– Ce que tu sollicites est impossible. Une femme d’Europe ne saurait être traitée comme une Malgache. Choisis dans notre léger bagage…
– Inutile. C’est elle que je veux.
– Et si nous refusons ?
– Alors au lieu du pardon, c’est la vengeance qui s’abattra sur vous, et l’épreuve du tanghin vous jettera mourants sur le sol. La fille blanche m’appartiendra quand même.
Bérard, Marcel et le Hova se regardèrent :
– Que faire ? murmura ce dernier tout pensif.
Marcel sourit :
– Parbleu ! étrangler ce coquin.
– Mais demain, on nous demandera compte…
– De cet acte de justice. Demain, nous ne serons plus ici.
– Comment ?
– Nous allons partir à l’instant, après avoir garrotté solidement notre ennemi. Ne perdons pas de temps. Il faut qu’au lever du soleil nous soyons loin de ce village.
Le jeune homme parlait avec calme. Le sorcier se méprit à cette tranquillité. Il pensa que l’on se rendait à sa requête, et cauteleux, s’efforçant de donner à sa face rusée une expression aimable, il s’approcha du groupe.
– Dois-je te faire le salut d’amitié ? dit-il. Tu es le chef, puisque ceux-ci te consultent. À toi de répondre.
Le sous-officier le considéra, une lueur dans ses yeux bleus.
– Ma réponse, la voici.
D’un croc-en-jambe il envoya le Betsileo rouler sur le plancher. En l’espace d’un éclair, le voleur fut de nouveau chargé de liens, réduit à l’impuissance, bâillonné.
Ses regards étincelants, ses sourcils agités de brusques contractions trahissaient seuls sa rage. Rapidement, chacun reprit ses armes et quitta la cabane où se débattait le sorcier écumant.
Le village dormait. Sans encombre, la petite troupe dépassa les dernières cases et s’élança dans la campagne.
– Guide-nous vers la passe de Vatomasina, ordonna Marcel à Roumévo.
– Non. Tu as dit au chef du village que telle était ta direction. Au soleil levant, on se mettra à notre poursuite de ce côté et nous serions atteints avant le soir, car les guerriers marcheront plus vite que ma sœur blanche.
– Alors tu penses ?
– Que le mieux est d’incliner vers le sud-ouest, quitte à nous rabattre dans deux ou trois jours vers l’océan Indien.

– Ton conseil est sage, allons.
Dans les pas du courrier, les voyageurs traversèrent les champs cultivés aux abords du village, et bientôt ils se trouvèrent dans la brousse. Mais là, ils durent ralentir leur allure. Des fourrés épineux les arrêtaient à chaque instant, les obligeant à de longs détours.
Et chaque fois le Tsimando vomissait un torrent d’imprécations, chose facile pour lui, car la langue hova en foisonne.
– Il existe sûrement un sentier, répondit-il à une question de Bérard. Si près des habitations, il est inadmissible que le fourré soit impénétrable. Si nous avions la chance de le découvrir, nous ferions, avec moins de fatigue, un chemin double. Mais il n’y faut pas compter. En plein jour, peut-être, arriverions-nous à nous diriger ; mais la nuit, avec un horizon borné, je n’ose l’espérer.
Ce pronostic désagréable devait se réaliser. Durant des heures, on erra à travers le dédale des buissons, et ce fut seulement lorsque les premiers rayons du soleil dissipèrent l’ombre que le courrier trouva le sentier. Yvonne était exténuée. Son frère de lait parla de faire halte. Mais le Tsimando, étendant son bras vers le nord, prononça ce seul mot :
– Regarde.
Le jeune homme obéit. À deux kilomètres à peine, dépassant le voile du brouillard matinal, les toitures du village betsileo apparaissaient. Pour parcourir cette faible distance, les voyageurs avaient employé toute la nuit. Et la marche fut reprise, silencieuse, attristée.
Chacun sentait le danger proche. Ils comprenaient que le temps perdu dans la brousse pouvait amener d’irréparables malheurs. Cependant les arbustes devenaient plus clairsemés ; une plaine nue, rocailleuse succédait, et au centre s’élevait une colline isolée, aux flancs dénudés, et couronnée d’un bouquet d’arbres. Roumévo désigna la hauteur :
– Nous nous reposerons là.
– C’est juste. En cas de poursuite, nous aurons l’avantage de la position. Trois hommes résolus tiendraient contre une troupe nombreuse de là-haut.
Un aboiement lointain fit expirer la parole sur ses lèvres.
– Un chien ! murmura-t-il.
– Pressons-nous ! s’écria le courrier.
– Pourquoi ?
– Les Betsileos ont lancé un chien à notre piste, j’en ai peur.
– Ah ! bégaya Yvonne toute pâle.
Un second aboiement, plus rapproché cette fois, passa dans l’air.
– Plus de doute, reprit le Tsimando. En avant ! Il faut à tout prix atteindre le sommet de la colline avant que nos ennemis nous aient rejoints.
– Si je restais en arrière pour abattre le chien ? demanda Claude.
– Non, il est tenu en laisse, les guerriers l’accompagnent. C’est la coutume des tribus betsileos.
Bien avant les armées d’Europe, les sauvages de Madagascar avaient compris quel parti on peut tirer, au point de vue militaire, du flair des chiens et s’en servaient comme éclaireurs. Les aboiements ne discontinuaient plus ; la piste était trouvée. Sans chercher à se dissimuler, les fugitifs s’élancèrent au pas de course dans la direction du monticule.
XV
LE « FADY »
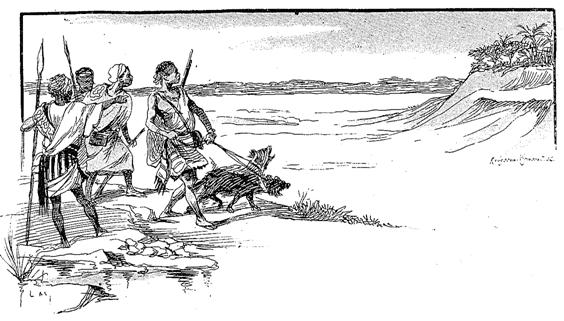
L’élévation unique, se dressant au milieu de la plaine aride, avait un aspect singulier. On eût dit deux troncs de cônes superposés, formant à mi-hauteur une corniche circulaire. Sur les flancs, pas une pousse verte, et sur le plateau supérieur, un épais bouquet d’arbres. Tout en courant, la petite troupe faisait ces remarques. La route était difficile ; partout des éclats de pierre, brillants, coupants.
– Du cristal de roche ? remarqua Marcel.
Roumévo acquiesça du geste. C’était un des gisements communs dans le massif central.
Glissant, haletante, Yvonne allait comme les autres, encouragée par son frère de lait, soutenue dans les passages difficiles. Rencontrait-elle un obstacle à franchir, d’instinct elle cherchait son bras, et ce, jamais en vain. Il veillait sur elle, toujours prêt à l’aider ; il semblait que pour lui les difficultés n’existaient pas. Ils approchaient du but. Cent mètres à peine les séparaient de l’éminence quand, à l’autre extrémité de la plaine, les ennemis débouchèrent du taillis. Un hurlement avertit les fugitifs qu’ils étaient découverts.
Comme cinglés par un coup de fouet, ils précipitèrent leur allure, arrivèrent au pied de l’escarpement. Sans prendre le temps de souffler, ils commencèrent l’ascension. La pente était rapide ; la terre calcinée glissait sous les pieds. Ils montaient toujours.
Tout à coup, la voix joyeuse de Marcel s’éleva :
– Regardez donc ces moricauds !
Tous se retournèrent. Dans la plaine, les Betsileos avaient fait halte. Formés en groupe, ils discutaient, montrant la hauteur avec de grands gestes.
– Ils se disent que la redoute sera difficile à enlever, déclara le « Marsouin. »
– Probablement. Profitons toujours de ce répit pour gagner le plateau.
La montée fut reprise aussitôt. En peu d’instants, Yvonne et ses compagnons se hissèrent au sommet de la colline, et prirent pied sur un plateau couvert d’herbes et ombragé par quatre ou cinq arbres aux proportions gigantesques.
Cette prairie mesurait une cinquantaine de pas dans tous les sens. Au centre, un bassin naturel déversait son trop plein sous forme d’un ruisselet qui courait sous l’ombrage, jusqu’au bord du plateau opposé à celui par lequel étaient arrivés les voyageurs.
Ce coin verdoyant, au milieu de la plaine brûlée, s’expliquait par la présence de cette source. Les Français, après la course folle qu’ils venaient de fournir, éprouvaient un véritable bien-être à se trouver sous l’ombre fraîche. Déjà ils se penchaient sur la fontaine, trempant leurs mains dans l’eau transparente. Une exclamation de Roumévo les fit sursauter. Immobile au pied d’un arbre, l’air désolé, le Hova figurait une statue de la douleur. Marcel courut à lui. Qu’avait-il ? D’où venait son désespoir ?
– Ah ! frère, murmura le courrier, nous avons commis le crime contre les esprits de la mort.
– Diable ! fit le sous-officier en riant, et quel crime ?
– Cette montagne est « fady » ; nul pied humain ne devait fouler son sol.
– Fady ? Qu’est-ce que fady ?
– Cela signifie que la montagne est sacrée ; sans doute elle sert de sépulture à un grand chef.
– Et alors ?
– En la gravissant, nous avons été sacrilèges.
Philosophiquement, Dalvan secoua les épaules :
– Ça vaut encore mieux qu’être aux mains des Betsileos. Du reste, il n’y a que le premier pas qui coûte, et si les noirs nous attaquent, je leur ferai tomber sur la tête le tombeau du grand chef.
Puis changeant de ton :
– À quoi reconnais-tu que cette colline est fady ?
– À ceci.
Roumévo désigna un bâton de bois rouge planté en terre près du tronc de l’arbre. À la partie supérieure, la forme d’un coq se profilait, et sur les faces des entailles entre-croisées figuraient ces lignes.

– Tu sais ce que signifient ces signes ?
– Non, répliqua Roumévo. Jadis, lorsque tous les Malgaches adoraient Zenahari, les prêtres écrivaient ainsi. Mais la tradition s’est perdue. Aujourd’hui le sens de ces lettres nous échappe. On pense seulement que ceci est la formule qui place un lieu sous la garde du soleil.
– Parfait ! Nous occupons donc un terrain placé sous la garde de Phébus et, par bonheur, gardé de lui par un épais ombrage. Visitons notre propriété.
D’un regard, le jeune homme s’assura qu’aucun danger immédiat ne menaçait ses amis du côté de la plaine. Les Betsileos continuaient leurs discours. Ils ne s’étaient pas rapprochés.
Tranquille sur ce point, Marcel poursuivit l’exploration de son domaine. Quelques enjambées le conduisirent à l’endroit où le ruisseau, quittant la surface plane, descendait en cascade la pente du coteau. Un cri d’admiration appela ses compagnons auprès de lui, et tous demeurèrent muets devant le spectacle qui s’offrait à eux. L’eau avait creusé le flanc de l’éminence et bondissait, de marche en marche, sur un escalier transparent que les rayons du soleil piquaient de feux multicolores. C’était une succession de degrés de diamant. Partout des lueurs, partout des étincelles, donnant aux voyageurs l’éblouissement d’un conte des Fées réalisé par la nature.
– Cristal de roche, dit encore Marcel.
Le mot expliquait les apparences. Sous la morsure du courant, la terre avait été entraînée, laissant le roc à nu ; et ce roc, poli par l’incessante caresse de la chute, était de cristal.
Sur chaque bord, de hautes herbes, des lianes fleuries formaient un rempart impénétrable de verdure. Plus loin dans la plaine, une bande verte indiquait le cours du ruisseau et allait rejoindre une forêt épaisse, dont les cimes ondulaient ainsi qu’une mer jusqu’aux confins de l’horizon.
– Comme c’est beau ! fit Yvonne.
Ses compagnons n’eurent pas le temps de lui répondre.
– Aux armes ! cria Roumévo. Ils approchent.
Les Français installèrent la jeune fille auprès de la source et vinrent se poster à la limite du plateau.
Le courrier avait dit vrai. Les Betsileos s’étaient formés suivant une grande ligne, ainsi que des tirailleurs, et dans cet ordre, ils s’avançaient sans hâte vers la colline « Fady ».
– Ah çà ? demanda Dalvan, est-ce qu’ils oseront violer le mont consacré au soleil ? L’histoire de Roumévo m’avait rassuré, mais maintenant, je vois bien que la piété des Madécasses est une légende.
Puis il adressa un sourire à son revolver et attendit.
– Que font-ils donc ? reprit-il après un instant, quelle singulière manœuvre !
À trente pas du monticule, le centre de la ligne ennemie s’était arrêté et les ailes opéraient, chacune en sens inverse, une conversion qui devait les amener en contact.
– Ils forment le cercle autour de notre bastion. Auraient-ils l’intention de nous attaquer de tous côtés à la fois ?
Le sous-officier devenait soucieux :
– La pente est raide, fit-il encore, mais nous sommes trois contre une centaine d’hommes. Il en arrivera toujours la moitié sur le plateau. Sapristi ! c’est trop ! beaucoup trop !
Il tourna la tête vers l’endroit ou il avait laissé Yvonne.
Elle n’avait pas bougé, mais ses yeux ne quittaient pas Marcel. Les regards des jeunes gens se rencontrèrent. Une seconde ils demeurèrent ainsi, hypnotisés, éprouvant au cœur comme une brûlure, puis tous deux abaissèrent leurs paupières.
– Eh bien non ! grommela Dalvan, il n’en arrivera pas la moitié de ces Betsileos, il n’en arrivera pas un.
Et avec un frisson :
– Il ne faut pas qu’ils s’emparent d’Yvonne… je la tuerais plutôt.
Il se tut brusquement. Une expression étonnée se peignit sur son visage. Tout bas, comme s’il eût eu honte de son aveu.
– Est-ce que je l’aimerais comme une fiancée, elle, ma sœur de lait ? Je me sens devenir fou à la pensée qu’elle serait captive de ces sauvages !… Eh ! eh ! peut-être bien.
Froidement il reprit par réflexion :
– C’est une complication cela… Elle est ma sœur de lait, elle a de l’amitié pour moi ; mais elle n’a pas l’idée de m’épouser. Donc, si elle s’apercevait de ma sottise, elle serait froissée… C’est bien simple, elle ne la saura pas.
Son ton devint douloureux :
– Oh ! oui, c’est bien simple ! Je la verrai chaque jour, je lui rendrai l’honneur et après… ah ! après, il faudra m’éloigner, disparaître… voilà le coup dur… Au diable les Betsileos qui me font faire ces réflexions-là !
L’ennemi avait achevé son mouvement. Un cercle de guerriers entourait la colline « Fady ».
Mais ils ne paraissaient pas vouloir procéder à une attaque de vive force. Tous prenaient leurs dispositions pour camper.
– Saprelotte ! s’écria Bérard posté à droite de Simplet, c’est un blocus en règle. Ils veulent nous prendre par la famine.
– La famine ! alors rien à craindre, repartit ce dernier.
– Nous n’avons aucune provision.
– Dans nos poches, c’est vrai, mais sur les arbres…
Et du doigt Simplet montrait des boules vertes se balançant à l’extrémité des branches. Ils étaient à l’ombre d’arbres à pain.
– Le vivre et le couvert, déclara joyeusement Marcel, nous allons être ici comme des coqs en pâte. Des repas succulents. Comme menu : pommes de l’arbre à pain ; comme liquide, eau de source hygiénique et rafraîchissante. Un blocus, ah ! la bonne idée. J’ai lu dans un certain Homère qu’il y eut autrefois une ville du nom de Troie, dont le siège dura dix ans. Le siège de cette butte sera plus long encore, à moins que nous ne trouvions un moyen de fausser compagnie à ces estimables moricauds.
Toute sa belle humeur était revenue. Les Betsileos respectaient le Fady. Donc, rien à craindre pour les voyageurs, tant qu’ils occuperaient le plateau. Roumévo lui-même partagea cette conviction.
Il abandonna son poste de combat, et s’installa auprès de la fontaine avec un soupir de satisfaction. Peut-être songeait-il en s’étendant sur l’herbe épaisse, en respirant l’air rafraîchi par le voisinage de la source, que les assistants devaient griller dans la plaine sans ombre et sans eau. De grand appétit tous déjeunèrent. Les baies de l’arbre à pain furent déclarées exquises. Puis désœuvrés, les assiégés firent la sieste.
La nuit vint sans amener aucun changement à leur situation. Seulement, à l’instant fugitif du crépuscule, le cercle d’investissement se resserra, enceignant de plus près la colline. Les Betsileos ne voulaient pas lâcher leur proie. Marcel avait suivi leurs mouvements avec attention. Les noirs n’étaient plus qu’à dix pas de l’éminence.
– Claude ! appela-t-il doucement.
– Que veux-tu ?
– Ces Malgaches nous tracassent, nous n’allons pas les laisser tranquilles.
– Si nous avions des fusils, cela irait tout seul ; mais nos revolvers ne porteraient pas jusqu’au bas de la pente.
– Aussi, je te propose de descendre.
– Tu dis ?
– Nous nous trouvons dans un fort admirable, puisque les assiégeants n’en tenteront pas l’assaut. Nous sommes donc assurés d’y trouver un refuge, Tu le disais toi-même, nous manquons de fusils… ou plutôt j’en ai un, mon remington de la léproserie, sans cartouches, hélas !… Prenons-en à nos ennemis, et alors nous les obligerons bien à élargir le cercle.
Yvonne n’avait rien entendu. Les sous-officiers se levèrent sans bruit et traversèrent le plateau. Au moment de s’engager sur la descente, ils prêtèrent l’oreille. Aucun bruit ne montait de la plaine. Il semblait que la troupe betsileo se fût éloignée. Mais ce calme était trompeur. Une pierre détachée sous le pied de l’un des Français roula sur le flanc du coteau. Aussitôt un cliquetis d’acier résonna dans la nuit.
– Ils sautent sur leurs armes, souffla Dalvan à l’oreille de son compagnon. Ils veillent.
Le silence s’était rétabli. Sans doute, les indigènes, comprenant le motif de leur alerte, avaient repris leur somme interrompu. Lentement, posant le pied à terre avec des précautions infinies, les Français s’aventurèrent sur la pente. Comme des ombres ils se rapprochaient de leurs adversaires, retenant leur haleine, tremblant d’éveiller l’attention. Parfois des pierrailles filaient avec un bruissement de pluie sur les vitres.
Et durant de longues minutes, aplatis sur le sol, les jeunes gens n’osaient bouger. Enfin, rassurés par le calme qui les environnait, ils repartaient, arrêtés bientôt par une nouvelle chute de pierres. Cependant ils avançaient. À leurs yeux apparaissait la surface noire de la plaine. Familiarisés avec l’obscurité, ils distinguaient des taches plus sombres.
Au-dessous d’eux, à quelques mètres, un guerrier était placé en sentinelle. Appuyé sur son fusil, la tête penchée, il semblait écouter ; se défiant de ses yeux, il s’en rapportait à son ouïe.
Ce fut le salut pour les assiégés ; sans cela, l’homme les aurait aperçus. Marcel se laissa glisser encore un peu, et d’un bond de tigre, se trouva à côté du Betsileo. Lui fracasser la tête d’un coup de revolver, lui arracher sa cartouchière et son fusil, tout cela fut fait dans l’espace d’un éclair. Des détonations pressées indiquaient que Claude ne restait pas les bras croisés.
Radieux, Dalvan se disposa à regagner sa retraite, mais il se sentit retenu par sa blouse de chasse. Il se retourna. Une forme obscure était accroupie derrière lui. Un grognement sourd lui fit comprendre à quel adversaire il avait affaire.
– Un chien !
D’un geste rapide il reprit son revolver. Mais lorsqu’il voulut tirer, il dut faire pivoter le corps sur ses hanches. Le chien tourna aussi.
Comme une tempête hurlante, les Betsileos se précipitaient sur le théâtre de la lutte. Marcel entrevit Bérard courant à la colline.
– À moi ! cria-t-il.

Et soudain un hurlement lamentable retentit. Le chien lâcha prise et s’affaissa avec des tressauts convulsifs. Une fusillade nourrie crépita aux oreilles de Simplet, brisant l’élan des ennemis, zébrant la nuit de raies de feu, tandis qu’une voix claire dont le timbre argentin était faussé par la terreur criait :
– Simplet, je t’en supplie, reviens !
– Chère Yvonne ! balbutia-t-il en rejoignant la vaillante enfant qui venait de le délivrer.
Son intervention était naturelle. Elle avait entendu la conversation des deux amis et avait voulu, au besoin, protéger leur retraite. Avec Roumévo elle avait quitté le plateau derrière eux.
Mais il importait de profiter de l’indécision des indigènes, et rapidement la petite troupe regagna son campement.
Les Betsileos ne tiraient pas. Les Européens leur échappaient après avoir tué ou blessé cinq à six des leurs ; mais le fanatisme était plus fort que la colère. On ne dirige pas son arme contre un lieu « fady », fût-ce pour tuer son plus mortel ennemi. Aussi Yvonne et ses amis arrivèrent sans encombre auprès de la source. Marcel avait saisi sa petite main. Moins troublé, il aurait remarqué combien elle était agitée, mais il songeait bien à observer en cet instant ! Il bredouilla :
– Merci, petite sœur. Sais-tu que tu es brave ?
Et elle, avec un mélange d’orgueil et d’humilité, répondit doucement :
– C’est toi qui m’as appris.
Ces mots indiquaient une complète évolution d’esprit chez Mlle Ribor. Le matin encore, elle prétendait diriger son frère de lait. En marchant à son secours, elle s’était senti des qualités d’audace, de sang-froid qu’elle s’ignorait. Elle s’était dit qu’elle devait cette valeur insolite au contact du tranquille courage de Simplet. L’ayant tiré du danger, c’est de lui qu’elle était fière. Le protégé était devenu le maître.
Roumévo ne leur permit pas de se livrer à leurs épanchements. Il réunissait le butin de l’expédition : deux fusils, ce qui, avec celui que la petite troupe possédait déjà, suffisait à l’armement de la garnison, une cinquantaine de cartouches et une gourde de betsabesse que Claude, dans sa précipitation, avait enlevée à un assiégeant, avec ses munitions.
– Au jour, nous pourrons ouvrir le feu, dit-il.
La face du Hova rayonnait. Il combattait l’ennemi héréditaire, le Betsileo.
– Moi, déclara Dalvan, je pense qu’il faut nous attacher à tuer les chiens.
– C’est de la rancune.
– Non, de la raison. On peut tromper la vigilance des hommes, non celle des bêtes.
Claude le toisa :
– Tu penses donc à quitter ce nid ?
– Parfaitement !
– Et serait-il indiscret de te demander de quelle façon ?
– Très indiscret ; mon idée n’est pas mûre, mais elle mûrira…
– Car elle est espagnole, fredonna le « Marsouin » ravi de son à peu près.
– En attendant, conclut Marcel, j’en suis pour ce que j’ai dit. Il faut détruire les chiens.
Comme personne ne répondit, le jeune homme s’allongea sur l’herbe et s’endormit ainsi que ses compagnons. Tous étaient fatigués. La journée avait été rude, et certes, si les Betsileos n’avaient été tenus à distance par le Fady, ils auraient eu beau jeu de surprendre les voyageurs.
Le soleil était déjà haut sur l’horizon lorsque Yvonne se réveilla. La mine reposée, elle s’assit et promena autour d’elle ses regards encore obscurcis par le sommeil. À quelques pas d’elle, Roumévo et Claude dormaient profondément. Le courrier ronflait en basse profonde, tandis que Bérard émettait sa respiration suivant un mode aigu.
La jeune fille sourit et chercha Marcel. Il n’était plus là. Elle tourna la tête de tous côtés, et finit par l’apercevoir presque à l’extrémité du plateau. Le sous-officier se livrait à une occupation qui intrigua Mlle Ribor.
De distance en distance, il enfonçait dans le sol des bâtons, et ceux-ci formaient une ligne sinueuse partant de la source et semblant devoir aboutir au bord même de la pente. Curieuse, Yvonne rejoignit son frère de lait.
– Que fais-tu donc ? interrogea-t-elle.
Il ne répondit pas directement, mais demanda :
– Tu ne t’ennuies pas ici ?
– Non, pas encore.
– Mais cela viendrait vite. Aussi je prépare notre fuite.
– Avec tes petits bâtons ?
– Avec mes petits bâtons.
Elle le regarda d’un air incrédule.
– Sois attentive, reprit-il doucement ; réfugiés sur une montagne sacrée, nous sommes bloqués par des gens qui ont le Fady en grande vénération. Or, nous avons profané le sol ; nos ennemis trouveraient donc naturel que les divinités en colère montrent de manière sensible leur mauvaise humeur.
– Oui, un miracle.
– Justement. Je prépare le miracle et j’espère, à la faveur de l’abêtissement dans lequel il plongera ces bons Malgaches, nous sortir d’ici.
– Ah ! fit-elle, prise par la confiance du jeune homme, et ce miracle ?
– Oh ! simple…
– Comme bonjour, acheva Yvonne, je n’en doute pas, mais dis toujours.
– Je veux bien. Voyons, suppose que d’un foyer incandescent jaillisse une source limpide, cela t’étonnerait ?
– Certes ; seulement si tu trouves cela simple…
– Mais oui. Que faut-il pour ces gens-là ? Leur donner l’illusion ; voici comment nous y arriverons. Les fruits de l’arbre à pain sont enveloppés de bogues aussi épaisses, que celles des châtaignes. Aucune récolte n’étant faite en ce lieu, nous avons sous les arbres une provision considérable de ces bogues desséchées qui ne demandent qu’à flamber.
– Je l’ai remarqué, en effet.
– Eh bien ! nous les entassons ici.
– Voilà le feu, mais l’eau ?
– Il faut l’apporter aussi. C’est à quoi je m’occupais tout à l’heure.
Et riant de l’expression étonnée dont le visage de Mlle Ribor était envahi :
– Mes morceaux de bois indiquent les points où jusqu’à quarante centimètres de profondeur il n’y a pas de roche. La terre se creuse facilement. Nous établissons un petit canal de dérivation entre la source et l’endroit où nous sommes ; la nuit venue, nous enflammons notre combustible et renversons la dernière barrière conservée pour l’eau. Les bogues brûlent, le ruisseau se précipite, dévale la pente semblant jaillir du brasier. Les Betsileos accourent, se prosternent, et nous, nous descendons l’ancien lit du cours d’eau. Protégés contre les regards par les végétations qui le bordent, nous gagnons la forêt, là-bas, au sud, et le tour est joué. Qu’en dis-tu ?
Elle frappa joyeusement ses mains l’une contre l’autre, appela Bérard, Roumévo, et fit tant qu’ils se réveillèrent. Mis au courant, ils applaudirent à l’idée de Dalvan.
– Seulement, objecta celui-ci, l’important est de nous débarrasser des chiens betsileos, car le miracle n’aura aucune influence sur leur flair. Nous allons aviser à cela, Claude et moi, tandis que Roumévo commencera à creuser le canal.
– Et moi, à quoi m’emploieras-tu ? réclama Yvonne.
– Toi, petite sœur, tu transporteras les cosses des fruits, après les avoir choisies.
Après un repas frugal, chacun se mit à la besogne. Simplet emmena le « Marsouin » et tous deux explorèrent la plaine. Une surprise leur était réservée. Loin déjà, une file de femmes, portant des vases de terre s’en retournait vers le village. Les ménagères avaient approvisionné les guerriers, tandis que les assiégés déjeunaient, mais les assiégeants avaient disparu. Autour du monticule, aucune silhouette d’homme ne se montrait.
– Pourtant, grommela Bérard, ils ne sont pas partis.
Soudain, il se frappa le front :
– Je comprends. Ils se sont terrés.
Souvent les indigènes, qui guettent un ennemi, creusent un trou en terre. Ils s’y étendent, recouvrent leur corps de sable et abritent leur tête, qui sort du sol, au moyen de pierres superposées.
De petits monticules disposés à distances régulières bossuaient la surface de la plaine. Ils avaient donné le mot de l’énigme à Bérard qui, on s’en souvient, avait habité Madagascar.
– Bon, fit Marcel, les hommes sont retrouvés, cherchons les chiens.
Mais il eut beau explorer les alentours, les bêtes malignes demeurèrent invisibles. Il s’impatienta, et s’adressant à son ami :
– Ton revolver est chargé ?
– Oui.
– Réserve-le pour l’ennemi à quatre pattes. Pour les autres, des coups de fusil seulement.
Puis il appela Roumévo.
– Tiens-toi en réserve derrière nous.
– Où vas-tu ? questionna Yvonne accourue aussitôt.
– Simuler une sortie, petite sœur, et tenter d’être aussi canicide que possible.
Et la voyant pâlir.
– N’aie pas peur, ajouta-t-il, nous serons prudents. Mais il faut bien que nous reprenions la recherche d’Antonin ; nous ne pouvons rester ici… Tu n’oublies pas que tu es toujours réputée coupable, et que chaque heure augmente la distance qui nous sépare de ton frère ?
Elle fit oui de la tête, incapable de parler, éprouvant une angoisse délicieuse. Simplet allait au-devant du danger pour elle, pour elle seule, et il le lui disait sans phrases. Son cœur battait avec force, sa vue se troublait. Un instant elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, les Français étaient engagés sur la pente. Roumévo les suivait à quelques pas, le fusil à la main, prêt à faire feu, et son visage bronzé exprimait une cruelle satisfaction. Yvonne croisa les mains et dans un souffle :
– Pourvu qu’il revienne sain et sauf !
Puis elle resta là à regarder. Les sous-officiers atteignaient la plaine. Un sifflement, léger comme celui du vent dans les joncs, courut dans l’espace ; enveloppant la colline d’un cercle sonore.
– On nous signale, dit Claude.
– Je m’en doute. Avançons, répondit Marcel.
De la main, il fit signe au courrier de garder la place qu’il occupait.
– Allons !
Et tous deux marchèrent droit sur les cachettes des assiégeants. Au tiers de la distance, Marcel commanda :
– Halte ! Genou terre !
Bérard exécuta le mouvement.
– Et maintenant, prends pour but ce tas de pierres, je choisis celui-ci… De la précision.
Chacun mit en joue. Dans le silence solennel, deux coups de feu éclatèrent ; le sable s’éleva en léger nuage aux points visés, et un guerrier, couvert de poussière, se dressa avec un hurlement. Comme s’ils avaient attendu ce cri, tous les assiégeants bondirent sur leurs pieds ainsi que des spectres vomis par leurs tombeaux.
En même temps des aboiements brefs résonnaient, et plusieurs chiens, détachés par leurs maîtres, se précipitaient en avant.
– Un… trois… cinq ! compta Marcel. Un tué cette nuit… Ça fait les six que nous avons remarqués… En retraite… revolver à la main.
Sans daigner riposter aux ennemis qui, tout en courant, déchargeaient leurs armes en poussant d’assourdissantes clameurs, Dalvan et son compagnon jouèrent des jambes.
À vingt mètres de la butte, la meute les joignit. Pressées, les détonations des revolvers se succédèrent. Quatre chiens roulèrent sur le sable.
Un seul était encore debout. Énorme, hérissé, l’œil sanglant, il barrait la route aux jeunes gens qui avaient épuisé leurs munitions.
Les Betsileos arrivaient. Yvonne, de son observatoire, suivait la scène. Elle tomba sur les genoux.
– Il est perdu !
Mais d’un mouvement rapide, Marcel avait tiré la baguette de son fusil.
– Le chien le plus féroce, disait-il à Claude, s’enfuit s’il est frappé aux pattes, donc…
La baguette siffla dans l’air. Le chien eut un aboiement rauque et se jeta de côté, livrant passage aux sous-officiers. D’un coup de fusil, Roumévo l’abattait aussitôt et avec ses amis reprenait le chemin du plateau, tandis que les assaillants, désappointés, regagnaient leurs cachettes en maudissant leurs insaisissables ennemis.
L’expédition avait réussi au delà de toute espérance. Maintenant il fallait travailler au miracle. Les trois hommes se mirent donc à creuser avec acharnement le canal, grâce auquel ils comptaient détourner le ruisseau.
Actionnés à leur besogne, ils ne remarquèrent pas qu’Yvonne avait pleuré. Les yeux rougis de la jeune fille disaient l’émotion qui l’avait secouée. Elle s’était remise à transporter les bogues à l’endroit désigné par son frère de lait.
Lorsqu’elle passait auprès de lui, elle le considérait longuement, heureuse de le voir vivant après l’avoir entrevu aux portes de la mort.
Au soir, malgré leurs efforts, les assiégés n’avaient effectué que les deux tiers de leur travail. Ils étaient harassés. Sans outils appropriés, la terre est dure à remuer. Cependant après avoir mangé quelques baies, l’obscurité s’étant faite, Marcel voulut encore préparer la portion du canal débouchant sur la rampe. De jour, les manœuvres des travailleurs eussent pu attirer l’attention de l’ennemi et nuire ainsi au succès final du stratagème.
Il était environ onze heures quand la garnison du mont « Fady » se livra à un repos bien gagné.
Sous le ciel paré d’étoiles, dans la tiédeur nocturne, des insectes décrivaient des zigzags bourdonnants, rythmant des palpitations de leurs ailes le sommeil des assiégés. Ils passaient, repassaient, tourbillonnant en farandoles dans les raies argentées dont la lune perçait le feuillage.
C’étaient le hanneton nacré, aux élytres changeants ; la libellule tricolore, au corps allongé, rayé de rose, de jaune et de bleu, aux longues ailes vertes ; les papillons de nuit, mesurant vingt centimètres d’envergure. Et puis aussi quelques moustiques dorés qui, du fond de la plaine, avaient été attirés par la présence d’une proie facile sur le plateau.
L’un d’eux piqua Marcel. Le jeune homme s’éveilla en sursaut. Au cou, il éprouvait une douleur vive, analogue à celle que causerait une forte piqûre d’aiguille. Il sourit. La cause du mal lui était révélée par la fanfare des moustiques.
Et, de suite, il songea à protéger contre eux sa sœur de lait, dont l’épiderme délicat était pour tenter ces insectes sanguinaires.
Un mouchoir remplirait l’office de moustiquaire. Doucement, pour ne pas troubler le repos de la jeune fille, il se glissa près d’elle.
Mais à deux pas, il s’arrêta surpris. Sur les épaules de la dormeuse une forme étrange s’agitait. C’était une boule plus grosse qu’une tête d’homme. Et deux appendices se mouvaient lentement comme deux bras.
Marcel se frotta les yeux. La vision persista. Alors Dalvan sauta sur ses pieds, armé d’un bâton qui se trouvait à sa portée.
L’objet inconnu quitta aussitôt sa place et s’éleva avec un grand bruit d’ailes. Mais un coup violent, porté par le sous-officier, le fit tomber juste sur la poitrine de Bérard, qui se dressa avec un juron.
L’objet se débattait et lui labourait le thorax de ses griffes. Avec l’aide de son ami, il réussit pourtant à s’en rendre maître. C’était une chauve-souris, de la taille d’une poule, bizarrement teintée de noir et de jaune. Le « Marsouin » la reconnut :
– Vampire, dit-il, excellente à manger. Variera un peu notre ordinaire demain matin ; mais assurons-nous qu’elle n’a pas mordu Mlle Yvonne.

L’observation avait sa portée. Ces chauves-souris, en effet, profitent du sommeil des hommes et des animaux pour les piquer sur une veine et se gorger de sang. Parfois elles absorbent jusqu’à un litre du précieux liquide. Point n’est besoin d’indiquer les résultats funestes d’une aussi copieuse saignée.
Yvonne avait été épargnée. Elle dormait les lèvres entr’ouvertes, son doux visage contracté par une expression de souffrance, et sous ses paupières closes, une larme avait filtré et glissait lentement sur sa joue.
Marcel la considérait, se demandant quelle douleur survivait en ce jeune corps anéanti dans le sommeil. La jeune fille fit un brusque mouvement ; elle murmura sur un ton de prière :
– Antonin… revenir en France… l’épouser !
Elle respira avec force et ne bougea plus. En face d’elle, Simplet restait comme pétrifié. Les paroles de la dormeuse l’avaient blessé au cœur. Pas un instant il ne pensa qu’elle rêvait de lui. Dans son esprit, un doute avait surgi.
– Elle aime quelqu’un en France. Elle a hâte de retrouver son frère et de retourner là-bas, où est celui qu’elle a distingué, pour l’épouser. Pourquoi ne m’a-t-elle jamais confié le secret de son cœur ?
Amère était la plainte, mais chez le brave garçon le reproche ne pouvait avoir une longue durée. Il revint vite à l’indulgence :
– C’est tout naturel, et je suis un butor de m’en étonner. La réserve d’une fillette ne s’accommode pas de ces confidences.
Et avec un accent de tendresse infinie :
– Ne crains rien, petite sœur, je t’appartiens quand même. Je travaillerai à ton bonheur. Tu reverras la France, rayonnante, honorée. Je t’amènerai, couronnée de fleurs, vers celui à qui ton âme rêve. J’éviterai ainsi la plus cruelle douleur qui me puisse atteindre : te savoir malheureuse.
Ses mains s’étendirent au-dessus de la tête d’Yvonne comme pour un serment, et il regagna sa place.
Seulement il passa la nuit à se tourner sans cesse. Un voile de deuil avait été brusquement jeté sur ses imaginations rosées. Son affection avait perdu l’espoir, et il restait au jeune homme une plaie cuisante que son dévouement, tout absolu qu’il fût, était impuissant à guérir. Lorsque le matin colora les cimes lointaines de la cordillère orientale, Dalvan se leva.
– À l’ouvrage ! se dit-il ; il faut délivrer Yvonne des Betsileos… pour l’autre, celui de France.
Puis haussant les épaules, il continua mélancolique et narquois :
– Il n’y a pas à le nier, les chauves-souris, ça présage le malheur.
Avec une activité fiévreuse, il se reprit à creuser le canal. Plus de deux heures s’écoulèrent, avant que ses compagnons vinssent le rejoindre. Le travail, ce grand consolateur, avait fait tomber sa surexcitation, apaisé les révoltes de sa pensée. Le calme lui était revenu et personne ne soupçonnait le drame intérieur qui l’avait torturé.
À midi tout était disposé pour le « miracle ». Le nouveau lit du ruisseau coupait d’une tranchée sinueuse la surface de la prairie. Près de la source on avait laissé un simple barrage facile à détruire. Les bogues sèches, amoncelées un peu en arrière du bord du plateau, afin de n’être pas aperçues par les assiégeants, formaient un bûcher de la hauteur d’un homme. Il n’y avait plus qu’à attendre les ombres propices de la nuit.
Entre les assiégés aucune conversation. Rassemblés auprès de la cascade, route de cristal qui devait les conduire à la liberté, ils gardaient le silence, absorbés par leurs pensées.
Toutes les inquiétudes du captif, durant les heures lentes qui précèdent l’évasion, assiégeaient les voyageurs. À chaque instant un visage se rembrunissait, montrant que son propriétaire se posait la redoutable question :
– Le stratagème réussira-t-il ?
Le mutisme de Marcel n’étonna donc personne. Tous crurent le jeune homme en proie aux préoccupations générales.
Ils ne remarquèrent pas le regard doux et triste, résigné comme celui du chien battu, qu’il oubliait souvent sur sa sœur de lait. Simplet disait l’adieu pénible aux illusions disparues. Il se traçait sa ligne de conduite. Toujours on ignorerait sa tendresse, pauvre oiselet, aux ailes trop faibles, tombé du nid avant d’avoir pu monter aux splendeurs bleues du firmament. Il serait l’ami fidèle, d’un dévouement sûr, car il n’en attendrait aucune récompense.
Et avec un serrement de cœur, il se promettait de jouer ce rôle ardu de gagner la confiance complète d’Yvonne, d’apprendre d’elle-même le songe mystérieux de son âme virginale.
Chez le sous-officier, un phénomène curieux s’accomplissait. Sous l’étreinte de la douleur, son être s’affinait, devenait immatériel. L’âme du petit soldat accoutumée aux devoirs simples : l’amitié, le drapeau, acquérait des complications de poète.
Non sans trouble, Simplet assistait à cette genèse de l’homme qu’il serait à l’avenir, et ses yeux se troublaient à sonder l’horizon toujours élargi du sacrifice.
Cependant Roumévo, pratique comme un homme familiarisé avec les vicissitudes de la vie sauvage, prépara un dîner succulent.
– Nous aurons à marcher cette nuit, affirma-t-il, il est utile de prendre des forces.
La chauve-souris, rôtie avec soin, parut délicieuse. Et de fait, la chair de l’animal rappelait celle des meilleurs poulets de Bresse.
Quoi qu’il en eût, Dalvan lui-même y fit honneur. Quand la mélancolie est soumise à des exercices violents, qu’elle est perchée sur une colline balayée par tous les vents du ciel, elle ne perd pas l’appétit, et maint rêveur anémique deviendrait vigoureux s’il promenait ses idées noires par des chemins de montagne. Du reste, l’instant d’agir était proche. Les Betsileos, auxquels les femmes avaient apporté de nouvelles provisions, avaient pris leur repas. Au lieu de se terrer de nouveau, ils s’étaient réunis par petits groupes, autour des tombes élevées aux guerriers tués pendant la sortie de la veille. Cette manœuvre avait inquiété les Français. Mais le courrier leur avait expliqué, que les assiégeants attendaient l’apparition de la lune pour entonner le chant de mort, hommage suprême auquel a droit l’homme frappé les armes à la main.
– Ils attendront peut-être longtemps, remarqua Simplet, le ciel est couvert de nuages, et madame la Lune semble avoir tiré ses rideaux.
En effet, au déclin du jour, des nuées épaisses poussées par un vent d’est – pluvieux à Madagascar alors qu’il est sec en Europe – avaient envahi la coupole céleste.
– Bon ! répliqua Roumévo, il suffit qu’elle se montre un instant.
Phœbé, presque aussitôt, glissa un pâle rayon entre deux nues, et un chant grave, solennel, s’éleva dans la plaine.
Parfois il s’abaissait ainsi qu’une plainte, puis les voix devenaient aiguës s’éraillant en cris de vengeance, et les strophes de la lugubre cantilène s’achevaient en sons hoquetés, heurtés, figurant des sanglots.
La lune de nouveau voilée, le plateau semblait une île perdue au milieu d’un océan d’ombre, et c’était sinistre d’entendre monter de la nuit le chant de mort des Betsileos.
– Maintenant, dit le courrier qui écoutait avec attention, ils nous maudissent et nous vouent à l’exécration des génies malfaisants.
– Alors, s’écria Marcel, c’est l’heure du miracle. Ils se croiront exaucés… Claude, allume le bûcher ; avec Roumévo, nous allons détruire le barrage.
Peu de minutes après, une flamme claire dansait au bord du plateau ; elle grandissait, grandissait au milieu de pétillements ; des gerbes d’étincelles s’éparpillaient avec des éclats stridents. Dans la plaine, des pas résonnaient, des froissements d’acier passaient nets dans le silence. Évidemment les assiégeants s’inquiétaient de la lueur brusquement apparue.
Et soudain un grand cri traversa l’espace. Le ruisseau dérivé avait empli son nouveau lit et roulait impétueusement sur la pente. Le canal passait sous le bûcher. L’onde semblait jaillir des flammes.
– Zenahari !… Zenahari !
À cet appel au dieu Soleil, Marcel répondit par une exclamation moqueuse.
– Ils coupent dans le pont ! Filons, et lestement.
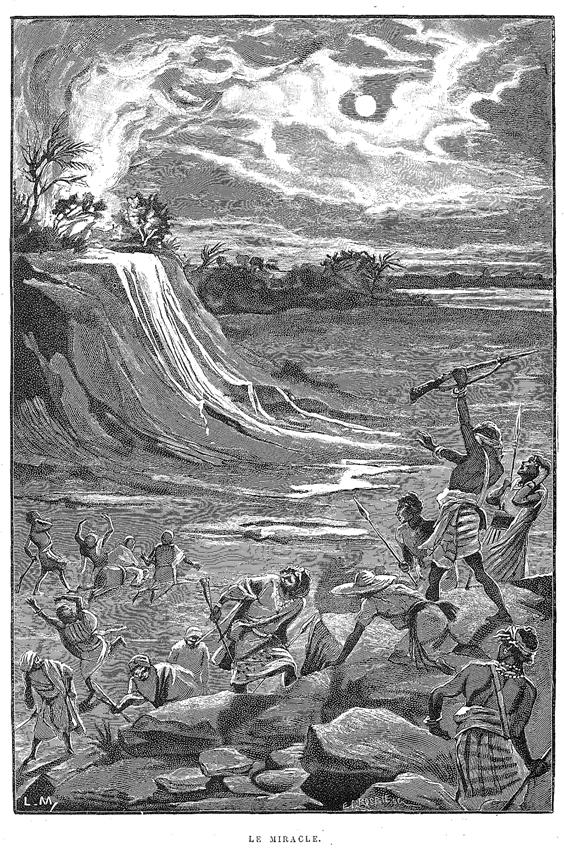
Suivi par ses amis, il gagna l’ancienne cascade et la descente commença. Difficile, périlleuse même ; les pieds glissaient sur les rochers polis par les eaux. Ici la paroi devenait lisse, et les ceintures, ajustées bout à bout permettaient à peine d’arriver au gradin inférieur. Plus bas, les degrés faisaient défaut, remplacés par une rampe raide, sur laquelle les fugitifs s’abandonnaient non sans anxiété. Ils glissaient dans la nuit opaque, brusquement arrêtés par un palier invisible.
Enfin, tous se trouvèrent les pieds dans l’eau, au fond d’une sorte de bassin vaseux. Ils avaient atteint le niveau de la plaine.
De l’autre côté de la colline sacrée, les vociférations continuaient. Sans nul doute, tous les Malgaches étaient réunis en face du point où se produisait le prodige.
Suivant le lit du ruisseau, la troupe reprit sa marche. Elle avançait difficilement sur le sol détrempé, parsemé de pierres et de trous encore emplis d’eau. Aussi, après un quart d’heure de ce fatigant exercice, certains d’avoir dépassé la ligne d’investissement, les fugitifs escaladèrent le talus et, côtoyant la haie d’herbes qui marquait le cours du ruisselet, ils se dirigèrent vers le sud.
Une clarté livide courut sur la plaine et s’éteignit. Tous s’arrêtèrent surpris. Un grondement formidable emplit l’atmosphère.
– L’orage ! cria Roumévo, hâtons-nous vers la forêt.
Mais quelque diligence que fissent les Européens, la tempête éclata avant qu’ils eussent gagné le fourré. De tous les points de l’horizon des éclairs lançaient leurs lumineux zigzags, des détonations ininterrompues éclataient dans les nues, et une pluie diluvienne s’abattit sur le sol subitement transformé en lac.
Aveuglés, courbés sous l’averse, tous se mirent à courir. En avant d’eux, une ligne plus sombre indiquait le taillis. Ils allaient l’atteindre, quand une nappe de feu les enveloppa avec un fracas assourdissant. Précipités à terre, ils entrevirent une masse énorme se renverser, et ils perdirent connaissance, à demi cachés sous les branches extrêmes d’un géant de la forêt terrassé par la foudre.
XVI
LE PAYS DES BARES
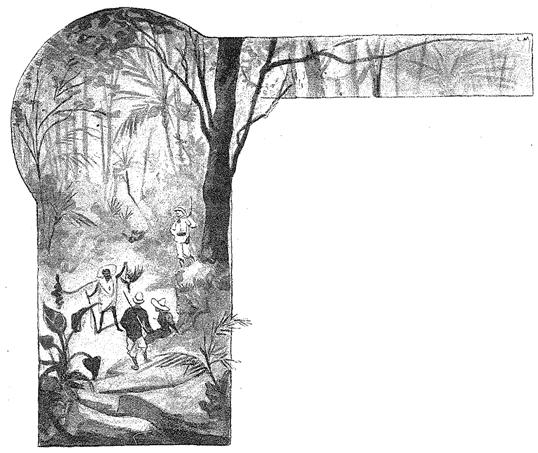
La première, Yvonne retrouva le sentiment. Elle était étendue sur le sol, la face tournée vers le ciel redevenu bleu. Elle regarda sans comprendre tout d’abord. Puis le souvenir lui revint ; elle se rappela et, très inquiète, elle chercha à se soulever pour apercevoir ses compagnons.
Son mouvement lui arracha un cri de douleur. Il lui sembla être contusionnée par tout le corps. Ses membres n’avaient plus de force. Mais elle lutta et parvint à s’asseoir.
Devant elle, une énorme boule verdoyante lui barrait la vue. C’était la cime de l’arbre déraciné par la tourmente. En regardant mieux, la jeune fille distingua ses compagnons enfouis sous les branches.
– Ils sont morts ! murmura-t-elle avec épouvante.
D’un héroïque effort elle se mit debout et, la poitrine serrée par l’angoisse, elle écarta les feuillages.
– C’est vous, mademoiselle Yvonne ? fit une voix faible.
– Oui, c’est moi… Mais Marcel, mais Roumévo sont ensevelis sous les branchages !
– Mâtin !
Et Claude, se traînant péniblement, sortit de sa verte prison. Une fois debout, il se livra à un vigoureux moulinet, afin de rétablir la circulation, et il aida Yvonne à délivrer ses amis. Dalvan avait reçu une blessure à la tête, plus effrayante que dangereuse heureusement, et bientôt les voyageurs constatèrent qu’en somme, l’aventure ne leur avait laissé qu’une forte courbature. Le meilleur moyen de combattre cette fâcheuse affection est l’exercice. Aussi, après s’être félicités, les amis franchirent la lisière de la forêt. Seulement Yvonne, si contente en découvrant que son frère de lait était sain et sauf, avait maintenant un visage assombri.
En lui disant son plaisir de la revoir vivante, Marcel lui avait paru froid, gêné, compassé. Elle ne se trompait pas. Mais dans l’impossibilité de deviner la brusque évolution produite dans l’esprit du jeune homme par son rêve parlé, elle lui fit un crime de son calme. Rougissante, elle se demanda s’il n’avait pas compris ses tendres inquiétudes.
– Mais si, se répondit-elle, ses regards, son accent, tout proclamait qu’il me savait gré de l’aimer davantage. Alors que signifie son attitude présente ? Veut-il me donner à entendre que son affection ne saurait aller au-delà de l’amitié ?
Et toute surprise de sa pensée :
– En vérité, qui donc lui demande cela… Eh bien ! je lui montrerai qu’il fait fausse route, je l’amènerai à regretter l’amitié qu’il refuse, car ce n’est que de l’amitié… Oh ! oui, rien que de l’amitié, rien que de l’amitié.
Avec l’adorable esprit de contradiction qui fait le charme de la femme et le malheur de l’homme, elle affirmait rondement, bien qu’ayant conscience de déguiser la vérité.
Seulement, ce qu’elle ne put déguiser, ce furent de grosses larmes qui jaillirent de ses yeux. Elle les essuya bien vite pour que Marcel ne les vît pas. Pourtant elle n’eût pas été fâchée qu’il les surprît, afin de lui faire honte. Songez donc, un homme qui coûte des pleurs à une femme, – c’est si lâche !
Partagée ainsi entre la crainte de parler et celle de se taire, tiraillée par des désirs adverses, Yvonne cheminait sans prendre garde aux merveilles végétales que sa jupe effleurait. Les sirikis noirs, perchés à l’intersection des branches, fixaient sur elle leurs yeux vifs ; les perroquets à collerette rouge, les perruches vertes babillaient sans réussir à attirer son attention.
Une fois ou deux seulement, le passage bruyant d’un cochon sauvage, l’envolée d’une poule sultane à la robe violette, la tirèrent de sa rêverie. Elle s’empressait d’y retomber.
Au soir, on dîna merveilleusement d’une sarcelle à tête rose, abattue par Roumévo, et d’œufs de caïman à l’enveloppe verdâtre trouvés sur le bord d’un étang.
Durant deux jours encore, les voyageurs firent route à travers les arbres. Un simple incident culinaire marqua les étapes. Roumévo escalada un palmier, dont la découverte avait amené un large rire sur sa face bronzée. Il coupa l’extrême cime et convia ses compagnons à s’en régaler. Ce qu’ils firent volontiers, car ce nouvel aliment n’était autre que le chou palmiste, dont les palais les plus délicats s’accommodent parfaitement.
La végétation devenait plus rare. Les herbes avaient disparu, et les amis d’Yvonne foulaient un terrain d’aspect jaunâtre. Les arbres se distançaient et perdaient leurs dimensions colossales. Des buissons chétifs leur succédèrent.
– C’est le désert, affirma Bérard. Quand j’étais en garnison dans l’île, on nous apprenait qu’au sud des provinces betsileos se trouve un désert, parsemé de buissons et habité par des peuplades sauvages, les Bares, dont les mœurs sont semblables à celles des Bushmen, voisins de la colonie du Cap.
Sur cette déclaration, les gourdes avaient été remplies à un maigre cours d’eau, et la caravane s’était portée en avant. Bientôt les assertions du « Marsouin » s’étaient vérifiées. Plus de chants d’oiseaux, plus de traces d’animaux. À perte de vue le feuillage grisâtre des plantes épineuses, qui croissent seules dans cette région. Plus de lacs, plus de rivières. Partout une terre sèche aux tons dorés.
Avec cela un soleil implacable. Il fallut renoncer à avancer pendant le milieu de la journée. C’eût été provoquer des insolations qui eussent arrêté la petite troupe. Et s’arrêter en ces lieux était se vouer à une mort certaine.
Au soir, haletants, la gorge séchée par la fine poussière que soulevait le moindre vent, les voyageurs s’arrêtèrent et inconsidérément vidèrent leurs gourdes. Quand Roumévo conseilla de garder une petite provision d’eau pour le lendemain, il était trop tard.
– Bah ! fit Claude, le désert malgache n’est pas grand : deux jours de marche à peine. Nous en sortirons demain.
Cependant une vague appréhension pesait sur tous, lorsqu’ils s’endormirent. Ils se réveillèrent avec une soif ardente. Le vent avait soufflé. Ils étaient couverts de poussière ; leurs narines, leurs lèvres desséchées se fendillaient.
– Debout ! ordonna Roumévo, marchons avant que le courage nous fasse défaut.
Vers dix heures, il fallut s’arrêter. La chaleur devenait intolérable. L’air semblait chassé par la gueule d’un four. Suffoqués, assommés par cette température, Marcel et ses amis se glissèrent sous des buissons, afin de se dérober aux brûlures du soleil. Et là, étendus à terre, la face congestionnée, ayant l’impression d’être enfermés dans une étuve, ils attendirent.
– Nous pouvons repartir.
Cette phrase, prononcée par Roumévo d’une voix spectrale, secoua les sous-officiers. Rampant sur les coudes et les genoux, ils quittèrent leur abri et se levèrent. Ils chancelaient. Dans leur crâne, il leur semblait que la cervelle bouillait et, pris d’une sorte de vertige, ils pensaient qu’autour d’eux les arbustes se mouvaient. Cependant ils vainquirent cette faiblesse et se disposèrent au départ.
– Et Yvonne ? demanda Dalvan.
Elle était restée étendue, les yeux clos. Il s’approcha.

– Yvonne, murmura-t-il doucement. Un peu de courage ; nous allons sortir de ce pays désolé.
Elle n’eut pas l’air d’entendre. Un sourire se joua sur ses lèvres.
– Des arbres verts, des moissons, de l’eau… Ah ! que c’est bon !
Le courrier avait entendu.
– Le délire, fit-il tristement ; si nous ne trouvons pas d’eau, elle ne pourra nous suivre.
Il se tut. Marcel l’avait saisi. Il le regardait d’un air égaré :
– Qu’as-tu dit ?
– La vérité, hélas !
– Alors, ma sœur ?…
– Est atteinte de la fièvre du désert et le seul remède, c’est l’eau.
Un instant, Simplet parut accablé ; puis se redressant :
– Eh bien, puisqu’il faut de l’eau à Yvonne, trouvons-en.
En vain le courrier essaya de lui démontrer l’inutilité d’une pareille recherche. Le jeune homme s’entêta. Profondément troublé, il répétait sans cesse cette phrase :
– Yvonne a besoin de boire ; c’est bien simple, il faut trouver de l’eau.
De guerre lasse, Roumévo céda. On chercherait pendant deux heures ; après quoi, on porterait la jeune fille sur les fusils entre-croisés, et on marcherait tant que les forces le permettraient.
En attendant, pour que les explorateurs ne se perdissent pas, le Tsimando attacha deux remingtons l’un au bout de l’autre, et surmonta le mât improvisé d’une baguette, à l’extrémité de laquelle il noua un mouchoir. Ce signal dépassait le niveau des arbustes d’un mètre cinquante environ, et devait s’apercevoir d’assez loin.
Toutes les précautions prises ainsi, les trois voyageurs partirent à la découverte. Mais ils eurent beau fouiller les fourrés, sonder le sol, nulle trace d’humidité ne leur apparut. De temps à autre, ils rencontraient des ravines creusées par les averses de la saison des pluies, mais la terre poreuse avait absorbé depuis longtemps les eaux du ciel.
Un à un, découragés, torturés eux-mêmes par la soif, ils revinrent au campement. Les yeux fixes, ils se regardaient. Leurs langues gonflées se refusaient à la conversation, et leur salive rare humectait insuffisamment leurs gosiers brûlants. Une sorte de torpeur les envahissait. Leur cervelle, subitement racornie, ballottait dans leur crâne ainsi qu’une amande sèche. Leur tête vacillait sur leurs épaules. Ils tentèrent un effort. Soulevant avec précaution leur compagne, ils la placèrent sur un brancard formé de deux fusils. Ils voulaient fuir droit devant eux, gagner une région plus clémente, avec de claires rivières aux rives ombreuses. Mais ils avaient trop présumé de leurs forces. Après cent mètres, ils durent s’arrêter. La frêle enfant pesait trop encore pour leurs bras affaiblis, et avec un désespoir farouche, ils la reposèrent sur le sable. Marcel appela ses compagnons.
– Partez, leur dit-il ; seuls vous réussirez peut-être à sortir de cette effroyable solitude.
Et comme ils refusaient :
– Il est inutile que vous périssiez avec nous.
– Mais toi-même, s’écria Bérard, pourquoi te condamnes-tu à périr de soif ?
Dalvan haussa les épaules.
– Je reste auprès d’elle.
– C’est la mort que tu cherches ?
– N’est-ce point le repos ?
Le ton de Simplet indiquait une résolution arrêtée.
Bérard cessa de discuter. Tranquillement il se coucha et ferma les yeux.
– Que fais-tu ? interrogea Marcel.
– Tu le vois, je reste aussi.
Un éclair passa dans l’œil du sous-officier. Il se mit debout et, d’un mouvement rageur, frappa la terre du talon. Un cri fou jaillit de ses lèvres, rugissement de damné apercevant le ciel. Sous le choc, la terre avait cédé, et des gouttelettes d’eau sautaient de tous côtés sur le sable.
– De l’eau !
Roumévo s’était précipité, et avec précaution il dégageait la partie supérieure d’une cavité ovoïde aux trois quarts emplie d’eau. Un peu bourbeuse peut-être, mais potable, mais capable de rendre l’existence à Mlle Ribor.
Les gourdes furent garnies, et Dalvan radieux, riant et parlant tout seul, fit couler quelques gorgées entre les lèvres serrées de sa sœur de lait. On eût dit que chaque goutte absorbée chassait une portion du mal. Les yeux de la malade s’ouvraient ; son regard voilé redevenait intelligent ; les roses de la vie remontaient à ses joues. Puis elle parla pour dire :
– Encore ! encore !
Elle but près d’un litre d’eau, et elle put se soulever, s’asseoir.
– Il me semble, déclara-t-elle, que je marcherais.
– Dans une heure, répondit le Tsimando, remettez-vous maintenant et laissez votre frère se rafraîchir à son tour.
Alors Marcel se souvint de sa soif, il l’apaisa et revint auprès d’Yvonne. Les gourdes pleines, les voyageurs largement abreuvés, la cavité se trouva vide. Claude, étonné de sa forme régulière, murmura :
– Ma parole, on dirait un œuf.
– C’en est un, en effet, répliqua Roumévo ; c’est un œuf d’œpiornis. Autrefois vivait dans l’île un oiseau gigantesque, auprès duquel l’autruche d’Afrique n’est qu’un oiselet. Ses œufs que l’on découvre parfois – jamais plus heureusement que celui-ci, par exemple – contiennent jusqu’à huit litres d’eau, c’est-à-dire six fois plus que l’œuf d’autruche. On peut juger ainsi de ce qu’était l’animal qui les pondait.
Le brave Hova mettait quelque orgueil à enseigner aux Français l’existence préhistorique du volatile unique au monde. C’était une production de sa terre natale, et s’il en était fier, un patriotisme un peu exagéré en était seule cause.
– Mais l’eau ? questionna Yvonne qui écoutait.
– Lors des dernières pluies, elle se sera infiltrée par une fente de la coquille. Une croûte sablonneuse a bouché l’ouverture et conservé, tout exprès pour vous sauver, un liquide dont vous ne rencontreriez pas trace à vingt kilomètres à la ronde.
Ragaillardis, oublieux des souffrances passées, les voyageurs partirent allègrement. Dans les bidons soigneusement bouchés, l’eau captive se démenait avec des glouglous encourageants. Nulle mélodie n’eût paru aussi douce aux oreilles de gens à peine échappés aux affres de la soif.
Toute la nuit, ils allèrent de l’avant, étonnés eux-mêmes de leur vaillance. Ils ignoraient que la soif tue avant l’épuisement des forces. Elle suspend la vie, qu’un peu d’humidité rend avec toute son activité. Aux approches du jour d’ailleurs, des signes certains montrèrent que le mauvais pas était franchi. Des plantes vertes, rares d’abord, succédaient aux buissons épineux. Puis vinrent des arbres, de taille exiguë encore, avant-garde naine des puissantes futaies.
Enfin, alors que l’horizon oriental rougissait, la caravane, épuisée mais joyeuse, fit halte au bord d’une petite rivière, qui couvrait de cinquante centimètres d’eau un fond sableux brillant comme de l’or. Sur chaque berge, des arbres s’élevaient ainsi que des colonnes et unissant leurs branches à cinquante pieds du sol, formaient une voûte feuillue impénétrable aux ardeurs solaires.
Les voyageurs se baignèrent. Yvonne avait remonté le courant et, à peu de distance, elle avait découvert une petite crique formant un ravissant cabinet de verdure. Avec délices la jeune fille barbota dans l’eau courante ; puis rafraîchie, elle rejoignit ses compagnons. Ceux-ci, établis dans une clairière gazonnée, parsemée de troncs abattus – sans doute un cyclone avait passé par là – étalaient leurs provisions sur le tapis vert.
Profitant de l’absence de la jeune fille, ils avaient fait une ample cueillette de fruits. Noix de coco, mangues, bananes s’amoncelaient, tandis que Roumévo, accroupi auprès d’un foyer formé de deux pierres, assujettissait au-dessus de la flamme une superbe pintade qu’il venait de capturer.
– Dans un quart d’heure, mademoiselle sera servie, s’écria Marcel en apercevant sa sœur de lait.
– Ah ! fit-elle, tant mieux ; je meurs de faim.
– Le meilleur des assaisonnements, affirment les philosophes.
– Je le possède à ce point que j’en oublie la fatigue.
– Tu dévoreras, petite ogresse, et après… tout le monde au dortoir… Comme les noctambules parisiens, nous nous blottirons dans les bras de Morphée à huit heures du matin.
Curieuse, Mlle Ribor alla jeter un coup d’œil sur la broche qui traversait la pintade. Elle était primitive. Une baguette de fusil supportée par deux pieux fichés en terre.
– Le triomphe du remington, avait déclaré Dalvan ; cette arme sans pareille sert à abattre le gibier, et à le faire cuire au besoin.
Le volatile, soigneusement retourné par le courrier, commençait à prendre une teinte dorée du plus appétissant aspect.
La jeune fille regarda autour d’elle. Pour le repas, il ne manquait rien. Ses compagnons fournissaient la volaille et le dessert. Elle voulait apporter sa part de contribution cependant. Et elle songea que les fleurs sont le complément de tout bon dîner. Elles sont la gourmandise des yeux. Faire un bouquet était facile. Des fleurs multicolores émaillaient la clairière. Yvonne se mit à en cueillir une gerbe.
Les muguets sauvages, les rouges arkatra, les lombodi à la corolle bleue veinée de noir s’entassaient en odorante botte sur le bras de la blonde voyageuse. Bientôt le fardeau devint gênant. Du regard la jeune fille chercha un endroit, où elle pût disposer ses fleurs.
À la lisière même du fourré, entre des buissons étoilés de blanches floraisons, était couché un jeune arbre, au tronc poli, renversé depuis peu certainement, car son écorce ne présentait pas ces moisissures qui rongent les géants sylvestres terrassés. Le coin semblait être fait exprès. La jolie bouquetière y courut, s’assit sur le siège mis à sa disposition par la forêt et jeta devant elle son tas de fleurs.
Déjà, entre ses doigts menus, elle tenait les tiges dont les brisures laissaient goutter la sève ainsi que des larmes, quand il lui parut que le tronc d’arbre s’agitait. Étonnée, elle pensa se lever. Elle n’en eut pas le temps. Renversée brutalement en arrière, elle se sentit enlacée par une spirale vivante, et au-dessus de son visage, elle aperçut une gueule énorme dont l’ouverture ne mesurait pas moins de quarante centimètres. Elle poussa un cri aigu et ferma les yeux, n’osant pas regarder venir la mort.
Le tronc d’arbre, sur lequel Yvonne avait pris place, était le corps d’un boa constrictor de grande taille. L’animal, sans doute engourdi par une digestion laborieuse – on a vu des boas rester plusieurs heures sans mouvement après la déglutition d’une proie – n’avait pas bougé tout de suite. Mais, si légère que fût Mlle Ribor, son poids avait causé au reptile un sentiment de gêne tel, que surmontant sa paresse, il avait songé à se venger de l’être importun qui l’étouffait.
Au cri d’Yvonne, ses amis s’étaient élancés. Puis ils étaient demeurés cloués sur place devant le terrible tableau. Le boa avait à peine dardé sur eux le regard de ses yeux jaunes et, d’un mouvement presque insensible, il abaissait sa tête vers le visage blêmi de sa victime. Sa gueule allait toucher le front de la vierge…, les mâchoires distendues se refermeraient, et le sacrifice serait consommé.
Claude épaula son fusil. Mais, plus rapide que lui, Marcel releva l’arme.
– Comme cela, c’est elle que tu atteindras.
Yvonne eut une plainte :
– J’étouffe !
Le constrictor se mettait à serrer celle qu’il tenait captive dans ses anneaux. Dalvan bondit, et soudain ses compagnons le virent s’arrêter ; un sourire courut sur sa physionomie bouleversée.
– Que je suis bête ! dit-il.
Ils crurent qu’il devenait fou. Mais lui continuait :
– Simple comme tout de le faire lâcher, la flûte des charmeurs !
Et doucement il se prit à siffler. Presque bas au début, le son s’enfla bientôt. Comprimant le frisson d’angoisse dont son être était secoué, Marcel lançait aux échos de la clairière l’enlaçante mélodie de la Vague. Le grand artiste, qui fut Olivier Métra, ne se doutait pas qu’il serait exécuté un jour dans de telles conditions.
Dès les premières notes, le reptile avait été parcouru comme par une commotion galvanique. Sa tête allongée s’était redressée et ses yeux, subitement couverts d’un voile, s’étaient fixés sur le musicien. Puis il se balança d’un mouvement rythmé, et comme le sous-officier, sifflant toujours, s’éloignait un peu, le serpent abandonna sa proie, ses anneaux glissèrent avec un frottement métallique sur la robe d’Yvonne, et il rampa vers le charmeur improvisé.
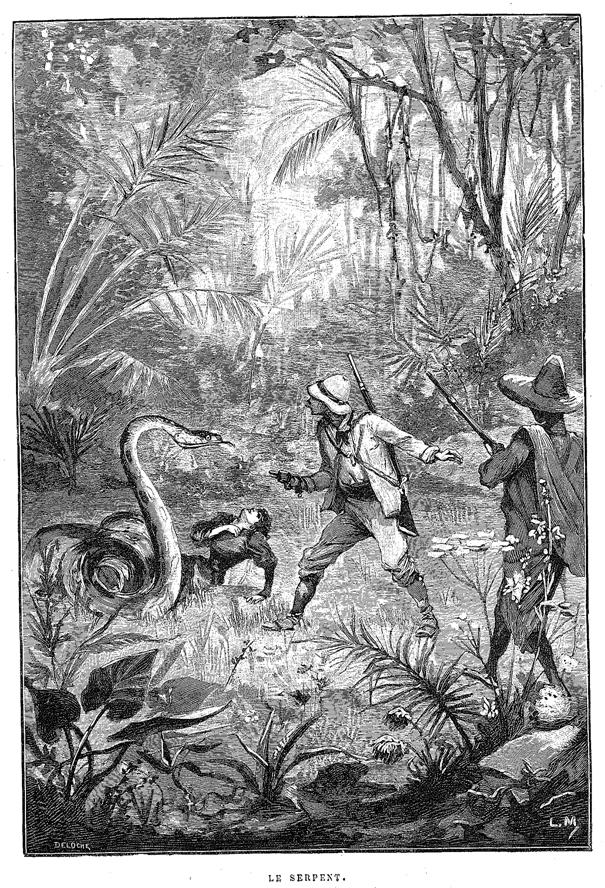
La hideuse bête se rapprochait, tout le corps oscillant en mesure. Marcel, à quelques pas, s’était arrêté. Mais l’attraction musicale continuait. Le boa, arrivé près de lui, avait levé la tête jusqu’à la hauteur de celle du jeune homme, et là, les regards papillotants, il semblait littéralement boire les sons.
Bérard et le courrier, qui assistaient immobiles à ce surprenant duel, virent Marcel prendre son revolver, porter lentement le canon en face de la gueule entr’ouverte du monstre. Le coup partit, et la tête éclatée, le constrictor se convulsa furieusement sur l’herbe, fauchant de sa queue les arbustes à sa portée.
Insoucieux de son agonie, son vainqueur courut à Yvonne, auprès de qui ses compagnons s’empressaient déjà. La jeune fille n’avait point perdu connaissance. Comme en rêve, elle avait vu le danger et le sauveur. À l’arrivée de Marcel, elle fit un mouvement pour se jeter dans ses bras.
Lui-même allait l’étreindre contre sa poitrine. Mais ils se souvinrent de leur douloureuse erreur. Dans un éclair, ils se dirent : lui, qu’elle en aimait un autre ; elle, qu’il ne l’aimait point ! Et ils restèrent glacés, muets, embarrassés d’être en présence. Enfin, Mlle Ribor surmonta son trouble et tendant la main à son frère de lait :
– Merci, Marcel, murmura-t-elle en détournant la tête.
Et Dalvan, comprimant avec peine les paroles affectueuses qui se pressaient sur ses lèvres, répondit comme inconscient :
– Il n’y a pas de quoi, petite sœur.
Bérard, qui ne pouvait comprendre le malentendu existant entre les jeunes gens, haussa les épaules et grommela rageusement :
– En voilà une petite drogue ! Son frère de lait passe sa vie à sauver la sienne. Elle le remercie du bout des dents. On dirait que ça lui est dû. J’ai déjà remarqué d’ailleurs son indifférence. Pour sûr que si ce n’était pas pour Marcel, je l’abandonnerais et je m’amuserais à la voir se débrouiller toute seule.
Décrivant un cercle afin d’éviter de passer auprès du boa toujours agité par l’agonie, tous allèrent prendre place à l’endroit où étaient déposées les provisions. Le repas fut silencieux. L’émotion avait paralysé l’appétit. La pintade parut coriace, les fruits amers.
Le déjeuner expédié, on pensa à dormir. Mais l’aventure récente avait prédisposé les esprits à l’inquiétude. Il fut convenu que chaque homme veillerait à tour de rôle. Le premier quart échut à Bérard. Roumévo s’étendit aussitôt sur l’herbe. Yvonne fit de même. Pour Marcel, il se retira à l’écart. La tête appuyée sur ses mains, mécontent de lui-même et des autres, il se reprocha de souffrir, comme si la volonté de l’homme pouvait enrayer la douleur.
Trois jours plus tard, le 19 février, ayant traversé une riche contrée où l’air était embaumé de jasmin et les nuits semées de mouches à feu, étincelles vivantes, les voyageurs atteignirent la mer. Là, Roumévo leur désigna un promontoire qui se profilait à l’horizon.
– Fort Dauphin ! dit-il. Vous y serez en sûreté et trouverez certainement un moyen de quitter Madagascar. Moi, j’ai rempli ma mission. Mon frère de sang n’est plus en danger ; je retourne à mon devoir auprès de ma souveraine.
En vain les Européens cherchèrent à le détourner de son projet. Il persista. Et tous éprouvèrent la tristesse de la séparation. Ils s’étaient attachés à ce compagnon fidèle, qui pour eux avait risqué sa vie, sa liberté. Il ressentait peut-être les mêmes choses, mais son visage sombre ne trahissait point sa pensée ; seulement, à l’heure du départ, il réunit dans sa main celles d’Yvonne et de Marcel. Il les considéra un moment comme absorbé, et avec un accent vibrant qui leur causa un inexplicable malaise :
– Vous serez heureux, prononça-t-il ; vous oublierez le frère Hova. Roumévo, lui, se souviendra toujours.
Puis il saisit son fusil, le jeta sur l’épaule et s’éloigna vers le nord d’un pas rapide, sans regarder en arrière. Longtemps les Français le suivirent des yeux, et quand il eut disparu, ils se décidèrent à prendre la route du sud.
À une vingtaine de kilomètres se trouvait Fort-Dauphin, l’un des premiers établissements français à Madagascar, fondé en 1643 par Pronis, gouverneur de la Compagnie de l’Orient, pour le compte de Louis XIV, roi de France.
Tout alla bien d’abord. Un chemin, qualifié de route dans le pays, longeait la côte. La marche était facile ; mais à mi-chemin les voyageurs atteignirent une petite crique. La mer montait lentement, mettant à flot des pirogues laissées sur le sable.
– Tiens, fit Marcel, si un pagayeur voulait nous conduire à Fort-Dauphin, il nous économiserait quelques heures de fatigue.
– Bonne idée, appuya le « Marsouin » ; seulement, si les rames sont dans les embarcations, les rameurs restent invisibles.
– Ils ne sauraient être loin.
– C’est probable.
Et tous deux scrutèrent les environs d’un regard circulaire ; aucun être humain n’apparaissait. De grands arbres, dominés par le parasol des palmiers, formaient un obstacle à la vue.
– Ma foi, reprit Marcel, faisons comme en France, quand le passeur a abandonné son bachot.
– Quoi donc ?
– Prenons place dans une pirogue ; cela fera accourir le propriétaire, qui nous guette, j’en jurerais.
La proposition était raisonnable. En un instant, tous trois furent assis au fond d’une des frêles embarcations. Ils s’étaient un peu mouillé les pieds, mais bah ! Dalvan plaçait les avirons et déclarait :
– Si le piroguier tarde, je lui tire ma révérence et je nage. C’est ainsi que vous dites dans la marine, n’est-ce pas, Claude ?
Le « Marsouin » sourit, prêt à répondre, mais le temps lui manqua. Des sifflements se firent entendre ; il sembla un instant qu’une armée de serpents évoluât autour des Français ; une grêle de projectiles s’abattit, faisant jaillir l’eau, et dans le bordage, clouant la manche de Bérard, une longue flèche se planta en vibrant. Tous regardèrent du côté du rivage. L’explication du phénomène se présenta aussitôt à eux. En avant des arbres, une cinquantaine de Malgaches au torse nu, les hanches ceintes d’un jupon de cotonnade, bondissaient en brandissant leurs arcs.
– Nous allons essuyer une seconde bordée ! s’écria Marcel ; prévenons-les.
Il avait épaulé son fusil. Claude avait déjà accompli le même mouvement. Deux assaillants, atteints par les balles, s’affaissèrent. Les ennemis s’arrêtèrent indécis.
– Aux avirons ! ordonna Claude, profitons de ce court répit.

Les sous-officiers se penchèrent sur les rames, et la pirogue, glissant sur les eaux ainsi qu’un oiseau, s’éloigna du rivage. Mais le premier mouvement de surprise passé, les Malgaches gagnaient la grève. Rapidement ils montaient dans les pirogues restées près du bord, et se lançaient à la poursuite des Européens.
– Ce sont des Bares, déclara Bérard, je les reconnais à leurs tatouages. Ce sont des sauvages féroces, vivant de chasse et de rapines. Tout plutôt que de tomber entre leurs mains.
Redoublant d’efforts, les jeunes gens ramaient vers la haute mer. La pirogue filait, laissant en arrière un sillage d’écume. Mais les indigènes conservaient leur distance. Durant dix minutes, la chasse continua sans avantage appréciable. Mais alors les Français comprirent qu’ils seraient fatalement vaincus dans cette lutte à l’aviron, car les Bares, plus nombreux, se relayaient.

– Tant pis ! gronda Marcel, reprenons les fusils.
Mais Yvonne secoua la tête :
– Non, au contraire, ramez, ramez toujours ! Il nous arrive du secours.
Sa main se tendait vers l’océan.
– Qu’est-ce ? interrogea Simplet, faisant écumer les flots sous la poussée nerveuse de la cuiller de l’aviron.
– Un navire !
– Appelle son attention ?
– Comment ?
– En déchargeant nos armes.
La jeune fille attira les fusils à elle. Les détonations vibrèrent dans l’air et, dépassant les volutes de fumée rampant à la surface des vagues, l’embarcation poursuivit sa course rapide. Deux fois encore, Yvonne tira. Alors elle eut un cri joyeux :
– Ils ont entendu ! Le vaisseau modifie sa route, il vient vers nous.
Soudain, un ronflement leur fit lever les yeux. Un obus passa au-dessus de leurs têtes et alla couper en deux l’une des pirogues de la flottille bare. Le bruit assourdi de la détonation arrivait en retard de quelques secondes.
Terrifiés, les indigènes retournaient vers le rivage à force de rames. Les voyageurs n’avaient plus rien à craindre de leur côté. Alors une nouvelle inquiétude les prit.
Si le navire était français, il leur faudrait déguiser leurs noms, raconter une histoire de brigands pour expliquer leur présence, car ils étaient sous le coup de la loi, et une maladresse aurait eu des conséquences désastreuses.
En peu de mots, ils arrêtèrent les grandes lignes de leur fable. Le temps pressait. Le vaisseau avait mis un canot à la mer. Bérard ne disait rien ; il regardait dans la direction du steamer :
– Sapristi ! exclama-t-il, est-ce que j’ai la berlue ?
– La berlue ?
– Certainement, il me semble que je reconnais ce bateau-là ?
Marcel examina le navire avec attention.
– Ce n’est pas possible ! fit-il avec étonnement.
– Ah ! tu le reconnais aussi ?
– Comment serait-il dans ces parages ?
– Je n’en sais rien, mais maintenant, je ne doute plus. C’est le Fortune.
À ce nom, Yvonne eut un mouvement brusque qui pensa faire chavirer l’embarcation :
– Le Fortune ? le yacht de cette charmante miss Pretty ? Êtes-vous certain de ce que vous affirmez ? Moi, je suis incapable de distinguer un vaisseau d’un autre.
– Oh ! c’est bien lui, reprit Marcel ; et tenez, regardez l’homme assis à l’arrière du canot qui vient à nous ?
– L’intendant !
– William Sagger ?
– En chair et en os.
Le digne licencié ès sciences géographiques trônait en effet à l’arrière de la chaloupe. Lui aussi avait reconnu les voyageurs il leur adressait des signes incompréhensibles. Bientôt les embarcations furent bord à bord. Abandonnant la pirogue, Yvonne et ses amis prirent place auprès de l’intendant, non sans lui avoir vigoureusement secoué la main. Ils n’osaient l’interroger, bien qu’ils eussent sur les lèvres cette question curieuse :
– Comment nous rencontrons-nous au sud de Madagascar, à sept cents kilomètres du point où nous nous sommes quittés ?
Du reste, la réponse ne se fit pas longtemps attendre, et ce fut miss Pretty elle-même qui la leur donna. Elle les attendait sur le pont, et son premier mot fut :
– Ah ! mes chers amis, que je vous ai cherchés !
Elle embrassa follement Yvonne, pressa les mains des jeunes gens à les briser et les entraîna dans le petit salon d’arrière, où elle les avait reçus pour la première fois. Toute sa hauteur yankee avait disparu ; elle parlait avec volubilité, comme hors d’elle-même. Les paroles se pressaient, s’élançant impétueusement de sa bouche rose comme un torrent aux digues rompues.
– J’ai pour vous beaucoup d’affection… oh ! beaucoup.
Ici un regard à Claude Bérard.
– Je m’en suis aperçue après votre départ à la Pointe-aux-Îles. Vous me manquiez trop. Alors je me suis rendue à Diego-Suarez. Je voulais vous faire la surprise. Je vous ai attendus toute une semaine. Personne ! Je mourais d’impatience. Que vous était-il advenu ? Par bonheur, un soldat sakalave vint de Port-Louquez ; il racontait la rencontre d’étrangers. Il était de l’escorte d’un chef… Ikaraïnilo.
– Le misérable ! interrompit Mlle Ribor.
Sans prendre garde à l’interruption, l’Américaine continua :
– Au signalement, je vous reconnus. Vous descendiez au sud. Il fallait vous retrouver… Le Fortune leva l’ancre. De port en port, j’allais, cherchant vos traces. À Tamatave, j’appris une partie de vos aventures. On ignorait votre identité. Mais ces deux jeunes gens, accompagnant une demoiselle, dont on me parlait, ne pouvaient être que vous. Je sus ainsi que vous aviez quitté Tananarive pour éviter la vengeance des Hovas. Comme vous n’aviez pas reparu sur la route de Tamatave, le Résident – un homme charmant qui s’était mis à mon entière disposition – pensait que vous aviez dû vous enfoncer dans les territoires du sud. Je repartis ; mais je commençais à désespérer. En aucun point de la côte vous n’aviez été signalés. Partout où je m’arrêtais, je laissais une lettre pour vous à l’adresse naïve : Deux gentlemen et une lady. Enfin, vous voici… ; et maintenant nous allons faire le voyage ensemble, je ne vous quitte plus.
– Excepté quand nous descendrons à terre, déclara Bérard.
– Si, si, même alors.
– Du tout, miss. Vous resterez à bord, et je pense que mademoiselle Yvonne consentira à vous tenir compagnie.
– Moi ! s’écria la jeune fille.
– Il le faut. Vous n’êtes pas assez forte pour supporter les fatigues auxquelles on est condamné dans les pays neufs. Votre présence double les chances d’insuccès. Souvenez-vous ; dix fois, nous avons failli rester en panne. Ce n’est pas votre faute, mais vous seriez coupable de vous obstiner.
Et comme Yvonne baissait la tête, un peu saisie de la mercuriale, le « Marsouin » reprit, s’adressant cette fois à miss Pretty :
– On vous racontera nos aventures. Vous verrez qu’avec une femme, nous avons eu bien du mal à traverser Madagascar… Avec deux nous serions morts à la peine.
Toute la rancune du soldat, contre celle qui avait été un impedimentum, et à qui il reprochait de se montrer ingrate, vibrait dans la voix de Claude. Lui, qui d’ordinaire était doux, silencieux, parlait avec autorité, forçant la note brutale. Et chose curieuse, l’Américaine autoritaire, l’enfant gâtée de la fortune inaccoutumée aux résistances, n’avait aucune révolte. Son attitude était celle du baby que l’on gronde. Claude était le premier homme qui eût osé ordonner, elle présente. Cependant, quand les sous-officiers furent rentrés dans leur cabine, laissant les jeunes filles seules en présence, miss Pretty enlaça calmement la taille d’Yvonne et baissant la voix :
– Ma chère amie, vous avez entendu ce qu’a dit M. Bérard ?
– Oui, oui.
– Et quel est votre avis ?
– Il a raison, par malheur. Ces semaines passées à l’intérieur de l’île n’ont servi qu’à me décourager.
– Vous vous soumettrez donc à ses conditions ? Vous resterez sur ce navire alors que nos amis affronteront le péril ?
Mlle Ribor eut un geste vague. La déclaration du « Marsouin » l’avait attristée. Sans nul doute, il avait dû s’entendre avec Marcel, et Marcel pensait comme lui qu’elle ne pouvait les suivre. Mais sa résignation parut exaspérer l’Américaine.
– Eh bien donc, ma chère amie, vous obéirez s’il vous plaît, mais moi…
– Vous, que ferez-vous ?
– Je suivrai M. Claude – elle se reprit vivement – ces messieurs partout où ils iront.

XVII
LA RÉUNION
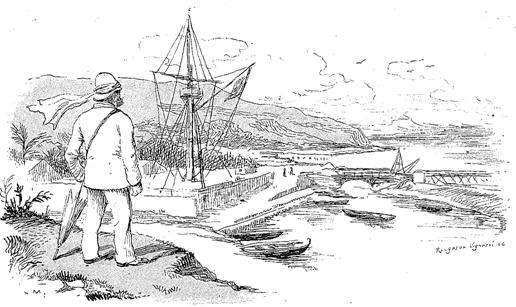
Le soir, après le dîner, tout le monde se réunit au salon. À la demande de Marcel, qui étudiait une carte détaillée de l’île de la Réunion, William Sagger avait été convié à déposer sa livrée d’intendant et à prendre le thé, comme gentleman, avec les voyageurs.
– Miss Pretty, déclara Dalvan, désire nous aider dans nos recherches et mettre son navire à notre disposition. L’offre est trop généreuse, le plaisir trop grand pour que nous refusions. Donc, nous allons cingler vers l’île de la Réunion, la possession française la plus proche de Madagascar.
– Sept cent quatre-vingts kilomètres, articula nettement William.
– Merci bien. Je compte sur vos connaissances géographiques pour me guider.
– À vos ordres.
– Trop aimable.
– Vous voulez savoir ?
– Voici. Pour retrouver Antonin Ribor, il faut le chercher là où il peut aller. Voyageur commercial par métier, scientifique par goût, quelles choses ont pu l’intéresser à la Réunion ?
L’intendant réfléchit une minute, puis tranquillement :
– Le port de la Pointe des Galets, port artificiel ouvert le 1er septembre 1886, qui reçoit toutes les expéditions de l’île.
– Nous gagnons donc le port de la Pointe aux Galets, dit l’Américaine, et après ?
– Après, l’explorateur a vu le chemin de fer qui entoure presque complètement l’île, se prolongeant à l’ouest jusqu’à la ville de Saint-Pierre, à l’est jusqu’à Saint-Benoist, en passant par Saint-Denis, chef-lieu du gouvernement. Il a dû pencher pour la direction de Saint-Denis - Saint-Benoist.
– Pourquoi ?
– Parce qu’à une journée de marche du point terminus se dresse la merveille de l’île, le Grand Brûlé.
– Le Grand Brûlé ?
– Volcan en activité !
Bérard se leva d’un bond :
– Un volcan français ! Enfin. Depuis que j’ai l’âge de raison, on m’assomme avec les volcans italiens, islandais ou autres. Le Vésuve, l’Etna, l’Hékla. Tout le monde en a plein la bouche, et nous faisions triste figure avec nos volcans éteints d’Auvergne… Mais nous en possédons un en activité, crachant du feu, des laves, du soufre, capable de causer des tremblements de terre, de couvrir de cendres Herculanum et Pompéia, si ces villes étaient à sa portée. Mon patriotisme se dilate. Et est-il seulement beau ce Grand Brûlé ?
– Je vous crois, trois fois la hauteur du Vésuve.
– Bravo ! Enfoncée l’Italie !
– Au milieu d’un cirque, dont le développement est de quarante-cinq kilomètres…
– Quarante-cinq kilomètres ! je bois du lait.
–… Et dont les parois, coupées de rares chemins d’accès, forment un mur vertical de 250 à 300 mètres…
– Délicieux !
–… S’élève à 2,625 mètres le piton Bory, ancien cratère obstrué maintenant.
– Ah ! protesta Claude, obstrué le cratère !
– Attendez donc ; le nouveau, moins haut de 100 mètres, le piton de la Fournaise, est perpétuellement couronné de vapeurs, et ses éruptions envoient à 20 kilomètres des coulées de laves former des promontoires sur la côte.
Le « Marsouin » exultait. Il donna au géographe un vigoureux shake-hand, et il allait sans doute s’abandonner à un accès de lyrisme, quand Marcel prit la parole.
– Il me paraît évident que notre ami a dû choisir la route que vous indiquez ; aussi, si notre aimable capitaine – il regardait Miss Pretty – ne s’y oppose pas, le Fortune jettera l’ancre à la Pointe aux Galets.
L’Américaine approuva d’un signe de tête.
– Là, je descendrai seul à terre. Le chemin de fer me conduira à Saint-Benoist, où le yacht viendra m’attendre.
– Pourquoi seul ? hasarda Yvonne.
– Parce que l’île est petite.
– Soixante et onze kilomètres sur vingt et un, murmura Sagger.
– Que la côte est très habitée et que, si nous sommes signalés aux autorités, seul, je n’attirerai pas l’attention.
– Voilà, appuya Claude, si enchanté qu’Yvonne ne fût pas du voyage, qu’il ne protesta pas pour lui-même.
En somme, les raisons de Simplet étaient plausibles. La séparation durerait deux jours à peine. Yvonne ne résista pas davantage.
Le lendemain, au coucher du soleil, le yacht, pavillon américain déployé, passa devant la Pointe des Galets. Parcourant de bout en bout le bassin, le steamer gagna l’une des darses ou bras ménagés au fond de chaque côté du terre-plein, supportant les magasins-docks à étage, et accosta près d’un solide appontement, à la racine duquel passait l’embranchement ferré qui, 500 mètres plus loin, se reliait à la ligne principale.
Après une dernière nuit à bord, le 21 de grand matin, Dalvan débarqua, et d’un pas allègre se rendit à la gare.
– Il fait beau temps, monsieur, dit un employé en se découvrant. C’est rare en cette saison. Vous faites bien d’en profiter, car cette éclaircie finira dans un cyclone, ou je me tromperais fort.
– Vous croyez ?
– Voici vingt ans que j’habite l’île. Chaque fois que durant la saison des pluies, le ciel s’est nettoyé comme ça… cela n’a pas manqué. Une tempête à tout casser.
– Est-elle proche à votre avis ? demanda le sous-officier, déjà inquiet pour ses amis.
– Ah ! on ne sait jamais. Peut-être demain, peut-être dans huit jours.
La voix d’un agent cria :
– Les voyageurs pour la Possession, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Cap-Fontaine et Saint-Benoist… En voiture !
– Que de saints, murmura Simplet en courant prendre place dans un véhicule, assez semblable aux wagonnets du petit chemin de fer Decauville qui desservit l’Exposition de 1889.
Deux heures après le convoi déboucha dans la vallée de la rivière de Saint-Denis. En arrière, sur les hauteurs, apparaissaient les casernes, le plateau de la redoute et, à gauche de la voie, au bord de la mer, les abattoirs. Le viaduc qui traverse la rivière et le canal latéral des Moulins fut franchi. Le train longea la rade, s’écarta un peu de la mer, à la pointe des Jardins, passa sous les murs de la batterie de l’Arsenal et stoppa enfin en gare de St-Denis.

Un commissionnaire s’offrit à guider Marcel vers le Gouvernement. Celui-ci accepta et traversa, à la suite de son guide, les rues de la Boucherie, du Conseil, Barachois, larges, bien alignées, bordées de jardins fermés de grilles – le barreau, comme on dit dans le pays – et plantés de cannes à sucre à la tige svelte surmontée d’une aigrette, de bananiers aux lourdes grappes pendantes, de cocotiers élancés, de manguiers au feuillage touffu, de pignons d’Inde chargés de noix, de papayers dont le tronc lisse et sans branches est couronné de melons verts.
Au fond de ces réduits d’ombre et de parfums, le passant aperçoit les varangues, galeries ouvertes autour des maisons, où les habitants se réunissent le soir.
– La rue de Paris, dit enfin l’homme en désignant une avenue plantée d’arbres, l’Évêché et la place du Gouvernement, en face.
Il désignait une maison spacieuse, formée de deux corps de bâtiments inégalement élevés et pourvue d’un jardin verdoyant enclos d’un mur bas supportant une grille, soutenue de distance en distance par des piliers de maçonnerie.
– C’est là.
Le moment de régler les honoraires de l’insulaire était arrivé. Marcel, après lui avoir serré la main, le pria d’accepter une pièce de deux francs toute neuve.
– Ah ! s’écria l’autre, ce jour est béni. De l’argent ! je vois de l’argent qui brille au soleil !
Il faisait de telles démonstrations de joie que Simplet en voulut connaître la raison :
– Comment ? Vous ne savez pas ? L’argent est rare ici. La monnaie courante se compose de bons du trésor divisés en coupures de un, trois, cinquante et cent francs.
Et sur ce renseignement financier, l’homme s’éloigna.
Simplet pénétra dans l’hôtel. Le Conseil administratif, composé du Gouverneur, du directeur de l’Intérieur, du procureur général et de deux notables ayant voix consultative, était en séance. Mais un secrétaire renseigna complaisamment le jeune homme…, insuffisamment aussi, car il lui avoua n’avoir jamais ouï parler d’Antonin Ribor. Il était peu probable que l’explorateur eût touché à la Réunion, sans que les autorités en fussent averties. Aussi le sous-officier revint vers la gare, avec le désir de gagner Saint-Benoist ; où le Fortune devait l’attendre, de s’embarquer et de se diriger, à toute hélice, vers d’autres rivages.
Un homme vêtu de toile, coiffé d’un casque colonial, agrémenté d’un voile vert qui dissimulait ses traits, se promenait dans la cour de la gare. À l’aspect du sous-officier, il eut un geste de surprise. Il le suivit sur le quai ; il tourna autour de lui à le frôler et, assuré sans doute de ne pas se tromper, il alla en toute hâte prendre un ticket. Il était temps, le convoi arrivait. L’inconnu s’installa dans un wagon voisin de celui dans lequel Dalvan était assis.
Un coup de sifflet. La machine se mit en marche. Le trajet n’atteint pas deux heures ; Marcel prit donc plaisir à admirer le panorama qui se déroulait sous ses yeux. La voie longe la mer, dont la plaine mobile reste toujours visible à gauche de la ligne. À droite, des pentes douces vont rejoindre les plateaux de l’intérieur de l’île, plaines des Fougères, des Salazes, des Palmistes, des Cafres.
De Cap-Fontaine à Saint-Benoist les rochers reparaissent.
Dans cette dernière ville, Dalvan courut à la rade, fort mauvaise d’ailleurs, que bouleversent les tempêtes. Le Fortune n’était pas arrivé. Un habitant enseigna au jeune voyageur qu’aucun navire ne pouvait pénétrer dans le port avant dix heures du soir, à raison de la marée. Il en était deux à peine. Marcel était mécontent : huit heures à tuer ! Ceux qui ont attendu savent combien est pénible cet assassinat partiel du Temps. Aussi eut-il un mouvement de joie quand l’habitant, auquel il s’était adressé, lui proposa :
– Vous semblez contrarié, monsieur. La ville, il est vrai, offre peu de distractions, autant dire pas. Mais vous pourriez profiter de votre passage pour pousser jusqu’au Grand Brûlé.
– Tiens ! c’est une idée ! Quelle distance ?
– Trente-cinq kilomètres.
– Bigre !
– Je vous louerai des chevaux et un guide. En deux heures et quart – la route est bonne – vous serez dans le grand Enclos, le cirque au milieu duquel se trouve le volcan. Cinq kilomètres à pied vous conduiront au cratère de la Fournaise.
– Va pour le cratère !
Aucun des interlocuteurs n’avait fait attention à un personnage qui, à trois pas, semblait absorbé par la contemplation de l’océan. C’était le voyageur au voile vert, monté dans le train à Saint-Denis. Sans doute, la visite de Dalvan au Grand Brûlé ne lui déplut pas, car il se frotta les mains et murmura :
– C’est une occasion de voir ce volcan, dont on me corne les oreilles depuis que j’ai mis le pied dans l’île.
Puis il s’éloigna, arrêta le premier habitant venu, et se fit indiquer l’emplacement de la mairie de la commune de Saint-Benoist.
Cependant Marcel faisait prix pour la location des chevaux et, moyennant vingt-cinq francs, devenait propriétaire, pour le reste du jour, de trois bêtes nerveuses et de deux guides, l’un Cafre, l’autre immigré hindou. Il sortait de la ville avec ses serviteurs, passait à la pointe de la Ravine-Sèche, où s’embranche le chemin de Saint-Pierre, et rendant la main à son cheval – manœuvre aussitôt imitée par ses guides – se lançait au grand trot sur la route Nationale qui fait le tour de la Réunion. Les caps du Bambou et des Cascades, dominés par le Piton-Rouge, se montrèrent. La route s’enfonçait dans une épaisse futaie.
– La forêt du Bois-Blanc, déclara le guide hindou, qui s’était fait le « Conti » de la promenade.
Brusquement les arbres furent remplacés par un rempart de rochers. La route s’encaissa, bordée d’entassements granitiques donnant l’impression d’une redoute construite par des Titans.
– La muraille du Grand Enclos, fit encore l’Hindou. Dans un instant nous verrons le Grand Brûlé.
Le chemin, en effet, débouchait entre deux murs perpendiculaires dans le cirque du volcan.
Dalvan ne put réprimer un cri. Le terrain montait en pente douce d’abord, plus accentuée ensuite vers le cratère, qui développait son panache de fumée à dix kilomètres de là. Partout des traces de l’œuvre du feu : des scories, des laves, les plus anciennes déjà reconquises par la végétation. Çà et là, des îlots de forêts respectés par les éruptions.
Un sentier partait de la route Nationale. Les chevaux le prirent sans hésiter, en bêtes accoutumées à cette excursion. À mi-hauteur, la cavalcade fit halte sur un plateau. L’Hindou allait y rester avec les montures. Le Cafre seul accompagnerait Marcel jusqu’au cratère. Le noir emporta un paquet de cordes attaché sur la croupe de son cheval.
– Pourquoi nous charger de cela ? questionna Dalvan.
– Pour la descente dans le cratère.
L’ascension commença. Devant la force sans bornes, le sentiment de son impuissance écrasait le sous-officier. Partout le travail du feu se marquait. La terre fendillée, coupée de lézardes, livrait passage à des exhalaisons sulfureuses ; des grondements souterrains imprimaient à la montagne de longs frissons.
À mesure que l’on montait, le guide observait avec plus d’attention le sommet du cône actif.

– Nous entrons dans la région des pierres, expliqua-t-il au Français. Imitez bien tous mes mouvements.
– Que voulez-vous dire ?
– Voilà. Tous les quarts d’heure à peu près, une colonne de matières solides est projetée au dehors du cratère ; il s’agit de ne rien recevoir sur la tête, quand cela retombe.
– Alors il faut un parapluie, soupira ironiquement Simplet.
– Non ; il y a sur le sentier deux relais où l’on s’abrite ; il faut calculer son ascension.
– Et vous pensez que je descendrai dans le cratère ?
– Oh ! au bord même et au fond, il n’y a aucun danger. Il existe, autour de la cheminée, une bande large de cent mètres, sur laquelle aucune matière n’est projetée. Tenez, voici une « fusée » – c’est le mot du pays – qui vient de se produire ; en route !
La sente en lacet devenait raide. Il fallut une demi-heure aux deux hommes pour arriver au cratère. Comme l’avait annoncé le Cafre, ils avaient dû s’abriter dans des grottes situées au bord du chemin, pour laisser passer des « fusées ». Une véritable tempête de pierres brûlantes avait dévalé à leurs pieds avec un vacarme assourdissant.
On atteignit le cratère. Devant les voyageurs s’ouvrait un gouffre de cinquante mètres de diamètre. En se penchant, Dalvan aperçut une cavité affectant la forme d’un entonnoir renversé. Le fond était formé par une galerie circulaire au milieu de laquelle un trou noir vomissait d’instant en instant des tourbillons de fumée brune.
– Je comprends, dit-il, on descend à l’aide de cordes et l’on se promène autour de la cheminée centrale.
Il se fit répéter que les scories projetées ne retombaient jamais dans le gouffre, et se laissa amarrer par le Cafre. Celui-ci, un hercule, maniait Dalvan comme un petit enfant. La descente commença. Suspendu dans le vide, sans autre point d’appui que les solides poignets du noir, Simplet n’éprouvait aucune crainte. Il était en quelque sorte hypnotisé par le bouillonnement perpétuel qu’il remarquait dans la cheminée. Une chaleur intense faisait perler à sa peau des gouttes de sueur ; la situation étrange soulignait la faiblesse de l’homme, ballotté au bout d’un câble entre ciel et feu.
Il se trouva debout sur la galerie. À ses pieds était l’abîme incandescent. Et, tout à coup, il se prit à rire. Il se souvenait d’une notice publiée par Victor Pâris, le célèbre explorateur du Vésuve et de l’Etna. Une phrase surtout lui revenait, provoquant sa gaieté.
« Le volcan a l’air de fumer sa pipe ! »
Et la comparaison lui semblait extraordinairement juste. De la cheminée s’échappaient régulièrement des bouffées de fumée.
– Pouh ! pouh ! pouh !
Le bruit – plus fort naturellement – rappelait celui du fumeur exhalant les vapeurs de nicotine. Tout à coup, il se fit un mouvement dans la lave en fusion. Le bouillonnement redoubla. Une explosion sèche vibra dans l’air, et une gerbe de feu s’élança au dehors du cratère.
– Non, décidément ! murmura Marcel, j’aime mieux m’en aller.
Il revint à la corde et commença de s’attacher. Soudain il s’interrompit. D’en haut, une voix affaiblie par l’éloignement avait prononcé son nom. Il frissonna. Cette voix, il lui semblait la reconnaître. Elle s’éleva de nouveau.
– M. Marcel, disait-elle, cette fois je vous tiens bien. Je vous informe que j’attends votre arrivée avec un gendarme colonial, chargé de vous mettre sous les verrous.
– Vraiment, monsieur Canetègne !
Le jeune homme retrouvait la parole.
– Oui, monsieur Marcel. Je vous suis depuis Saint-Denis. Je vous coffre, et je guette le bateau qui doit vous prendre à Saint-Benoist. Vos complices vous rejoindront bientôt dans la prison municipale.
– Eh bien, monsieur Canetègne, votre plan est bien conçu, seulement…
– Seulement ?…
– Il contient une petite erreur.
– Et laquelle, s’il vous plaît ?
– C’est que vous pensez que je vais remonter.
– Eh bien ?
– Eh bien, je reste, voilà tout.
Cette dernière réplique fit bondir le commissionnaire.
Après son échec à Tananarive, il s’était transporté à la Réunion, certain que ses ennemis y viendraient. Constamment il rôdait autour de la gare de Saint-Denis ou du palais du Gouvernement. C’est ainsi que, caché sous un voile vert, il avait dépisté Marcel. À Saint-Benoist, le maire, informé par lui qu’un contumax excursionnait sur le Grand Brûlé, avait enjoint à l’unique gendarme de la localité d’accompagner l’Avignonnais et de procéder à l’arrestation du délinquant. Celui-ci au violon, rien de plus simple que de « pincer » ses complices au débarquement. Et voilà que le sous-officier remettait tout en cause.
Il refusait de quitter le fond du cratère, de revenir à la lumière du jour se constituer prisonnier. S’il s’entêtait, impossible de retourner assez tôt à Saint-Benoist. Que faire ? Malgré les exhortations de Canetègne, le gendarme refusait d’aller rejoindre le brigand. Les règlements de la gendarmerie ne prescrivent pas les perquisitions dans les cratères.
Et les minutes s’écoulaient. Dans sa rage, le négociant se dit qu’après tout il pouvait bien descendre lui-même. Il était muni d’un revolver, et n’avait rien à redouter de Marcel. Sous l’œil de l’autorité – un peu loin de cet œil, il est vrai, – l’accusé n’oserait se livrer sur sa personne à aucune voie de fait.
Bref, après s’être assuré que le barillet de son arme était garni de cartouches, il sollicita le concours du Cafre. La corde remontée, Canetègne, solidement lié, opéra à son tour la descente. Dalvan, tranquillement assis sur un bloc de basalte, regardait le commissionnaire se balancer dans les airs. À quelques mètres du sol, celui-ci fit craquer la batterie de son revolver.
– Prenez garde, railla le sous-officier, vous allez vous blesser !
L’Avignonnais ne répondit pas. Il toucha terre, se débarrassa de la corde, et braquant son arme sur le jeune homme :
– Monsieur, dit-il, il vous a plu de vous jeter dans mes jambes, de troubler mon commerce, de défendre…
– La Belle contre la Bête… féroce.
– Oh ! raillez, il m’importe peu. Si je rappelle vos torts, c’est…
– Pour excuser les vôtres, peut-être ?
– C’est, continua Canetègne sans relever l’interruption, pour vous convaincre que vous n’avez à attendre de moi aucune indulgence.
– Je m’en doutais, cher monsieur. Vous réunissez dans votre nom deux fléaux : la canne et la teigne.
– Sous-officier ! fit le négociant avec hauteur.
– Sous-officier, c’est ce qui fait ma supériorité sur vous. Vous vous êtes inspiré, pour régler votre conduite, de la vie et des œuvres du célèbre Cartouche ; moi, je n’ai fréquenté de cartouches que celles du fusil Lebel. Résultat : je sais tirer, vous pas, et votre revolver ne m’effraye nullement.
Les plaisanteries du jeune homme exaspérèrent son interlocuteur.
– Je ne suis pas descendu au fond de ce cratère pour écouter vos fariboles. En face de vous, je ne suis plus un homme, je suis la loi.
– Est-elle vraiment si laide que ça ?
– Et je vous somme, rugit l’Avignonnais, de vous attacher à la corde. À mon signal, on vous hissera vers l’orifice…
– Et si, par hasard, je refusais de gagner la « sortie » ?
– Alors je n’hésiterais pas : je vous casserais la tête d’un coup de revolver. Je le déplorerais, mais il faut que je capture vos complices. Je fais œuvre d’épuration sociale.
– Vous m’annoncez votre suicide ? mille grâces.
Cette fois, c’en était trop. Le négociant leva son arme ; mais il n’acheva pas le mouvement commencé. Marcel souriait. La joie d’un adversaire est toujours inquiétante, et Canetègne s’inquiéta. Or, depuis quelques minutes, le sous-officier observait à la dérobée la cheminée centrale. Ses répliques mordantes n’avaient d’autre but que de détourner l’attention de son ennemi. Il attendait quoi ?… : La « fusée ». Et le bouillonnement précurseur du phénomène s’accusait. Soudain un tourbillonnement se produisit dans la masse ignée, les gaz captifs détonèrent, et un jet de lave fusa vers le ciel.
Surpris, le commissionnaire tourna la tête. Avec l’impétuosité française – la furia, comme disent les Transalpins – Marcel se rua sur lui, lui arracha son revolver et, portant le canon à hauteur du nez de Canetègne stupéfait :
– La roue a tourné, cher monsieur, fit-il ; à moi d’opérer comme épurateur social.
En face de l’arme menaçante, toute la faconde du Tartarin d’Avignon tomba.
– Vous n’oserez pas faire cela ! clama-t-il.
– Et pourquoi donc ? Les honnêtes gens se défendent parfois contre les rôdeurs louches.
– J’appelle à l’aide.
– Appelez ! je tire.
– Cap de biou ! gémit Canetègne terrifié. Que le diable l’emporte ! – et par réflexion : – Té, c’est pas possible, c’est le diable lui-même !

Dalvan s’inclina :
– Trop flatteur en vérité. Mais votre exclamation indique un retour à la raison ; je crois que nous allons entrer en arrangement.
– En arrangement ? protesta l’autre…
– Ne récriminez pas. À mon tour, je vous tiens. Vous êtes un bandit, vous avez déshonoré ma sœur Yvonne après l’avoir ruinée. Si je rappelle vos torts, comme vous le disiez tout à l’heure, c’est pour vous convaincre que vous n’avez à attendre de moi aucune indulgence.
Son interlocuteur baissa la tête :
– Je songeais, poursuivit Simplet, que, dans la situation actuelle, prouver l’innocence de ma sœur serait simple au possible. Il suffirait que vous écrivissiez la vérité… Mais vous m’objecteriez qu’il vous manque de quoi écrire, et là-haut – il montrait le cratère – vous prétendriez que cet écrit vous a été extorqué par force. J’abandonne cette idée, je me contenterai de m’en aller.
– Oh ! gronda Canetègne, nous verrons bien.
– Mais c’est tout vu. Vous avez le sens des affaires trop développé pour ne pas comprendre que je vous ai à ma merci. Tenez, je vais me montrer confiant, la confiance en ma force, ne vous y trompez pas, et vous dévoiler mes projets.
Comme le négociant faisait un pas en avant, Dalvan le mit en joue :
– Pas de familiarités. La conversation à distance. Là, vous êtes bien ; je reprends : Vous avez un veston blanc, un casque et surtout un voile vert qui me plaisent infiniment. Avec ces accessoires, le voile sur la figure, tous les hommes se ressemblent. Vous me les donnez.
– Moi ? bégaya l’associé de Mlle Doctrovée ?
– Vous même. Grâce à ce déguisement, je remonte là-haut, et suis libre, je m’en charge.
– Si je n’accepte pas ?
– C’est plus simple encore. Je vous fais sauter la cervelle, je prends les vêtements que je convoite et je précipite votre dépouille dans la cheminée centrale. – Le feu purifie tout, cher monsieur. – Cette attention aidant, votre âme immortelle – les canailles en ont une comme les autres – votre âme arrivera peut-être au ciel en odeur de sainteté.
Cette déclaration énergique était à peine terminée que Canetègne se mettait en manches de chemise. Marcel endossa la vareuse blanche, se coiffa du casque, s’emmitoufla dans le voile vert. Il paraissait cependant chercher encore.
– Tiens, dit-il tout à coup, vous avez des bretelles.
– Oui, pour tenir mon pantalon, balbutia le négociant.
– Ici, cela n’a pas d’importance. – Ôtez les bretelles.
– Mais…
– Dépêchons.
L’Avignonnais s’exécuta :
– Là. Maintenant, soyez assez aimable pour réunir vos poignets derrière votre dos.
– Pourquoi ?
– N’interrogez pas. Vous aurez tout le plaisir de la surprise.
Et de l’une des bretelles, il ligotta avec soin les mains de son ennemi.
– Vous me faites mal, gémit celui-ci.
– Oui, mais je vous mets dans l’impossibilité de m’en faire.
Dextrement, le jeune homme bâillonna Canetègne, à l’aide de la seconde bretelle.
– Parfait ! dit-il ; vous ne serez pas tenté de crier pendant que j’opérerai mon ascension.
Tandis que, tout déconfit, le commissionnaire se laissait tomber sur le bloc de basalte qui, un peu avant, servait de siège à Dalvan, le sous-officier fixait la corde autour de ses reins, et avec un accent fort bien imité :
– Eh ! là-haut ! Hisse, mon bon !
Ses pieds quittèrent aussitôt le sol et, à l’extrémité du câble halé avec vigueur par le Cafre, il remonta vers le cratère.
En bas, dans la pénombre, Canetègne s’agitait furieusement, faisant de vains efforts pour se débarrasser de ses liens. L’homme d’argent eût certes donné une belle somme pour faire manquer l’évasion de son adroit adversaire. Mais les bretelles étaient solides. – Comme il s’en vantait, il n’achetait que de la bonne marchandise, – ses contorsions ne servaient qu’à les serrer davantage autour de ses bras endoloris.
Et pendant ce temps Marcel approchait du cratère, il y arrivait, il disparaissait aux yeux du négociant. Alors la rage donna de la mémoire au vilain personnage. Il se remémora les évasions célèbres. Les prisonniers usaient leurs chaînes en les frottant sur la pierre. Eh bien ! il userait ses bretelles. Son cœur en saignait. Encore une dépense que ce maudit Dalvan lui imposait. Mais la volonté de poursuivre le fugitif fut plus forte que la parcimonie. L’opération commença. Elle était peu commode. Les mains attachées derrière le dos, on n’a pas une grande liberté de mouvements.
Avec cela, les bretelles résistaient. Trop bonne marchandise, décidément ! Et la nuit venait. Le cercle lumineux du cratère s’estompait d’ombre. Il devait être près de neuf heures. L’Avignonnais tendit ses muscles ; ses liens éclatèrent. Secouant ses mains engourdies, il détacha son bâillon. Haletant, furieux, il appela :
– Hé ! gendarme !
La voix du Pandore colonial résonna, railleuse, dans le vaste entonnoir.
– Ah ! vous vous décidez, mon garçon !
Mon garçon ! La familiarité exaspéra Canetègne, très monté déjà.
– Imbécile ! rugit-il.
– Soyez poli, n’aggravez pas votre situation !
C’était la seconde fois que cette phrase malencontreuse sonnait aux oreilles du négociant, depuis le jour fatal où il s’était lancé à la poursuite de ses insaisissables ennemis. Il s’affola.
– Crétin ! butor ! âne bâté !
Lancé, il aurait continué longtemps sur ce ton, si l’organe placide du gendarme ne s’était élevé de nouveau.
– Allez toujours, disait le représentant de l’autorité, je verbalise. Insultes à la force publique, outrages à un agent. Ça m’ennuie d’être de garde toute la nuit sur ce piton, mais vous êtes encore plus mal que moi, cela me console.
– Toute la nuit ! glapit le prisonnier ; mais je veux remonter.
– Impossible, le guide a emporté la corde.
– Il est parti ?
– Avec M. Canetègne, qui est allé capturer vos complices. Vous, il était bien sûr que vous ne vous évaderiez pas.
– Mais, Canetègne c’est moi.
Un éclat de rire sonore répondit à cette déclaration.
– Farceur, va !
L’Avignonnais poussa un hurlement de fauve et se mit à tourner au fond du cratère. Les fusées, les détonations excitaient encore sa frénésie. Il était joué. Les soldats de la loi faisaient le jeu de Marcel. Celui-ci, tout en remontant vers le jour, s’était tenu ce raisonnement :
– Il faut que je rejoigne mes compagnons, et que le Fortune ait le temps de quitter la rade. Donc, Canetègne doit rester au fond du cratère une bonne partie de la nuit.
En vertu de ce postulatum, il avait sauté sur le cône, requis le Cafre de le suivre, mis le gendarme de planton au bord du cratère. Cela fait, il avait rejoint les chevaux, toujours sous la garde de l’Hindou et, à fond de train, avait regagné Saint-Benoist. Le Fortune était en rade. Se faire conduire à bord, informer ses amis de ses démarches, fut l’affaire de cinq minutes. La machine était sous pression, car un cyclone était annoncé, et il importait de quitter sans retard cette rade ouverte. C’est la seule manœuvre possible pour les navires, car en dehors du port de la Pointe aux Galets, aucun mouillage de l’île n’est sûr. La mer était étale. Le steamer put donc prendre le large.
XVIII
TROIS MILLE KILOMÈTRES DANS UN CYCLONE
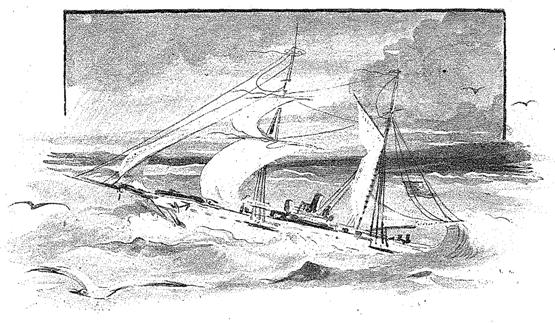
Rassemblés sur le pont, les passagers du Fortune interrogeaient l’horizon. Une bande noire s’étendait peu à peu sur le ciel. L’armée des nuages, poussée par la tempête lointaine, s’avançait avec la rapidité d’un express.
Le yacht allait avoir à subir un rude assaut. Silencieux, tous se regardaient. Pas une parole ne venait à leurs lèvres. À l’approche des grands cataclysmes, la voix de l’homme se tait. Un duel effrayant se préparait entre la tourmente et le frêle navire, point imperceptible au milieu de l’Océan.
Nul abri, nul port de refuge à proximité. Un seul moyen de défense : la fuite devant l’ouragan. Attaché sur la passerelle, le capitaine donnait ses ordres. À la première « claque » du vent, la machine stopperait. On déploierait tout ce que le vaisseau pourrait porter de toile, et on se laisserait emporter par le cyclone.
– Cette manœuvre, expliqua William Sagger, est celle à laquelle on s’est définitivement arrêté dans la marine. Elle offre deux avantages : le premier, de ménager la machine, car par une mer forte, l’hélice tourne souvent « à vide », c’est-à-dire hors des flots, et il en résulte des secousses capables de fausser l’arbre de couche ; le second est de donner au navire une rapidité égale à celle de la lame, si bien que le pont n’est pas couvert par les montagnes d’eau, et que la membrure fatigue moins.
Tout était paré. Mais l’inquiétude persistait. La plus effrayée était miss Pretty. La voyageuse, qui avait choisi la mer comme patrie, était pâle. Mais en regardant avec attention, on comprenait qu’elle avait peur en dehors d’elle-même. Ses yeux ne quittaient pas Claude Bérard.
La ligne noire des nuées arrivait au-dessus du navire.
– Rentrons dans nos cabines, proposa l’Américaine.
– Ma foi non, répliqua Claude ; secousses pour secousses, je les aime mieux en plein air.
Elle n’insista pas. Ce fut William qui prit la parole.
– Vous avez tort, monsieur Bérard. Un paquet de mer a tôt fait d’enlever un homme et…
La phrase demeura inachevée. Le navire fut secoué comme une plume, tandis que des rugissements, des sifflements aigus traversaient l’air. Et, dominant le fracas de la tempête qui s’abattait sur le steamer, la voix du capitaine s’éleva :
– Stoppez !… Aux voiles !
L’hélice cessa de battre les flots, le navire se couvrit de toile, et comme un coursier généreux, fila follement dans la tourmente.
– Mâtin ! murmura Claude, quelle gifle !
– Que les voiles tiennent, fit doucement miss Pretty, et tout ira bien.
Puis, avec une nuance d’orgueil :
– Un fin voilier, mon Fortune ; il ne met pas le nez dans la plume.
L’expression maritime était bizarre dans sa jolie bouche. Personne du reste n’y fit attention. La splendide horreur du tableau les prenait. Sur les côtés, en avant, en arrière, des vagues monstrueuses se précipitaient, échevelées, bondissant les unes sur les autres. Entre elles, des gouffres livides se creusaient. Et le yacht montait et descendait, pour remonter encore ; tel un oiseau rasant les flots de ses blanches ailes. D’incessantes détonations déchiraient l’air ; partout des éclairs démesurés fendaient la nue, jetant sur la mer démontée des lueurs blafardes. Et comme une basse continue, dans cet effrayant concert, le vent hurlait sans relâche, tandis que les lames se fracassaient les unes sur les autres. Des flammèches bleutées dansaient à la pointe des mâts, à l’extrémité des vergues. Le feu Saint-Elme montrait la puissance de la tension électrique. Aveuglés, assourdis, sans voix, trempés par les embruns, subissant un anéantissement moral devant ce colossal déchaînement, les voyageurs se retirèrent dans le salon d’arrière.
Ils ne pouvaient se résoudre à se séparer, à s’enfermer dans leurs cabines durant l’effroyable cataclysme. Et là, comme engourdis, ils attendirent le jour. Mais avec la lumière, la tempête sembla redoubler d’intensité. Aidée par Bérard, miss Pretty se hissa sur la passerelle auprès de l’officier.
– Où sommes-nous ? demanda-t-elle.
– Je l’ignore, Miss. Impossible de faire le point ; mais nous sommes entraînés vers le sud avec une grande rapidité. Du reste, je vais faire jeter le loch, et nous aurons ainsi une idée approximative de notre situation.
Le loch indiqua une vitesse de plus de soixante-dix kilomètres à l’heure.
– Nous devons profiter d’un courant, déclara l’officier, car l’ouragan seul ne nous communiquerait pas cette allure.
À ce moment même un choc se produisit : une des bonnettes avait cédé, emportée par une rafale, et une énorme vague s’abattait sur le yacht. Surpris, Bérard se sentit enlacé par la lame. Il allait être emporté et, dans l’espace de l’éclair, la réflexion de William Sagger traversa sa pensée.
– Cela a tôt fait de vous enlever un homme !
Mais une petite main nerveuse avait saisi son poignet. Le flot passé, il se retrouva couché sur la passerelle, encore retenu par l’Américaine. Habituée à la mer, elle avait vu le danger. Se cramponnant d’une main au garde-fou, de l’autre elle avait empoigné le sous-officier. Il se releva.
– Merci, miss ; sans vous, je partais pour l’autre monde.
Et elle, animant d’un sourire son visage blêmi :
– Vous voyez bien qu’une femme est capable de donner un coup de main.
Il rougit, mécontent qu’elle rappelât ses paroles.
– Ne vous fâchez pas de ma remarque, reprit-elle sur le ton de la prière ; en refusant à Mlle Ribor et à moi la joie de vous accompagner si vous parcourez encore des pays peuplés de dangers, vous nous avez fait de la peine.
– Pour vous, je le regrette.
– Et pour elle ?
– Pour elle, non.
– Vous lui en voulez donc bien ?
– Miss, j’ai horreur des ingrats. Eh bien, j’ai vu Marcel faire pour elle des choses que j’admirais, moi soldat, habitué à la vie des colonies. C’est à peine si elle a daigné le remercier.
– Timidité peut-être.
– Du tout, seulement elle croit que cela lui est dû, et alors… je m’entends.
Grâce au dévouement de l’équipage, une nouvelle bonnette avait pu être établie et le Fortune avait repris sa course effrénée. Le jour s’écoula ainsi, le lendemain encore. Le yacht se comportait admirablement, et les passagers avaient fini par s’accoutumer à la tempête. Les conversations recommençaient.
Mais Yvonne, à qui l’Américaine avait raconté l’incident de la passerelle, n’avait pas cru devoir lui confier son douloureux secret. Elle était restée triste, et sa froideur envers Marcel s’était accentuée. Au contraire, un amical rapprochement se faisait entre miss Pretty et le « Marsouin ». Celui-ci adoucissait son abord quelque peu rude, pour parler à la jeune fille.
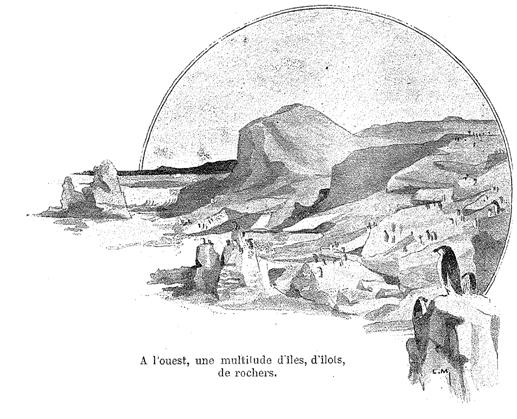
Intelligent, plus instruit que la moyenne des hommes, car avec son naturel sérieux, il avait cherché à se rendre compte de ce qu’il avait vu ou entendu, il avait avec elle de longues causeries. Sevré de tendresse, il n’avait jamais été tendre jusque-là. Son dévouement inné était demeuré brutal. Maintenant il se sentait changé. Il cherchait des mots plus doux, des périphrases atténuées pour exprimer sa pensée devant la charmante propriétaire du steamer. Et parfois il avait conscience de n’être plus le même. Alors il s’arrêtait court, promenait autour de lui un regard étonné et longtemps gardait le silence.
Enfin, le 26 février au matin, c’est-à-dire après plus de trois jours, la tempête s’apaisa. Le vent tomba, le ciel s’éclaircit et le matelot de vigie cria :
– Terre !
Ce cri avait à peine retenti que matelots et passagers se précipitaient sur le pont. Entraînés vers le sud par l’ouragan, en vue de quelle terre se trouvaient-ils ? Les cartes n’en indiquaient aucune. Le Fortune était à l’entrée d’une vaste baie. À l’est, une montagne formait promontoire. Au fond de l’estuaire s’ouvraient une série de fjords, aux falaises plongeant à pic dans la mer ; à l’ouest une multitude d’îles, d’îlots, de rochers, séparés par d’étroites passes.
– Des hommes, fit Yvonne désignant des êtres rangés en ligne sur le rivage.
– Non, des pingouins, riposta miss Pretty qui, à l’aide d’une lorgnette, examinait la contrée.
En effet, les grotesques oiseaux se distinguaient, avec leurs becs allongés, leurs embryons d’ailes, leurs pattes courtes comme écrasées sous le poids des ventres énormes.
– Et, reprit l’Américaine, le pays semble assez désolé. Pas d’arbres, des plaques d’herbes ou de mousses. À l’intérieur, des montagnes couvertes de neige.
– Il fait froid du reste.
Le thermomètre consulté marquait 8° centigrades. Pour des voyageurs arrivant de régions inondées de soleil, cette température pouvait à bon droit passer pour fraîche.
– Mais où sommes nous ?
À l’avant, William Sagger dessinait sur une plaque de carton appuyée au bastingage. Miss Pretty l’appela.
– Voyons, monsieur le géographe, dit-elle, ne pourriez-vous nous apprendre en quelle contrée du monde nous sommes en ce moment ?
Pour toute réponse l’intendant présenta son dessin à la jeune fille.
– Tiens, la carte de la baie, pourquoi ?
– Je l’ai dressée. Précisément, Miss, pour vous donner l’explication que vous cherchez.
– Ce croquis ne me renseigne pas.
– Aussi vais-je le compléter. J’ai dans la tête la forme cartographique des moindres parcelles de terre. J’ai donc établi le plan de ce que j’ai sous les yeux.
– Et ?
– Cette terre est une possession française.
– Ça ?
Marcel, Claude et Yvonne poussèrent en même temps cette exclamation !
– Ça, poursuivit le savant. Découverte en 1772 par un navigateur français… Il s’appelait Kerguelen, et c’est aussi la désignation de l’île.
– Kerguelen, répéta Dalvan, je voulais laisser cette terre de côté dans notre voyage, le ciel en a décidé autrement.
– C’est impossible, fit une voix.
Tous se retournèrent. Le capitaine était près d’eux. Il avait tout entendu.
– Pourquoi impossible ? interrogea Sagger.
– Parce que nous avons quitté la Réunion par 21° de longitude et que nous serions par 49°.
– Eh bien ?
– Le cyclone nous aurait donc portés à trois mille kilomètres au sud ?
– Comme l’archipel Kerguelen n’a pas bougé, il me paraît évident que le navire a franchi cette distance. D’ailleurs, vous pourrez vous en assurer bientôt. Le ciel est clair, le soleil brillant. Le point nous départagera.
À midi, le capitaine fit le point. Le Fortune était par 49° 7’de latitude et 67° 10’de longitude. L’intendant avait eu pleinement raison.
Dans ce port, on procéda à une visite du Fortune qui démontra que le navire avait peu souffert. Il était encore en état de faire une longue traversée.
– Pouvons-nous gagner l’Inde ?
À cette question de l’Américaine, le capitaine inclina la tête.
– Parfaitement, miss. Mais là, il sera nécessaire de procéder à une réparation sérieuse. Sans cela, les avaries légères s’aggraveraient et compromettraient un bon et brave navire.
Deux journées employées à faire la toilette du yacht, un peu « ébouriffé » par la tourmente, lui rendirent son aspect coquet. Et le 1er mars, sous petite vapeur, le steamer franchit les passes de la baie Hillsborough et se dirigea droit au nord. Mais une fois au large, on fit éteindre les feux et on navigua à la voile. Le vent favorable le permettait et il était urgent d’économiser le combustible. La cale, en effet, contenait du charbon pour deux jours seulement. La brise ayant tourné, il fallut de nouveau recourir à l’hélice, si bien que, le 5, le navire dut mettre en panne, ses chaudières refroidies, pour attendre un vent favorable. Le vapeur n’était plus qu’un voilier, et pour se ravitailler, il devait atteindre l’île Maurice par 20° de longitude sud.
L’équipage connut tous les ennuis de la navigation à voiles. Retardé par des vents contraires, immobilisé par un calme plat qui dura une semaine entière, le navire ne mouilla en rade de Port-Louis, chef-lieu de l’île Maurice, que le 28 mars au soir. Il avait mis près d’un mois à effectuer le trajet, que la tempête lui avait fait parcourir en trois jours. Le 29 fut employé à remplir les soutes de charbon. Le lendemain, le yacht reprit la mer, et le 10 avril, il jetait l’ancre en face de Mahé, le seul port français de la côte de Malabar. À un kilomètre au nord, on apercevait le remous causé par l’embouchure de la rivière de Mahé, et le mât de pavillon se dressait, avec sa flèche menue et ses cordages, en face de la route qui va du débarcadère à la ville. Les voyageurs posèrent le pied sur le sol de l’Inde.

XIX
LE PAYS DES PIERRES PRÉCIEUSES
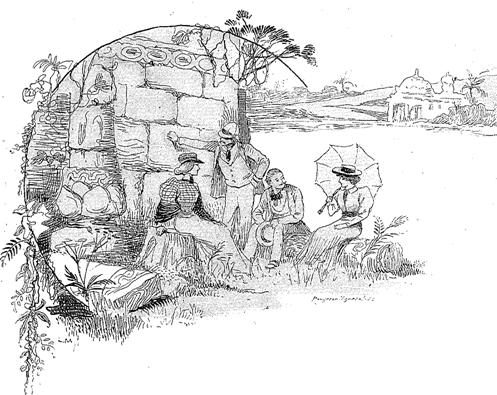
– Serons-nous plus heureux dans nos recherches, sur cette terre classique des monuments grandioses, de l’or, du diamant, des turquoises, des émeraudes, des saphirs, des rubis, le pays des contes fabuleux ruisselants de pierreries, où les poètes, pour atteindre le merveilleux, se bornaient à dépeindre la nature ?
Ainsi Marcel salua la patrie des rajahs. William Sagger, devant qui s’exhalait cette bouffée d’enthousiasme, eut un sourire moqueur, mais ne répondit rien. Ils étaient sur le quai, regardant le Fortune qui déjà s’éloignait couronné d’un panache de fumée. Le vaillant navire se rendait à Bombay pour y être radoubé. Avant son départ, on avait tenu conseil. Et Dalvan avait ainsi résumé la discussion :
– Ces demoiselles – il s’agissait bien entendu d’Yvonne et de miss Pretty – peuvent sans inconvénient nous suivre à terre. Les établissements français de l’Inde ont à peine 510 kilomètres carrés de superficie, soit le dixième d’un département français. Tandis que le yacht sera en réparation, nous irons de l’un à l’autre, par chemin de fer ou par bateaux. Donc, pas de grosses fatigues, pas de gros dangers légaux, puisque nous voyageons presque constamment en pays anglais.
Et avec un soupir de regret, il avait ajouté :
– Aux temps des Martin, Dupleix, Bussy, La Bourdonnais, vous seriez restées à bord, car alors de Surate au cap Comorin, tout le pays au sud des monts Vindhya était à nous.
– Eh mais ! fit l’intendant, vous me faites concurrence comme géographe.
– Non, n’ayez point cette crainte. Ce que je dis est l’épitaphe de la grandeur française dans l’Inde ; grandeur que les Anglais ne nous ont pas enlevée par la force des armes – les raclées que leur infligèrent Dupleix et La Bourdonnais sont légendaires – mais qu’ils nous dérobèrent traîtreusement, profitant de nos embarras en Europe pour nous vendre leur venimeuse neutralité, au prix de honteux traités. L’Inde est pour moi une Alsace-Lorraine coloniale, et ce n’est pas sans une joie réelle que je vois la Russie s’avancer par le nord, alors que nous sommes solidement établis en Indo-Chine. Je suis soldat comme nos ancêtres gaulois et ma devise est : Toutes les revanches !
Yvonne écoutait, les yeux agrandis par une émotion intérieure. Dire que c’était là ce frère de lait, qu’elle avait considéré comme un être sans importance, presque un jouet !
– Que pensez-vous de cela ? demanda l’Américaine à Claude pensif.
– Moi, mais je pense comme Marcel ; en ma qualité de « Marsouin », je suis encore plus vexé que lui, si c’est possible.
– À la bonne heure.
– Cela vous fait plaisir ?
– Énormément.
– Pourquoi ?
– Pourquoi ? mais parce que…
Elle s’arrêta, rougit un peu et acheva tranquillement :
– Parce que je suis Américaine.
Puis, désireuse de changer le sujet de la conversation :
– Si nous songions à notre voyage ?
– J’y pensais, interrompit William, et j’ai une proposition à vous faire.
– Nous écoutons.
– Le territoire de Mahé est coupé en deux. La presqu’île comprise entre la mer et l’Arou.
– L’Arou ?
– La rivière, c’est le terme indien. Cette presqu’île, dis-je, contient la ville et son mouillage. Les aldées ou villages formant le territoire sont situées sur la rive droite de l’Ar-Mahé, (ruisseau de Mahé), et séparées de l’eau par une bande de terrain appartenant aux Anglais. Ils ont morcelé vos possessions autant qu’ils l’ont pu. Eh bien, traversez le pont et arrêtez-vous sur la route des aldées qui lui fait suite. En pays étranger, vous ne courez aucun risque, puisque l’Administration française devrait, pour vous arrêter, demander l’extradition. Pendant ce temps, j’irai chez l’administrateur, et je m’informerai de M. Antonin Ribor.
Sage était le plan. Il fut aussitôt adopté. L’intendant se dirigea vers la résidence. Quant à Marcel et à ses amis, ils s’engagèrent sur le pont de bois jeté en accent circonflexe sur la rivière, et atteignirent l’autre berge entre les aidées anglaises de Great Coloy et de Caclon-house. À gauche de la route, sur une butte peu élevée, on distinguait les bastions du fort Saint-Georges, dominant les ruines du bourg du même nom. À droite, au-delà des agglomérations de Less Coloye et d’Agroen, la première anglaise, la seconde française, se dressait le mont Chalakara, aux pentes couvertes de cocotiers.
– Installons-nous près des ruines, proposa miss Pretty.
– Volontiers, lui répondit-on en chœur.
Tous s’assirent à l’ombre d’un pan de mur recouvert, comme d’un manteau, d’une liane énorme, dont le feuillage vert était semé de larges fleurs violettes. On eût dit des volubilis. Non pas nos frêles corolles d’Europe, ici, elles s’épanouissaient en coupe de la dimension d’un hanap germain. Des frétillements agitèrent les feuilles ; des lézards, dérangés dans leur sieste, filèrent entre les pierres. L’un, à la robe dorée, s’arrêta à quelques pas, et de ses yeux vifs considéra les importuns. Soudain, une lanière de couleur sombre décrivit une parabole en l’air et vint s’abattre sur l’inoffensif saurien. L’Américaine eut un cri de frayeur.
– Un naja.
C’était un serpent long d’un mètre environ, vulgo serpent à lunettes, dont la morsure occasionne une paralysie générale qui, en peu d’instants, détermine la mort.
Le reptile, happant sa proie, rampait vers un buisson voisin. Au cri de miss Pretty, Claude avait bondi devant elle ; il courait sus au naja. Elle l’appela. Il ne répondit pas, mais profitant de ce que la gueule de l’animal était obstruée par le corps du lézard, il saisit le reptile par le cou, lui appuya la tête à terre et d’un coup de talon la broya.
– Oh ! monsieur Claude, murmura miss Pretty, pourquoi vous exposer ainsi ?
Le « Marsouin » hésita, puis :
– J’étais furieux. Il vous avait fait peur.
– Ah !
Un silence embarrassé suivit. L’Américaine et Bérard baissaient les yeux, Dalvan souriait ; quant à Yvonne, un nuage de tristesse couvrit son doux visage. Ses lèvres s’agitèrent, et dans un souffle, si bas que personne ne l’entendit, cette plainte s’échappa de ses lèvres :
– Elle est bien heureuse !
Que voulait-elle dire ? Mystère ! Obscurs sont les cœurs des jeunes filles. Muets, les yeux mi-clos errant sur la campagne ruisselante de soleil, les voyageurs songeaient. La mousson du nord-est qui, à peu de jours de là, devait être remplacée par celle du sud-ouest, passait sur eux en un frôlement caressant. Une sensation d’engourdissement, un bien-être anéanti les envahissait. Marcel se souleva brusquement.
– Qui sont ces gens-là ?
Tous, secoués par le son de sa voix, portèrent les yeux sur la route.

Un étrange cortège y défilait.
En tête, un homme et une femme, coiffés de mitres d’or agrémentées de pierreries étalaient, sur leurs longues tuniques aux plis lourds, une profusion de colliers, de chaînettes, d’arabesques en passementerie.
Les saphirs alternaient avec les diamants, les rubis sanglants chatoyaient auprès des émeraudes, la topaze se mariait aux turquoises, aux chrysolithes, aux grenats, aux sardoines, aux malachites. Derrière ces châsses vivantes, une douzaine de personnages marchaient à la queue-leu-leu en habits de fête. Turbans aux aigrettes de pierreries, tuniques et dhoutils – pantalon indien – d’éclatantes couleurs. Le dernier, un Européen reconnaissable à ses vêtements blancs de coupe anglaise, à son casque de toile, semblait le plus satisfait de la bande. Il se frottait les mains avec une énergie qui attira l’attention de Marcel.
– Voilà un geste qui ne m’est pas inconnu, fit-il.
Au même moment Yvonne s’écria :
– Je rêve… mais je crois voir…
– M. Canetègne, petite sœur ?
– Oui.
– Tu ne te trompes pas.
– Oh ! le vilain homme ! dit miss Pretty. Nous le rencontrerons donc partout !
L’Avignonnais avait aperçu ses ennemis ; tirant des jumelles de sa poche, il les braquait sur eux.
– Regarde, regarde, plaisanta Marcel, nous sommes en pays anglais ; tu ne peux rien contre nous.
Cependant, le négociant appela sans doute ses compagnons, car ceux-ci se rassemblèrent en cercle autour de lui.
– Que leur raconte-t-il ?
La réponse à cette question de Marcel ne se fit pas attendre ; quittant la route, la troupe hindoue se dirigea vers eux.
– Qu’est-ce que cela veut dire ?
À dix pas, les indigènes s’arrêtèrent, se courbèrent en un profond salut, puis l’homme qui marchait le premier s’adressa à Dalvan en français assez pur.
Il est à remarquer, en effet, que grâce aux écoles établies partout et aux louables efforts du gouvernement, la plupart des Hindous, habitant les enclaves françaises et les environs, possèdent notre langue.
– Sahib, dit l’homme – sahib est l’équivalent de seigneur – j’ai à adresser à ta bonté une prière.
– J’écoute, répliqua le jeune homme, étonné de cette entrée en matière.
L’Indien s’inclina.
– À mon costume, tu comprends que je me marie. J’épouse Maïssoura qui m’accompagne, pour laquelle Vishnou, conservateur des Êtres, m’a inspiré l’affection.
– Félicitations à Vishnou et à toi.
– Maïssoura est belle, elle a dix ans.
– Dix ans ! se récria Yvonne.
– Oui, expliqua Dalvan ; c’est l’âge de l’hyménée dans l’Inde. Ici la femme se marie entre huit et onze ans ; elle est fanée à vingt et archivieille à trente. Question de climat. Ainsi que les fleurs, les humains croissent plus vite et s’étiolent aussi plus tôt.
Et s’apercevant que l’indigène attendait.
– Continue.
– J’obéis, Sahib. Tu sais que les Invisibles Esprits remplissent le Ciel embrasé et la Terre féconde, veillant sur nous et donnant le bonheur à ceux qui écoutent leurs inspirations. Or, je souhaite que la félicité habite la demeure qu’embellira Maïssoura. J’ai fait tout ce que recommandent les traditions pour atteindre ce résultat. J’ai brûlé le bois d’Arek, jeté l’opium et le gingembre dans le lait d’une génisse sans tache. Depuis un mois, j’entretiens au-dessus de la deuxième ouverture de ma maison, en commençant par l’est, un nid de koubaous, les colombes aux reflets bleus. Chaque matin je leur ai donné, en tenant la fourche à trois dents, un grain de maïs, deux d’orge, trois de riz. J’ai accompli les cent vingt-quatre prières, les douze macérations ; sur un pied, j’ai salué à son lever le Soleil, huitième représentation de Brahma Créateur. Et pour que Siva Destructeur, et son épouse Kali se détournent du Bapota, champ paternel, j’ai tracé devant ma porte les trois cercles concentriques, répandu le sang d’un agneau de trois mois, tout blanc, avec la tache noire sur le dos. J’ai ceint mes reins de l’écharpe des pèlerins avec la pierre rouge consacrée sur le nombril. Bref, je n’ai négligé aucune des prescriptions des livres saints, Brahmanas et Soutras.
– Quel bavard ! fit Marcel.
– Or maintenant, une inspiration est venue à ce sage, – l’Hindou appuya le doigt sur la poitrine de Canetègne.
– Ah ! nous y voilà. Et quelle est l’inspiration ?
– L’Esprit du fleuve lui a parlé. Il lui a dit : « Près des ruines de Saint-Georges des étrangers se reposent. Qu’ils assistent au repas auquel sont conviés nos amis, et de longues années de félicité leur sont assurées. » Par cinq fois, nombre cher au héros Rama, je te prie de te joindre à nous avec les tiens.
Tous se regardèrent avec surprise. L’Avignonnais se tenait modestement en arrière, semblant prêter peu d’intérêt à ce qui se passait. Mais Marcel se frappa le front.
– Où nous conduis-tu ?
– À Bentaguel, Sahib.
– En territoire français ?
– Oui, Sahib.
Le jeune homme alla vers le négociant et lui tapa sur l’épaule.
– Pas mal, ça, mon brave monsieur Canetègne ; seulement je m’informe et je n’irai pas.
– Vous vous trompez, mon brave monsieur Marcel.
– Ah bah !
– J’ai exploité la superstition de ces imbéciles, et ils vous traîneront de force dans leur village.
– Alors bataille ?
– Si vous voulez. Seulement comme vous aurez blessé des sujets français, les autorités anglaises vous livreront sans demande d’extradition préalable. Il existe une convention de police à cet effet.
– Diable ! pensa le sous-officier.
Soudain il se prit à rire et revenant au marié indigène :
– Mon ami, dit-il, j’accepte, mais moi aussi, je suis inspiré par les esprits flottants et ils me parlent.
– Que t’ordonnent-ils, Sahib, questionna l’Hindou, croyant sans hésiter à l’invention de son interlocuteur.
– Toutes les prospérités promises, déclara Dalvan avec le plus grand sérieux, toutes sans exception, disparaîtront si le blanc qui t’a conseillé se sépare de moi une seconde en ce jour. Je vais lui donner le bras. Veille à tout instant qu’il ne s’éloigne pas de moi.
Canetègne ne put maîtriser une grimace de dépit, mais comme lui, Simplet exploitait la crédulité du marié, il fallait s’exécuter. Bras dessus, bras dessous, les deux hommes regagnèrent la route des Aldées, suivis par toute la troupe qui manifestait bruyamment sa joie. Comme ils l’atteignaient, William Sagger débouchait du pont en compagnie d’un personnage brun de figure, à l’allure européenne. Ils approchèrent.
– Mes amis, déclara William, au gouvernement, aucun indice ; seulement vous êtes signalés de façon particulière, et monsieur, attaché à la police, a tenu absolument à me suivre.
Et le personnage inconnu, qui venait de consulter un carnet, s’avança vers Marcel :
– Monsieur Marcel Dalvan, au nom de la loi, je vous arrête.
– Pardon, je suis en pays anglais.
– Du tout, la route est française. Les talus appartiennent à Sa Gracieuse Majesté l’Impératrice des Indes, mais la chaussée est républicaine… Donc…
Avec une habileté surprenante, l’agent avait mis les menottes au sous-officier. Les Hindous murmuraient. Le marié expliqua la situation à l’agent. Ce dernier parut embarrassé. Arrêter un contumax était son devoir, mais les règlements d’administration prescrivent de n’offusquer en rien les croyances indigènes. Il songea que cette prudence était inspirée par les événements de 1857, année où la distribution aux cipayes de cartouches enduites de graisse de porc amena la terrible insurrection, qui inonda de sang Barakpour, Meerut, Delhi, le Pendjab, Nassirabad, Lucknow, Benarès, Allahabad, Cawapour. Le porc, réputé impur, avait coûté la vie à plusieurs centaines de mille individus. Ce souvenir aidant, le policier se décida à transiger. Son captif et ses amis assisteraient au repas nuptial, puis il les ramènerait à Mahé et les écrouerait à la prison.
Les visages bronzés s’éclairèrent. Le cortège reprit sa marche. Auprès de Marcel, toujours empêtré des menottes, Canetègne s’était placé. Toute sa figure riait, plissée de rides qui traçaient des sillons ironiques dans la chair grasse. Ses mains frétillaient, irrésistiblement attirées l’une vers l’autre pour le frottement favori. Il triomphait sans pudeur.
Dalvan l’observait du coin de l’œil, et peu à peu son regard devenait malicieux, au grand contentement d’Yvonne qui, de son côté, saisissait au vol les impressions de son frère de lait, afin de savoir s’il fallait s’abandonner au désespoir ou espérer.
– Monsieur Canetègne, commença le jeune homme d’un air aimable.
– Monsieur Dalvan, répondit le commissionnaire.
– Je suis votre prisonnier.
– Je m’en flatte.
– Ce n’est pas une raison pour bouder. La bouderie est muette, partant mélancolique. Invités à une noce, rions aujourd’hui, nous pleurerons demain.
– Vous pleurerez, rectifia l’Avignonnais.
Simplet prit un air contrit.
– Je le crois, et je regrette bien d’avoir engagé une lutte inégale contre vous.
Canetègne tourna vers son interlocuteur une face effarée. Quoi, il s’excusait ! C’était pour se moquer. Mais le visage du captif était si penaud ; il traduisait si bien l’ennui que le gros homme fut persuadé. Il se rengorgea. Le dindon et l’homme inférieur expriment leur satisfaction de la même manière. Le jabot du négociant se gonfla.
– Oui, poursuivit Dalvan de plus en plus humble, j’aurais dû prévoir ce qui arrive. Avec votre grande habitude des affaires, vous étiez assuré du succès final. J’ai compris tout à l’heure le sourire railleur avec lequel vous avez accueilli mes menaces, chez vous, à Lyon.
Canetègne rayonna. Il avait eu très peur, lors de la scène que rappelait le sous-officier ; aussi était-il doublement heureux que ce dernier ne s’en fût pas aperçu. Il ne remarqua pas la légère contraction des lèvres de Marcel, le vacillement joyeux de son regard. Aveuglé par l’éloge, il prit un ton paterne :
– Vous n’êtes pas maladroit, mon ami, pas du tout. C’est même pour cela que vous êtes attaché alors que vos amis sont libres. Les menottes vous donnent la mesure de mon estime. Seulement, vous êtes jeune ; une ou deux fois, à l’aide de farces très drôles – j’en ai ri après, vous voyez que je rends justice à mes adversaires – une ou deux fois, vous m’avez glissé entre les doigts. Mais cela ne pouvait se répéter souvent. Un homme averti en vaut deux. Cependant je reconnais qu’en vous guidant quelque peu, vous deviendriez un sujet remarquable.
Simplet garda le silence. Une envie de rire le prenait, en voyant son ennemi s’engluer à sa feinte humilité. Il n’aurait pu ouvrir la bouche sans se trahir.
Le cortège, après avoir suivi le chemin sinueux des Aldées, bordé par les futaies de Chambra-Cannoa et de Palour, empruntait la route de Paroly à Choely, pour rejoindre le sentier de Bentaguel. À cent mètres, les ruines de la redoute de Chankaly apparaissaient, drapées de végétations fleuries.
– Oui, je me suis trompé, reprit Dalvan, dominant ses velléités de gaieté ; je suis arrivé, j’ai vu une jeune fille que vous vouliez épouser malgré elle.
– Elle vous a paru jolie, et avec un doux espoir, vous vous êtes déclaré son chevalier. J’ai deviné vos sentiments.
La suffisance perçait dans cette réplique de l’Avignonnais.
– C’est surprenant ! s’écria le sous-officier, vous auriez été mon confident que…
– L’observation, mon jeune ami, l’observation et l’expérience.
– Eh bien ! je reconnais mes torts et je veux vous proposer un traité.
– Un traité ?
Le négociant dressa l’oreille.
– Oui.
– Allez. On doit toujours écouter.
– Vous désirez épouser Yvonne ?
– Je ne puis dire le contraire.
– Reprenez donc votre idée.
– Que je…
Vraiment le négociant était ahuri.
– Vous me rendrez la liberté, conclut Simplet, après le mariage.
– Après, c’est possible.
– Oh ! je suis très sincère. À ce point que je vous donnerai un bon conseil.
– Donnez ?
– Ne rentrez pas de suite en France.
– Pourquoi cela ?
– Parce que la résistance de ma sœur de lait, résistance qui m’a embarqué dans ce sot voyage, provient…
– De ?…
– De ce qu’elle a peut-être distingué quelqu’un…
Un cri de Canetègne lui coupa la parole.
– Vous en êtes sûr, mon bon ; je conçois tout. Adieu l’espoir, adieu le dévouement. Je savais bien que vous étiez pratique. Des fatigues sans récompense, la lutte au profit d’un autre, il n’en faut pas. À présent, je considère la proposition comme sérieuse. Prisonnier pour elle, certain que son cœur ne vous appartiendra jamais – car vous en êtes certain, bien que vous disiez : Peut-être ! On ne me trompe pas, moi. – Dans cette mauvaise posture, vous avez réfléchi. Vous vous êtes affirmé que le seul moyen de sortir de l’impasse était de faire votre paix avec moi, de renoncer à cette course autour du globe. C’est parfait, et cela fait honneur à votre jugement.
Et avec abandon :
– Vous pressentez bien qu’une fois sorti du Grand Brûlé, j’ai couru chez le procureur général à Saint-Denis et, séance tenante, je lui ai fait câbler à tous les établissements français de l’Inde. À peine débarqué, le télégraphe a joué. Dans chaque ville, je solde un agent qui ne quitte pas le gouvernement et moi, je vous attendais ici, tout en faisant du commerce.
Une poussée d’orgueil colora ses joues.
– Car je ne perds jamais mon temps, moi. Les Hindous, quand ils s’épousent, adorent se parer comme le couple qui nous précède. La tiare, les pierreries, coûtent trop cher pour la bourse de la plupart, tel le mien qui appartient à la caste des koumhar ou potiers. Alors, on les leur loue.
– C’est une grosse mise de fonds, souligna sérieusement Marcel.
– Erreur, mon jeune ami ; mes diamants sont de verre, mes ors de cuivre. Ils l’ignorent, payent une location… salée…, et me signent un renoncement à leurs propriétés, au cas où ils égareraient quelqu’un des joyaux. Puisque vous devenez raisonnable, je vous associe à mes opérations. J’ai besoin d’un second actif et adroit pour lancer l’affaire sur d’autres points. Ça va-t-il ?
– Vous le demandez ?
– Alors, avant dix ans, nous serons les plus gros propriétaires fonciers de l’Inde. Vous voyez que rien ne me presse de retourner en France.
– Vous êtes prodigieux ! déclara Marcel avec une apparence d’admiration si bien jouée, que l’Avignonnais le prit amicalement par le bras et marcha ainsi près de lui jusqu’au village.
Au milieu d’un bois touffu, abritées par la ramure, les paillottes de l’aidée étaient semées au hasard. Chaque famille avait choisi un emplacement à sa convenance, sans souci des alignements. Sous un bananier une table était dressée. Des amoncellements de fruits, de végétaux, des flacons de spiritueux aux étiquettes anglaises la couvraient.
– Les Hindous, professa William, ne mangent point de viande ; le brahmanisme en a fait des végétariens. C’est même ce qui empêche la propagation du bétail. Les buffles superbes de la péninsule sont utilisés seulement comme bêtes de trait ou de labour.
Profitant de l’inattention générale, Marcel s’était glissé près d’Yvonne et la mettait rapidement au courant de sa conversation avec Canetègne. Il se sentit brusquement tiré en arrière et jeté contre le négociant. Les deux hommes poussèrent une exclamation. Le marié était devant eux.
– Sahib ! gémit-il, tu veux donc attirer le malheur sur ma maison ?
– Moi, mais non !
– Alors pourquoi te sépares-tu de Canetègne, Sahib ? Tu sais bien que les Esprits ont parlé.
– Ah ! c’est vrai.
– Tu m’as dit de veiller à ce que leurs ordres soient exécutés, permets-moi donc de prendre une précaution.
Sur un signe, l’un des invités avait disparu dans une paillotte. Il en sortit presque aussitôt avec un lien de paille. L’époux s’en saisit et attacha le bras droit de Dalvan au bras gauche de l’Avignonnais.
– Pardonne-moi, mais c’est une existence de bonheur que j’assure ; grâce à ce lien, plus de danger que vous cessiez d’être ensemble.
Le négociant et le jeune homme se regardèrent en riant.
– Vous nous avez fait une bonne farce, mon bon, fit le premier.
– Bah ! riposta Simplet, c’est le symbole de notre association.
– Très juste !
– Vous voyez bien qu’il faut en prendre notre parti.
On se mit à table. Au bout de cinq minutes, Dalvan pestait.

– Ces menottes me gênent horriblement.
– Oh ! fit Canetègne, rien ne s’oppose à ce que l’on vous en débarrasse ; notre hôte a pris soin, avec sa tresse, de les rendre inutiles.
Et l’agent remit l’appareil dans sa poche, laissant les mains libres au sous-officier.
Yvonne se trouvait en face du négociant. Celui-ci éleva son verre empli jusqu’aux bords de Porto-Wine.
– Chère demoiselle Ribor, fit-il, je considère ce festin comme notre repas de fiançailles ; je bois à notre heureuse union.
La jeune fille ferma les yeux.
– Ce toast, s’empressa d’ajouter Dalvan, est le résultat d’un entretien que nous venons d’avoir, M. Canetègne et moi. Nous sommes arrêtés, sous le coup de la prison. Miss Diana Pretty Gay Gold, qui a été si bienveillante, risque d’être inquiétée. Pour sauver tout le monde, il suffit que tu te dévoues. Nous avons fait le possible pour toi, à ton tour maintenant.
– Très bien, appuya l’Avignonnais. Voilà qui est parler.
D’une main tremblante, Yvonne éleva son verre et le choqua contre celui du commissionnaire.
– À nos fiançailles ! murmura-t-elle d’une voix éteinte.
Dalvan l’avait prévenue. Elle savait se prêter à un jeu destiné à endormir la défiance de l’ennemi commun. Pourtant une émotion poignante la torturait. Il lui semblait commettre un sacrilège. L’affection, cette divinité de la jeunesse, se révoltait contre la ruse à laquelle on la mêlait. Et sans doute aussi la jeune fille pensait :
– Pour que Simplet imagine une telle comédie, il faut bien qu’il ne songe pas à m’épouser. Autrement tout son être se soulèverait de colère et de dégoût.
Se méprenant sur la cause de son trouble, l’Avignonnais voulut « lui remonter le moral », et avec des grâces qu’un éléphant eût enviées :
– Remettez-vous, chère demoiselle. Dans les cervelles de jeunes filles naissent des projets éphémères, que la réalité se charge de dissiper. Je vous tiens en grande estime et vous trouverez le bonheur dans notre union. Elle ne vous passionne pas ; vous aviez pensé à un autre ; votre frère de lait m’a prévenu.
– À un autre ! répéta Yvonne surprise.
Interrompu par le superstitieux marié, Dalvan n’avait pas eu le loisir de donner des détails à sa compagne. Elle ignorait donc « le conseil » qui avait convaincu le négociant. Ses yeux étonnés interrogèrent le visage de Simplet. Elle le vit pâle, les orbites marquées d’une tache bleuâtre. Emporté par le désir de persuader son adversaire, le sous-officier avait senti l’importance de l’annonce faite à l’Avignonnais. Il avait parlé, triomphé des dernières défiances du madré personnage. Mais en lui entendant rappeler ses paroles, il avait éprouvé une douleur cuisante. Son cœur s’était contracté. Un instant la circulation avait été suspendue, et devant ses yeux voilés s’était profilée la silhouette du mont Fady. À ses oreilles avaient résonné les mots échappés au rêve de sa chère Yvonne :
« Antonin ! revenir en France… L’épouser ! »
Dès le premier instant il s’était sacrifié, il n’avait donc pas le droit de se complaire aujourd’hui dans sa souffrance. Il se raidit, rappela les couleurs à ses joues, le sourire sur ses lèvres, la vie dans son regard. Et sûr de lui-même, incapable d’émotion désormais, le cœur pétrifié, le front d’airain, il présenta, à celle qui avait mis en lambeaux son espoir, un masque froidement impassible de gladiateur condamné. Canetègne continuait à piétiner les plates-bandes du rêve.
– Oui, disait-il, un souvenir de France, l’idéal entrevu un soir de bal, fantoche dont l’imagination fait un demi-dieu. Cela, ma chère demoiselle, n’a pas d’importance. Nous laisserons à ce brouillard le temps de se dissiper. Et après, munie du vrai bonheur, du seul qui puisse fixer les esprits sérieux, de l’argent, vous me remercierez de m’être jeté à la traverse, d’avoir immobilisé le char de la féerie en mettant dans ses roues le bâton du réalisme grossier. Aux fumées d’ambroisie, aux vapeurs du nectar, vous préférerez le plat solide, le vin généreux.
Ouf ! Il respira, satisfait de son improvisation. De nouveau son verre heurta celui d’Yvonne. Trop violemment, car des gouttes de porto sautèrent sur la table. Un gémissement sortit de tous les gosiers hindous.
– Du vin répandu, malheur sur nous !
– Eh non ! s’écria l’Avignonnais, couvrez de sel les taches de liquide, et la prospérité descendra sur vos maisons.
De toutes parts des poignées de sel s’abattirent sur l’endroit mouillé par le vin rose.
L’on buvait sec. Canetègne poussé par « son associé » – c’est ainsi qu’il désignait Dalvan – asséchait coup sur coup la noix de coco curieusement ouvragée qui lui servait de verre. Le policier, encouragé par son patron, vidait les flacons dans sa coupe d’un air pâmé. Il se penchait vers son voisin, William Sagger, et tandis que les spiritueux s’échappaient du goulot avec un glouglou brutal, il murmurait, les paupières baissées, la face enluminée :
– Quelle musique, monsieur, quelle musique !
Les époux avaient disparu. Au son de la guitare au manche allongé et de la flûte, les invités se balançaient en cadence. Sans doute, les fumées des spiritueux augmentaient les oscillations de leurs corps, leur faisaient perdre la mesure ou esquisser des pas imprévus. Mais ils s’en tiraient tout de même. Seulement, après chaque figure chorégraphique, – et Brahma sait si elles sont nombreuses, – c’étaient de nouvelles libations. Bientôt la scène d’ivresse, ultime de toute fête hindoue, commença. Ruisselants de sueur, les yeux hors de la tête, tous se prirent à tourner avec des contorsions simiesques. Le mouvement de rotation s’accéléra, devint vertigineux. Un à un les danseurs roulèrent à terre. Le plus grand nombre, se trouvant couché, jugea opportun de dormir.
Quelques-uns, plus résistants, luttèrent encore ; l’alcool anglais les terrassa à leur tour. Le lieu du repas ressembla bientôt à un champ de bataille. Et dans le silence, coupé par les rauquements de respirations embarrassées, une voix chevrotante s’éleva :
Madame la marquise,
Votre bras est bien fait ;
Votre taille est bien prise
Et votre pied parfait.
Canetègne chantait, et avec la tendresse des ivrognes :
– Écoute ça, mon petit Marcel, disait-il ; c’est une chanson d’autrefois. On n’en fait plus comme ça.
Et reprenant avec les variantes les plus réjouissantes :
J’aime sur votre joue
Ces mouches de velours,
Votre coquette moue
Et vos piquants discours.
Mais, ô ma toute belle,
Songez-vous qu’à l’instant,
Votre fille Isabelle
Revient de son couvent ?
Adieu, vos succès à la cour,
Il faut que chacun ait son tour.
Ses paupières clignotaient ; ses yeux promenaient sur toutes choses un regard noyé.
Du geste Dalvan désigna à William et à Claude le policier qui, sans cérémonie, dormait les coudes sur la table.
Les deux hommes soulevèrent l’agent et le portèrent avec sa chaise à la place de Simplet. Celui-ci s’était levé. Le mouvement troubla l’Avignonnais, toujours attaché au sous-officier par le lien de paille.
– Reste donc tranquille, mon petit Marcel, fit-il d’une voix pâteuse.
– Je me lève pour mieux t’entendre.
– Pour mieux m’entendre ?
– Parfaitement ! la voix monte et alors…
– C’est juste ! Alors elle te plaît, ma chanson. Écoute-moi le second couplet. Allons bon ! je l’ai oublié.
Canetègne pencha le front, ferma les yeux, cherchant.
– Ah ! je l’ai, bredouilla-t-il, c’est la réponse de la marquise. Tu vas voir si c’est touché :
Marquis, si la franchise
Est votre qualité,
Souffrez que je vous dise
Aussi la vérité.
Il s’interrompit. Profitant de sa préoccupation, Dalvan avait dénoué le lien qui fixait son bras droit au bras gauche de son ennemi.
– Qu’est-ce que tu fais encore ? questionna le commissionnaire.
– Je desserre leur satanée corde.
– Non, pas ça. Les Hindous ne plaisantent pas, rattache vite.
– Volontiers.
Et tranquillement, le jeune homme glissa dans l’anneau de paille le bras de l’agent.
– À la bonne heure, approuva Canetègne trop ivre pour s’apercevoir de la substitution. Je poursuis le couplet de la marquise :
Aussi la vérité.
Vous portez à merveille
Manchettes à sabot,
Chapeau rond sur l’oreille,
Rubans, poudre et jabot.
Mais, ô très noble père,
Songez-vous qu’à l’instant
Votre grand fils Valère
Revient du régiment ?
Le chanteur enflait sa voix. Il fit un couac, et sans en paraître troublé attaqua le refrain :
Adieu, vos succès à la cour,
Il faut que chacun ait son tour.
Le doigt sur les lèvres, Dalvan invita ses amis à le suivre. Tous sur la pointe des pieds, évitant de froisser les branches, gagnèrent la limite de la clairière.
– Té, mon petit Marcel, où vas-tu ?
Cette question, sortie de la bouche de l’Avignonnais cloua les fugitifs sur place. Mais un regard dans la direction de l’ivrogne les rassura. Penché sur le policier dont le front s’appuyait à la table, Canetègne continua :
– Tu dors. Tu ne veux pas connaître le troisième couplet. C’est le plus beau. Le triomphe de l’amour paternel… et maternel aussi. Non… tu as ton compte. Ça m’est égal, je le chanterai pour moi !
Et avec un accent de mépris grotesque :
– Ces jeunes gens. Ça ne sait pas se modérer. Ça boit comme des éponges et ça s’endort. Mais regardez-moi donc. J’ai ri comme tout le monde sans perdre mon sang-froid.
Il fit un mouvement comme pour quêter les félicitations des assistants, mais l’équilibre lui manqua. Il s’agrippa à la table et réussit à se rasseoir.
– Sont-ils bêtes, ces Hindous ! grommela-t-il. Ils s’installent sur un terrain pas solide… et la terre se dérobe sous les pieds. Sont-ils bêtes !
Puis sans transition, passant à un autre ordre d’idées :
– Troisième et dernier couplet, clama-t-il d’une voix de Stentor :
– C’est ma fille Isabelle !
– C’est Valère, mon fils !
Marquise, qu’elle est belle !
– Qu’il est galant, marquis !
– Je crois voir ta figure,
Marquise, à dix-huit ans.
– Je crois voir ta tournure,
Marquis, en ton printemps.
Si notre place est prise,
N’en soyons point jaloux.
– Acceptez une prise
Et raccommodons-nous.
Adieu, nos succès à la cour,
Il faut que chacun ait son tour.
Sous les arbres les fugitifs avaient disparu, et tandis que l’écho affaibli des chants de Canetègne leur parvenait encore, Simplet disait à ses compagnons qui le félicitaient de les avoir délivrés :
– Ne parlons pas de ça. On est à table. Un monsieur vous gêne, on le grise. C’est vraiment trop simple !
XX
L’INDE TELLE QU’ELLE EST

Lorsque la noce fut dégrisée, on s’aperçut que Canetègne n’avait plus le même compagnon – de chaîne.
Furieux, il ne pouvait expliquer l’aventure. Aussi dans toute l’Aldée des lamentations retentirent. Les invités européens avaient disparu. Le bonheur du jeune ménage était compromis. Le mari et ses parents songèrent d’abord à déchiqueter le policier et son compagnon.
Par bonheur pour eux, un brahme en promenade les tira d’affaire. Moyennant quelques roupies, il déclara aux indigènes que Marcel était issu de Rama ; qu’il était descendu sur terre avec sa suite pour combler de prospérités les pauvres Hindous ; que le lien de paille était une relique, et que le négociant lui-même, dont le bras avait eu l’insigne honneur de demeurer en contact avec le divin visiteur, était personne sacrée.
Alors ce fut autre chose. Chacun prétendit posséder un fragment de relique. Les habits de Canetègne, voire même ceux de l’agent, furent découpés en petits morceaux. Les gens de l’Aldée, ceux des villages voisins accourus au bruit de la merveilleuse visite, se les partagèrent. Les cheveux même des deux hommes excitèrent les convoitises des derniers venus, et on les rasa de près.
Bref, au soir, saturés d’adorations, mais couverts seulement de petits jupons de toile, obligeamment prêtés par le marié radieux, le négociant et son policier firent dans Mahé une rentrée qui n’était pas positivement triomphale.
L’agent, après s’être nanti d’une toilette présentable, se rendit de bon matin chez l’administrateur pour lui rendre compte de sa mission. Pour plus ample informé, l’administrateur expédia un secrétaire chez Canetègne. Ce secrétaire confia l’affaire à un négociant, qui la colporta aussitôt chez tous ses confrères. Les occasions de rire sont rares à Mahé. Aussi toute la ville fut-elle bientôt au courant. On stationnait devant la maison occupée par l’Avignonnais. On voulait le voir. Les dames, qui occupent leurs loisirs à déchiffrer nos partitions parisiennes introduisaient une légère variante dans celle de Kosiki et fredonnaient :
Ah ! Par Bouddha ! par Bouddha ! par Bouddha !
Le joli Rama que voilà !
En un mot, le commissionnaire connut, à sa profonde mortification, tous les inconvénients de la célébrité. Il n’osait sortir de peur d’une ovation burlesque.
Tout le jour il resta enfermé chez lui, tournant dans les chambres, s’irritant de plus en plus à la pensée que ses ennemis fuyaient sans être inquiétés, maudissant Marcel et lui-même, justement puni de sa sotte confiance. L’agent, d’après ses ordres, avait retenu un bateau côtier. L’ombre venue, Canetègne s’embarquerait, gagnerait Calicut à quelques lieues au sud de Mahé. Cette ville étant tête de ligne du railway transpéninsulaire, qui finit sur la côte de Coromandel, à Négapatam, port distant de neuf kilomètres seulement du territoire français de Karikal, il comptait bien rejoindre ses astucieux adversaires. Et une fois qu’il les tiendrait, il ne les lâcherait plus. Il formulait les plus terribles serments de vengeance, quand sa domestique indienne – les pieds nus, la jupe courte, le torse à demi couvert par une écharpe de cotonnade – le prévint qu’un indigène demandait à lui parler :
– Un indigène !… Sans doute pour une location de costumes de mariage. Impossible, je m’absente et n’engage aucune affaire nouvelle. Renvoyez-le.
Un instant après, la servante reparaissait. L’inconnu insistait. Il s’agissait d’une chose intéressant personnellement M. Canetègne. Le négociant reçut le visiteur. C’était un homme de taille moyenne, à la peau foncée. Il portait le turban blanc, la longue tunique de cotonnade bleue, serrée aux hanches par une ceinture à maillons de cuivre, dans laquelle était fiché un kandjar recourbé. Ses pieds nus sortaient d’un dhoutil également bleu, étroit aux chevilles, plus large sur la jambe.
– Canetègne-Sahib ? fit-il en entrant.
– C’est moi.
– Bien. Ton aventure à l’Aldée de Bentaguel fait l’objet de toutes les conversations. J’ai des oreilles, j’ai entendu. J’ai appris que tu poursuis des brigands français, qu’ils t’échappent toujours, et j’ai pensé que nous aurions intérêt peut-être à nous allier.
L’Avignonnais examinait l’Hindou. Il était frappé de l’audace de son regard, de l’intelligence de sa face large.
– Qui est-tu, interrogea-t-il ?
– Je suis Nazir, de la nation des Ramousis.
– Qu’est-ce que les Ramousis ?
– Une race noble entre toutes celles qui peuplent l’Inde. Comme les brahmines, nous refusons de travailler. Nous prenons ce dont nous avons besoin aux Hindous des castes inférieures.
– Sans payer ?
– Naturellement.
– Alors vous êtes des voleurs ?
– C’est ainsi que les Anglais nous appellent.
Et Nazir se redressa avec l’orgueil d’un gentilhomme.
– Eh bien ! Nazir, que veux-tu ?
– Je suis pauvre ; les Anglais aux favoris rouges troublent notre industrie. Toi, tu es riche ; prends-moi à ta solde. Je poursuivrai tes ennemis et morts ou vifs, je les arrêterai.
– Oh ! morts !… Je ne tiens pas à verser le sang.
Le Ramousi haussa les épaules.
– Tu as tort. Le poignard est l’ami le plus fidèle. Cependant j’exécuterai tes ordres. Nous savons l’art des ruses et des déguisements. Notre courage est grand, mais notre adresse n’y perd rien.
– Et si j’acceptais, que demanderais-tu ?
– Dix roupies par mois. De plus, je veux être traité avec déférence. En signant le pacte, je deviens ton allié, non ton serviteur.

Évidemment Nazir avait dit vrai. C’était un gaillard qui n’avait pas froid aux yeux. Canetègne, qui n’était pas très certain de son propre courage, comprit que l’Hindou lui serait un aide précieux. Peu coûteux d’ailleurs. Avoir à sa solde, pour dix roupies mensuellement, un brave capable de jouer du kandjar, c’était véritablement une occasion.
– Peux-tu quitter la ville aujourd’hui ?
– À l’instant même.
– Alors j’accepte ta proposition.
– J’en étais sûr.
– À neuf heures, sois au débarcadère.
– J’y serai.
Et déjà le Ramousi se dirigeait vers la porte. Le négociant le rappela.
– Tu ne me demandes pas où nous allons ?
– Que m’importe. Tu me payes, je te suis. Le but m’est indifférent.
Sur ces mots, il fit une sortie majestueuse, laissant le commissionnaire tout surpris. Sans qu’il voulût se l’avouer, Canetègne était impressionné par les grands airs de son nouvel employé. Nazir fut exact au rendez-vous et, vers la dixième heure, le caboteur loué par le policier quitta la rade de Mahé et cingla vers Calicut.
Conseillés par William, pour qui le réseau de la voie ferrée Cisgangétique n’avait pas de secrets, Marcel et ses amis avaient atteint la ville anglaise le matin même, et à cette heure, ils filaient à toute vapeur à travers les plaines du Naghiri.
Des Bania ou marchands, des officiers de l’armée indo-anglaise étaient les seuls voyageurs que contenait le train. Au matin, les Français atteignirent la ville de Koûnbatore, située près des sources de la Cavery, qui à son embouchure arrose Karikal. Mais au lieu de suivre le cours du fleuve, le railway remonta vers le Nord jusqu’à Ostaramund, où les voyageurs durent séjourner plusieurs heures pour attendre la correspondance sur Negapatam. Cet arrêt, du reste, leur fut profitable.
Et Marcel, si enthousiaste de la péninsule Hindoustan, toucha du doigt les dessous de son apparente prospérité. Une promenade dans la ville suffit. La population était morne. Près des habitations riches, arrêtés par les grilles, des misérables Hindous se pressaient. Maigres, hâves, l’œil luisant, avec une résignation grosse de colère, ils attendaient l’aumône.
Parfois une voix hurlait un des nombreux jurons, où les noms de Brahma, Vishnou, Siva, Kali s’associent à une injure. Un grondement courait dans la foule. Puis un silence plus lourd succédait à cette explosion. Et comme les voyageurs regardaient, étonnés par ce spectacle farouche, William Sagger dit simplement :
– La famine.
– La famine, ici, dans ce pays béni du ciel ! se récria Dalvan.
– Ma foi oui, et le tableau que vous avez sous les yeux n’est pas exceptionnel. Chaque année où la récolte n’est pas superbe, la faim prend les Hindous aux entrailles et, dans certaines provinces, détruit un tiers de la population.
– Mais on ignore cela en Europe.
– Certes. Les Anglais ont tout intérêt à le cacher. Ils ne disent pas que les négociants de Calcutta, de Madras, de Bombay spéculent sur les grains, augmentant ainsi la misère. Ils ne disent pas que lorsque des millions d’hommes râlent d’inanition, ils exportent les mêmes quantités de céréales. Il ne faut pas que leur commerce souffre.
– Comment les deux cent cinquante millions d’Hindous n’ont-ils pas le courage d’exterminer les cent mille Anglais qui détiennent la fortune de l’Inde ?
– Ils sont doux en général. Le brahmanisme, la croyance en la métempsycose les rendent respectueux de la vie des moindres animaux. En tout, il y a quarante ou cinquante millions d’indigènes attendant une occasion pour se soulever.
– Ce serait suffisant, il me semble, pour chasser les occupants européens.
– La force des Anglais provient uniquement de la faiblesse de leurs sujets. Ceci m’amène tout naturellement à une comparaison. En France, naïfs comme vous l’êtes, vous déclarez à tout propos et hors de propos, que les Saxons vous sont supérieurs en fait de colonisation.
– Ma foi, affirma Marcel, il me semble…
– Il vous semble mal. Les colonies françaises deviennent françaises : voyez le Canada, la Louisiane, l’Algérie, la Guadeloupe, la Réunion. Les colonies anglaises ne subissent aucune assimilation. Pourquoi ? Parce que vous entreprenez la conquête morale des peuples, tandis que les habitants de la Grande-Bretagne cherchent seulement à les confisquer commercialement. Nulle part l’exemple n’est aussi frappant qu’ici. Un proverbe typique est celui des Mahrattes. « Les jours de liberté reviendront, disent-ils, quand les pavillons tricolores franchiront les portes de l’Occident. » Je m’arrête, fit brusquement l’intendant, l’heure de prendre le train est arrivée.
Tous revinrent à la gare. Ils étaient pensifs. La digression de Sagger, en face des meurt-de-faim, pâles victimes de l’occupation saxonne, les avait attristés, et tout bas Yvonne, se penchant à l’oreille de Diana, répéta la devise citée la veille par Marcel :
– Toutes les revanches !
– Oui, toutes, appuya l’Américaine ; je les souhaite toutes, au nom de la civilisation et du progrès.
De nouveau les voyageurs roulèrent sur la voie ferrée. Au passage, ils notèrent les villes de Kumbakouam, Trichinopol. Prévenus maintenant, ils découvraient partout les traces de la faim. Des malheureux aux joues caves, aux membres grêles, guettaient les voyageurs. Ils s’offraient à porter les bagages pour un cashe ou un paice. Et William, encyclopédie vivante, disait :
– La roupie vaut actuellement non pas 2 fr. 06, comme on le croit, mais 1 fr. 84. Elle se décompose en 8 fanons, le fanon en 2 annas, l’anna en 12 cashes ou paices. C’est-à-dire que ces pauvres diables transporteront une malle, souvent à plusieurs centaines de mètres, pour un centime environ.
Dans les champs, les paysans au torse nu, les reins serrés dans une bande de toile, demeuraient accroupis, immobiles, attendant la mort avec ce stoïcisme silencieux de ceux qui vivent près de la terre. Et dans le convoi, dont le roulement formidable troublait le calme de tombeau de la plaine embrasée, les officiers anglais riaient, les marchands jouaient, sans un regard, sans une pitié pour ces moribonds qui bordaient la voie ainsi qu’une armée de spectres.
À Négapatam, les voyageurs passèrent la nuit dans un boarding house tenu par la veuve d’un major, et le lendemain, de grand matin, ils se mirent en marche vers Karikal. Les neuf kilomètres qui les séparaient de la limite de la possession furent franchis en une heure trois quarts, sur une belle route soigneusement entretenue.
Tout de suite, ils comprirent qu’ils avaient quitté la terre anglaise après avoir traversé le pont jeté sur le Nagour-Odaï, ou rivière de Nagour. Sur la rive droite, la campagne stérile, desséchée, au sol crevassé par le soleil dévorant. Sur la rive gauche, un pays fertile découpé en rizières, vergers, bouquets de palmes, plantations d’indigotiers, de cotonniers, de tabac. Et comme ils s’étonnaient :
– Tout cela, fit ironiquement Sagger, vient de ce que le Français n’est pas colonisateur. Les Hindous anglais périssent de faim, les Hindous soumis à la France vivent dans l’abondance. On a construit ici deux cents réservoirs, lesquels alimentent six grands canaux avec de nombreuses ramifications. Le résultat est que le pays a mérité d’être appelé « le Jardin de l’Inde méridionale » et peut nourrir cent quatre-vingt-quinze habitants par kilomètre carré, soit cent vingt-quatre de plus que le sol de la métropole.
Puis ils tinrent conseil. Claude fit remarquer que la maison de l’administrateur devait être surveillée par un agent à la solde de Canetègne. L’Avignonnais l’avait positivement déclaré lors de leur rencontre à Mahé. Il était prudent de ne pas s’y rendre ; autant rester en dehors de la ville, et trouver un expédient pour se renseigner sur Antonin Ribor. Mais Dalvan haussa les épaules.
– Nous avons une avance sur notre ennemi. Donc, rien à craindre ; laissez-moi faire.
L’habitude de la confiance était venue à tout le monde. On suivit donc le brave garçon. Il laissa les amis sur le port. Sur la place du Gouvernement, il n’eut pas de peine à reconnaître le policier chargé par Canetègne de le saisir au passage. Chaque profession a ses stigmates. Un avocat ne saurait être confondu avec un barbier, encore que tous deux soient « rasants » ; un « cabotin » se distingue d’un laquais, bien que l’un et l’autre soient rasés.

L’agent était à la fois grand, fort et… blond filasse. Il avait de gros yeux bleus, le nez bulbeux, décoré d’un aimable carmin, la bouche fendue en coup de sabre, les épaules larges, la poitrine bombée, des pieds et des mains pour deux. Debout devant un pilastre de la façade, il causait amicalement avec un secrétaire de l’administrateur. Marcel l’enveloppa d’un regard.
– Nous allons rire un peu, dit-il.
Et tranquillement, ainsi qu’un homme qui n’a rien à craindre, il s’approcha. Les causeurs s’étaient tus.
– Pardon, messieurs, vous êtes sans doute attachés à la Résidence ?
– Oui, monsieur, répondit le secrétaire.
– Enchanté, monsieur, car vous pourrez, j’espère, me donner un renseignement.
– À votre disposition.
– Merci. Sur dépêches du Procureur général de Saint-Denis, Réunion, et de M. Canetègne, négociant, un agent doit être en observation aux environs, attendant des personnages qui ont échappé à la justice métropolitaine.
– Que lui voulez-vous ? questionna le policier.
– Lui faire une communication de la part de M. Canetègne. Aussi vous serais-je obligé de me mettre en rapport avec lui.
L’agent parut se consulter. Il jugea qu’il pouvait parler.
– C’est facile, dit-il.
– Ah !
– Car c’est moi-même.
– Très bien. Je ne perdrai pas de temps alors, car je dois encore me rendre à Pondichéry…
– À deux pas, une journée de mer par steamer, deux à la voile.
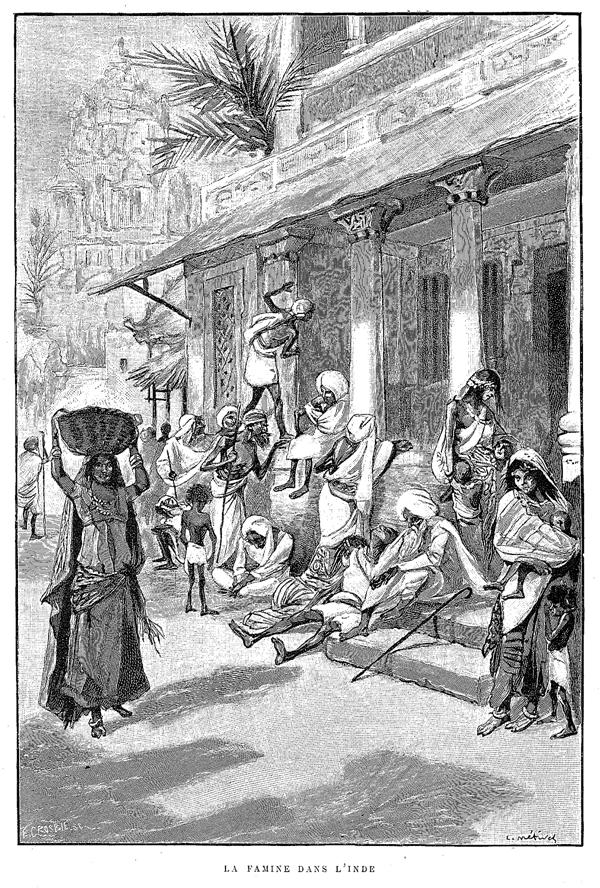
– Je sais bien, mais je suis pressé. Pour en revenir à nos moutons, vous êtes chargé d’arrêter des filous. Vous les reconnaîtrez à ceci : ils viendront s’enquérir d’un certain Antonin Ribor qui probablement n’a jamais paru en cette ville.
– Jamais !
Dans un sourire fugitif, Dalvan songea :
– Je suis fixé sur ce point. Maintenant taquinons Canetègne.
Et gravement :
– Avertis sans doute de la surveillance dont ils sont l’objet, ces coquins ont imaginé une ruse, pas maladroite en vérité. L’un, assez gros, à la chevelure rare, paraissant friser la cinquantaine, bien qu’il soit tout jeune – juste punition de ses fautes, – l’un donc se fait passer pour M. Canetègne. Vous ne connaissez pas cet honorable négociant, il serait possible que vous ajoutiez créance aux dires du drôle. C’est pour éviter cet inconvénient que j’ai effectué le voyage.
Le jeune homme avait l’air très sérieux. Rien dans sa physionomie n’indiquait qu’il faisait une formidable farce à son ennemi. Pourtant le policier crut devoir demander :
– Pourquoi M. Canetègne ne vient-il pas ?
– Il est retenu à Mahé.
– Il aurait pu télégraphier.
– Ah bien ! parlez-lui de ça. Il prétend que le télégraphe seul est capable de l’avoir trahi, d’avoir informé de ses dispositions ceux qu’il poursuit ; et il a préféré me charger d’avertir et vous et vos collègues.
– C’est pour cela que vous gagnez Pondichéry ?
– Précisément.
– Portez donc le bonjour de ma part à mon confrère Barton.
– Volontiers.
– De la part de Mariolle.
– Entendu.
– Quand aux gredins, soyez tranquille. Le premier qui me dit : « Je suis Canetègne », je le coffre.
– Vous aurez bien raison.
Serrant la main du policier, Marcel rejoignit ses compagnons. Ce fut un concert de rires quand il raconta son entretien avec le digne représentant de la loi. De leur côté, Yvonne et ses amis n’avaient pas perdu leur temps. Ils avaient soldé leur passage, à bord du vapeur « Victoria » de la British India Company, qui fait le service des côtes de la péninsule, à destination de Pondichéry.
Le départ devait avoir lieu le soir même. En attendant, les voyageurs remplacèrent leur garde-robe, un peu appauvrie par le voyage, à des prix inconnus en Europe. Pour cinquante francs, Marcel et Claude se vêtirent de la tête aux pieds. Yvonne elle, acquit moyennant trois pagodes (25 fr. 80), un délicieux « touriste confectionné », sous lequel elle avait l’air le plus avenant du monde. Leurs emplettes terminées, ils se rendirent sur le « Victoria », dont les cheminées vomissaient des tourbillons de fumée noire, indice précurseur du départ.
Un coup de sifflet, un coup de cloche et lentement le steamer tourne sur lui-même, présente l’avant à la haute mer. L’hélice bat les flots en un tourbillonnement.
On part, on est parti. Une journée de navigation et le navire entre dans le port de Pondichéry, après avoir longé la côte de Bahour. C’est le soir, toute démarche doit être remise au lendemain 15 avril. Les voyageurs cherchent un gîte, dînent et se couchent.
De grand matin, ils se rendirent au gouvernement. Ils voulaient s’assurer qu’Antonin n’avait pas été vu. De crainte, ils n’avaient aucune, puisque Marcel devait écarter tout soupçon en offrant au policier Barton les amitiés de son collègue Mariolle, de Karikal.
L’agent Barton les accueillit cordialement, leur affirma que l’explorateur Antonin était inconnu à Pondichéry et, pour faire honneur aux messagers de son confrère, s’offrit à leur servir de cicerone. Aucun départ sur Yanaon, enclave française, sise à trois journées de navigation, avant le surlendemain. La proposition du policier fut donc agréée. Celui-ci mit de planton à sa place un camarade et guida la petite troupe. Puis enchanté de la promenade, il leur offrit de les mener en excursion.
– Venez. Nous prendrons le chemin de fer à Villadour, nous le quitterons à Nalloor, où nous trouverons des porteurs pour gagner ma villa des champs.
Ce plan s’exécuta de point en point. En wagon, tandis que le convoi filait entre des plaines fertiles, aux routes plantées de cocotiers, Barton pérorait, cicerone infatigable. À l’instant où le train franchissait un pont dominant la rivière :
– Nous entrons au pays anglais, l’enclave de Fivorandarcovil.
– Déjà ?
– Oui, les terrains ressortissant à Pondichéry sont très morcelés. La commune de Vadanoor surtout…
– N’est-ce point là que vous nous conduisez ?
– Si. Cette commune, allais-je vous dire, est indivise. Les parts de propriété attribuées à la Grande-Bretagne et à la France sont respectivement de 7/12 et de 5/12, si bien que – le cas ne s’est jamais présenté, heureusement – un criminel y serait comme en un lieu d’asile.
Les voyageurs échangèrent un regard. Et Marcel curieusement :
– Qu’entendez-vous par là, monsieur Barton ? Je vous fatigue peut-être de mes questions, mais vos explications m’intéressent au suprême degré.
Flatté, l’agent s’inclina.
– Vous allez me comprendre. L’extradition est indispensable pour arrêter un coupable en pays étranger.
– En effet !
– Eh bien ! supposez un voleur irlandais, écossais, gallois réfugié à Vadanoor. Les autorités anglaises ne sauraient lui mettre la main au collet, puisqu’il est pour cinq douzièmes en terre française. D’autre part, la France ne pourrait accorder l’extradition, puisque l’extradition doit être entière et non fractionnée. Le seul moyen d’en sortir serait que l’un des États rétrocédât à l’autre sa part de propriété. Vous le voyez, légalement, le criminel serait en sûreté.
L’orateur s’arrêta, ébahi. Simplet lui serrait cordialement la main.
– Qu’est-ce ? fit-il.
– De la reconnaissance. Vous nous pilotez dans des endroits incroyables ; à mon retour en France, je parie que personne ne croira à ce que je raconterai.
– Ah ! nos compatriotes ne sont pas forts en géographie.
– Bah ! ils sont remplis de bonne volonté. Quand on leur enseigne quelque chose, soyez-en certain, la leçon ne tombe pas dans l’oreille de sourds.
Le convoi ralentissait à l’arrêt de Nalloor. Quittant le train, Barton, décidément très féru de ses hôtes, se démena tant et si bien qu’il eut bientôt réuni assez de porteurs et de chaises, pour assurer aux Européens un transport commode jusqu’à son logis. Bientôt, la rivière ou Ar de Pambé se montra.
– Sur l’autre rive, dit Barton, commence la commune de Vadanoor.
Le pont traversé, tous voulurent mettre pied à terre. Il leur plaisait de poser le pied sur ce sol hospitalier, où grâce aux douzièmes de propriété saxonne et gauloise, il leur était loisible de se promener avec un agent de police sans rien craindre pour leur liberté. La maison de leur guide était charmante. Un simple rez-de-chaussée, précédé d’un péristyle à la colonnade gracieuse et surmonté d’une terrasse fleurie bordée d’un balcon, aux balustres entourés de plantes grimpantes. Le tout revêtu d’un crépi aurore qui, sous la lumière crue d’un soleil implacable, était d’un délicieux effet.
On se disposait à entrer dans l’habitation quand soudain Yvonne s’arrêta et, désignant à son frère de lait une troupe qui s’avançait, elle murmura d’une voix frémissante :
– Lui !
Au milieu de plusieurs personnages, Canetègne apparaissait. Suant, soufflant, les cheveux ébouriffés, les vêtements en désordre, le visage lacéré d’égratignures, l’Avignonnais courut sus à ses ennemis :
– Enfin, je vous rencontre !
Et prenant par la main un de ses compagnons :
– Monsieur le Directeur de l’intérieur de la colonie, dit-il, suivi de quelques agents. Cette présentation afin de vous prouver que toute résistance est inutile.
Puis se croisant les bras, foudroyant Marcel du regard :
– Ah ! vous faites des farces ! Ah ! vous me faites arrêter à mon arrivée à Karikal par un policier imbécile qui sera révoqué, car il m’a frappé, assommé à demi.
Simplet n’avait pas bougé. À ce moment il parut s’émouvoir.
– Quoi, mon bon monsieur, vous avez été si malheureux que cela ?
– Oui, monsieur.
– Allons, tant mieux. Au moins cette fois, le « passage à tabac » ne s’est pas égaré.
Canetègne serra les poings. Mais se calmant soudain :
– Plaisantez, jouissez de votre reste. J’ai le beau rôle et vous allez nous suivre à Pondichéry…
– Pourquoi cela, cher monsieur ?
– Pour être jeté en prison et expier vos forfaits.
Dalvan eut un petit rire sec.
– Cela ne me tente pas.
– Peu importe, votre adhésion n’est pas nécessaire.
– Vous vous trompez.
– Je me…
– Complètement. Nous sommes ici en terre d’asile. La France n’a que cinq douzièmes de propriété. Vous ne pouvez arrêter que les cinq douzièmes de moi-même. Or, je suis indivis, ainsi que la commune de Vadanoor. Donc, tant que je n’aurai pas l’obligeance de rentrer en territoire complètement français, je reste libre.
Le personnage, que le négociant avait désigné sous le titre de Directeur de l’intérieur, inclina la tête.
– C’est vrai.
– C’est vrai ! hurla Canetègne exaspéré par ce nouveau contre-temps.
– Oui, et si je vous ai accompagné, c’est uniquement parce que j’espérais les accusés ignorants de cette particularité. De bonne grâce ils auraient quitté ce lieu de refuge, et l’arrestation aurait pu être opérée.
– Ah ! gronda l’Avignonnais, qui donc les a si bien instruits ?
Le policier Barton avait assisté à toute la scène. Son visage avait exprimé la colère, le doute. Ses yeux se portaient du négociant à ses hôtes. Irrésolu, ne sachant auquel entendre, il semblait pourtant emporté vers ces derniers par un courant sympathique. À la question du commissionnaire, il voulut répondre. Simplet le prévint. D’un ton grave :
– Monsieur Canetègne, fit-il, depuis que vous nous poursuivez, vous avez dû constater qu’un pouvoir mystérieux déjoue toutes vos combinaisons.
Et avec un regard à l’adresse de Barton :
– C’est lui qui a suscité un brave homme pour nous donner, cette fois encore, la parade à votre attaque. Si on le mettait en notre présence, je suis certain qu’il n’aurait aucun regret. On sait que la loi n’est pas toujours la justice, qu’elle se met parfois au service des plus détestables causes. Il suffit du reste de consulter votre visage et le nôtre pour en être assuré.
– Des mots, essaya de protester l’Avignonnais.
Mais Dalvan lui imposa silence du geste, et d’une voix claire, nette, vibrante qui impressionna les assistants :
– Vous êtes entouré d’agents, accompagné par un des plus honorables fonctionnaires des établissements français, M. le Directeur de l’intérieur. Eh bien ! tous sentiront que je dis vrai en affirmant, ce que vous savez aussi bien que nous, que vous êtes un escroc.
Canetègne esquissa un mouvement. Simplet n’y prit pas garde.
– Un escroc, continua-t-il ; à force d’habileté processive, vous avez fait emprisonner ma sœur de lait. Claude et moi, à peine libérés du service militaire, l’avons aidée à s’évader. Et aujourd’hui, vous nous traquez, non pas au nom de la justice, mais pour éviter le châtiment ; pour nous empêcher de rejoindre le frère d’Yvonne, Antonin Ribor que vous avez ruiné, exilé, et qui peut fournir la preuve de votre infamie. Cette preuve, malgré vous, nous la trouverons ; nous la produirons, et ceux qui m’écoutent en ce moment béniront le hasard, qui nous a mis face à face sur ce coin de terre, où ils sont désarmés.
Malgré son audace, le négociant resta muet. Le regard flamboyant de Marcel exerçait sur lui une sorte d’hypnotisme. Les personnages présents éprouvaient une gêne réelle ; ils comprenaient qu’ils venaient d’entendre la vérité. Représentants de la loi, ils avaient honte d’être astreints à prêter main-forte à celui qu’ils considéraient comme le coupable. Et Barton traduisit cette impression.
– Monsieur, dit-il à Dalvan, vous vous êtes un peu moqué de moi ; mais j’ai écouté, je vois. Dès ce moment je n’ai aucun regret. Bien plus, je serai heureux de vous recevoir dans ma maison.
Le sous-officier lui tendit la main, puis souriant :
– Après cet entretien déjà long, je me reprocherais, messieurs, de vous retenir encore. Mes amis et moi allons vous quitter.
Il fit un signe à l’intendant.
– Nous avons besoin de votre géographie.
– Elle est à vos ordres.
– Où se trouve la frontière anglaise ?
– À cinq cents mètres, à l’est.
– Tiens, murmura Barton, c’est presque juste. Exactement la limite séparative est à…
– Cinq cent vingt-quatre mètres, acheva Sagger.
L’agent salua.
– Oh ! j’ai étudié, expliqua modestement William, et je m’en félicite, puisque mes connaissances sont utiles à de braves gens. Miss Diana Gay Gold Pretty, ici présente, pense de même. Elle n’a pas cru pouvoir employer mieux sa fortune qu’à aider Mlle Yvonne Ribor à confondre son accusateur.
Le nom de la riche Américaine eût levé les derniers doutes, s’il s’en fût trouvé encore dans l’esprit des auditeurs. Aussi toutes les figures s’épanouirent, lorsque Dalvan s’écria :
– Gagnons donc la frontière. Monsieur Canetègne, inutile de nous signaler aux autorités anglaises ; vous savez que nous marchons vite.
Un quart d’heure après, le jeune homme et ses amis franchissaient la limite du territoire de Vadanoor et, après un salut amical aux fonctionnaires français, disparaissaient bientôt derrière un bouquet d’arbres.
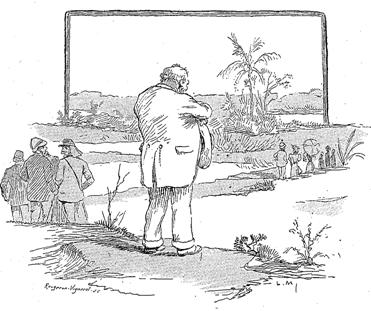
XXI
UN COUP DE KANDJAR
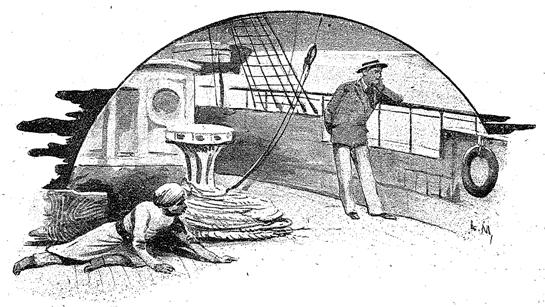
Le Directeur de l’intérieur, les agents étaient partis. Seul Canetègne demeurait les pieds cloués au sol, près de la ligne fictive limitant les possessions françaises. Dans son cerveau grondait l’orage. Tout ce qu’il tentait contre ses adversaires échouait piteusement. La police elle-même le secondait avec mollesse, pour ne pas dire avec mauvaise volonté.
Il rêvait ainsi lorsqu’une main se posa sur son épaule. Il tressaillit, leva la tête et reconnut le ramousi Nazir qu’il avait embauché à Mahé. L’Hindou riait. Il s’était tenu à l’écart durant l’entretien précédent. Il avait observé et deviné ce qui se passait. L’Avignonnais le regarda avec colère.
– Tu ris ? commença-t-il.
– Oui, parce que j’avais raison en te disant : le kandjar est l’ami le plus sûr.
– Oui, peut-être.
Dans son irritation, Canetègne, rebelle par nature aux moyens violents, arrivait à en admettre l’utilité.
– Écoute, Sahib, ce que Nazir a pensé.
– Parle.
– Les pays français sont trop peu étendus. Ceux que tu chasses t’échapperont toujours. Il faudrait les arrêter en un point de l’Inde anglaise, assez longtemps pour que tu puisses obtenir leur arrestation de la police britannique.
– Et le moyen ?
– Ils fuient vite, donc ils emploieront le cheval de feu.
– Hein ?
– Le railway, comme disent les blancs. À Madras, ils seront obligés de reprendre la mer pour gagner Yanaon. Viens à Madras. Je prendrai passage sur le même navire qu’eux et…
Le Ramousi termina sa phrase par un geste expressif. Sa main caressa la poignée du kandjar recourbé qui ne le quittait jamais. Puis, tranquillement, comme s’il se fût agi de la plus licite des besognes :
– Combien te faut-il de jours pour tes démarches auprès du gouvernement de l’Inde britannique ?
– Trois semaines, un mois.
– Bon. Partons pour Madras. Là, tu attendras de mes nouvelles et agiras aussitôt que je t’informerai de la réussite de mon projet.
Canetègne se leva sans ajouter une parole. À son tour il quitta le territoire de Pondichéry et se dirigea vers la plus prochaine station du South India Railway.
Le 18 avril, à deux heures, il descendait à la gare de Madras. Sur le conseil de Nazir, il s’enferma dans une chambre d’hôtel. Quant au Ramousi, il se mit en quête des amis de Mlle Ribor. Il avait calculé juste. Ceux-ci, vu l’impossibilité de gagner Yanaon par terre, avaient résolu de rejoindre à Madras un steamer de la British India Company, et de ne pas quitter le navire jusqu’à Calcutta. À l’escale d’Yanaon, l’Américaine descendrait à terre, et de Calcutta elle se rendrait à Chandernagor afin de s’enquérir, dans l’une et l’autre enclave, du voyageur Antonin. Ainsi, tous les établissements auraient été visités ; il était évidemment inutile de se rendre dans les factoreries ou loges que nous possédons à Surate, Calicut, Mazulipatam, Balassore, Dakkou, Patna et Jangdia.
En avance de quelques heures sur Canetègne, tous avaient atteint Madras. Le vapeur Nerbadah, qu’ils devaient prendre à Pondichéry lors de la rencontre fâcheuse de l’Avignonnais, était attendu dans la soirée et ne repartirait qu’au jour. Ils retinrent leurs places à l’agence maritime, puis tranquilles de ce côté, ils songèrent à se reposer. Douze heures passées en chemin de fer justifiaient cette préoccupation. Malheureusement, vers le soir, ils crurent bon de s’assurer que le navire attendu était en rade. Et Nazir qui, depuis son entrée dans la ville, se tenait en sentinelle vigilante aux abords de l’appontement de l’embarcadère, les rencontra.
L’Hindou eut un sourire de satisfaction. Adroitement il se rapprocha des voyageurs, saisit au vol leurs questions au sujet du départ du steamer, et bien renseigné, retourna à l’hôtel où Canetègne l’attendait.
Aussi, lorsqu’à six heures du matin, par un temps couvert, le Nerbadah quitta la rade de Madras, il emportait, avec les compagnons d’Yvonne, le « bravo » gagé par son mortel ennemi. Il ventait frais, la mer était dure. La plupart des passagers demeuraient enfermés dans les cabines.
Le Ramousi eut donc toute liberté d’action. Il en profita, du reste, et apprit avec joie que Marcel et ses amis s’étaient réservé l’usage exclusif d’une cabine par personne. Chacune contenant deux couchettes superposées, il est de coutume de la partager avec un passager, mais miss Diana avait une trop haute idée du confort pour se plier à pareille incommodité. Elle avait insisté de telle sorte, que l’on s’était rendu à ses raisons. Et Marcel était seul ; Marcel, que l’Hindou avait choisi pour victime, pensant, comme un diplomate européen, qu’il faut priver une troupe de son chef pour la réduire à l’impuissance.
La brise tomba peu à peu. Le pont se peupla de « terriens » en toilettes claires. Ladies aux longues dents, officiers, banians vêtus de cotonnades à fleurs, radjahs avec leur suite brillante.
À la nuit, le paquebot mouilla en rade de Bellore. Le lendemain, il prolongea la côte des Circars, eut un court arrêt à Mazulipatam et jeta l’ancre, à la nuit, à l’embouchure de la rivière Godavery, sur les bords de laquelle se trouve l’enclave française d’Yanaon. Le Nerbadah devait rester sur son ancre le jour suivant, et Diana se proposait de remonter jusqu’à la ville de grand matin. En conséquence, elle souhaita le bonsoir à ses compagnons de voyage et se retira dans sa cabine, bientôt imitée par Yvonne, William et Claude.
Marcel resta seul sur le pont. Il songeait, non à la cité d’Yanaon, jadis la capitale d’un empire conquis par Dupleix et Bussy, dont les Anglais nous ont restitué, en 1839, une parcelle minuscule, mais à Yvonne. Ils ne se parlaient presque plus, évitant de se trouver ensemble, chacun s’enfonçant de plus en plus dans son erreur. La poursuite d’Antonin Ribor devenait nerveuse, exaspérée… Le sous-officier, la jeune fille, avaient hâte de l’atteindre, afin que le voyage fût terminé, qu’ils pussent se séparer, briser la chaîne qu’un amical dévouement avait rivée à leurs corps. Car ils le comprenaient, ou croyaient le comprendre, pas d’autre solution n’était possible.
Dalvan n’avait pas une seconde songé à renoncer à la recherche du jeune explorateur, et pas une fois, Mlle Ribor n’avait pensé qu’elle pût être abandonnée par son frère de lait. Penché à l’arrière, bercé par le clapotis des vagues se brisant sur la coque du steamer, Simplet se laissait aller à sa tristesse. Tapi derrière un rouleau de cordages, ramassé sur lui-même comme pour bondir, le Ramousi l’observait.
– Allons, prononça tout haut Dalvan, le mieux est encore de me coucher. À la cabine, maudit rêveur ; là au moins tu oublieras en dormant.
Glissant sur le pont ainsi qu’un spectre, Nazir gagna aussitôt l’escalier et plongea dans la pénombre des coursives. Marcel n’avait rien vu. Il quitta sa place, et lentement, de cette allure lasse de ceux qui ne sont point pressés d’arriver, il descendit à son tour dans le couloir des cabines. Mais au lieu de se diriger tout de suite vers la sienne, il alla d’abord écouter à la porte de sa sœur. Aucun bruit.
– Elle repose, murmura-t-il encore.
Et revenant sur ses pas, il prit le chemin de l’étroite chambrette dont il disposait.
– Tiens, fit-il en poussant la porte, je n’avais pas fermé.
Sans attacher d’importance à cette remarque, il entra et commença à se dévêtir. Il tournait le dos aux deux couchettes étagées. Soudain, au bord de la plus élevée, une figure noire aux yeux brillants se montra. C’était le Ramousi. Il considéra le jeune homme et brusquement bondit sur lui. Renversé par le choc, Dalvan ne poussa pas un cri. Le bras de l’assassin se leva, la lame de son kandjar descendit dans un éclair et s’enfonça avec un bruit mat dans l’épaule du sous-officier.
Son crime accompli, l’Hindou s’élança vers la porte, la referma et courut se verrouiller dans sa cabine en ricanant :
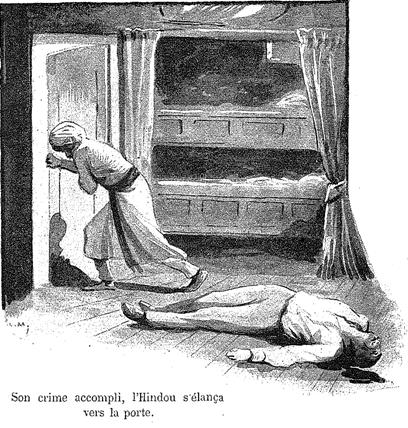
– Canetègne-Sahib a tout au moins un mois devant lui !
Simplet était étendu sur le plancher de sa cabine, au milieu d’une mare de sang qui filait en rigole vers la porte. La violence du coup lui avait fait perdre connaissance. Bientôt cependant il rouvrit les yeux. Il regarda autour de lui, ne comprenant pas. Puis le souvenir lui revint. Un corps lourd était tombé sur lui et l’avait précipité à terre. Qu’était-ce ? Il voulut se lever pour s’en assurer, mais une douleur aiguë parcourut son épaule droite, amena un frisson qui le fit trembler de tout son être. Alors il s’aperçut qu’il était mouillé ; sa main baignait dans le sang. La réalité lui apparut ; il était blessé.
D’un effort surhumain, il réussit à s’asseoir. De nouveau la douleur le reprit. Il grinça des dents, sentant perler à ses tempes des gouttes de sueur. Mais la saignée abondante l’avait affaibli, ses yeux se troublèrent ; il rassembla ses forces pour appeler, un faible gémissement sortit de ses lèvres contractées. Autour de lui tout tournait, sa cabine lui semblait montée sur un pivot, les couchettes décrivaient des cercles. Puis, ses oreilles s’emplirent de bourdonnements, les cloisons se strièrent de raies de feu, et il retomba en arrière privé de sentiment.
Dans le couloir des cabines, un passager noctambule passa. Soudain son talon glissa sur une surface humide.
– Qu’est-ce ? fit-il à haute voix.
Les lampes qui éclairaient les coursives étaient assez distantes, et dans la demi-obscurité, le promeneur distingua seulement un filet liquide tremblotant sur le plancher. Il frotta une allumette, se baissa.
– Du sang, balbutia-t-il pris d’angoisse.
Et secoué par la terreur, il s’enfuit, escalada l’escalier du pont et, rejoignant l’officier de quart sur la passerelle, lui annonça sa lugubre découverte. Des matelots pénétrèrent dans la cabine et emportèrent Marcel à l’infirmerie. Le médecin du bord hocha la tête en le voyant.
– La blessure n’est pas mortelle par elle-même, mais le malheureux a perdu beaucoup de sang. Lui restera-t-il assez de vitalité pour résister à l’assaut de la fièvre.
Au jour, tout le monde connut le crime. La nouvelle sinistre parcourut le navire avec une rapidité vertigineuse. Équipage, passagers furent rassemblés sur le pont en quelques minutes. Des groupes se formaient. On pérorait. Quel pouvait être l’assassin ? Et parmi les plus diserts, les plus irrités, Nazir se faisait remarquer.
C’est au milieu de cette effervescence que Diana, donnant le bras à Yvonne, parut, En les voyant, on fit silence. On se sentait ému devant ces belles jeunes filles que le malheur touchait de sa griffe. Un officier s’approcha d’elles. Avec ménagement, il leur apprit l’accident survenu. Elles ne prononcèrent pas une parole, et d’un pas lent se dirigèrent vers l’infirmerie.
Sur une couchette, Marcel était étendu, pâle, exsangue, les yeux clos. Yvonne s’agenouilla.
– Mort ! il est mort, murmura-t-elle en appuyant son visage sur le drap.
Elle ne bougeait plus. Miss Pretty, très émue elle-même, voulut lui adresser quelques paroles d’encouragement, mais elle secoua la tête d’un air d’ennui, de lassitude irrémédiable. À ce moment, le médecin, prévenu de leur visite, arriva. D’un mouvement automatique, les jeunes filles se dressèrent devant lui, une ardente interrogation dans les yeux. Le praticien haussa les épaules.
– Il est très affaibli, fit-il entre haut et bas. La fièvre va le prendre.

Il tâta le pouls du blessé.
– Oui, oui, voilà que ça commence. Nous lutterons. Après tout, le sujet est jeune, bien constitué, il surmontera peut-être la crise. Mais il faut du repos, une tranquillité absolue. Je veux rester seul auprès de lui. Vous m’entendez, seul absolument !
Il avait pris les jeunes filles par le bras et les conduisait vers la porte. Elles eurent une résistance.
– Laissez la nature agir. Un cri, une parole, un sanglot peuvent paralyser la vie dans sa lutte contre la destruction. Le malade paraît insensible. Ne vous y fiez pas. Le cerveau veille souvent alors que le corps est anéanti. Combien de fois, des amis, des parents, croyant pouvoir donner libre cours à leur douleur, ont tué par l’émotion réflexe celui qui aurait été sauvé ! Je ferai pour le mieux.
Une fois hors de la vue du blessé, le docteur reprit :
– Maintenant, mesdemoiselles, il y a autre chose.
– Quoi donc ? interrogèrent-elles, surprises du ton du docteur.
– Un crime a été commis. Votre compagnon a été frappé par derrière d’un coup de poignard hindou.
– Hindou !
Elles répétèrent le mot en échangeant un regard. Toutes deux avaient eu la même pensée. Pour elles, l’assassin s’appelait Canetègne. Que venait faire ici cette arme indienne ?
– Oui, poursuivit le médecin. La lame a traversé l’épaule, perforé l’omoplate et est ressortie sous la clavicule, en frisant l’articulation de l’humérus. J’ajoute : nous ne sommes pas en présence d’un crime ordinaire, mais d’une vengeance. Tout le prouve : l’argent resté dans le portefeuille, la montre dans le gousset du pantalon, tout. Vous avez deux devoirs. Me laisser tenter de sauver la victime et aider la justice à découvrir l’assassin.
Comme figées, Yvonne et Diana écoutaient. Découvrir l’assassin ! Ah ! certes, elles le devinaient ! Elles étaient sûres que la main de l’Avignonnais avait dirigé l’arme, mais il leur était interdit de parler. Pour accuser, elles devraient raconter les origines de la haine du négociant. Et alors elles seraient prisonnières. Le blessé lui-même deviendrait captif. Il n’échapperait au trépas que pour être la proie de la geôle.
– Ne connaissez-vous au passager aucun ennemi ? articula nettement le docteur.
Le visage des jeunes filles prit des tons de cire. Mais la liberté de Marcel dépendait de leur énergie. Elles regardèrent leur interlocuteur bien en face, et d’un ton calme, assuré :
– Non, dirent-elles, aucun ennemi.
– Alors, un crime banal. Une vengeance d’Hindou froissé dans ses sentiments de religion ou de caste.
– Probablement.
– Ah ! les sauvages ! grommela le médecin complètement trompé par leur réponse. Enfin, je vous quitte. Je vais m’occuper de notre malade. Soyez tranquilles, il est en bonnes mains.
Après un cordial shake-hand, il rentra à l’infirmerie. Pas un instant il n’avait paru surpris de voir ces « misses » venir seules au chevet d’un jeune homme. Il était Anglais, médecin d’un steamer anglais, habitué à voir les Anglaises agir librement et ignorant du « potin », plaie de notre patrie française. Comme Diana et Yvonne s’éloignaient, elles rencontrèrent Claude qui arrivait tout bouleversé. Elles lui racontèrent leur entrevue avec le docteur. Lui, leur apprit que William Sagger, comprenant que miss Pretty ne pourrait quitter le bord, venait de s’embarquer pour Yanaon. Il s’enquerrait d’Antonin et rapporterait ce qu’il croyait utile au blessé. L’Américaine eut un mouvement de dépit.
– William ne devait pas sans me consulter…
– Le temps pressait, riposta Claude, et je l’ai approuvé, certain qu’elle – il montrait Yvonne – aurait besoin de vous.
– Ah !… en effet, vous avez raison.
– À la bonne heure, vous voici raisonnable.
Ils se serrèrent la main sans savoir pourquoi. Longue fut la pression. Ils demeurèrent ainsi, les yeux dans les yeux, s’oubliant. Soudain, comme en un choc, ils eurent conscience de leur attitude et se séparèrent avec embarras. La journée fut interminable. Vers cinq heures, Sagger reparut. Antonin n’avait pas été vu à Yanaon, et le géographe avait dû se borner à faire provision d’oranges. Tous les portèrent aussitôt à l’infirmerie.
Le docteur les reçut fort bien, mais ne laissa personne pénétrer auprès du malade. Le délire commençait son œuvre. À travers la porte close, des éclats de voix parvenaient jusqu’aux visiteurs. Yvonne tremblait, les yeux fixés sur le panneau de bois, qui lui dérobait la vue de son frère de lait. Un instant l’aide du docteur entre-bâilla l’huis pour appeler son supérieur. Un rugissement passa dans l’air.
– Yvonne ! Yvonne ! défends-toi, me voici ! Puis un éclat de rire lugubre.
– C’est bien simple.
Frissonnante, éperdue, Mlle Ribor fut entraînée presque de force par Claude et Diana. Le docteur revint auprès de son client. La face empourprée, Dalvan s’agitait, combattant des ennemis imaginaires que l’hallucination suscitait autour de lui. Toute la nuit, le médecin le veilla. De deux en deux heures, il lui faisait absorber une dose de sulfate de quinine. Dans l’intervalle, il lui exprimait dans la bouche le jus d’une orange.
Le Nerbadah avait repris la mer. Durant les jours suivants la lutte contre le mal continua. Peu à peu les symptômes alarmants disparurent, et en arrivant en vue de l’embouchure de l’Hougly, bras méridional du Delta du Gange, sur lequel est bâti Calcutta, capitale des possessions anglaises, le praticien put dire à Yvonne :
– Il est hors de danger. Mais il lui faudra plus d’un mois de repos. Enfin il est assez bien pour être transporté au logis que vous choisirez.
Pour la première fois depuis le départ d’Yanaon, le sourire reparut sur les lèvres de la jeune fille. Elle entraîna miss Pretty sur le pont. Heureuse de savoir Simplet sauvé, elle semblait revivre. Et ainsi qu’il arrive souvent, dans le deuil où dans la joie, elle se persuadait que les objets extérieurs se mettraient à l’unisson de ses sentiments.
Jamais une journée ne s’était annoncée plus belle. Cette matinée du 25 avril était exceptionnelle. Comme le soleil se montrait radieux ; quelles délicieuses senteurs venaient de terre apportées par la brise ; comme le spectacle de l’immense lagune qui forme le Sunderbund, ou bouches du Gange, était merveilleux ! Cependant, laissant à droite la rade de Sangor et le banc sableux de Mizra, le steamer embouquait l’estuaire de l’Hougly, large de plus de douze kilomètres et remontait vers Calcutta. Le navire doublait le cap Hougly surmonté d’un sémaphore, brûlait Folta, près de son lac poissonneux, Atchipoor, Oolahburnia, le fort Gloucester, gardien du pont tournant de Budge-Budge.
Brusquement le cours d’eau s’infléchissait à l’est, et sur la rive gauche se montraient les premières villas de Garden-Reach, faubourg lointain de Calcutta. Un nouveau coude, et Calcutta s’étale sur les deux rives en panorama devant les voyageurs. À leur droite les docks, les bassins, le canal de Tolly-Nallah, l’arsenal ; à gauche le jardin botanique et le faubourg de Sihpoor. Le vapeur avance toujours, se glissant entre les embarcations nombreuses qui sillonnent la surface du fleuve, passant à une encablure des vaisseaux de toutes nationalités amarrés au quai du Strand, promenade de trois kilomètres, fréquentée par le high-life de la capitale indo-britannique. Presque à la limite de la ville noire, Black-Town, il s’arrête le long du quai élevé de quinze mètres, et la planche est jetée sur l’un des larges escaliers, ou ghats, qui permettent de descendre de la promenade au niveau des eaux.
XXII
NAZIR TRAVAILLE

Depuis un mois, Marcel était installé dans une chambre confortable dont les fenêtres grandes ouvertes donnaient sur le fleuve. Le Sunderbund-Hôtel l’avait reçu ainsi que ses compagnons. Après deux rechutes peu graves, la convalescence commençait. Le médecin lui avait permis de se lever. Assis auprès de la croisée, ayant à côté de lui Yvonne et Diana attentives au moindre signe, il aspirait délicieusement l’air tiède qui baignait son visage. La porte s’ouvrit ; Claude parut. Le « Marsouin » agitait triomphalement une dépêche.
– Pour miss Pretty, dit-il.
Celle-ci l’ouvrit. Le capitaine du Fortune lui mandait que le steamer, complètement radoubé, quitterait Bombay sous deux ou trois jours et ferait route pour Calcutta, où il arriverait vers le 20 juin.
– Juste ce qu’il faut à Simplet pour se remettre tout à fait, s’écria Yvonne.
Le blessé sourit.
– Et nous pourrons reprendre notre voyage.
– Ne t’occupe pas encore de cela.
– Pourquoi donc ?
– Tu es malade.
– Justement. Nos pérégrinations terrestres me semblent peu de chose ; j’ai pensé en faire une plus longue… de l’autre côté de la vie.
Et voyant Mlle Ribor pâlir au souvenir des angoisses endurées :
– Mais c’est fini, bien fini. Donne-moi la main, petite sœur, et ne me garde pas rancune pour la peur que je t’ai causée.
– Rancune !
La jeune fille l’embrassa sur le front, puis elle se rassit, abandonnant au sous-officier sa main qu’il tenait serrée dans les siennes. Il avait fermé les yeux. Elle n’osait faire un mouvement, croyant qu’il dormait. Il se disait :
– Pourquoi cela ne peut-il durer toujours ?
Miss Pretty causait avec Claude un peu à l’écart. Cela leur arrivait souvent maintenant ; mais tandis que l’Américaine devenait chaque jour plus joyeuse, Bérard s’assombrissait progressivement. Un domestique vint demander si M. Dalvan voulait recevoir M. Nazir.
– Oui, répondit le jeune homme.
Le Ramousi entra, échangea des poignées de main avec tout le monde, et s’adressant au blessé :
– Je vous apporte quelques primeurs introuvables en ville. Je les tiens d’un de mes amis, agronome distingué, qui a été heureux de s’en dessaisir au profit d’un gentleman victime d’un guet-apens.
Tous le remercièrent avec effusion.
Il ne laissait jamais passer une occasion d’être aimable. De fait, l’Hindou s’était introduit dans l’intimité des voyageurs. À Calcutta, il était descendu dans le même hôtel, se donnant pour un négociant. La pension était chère, mais ce voleur possédait quelques économies, et deux lettres confidentielles écrites par Canetègne lui assuraient le remboursement de ses dépenses. Il s’était mis à la disposition des amis de Marcel.
– J’étais sur le bateau Nerbadah, avait-il dit, j’ai été très ému de votre malheur, mais j’aurais pensé être importun en me présentant à vous. Ici, il n’en est plus de même. Je connais la ville qui vous est étrangère, et tout en m’occupant de mes affaires, je suis à même de vous être utile.
Tout doucement il s’était rendu indispensable. Il avait amené le meilleur médecin de Calcutta. Pour le blessé il dénichait les plus beaux fruits, les légumes les plus savoureux. Quand il rentrait, il ne manquait jamais de visiter Marcel. Il lui apportait les journaux, les livres parus, lui narrait les anecdotes piquantes de l’agglomération. Peu à peu, tous s’étaient pris à son amabilité, sans se douter qu’ils serraient la main à un agent de leur ennemi. Dès l’arrivée, Nazir avait télégraphié à Canetègne.
– Activez démarches. Avez un mois ou six semaines pour conclure affaire. Plus que suffisant.
À cette dépêche de tournure commerciale, l’Avignonnais avait répondu, à quarante-huit heures d’intervalle, par deux lettres ; l’une bourrée d’instructions, l’autre annonçant son départ de Madras pour Pondichéry, où il allait prier le gouvernement de réclamer des autorités anglaises l’extradition du sieur Dalvan.
Depuis, plus de nouvelles. Nazir trompait l’ennui de l’attente en trompant ceux qu’il désirait perdre. Cependant le silence de son « chef » l’agaçait un peu. Et ce jour-là, en écoutant les projets de départ des voyageurs, une vague inquiétude le saisit. Est-ce qu’ils allaient lui échapper ? Aurait-il donné un maître coup de kandjar, fait un voyage long et pénible pour n’arriver à aucun résultat ? À quoi s’occupait donc Canetègne-Sahib ? Les formalités d’extradition sont rapides dans l’Inde. On y sait la valeur du temps, et l’on tient à arrêter les criminels. Comment l’arrestation n’était-elle pas opérée ?
Il remonta pensif dans sa chambre.
Les jeunes filles, sur le conseil de Marcel, allèrent se promener.
– Le séjour chez un malade ne vous vaut rien, déclara le sous-officier, et je n’aurai pas besoin de vous. Je suis guéri.
Il avait insisté pour que Claude les accompagnât. Celui-ci s’y refusa. Et quand il fut resté seul avec son ami :
– Je voulais te parler, dit-il.
– À moi ?
– Oui.
– Quelque chose que tu ne voulais pas dire devant nos amies ?
– Par une bonne raison. Ce que j’ai à te confier concerne miss Diana.
– Ah !
Marcel eut un sourire.
– Peut-être bien que je suis déjà au courant.
– Non, car tu ne rirais pas.
– Ah çà, qu’as-tu donc ?
– Je suis malheureux !
Et se décidant brusquement, Claude reprit :
– Elle est jolie et elle est bonne ; j’aurais dû me défier, mais je ne savais pas. Moi et l’affection nous nous sommes rarement rencontrés. Elle me parlait avec une jolie petite voix douce. M. Claude par-ci, M. Bérard, par-là. Et puis elle vous a des grands yeux…
– Bref, tu ressens une vive amitié pour elle ?
– Je crois que oui.
Le « Marsouin », en faisant cet aveu, avait l’air si penaud que Dalvan ne put s’empêcher de rire, malgré ce que venait de dire son ami. Ce dernier fit claquer les doigts avec impatience.
– Tu ne comprends donc pas que c’est un désastre ?
– Un désastre ! Non, car il me semble bien que miss Pretty de son côté…
– Tu es fou !
En prononçant ces mots le visage de Claude s’illumina, mais il se rembrunit aussitôt.
– Et quand même cela serait…
– Rien de plus simple alors. Vous vous aimez, le mariage est indiqué.
– Le mariage ! Ne plaisante pas, je souffre.
Marcel devint grave.
– Explique-toi. Vous êtes toujours ensemble. Vous tenez des conciliabules. Quel est l’obstacle qui vous empêche d’unir vos destinées ?
– Tu le demandes ?
– Tu l’entends bien.
– Elle est millionnaire ! gémit Claude d’un air désolé.
Simplet lui prit la main.
– Tu es un brave garçon, commença-t-il.
– Ah ! tu vois bien, tu penses comme moi.
– Je pense surtout que tu devrais me laisser finir. Je trouve bien que tu aies songé à son argent, que tu te sois dit : Je suis pauvre, je n’ai pas le droit d’épouser cette fortune.
– Voilà ce qui me rend le plus triste des hommes.
– Seulement, tu ne l’aimes pas pour son or, tu l’aimes malgré lui. Je ne comprendrais pas que tu veuilles la prendre pour femme parce qu’elle est riche, mais rien ne s’oppose à ce que tu l’épouses quoiqu’elle le soit.
Claude secouait la tête, entêté dans son scrupule de désintéressement. Et Marcel, touché de sa résistance, éleva la voix :
– Sapristi ! tu deviens cruel. Parce qu’une fille est riche, tout honnête homme sans fortune doit s’éloigner d’elle, la livrant aux coureurs de dot, aux faquins sans cœur et sans esprit, incapables d’une vibration généreuse ; pour qui tout s’évalue ; pour qui la pureté, la bonté, la droiture ne sont que des accessoires sans importance. Ton cœur lui appartient, dis-tu, et tu veux l’abandonner aux immondes croqueurs d’or. Jolie façon de comprendre la vie !
Les yeux de Bérard lancèrent un éclair :
– Si l’un de ceux-là se présentait, je le tuerais.
– Eh bien, alors ?
– Seulement, raisonnons. Tu as parlé juste, mais tu supposes qu’elle répond à ma tendresse. Est-ce exact ? Est-ce possible ?
– Pourquoi pas ?
– Parce qu’elle est élégante, instruite. Moi je ne suis qu’un sous-officier, sachant tout ce que l’on peut apprendre seul, mais ignorant le reste.
– Tu travailles chaque jour à réduire la distance qui vous sépare.
– Que dis-tu ?
Une rougeur colorait les joues du « Marsouin ».
– Ce que j’ai vu, parbleu ! Pendant la traversée de Kerguelen à Mahé, depuis notre arrivée à Calcutta, tu te plonges dans des bouquins quand tu ne causes pas avec miss Pretty. Comment ne serait-elle pas émue devant cela ?
Mais Bérard secoua la tête.
– Ton amitié te dicte tes paroles. Le plus sage, va, serait de partir, de ne plus la voir. Et je n’en ai pas le courage. Ma vie est unie à la tienne. Je dois réussir ou succomber avec toi. Exilé de France par les circonstances, je ne saurais plus vivre seul, avec le souvenir de miss Diana. Je resterai donc, comptant que, notre voyage achevé, tu me laisseras vivre auprès de toi, dans la même ville, et que tu écouteras les radotages d’un camarade sottement épris d’une étoile née au pays d’azur.
Et arrêtant Simplet qui allait encore protester :
– Toi aussi, tu as une tristesse.
– Moi ?
– Yvonne.
À son tour, le frère de lait de Mlle Ribor parut embarrassé.
– Tais-toi.
– Tu te dévoues en désespérant. Je ne sais pas ce qui vous sépare, mais j’ai vu, comme tu le disais tout à l’heure. Eh bien, mettons notre souffrance en commun et appuyons-nous l’un sur l’autre.
Tous deux avaient les yeux humides. Et doucement, avec la mélancolie de la résignation, Dalvan murmura :
– Ton malheur est moindre que le mien. Tu seras heureux, toi, j’en suis assuré.
Quand les jeunes filles rentrèrent, les sous-officiers avaient retrouvé leur calme. Elles ne se doutèrent de rien.
Peu à peu, Dalvan reprit des forces et, le 4 juin, le médecin lui donna l’exeat. Le jeune homme pouvait descendre et se promener, promenade courte d’abord, mais que l’on prolongerait graduellement. Ce jour là, Nazir qui, depuis quelque temps, paraissait préoccupé, nerveux, annonça à ses « amis » qu’il se rendrait le lendemain à Madras.
– Appelé par une importante affaire, dit-il, je quitte Calcutta à la première heure. J’espère être de retour avant votre départ. En tout cas, je vous fais mes adieux.
Cette brusque détermination était motivée par le silence persistant de Canetègne. Lassé d’attendre, craignant pour ses avances, le Ramousi allait relancer l’Avignonnais. On échangea des souhaits, des poignées de main, et le 5, à 6 heures, un steamer descendait le cours de l’Hougly emportant le lieutenant de Canetègne-Sahib.
Le 11, Nazir touchait à Madras et courait à l’établissement « confortable et à prix modérés » où demeurait le négociant.
– Il est chez lui, répondit-on, chambre 27.
L’escalier gravi, l’Hindou trouva sans peine le numéro indiqué. La clef était sur la porte. Il frappa et ouvrit aussitôt. Un homme assis dans un fauteuil, enveloppé dans une robe de chambre, coiffé d’un bonnet de coton, la figure écarlate semée de croûtes brunes, se leva péniblement. Nazir crut s’être trompé. Mais le personnage s’écria :
– Nazir, quoi de nouveau ?
Tout d’abord le Ramousi garda le silence. Il considérait son interlocuteur. Ce n’était plus le Canetègne gras, triomphant, qu’il avait vu un mois auparavant. Maigre, courbé, les mains osseuses, le négociant se présentait comme l’ombre de lui-même.
– Que vous est-il donc arrivé ? fit-il enfin.
– La variole, mon ami, l’affreuse variole. Le jour même où je vous annonçais mon départ pour Pondichéry, j’avais une forte fièvre, mais je pensais me mettre en route tout de même. En me rendant au bateau, je me suis trouvé mal. On m’a rapporté ici, et depuis hier seulement je me lève. Le docteur m’ordonne de sortir, mais avec une figure comme j’en ai une, je n’ose pas.
– Alors, l’extradition de vos ennemis ?
– Eh ! rien de fait ! Quand on se débat contre la mort, est-ce que l’on a le temps de songer aux autres !
– Et maintenant toute démarche est inutile ; ils quittent l’Inde le 20 juin.
– Le 20 ! reprit l’Avignonnais se dressant brusquement, le 20 ! Ils m’échappent encore. Ah !
La haine lui rendait des forces. Il arpentait fiévreusement la chambre.
– Ils vont gagner la Cochinchine, l’Annam, le Tonkin, vastes territoires où la police est mal organisée. Où les attendre ? Où les prendre en défaut ? Avec cela, ils avancent toujours. Toutes les colonies épuisées, ils chercheront en Afrique dont je les ai détournés, et alors…
Et sa rage se doublant de terreur.
– Ils retrouveront ce damné Antonin. La chance est pour eux.
Cette maladie le prouve. Elle me cloue au lit, me défigure alors qu’ils étaient à ma discrétion. Ah ! suis-je donc perdu ?
– Non, répliqua le Ramousi d’une voix forte.
Le négociant s’arrêta. Il tourna les yeux vers son noir acolyte. Il le vit souriant, et soudain il eut le pressentiment de s’être livré, d’avoir trop parlé. Son abandon allait lui coûter cher.
– Pas perdu, reprit Nazir, si tu veux m’écouter, et surtout me donner les moyens d’exécuter l’idée qui m’est venue.
– Qu’appelles-tu les moyens ?
– Pour faire vite et bien, que faut-il ? de l’argent.
L’hésitation se peignit sur les traits du commissionnaire.
– Tu refuses, Sahib, je t’abandonne à ton sort. Je te prierai seulement de me rembourser les frais de mon séjour à Calcutta.

Et paisiblement, le Ramousi étala sur la table-guéridon, placée au milieu de la pièce, une liasse respectable de factures. L’Avignonnais étendit la main, puis la retira. Il avait réfléchi. En somme, il était à la merci de son complice. Peut être celui-ci avait une idée ingénieuse. Et puis une fois qu’il la connaîtrait, il trouverait bien à l’exécuter sans verser la somme réclamée. Il « roulerait » son associé. Pareille éventualité n’était pas pour l’effrayer, au contraire. Aussi son visage redevint aimable.
– Eh bé ! mon garçon, parle.
Mais l’Hindou secoua la tête.
– Pas comme cela.
– Comment ? qu’y a-t-il encore ?
– Tu veux que je parle ?
– Oui.
– Alors, paye d’abord.
Canetègne ne put dissimuler une grimace. Il était pris.
– Qu’exiges-tu ?
– Le remboursement de ces factures : mille roupies.
– Mille roupies ! clama le commissionnaire.
– Tu peux compter, le chiffre est exact, continua imperturbablement Nazir. Nous disons donc mille. Maintenant, je me charge d’enlever la jeune fille et de te l’amener à l’endroit que tu me désigneras.
– Pourquoi la jeune fille ?
– Parce que c’est l’otage important. À Calcutta, j’ai beaucoup fréquenté tes ennemis, et peu à peu j’ai surpris les secrets que tu n’avais pas jugé bon de me confier.
Canetègne se mordit les lèvres.
– Les gens de là-bas ont avec eux, reprit le Ramousi, miss Diana Gay Gold Pretty.
– La milliardaire américaine !
– Et c’est sur son yacht qu’ils voyagent.
Les mains du négociant se crispèrent sur son bonnet de coton.
– Une milliardaire ! Cela n’arrive qu’à moi.
Et, par réflexion :
– Mais alors tu me trahis ?
Le Ramousi eut un large rire.
– Non, car j’ai intérêt à être dans ton jeu. Je prépare sur elle une petite opération dont nous parlerons plus tard. Il faut procéder avec ordre. Acceptes-tu ma proposition ?
– Quel est ton prix ?
– Deux mille roupies, plus les mille que tu me dois.
L’importance de la gratification fit bondir Canetègne. Mais Nazir le ramena, il lui exposa son plan. En fin de compte, l’Avignonnais aligna sur la table la moitié de la somme en billets de banque, le reste serait payé à Saïgon où il donna rendez-vous à son lieutenant.
– Je profiterai du premier départ pour gagner Colombo et rejoindre ainsi les vapeurs pour Saïgon, conclut-il. Je t’y attendrai avec la petite Yvonne.
– Tu n’attendras pas longtemps.
Les coquins scellèrent leur contrat d’un dîner, et le 12 au soir, le Ramousi prit place au bord d’un navire de la British India Company à destination de Calcutta. Durant la traversée, il arpenta sans cesse le pont du steamer, parcourant ainsi des kilomètres. Il cherchait à calmer son impatience. Pourvu que les voyageurs ne fussent pas partis avant son arrivée ! Certes, ce n’était pas à cause de son marché avec Canetègne qu’il s’inquiétait ainsi. Il avait palpé une partie du prix du rapt à accomplir, et il était homme à la garder quoi qu’il arrivât. Mais il avait flairé l’affection naissante de Diana pour Claude, et il songeait à l’exploiter. Si, en même temps que Mlle Ribor, il enlevait le « Marsouin », l’Américaine n’hésiterait pas à payer une lourde rançon pour le revoir. C’était la fortune assurée. Telle était l’opération, à laquelle il avait fait allusion dans son entretien avec Canetègne.
Enfin tout a un terme, même les traversées. Le 18 juin, Nazir atteignit Calcutta, sauta sur le quai du Strand et courut au Sunderbund-Hôtel. Là, il respira. Le gibier qu’il pourchassait était encore au gîte. Toute la bande avait frété un petit vapeur et faisait une excursion à Chandernagor, mais elle serait de retour le lendemain.
Le Ramousi, pour tuer le temps, lut les journaux ; il apprit ainsi que dans l’Indo-Chine, sur les rives du Mékong, aux environs de Khône, des engagements avaient lieu entre des troupes françaises et siamoises. En effet, les hostilités commençaient à la frontière de notre empire asiatique. Les Siamois, encouragés par notre longue patience, tentaient d’occuper les territoires situés à l’est du grand fleuve. Nos bataillons annamites résistaient.
La poudre avait parlé. On annonçait que l’escadre française de l’Extrême-Orient se rassemblait à Saïgon. On disait une guerre imminente, plus grave qu’elle ne le paraissait à son début, car l’Angleterre ne permettrait pas que le royaume de Siam fût démembré. Et cætera, et cætera. Tous les racontars qui précèdent les luttes de peuple à peuple. Pour Nazir, très indifférent en matière politique, l’aventure parut l’enchanter. Il se frotta les mains.
– Voilà qui fait mon affaire. Je cherchais un moyen, il est trouvé. Battez-vous donc, bons imbéciles, afin d’assurer ma fortune.
D’excellente humeur, Nazir passa la journée d’attente dans des rêves dorés.
Marcel et ses compagnons, certes, ne pensaient pas à lui. Tandis qu’il effectuait le trajet, aller et retour, de Calcutta à Madras, Dalvan recouvrait la santé. Tout à fait solide désormais, sa blessure n’étant plus qu’un souvenir effacé, il avait proposé à ses amis de se rendre à Chandernagor, seul établissement français de l’Inde où ils n’eussent pas recherché la trace d’Antonin.
C’était une promenade de trente-deux kilomètres en bateau, sur l’un des plus beaux fleuves du monde, coulant à travers la campagne du Bengale.
Des précautions contre les menées possibles de Canetègne, on en prendrait. Certes le négociant, invisible depuis des semaines, devait machiner quelque chose dans l’ombre. On se garderait de lui. L’embarcation s’arrêterait le long de la rive gauche, rive anglaise, et les Américains passeraient sur la rive droite, où se trouve le territoire français.
Il finit par décider ses amis, et l’excursion fut résolue pour le 18. Une barque à vapeur de louage les emporta de bon matin vers le haut fleuve. Ainsi qu’il avait été convenu, le vapeur passa devant le bazar de Hatte-Khola et navigua jusqu’au bac existant au nord de la ville. William Sagger se fit passer, gagna la Résidence et revint au bout d’une heure et demie. Il n’avait eu garde de s’enquérir d’Antonin Ribor. C’était de M. Canetègne qu’il s’était informé, et par ricochet, il avait appris que le frère d’Yvonne était aussi inconnu à Chandernagor que dans les autres enclaves de l’Inde. Personne n’en fut surpris. On s’y attendait presque.
Ce qui parut plus étrange, c’est qu’aucun policier n’avait montré le bout de son nez. Mais ce pouvait être une ruse ; aussi, après avoir déjeuné sur le sol anglais, en face du district français de Damsamardorga, situé au sud du territoire, les voyageurs remontèrent le cours du fleuve à pied ; regardant de loin ce lambeau de terre, sauvé du naufrage de notre puissance dans l’Inde.
Marcel avait parlé bas à William Sagger. L’intendant avait souri et, entraînant Yvonne et Claude en avant, s’était lancé dans une discussion à perte de vue sur les races ethniques dont la grande presqu’île est peuplée. Il allait toujours, parlant d’abondance, tenant ses auditeurs sous le charme ; si bien que ni le « Marsouin », ni la jeune fille ne songeaient à Dalvan, resté en arrière avec miss Diana.
Et pourtant Bérard eût été vivement intéressé s’il avait entendu leur conversation. Ils s’entretenaient de lui. Adroitement, Simplet avait souligné l’air soucieux de son ami. L’Américaine l’avait remarqué. Elle s’en inquiétait. À ses questions, Claude avait toujours répondu évasivement. Marcel souriait en l’écoutant. Dans les paroles de la jeune fille, il démêlait une émotion profonde, une inquiétude constante ; il ne s’était pas trompé. Elle était entraînée par le même souffle affectueux qui emportait Bérard.
– C’est ici, dit brusquement Simplet en désignant le village de Hatte-Gouge, qu’est mort le poète Arramoëry, auteur de paraboles charmantes. Vous plaît-il que je vous en récite une ?
– Certainement, fit-elle un peu surprise de voir la conversation tourner court.
– Ce n’est point pour faire de l’érudition. Parmi les livres que me prêtait cet excellent M. Nazir, j’ai trouvé une traduction du poète. Donc, oyez le Silex et l’Opale.
Et son regard allant de Bérard à Diana, comme pour bien indiquer le but de la fable, il commença :
« Dans un champ, le soc d’une charrue mit au jour deux cailloux. L’un était un silex, simple pierre à feu. L’autre, une merveilleuse opale aux reflets chatoyants. Les pierres se virent. Silex se prit à la beauté de sa brillante voisine. Elle fut touchée de sa tendresse et découvrit les solides qualités enfermées en sa rude surface.

« Mais Silex, caillou vulgaire, épris d’une pierre précieuse, n’osa se déclarer.
« La pudique Opale ne sut point lui montrer ses sentiments.
« Et l’affection devint une souffrance, et leur torture s’accrut chaque jour. »
Miss Pretty avait baissé les yeux. Une teinte plus vive colorait son visage, et les mouvements de son corsage trahissaient les battements de son cœur. D’une voix douce, puisant dans sa volonté d’assurer le bonheur de son ami, les inflexions les plus caressantes, Marcel reprit :
– Désespéré, Silex appela un soldat qui passait : Prends-moi, lui dit-il, taille-moi en fer de lance, en hache meurtrière. Précipite-moi dans la mêlée, brise-moi sur les boucliers ennemis.
« Et le soldat l’emporta bien loin.
« Alors l’Opale se désespéra. Elle perdit ses couleurs et ses reflets changeants. Trop tard, elle comprit que c’est au riche à tendre la main au pauvre. »
Le jeune homme se tut. Un instant, l’Américaine marcha auprès de lui sans parler, comme absorbée par ses réflexions. Enfin, sans lever ses paupières, elle dit :
– Votre histoire finit mal !… j’en veux au poète Arramoëry.
– Pourquoi cela ?
– Votre Silex est trop défiant de lui-même.
– Il paraît que tous les Silex sont ainsi.
– Vous pensez donc, comme l’auteur, que l’Opale aurait dû…
– Lui tendre la main ?…
– Vous avez peut-être raison.
Et avec un sourire, un regard rapides :
– Quel malheur, que vous n’ayez pu la conseiller ! Car… une Opale avertie en vaut deux.
Elle hâta le pas pour rejoindre ses compagnons. Marcel la suivit, un rayonnement dans les yeux, murmurant pour lui seul :
– Allons donc ! Au moins Claude ne connaîtra pas les chagrins que j’endure.
À la nuit seulement, les voyageurs embarquèrent et descendirent l’Hougly, pour regagner Calcutta. Vers une heure du matin, l’embarcation les déposait vis-à-vis l’entrée du Sunderbund-Hôtel. Après une journée aussi fatigante, le sommeil est profond. Aussi les excursionnistes se levèrent tard. Ils s’étaient réunis au salon de lecture de l’Office et commentaient les journaux remplis d’appréciations sur les affaires de Siam, lorsque Nazir parut. Il eut un cri joyeux, vint à eux, les accabla de protestations. Puis montrant les feuilles quotidiennes :
– Je parie que vous parliez du Siam.
– Justement ! répliqua Dalvan, et je m’étonnais que ce pays osât chercher noise à la France. Comment les conseillers du roi ne lui montrent-ils pas qu’il court au-devant d’une défaite ?
– C’est incompréhensible en effet. J’ajoute que c’est ennuyeux.
– Ennuyeux ?
– Oh ! j’ai prononcé ce mot, parce que je songeais à mes affaires personnelles. L’égoïsme est humain, n’est-ce pas, et vous m’excuserez ?
– Oui, si vous vous expliquez davantage.
Le Ramousi se défendit. À quoi bon entretenir ses amis de son négoce ? C’était le vrai moyen d’exciter leur curiosité. À leur insistance il parut se rendre.
– En deux mots, voici. J’ai des intérêts considérables au Siam. Or, en temps de guerre, quand on n’est pas là pour se défendre, les consuls vous oublient, et les indemnités ne se répandent pas sur vous.
Claude approuva.
– C’est malheureusement vrai. Pendant que j’étais en garnison à Madagascar, j’ai vu des négociants complètement ruinés n’avoir aucune part à la distribution. Si vos opérations engagées en valent la peine, partez pour Bangkok.
Nazir leva les bras au ciel.
– Je le voudrais.
– Qui vous en empêche ?
– Je ne puis y aller à la nage.
– Il n’y a pas de navires en partance ?
– Non. Le bateau du service régulier Calcutta-Bangkok a pris la mer le 17. Je n’aurai donc pas de départ avant quinze jours.
– Diable !
– Et dans quinze jours, au train dont marchent les choses, le blocus de la côte siamoise sera probablement déclaré.
– Vous pensez qu’on en viendra là ?
– C’est du moins l’opinion des négociants de la ville. Hier j’ai cherché à prendre passage à bord d’un navire marchand. Partout on m’a déclaré que, jusqu’à nouvel ordre, aucune cargaison ne serait expédiée vers la capitale du Siam.
Diana s’approcha.
– Monsieur Nazir, fit-elle, vous vous êtes montré si bon et si aimable pendant la maladie de M. Dalvan…
– Ne parlons plus de cela, je vous en prie.
– Si, il faut rappeler ce qui a transformé en ami, un homme qui, il y a un mois, nous était inconnu. Cela vous décidera sans doute à accepter l’offre que je vais vous faire.
Une lueur traversa les yeux sombres du Ramousi : sa victime tombait dans le piège qu’il avait tendu.
– Mon yacht, continua miss Pretty, arrivera ici aujourd’hui ou demain, et aussitôt nous cinglerons vers l’Indo-Chine. Au nom de mes compagnons comme au mien, je vous propose de vous conduire où vous appellent vos intérêts. Cela nous détournera bien peu et nous permettra de reconnaître vos bons procédés.
Nazir étouffa une exclamation de triomphe prête à lui échapper. Il sut conserver son calme. Il refusa, se laissa convaincre, et en fin de compte, supplia les voyageurs d’accepter l’hospitalité dans la demeure qu’il possédait à Paknam, ville sainte sise près de l’embouchure du fleuve Meïnam, à trente kilomètres au sud de Bangkok, capitale du royaume de Siam.
– Vous me rendez un tel service, dit-il, que je serais heureux de vous recevoir dans ma maison.
– Ma foi, répliqua William, après avoir consulté du regard ses compagnons, Mlle Yvonne pourrait profiter de l’invitation avec MM. Bérard et Dalvan. Miss Pretty et moi nous nous rendrions à Saïgon et reviendrions les reprendre.
Rapidement les avantages de la combinaison se présentaient à l’esprit de tous.
Pas d’arrestation à craindre. Les Américains s’informeraient dans la capitale de la Cochinchine de l’introuvable Antonin Ribor. Les Français n’étant point à bord, ils n’auraient à prendre aucune précaution, D’où économie de temps et d’inquiétudes.
Le soir Nazir s’assit à la table de Diana. Sans souci des vieilles traditions d’hospitalité, qui veulent que l’on épargne ceux dont on a rompu le pain, partagé le sel, il se retira assez tard ; mais au lieu de rentrer dans sa chambre, il quitta l’hôtel et courut au bureau de télégraphe du port, lequel ne ferme jamais. Là, il expédia la dépêche suivante :
Calcutta, 19 juin 1873.
À Bob-Chalulong, mandarin militaire à Paknam-Ville, Siam. Frère arrive. A besoin ta maison être sienne ; illustres étrangers français accompagnent.
Nazir.
Il s’assurait la complicité d’un Ramousi de même caste que lui, entré au service du roi de Siam. Et tandis qu’il conspirait contre elles, les jeunes filles s’endormaient, songeant, qui à Marcel, qui à Claude, et se disaient :
– En Indo-Chine, il ne courra pas les mêmes dangers qu’à Madagascar ou dans l’Inde !
Le lendemain le Fortune, tout battant neuf, mouillait dans le port de Calcutta.
Il s’approvisionnait de combustible, de vivres, de munitions et, le 22, par un soleil radieux, son pavillon aux trente-six étoiles déployé, il descendait majestueusement vers la mer, emportant à son bord, avec ses passagers habituels, le Ramousi Nazir.
Le loup habitait la bergerie.

XXIII
LE MEÏNAM

Le Fortune, après avoir traversé le golfe du Bengale, passé entre l’île Andaman du nord et le rocher des Cocos, contourna la presqu’île de Malacca. Le 9 juillet au soir, il arrivait en vue de Paknam.
Des rives basses et nues que protège une barre, produite par le refoulement des eaux du fleuve Meïnam en contact avec celles de l’Océan. À gauche du courant, en avant de la ville de Paknam, d’où émergent les clochetons, les dômes de nombreuses pagodes, une redoute armée de canons Armstrong. À droite, une batterie semblable. Au milieu, partageant le fleuve en deux bras, l’île fortifiée de Chédi-Pak-Nam, dominée par la flèche conique de la pagode qui lui a donné son nom. Telle se présente l’embouchure du grand fleuve siamois, le Tchan-Phya-Meïnam, c’est-à-dire Prince-Chef-Mère des Eaux.
Or, le 6 juillet au soir, un canot dirigé par deux rameurs seulement et venant du nord, de la direction de Bangkok, avait accosté en face de la ville. Un homme de tournure européenne, assis à l’arrière, sauta sur la berge et s’enfonça dans les ruelles de l’agglomération. Les pagayeurs, après avoir amarré la barque, se couchèrent dans les herbes touffues du rivage, sans souci des moustiques dont le bourdonnement accompagnait le clapotis de l’eau.
L’Européen marchait d’un bon pas. Il devait être accoutumé à la silhouette bizarre des maisons siamoises, dont les toits en étages se retroussent aux angles vers le ciel, car il n’avait pas un regard pour elles. Il longeait les murailles curieusement incrustées de lakes, de porcelaine, de verre, effleurait les rameaux parfumés des plantes grimpant aux colonnes des vérandas, sans lever la tête. Évidemment il regardait en lui-même. Enfin, il s’arrêta devant une habitation plus spacieuse que les autres. C’était la demeure d’un fonctionnaire, car le pavillon central était surmonté d’une toiture à six corniches superposées, en souvenir des six purifications de Bouddha.
Auprès de la porte close, un disque de tôle était suspendu par deux chaînes ; fixé au mur par une chaîne également, une sorte de pilon de bois au manche allongé oscillait lentement. Le promeneur le prit et s’en servit pour heurter la plaque métallique, qui résonna gravement dans le silence. À l’appel du gong, la porte tourna sur ses gonds. Un soldat, à la tunique bleue, au casque surmonté de la pointe sivaïque, parut :
– Le mandarin Bob-Chalulong ? demanda le visiteur.
Et comme l’autre hésitait, l’Européen éleva ses mains à la hauteur de ses oreilles, l’index et le médium dressés.
– Ordre de Somdetch-Phra-Paramendr-Choufachulalon-Korn, roi de Siam.
À l’instant le soldat se prosterna, les coudes et les genoux touchant le sol, puis indiquant à l’envoyé du roi la salle de réception éclairée par une lanterne enveloppée de soie rose, il s’élança à travers les appartements. L’inconnu se laissa tomber sur un divan – meuble européen qui étonnait dans cet intérieur asiatique. – Un sourire dédaigneux crispa sa bouche :
– Ombre de soldat agenouillée devant une ombre de roi, murmura-t-il. C’est faire œuvre de civilisation que donner ce pays à l’Angleterre. La grande nation seule tirera parti de ses richesses ; elle métamorphosera les singes en hommes.
Il s’interrompit. Des pas légers glissaient sur le sol et, par la porte entre-bâillée, un filet de lumière éclatante se glissait, rendant obscur, par comparaison, le demi-jour qui régnait dans la pièce. Les battants s’ouvrirent et sur le seuil, escorté de trois soldats dont chacun portait un candélabre à trois branches, parut le mandarin Bob-Chalulong, couvert de sa tunique bleue à parements jaunes, le casque en tête, la poitrine constellée de décorations baroques.
– Salut à l’envoyé du roi, fit-il en se prosternant ; salut au messager du fils des étoiles, cousin du Soleil et frère de la Lune.
Les guerriers se livraient à des salamalecs sans fin. Déposant les candélabres à leur droite, ils s’allongèrent sur le sol, le nez contre les dalles peintes de couleurs variées. Puis les flambeaux passèrent à gauche, et les nez se remirent en contact avec la pierre. L’inconnu s’était retourné.
– Les imbéciles, ils vont me donner toute l’étiquette réservée aux courriers royaux. Ces drôles me reconnaîtront et alors…, adieu le secret de ma mission.
– Illustre messager, psalmodiait le mandarin, si j’avais pensé qu’en ma maison tes pieds respectés te porteraient pour m’honorer et mille et cinq cents fois, j’aurais endossé le manteau aux six bandes azurées, fixé sur ma poitrine l’image d’or de Hoalaman à la queue de dragon, aux jambes terminées par des mains. Mais j’ai craint de faire attendre ta Grandeur…
Le visiteur frappa du pied avec impatience :
– C’est bon ! c’est bon ! renvoie tes guerriers.
– Mais, courrier divin, tu n’y songes pas…, l’étiquette !…
– Obéis à ce qu’a décidé Celui qui n’a pas de maître.
– Ordre du roi. Je me prosterne dans l’obéissance.
Sur un signe, les soldats s’éloignèrent emportant les flambeaux. Alors l’Européen se leva et se plaçant sous la lanterne, de façon que son visage fût en pleine lumière :
– Me reconnais-tu ?
Le mandarin poussa un cri :
– Le seigneur Rolain, Le Sage venu d’Europe pour être l’ami et le conseil du roi des rois.
– Major Rex Siamensium, acheva le messager, citant les trois mots latins, importés on ne sait d’où, dont le maître du Siam fait suivre ses nom et prénoms. Assez de salutations, poursuivit-il, arrêtant son interlocuteur qui se préparait à redoubler de génuflexions ; dépouille tes habits de cérémonie, tu vas m’accompagner aux forts de Paknam.
– Aux forts de Paknam ?
– Oui. Ne t’y attendais-tu pas ? N’as-tu pas appris que les Francs, maîtres de l’Annam et du Tonkin, osent prendre les armes contre la Lumière de Siam ?
– On le disait, vénéré messager, mais je n’y croyais pas.
– Cela est cependant. À cette heure, deux canonnières de ces maudits, l’Inconstant et la Comète, pilotées par le Jean-Baptiste-Say, des Messageries fluviales de Cochinchine, se préparent à quitter Saïgon. Dans quelques jours elles seront ici, caressant le fol espoir de forcer le passage de Paknam et de venir à Bangkok même braver notre maître.
– Par Bouddha ! fit le mandarin Bob-Chalulong d’une voix tremblante, qui démontrait sa faible confiance dans la valeur de ses troupes. Ils agiront ainsi ?
– Non, car nous les en empêcherons.
– Vous pensez ? ô courrier !
– Oui, nous frapperons un coup de foudre. Le monde étonné apprendra en même temps l’insulte et le châtiment. Mais exécute mes ordres et surtout que nul ne soupçonne ma présence. Va.
Dix minutes s’étaient à peine écoulées que Bob-Chalulong, emprisonné dans un uniforme bleu foncé, portant sur la tête le bonnet plat des troupes anglaises, se glissait dehors avec le confident du roi. Ce dernier, le visage couvert d’un voile de gaze replié sur le front et sur la bouche, de telle sorte que personne n’aurait pu le reconnaître, marchait sans mot dire. Suivant la route parallèle au fleuve, les deux hommes sortirent de la ville et atteignirent bientôt la redoute qui commande la rive gauche.
Personne ne les arrêta. La garnison dormait et les factionnaires, jugeant inutile de veiller, s’étaient couchés à leur poste, cherchant dans le rêve une compensation aux exigences du service militaire.
– Dix coups de bâton à chacun de ces hommes, prononça durement Rolain.
– Ta volonté sera faite, seigneur.
– Bien. Veille désormais à ce que de pareilles licences ne se reproduisent plus. Que dirait le roi, que dirait l’Angleterre notre alliée, s’ils voyaient nos guerriers aussi indifférents à la veille d’une attaque des Francs ?
À grand’peine on découvrit l’officier chargé de la défense de la redoute. Le Mandarin lui parla sévèrement, le menaça des plus terribles peines s’il n’accomplissait pas son devoir. Il lui annonça la venue prochaine des ennemis, lui recommanda de veiller, de mettre l’artillerie en état.
Sur la rive droite, dans l’île de Chedi-Pak-Nam, les mêmes scènes se reproduisirent. Le confident du roi et le Mandarin revinrent vers la ville.
– Bob-Chalulong, dit le premier en prenant congé, chaque nuit, tu feras une ronde, et tu te montreras impitoyable pour quiconque enfreindra la discipline. Ta tête répond de ton zèle.
– Seigneur, je t’obéirai.
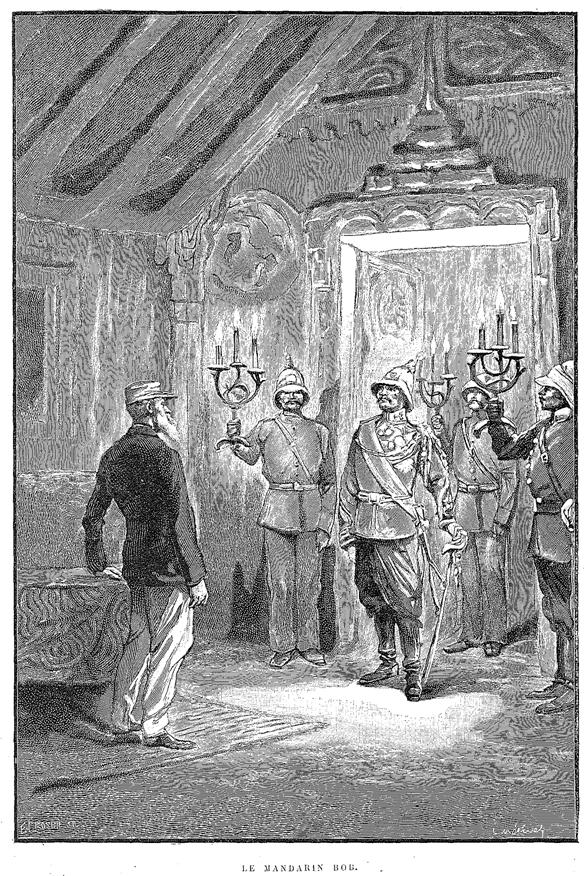
– Maintenant ouvre tes oreilles et souviens-toi. Dans la nuit du 11, dans cinq jours, tu m’entends ?
– Oui, maître.
– Les canonnières siamoises, au nombre de huit, descendront le fleuve et viendront s’embosser près des deux berges. Tu auras eu soin de couler des jonques afin de ne laisser qu’un étroit chenal navigable.
– Ce sera fait.
– D’ici là, des officiers danois et anglais, au service du roi, viendront te trouver. Ils établiront des circuits électriques destinés à communiquer le feu à des engins effrayants, les torpilles, qui seront confiées au fleuve sous ma direction.
– Dans la nuit du 11 ?
– Oui. Tu aideras ces officiers de tout ton pouvoir. Tu interdiras aux habitants de s’approcher durant leurs travaux.
– J’interdirai cela.
– Et pour la pose des torpilles, comme personne au monde ne doit pouvoir indiquer leur place à nos ennemis, tu avertiras les citoyens de Pak-nam que tout homme, rencontré hors de chez lui après huit heures du soir, sera livré aux tigres du roi.
Le Mandarin s’inclina avec terreur. Ramousi d’origine, comme son ami Nazir – on se souvient que celui-ci lui avait télégraphié de Calcutta – il avait pris du service dans l’armée siamoise, parce que sa situation lui permettait de réaliser de jolis bénéfices. Jamais il n’avait cru à la possibilité d’un conflit entre la paisible population et une nation européenne. Et tout à coup le seigneur Rolain, dont l’énergie connue en imposait aux plus braves, lui tombait sur les épaules, soufflant la guerre, ponctuant ses phrases de mots terrifiants : le bâton, la mort, le tigre, les torpilles.
Ses jambes tremblaient sous lui. Il se souvenait du télégramme laconique de son frère de caste. Nazir était en route avec des étrangers, des Français ; la dépêche l’affirmait. Il désirait que la maison de Bob devînt la sienne, que ses compagnons y fussent hébergés. Des Français chez lui ! Comment leur cacherait-il les préparatifs belliqueux ? Ils découvriraient le mystère, le dévoileraient peut-être, et alors, lui, Bob de son nom hindou, Chalulong de par sa patrie d’adoption, serait déclaré traître, livré au tigre. Non, de mandarin devenir beefteak ad usum tigrorum, la métamorphose n’était pas acceptable. Il valait mieux tout avouer au seigneur Rolain. Et timidement, Bob le retint par le pan de sa blouse de chasse en murmurant :
– Seigneur, lisez ceci.
Il présentait en même temps la dépêche de Nazir.
– Eh bien ? demanda le conseiller du roi après avoir parcouru les deux lignes.
– Votre suprême intelligence a compris…
– Que des Français se rendent ici avec un ami à toi.
– Un ami, seigneur, plus que cela, un Hindou de même caste et de même nation. Il veut ma maison, je dois la lui donner sous peine d’être exilé à jamais de ma patrie.
– Donne-la-lui.
– Quoi ? vous pensez ?… mais ils vont me gêner pour l’exécution de vos ordres.
– Renvoie tes soldats de garde aux retranchements. Fais que ta demeure n’ait rien de militaire. Au surplus, ton ami, un Ramousi comme toi, n’est-ce pas ?
– Oui, seigneur.
– Un voleur par conséquent. Il doit tramer quelque chose contre ces « illustres étrangers français. » Aide-le, ce sont des ennemis et même – Rolain songea un instant – qu’il les amène à Bangkok. Le palais s’ouvrira devant lui…
– Vous consentiriez ?
– Oui, adieu ; souviens-toi.
L’Européen sortit sur ces mots, mais quand il eut fait quelques pas dans la rue :
– Après tout, ces gens-là sont peut-être de précieux otages. Enfin on verra.
Et accélérant son allure, il se dirigea vers l’endroit où il avait laissé son embarcation. Les pagayeurs sautèrent sur leurs avirons, et glissant comme une hirondelle à la surface des eaux, le canot remonta vers Bangkok. Il était environ huit heures du matin lorsque l’esquif passa devant le cimetière protestant, derrière lequel on aperçoit le New-Road, rue de dix kilomètres, qui aboutit à la ville Royale, est éclairée au gaz et est desservie par un tramway tiré par des poneys. Puis les consulats suédois et américain, le débarcadère des bateaux de la Compagnie Bornéo, l’église protestante, les docks de Bangkok, l’hôpital, les consulats, danois, français, anglais, portugais, autrichien et allemand, tous sur la rive gauche, avec leurs jardins venant mourir au bord du fleuve, défilèrent sous les yeux de Rolain.
Il eut un regard pour le pavillon tricolore, passa indifférent devant le drapeau bleu à croix jaune de Suède, devant les étoiles de l’Union, la bannière rouge à la croix blanche du Danemark. Mais à hauteur du consulat d’Angleterre, il scruta des yeux la façade. À une fenêtre, un objet rouge, écharpe ou manteau, flottait, agité par le vent.
– Bon, murmura le conseiller du roi, il m’attend.
Et sans accorder un regard aux couleurs bleue et blanche du Portugal, jaune d’Autriche-Hongrie, noire, blanche et rouge de l’empire Allemand, il excita les rameurs.
Le débouché du canal du Régent s’ouvrait sur la rive droite, et soudain aux habitations clairsemées, entourées de jardins et de rizières, succédait le prodigieux fouillis de maisons aux toits pointus qui forme Bangkok. Les hautes tours de la pagode de Wat-Cheng, terminées par la flèche sivaïque à six branches, celles de la nécropole de Wat-Saket, les dômes, les aiguilles de la ville royale formaient un imposant panorama. Et bordant chaque berge, une ville flottante, des baraques édifiées sur des radeaux qui montent ou descendent le long de pieux, suivant le niveau du fleuve.
– Obliquez à droite, ordonna Rolain, de façon à raser les radeaux. Les pagayeurs obéirent. En passant devant les canaux, rues aquatiques ménagées entre les bateaux-maisons, la berge apparaissait couverte par les constructions du quartier de Tulat-Sampang avec son marché. Partout la foule grouillante. Sur la terre ferme, sur les jonques, sur les plate-formes flottantes, des gens affairés, discutant, pérorant, personnifiant l’offre et la demande, remplissaient l’air de leurs cris. En avant, un mur de briques, enceinte de la ville royale interdite au peuple, se dressait perpendiculaire au cours du Meïnam. Une tourelle plongeait sa base dans l’onde. À son sommet flottait le drapeau rouge de Siam, sur lequel se détachait en blanc la forme de l’éléphant sacré.
– Stop ! dit Rolain.
Les rames se levèrent, et le canot courant sur son aire s’arrêta le long d’un des planchers mobiles. Le conseiller du monarque siamois y prit pied et disparut dans la cabane qu’il supportait. Un homme s’y trouvait déjà. Son teint rose, ses favoris blonds, sa démarche raide eussent suffi à trahir sa nationalité, alors même qu’il n’eût pas jugé à propos d’entamer l’entretien dans le plus pur anglais :
– All’s ready ? fit-il.
– Oui, tout est prêt.
– L’entrée du fleuve est barrée ?
– Elle le sera le 11.
– Parfait ! Que les Français ne puissent remonter jusqu’à Bangkok et nous gagnons du temps ; nous décidons la Triple-Alliance à faire des représentations au gouvernement de la République. On lui allouera une indemnité pour les affaires du Mékong. Notre influence s’accroît ici en raison du service rendu. En agitant le spectre de la guerre avec la France, avant six mois écoulés, nous établissons le protectorat anglais sur ce pays. C’est le complément indispensable de notre empire Hindou.
– Je m’y emploie de mon mieux, vous le constaterez, milord.
– Je le reconnais volontiers.
– Et j’aurai bien gagné…
L’Anglais se mit à rire :
– Une récompense. Certainement, monsieur Rolain, nous n’oublierons pas que vous êtes Belge et par conséquent moins sensible que nous à l’accroissement de la puissance anglaise. À propos, c’est dans la nuit du 11/12, que vous posez les torpilles ?
– Oui, milord.
– Si vous le permettez, je vous accompagnerai. Quand on fait une affaire, il est bon d’opérer soi-même.
– Je serai enchanté de jouir de votre compagnie.
– C’est bien. Inutile de nous revoir d’ici là. Pour ne pas attirer l’attention, je vous rejoindrai hors de la ville, à l’extrémité sud de New-Road.
– Entendu, milord.
Les deux hommes se touchèrent la main. Rolain sortit, reprit place dans son bateau, qui aussitôt enlevé par les rameurs attentifs, reprit sa course dans la direction de la ville royale. Quant à l’Anglais, il souleva un rideau de toile grossière qui partageait la cahute en deux et démasqua deux hommes doués ainsi que lui du type saxon.
– Vous avez entendu, gentlemen ?
– Yes, parfaitement.
– Grâce à la résistance organisée par notre allié, le courant d’opinion que nous établissons en Europe au moyen de la presse anglaise a le temps de se manifester. Sous la pression des États confédérés, la France renoncera à la lutte et sera confinée dans l’Annam et le Tonkin, laissant tout le cours moyen du fleuve Mékong au Siam, c’est-à-dire à nous. Dès lors notre Railwav-Birman, de la frontière du Yun-Nam à la mer, avec raccordement sur le Meïnam et Bangkok, est la seule voie commerciale par où pourront s’écouler les produits de la Chine méridionale. La colonie de nos vieux adversaires est ruinée et nous empocherons de forts bénéfices. All right !
– All right ! répétèrent les autres.
– Nos actionnaires du Birman-and-Thaï-Railway penseront que trois millions sont peu de chose pour avoir mené à bonne fin une opération aussi importante. Venez gentlemen and laught at the little french.
Se moquer du petit Français paraît délectable à tout citoyen du Royaume-Uni. Le triumvirat composé, ainsi qu’on le devine, d’administrateurs du chemin de fer projeté à travers la Birmanie, poussa un laugh approbatif et regagna gaiement le rivage.
Cependant la barque de M. Rolain avait dépassé le mur d’enceinte de la ville royale, le poste télégraphique numéro 1 qui fait vis-à-vis à l’église catholique de Sainte-Croix, puis, abandonnant le lit du Meïnam, elle s’était glissée dans le canal de Talat dont la ligne semi-circulaire partage la ville de « Celui au-dessus duquel on ne marche pas » en deux arcs de cercle concentriques. Longeant les casernes elle aborda devant le large escalier de pierre situé auprès de l’École militaire. À peine Rolain avait-il sauté sur les degrés que l’esquif se remettait en marche. Les pagayeurs allaient le remiser dans le dock royal sur la rive droite du Meïnam. Rolain se pencha sur l’eau bleue, y trempa le bout des doigts, se frotta les yeux.
– Je suis las, fit-il à voix basse ; quand donc en aurai-je fini avec ces princes d’opérette ? Quand pourrai-je retourner dans mon cher Bruxelles et réaliser le rêve caressé depuis des années : vivre obscur entre une Flamande accorte aux yeux bleus et de gros poupons blonds ? Oh ! la pauvreté, la nécessité de faire fortune ! – Puis se gourmandant :
– Allons, allons, ami Rolain, vous devenez bucolique quand vous avez sommeil. Vous n’ignorez pas qu’au réveil vous vous souciez peu des Flamandes et des enfants. Il faut vous reposer. Mais avant, une corvée encore : enflammer le courage du valeureux roi de Siam… Obus et mitraille, voilà le mot d’ordre ! – Et avec une ironie amère :
– Tout cela pour arriver à la construction d’un chemin de fer ; c’est bien prosaïque.
Avec un haussement d’épaules, il monta les degrés et s’avança rapidement vers une muraille revêtue d’ornements multicolores en porcelaine, au faîte doré, marquant dans la ville interdite la limite plus interdite encore du palais proprement-dit.
XXIV
LE ROI
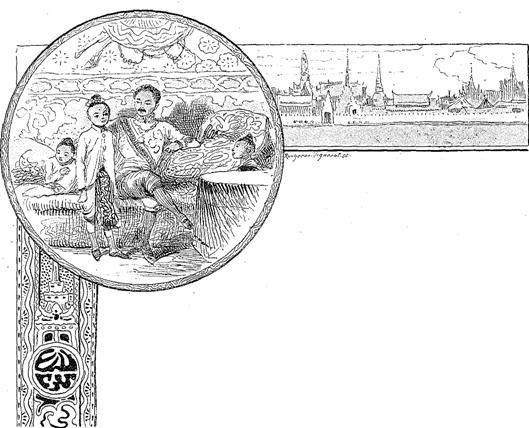
Un casino de ville d’eaux, telle est l’impression que donne l’édifice habité par le roi, avec ses pavillons central et d’angles coiffés de toits dorés en forme de mitre siamoise.
Deux larges escaliers accèdent au pavillon qui occupe le centre. Ils aboutissent à un vaste vestibule communiquant, à droite, avec les salons de réception des grands dignitaires de la couronne ; à gauche, avec la salle du corps diplomatique au bout de laquelle est le bureau du souverain.
Un cabinet haut et spacieux, meublé à l’européenne, avec table, chaises, divans, bibliothèque garnie de volumes surtout anglais, et au milieu de cela, des tapis hindous, des tentures de soie d’Annam. Sur la cheminée, entre deux candélabres de jade et bronze sortis de la maison Barbedienne, un Bouddha couché sur un bloc de cristal. Des panoplies où le javelot des Muongs alterne avec les fusils perfectionnés d’Europe, où le modeste sabre-baïonnette figure parmi les kriss, les kandjars damasquinés, enrichis de pierres précieuses. Le luxe oriental mêlé au confortable européen.
Un homme est assis sur un divan. Il a une trentaine d’années, est de taille moyenne et bien proportionné. Mais son visage rond, que la fine moustache tombante coupe d’une ligne noire, mais ses yeux profonds au regard très doux expriment la tristesse. C’est le roi. Habillé d’un veston en petit drap bleu-marine, d’un langouti de soie bleue descendant aux genoux, de bas noirs et de souliers vernis, il caresse distraitement trois jeunes enfants aux yeux noirs perçants, à la mine futée, portant des vêtements anglais, mais coiffés à la siamoise, c’est-à-dire les cheveux relevés au sommet de la tête en un toupet qu’enserre une couronne de fleurs de jasmin.
Ce sont les princes, ses fils aînés. Ils n’ont point encore séjourné dans les bonzeries pour y apprendre la sagesse des talapoins ; aussi n’a-t-on point tondu le toupet fleuri, emblème de la jeunesse et de l’irresponsabilité. Ils rient, babillent, font des niches. Le roi n’y prend pas garde.
Il se lève, va à la fenêtre, fouille des yeux la cour où se croisent des soldats, des serviteurs, des mandarins, fixe un regard sur la pagode de Val-Maha-That dont les cryptes renferment les cendres de ses aïeux, puis il laisse retomber le rideau.
– Rien, rien encore ! fait-il tout haut.
Les enfants ont entendu. Ils se rapprochent.
– Qu’attend ainsi mon père tout-puissant ? demande l’un.
– Ah ! riposte l’aîné, je m’en doute.
– Quelqu’un ou quelque chose ?
– Quelqu’un.
– Et qui ?
– Celui qui est toujours auprès de notre père vénéré, celui dont la voix le charme, dont la pensée pénètre en lui, dont la sagesse l’étonne.
– Rolain, répondent les deux autres en chœur.
– Rolain, vous l’avez dit.
Ces voix chères éclaircissent un moment le front rembruni du souverain. Un pâle sourire voltige sur ses lèvres.
– Tu as deviné, Chulachom Phra, c’est Rolain que j’attends.
Le fils aîné s’appuie calmement contre son père.
– Quand il viendra, vous ne me renverrez pas, seigneur ?
– Si, car nous avons à nous entretenir de choses sérieuses.
– Ah ! tant pis !
– Tu tenais donc bien à le voir, Chulachom ?
– Oui, père, et à l’entendre surtout. C’est un homme, celui-là, comme le divin philosophe Bouddha les aimait.
Le roi sourit de nouveau.
– Oh ! oh ! Chulachom, tu connais les goûts de Bouddha ?
– C’est le mandarin, ministre de l’armée, qui le disait l’autre jour, et je pense qu’il a raison. Ah ! quand il parle de guerre, des anciennes gloires du Siam, de celles qui lui sont tenues en réserve, j’ai envie de l’embrasser, Rolain.
Et tristement, le roi secoue la tête.
– Toi aussi, il t’a entraîné !
Il revient à la fenêtre, et tout à coup son visage s’illumine.
– Le voici !
Il ouvre et appelle :
– Rolain, mon ami, montez, montez vite.
Puis il referme sans remarquer l’ahurissement du maître des cérémonies pétrifié au milieu de la cour par cette infraction invraisemblable à l’étiquette : le roi se donnant la peine de héler quelqu’un lui-même.
Un gong a retenti. Un serviteur entre dans le cabinet et emmène les princes mécontents malgré une dernière caresse de leur père.
Le maître du Siam est seul. La porte tourne sur ses gonds. Rolain paraît. Sa figure n’est plus dure comme au moment où il donnait ses ordres au mandarin Bob-Chalulong, ni obséquieuse comme à la minute peu éloignée où il recevait ceux de l’administrateur du Birman-Railway. Elle respire la franchise, l’enthousiasme. – Ce masque se prend comme un autre. Le souverain court à lui, il lui saisit les mains – oubliant encore l’étiquette – et d’une voix anxieuse :
– Qu’as-tu appris, ami, parle ?
– Tout est vrai, mon maître vénéré.
– Tout ? Ainsi les Francs ?…
– Les Francs arment. Ils envoient en avant leurs canonnières l’Inconstant et la Comète.
– Alors c’est la guerre, la guerre inévitable ?
– Oui.
Un long silence succède à ces courtes répliques. Le roi a baissé les paupières. Un pli douloureux se creuse entre ses sourcils.
– La guerre ! répète-t-il.
Mais Rolain, qui a eu un imperceptible et insolent mouvement d’épaules, s’écrie :
– Oui, la guerre avec la victoire assurée, grâce au concours de l’Angleterre votre alliée, qui soulève l’Europe lasse de l’orgueil de ces Francs. La guerre qui vous couvrira de gloire, qui stimulera l’amour de vos sujets et vous vaudra devant l’histoire le surnom de Victorieux.
Le prince ne se prend pas à son exaltation.
– Ce n’est point là ce que j’avais espéré. Sur la foi des journaux, j’avais pensé les Français disposés à abandonner l’Annam, le Tonkin et je croyais pouvoir les réunir à ma couronne, nouer des relations commerciales avec l’Inde, la Chine, l’Europe, décupler la fortune de mon pays et mériter le seul titre de Bienfaiteur des Thaï.
– Le résultat sera le même, Sire, et un peu de lauriers ne gâte rien.
– Des lauriers ! As-tu songé de quel prix on les paye ? De beaux jeunes hommes que l’on envoie à la mort, des familles désespérées ; des mères, des fiancées criant vengeance auprès de Bouddha. Va, c’est parce que les malédictions de ces pauvres femmes les ont marqués au front que les conquérants se couronnent de lauriers. Ils veulent cacher la marque sanglante.
Comme inspiré, le roi parlait. Il s’animait à défendre les humbles, victimes émissaires du triomphe des conquérants.
– Et je vais déchaîner de tels malheurs sur la patrie des Thaï ! reprit-il. Du fond de mon palais, dans mes nuits sans sommeil, je serai poursuivi par les sanglots de la nation ; j’entendrai au loin les détonations de la poudre, dont chacune annoncera la mort de quelques créatures humaines. Et pourquoi tout cela ? Pour cette fumée chargée de l’odeur fade du sang que l’on appelle la gloire ! Ah ! Rolain, mon ami, que ne puis-je donner ma vie pour épargner celle de mes soldats !
Le roi était profondément attristé. Une émotion sincère faisait trembler sa voix, alors qu’il exprimait ses généreuses pensées. Bien qu’il fût monarque absolu, il n’avait point revêtu la cuirasse d’égoïsme qui enveloppe d’un triple airain le cœur des tyrans. Doux et bienveillant, il était resté le philosophe façonné par les talapoins. Bouddhiste, il ne se disait point que la divinité l’eût fait d’une essence supérieure ; homme, il aimait son peuple. Et certes, ainsi qu’il l’avait affirmé, il aurait volontiers fait le sacrifice de sa vie s’il avait pu ainsi éloigner du Siam les horreurs de la guerre.
Son interlocuteur se taisait. Avec l’indifférence de ceux qui sont assurés d’avoir le dernier mot, il laissa s’épancher la douleur du souverain, et quand il jugea le moment opportun :
– Roi, lui dit-il, vous avez la sagesse des dieux, votre âme est ouverte aux subtiles tendresses ; mais pourquoi pleurer sur ce qui est fatal ? À cette heure, les vaisseaux francs forcent de vapeur pour arriver sous votre capitale et la couvrir d’obus. Il faut agir.
– Agir, c’est-à-dire appeler la furie des combats, offrir des hécatombes aux génies de la mort. Ah ! pourquoi m’as-tu empêché de faire droit aux réclamations des Francs ?
– Le souci de Votre Grandeur, Sire, interrompit Rolain d’un ton pénétré. Je ne croyais pas qu’un jour mon dévouement me vaudrait un reproche du maître à qui j’appartiens tout entier.
– Pardonne-moi, ami, s’empressa de répondre le roi en pressant la main de son conseiller, je souffre et cela m’égare. C’est moi seul que je dois accuser. Qu’importe ma Grandeur, la seule vérité est la justice. Les revendications des Francs étaient justes, je devais céder. Jamais il n’est trop tard pour reconnaître son erreur. Le sang a coulé, mais il n’en coulera pas davantage. Pars, mon ami ; pars, mon autre moi-même. Va dire aux Français que mes soldats abandonneront les rives du Mékong, que j’indemniserai ceux qui ont été lésés. S’il le faut, ajoute que le roi de Siam regrette son erreur.
Il est impossible de peindre l’expression de la figure de Rolain. La stupéfaction, la rage s’y montraient tour à tour. Quoi, ses longues machinations, sa cauteleuse diplomatie aboutiraient à un échec. Le prestige de l’ennemi s’accroîtrait soudainement alors que le sien s’effacerait dans l’ombre ? Jamais il n’accepterait cela. Il fallait de l’audace, il en aurait. Et soudain, d’une voix nette, tranchante :
– Ô Roi, dit-il, cherchez quelque autre messager pour porter vos paroles à nos ennemis ! moi je ne m’en sens pas capable.
Le souverain fit un geste de surprise, mais son confident poursuivit.
– Le sang a coulé, vous l’avez reconnu. Des guerriers thaï dorment dans les plaines voisines de Khône. Votre peuple a les yeux fixés sur vous. Vous êtes son défenseur, puisque vous êtes son maître. Il attend que vous le vengiez. Il ne comprendra pas votre justice. Ce n’est point après avoir défié son adversaire que le soldat doit s’agenouiller devant lui. Il fallait céder plus tôt, répétera-t-on dans chaque demeure de votre empire. Le roi a tremblé devant le canon des Francs, ricaneront les gouvernements étrangers. Prenez garde qu’au lieu des surnoms de Victorieux et de Bienfaiteur que vous invoquiez, vos sujets eux-mêmes ne vous appellent « Le Lâche ! »
Les yeux du roi lancèrent un éclair. Un flux de sang empourpra ses joues.
– Rolain ! gronda-t-il avec menace.
L’Européen ne baissa pas les paupières. Son regard ardent se riva sur celui du prince :
– Je vous ai insulté, s’écria-t-il dans un geste théâtral, livrez-moi à vos bourreaux, à vos tortionnaires. Que mon corps soit déchiré en lambeaux, jeté à tous les vents. En mourant par vous, victime de mon dévouement, je dirai encore : Roi, ne cède pas aux Francs. Et si durant ma longue agonie, vous venez auprès de moi, si je lis dans vos yeux la résolution de vaincre, de porter haut le drapeau des Thaï, alors, Sire, soyez-en sûr, le mourant se soulèvera et, sanglant, défiguré, reste informe d’un serviteur fidèle, il retrouvera des forces pour lancer à l’écho le cri : Vive le Roi !
L’irritation du souverain était tombée. Il s’assit et se cacha le visage dans ses mains. Rolain eut un indéfinissable sourire, puis paisiblement :
– Je vais me remettre aux mains de vos gardes, Sire.
– De mes gardes ! répéta le roi venant à lui, non, non. Tu es mon seul ami et j’irais te livrer ! Je ne puis te savoir mauvais gré, tu as parlé selon ton cœur. Tu t’es laissé entraîner par ton affection, je le comprends bien… Je sens que tu as raison. Il est trop tard pour accepter les conditions de nos ennemis ; mais alors, conseille-moi, soutiens-moi, guide-moi. Je n’ai confiance qu’en toi, Rolain, n’abandonne pas ton prince.
Une expression de triomphe se montra, fugitive, sur les traits du confident.
– J’ai été trop loin, c’est vrai. La crainte d’entendre le monde mépriser mon souverain bien-aimé m’a emporté. Je préférerais la mort à votre déshonneur, Sire.
– Brave ami !
– La guerre est nécessaire aujourd’hui. Quel est votre devoir ? Vous efforcer de la rendre aussi courte que possible pour le Siam.
– Oh oui, mais comment ?
Le conseiller s’épanouit. Depuis le commencement de l’entretien, il attendait cette question.
– Lisez, mon roi, fit-il en tirant de sa poche un rouleau de papyrus.
– Quoi ! tu as préparé un plan ?
– Oui, mon seigneur vénéré. Tous les instants de ma vie vous appartiennent ; sachant votre exquise bonté, j’ai passé des nuits à chercher de quelle façon l’effusion de sang pouvait être diminuée.
Et le maître du Siam lut.
Le papyrus énumérait les dispositions dont Rolain – avant même de solliciter l’autorisation de son souverain – avait donné connaissance au mandarin militaire de Paknam, Bob-Chalulong. L’État de siège proclamé à Paknam. Le fleuve, sauf un étroit chenal, obstrué par des jonques coulées. La pose de torpilles. La mobilisation des huit canonnières du roi. Celui-ci lisait.
– Oui, dit-il enfin, mes soldats seront bien protégés, mais les autres, pauvres gens ?
– Les autres sont vos ennemis.
– Je le sais, ami. Seulement je ne puis m’empêcher de les plaindre. Songe donc à leur mort horrible. Ils sont sur leur navire, ils remontent le courant et, tout à coup, une sourde explosion résonne, une montagne d’eau se soulève, tout disparaît dans un tourbillon d’écume. La torpille a fait son œuvre.
– C’est la victoire pour les vôtres, Sire !
– C’est l’assassinat en grand !
– Non, mon prince, c’est la bataille. La morale d’une nation ne saurait être celle d’un individu. Ce qui est mal pour celui-ci, devient louable chez celle-là. L’unité et la pluralité ne sont point régies par les mêmes lois, attendu que l’unité doit être limitée en liberté sous peine de nuire à la pluralité, tandis que celle-ci est indépendante.
– Pas absolument.
– Non, mais relativement.
Comme tous les élèves des talapoins, comme les mandarins et les lettrés, le roi de Siam s’était bourré de philosophie bouddhiste, et Rolain savait bien qu’une fois sur le terrain des subtilités métaphysiques, il lui appartenait.
– Relativement, reprit-il, voir Causes et Effets, Livre VII, des Traditions de Bouddha.
Le prince sourit :
– Législation, verset 2063, acheva-t-il.
Et le confident récita le verset :
– « Au commencement, l’individu, vivant isolé, existait seul et sa liberté était complète…
« – Mais, continua le roi chez qui toute tristesse avait disparu, les individus se multiplièrent, la terre en parut plus petite et la liberté des uns lésa celle des autres. C’est alors que se constitua la tribu qui seule désormais avait la liberté absolue, chaque unité ayant été contrainte d’abandonner une part de la sienne, sous peine de se condamner à la solitude et à la faiblesse.
Ici Rolain ressaisit la parole :
– « Bientôt, la tribu elle-même fut insuffisante, et plusieurs se groupèrent formant des républiques, première aspiration de l’homme vers un gouvernement régulier.
« – Les Burr, les Thaï, les Mogols, Tatars, Hana, Pou-Haï, Muongs, Duongs, Laongs élirent des chefs, assistés d’un conseil, au suffrage universel, chaque unité du faisceau conservant le droit de contrôle dans les affaires de l’Association.
– « Or, le nombre des lettrés, des cerveaux éclairés est moindre que celui des ignorants et des faibles d’esprit. Les inconvénients du système se firent jour.
– « Les incapables étant majorité écartaient systématiquement du pouvoir ceux qui savaient, ceux que l’étude avait préparés aux fonctions publiques.
– « Et d’une organisation juste, en apparence, naquit le règne des inférieurs, de la concussion. La bêtise et le vice enfantèrent le crime, et le contrôle libre de ceux qui ne comprenaient pas, amena l’esclavage de ceux qui comprenaient.
– « C’est alors que Bouddah survint.
– « Un rayon de soleil autour du front.
– « La sagesse sur les lèvres.
– « Et la bonté dans le cœur.
– « Pour se faire comprendre des humbles égarés il se présenta d’abord comme un humble.
– « Il se manifesta dans une étable où l’on enfermait les buffles domestiques.
– « Puis il parcourut les cités, surprenant les hommes par la clarté de ses raisonnements, par la vérité de ses discours, les entraînant par son éloquence, les dominant de sa ferme volonté.
Une minute, Rolain garda le silence avant de continuer d’un ton prophétique :
– « Et il institua la forme définitive et parfaite du gouvernement. Considérant qu’une autorité toute-puissante est nécessaire pour réfréner les appétits des individus, que sans pouvoir on arrive à l’anarchie, il établit la royauté absolue.
– « Au-dessous du roi, maître et juge de ses sujets, enchaîna le prince absorbé par la fiction philosophique, tous étaient égaux.
– « Mais s’inspirant de la nature qui crée les uns intelligents et les autres dénués de sens, tenant compte que le savoir rend apte aux conceptions les plus nobles et les plus vastes, que l’ignare, par ce fait seul qu’il ne sait pas, est incapable d’embrasser l’ensemble d’une question, il décida que les dignités seraient réservées à ceux qui, par leur intellect, leurs connaissances, leurs titres scientifiques s’élèveraient au-dessus de la généralité.
– « Et ainsi le divin philosophe mit fin aux guerres civiles et au malheur des peuples. »
La figure épanouie, les yeux fixés dans le vague, le souverain des Thaï rêvait. Rolain changea brusquement de ton :
– Et comme le roi est maître et justicier, ses sujets attendent qu’il sauvegarde leur honneur et leurs intérêts.
À ces paroles, le prince tressaillit. Ses traits se figèrent en une expression grave et d’un accent décidé :
– Que dois-je faire, à ton avis ?
– Signer ce papier, Sire, et ordonner l’exécution du plan qui y est développé.
– À mon ministre de la guerre ?
– Non. Il ignore la tactique des flottes européennes. Il lui suffira de mobiliser vos troupes et de se procurer en Birmanie des armes et des munitions.
– Tu veux donc toi-même ?…
– Oui, Sire. Ce me sera une récompense de mon affection de n’être étranger à rien de ce qui touche la gloire de Votre Majesté.
– Soit, mon bon Rolain, tu passes général.
Et allant à son bureau, le roi écrivit au bas de la feuille :
« Ordre à tout mandarin, soldat, marin, homme du peuple ou négociant du pays de Thaï, d’obéir à Rolain, dont il m’a plu de faire le premier de mes sujets. »
Puis il signa et rendit le parchemin à son confident.
– Es-tu satisfait maintenant ?
– Oui, mon seigneur, car je vais travailler à ta gloire.
Peu après, le conseiller sortait du bureau, traversait la cour du palais et disparaissait dans un cottage en forme de chalet suisse situé à droite de l’édifice.
Il montait au premier, pénétrait dans une chambre à coucher où le lit était remplacé par une natte tendue entre deux supports et il se couchait. Presque de suite il s’endormit paisiblement. Le but de son ambition était atteint. À cette heure, Rolain, grâce à la signature arrachée au roi, était le véritable maître du Siam.
XXV
L’HOSPITALITÉ DE BOB
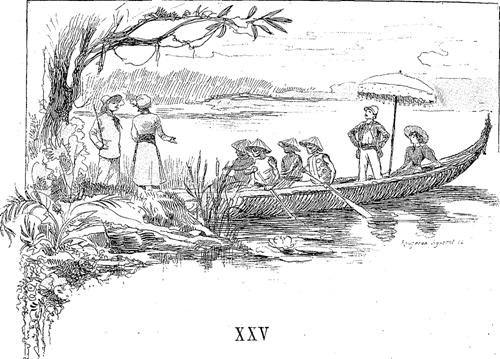
Le surlendemain le steamer Fortune fut signalé à Paknam. Le mandarin Bob-Chalulong avait eu le loisir de faire cesser les travaux entrepris par les officiers envoyés de Bangkok.
Marcel et ses amis ne remarquèrent donc rien d’anormal en se rendant à la demeure que Nazir annonçait populeusement comme sienne. Ils firent honneur à la collation que Bob – devenu le représentant à Siam du négociant Ramousi – leur avait fait préparer. De bonne heure ils se retirèrent. Diana avait l’intention de reprendre la mer dès le lendemain matin. Aux prières de Nazir, qui lui demandait de prolonger son séjour, elle avait répondu avec un regard que Claude ne vit pas.
– Laissez-moi partir, je reviendrai plus tôt.
Nazir n’avait point insisté. Et, sous couleur de parler affaires, il était demeuré seul avec son pseudo-représentant. Leur entretien dura plus d’une heure, ils alignèrent des chiffres sur une feuille de papier qui présenta bientôt l’aspect suivant :
2 yôt + 1 sen x 4 rameurs = 1 tical = 4 ticals + 1 salung / 2 (fuang) / 1 tamlung
Pirogue :
4 wah, 2 sawk, 1 kup, 3 nuis = 1 tamlung, 16 pie, 1 att / (2 tamlungs, 16 pie, 1 att)
Imprévu 1 tamlung.
(2 tara/13 + 1 hap + 5 changs) /2 = 1 tara/13 + 27 changs + 40 ticals – (1 tamlung + 2 ticals + 8 pie) / (1 tara/13 + 27 changs + 6 ticals + 1 salung)
Ce qui, en bon français, pouvait se traduire par :
31.212 mètres à parcourir avec 4 rameurs Coût :...................................... 13 fr. 40
Location d’une pirogue de 8m50................................................................... 14 fr. 65
Dépenses imprévues ...................................................................................... 13 fr. 00
............................................................................................................................ ----------
Total................................................................................................................... 41 fr. 05
Rançon à partager à deux ................................................................... 201.094 fr. 00
Soit pour chacun .................................................................................. 100.547 fr. 00
Et défalcation faite de la moitié des frais, soit :......................................... 20 fr. 53
................................................................................................................... ----------------
Reste ........................................................................................................ 100.526 fr. 47
Ainsi qu’une opération commerciale, les Ramousis établissaient en partie double – doit et avoir – l’enlèvement de Bérard et d’Yvonne.
Ces calculs, entrecoupés de verres de wisky, avaient sans doute fatigué les Hindous, car ils gagnèrent leurs chambres, oubliant sur la table leur papier crayonné.
Avec le jour, Marcel fut debout. Tout dormait encore. Il descendit sans bruit, pressé de jeter un coup d’œil sur la ville siamoise. Le grimoire des Ramousis attira son attention. Il le lut, n’y comprit rien, mais il le garda, car Dalvan n’aimait point les choses incompréhensibles. Et quand William Sagger descendit à son tour, il le pria de le lui traduire.
Le géographe n’était jamais à court. Sa prodigieuse mémoire ne pouvait faillir.
– Il s’agit sans doute d’un transport par eau, dit-il, un colis à destination de Bangkok, car 2 yot, 1 sen représentent exactement 31,212 mètres ou la distance de Paknam au marché chinois.
Puis regardant les derniers chiffres :
– Oh ! oh ! l’objet est précieux. Une petite pirogue suffit à le contenir et il rapporte le prix exorbitant de 201,094 francs. Quel diable de commerce fait donc le seigneur Nazir ? Je vois 41 francs de dépenses et plus de dix mille louis de bénéfices. Les frais d’achat ne doivent pas être compris dans cette note.
Simplet remit le papier à la place où il l’avait trouvé. Toutefois, sans en avoir l’air, il retint Sagger dans la pièce. Il remarqua que l’Hindou, survenant à son tour, s’empara du singulier compte avec une précipitation non dissimulée. Il ne salua même ses compagnons de voyage qu’après l’avoir plié et mis dans sa poche. Et le sous-officier répéta tout bas l’exclamation de l’intendant :
– Quel diable de commerce fait-il donc ?
Mais il n’eut pas le loisir de s’appesantir sur cette idée. Prête au départ, miss Diana se montra. Yvonne la suivait. Toutes deux étaient pâles. Leurs yeux brillaient de larmes mal séchées. Sans doute elles s’étaient déjà fait leurs adieux et la séparation leur semblait cruelle. Peut-être un pressentiment les avertissait-il que le malheur les menaçait. Cependant elles firent bonne contenance. L’Américaine distribua à la ronde de vigoureux shake-hand. Bob lui-même en eut sa part. Puis, escortée de ses amis blancs et noirs, elle se rendit à bord du yacht. Le steamer était sous pression. À peine fut-elle sur le pont que le commandement « go ahead » retentit. L’hélice battit l’eau bouillonnante, et le navire s’éloigna striant l’eau du fleuve d’un large sillage, dont les lames convergentes à l’arrière vinrent mourir sur la rive en un flot rageur.
Debout à la poupe, Diana et William adressèrent aux Français un signe d’adieu, puis avec l’éloignement leur silhouette devint moins distincte, elle se fondit en une teinte grise.
Au retour, Nazir s’excusa de ne pouvoir servir de cicerone à ses hôtes le jour même. Un négociant se doit à ses affaires.
– Mais, ajouta-t-il, j’organiserai pour demain une promenade dans la direction de Bangkok. Aujourd’hui, laissez-moi vous prier de ne pas vous éloigner de la maison. Le bas peuple est un peu surexcité contre les Français. Effet de la guerre imminente,… et il pourrait se produire des incidents regrettables.
Il débitait sa petite harangue du ton le plus naturel. Comment se défier d’un homme qui s’occupait à la fois du plaisir et de la sécurité de ses amis. Et quand il resta un peu en arrière, donnant le bras à Bob-Chalulong, il ne vint à l’esprit d’aucun qu’il complotait contre des hôtes aussi choyés. Pourtant le mandarin disait :
– Alors c’est pour demain ?
– Dame ! le 11 au soir, tu es occupé pour le service du roi.
– Comme je te l’ai raconté.
– Il est donc inutile qu’ils soient à Paknam.
– C’est juste. Mais tu enlèves aussi ce Marcel Dalvan ?
– À quoi bon ? Ce serait une bouche de plus à nourrir et il ne rapporterait guère. Je m’arrangerai pour qu’il ne soit de retour que le 12 dans la journée.
– Il m’ennuiera, réclamera ses camarades.
– Tu seras redevenu le mandarin militaire. S’il fait du bruit, arrête-le, emprisonne-le. Je te donne carte blanche. L’important est qu’il ne soit pas à ma charge.
Jusqu’au crépuscule Nazir et Bob furent dehors, laissant Yvonne et ses amis maîtres absolus de la maison. Seulement, aussitôt qu’ils faisaient un mouvement, un serviteur paraissait, sous couleur de prendre leurs ordres. Des soins aussi attentifs ressemblaient à une étroite surveillance. Le dîner réunit tout le monde à table. Nazir renouvela ses excuses. Il avait mis les bouchées doubles, assuré les services de son négoce. Désormais il appartenait à ses hôtes.
– Et pour commencer, leur dit-il, demain, nous ferons une grande promenade sur le Meïnam. Nous partirons de bonne heure, munis de provisions. Nous déjeunerons et ferons la sieste en route.
Mlle Ribor approuva. Il fut donc convenu que le départ aurait lieu à cinq heures. Certes, il eût été moins fatigant de naviguer de nuit, mais les Français avaient besoin de voir le pays, et ils préféraient braver la chaleur pour profiter de la lumière.
Les Ramousis, comme la veille, demeurèrent seuls. Alors ils se livrèrent à un singulier travail. Ils avaient rapporté quelques bouteilles de vin rouge et blanc, achetées à prix d’or. Ils les débouchèrent, mêlèrent le blanc et le rouge par moitié, remirent des bouchons neufs, les cachetèrent. Après quoi, ils rangèrent les flacons dans un panier. Et avec un ricanement qui aurait troublé la quiétude des voyageurs, s’ils l’avaient pu surprendre, ils s’en furent dormir.
La journée du 11 commença. Aux premières lueurs de l’aube, la maison de Bob-Chalulong fut en l’air. Des serviteurs étaient envoyés en avant chargés de victuailles. Nazir était partout, gourmandant les domestiques, pressant ses amis. L’excursion semblait lui causer un plaisir de pensionnaire. Marcel en fit la remarque.
– Ah ! répondit le faux négociant. Il y a si longtemps que cela ne m’est arrivé, la promenade avec des gens que j’aime ! Vous ne vous figurez pas combien le commerce est un maître cruel. Toujours il faut être sur la brèche. Les achats emploient les loisirs que laisse la vente. Et les variations de la mode qui nous obligent si souvent de renouveler notre stock de marchandises ! Depuis plus de dix ans, je n’ai pas eu ce que vous allez me donner aujourd’hui : un jour de vacances.
Tout était prêt. On partit. À cinq heures on atteignit la rive du fleuve encore plongée dans l’ouate du brouillard matinal. Une longue pirogue, au fond de laquelle étaient déjà déposés les vivres, flottait au milieu des végétations aquatiques, et quatre rameurs assis à leurs bancs attendaient dans une immobilité de statues le moment d’enlever l’embarcation. Ils saluèrent en portant alternativement les mains à leur chapeau de paille en forme d’abat-jour. Le mouvement fut exécuté avec un tel ensemble que Dalvan en fut frappé.
– On dirait des soldats, murmura-t-il.
Et le souvenir de la fiche trouvée sur la table, expliquée par William, lui revint.
Il avait sous les yeux une pirogue de huit à neuf mètres, montée par quatre pagayeurs. Mais on embarquait. Il sourit. La coïncidence n’avait rien de surprenant, et le fleuve Meïnam devait être sillonné par de nombreuses barques, ayant pour caractères de mesurer une huitaine de mètres et de posséder quatre hommes d’équipage.
Les passagers se répartirent : deux à l’arrière, Yvonne et Bérard ; deux à l’avant, Marcel et Nazir. Bob restait à Paknam.
– En route ! cria joyeusement le Ramousi.
Les avirons frappèrent l’eau ; la pirogue glissa, écartant de sa proue effilée les feuilles de nénuphars gigantesques.
La promenade commença. Ce fut un enchantement. Les plantes terrestres, les floraisons aquatiques se mariaient en un fouillis inextricable ; les arbres se penchaient sur l’eau, la végétation du fleuve escaladait la rive, et les voyageurs se demandaient :
– Où finit le lit du Meïnam ? où est le sol solide ?
Et puis des échappées sur la campagne. Des paillottes basses, toutes en toit, groupées autour d’une pagode aux flèches dorées, aux murs bariolés par des alternances de briques, de lakes, de faïences.
Désireux d’amuser ses hôtes, Nazir s’était muni de lignes. On les mit à la traîne. Et Yvonne ravie ramena des poissons baroques, aux formes grotesques que si longtemps on a cru en Europe n’exister que sur les Kakemonos du Japon ou de la Chine.
Au passage de la pirogue, de grands battements d’ailes, des piaillements d’oiseaux s’élevaient dans les verdures.
Parfois, comme une volée de mitraille, une bande emplumée s’éparpillait dans les airs. Faisans, tourterelles, pigeons, sarcelles, bécasses, cailles, bécassines, poules d’eau, canards succédaient aux espèces indigènes, aux dua-nang bariolés, aux coubras d’un vert métallique, au t’hapou peint d’un arc-en-ciel.
On faisait peu de chemin, d’abord pour faciliter la pêche de Mlle Ribor, ensuite pour permettre aux voyageurs d’admirer le pays. Vers neuf heures on accosta, ayant parcouru une douzaine de kilomètres, auprès d’une pagode, dont les six toits superposés étaient revêtus d’un enduit blanc éclatant. Un bois épais couvrait la rive. Une route parallèle au cours du fleuve s’enfonçait sous l’ombrage.
– Quelle est cette voie ? questionna Dalvan.
– La route de Bangkok à Paknam, répliqua Nazir. Tenez, nous allons nous installer ici. Nous serons à merveille.
Les piroguiers avaient amarré la barque, et à l’aide de larges couteaux, réductions du machete américain, déblayaient le terrain des fougères et des buissons enchevêtrés.
Déjà, la chaleur était étouffante. Marcel, plus sensible depuis sa blessure, se coucha. Il refusa de déjeuner avec ses amis. Le repos lui était avant tout nécessaire. Il avait dit vrai, car peu de minutes après il dormait. Inquiète, Yvonne l’observait, et ce ne fut qu’après s’être assurée que son sommeil était paisible qu’elle vint s’asseoir auprès de la natte couverte des provisions de Nazir.
À côté de la volaille froide, des fruits exquis, il y avait de la gelée sucrée d’algue marine, du gelidium spiriforme et du bouillon de nids de salanganes, hirondelles de l’Indo-Chine. Et les mets inconnus furent déclarés délicieux par les jeunes gens, ce qui parut causer au Ramousi une joie sincère. Il la traduisit en portant des santés avec le vin de France. Le rouge compatriote fut le bienvenu auprès de Bérard, et Yvonne elle-même fit raison à l’Hindou.
Comment aurait-elle pu refuser d’ailleurs ? Les toasts s’appliquaient à Diana absente, à Dalvan endormi. Mais bientôt ses yeux brillants se voilèrent. À son tour, elle sentait le sommeil la gagner.
Elle regarda Bérard. Les paupières du « Marsouin » clignotaient. Le mélange de vins rouge et blanc, opéré par Nazir, portait ses fruits. En effet, du contact de ces liquides naît une sorte de fermentation, dont le résultat est de terrasser à bref délai le buveur le plus intrépide. Or, pareille épithète ne s’appliquait ni à la jeune fille, ni à son compagnon.
– La sieste est absolument nécessaire dans ce pays, déclara Nazir. Moi-même j’en éprouve le besoin. Dormons, les rameurs veilleront pour nous.
Et, prêchant d’exemple, il s’étendit sur la terre. Les Européens l’imitèrent. Durant un quart d’heure régna le silence, puis l’Hindou souleva doucement la tête, s’assura que ses hôtes étaient endormis et s’assit. Sa face noire rayonnait de malice.
– Je les tiens, fit-il ; voilà une affaire menée rondement ! Et se levant tout à fait :
– L’autre s’est endormi tout seul. Nous le laisserons là. Les rameurs porteront les prisonniers dans la pirogue.
Déjà il ouvrait la bouche pour les appeler. Un bâillement se fit entendre. Il se retourna. Dressé sur son séant, Marcel s’étirait.
– Cela remet, un bon somme !… Oh ! cela va mieux ; maintenant, je meurs de faim.
Le Ramousi eut peine à réprimer un geste d’impatience. Si Dalvan se mettait à déjeuner, Claude et Yvonne auraient peut-être le temps de se réveiller et alors, adieu le succès de la combinaison. Il faudrait livrer bataille, et bien que les rameurs eussent été recrutés parmi les soldats de la garnison de Paknam, Nazir connaissait trop bien les guerriers siamois pour les croire capables d’attaquer deux Francs debout. La ruse était indiquée. Il prit un air affligé.
– Mes hommes ont emporté presque tous les reliefs dans la pirogue, afin que les insectes ne viennent pas troubler le repos de nos amis.
– Bah ! riposta Marcel montrant un demi-poulet étalé sur la natte, cela me suffira.
– Non, je ne souffrirai pas que l’un de mes hôtes déjeune mal. Ils vont de nouveau dresser la table, et pour tuer le temps, nous allons visiter la pagode blanche.
Son doigt indiquait le monument remarqué par Marcel lorsqu’il avait débarqué.
– Écoutez, reprit le jeune homme, je ne veux pas vous contrarier mais je prends le poulet tout de même. Il me fera prendre patience.
– Soit.
Nazir parla bas à l’un des pagayeurs, puis se dirigea vers la pagode.
– La destination de ce temple vous amusera.
– C’est possible, dit le sous-officier la bouche pleine et riant – moi, un rien me distrait. Vous voyez, un poulet et une pagode me suffisent.
– Vous savez, n’est-ce pas, que les Siamois professent un culte à l’usage de l’éléphant blanc ?
– Oui. Les pachydermes sont sacrés. On les encense. Ils sont servis par des prêtres.

– C’est cela. Mais les éléphants blancs sont rares. La plupart sont simplement couleur « café au lait », ou n’ont même qu’une tache claire sur le dos ou sur la tête.
– Quelle douleur pour les fidèles !
– Plus grande que vous ne pensez. Le fond de l’adoration siamoise n’est pas l’éléphant – encore qu’il soit la plus grosse manifestation de la création vivante – mais bien la couleur blanche. Aussi s’inclinent-ils devant tout animal de cette teinte.
– Alors la pagode contient ?…
– Un lapin blanc aux yeux rouges.
– Parfait, un lapin russe.
Nazir étendit les bras en signe qu’il ne comprenait pas. Le lapin russe, en effet, est inconnu dans l’Inde. Le climat ne se prête-t-il pas à son acclimatation, ou bien la grande possession britannique lui est-elle fermée par mesure politique ? Impossible de trancher cette importante question. Toujours est-il que le Ramousi n’avait jamais ouï parler du rongeur des plaines de la Volga. Il arrivait d’ailleurs à la porte du temple. Les battants de bronze étaient largement ouverts, et les barres de fer, destinées à les assujettir, étaient posées le long du mur.
Marcel entra avec son guide. L’intérieur formait un parallélogramme long de dix mètres, large de quatre. Au fond et séparé du mur par une étroite ruelle, un piédestal de marbre supportait une cage dorée, dans laquelle se promenait un gros lapin blanc bizarrement accoutré. L’extrémité de ses longues oreilles avait été percée, et des pendants d’or s’y balançaient. Ses pattes de devant s’embarrassaient dans les manches d’un veston de brocard, et ses reins étaient ceints d’une lame dorée à laquelle était fixée une chaînette, dont l’autre bout s’attachait à un barreau de la cage. Le joli lapin ! Et quel admirable sentiment de sa dignité ! À l’entrée des visiteurs il s’assit gravement sur son derrière, la tête droite, ses pendants brimballant à chaque mouvement de ses oreilles. On eût dit qu’il attendait les marques de respect auxquelles on l’avait accoutumé. Marcel, très égayé par cette attitude, passa le doigt à travers les barreaux et gratta amicalement le dos du dieu. Celui-ci d’ailleurs sembla flatté de cette caresse, car il se rapprocha afin de se livrer plus complaisamment à la main de l’étranger. Cela le changeait sans doute. Les indigènes, paralysés par la vénération, n’osaient prendre de pareilles privautés. Or, chez les lapins comme chez tous les êtres, les honneurs flattent l’amour-propre, mais laissent le cœur vide.

Du premier coup, Dalvan avait gagné la tendresse du divin rongeur. Donc il lui grattait le crâne quand l’obscurité se fit tout à coup. Qu’arrivait-il ? Le temple était percé de deux ouvertures seulement. La porte et une meurtrière ouverte derrière l’autel. La première s’était refermée, et le bruit d’une barre de fer glissant dans les crochets démontrait que le hasard n’était pour rien dans cet incident.
– On nous enferme, s’écria Simplet, Nazir !
Rien ne répondit à cet appel. La ligne lumineuse entrant par la meurtrière produisait une pénombre, mais le jeune homme eut beau regarder autour de lui, il n’aperçut pas son compagnon.
– Ah çà ! reprit Marcel, est-ce qu’il me ferait une plaisanterie ?
Il courut à la porte et la secoua. Les panneaux de bronze furent à peine ébranlés. La prison était bien close.
– Nazir ! appela-t-il encore.
Il lui sembla qu’un ricanement répondait au dehors, du côté du fleuve. Traverser la salle, grimper sur l’autel, au risque des malédictions du dieu Lapin, et couler un regard par l’ouverture fut l’affaire d’un moment.
Un grondement s’échappa des lèvres du sous-officier. Les rameurs couchaient au fond de la pirogue ses amis étroitement ficelés. Ils prenaient place à leurs bancs. Nazir s’asseyait à l’arrière.
Le guet-apens était flagrant.
– Misérable ! rugit le prisonnier.
Sa voix fut couverte par le bruissement des joncs ! Il vit l’Hindou faire un geste, l’embarcation s’éloigner de la rive et disparaître bientôt derrière les massifs verts du bois.
Bouillant de rage, Dalvan quitta son perchoir ; il courut à la porte, se cramponnant désespérément aux lourds vantaux. Efforts inutiles ! L’airain résonna sous les chocs et ce fut tout. Bientôt il comprit l’inanité de ses tentatives. Il ne serait délivré que par un prêtre ou un fidèle venant adorer sa divinité. Que faire en attendant ? Réfléchir. Deviner d’où partait le coup. Tâche ardue, car, d’une part, il ignorait les relations de Canetègne avec le Ramousi, et d’un autre côté, la façon évidente dont il avait été abandonné lui-même l’empêchait de supposer que le coffre-fort visé fût celui de miss Pretty.
– Voyons, fit-il après avoir cherché longtemps, raisonnons avec calme. Le papier, que ce brave M. Sagger m’a traduit, a évidemment trait à la petite opération dont nous sommes victimes. J’y retrouve la pirogue, les quatre rameurs. Parbleu ! la marchandise qui coûte quarante-huit francs de débours, et que l’on revend deux cent mille francs ; c’est cette pauvre petite Yvonne. – Il se passa la main sur le front. – Mais comment ?… Arrivée avant-hier… Ah ! c’est bien simple. Un mandarin désirait une femme blanche, il a chargé ce Nazir de lui en fournir une. Oui, ce doit être cela. Ne me souvient-il pas de l’histoire de la petite modiste Blanche Gruson, qui m’a si fort réjoui lorsque j’étais soldat. Partie à Mandalay pour y faire du chapeau parisien, elle fut remarquée par un lettré, enlevée par son ordre, et elle est aujourd’hui princesse, plus ou moins parente du soleil et des étoiles. Je suis sur la voie. Mais Claude, pourquoi l’avoir enlevé aussi ? Peut-être a-t-il surpris le but du voyage. Les ravisseurs l’ont emmené pour qu’il ne me renseigne point.
Puis par réflexion :
– Je le connais aussi, votre but, maîtres drôles. Toujours votre petit papier qui portait exactement la distance de Paknam à Bangkok, m’a dit Sagger. C’est donc à Bangkok qu’il me faut aller pour délivrer Claude, pour délivrer ma chère Yvonne.
Et avec une pointe de mélancolie :
– L’arracher au mandarin pour la conserver à l’autre, celui de France qu’elle veut épouser. Ah ! en voilà un qui ne saura jamais tout ce qu’il me doit !
Il demeura pensif, puis avec une résolution généreuse :
– Après tout, de ce que je suis malheureux, il n’en résulte pas qu’elle doive être malheureuse. Pas d’égoïsme, ami Simplet ! Quand on sauve les gens, c’est pour leur conserver la vie, et non pas pour la confisquer à son profit.
Son parti pris, il attendit plus tranquillement. Mais réfléchissant que peut-être sa présence dans le temple serait mal interprétée par les sectateurs du Lapin blanc, il se promit d’être prudent. Il importait, en effet, de n’être retardé en rien dans sa mission. Cependant peu à peu l’impatience lui vint. Le jour déclinait. La meurtrière ne laissait plus passer qu’une lumière affaiblie.
– Diable ! vais-je rester enfermé la nuit entière ?
La réponse fut prompte. Des pas résonnèrent au dehors, se rapprochèrent de l’entrée du temple. Des mains invisibles soulevèrent les barres, tandis qu’un bruit de voix parvenait au captif. Celui-ci se glissa derrière l’autel. Les vantaux tournèrent sur leurs gonds, et dans la nuit tombante, plusieurs personnes entrèrent. En tête marchait un talapoin, reconnaissable à sa tunique monacale. Derrière lui, c’étaient des paysans qui, le labeur terminé, apportaient la dîme au vénéré lapin.
De sa cachette, Dalvan assista à un curieux spectacle. Chacun approchait de la cage et glissait entre les barreaux une friandise végétale : tige de maïs, jeune pousse de riz, feuilles de cannelier. Puis il se retirait et dressait un petit monticule de poussière, dans lequel il enfouissait une pièce de monnaie et un papier. Quand tous eurent défilé, ils se retirèrent avec force génuflexions. Le talapoin fouilla les tas de sable, mit dans sa sacoche la monnaie, et à l’aide d’une allumette enflamma les papiers. Comme la fumée montait, il étendit les bras et d’une voix éclatante :
– Bouddha ! tu le vois, ces fidèles ont versé le tribut à tes serviteurs. Que par l’intercession du Lapin blanc, les requêtes contenues dans leurs placets soient bien accueillies de ta Grandeur !
Cette invocation lancée, le prêtre secoua sur le seuil la poussière de ses sandales et s’en fut tranquillement, laissant la porte grande ouverte.
– Libre enfin ! fit Marcel.
Il s’élançait au dehors, mais il se ravisa soudain :
– Je suis seul contre tout un peuple, reprit-il, je suis évidemment le plus faible. C’est donc bien simple, il faut être le plus adroit.
Et se rapprochant de l’autel :
– Petit lapin blanc, échappé à la gibelotte meurtrière, on s’incline devant toi… Sois mon égide.
En un instant il eut brisé la chaînette, introduit la main dans la cage et saisi le rongeur qui ne fit aucune résistance. Sans doute, lui aussi sortait volontiers de sa prison. Le seigneur Jeannot sur l’épaule, Dalvan gagna la route et se dirigea vers le bois, théâtre des exploits de Nazir. Aux dernières lueurs du jour, il reconnut l’endroit où ses amis avaient déjeuné. Un point blanc attira son attention. C’était un mouchoir, portant brodé à l’angle ce nom : Yvonne. Comment la jeune fille l’avait-elle perdu ? Simplet ne se le demanda pas. Il le pressa sur ses lèvres et le serra précieusement sur son cœur, ainsi qu’un avare cachant son trésor.
Sous la voûte feuillue la nuit s’épaississait rapidement. De loin en loin une percée se faisait sur le fleuve baigné d’une teinte bleutée par les rayons de la lune. Le lapin agitait les oreilles avec inquiétude, pour ne se rassurer que lorsque son conducteur s’enfonçait sous la voûte sombre. Le sous-officier songeait :
– J’ai à parcourir une vingtaine de kilomètres pour atteindre Bangkok ; soit quatre heures de marche. Je ferai un somme en plaine afin d’attendre le matin, et alors… comment procéderai-je ?
Il fut distrait par un bruit lointain. On eût dit des halètements sourds.
– C’est un vapeur, se déclara-il après avoir prêté l’oreille… Mais non, car les sons me semblent bien pressés… Parbleu ! ce n’est pas un, mais des vapeurs. Que se passe-t-il donc sur le Meïnam ?
Une trouée dans le mur de feuillage se présenta. Marcel se faufila dans les herbes, et la tête émergeant seule, il explora la surface du fleuve. Il ne vit rien. Cependant le bruit grossissait de minute en minute. Bientôt des ombres rapides parurent à la surface de l’eau, descendant le courant. Elles arrivèrent à hauteur du Français ; elles le dépassèrent.
– Mais ce sont des canonnières, murmura-t-il, et siamoises encore. Le pavillon rouge avec l’éléphant blanc flotte à l’arrière… Une, deux, trois, cinq, sept, huit… Huit canonnières. Où vont-elles ?
Et se souvenant :
– Nos navires ne doivent pas être loin de la côte. Elles vont s’opposer à leur passage… Bien, bien. Les amis de la flotte leur frotteront les côtes. Le retour sera moins brillant que le départ.
Insoucieusement il se remit en route. Un kilomètre plus loin il dut s’arrêter. Des pas nombreux résonnaient sur la terre.
– Qu’est-ce encore ? Il faut voir sans être vu.
Sur cette réflexion empruntée aux instructions de l’école de tirailleurs, le sous-officier se coucha derrière un bouquet de baliveaux, dont les troncs grêles surgissaient du sol en corbeille. Le lapin, posé à terre et retenu par le fragment de chaînette fixé à sa ceinture, parut apprécier cette halte et se mit à grignoter des herbes. C’est ainsi que Simplet et son nouvel ami Jeannot assistèrent au défilé de l’armée siamoise.
Une centaine de cavaliers ouvrirent la marche. Puis l’infanterie succéda s’avançant en bon ordre. Enfin l’artillerie portée à dos d’éléphants. Les lourds pachydermes allaient, le cornac sur le col, la pièce de canon sur le garrot, le pointeur sur la croupe, encadrés par des escouades de servants.
La longue file disparut dans la nuit et Dalvan allait se remettre en route, quand ses regards rencontrèrent à peu de distance un point rouge, brillant, comme incandescent.

– Ma parole ! on jurerait un cigare !
Un hennissement de cheval se fit entendre. Deux cavaliers se montrèrent. À dix pas de Simplet ils retinrent leurs montures.
– Arrêtons-nous ici, dit l’un en excellent français, mon cheval boite, j’ai peur qu’une pierre soit prise dans le sabot.
– Do as you like, répondit l’autre.
– Tiens, un English, constata Marcel, et il suit l’armée siamoise ? Eh ! eh !
Mais il ouvrit les oreilles en entendant celui qui avait parlé le premier s’écrier :
– En français, milord, en français. Votre langue est trop répandue dans le pays.
– Oh ici, pas de danger que l’on nous écoute.
– C’est égal. Abondance de précautions ne nuit jamais. Employons le français.
Dalvan eut un sourire silencieux.
– Cela me sera plus commode.
L’Anglais continuait :
– Je ferai ce que vous désirez, seigneur Rolain, mais vous êtes bien l’homme le plus prudent que j’aie jamais vu.
Simplet avait tressailli. Rolain, le nom du confident du roi ! Il l’avait lu dans les journaux. Du coup il devint très attentif. Les causeurs avaient mis pied à terre. Le conseiller soulevait avec précaution les pieds de son cheval.
– Comme c’est facile, gronda-t-il, il fait noir comme dans un four ! N’avez-vous point d’allumettes, milord ?
– Si.
Presque aussitôt une petite flamme brilla.
– Je vois. Sous le pied droit ce caillou… Ah ! il est encastré sous le fer, je dois employer mon couteau.
Et tout en grattant la corne du sabot :
– Quel joli métier ! Heureusement la récompense est proche de la peine.
Son interlocuteur se mit à rire.
– Au moins vous ne doutez pas du succès ?
– Et comment en douterais-je, milord ?
– En tout, il y a une portion de hasard.
– Pas dans notre affaire, milord. Les Français ne savent rien de nos projets.
– D’accord.
– Ils vont se présenter à l’embouchure du fleuve, croyant tout le cours navigable ; ceux qui échapperont aux obus des forts s’échoueront sur les jonques que l’on a coulées, car ils ne donneront pas juste dans le chenal ménagé à deux cents mètres à droite de l’îlot Chedi-Pak-Nam.
– C’est probable.
– Et si l’un des bâtiments avait la bonne fortune de s’y engager, les torpilles que nous poserons cette nuit même en auraient bientôt raison.
– Il me semble, en effet.
– Là. Voici mon cheval délivré. Un temps de galop pour rejoindre la colonne.
Les deux hommes remontèrent en selle et partirent en coup de vent. Marcel demeurait comme pétrifié. Ce qu’il venait d’entendre le bouleversait. Les canonnières françaises étaient perdues. En quelques mots, Rolain l’avait démontré.
Ces jonques, reposant au fond du lit du fleuve, semaient l’eau d’écueils invisibles. Pour augmenter encore le péril, des torpilles barraient le chenal libre. Sans nul doute, les bâtiments ayant à répondre au feu des redoutes, tomberaient sur ces récifs fixes ou mobiles dont rien ne leur décèlerait la présence. Couler ou sauter, pas d’autre alternative.
Mais lui, placé sur le chemin des ennemis par un bonheur inespéré ; lui qui avait appris leurs desseins, il devait avertir ses compatriotes. C’était son devoir de soldat. Il n’y faillirait pas. Il reviendrait vers Paknam. Il volerait une embarcation quelconque ; il irait au-devant des vaisseaux français. Et déjà il se levait. Mais une pensée le cloua sur place. Yvonne était prisonnière. Entraîné par une hallucination, il la vit tendant les bras vers lui !
Il lui sembla qu’au nord, vers Bangkok, dans une clarté, le doux visage de sa sœur de lait apparaissait, pâle, épouvanté, sillonné de larmes, et que de sa bouche entr’ouverte s’échappait l’appel :
– Simplet, à moi !
Il fit quelques pas vers la vision. Alors elle s’éteignit. La fantasmagorie de son imagination changea de forme. C’étaient des matelots qu’il voyait maintenant sur le pont d’un navire. Avec leurs vareuses sombres, le maillot bleu et blanc dégageant le cou hâlé, le béret en arrière, ils se penchaient sur des affûts, visant les embrasures ennemies. Et à la surface de l’eau, une torpille animée, vivante, nageait ainsi qu’un poisson de métal. Elle se rapprochait du bâtiment. Elle allait le toucher, le pulvériser dans une épouvantable détonation.
Puis tout disparut dans un brouillard. Alors, dans les bourdonnements produits par l’afflux du sang à son cerveau, Marcel crut distinguer une sonnerie de clairons. Le ralliement au drapeau vibrait en lui, le secouant de ses notes piquées. Il ferma les yeux, joignit les mains :
– Pardonne, petite sœur, la France d’abord.
Dix secondes s’écoulèrent. Dalvan ramassa Jeannot et reprit le chemin de Paknam, en murmurant avec un accent intraduisible, mélange d’héroïsme, de désespoir, d’affection, d’abnégation :
– Je reviendrai, c’est bien simple !
XXVI
EN AVANT !

La nuit s’avançait quand Marcel aperçut en face de lui la masse sombre de la ville. L’ennemi maintenant était proche. Il lui fallait redoubler de précautions afin de n’être pas découvert.
Heureusement la berge envahie par les hautes herbes offrait une retraite facile au sous-officier. Il se fraya passage à travers les pousses, et immobile, retenant son souffle, il explora la rivière d’un œil attentif. Le long de l’autre rive, cinq canonnières étaient embossées. En se penchant, il distingua un peu en aval de sa cachette, deux autres navires.
– Cinq et deux font sept, murmura-t-il. J’en ai compté huit tout à l’heure, où est l’autre ?
Et curieux, comme un homme persuadé que la vie de braves marins dépend de ce qu’il verra, le jeune homme se prit à ramper, gagnant du côté des canonnières. Il arriva à leur hauteur. Ancrées à quelques mètres du rivage, elles se balançaient sur l’eau, entourées de petites lames qui se brisaient contre leur coque.
– Bateaux coulés, torpilles, redoutes, et pour finir, si un bâtiment français passe, les canonnières, fit encore Simplet ; quelle embuscade !
Mais, il avait beau regarder, le huitième navire siamois restait invisible. Tout en monologuant, le sous-officier faisait du chemin. Il dépassa les vaisseaux, reconnut l’endroit où le matin il s’était embarqué avec Yvonne. Le cœur serré, il continua cependant. Le bas du fleuve était masqué par un promontoire. Le courageux Français employa une demi-heure à le contourner. Sa patience devait être récompensée.
En effet, à la surface du fleuve, deux rangs de lanternes s’alignaient. Entre elles des pirogues se croisaient en tous sens, rayonnant autour d’une chaloupe, où elles semblaient venir à l’ordre.
Dalvan comprit. Les lumières indiquaient la passe libre, les embarcations procédaient à la pose des torpilles. Le piège tendu aux Français se développait sous les yeux de l’observateur. Il regardait de tout son être, établissant des repères afin de retrouver le chenal, notant dans son esprit les points où les torpilles étaient mises à l’eau.
L’opération touchait à sa fin, car la chaloupe regagnait le bord. Deux hommes en descendirent et disparurent dans une paillotte dressée à quelques pas du rivage. Mais si vite qu’ils y fussent entrés, Simplet avait reconnu la silhouette des personnages rencontrés dans le bois. Ils allaient encore machiner quelque trahison, ourdir une nouvelle trame.
Dalvan pressentit que sa présence à leurs côtés serait utile. Et quoique las, il rampa de nouveau, se traînant sur le sol, les coudes douloureux, les jambes ankylosées, poussé par le désir de savoir.
La paillotte était abandonnée depuis longtemps déjà. Les bambous de la charpente avaient fléchi en maint endroit, les murs de terre s’étaient crevassés, la toiture penchait. Des lianes, des arbustes, des ronces, lui faisaient une ceinture de verdure, comme si la nature, pressée d’effacer les vestiges du passage des hommes, avait pris soin d’ensemencer le terrain environnant. Évitant de produire le moindre bruit, de froisser les feuillages, retenant les cris de douleur que les crocs acérés des ronces faisaient monter à ses lèvres, il se faufila dans le fourré. Maintenant il était contre le mur même de la paillotte. Les fentes ne manquaient point. Il regarda ! Par le toit déchiré, des rayons de lune filtraient, éclairant l’intérieur d’une lueur incertaine. Les deux hommes étaient occupés à détacher leurs montures, remisées là lors de leur arrivée.
– Ainsi, disait l’Anglais, vous êtes certain que la canonnière envoyée à la rencontre des bâtiments français ne les rejoindra pas.
– Absolument. Mes ordres sont précis. Elle a dû mettre le cap au sud-est. Les Français arrivant par le sud-ouest…
L’Anglais eut un rire sonore.
– Parfaitement. Les ordres câblés de France ne parviendront pas à leur adresse et…
– La partie est gagnée, acheva Rolain.
Marcel frémissait de rage. Des ordres du gouvernement français étaient confisqués. Quels étaient les ordres ? Les conspirateurs triaient leurs chevaux au dehors. Et soudain, le jeune homme sentit comme une odeur de musc, il perçut un piétinement dans les herbes.
Brusquement il se retourna. À deux pas de lui, la gueule béante d’un crocodile se montrait avec son râtelier de dents aiguës. Dalvan empoigna son revolver, mais une réflexion l’arrêta :
– Si je tire, on me découvre, et alors mes camarades de la flotte sont perdus.
L’animal fit un pas. Son souffle fétide arrivait jusqu’au sous-officier. Ses yeux verts luisaient. Il avait faim. Une seconde, un siècle d’angoisse s’écoula. Un petit cri plaintif se fit entendre. C’était le lapin blanc qui, terrifié, les oreilles rabattues, la croupe bombée, se pressait contre son compagnon de quelques heures.
Menaçant, le crocodile ouvrit la gueule. Mais prompt comme la pensée, Marcel enleva Jeannot et le jeta entre les formidables mâchoires du monstre. Celles-ci se refermèrent sur leur proie. Le saurien disparut dans le fourré, puis l’eau du fleuve résonna sous le choc d’un corps lourd.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? cria dans le silence la voix de l’Anglais.
– Rien, riposta l’organe de Rolain, un crocodile qui prend ses ébats.
Et les sabots de deux chevaux sonnèrent sur la terre. Dalvan s’était relevé, les tempes mouillées de sueur.
– Brrr ! murmura-t-il, la vilaine bête ! sans Jeannot…
Et déjà remis de son émotion :
– Je n’aimais pas le lapin, conclut-il, désormais j’adorerai même la gibelotte !
Tout bruit s’était éteint. Le piège tendu, les Siamois s’étaient dispersés. Simplet sortit avec précaution de sa cachette. Plus un homme en vue. L’eau du fleuve, moirée par la lune, coulait déserte. Au long de la rive, des pirogues étaient amarrées, mais les rameurs les avaient abandonnées. Ils dormaient sans doute en rêvant à la victoire assurée.
Bientôt Marcel sauta dans une des embarcations. Les pagaies étaient posées sur les bancs. Doucement il détacha l’esquif et s’abandonna au courant, se maintenant dans l’ombre de la berge. Une heure après, ayant passé inaperçu sous les canons des redoutes, il atteignait l’extrême-pointe de l’estuaire du Meïnam. Et là, harassé, il dissimula la pirogue dans les joncs géants, puis s’étendant au fond, il ferma les yeux et s’endormit.
Le jour vint. Et avec lui le réveil et la souffrance. La faim tordait les entrailles du sous-officier. Sortir de sa retraite, impossible. Il aurait été découvert, signalé, poursuivi, pris. Un soleil ardent ruisselait en cascade de feu. Mâchonnant des tiges de jonc pour leurrer son appétit, le jeune homme demeura tout le jour sous cette ardente averse.
La tête brûlante, les yeux troubles, il scrutait l’Océan. Vers quatre heures, il eut un cri de joie. Tout là-bas, au fond de l’horizon, des points noirs se montraient, couronnés d’un panache de fumée. Il en compta trois. Les points grandirent, devinrent distincts. C’étaient les navires français. Alors le sous-officier oublia tout, ses fatigues passées, le danger présent. Il saisit les rames, guida la pirogue hors du fourré aquatique, et se mit à nager vigoureusement vers la haute mer.
Des cris partirent des redoutes, des balles ricochèrent sur l’eau. Mais son allure n’en fut pas ralentie. Il allait, secoué maintenant par la houle, approchant de la barre qui formait un rempart liquide devant lui. D’un maître coup d’aviron, il enleva l’embarcation, franchit l’obstacle et fila droit sur le plus rapproché des steamers, au grand mât duquel flottait la flamme du commandement.
Déployer son mouchoir, l’agiter, fut la première pensée du sous-officier. Sa manœuvre attira l’attention des navires. Ils stoppèrent. Une chaloupe mise à l’eau se dirigea bientôt vers la pirogue. Vingt minutes plus tard, Marcel sautait sur le pont de la canonnière qui marchait en avant.
– Quel est ce bâtiment ? demanda-t-il.
– L’Inconstant, accompagné de la Comète et du Jean-Baptiste Say.
– Qui commande à bord ?
– C’est moi, fit un officier portant les insignes de capitaine de frégate.
Il dardait son regard clair et froid sur le jeune homme. Celui-ci ne baissa pas les yeux.
– Je suis le capitaine Bory, à qui vous vouliez parler, sans doute.
– Sans doute, capitaine, car depuis vingt-quatre heures, caché dans les roseaux du rivage, je guette votre arrivée… sans avoir rien à me mettre sous la dent du reste.
L’officier parut frappé de la réponse.
– De quoi s’agit-il ?
– Simplement de vous signaler une embuscade.
Et à grands traits le sous-officier raconta ce qu’il avait vu et entendu. Le marin écoutait sans faire un mouvement. Seules, les contractions de sa face brune et énergique dénotaient l’intérêt qu’il attachait à ce récit. Quand Dalvan eut fini, il lui serra la main.
– Merci, monsieur.
C’était la seconde fois qu’un représentant de la France adressait ces mots au voyageur.
– Votre nom ? reprit le capitaine Bory.
– Marcel.
– C’est un prénom cela ?
– Je n’en ai pas d’autre, au moins jusqu’à nouvel ordre.
L’officier s’inclina :
– Je n’insiste pas.
Il se retourna vers son second, qui attendait ses ordres à quelques pas.
– À la timonerie. Appelez à bord le lieutenant de vaisseau Dartige de Fournets et le capitaine Gicquel.

Puis s’adressant à Marcel :
– Les commandants de la Comète et du Jean-Baptiste Say qui m’accompagnent. Nous allons tenir conseil. Veuillez y assister. Vos renseignements seront précieux.
Il regarda le ciel qu’envahissaient de lourds nuages gris.
– Il va pleuvoir, murmura-t-il pensif. La nuit sera obscure. Qui sait !
Marcel s’éloigna et se promena sur le pont. Les matelots dévisageaient cet inconnu, qui apparaissait brusquement pour apporter des nouvelles assurément graves, puisque les signaux appelaient les commandants de la flottille sur l’Inconstant. Mais aucun ne lui adressa la parole. Chez ces hommes de devoir, accoutumés à l’obéissance passive, la curiosité n’est point indiscrète. Leur commandant savait de quoi il retournait, c’était suffisant. Il donnerait, le moment venu, les ordres nécessaires, eux les exécuteraient et tout serait dit. C’est cette insouciance du péril, cet abandon complet de leur existence à leurs officiers qui expliquent l’héroïsme déconcertant, l’audace inouïe de nos marins.
Cependant un quartier-maître vint avertir Simplet qu’on l’attendait dans la cabine du commandant.
Penchés sur une carte de l’embouchure du Meïnam, les trois officiers s’entretenaient vivement. À l’entrée du voyageur ils se turent, et le capitaine Bory lui demanda :
– Monsieur Marcel, voulez-vous répéter à ces messieurs ce que vous m’avez rapporté tout à l’heure ?
– Volontiers.
– Allez lentement. Nous suivrons sur la carte.
Alors, Simplet rappela les incidents de son retour vers Paknam. Il dit la rencontre des canonnières, de l’armée siamoise, la conversation de Rolain avec l’Anglais, puis sa course à travers la nuit, sa station au coude du fleuve, d’où il avait vu les bateaux placer les torpilles. Ici, les officiers l’arrêtèrent.
– Savez-vous lire une carte ?
– Parfaitement.
– Alors, tenez. Voici le cours du fleuve, la presqu’île dont vous parlez… Où étiez-vous le plus exactement possible ?
Dalvan se pencha sur le plan.
– C’est aisé, fit-il après un rapide examen. Voici la paillotte où le seigneur Rolain et son ami l’Anglais avaient abrité leurs chevaux. Elle se trouvait à une centaine de mètres à gauche de mon observatoire.
Et marquant de l’ongle un point sur la carte :
– J’étais ici.
Les marins échangèrent un regard de satisfaction.
– Bien ! s’écria le capitaine Bory ; placez-vous par la pensée à l’endroit que vous désignez et dites dans quelle direction étaient placés les feux qui, à votre avis, bordaient le chenal libre.
Marcel tressaillit. Il considéra ses interlocuteurs. À leurs yeux brillants, à je ne sais quoi d’éclatant dans leurs physionomies, il comprit que déjà, dans leur esprit, avait germé la volonté de franchir les obstacles accumulés devant eux. Ce qu’ils lui demandaient c’était la route à suivre. Un instant il se recueillit, hésitant presque à assumer la lourde responsabilité qui lui venait des circonstances. Une erreur pouvait entraîner la perte des navires, la mort des braves gens qui les montaient. Mais le souvenir lui revint net, précis. Il avait gravé dans son cerveau tous les détails de la scène nocturne.
Et lentement, il traça une ligne partageant le Meïnam en deux parties inégales.
– Ce doit être cela, firent les officiers.
Simplet les regarda.
– Oui, expliqua le capitaine Bory, le chemin habituel des bâtiments est plus rapproché de la rive gauche. Ils ont songé à tout, ces bons Siamois, même à déplacer le chenal. Une seule chose leur a échappé : c’est qu’un homme de cœur pouvait se cacher dans la nuit pour surprendre leur guet-apens.
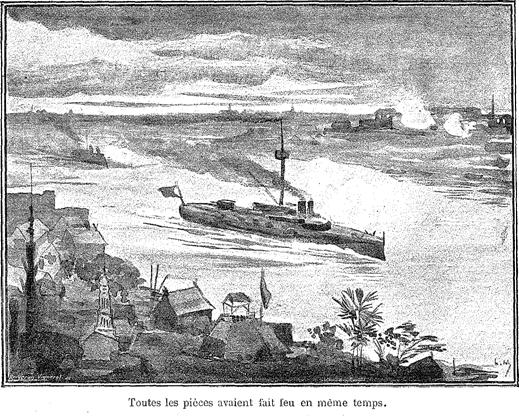
Et sans laisser au jeune homme le temps de répliquer.
– Avant de regagner votre pirogue, continua-t-il, ne désirez-vous rien de nous ?
Dalvan sursauta :
– Regagner ma pirogue !
– Oui, nous sommes décidés à tenter l’aventure. Le pavillon français ne peut pas être tenu en échec par des Siamois. Mais il n’est pas nécessaire de vous entraîner dans le danger, puisque après tout vous n’appartenez pas à nos équipages.
Le sous-officier fit la grimace, puis :
– Vous m’avez prié de vous dire si je ne désirais rien de vous ?
– En effet.
– Eh bien, je désire deux choses.
– Voyons ?
– La première, rester à bord de l’Inconstant.
Et comme les marins esquissaient un geste.
– Oh ! je sais bien, dans la marine vous avez le mépris des terriens. Bien sûr, nous n’allons pas sur l’eau aussi bien que les matelots, mais pour aller au feu…
Les officiers se mirent à rire.
– Soit, vous restez à bord. Et votre seconde demande ?
– Ma seconde ? Ah oui ! faites-moi donner à manger, je tombe d’inanition.
Un peu après, tandis que le lieutenant Dartige de Fournets et le capitaine Gicquel retournaient à leurs bâtiments respectifs, Dalvan dévorait un biscuit sur lequel s’amoncelait une tranche de bœuf conservé. Il mangeait sur le pouce, sans façon, ayant obstinément refusé de quitter le pont. Il voulait voir. Voir autant que possible, car la nuit venait. De plus, une pluie fine commençait à tomber, crépitant sur les lames.
Soudain une colonne de fumée s’échappa des tuyaux de la machine, l’hélice battit les flots, et l’Inconstant piqua droit vers l’estuaire du Meïnam, suivant le Jean-Baptiste Say qui était passé en tête. La Comète venait la dernière.
Au même instant, le bateau-phare, situé en avant de l’îlot de Chedi-Pak-Nam, s’allumait, et les rayons de son feu blanc éclairaient la marche des croiseurs français. La côte se noyait d’ombre. Et c’était émouvant de songer que, dans l’obscurité, des canons chargés étaient prêts à vomir des obus sur ces navires, qui filaient sans souci des dangers échelonnés sur leur route. On atteignit la barre.
– Ils ne veulent pas tirer, se dit Marcel, ils pensent que leurs torpilles suffiront.
Il achevait à peine que des éclairs sillonnèrent la rive gauche, bientôt suivis de détonations assourdies. Aussitôt les batteries de la rive droite tonnèrent. À son tour l’îlot Chedi s’embrasa. Et le Jean-Baptiste Say, atteint dans ses œuvres vives, alla s’échouer à la côte.
L’Inconstant et la Comète ne s’arrêtèrent point pour lui porter secours. Les minutes étaient comptées. On ne pouvait espérer réussir qu’en surprenant l’ennemi par la rapidité des évolutions. La voix du capitaine Bory s’éleva :
– Forcez les feux !
Les cheminées lancèrent des tourbillons de fumée noire, la membrure du navire vibra sous la rotation accélérée de l’arbre de couche, l’hélice se tordit sous les eaux et le croiseur embouqua la passe. Les batteries faisaient rage. Comme un tonnerre continu les canons grondaient. Un ouragan de fer s’abattait autour de l’Inconstant. Il fallait se hâter plus encore.
– Maître mécanicien, cria encore le capitaine, forcez la vapeur !
– Impossible, capitaine, maximum de pression.
– Chargez les soupapes !
Après cet ordre, un silence ; puis sous les coups sourds des pistons, les plaques de couche sautaient avec des tintements métalliques, et tous ces bruits, unis au sifflement de la vapeur, couvraient le fracas de l’artillerie.
Un ronflement, un choc, un éclatement. Dans une gerbe de feu, la canonnière parut un instant, puis tout rentra dans l’ombre. Un obus venait de tomber à quelques pas de Marcel, tuant trois hommes. Et le vaisseau eut comme un sursaut. Toutes les pièces avaient fait feu en même temps. C’était la première riposte des Français. On atteignait l’extrémité de la passe. On allait retrouver la rivière libre d’embûches. La zone la plus dangereuse était franchie.
Mais un remous épouvantable se produisit. Une vague énorme, géante, monta à dix mètres de haut, secouant les eaux ainsi qu’une commotion volcanique. Une torpille avait sauté à l’arrière de l’Inconstant. Sous l’effort de la lame, le steamer pivota sur lui-même, se plaçant en travers du courant.
– La barre à tribord… toute ! rugit le capitaine Bory.
Et soudain, comme un cheval ramené par un habile cavalier, l’Inconstant se relève et reprend sa course folle. Il va, couronné de vapeurs noires que les étincelles sèment de rubis, il va crachant les obus. Dans l’ombre une silhouette se dessine. C’est une canonnière siamoise qui s’est mise en travers du fleuve pour arrêter l’élan des navires français. L’Inconstant ne se détourne pas. Un choc épouvantable a lieu, et le vaillant vapeur continue sa charge héroïque, après avoir coupé de son éperon l’avant du vaisseau ennemi qui s’engloutit lentement.
Intimidée, la flotte siamoise n’ose poursuivre les braves bateaux qui ont accompli un des plus beaux faits d’armes de la marine française.
Hors de portée des forts, les canonnières ralentissent leur allure échevelée. Ils n’ont plus rien à redouter. Il y a bien encore une redoute à Paklet, à quelques kilomètres plus haut, mais on ne l’a pas mise en état. À quoi bon ? Les prévisions les plus pessimistes n’admettaient pas que les Francs arriveraient jusque-là. Et l’Inconstant, ayant dans son sillage la Comète qui n’a été atteinte par aucun projectile, mouille à Bangkok, en face du Consulat français. Deux cent quinze marins de Gaule tiennent sous une menace de bombardement une ville de trois cent mille habitants.
Et tandis que ces braves se réjouissent, Marcel, accoudé au bastingage, considère la cité des Thaï ; il regarde la foule qui grouille sur les plates-formes des maisons flottantes, ahurie de la venue des Francs. Doucement, il se dit :
– C’est ici que ma chère petite Yvonne est prisonnière. Il s’agit de la retrouver maintenant que j’ai sauvé les autres !
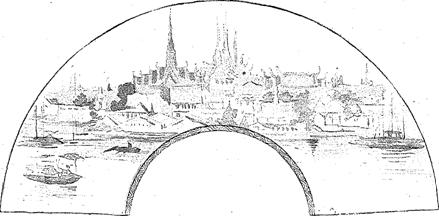
XXVII
À BANGKOK, À SAÏGON
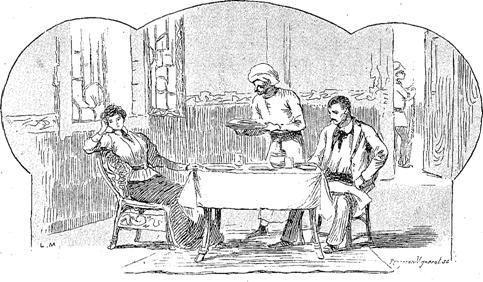
Dès le lendemain, Marcel se fit conduire à terre, et dans le dédale des ruelles, parmi la foule grouillante et bavarde, il chercha les traces de Claude, d’Yvonne.
Ils devaient être à Bangkok. Le raisonnement le lui avait démontré ; son instinct le confirmait dans cette pensée.
Il avait le sentiment que Mlle Ribor était près de lui. Sa tendresse lui donnait une sorte de double vue, et dans les ondes du vent qui frôlaient son visage il croyait reconnaître parfois l’haleine de sa compagne de lutte. Mais ses démarches demeurèrent d’abord vaines. Durant plusieurs jours, il fureta sans succès dans tous les quartiers de la ville, repassant vingt fois par les mêmes voies, interrogeant les passants ébahis, les agents des consulats. Toujours il revenait au fleuve, et dans son esprit s’implantait la conviction que sur ses rives sa « sœur » était prisonnière.
Pourtant rien ne venait corroborer cette obsédante idée. Cependant il ne désespérait pas. Chaque matin il quittait le vapeur pour y revenir chaque soir, brisé de fatigue, anéanti par la chaleur, mais décidé à reprendre ses investigations.
Enfin, un soir, un peu avant le crépuscule, Dalvan, arrêté sur le quai, considérait d’un œil distrait les maisons flottantes, qu’à l’approche de la nuit leurs habitants rapprochaient de la rive, à grand renfort de perches et de glapissements. Soudain il tressaillit. À son oreille venait de résonner une voix connue. Il tourna les yeux dans la direction du son et demeura immobile, stupéfié par la façon dont lui arrivait le renseignement si ardemment cherché.
À deux pas de lui, l’Anglais entrevu sur les bords du Meïnam, dans la nuit terrible où se préparait le massacre des marins français, causait avec un autre Européen. Le gentleman ne le voyait pas, masqué qu’il était en partie par l’angle d’une baraque en planches, et tranquillement il disait :
– Entre nous, je ne crois pas que ces deux prisonniers soient des otages sérieux.
– Deux prisonniers ! répéta tout bas Simplet, c’est d’eux qu’il s’agit !
L’Anglais continuait :
– Mais cet Hindou, un rusé coquin, a persuadé le roi. Il ne faut pas le contrecarrer. En faisant son jeu, il fait le nôtre. Et puisque le chef vénéré des Siamois écoute plus volontiers vos conseils de résistance aux Français, depuis qu’en son palais il garde cette fillette insignifiante et ce garçon de peu, aidons franchement le Nazir. Gagner du temps est tout pour nous à cette heure. Plus la solution des difficultés pendantes tardera, moins les Français bénéficieront de leur audacieux coup de main. Bons soldats, les Français, mais pauvres diplomates !
Les causeurs se remirent en marche et s’éloignèrent lentement, tandis que Simplet, tout pâle, restait à la même place, étourdi, ivre de joie, frémissant sous les coups de son cœur affolé, qui bondissait éperdument dans sa poitrine. Yvonne était au palais du roi ! Qu’allait-il faire ? Pendant qu’il s’interrogeait, la nuit tombait rapidement, noyant toutes choses d’une teinte indécise. Du fleuve, une buée légère montait, et dans l’indigo profond du ciel, les étoiles s’allumaient, troupeau de soleils errant à travers l’infini.
– C’est l’heure de rentrer à bord, murmura enfin le jeune homme. – Mais secouant la tête : – Rentrer, reprit-il, quand l’ombre propice m’entoure, quand, peut-être avec un peu d’adresse, je pourrais, sans crainte de surprise, découvrir la prison de mes amis !
Et après un silence :
– Ils sont dans le palais, mais en quel endroit ?
Un grand quart d’heure encore il réfléchit. Les maisons qui bordent le fleuve s’éclairaient, renfermant le cours d’eau dans une ligne de feu. À droite, un vaste espace noir frappa les regards de Dalvan.
– Le mur de briques du palais, se dit-il, et avec un sourire, c’est par là que je dois tenter de forcer l’entrée de la résidence royale, puisque c’est la seule partie qui reste plongée dans l’obscurité.
Alors il se rapprocha du bord du Meïnam, et se penchant, il inspecta soigneusement les environs. Bientôt il distingua une pirogue encore munie de ses pagaies. Sans doute un habitant de l’autre rive, en visite sur celle où il se trouvait, l’avait amarrée là, toute prête à le ramener à son logis. Prudemment, Dalvan se glissa jusqu’à l’embarcation, et ayant détaché la corde qui la retenait à la rive, saisit les avirons. Évoluant entre les maisons flottantes, il remontait le courant. En peu d’instants, l’esquif atteignit la zone obscure avoisinant l’enceinte royale et se confondit avec l’ombre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
À la même heure, dans une salle du chalet bizarre située à gauche de la cour d’honneur du palais, Claude et Yvonne dînaient tristement. Nazir les servait. Avec l’effronterie cynique de sa race, le Ramousi s’était métamorphosé d’ami en geôlier.
Après leur sommeil causé par un narcotique puissant, les jeunes gens s’étaient réveillés captifs en l’endroit où ils étaient encore. Tout surpris de se voir dans une maison, alors qu’ils se souvenaient d’avoir fermé les yeux sous le dôme vert de grands arbres, ils avaient couru aux fenêtres. D’un côté, le palais bizarre du monarque siamois avait frappé leurs regards. Du côté opposé, un étroit couloir séparait l’habitation d’un mur de briques dont la crête dépassait la hauteur de la croisée. Et comme ils appelaient, l’Hindou parut, accompagné de soldats siamois. En riant il raconta à ses prisonniers comment il les avait amenés à Bangkok. À leurs protestations indignées, il répondit seulement par des railleries et conclut ainsi :
– Il est sage de supporter ce qui ne peut être empêché. Soyez sages, et bientôt vous serez délivrés.
Depuis cette heure, il avait servi les Européens avec beaucoup de soin, laissant seulement la porte ouverte lorsqu’il entrait, afin que Claude pût apercevoir les soldats en faction au dehors. Cette vue était pour calmer toute velléité de résistance chez le « Marsouin » qui, sans elle, aurait certainement étranglé le vilain personnage.
Pour obtenir cette garde d’honneur, le Ramousi avait audacieusement trompé le souverain, en présentant ses prisonniers comme des otages précieux, dont la capture faciliterait sans doute le triomphe des négociations diplomatiques avec la République française.
Les jours avaient passé, tristes, lents, monotones. Claude s’exaspérait, Yvonne se désolait. D’abord elle avait attendu Simplet, elle n’avait pas douté qu’il viendrait à son secours. Mais à mesure que le temps s’écoulait, son espoir s’était transformé en inquiétude. Puisqu’il ne paraissait pas, il lui était donc arrivé malheur. Maintenant elle se ressassait cette pensée funèbre. De longues heures, elle restait assise, sans une parole, sans un mouvement. À présent qu’ils étaient séparés, lui et elle, la jeune fille s’avouait son affection. Ah ! pourquoi s’était-elle condamnée au silence ? Si elle avait eu le courage de parler, nul doute que Simplet l’aurait aimée. Il serait son fiancé, tandis que par ses plaisanteries, plus tard par sa réserve, elle l’avait éloigné d’elle-même. Elle se promettait, si jamais le sort les réunissait de nouveau d’être plus franche. Bientôt un nouveau sujet de crainte apparut à Mlle Ribor. Le Ramousi devint galant, empressé auprès d’elle. L’Hindou qui, au début, ne se montrait que rarement, faisait des visites fréquentes à ses prisonniers, et son regard noir, aigu, brûlant, ne se détachait plus de la jeune fille. Une fois même, profitant de ce que Claude était absorbé par une lecture, il dit à Yvonne :
– Les Ramousis sont la race la plus noble de l’Inde. Bientôt j’aurai beaucoup d’argent. Alors je prendrai pour femme la vierge que j’ai choisie.
Elle ne répondit pas, troublée par l’éclat insoutenable des regards de Nazir. Il reprit :
– Celle-là n’est pas de ma caste. Je romprai pour elle avec les miens ; je consentirai à n’avoir plus d’amis, plus de famille. Celle-là, jeune fille, c’est toi.
Yvonne se leva sans prononcer une parole et alla s’asseoir à côté de Claude. La complication qui se produisait l’avait remplie d’épouvante. Pauvre oiseau en cage, elle palpitait sous l’œil d’un maître, auquel il suffirait d’étendre la main pour la saisir. Sa terreur aidant, sa tendresse pour Marcel grandissait encore. Elle l’appelait de tous ses vœux, de toute son âme.
– Huit jours déjà, murmura-t-elle, poursuivant à haute voix sa pensée intime, huit jours et il n’a point paru !
Claude avait levé la tête. Il regarda la jeune fille avec tristesse, sans répondre.
– Pourquoi ne vient-il pas ? J’ai peur. Cette absence m’épouvante. Je me demande si le misérable qui nous garde n’a pas tué notre ami.
– Tué. Si je le pensais !…
Bérard, tout pâle, s’était dressé. Déjà, il avait eu cette idée. Bien des fois, le front collé à la vitre, en regardant passer dans la cour du palais les mandarins, courtisans du roi, il s’était anxieusement posé la question qui venait aux lèvres de Mlle Ribor. Pour ne pas tourmenter sa compagne de captivité, il avait gardé le silence, refoulant au fond de lui-même sa douloureuse rêverie. Et maintenant qu’elle-même exprimait la crainte dont il était assiégé, il ne trouvait rien à lui dire pour la consoler.
– Ainsi, dit-elle après un instant, vous supposez, comme moi ?…
– Non, j’espère que vous vous trompez.
– Pourquoi tenter de me donner le change ? fit-elle violemment. Vous le croyez mort, dites-le donc.
Et avec un accent déchirant.
– Mort pour moi, pour moi seule ; mort en me croyant indifférente à son dévouement, en m’accusant peut-être d’ingratitude !
Des larmes coulaient sur ses joues, elle se tordait les mains dans une crise de désespoir. À ce moment, du côté du mur de briques qui séparait la demeure royale du fleuve, un sifflement retentit. Faible, avec des modulations bizarres, le bruit se renouvela. Les prisonniers s’étaient tus. Ils écoutèrent, une flamme d’espérance dans les yeux. Un choc léger fit vibrer les carreaux. Claude courut à la fenêtre.
– C’est un signal ! exclama-t-il en ouvrant.
Yvonne le rejoignit, et tous deux, penchés sur la barre d’appui, sondèrent du regard le couloir obscur ménagé entre la maison et l’enceinte. Un souffle passa dans l’espace.
– Yvonne… en haut… sur le mur.
Elle leva les yeux, et accroupie sur la crête, à quelques pieds d’elle, elle aperçut la silhouette sombre d’un homme. Elle ne pouvait distinguer ses traits, mais son cœur le reconnut, et d’une voix brisée, la poitrine haletante, elle s’écria :
– Simplet ! c’est toi enfin. Ah ! comme je t’ai attendu…
– Les instants sont précieux. C’est Nazir qui vous a amenés ici ?

– Oui, ce traître nous a livrés aux Siamois. Nous sommes des otages, et les guerriers de Somdeteh Phra Chalulong nous gardent.
– De ce côté, je ne vois aucun factionnaire.
– Ils ne supposent pas que l’on puisse franchir la muraille.
– Alors, c’est bien simple : c’est de ce côté que nous tenterons de vous arracher aux mains du seigneur Nazir. Veillez.
Yvonne se rassurait en entendant son frère de lait. Il lui semblait que le danger s’écartait d’elle. Tout à coup elle vit Simplet faire un mouvement. Le bruit d’une fenêtre brusquement ouverte parvint jusqu’à elle, puis un coup de feu dont l’éclair livide illumina le couloir, et puis la chute d’un corps lourd dans l’eau.
Éperdue, elle regarda la crête du mur ; Marcel avait disparu. Le jour se fit dans son esprit. Simplet avait été aperçu, on avait tiré sur lui ; il était tombé dans le fleuve. Elle eut un cri de rage folle, puis ses genoux se plièrent, et elle s’affaissa près de la fenêtre en sanglotant :
– Ils l’ont tué ! Ils l’ont tué ! Ils ont tué mon âme !
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canetègne débarqué à Saïgon, ainsi qu’il l’avait dit à son complice Nazir, s’ennuyait ferme en attendant l’heure où le Ramousi lui livrerait Mlle Ribor. Pour se distraire, il avait « rayonné » autour de la ville, utilisé le tramway de Saïgon à Cholon, le chemin de fer de Saïgon à Mytho, fait de longues promenades sur la rivière profonde qui réunit la capitale de la basse Cochinchine à la mer, sur les arroyos nombreux où les barques glissent sur un tapis de floraisons aquatiques, tandis que des arbres, dont les cimes se rejoignent en voûte, pendent, multicolores et embaumées, des grappes de fleurs.
Mais loin de la cité, il éprouvait une vague inquiétude. Vraiment, il ne se sentait rassuré que lorsqu’il se trouvait en face du palais du lieutenant-gouverneur, non qu’il admirât l’édifice – un des plus beaux de l’extrême Orient – mais parce que de là il pouvait surveiller les allées et venues de tous les étrangers. Avec raison il pensait que, si ses adversaires échappaient au Ramousi, ils viendraient à Saïgon continuer leurs investigations, et qu’ils se livreraient ainsi à sa discrétion.
Pour leur enlever toute chance de lui brûler la politesse, il s’était lié avec un secrétaire du gouvernement. Il s’était donné pour un voyageur curieux d’archéologie, et avec son nouvel ami – de son nom Chapousse, de Marseille – il avait visité tous les monuments de la colonie, depuis la cathédrale jusqu’au dock flottant, sans oublier la chambre de commerce, les collèges d’Adran et Chasseloup-Laubat, les bassins de l’arroyo Rack-Can-Saù, anciens viviers où l’on gardait les crocodiles destinés à l’alimentation. Avec une patience imperturbable, Giraud – c’est le nom d’emprunt qu’avait pris l’ennemi d’Yvonne – écoutait les dissertations de son verbeux ami, apprenant tout ce qui se passait au Gouvernement, en même temps que l’histoire de la Cochinchine, le nombre des élèves indigènes se livrant à l’étude du français, et une foule d’autres renseignements dont il se souciait comme de l’an VIII.
Il ne souffrait aucunement du climat. La maladie qui l’avait défiguré, qui avait changé le timbre de sa voix – phénomène fréquent dans la variole – avait aussi profondément modifié son tempérament. De gras, il était devenu maigre, et la chaleur, qui le faisait souffrir jadis à Lyon, lui semblait très supportable dans la contrée torride qu’il parcourait aujourd’hui.
Cependant il commençait à trouver le temps long, lorsqu’un incident vint transmuer en rage l’ennui du commissionnaire. Un matin, une dépêche, envoyée de Paknam (Siam), arriva au Gouvernement ; elle était « confiée aux bons soins » du lieutenant-gouverneur, pour être remise, à l’arrivée du yacht Fortune, à miss Pretty. Chapousse, chargé de la commission, montra le télégramme à son ami avec force imprécations contre les Siamois, et Canetègne lut les lignes suivantes :
Miss Pretty Gold, à bord du yacht « Fortune » en rade de Saigon.
Prière à M. le Lieutenant-Gouverneur veiller à remise exacte. Claude, Yvonne captifs, près Bangkok, bandits siamois. Rançon : cent mille piastres ou mise à mort.
Réponse urgente.
Nazir.
Palais du Roi – Bangkok.
Dire la rage du commissionnaire est impossible. Il se voyait joué par son complice. Pas un instant il ne crut à l’histoire de brigands imaginée par le Ramousi.
Ainsi cet Hindou, ce demi-sauvage, que l’homme d’affaires véreux dédaignait, reprenait tranquillement l’opération pour son compte. Il allait réaliser un gros bénéfice et laisser Canetègne plus empêtré que jamais.
Devant l’ami Chapousse, l’ennemi de Mlle Ribor dissimula ; mais une fois seul, il se livra à des transports de colère dont le mobilier de son logis porta les marques. Deux chaises brisées, une table fendue par le milieu, des calebasses pulvérisées restèrent sur le champ de bataille, innocentes victimes de la coquinerie de Nazir. Puis après l’emportement vint le raisonnement. Canetègne se prit la tête à deux mains, fit bouillonner la ruse dont sa cervelle était saturée, et finalement poussa une exclamation de triomphe.
– Je suis méconnaissable, se déclara-t-il. La maladie a fait de moi un autre personnage. Profiter de la situation est l’abc de la lutte pour la vie. Je veux désormais vivre au milieu de mes adversaires et profiter de leur moindre bévue. Masqué, j’ai l’avantage, puisqu’ils restent pour moi à visage découvert.
Il riait. Son visage couturé par la variole était plus laid encore dans la joie que dans la colère. Et cependant il se contemplait avec satisfaction dans son miroir.
– Té ! fit-il, le diable lui-même ne me reconnaîtrait pas. Je suis hideux, mais je m’en moque ; ce n’est pas à un mariage d’amour que je veux contraindre cette petite Yvonne, mais à un simple mariage de sûreté.
Dans sa joie, il expédia à Mlle Doctrovée, son associée de Lyon, un peu négligée par lui depuis quelque temps, un cablogramme amical :
Saïgon.
Compliments. Envoyez nouvelles Bangkok. Maison prospère.
Canetègne.
À partir de ce moment, le vilain personnage ne quitta plus la ville. De l’agglomération saïgonaise il sembla se désintéresser, pour concentrer toute sa sollicitude sur le palais gouvernemental et sur la rade. Il faisait de longues stations au bord de la rivière, devant l’hôtel du représentant des Messageries maritimes. Il s’enquérait des entrées et des sorties du port, agissant, en un mot, comme s’il guettait l’arrivée d’amis impatiemment attendus.
Sa persévérance fut bientôt récompensée. Le yacht Fortune, un beau matin, remonta le Dong-Naï et la rivière de Saïgon, et jeta l’ancre à quelques mètres de l’endroit où se tenait le commissionnaire. À l’ombre d’un aréquier, celui-ci vit les matelots mettre un canot à flot, miss Pretty et William Sagger y descendre, et quand l’embarcation toucha la rive, l’Américaine l’aperçut debout, le chapeau à la main, courbé en un salut respectueux.
Elle n’eut pas le temps de demander quel était le personnage qui la recevait ainsi sur une terre inconnue. Le faux Giraud s’approcha, lui tendit la main pour l’aider à débarquer et d’une voix insinuante :
– Miss, dit-il, permettez-moi une simple question, êtes-vous la fille du roi de l’Acier ?
– Oui, fit-elle en réprimant avec peine un mouvement de répulsion causé par la laideur de son interlocuteur.
– Oui, alors mon ami est sauvé.
La jeune fille le considéra avec surprise :
– Votre ami !… Quel ami ?
– Je vous prie de m’excuser, miss, mais je n’ai pas été maître de ma joie. Une dépêche de Siam annonçait votre venue, et je vous attendais depuis plusieurs jours.
– Vous m’attendiez, pourquoi ?
– Parce que l’on vous dit aussi bonne que riche, aussi riche qu’ennuyée ; j’espère que vous me prêterez votre concours pour délivrer un explorateur que j’accompagnais, et qui est resté, dans le haut Tonkin, prisonnier des Muongs.
L’Américaine avait tressailli.
– Un explorateur ? questionna-t-elle. Quel est son nom ?
– Antonin Ribor.
Elle eut un léger cri. Celui que cherchaient ses amis était retrouvé. Il foulait cette terre indo-chinoise, où elle venait de prendre pied.
– Nous avons remonté le Mékong, continuait d’un ton ému le commissionnaire, mais au coude du 20e parallèle, les rapides devenant nombreux, nous quittâmes le fleuve pour rejoindre, à travers les montagnes, le cours de la rivière Claire et le Song-Coï ou fleuve Rouge. C’est durant ce voyage que mon malheureux ami fut pris par les Muongs. Moi-même, blessé, je fus capturé par un des détachements siamois qui parcouraient indûment la rive gauche du Mékong. De poste en poste je fus ramené au Cambodge, et du pays des Kmers je pus revenir à Saïgon.
Il s’arrêta ; miss Pretty lui avait saisi les mains.
– Comptez sur moi, monsieur…
Elle cherchait le nom.
– M. Giraud, dit-il, pour vous servir.
– Eh bien, monsieur Giraud, nous quitterons Saïgon ce soir même ; notre rencontre me dispense des recherches que je venais faire ici. Nous retournerons à Paknam, où je dois reprendre des passagers, et de là, nous nous lancerons à la délivrance de M. Ribor.
Puis coupant court aux remerciements du pseudo-explorateur :
– Mais vous parliez tout à l’heure d’une dépêche annonçant ma venue.
– Reçue au gouvernement. Je l’ai appris par un secrétaire de mes amis, M. Chapousse.
Une heure plus tard, miss Pretty avait en sa possession le cablogramme de Nazir. Elle ne s’en émut point. Une rançon de cent mille piastres n’était point pour la troubler. Et même elle se confia tout bas qu’il lui était agréable d’appliquer cette somme à libérer Claude Bérard.
Sous couleur de préparatifs de départ, Canetègne s’esquiva ; mais, vers quatre heures du soir, il se rendit à bord du Fortune. Quelques minutes après, le yacht, guidé par un pilote, descendait la rivière de Saïgon, emportant dans ses flancs l’ennemi de Mlle Ribor. La ruse du négociant avait pleinement réussi.
Le 28 juillet au matin, le steamer dut mettre en panne à l’embouchure du Meïnam. Le blocus du fleuve était établi, et des vaisseaux de guerre croisaient devant la passe de Paknam. Cela dura jusqu’au 1er août. Le blocus devint moins sévère, et le yacht, après explications préalables, fut autorisé à poursuivre sa route. Le 2, il atteignit Bangkok, et tout aussitôt miss Pretty, escortée de William Sagger, du faux Giraud et du capitaine Maulde, se fit mener à terre et se dirigea vers l’entrée du palais du roi.
Elle portait sur elle la rançon que le ramousi Nazir avait réclamée par dépêche.
XXVIII
SIMPLET DEVIENT CHIMISTE

Du sommet du mur de briques, Simplet avait sauté dans le fleuve sans blessure heureusement. Le grincement de la fenêtre, ouverte par le geôlier hindou, l’avait averti à temps, et au moment où ce dernier faisait feu, le sous-officier s’était précipité. Grimper dans sa pirogue, amarrée près de là, s’éloigner à force de pagaies et se réfugier dans un magasin flottant pour y achever la nuit, telles furent les premières préoccupations du jeune homme.
Une fois installé, il s’endormit. Ses vêtements mouillés se collaient sur son corps, mais l’atmosphère était si tiède, le clapotis des eaux si berceur qu’un Sybarite même, en semblable position, n’aurait pu résister au sommeil. Bien avant le jour, Simplet se réveilla. Là-bas, au milieu de la rivière, en face du consulat français, il apercevait les feux de position des canonnières ; mais il était encore trop tôt pour revenir à bord. Il s’assit et se prit à réfléchir :
– La situation s’est améliorée, se dit-il, je sais où sont détenus mes amis. Le problème est donc bien simple, il s’agit de pénétrer dans leur prison et de les délivrer.
Comme on le voit, il continuait à trouver simple une aventure qui eût paru compliquée à beaucoup de bons esprits. D’ailleurs, la solution ne vint pas tout de suite ; Simplet eut beau plisser son front, élever et abaisser ses sourcils, se livrer enfin à la mimique de la réflexion intense, ses combinaisons se brisaient toutes contre l’enceinte du palais, ou contre la pointe des baïonnettes des soldats chargés de la garde des postes. Et pourtant, après une demi-heure, il hocha la tête d’un air satisfait :
– L’escalade ne vaut rien ; il faut passer devant les hommes de garde, sans être arrêté par eux. Premier point acquis.
À l’orient, le ciel s’éclairait. Le crépuscule rapide des pays chauds commençait, jetant des teintes grises sur la ville.
– Oui, répéta le jeune homme, il faut passer inaperçu.
Ses yeux erraient distraitement autour de lui. Tout à coup ils se fixèrent sur des bonbonnes enveloppées de paille tressée. Il se donna sur la tête une calotte en disant :
– Suis-je bête… Pas inaperçu du tout ! Je passerai au grand jour, et le poste présentera les armes !
Qu’avait-il donc vu ? Dans le coin pour lequel il avait des regards caressants, rien que les bonbonnes surmontées de cet écriteau :
OXIGENATED WATER
WHITE FRIDAY
SINGAPOOR.
C’est-à-dire : Eau oxigénée[3] de la maison White-Friday de Singapour.
Toujours est-il que, quittant le magasin flottant, il se laissa glisser dans sa pirogue et nagea droit vers la canonnière la plus proche. Reconnu, il monta à bord, abandonnant au fil de l’eau l’esquif qui l’avait amené. Dans le courant de la journée, il profita d’un voyage à terre du canot pour se rendre au marché, d’où il rapporta un superbe lapin à la fourrure rousse et noire. Les matelots le raillaient de son acquisition, mais il n’y prit pas garde, et tenant le rongeur par ses longues oreilles, il alla trouver le médecin du bord.
– Eh ! mon ami, vous vous trompez, fit celui-ci en riant, la recette de la gibelotte ne me concerne pas.
Le sous-officier l’interrompit :
– Il ne s’agit pas de gibelotte. Si j’avais trouvé un lapin blanc, vous ne me verriez pas à cette heure ; mais les animaux de cette couleur sont inconnus ici.
Le docteur ouvrit des yeux ébahis :
– Vous avez de l’eau oxygénée, sans doute ? continua Simplet.
– Naturellement, la pharmacie en contient.
– Alors, vous pourrez m’aider. De ce lapin rouge et noir je désire, en utilisant les propriétés décolorantes de l’eau oxygénée, faire un lapin d’un poil de neige.
Et comme son interlocuteur semblait de plus en plus étonné, le jeune homme se pencha à son oreille et prononça quelques paroles rapides.
– Ah ! répondit seulement le médecin, alors je ferai ce que vous voulez, mais il faudra plusieurs jours.
– Peu importe. Docteur, je vous remercie.
Le lapin fut installé dans une cage de bois et comblé de légumes, ce qui parut lui être des plus agréable ; mais, hélas ! comme celle de l’homme, l’existence du lapin a ses vicissitudes ; chaque jour, le rongeur était tiré de sa prison par Simplet qui, sous la surveillance du docteur, lui faisait subir une application d’eau oxygénée. Après cette opération, le sous-officier se livrait à des travaux qui intriguaient fort l’équipage. Il fabriquait des boucles d’oreilles de forme étrange. Puis après avoir soigneusement pris mesure au rongeur, il avait taillé une ceinture de cuir ornée d’un anneau, et y avait adapté une chaînette de cuivre de trente centimètres de long, terminée par un mousqueton. Pour un peu, les marins l’auraient déclaré maniaque. Cependant l’eau oxygénée produisait son effet : l’animal se décolorait visiblement ; il passait par toutes les gradations du gris, devenait jaunâtre. Enfin, le 1er août, sa fourrure ne présenta plus la moindre trace de coloration. Marcel manifesta une joie folle. Il para son lapin de ses pendants d’oreilles, de sa ceinture. Il serra les mains du docteur, pris lui-même d’une émotion incompréhensible, et qui faillit pleurer lorsque le jeune homme lui dit :
– Ah ! je vous devrai plus que la vie.
La curiosité de l’équipage était vivement excitée ; dans l’impossibilité d’arracher une confidence aux deux hommes, officiers et matelots surveillaient Simplet ; ses moindres mouvements étaient notés, commentés, mais l’énigme demeurait indéchiffrable.
Le 2, au point du jour, le docteur fit descendre le canot. Il s’embarqua avec le sous-officier qui prit les avirons. Du navire français, on les vit traverser le fleuve et atterrir à proximité du palais. Là, Simplet sauta à terre, posa son lapin blanc sur son épaule et s’enfonça dans la ville, tandis que le médecin ramenait l’embarcation vers le steamer.
Le sous-officier marchait d’un bon pas. Sur son passage, les habitants s’écartaient respectueusement et s’inclinaient ; après avoir adressé au lapin blanc des gestes compliqués.
– Allons, murmura le jeune homme, cela prend bonne tournure. Quelle chance d’avoir appris la vénération de ces faces jaunes pour les lapins blancs !
Il arrivait au bord du canal qui entoure la ville royale. Sur le quai, des rameurs jouaient à une sorte de jeu de bouchon. À leur tunique sans manches, rouge avec bordure jaune, on reconnaissait qu’ils étaient au service du roi. Seuls dans leur corporation, ces bateliers ont le droit de revêtir l’uniforme dont il s’agit. À la vue du lapin blanc, ils interrompirent leur partie et saluèrent.
Simplet répondit par un signe protecteur et prit place dans l’une des pirogues attachées au quai. Sur un geste, deux pagayeurs y descendirent à leur tour et ramèrent vers l’escalier de pierre situé sur l’autre rive, et par lequel Nazir s’était introduit dans l’enceinte interdite. Jetant quelques sapèques aux piroguiers, Marcel gravit les degrés, contourna les casernements d’artillerie, et sans que personne osât l’arrêter, atteignit la muraille de briques qui, dans la cité royale, isole le palais.
Une haute porte, surmontée de la toiture à sept degrés, s’ouvrait devant lui. Sous la voûte, des soldats de la garde, serrés dans le dolman bleu à brandebourgs rouges, coiffés de la calotte ronde de l’infanterie anglaise, étaient en faction. Ils firent mine de croiser la baïonnette, mais le Français plaça le lapin sur sa poitrine et marcha droit à ceux qui lui barraient la route. Un instant les soldats hésitèrent, puis ils s’écartèrent en présentant les armes.
Maintenant Marcel était dans la première cour pavée de briques vernissées rouges, entourée d’une profusion de colonnes, de clochetons bouddhiques. Des officiers qui gardaient une seconde porte le laissèrent passer sans résistance. De bout en bout il parcourut une autre cour pavée de jaune, et enfin, après s’être engagé sous une voûte plus sombre et plus étendue que les autres, il se trouva dans la cour principale.
Un spectacle étrange s’offrit à ses yeux. Des femmes, bizarrement équipées et coiffées d’un casque noir étaient alignées, commandées, à ce qu’il semblait, par des hommes couverts de robes de soie rose à larges manches. Un murmure aussitôt étouffé accueillit l’entrée du voyageur. Sans y faire attention, il alla droit au perron, sur les marches duquel les porte-sabres du roi, à l’uniforme entièrement rouge, formaient la haie. Dans le vestibule, des officiers, des fonctionnaires se pressaient devant la porte de la salle du trône ouverte à deux battants. Là encore le lapin blanc fit merveille. En une minute Marcel fut au premier rang, et son regard plongea dans la vaste pièce.
Il se sentit impressionné et resta immobile. Au fond, en face de lui, sous un dais à sept étages, Somdeteh Phra Chalulong était assis sur son trône doré. La tête coiffée d’un casque blanc surmonté de la flèche sivaïque, vêtu de la tunique de même couleur, constellée de décorations et de broderies et retombant sur la culotte courte ; le roi, chaussé de souliers à la pointe recourbée et de bas de soie, parlait d’une voix douce et lente. À côté de lui se tenait l’aîné de ses fils, casqué comme lui, mais couvert d’une robe.
Le long des murs, devant les porte-flambeaux à sept branches, alternant avec les pyramides sivaïques, des mandarins militaires ou civils se tenaient courbés dans leurs costumes de cour, les yeux obstinément fixés sur des baguettes d’ivoire qu’ils tenaient à la main, afin d’observer la loi qui interdit de regarder le souverain.
Le roi présentait son héritier qui, selon la coutume, allait être confié aux bonzes pour recevoir d’eux la seconde éducation. Et soudain, dans le silence religieux de la cérémonie, des talons sonnèrent sur le plancher : Marcel se décidait.
Les assistants regardèrent stupéfaits cet Européen qui pénétrait ainsi dans la salle du trône. Le roi lui-même, en dépit des rites et de l’étiquette, montrait son étonnement. Mais l’inconnu portait sur l’épaule un lapin blanc. Les gardes n’osèrent l’arrêter. Il arriva auprès du roi, et après s’être incliné profondément :
– Sire, dit-il tranquillement, parlez-vous français ?
Somdeteh, on le sait, emploie indistinctement notre langue ou la langue anglaise. D’un ton courroucé, mais en pur français, il demanda :
– Qui es-tu, toi qui viens troubler mes serviteurs ?
– Un citoyen de France, Sire. Grâce à cet animal sacré – il désigna le lapin qui paraissait ne rien comprendre à l’aventure – j’ai pu parvenir jusqu’à vous pour vous faire entendre la vérité.
Le souverain considéra celui qui lui parlait ainsi. D’un regard il arrêta les mouvements des mandarins qui, oubliant la coutume sous l’empire de la colère, étaient sortis de leur immobilité, et plus doucement :
– Y a-t-il donc une vérité que je ne connaisse pas ?
– Que Votre Majesté me pardonne, reprit hardiment le sous-officier, mais elle est entourée de gens qui la trompent.
Une flamme passa dans les yeux du roi.
– On me trompe, dis-tu ?
– Sûrement. En voulez-vous la preuve ? Dans ce palais sont détenus deux prisonniers que l’on vous a désignés comme des otages précieux. Eh bien ! l’un est sous-officier comme moi dans l’armée française ; l’autre est ma sœur.
Le visage du monarque se couvrit de pâleur. Son front s’inclina pensif.
– On vous a dit, continua Marcel, que grâce à leur capture vous auriez facilement raison de nos négociateurs. Cela n’est pas.
Et brièvement il raconta la trahison de Nazir, les calculs financiers auxquels le Ramousi avait dû se livrer. Il conclut enfin :
– Si vous doutez, faites appeler devant vous cet Hindou et ses captifs, Sire, et punissez qui vous a menti.
Somdeteh goûta la proposition. Il leva le doigt. Aussitôt plusieurs officiers se précipitèrent au dehors. Et morne, silencieuse, immobile, l’assemblée attendit, tandis que le chef baissé, le roi rêvait. Puis au dehors un bruit de pas, et les mandarins militaires reparurent, conduisant Claude Bérard au milieu d’eux.
– Yvonne, où est Yvonne ? s’écria Marcel, mordu au cœur par l’angoisse.
– Yvonne, enlevée il y a quelques instants par ce coquin de Nazir.
De leurs baguettes d’ivoire les mandarins frappèrent l’épaule des jeunes gens pour les engager au silence. Mais le roi avait entendu :
– Tu as dit vrai, fit-il d’un ton attristé. L’Hindou était présent tout à l’heure, et sa fuite le condamne. Tu es libre ainsi que ton camarade. Partez, et dites aux Français que le roi de Siam rend la justice.
– En échange de votre bonté, Sire, répliqua Simplet, laissez-moi vous donner un avertissement. La République française est puissante, son armée, innombrable. Vous ne pouvez vaincre et le sang versé coulera inutilement.
Et comme le souverain tressaillait :
– Pardonnez-moi de vous dire ces choses, mais si vous me croyez, la vie de bien des innocents sera épargnée, Et puis, si je ne prenais sur moi de vous renseigner, je crois que personne de votre entourage ne le ferait.
Il salua le maître de six millions d’hommes et entraîna Claude tout abasourdi.
– Maintenant, il s’agit de retrouver Yvonne. Son ravisseur ne saurait être loin. En chasse, mon bon Claude, en chasse.
XXIX
ZÉBUS ET RHINOCÉROS

Tout en traversant au pas de course les cours du palais, le jeune homme racontait son expédient au « Marsouin » et il finissait par déclarer de la meilleure foi du monde :
– J’ai été un imbécile. C’était tellement simple ; j’aurais dû me défier de Nazir.
Comme la première fois, le sous-officier, toujours flanqué de Claude, traversa le canal sans difficulté. Même le pagayeur, auquel le « Marsouin » avait adressé quelques mots en sabir Annamite, souvenir de son passage au Tonkin, lui donna un précieux renseignement. Nazir s’était fait « passer » quelques instants auparavant. Avec sa captive il s’était rendu dans la New-Road, chez un parent du batelier nommé Raïa, de son métier loueur de zébus – bœufs à bosse. – de course.
– Courons chez Raïa, dit Simplet, auquel son ami expliqua que les zébus sont d’admirables bêtes de selle, aussi rapides et plus vigoureuses que le cheval.
Bousculant les passants, les jeunes gens gagnèrent New-Road et cherchèrent la maison du loueur de bœufs. Ils étaient si absorbés par cette occupation qu’ils se trouvèrent, sans les avoir aperçus, au milieu de plusieurs matelots qui firent entendre une exclamation gutturale. Presque aussitôt, une douce voix disait à leurs oreilles :
– M. Claude ! M. Dalvan ! Vous, vous enfin !
Ils eurent un cri de joie. Miss Diana Pretty, William Sagger leur serraient les mains. Et debout auprès d’eux, contemplant la scène avec attendrissement, un homme sec, maigre, défiguré par la variole, portait un mouchoir à ses yeux. C’était Canetègne qui jouait son rôle de pseudo-Giraud. En quelques mots, tout le monde fut au courant de la situation. Diana présenta le faux compagnon d’Antonin Ribor aux sous-officiers.
– Vous savez où il est, dit Simplet en secouant vigoureusement la main de son ennemi méconnaissable, alors vous nous guiderez, dès que j’aurai délivré ma sœur, ma chère Yvonne.
Il s’interrompit. Un large panneau peint sur une maison avait attiré son attention. Un zébu lancé à fond de train y était figuré.
– Ce doit être là, la demeure de ce Raïa que je cherche.
– Entrons, répondit Diana.
Et comme Claude la regardait :
– Car je vous suivrai, ajouta-t-elle, partout où vous irez.
Le « Marsouin » baissa les yeux. Pris d’un trouble étrange, il garda le silence. Un quart d’heure après, l’Américaine renvoyait ses matelots à bord du Fortune, avec ordre au capitaine Maulde d’attendre à Bangkok durant trois jours, et ce délai expiré, d’aller jeter l’ancre à Saïgon où les voyageurs rallieraient le yacht. Canetègne seul resta auprès de ceux dont il rêvait la perte. Juché sur un zébu comme Simplet, Claude, Sagger et miss Pretty, il sortit de Bangkok à leur suite. Dans leurs traces, il fila à fond de train sur la route royale de l’est.
Le loueur, tout en faisant affaire, avait indiqué cette voie comme devant être empruntée par le ramousi Nazir. Auprès de l’industriel, comme auprès du roi, des mandarins, des pagayeurs, le lapin blanc avait eu un plein succès. Aux questions du maître du rongeur, le Siamois avait répondu franchement. Nazir entraînant sa proie vers l’est, tous le poursuivaient. Et Canetègne, qui de sa vie n’avait enfourché une monture, se cramponnait désespérément à sa selle de bois, tandis que son zébu, emporté dans une course vertigineuse, galopait au milieu de ses congénères.
Chaque bond de l’animal amenait un rapprochement brusque entre le fond de culotte du négociant et les planches de la selle primitive. De là des chocs répétés, qui se traduisirent bientôt par une douleur aiguë aux points de contacts. L’homme le plus dur a toujours un endroit sensible ; Canetègne s’en aperçut à ses dépens ; l’équitation lui révéla le défaut de la cuirasse. Ainsi que le héros Achille, il pouvait être frappé par derrière, mais hélas ! ce n’était point son talon qui était vulnérable !
Dire sa colère est impossible. Partagé entre le désir de voir finir son supplice et celui de rejoindre Yvonne, afin de réaliser ses petites vilenies, il maugréait tout bas, proférant à l’adresse de Nazir, cause vivante de ses maux, les plus terribles menaces. Puis une douleur plus vive faisait naître en lui un sentiment inconnu jusqu’à ce jour ; la pitié. Oh ! la pitié de lui-même ! Il se déclarait très sérieusement que dans les pays sauvages, rien n’est à sa place ; avec un semblant de raison d’ailleurs, car il est rare de voir un notable commerçant, payant patente et ayant pignon sur rue, à califourchon sur un bœuf à bosse.
Le zébu courait toujours. Comme un marteau sur l’enclume, la selle battait rudement la portion blessée du cavalier. Alors les idées de Canetègne s’embrouillèrent, et il se laissa emporter par le galop de l’animal, sans penser, sans même se plaindre, abîmé en une profonde commisération pour la portion de son être qu’il avait dédaignée jusqu’à ce jour parce qu’il s’asseyait dessus.
À la nuit, on s’arrêta dans un village. Devant le lapin blanc, véritable Sésame, ouvre-toi, nulle porte ne restait fermée. Le mandarin, chef de l’agglomération, reçut les voyageurs. Il leur apprit qu’un homme et une femme, répondant au signalement de ceux qu’ils voulaient rejoindre, avaient traversé le village, avec une heure d’avance environ. Selon toutes probabilités, ils passeraient la nuit à Nayen-Sap, bourgade distante de quelques yot.
Simplet voulait se remettre en marche de suite, mais l’indigène fit observer que la route royale prenait fin en cet endroit ; qu’elle était continuée par un sentier tracé dans une forêt, riche en fauves, et que la nuit, il était follement téméraire de s’y engager. Force fut donc à la caravane de s’arrêter.
Canetègne, que tous plaignaient sous le nom de Giraud, accueillit avec joie cette solution. Enfin il pourrait s’étendre sur une natte, reposer ses membres endoloris. Il dîna debout, son état ne lui permettant pas de prendre une position plus commode, et boitant, tirant la jambe, alla se jeter sur la couche préparée par les soins de son hôte.
Hélas ! la nuit fut pour lui une nouvelle épreuve. Impossible de rester sur le dos et pour cause. La station horizontale sur les côtés lui sembla presque aussi douloureuse. Il dut se mettre sur la quatrième face de lui-même, et alors son nez se trouva en contact direct avec la natte grossière qui compose toute la literie du pays.
Au moindre mouvement, son appendice nasal était victime des chatouillements les plus désagréables. Il se réveillait en sursaut, esquissait un mouvement brusque qu’il déplorait aussitôt, rappelé à l’ordre par une douleur lancinante dans la région malade.
Avec terreur, il songeait que le soleil allait reparaître ; qu’il lui faudrait recommencer l’épouvantable chevauchée et entrer de nouveau en relations avec la selle de bois dont le souvenir lui était si cuisant. Et tournant la tête, il jetait derrière lui un regard effrayé, comme s’il craignait d’apercevoir, suspendu au-dessus de ses blessures, l’instrument de son supplice. Cela devenait de l’obsession ; une véritable « selle de Damoclès ! »
Sans souci des malédictions du négociant, Phœbus poursuivant sa carrière, parut à l’horizon. Force fut à Canetègne de se lever comme l’astre radieux.
Fourbu, moulu, il se traîna dehors. Déjà ses compagnons harnachaient leurs zébus. Il les imita, et bientôt, après avoir pris congé du mandarin, la caravane se remit en route.
Mais en arrivant à Nayen-Sap, les voyageurs ne trouvèrent plus ceux qu’ils espéraient atteindre. Aussi matinal qu’eux-mêmes, Nazir s’était éloigné avec sa prisonnière, dans la direction du petit port de Boug-Palung. Tous y coururent. Trop tard encore. Ils reconnurent la trace du Ramousi ; celui-ci avait essayé de s’embarquer, mais les croiseurs Français ayant déclaré le blocus de la côte siamoise, aucun caboteur n’avait voulu quitter le port. L’Hindou alors s’était enfoncé dans les terres par la route d’Ancorboa.
– Allons, gronda Simplet, crevons nos zébus, mais tâchons de rejoindre Yvonne.
Et la course folle recommença. Au soir, les voyageurs campèrent sur le plateau herbeux qui domine les monts Sakoc ; le lendemain ils arrivaient à Ancorboa. Ni les rues bordées de vérandas rustiques, ni les pagodes de bois curieusement travaillé, n’obtinrent un de leurs regards. Tous fouillaient des yeux les maisons, les ruelles, espérant découvrir Nazir. Peines perdues. Une bonzesse, à laquelle Diana fit l’aumône, leur déclara que l’Hindou n’avait pas séjourné dans la ville. Il avait simplement renouvelé ses provisions à la bonzerie à laquelle elle appartenait, et avait filé sur Ker-Has et Battembang, capitale de l’ancienne province de ce nom, dérobé au Cambodge par l’avidité siamoise.
Évidemment le rusé Ramousi se sentait poursuivi puisqu’il doublait les étapes. Fatigués, mais furieux, Simplet et ses compagnons s’engagèrent dans le sentier de Ker-Has. Ils atteignirent cette bourgade, exténués. Il leur fallut s’arrêter, leurs zébus n’en pouvant plus. Et là, un fermier confessa qu’il avait vendu ses deux derniers bœufs de selle à un étranger voyageant avec une jeune fille, malade sans doute, car elle était enveloppée dans un voile de gaze, et son guide l’avait portée à bras dans le léger palanquin attaché sur le dos de sa monture.
Fou de rage, Marcel voulait partir à pied. Ses amis durent le retenir, lui faire comprendre l’inanité de sa démarche. Il consentit à passer la nuit à Ancorboa. Et le lendemain, une étape forcée conduisit la petite troupe à Battembang. Nazir était en route pour Samreap.
À leur arrivée dans cette ville, située près du Thanle-Sap, le grand lac du Cambodge, le Ramousi était déjà loin sur le chemin d’Angkor.
On quitta Samreap de grand matin. Vers une heure, on passa en tempête devant les ruines gigantesques d’Angkor-Vat, livre de pierre où les peuples disparus ont gravé leur histoire. Entassement prodigieux de tours, de terrasses ; ville mystérieuse et déserte, construite jadis par des artistes inconnus, les plus fantaisistes, les plus imaginatifs de tous ceux qui ont laissé une trace sur notre globe.
– Foin de l’archéologie, grommela Simplet, à qui Sagger parlait avec admiration de ces vestiges d’une civilisation éteinte. Je donnerais tous les monuments du monde pour retrouver Yvonne.
Angkor-Vat restait en arrière. Devant les voyageurs, au bout d’une plaine couverte d’herbes, se montrait un taillis épais, et dépassant les plus hautes cimes, des tours de pierres aux gradins superposés.
– La pagode d’Angkor-Thom, déclara l’intendant[4].
Le licencié ès-sciences géographiques n’eut pas le loisir d’ajouter les renseignements qui lui venaient aux lèvres. Le chemin faisait un coude. Simplet, arrivé au tournant, avait brusquement arrêté sa monture, et avec un cri étranglé, avait sauté à terre. Tous le rejoignirent. Une même exclamation s’échappa de leurs bouches. En travers de la route, un zébu était couché, mort, un filet de sang coulant des narines ; le ventre serré par la sous-ventrière, qui maintenait encore sur le dos de l’animal un palanquin aux draperies rouges.
– Le Ramousi n’est pas loin, s’écria le sous-officier, le corps du bœuf est encore chaud.
– Vous pensez donc que ce zébu est un de ceux qui ?…
Le jeune homme ne laissa pas Diana achever sa question. Il se baissa et montrant triomphalement une épingle, longue de vingt centimètres environ, terminée par une figurine dorée :
– J’en suis sûr, voici une épingle qu’Yvonne a achetée à Calcutta.
– C’est vrai, je la reconnais.
– Et si vous doutez encore, acheva le jeune homme, regardez à terre. Du doigt il désignait un endroit du chemin, où des lignes étaient tracées sur le sol. En s’approchant, les voyageurs distinguèrent les lettres suivantes :
Y V O.
– Yvonne, expliqua Simplet, elle n’a pu achever d’écrire son nom, à cause de son geôlier, mais ces trois lettres suffisent.
Émus à la pensée qu’enfin ils touchaient au terme de cette longue chasse à l’homme, tous se remirent en selle. Bientôt ils furent sous le taillis. Des branches s’étendaient en travers du chemin, barrant la voie. Il fallut ralentir l’allure des zébus, car une rencontre avec ces obstacles aurait pu être mortelle.
Parfois des masses de pierres taillées, sculptées, paraissaient au bord de la route, emprisonnées dans une végétation robuste. Des tours ruinées ceintes de lianes, des fenêtres ogivales d’où s’échappaient, en bouquets énormes, les floraisons de la forêt, et puis des statues colossales : lions accroupis, serpents de granit dardant leur langue de pierre au milieu de buissons fleuris.
– La voie d’honneur du temple d’Angkor-Thom, fit tout bas Sagger.
Puis une dernière barrière de verdure franchie, tous s’arrêtèrent stupéfaits. Devant eux s’ouvrait l’immense cour intérieure de la pagode ruinée. À droite et à gauche, des terrasses suspendues, supportées, non par des colonnes, mais par des rangées d’éléphants arcboutés, de lions, de garoudas superbement dressés, allaient rejoindre, à huit cents mètres de là, le grand temple, avec ses cinquante tours groupées en pyramide et formant cinquante têtes quadruples, coiffées de tiares à étages. Entre ces tours, des escaliers interminables, serpentaient en détours sinueux. Et puis des ouvertures de toutes formes, découpant des figures noires dans la masse de granit, fouillée de la base au sommet par le ciseau brisé de générations d’artistes des temps écoulés.
Les herbes, les ronces, les buissons remplissaient la cour, avaient fait éclater le dallage. Des lianes audacieuses avaient crû sur les tours, escaladé les tiares de la toiture, jetant leur linceul de feuillages sur le temple, pétrification d’un rêve géant, vainqueur triomphant et désolé de l’armée innombrable des siècles.
Et devant cet asile d’un dieu détrôné, demeure vide survivant aux nations d’adorateurs, tous restaient immobiles, oubliant leurs propres intérêts, pris par le désespoir grandiose de la pagode déserte. Soudain un cri retentit dans le silence.
– Simplet !
Cri lointain, affaibli. Tous regardent, haletants. Ils ont cru reconnaître la voix d’Yvonne. Le bras de Marcel s’étend :
– Là-bas ! là-bas ! c’est elle.
Oui, le jeune homme dit vrai. À l’extrémité de la terrasse de droite, emportée par le Ramousi, Mlle Ribor se débat. Elle appelle encore. Les talons de Marcel s’enfoncent dans les flancs de sa monture. Le zébu bondit en avant, mais presque aussitôt il trébuche et s’abat. Le sol est parsemé de crevasses, de dalles branlantes. Les bœufs s’arrêtent, tremblant sur leurs jarrets, effrayés par ce sol mobile. Alors Dalvan saute à terre et se précipite en courant dans la direction du ravisseur. Les autres l’imitent ; à droite et à gauche, ils gagnent les terrasses afin de couper la retraite au Ramousi.
Maintenant ils dominent la cour que Marcel traverse à une allure rapide. Eux aussi se pressent. Mais brusquement ils s’arrêtent. Là-bas, entre les statues de garoudas et de lions, quelque chose a remué dans l’ombre. Cela est énorme, d’une teinte brune ; cela s’approche de la zone éclairée ; les formes se précisent. C’est un rhinocéros de grande taille, à la corne longue de deux pieds. Farouche, il souffle bruyamment exprimant ainsi sa colère d’être dérangé dans son repos.
Un cri signale le danger à Marcel. Le jeune homme regarde autour de lui. Il aperçoit le monstre. Il hésite un instant. Ses armes sont restées accrochées à la selle du zébu. Il n’a qu’un sabre d’abatis court, bien inutile contre le pachyderme, dont la peau épaisse résiste même à la balle.
Ses compagnons comprennent le péril, ils veulent se porter à son secours, mais ils arriveront trop tard. Le rhinocéros, la tête entre ses jambes, la corne menaçante en avant, se rue sur le sous-officier. Marcel va être éventré, piétiné, brisé par son formidable ennemi.
La bête furieuse est à dix pas de lui, Diana ferme les yeux.
– Bravo ! crie Claude à côté d’elle.
Elle relève les paupières. Le pachyderme a dépassé Dalvan sans le toucher, et emporté par son élan, continue sa course. Avec la rapidité de l’éclair, Simplet a compris la tactique à employer :
– C’est bien simple, s’est-il dit, le rhinocéros galope droit devant lui ; un saut de côté et je l’évite. Il s’agit de répéter la manœuvre assez souvent pour gagner un escalier.
Et il a sauté. Il rit, enchanté de voir son ennemi s’éloigner et profite de cet instant pour se rapprocher de la pagode. Mais il est au centre de la cour ; aura-t-il le bonheur d’atteindre le refuge qu’il vise ? Le rhinocéros est parvenu à s’arrêter. Il se retourne furieux de son insuccès et charge de nouveau. Aux appels de ses amis, Simplet répond par un geste de la main, il semble leur dire :
– Soyez donc tranquilles. Un rhinocéros, ce n’est pas une affaire !
Et quand la bête mugissante arrive sur lui, il fait un pas de côté, frôlé au passage par son monstrueux adversaire que son élan entraîne encore à cinquante mètres.
Mais, à la grande surprise de ses amis, immobiles sur les terrasses, Dalvan ne paraît plus songer à se rapprocher du temple. Il demeure sur place, attendant tranquillement le retour du rhinocéros. Durant une heure, il lutte ainsi, laissant le pachyderme se fatiguer en vaines foulées. La bête s’épuise visiblement ; ses jambes lourdes tremblent, mais la rage lui rend de nouvelles forces, elle va, revient, passe, repasse en un galop sans trêve, hantée du désir de broyer son insaisissable ennemi.
Peu à peu, le cerveau épais de l’animal a compris la manœuvre de Simplet. Farouche, il charge encore, mais arrivé à deux pas du sous-officier, il s’arrête brusquement sur ses pattes raidies et cherche à porter un coup de côté au vaillant champion.
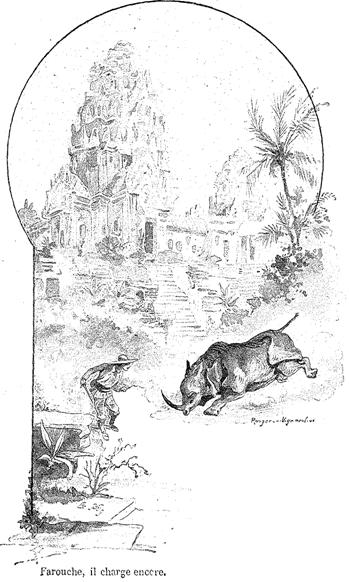
Claude, Diana, Sagger ont un cri d’épouvante ; le pseudo-Giraud espère un instant être débarrassé du meilleur ami d’Yvonne, puis tous ouvrent des yeux effarés, car une chose inexplicable se passe. Marcel a étendu le bras en avant. Sa main a touché le front du rhinocéros, et soudain l’animal pousse un effroyable beuglement, ses jambes plient sous lui, il roule sur le sol où il reste sans mouvement, après une rapide convulsion.
Et avec un appel de victoire, Dalvan se tourne vers l’endroit où tout à l’heure Yvonne a paru emportée par Nazir.
Ses amis suivent la direction de son regard. Une tristesse profonde les étreint. La jeune fille n’est plus là, non plus que son ravisseur. Profitant de la diversion amenée par le fauve, l’Hindou a fui avec sa victime. Marcel bondit vers le temple. Ses compagnons parcourent les terrasses. Tous atteignent les ruines, escaladent les escaliers, dont les spires s’enroulent aux flancs des tours. Ils pénètrent dans les salles immenses, dans des corridors sans fin. Partout le vide, partout, sur les murailles de granit, sur les plafonds, les corniches, les degrés, les entablements, les figures fouillées par les sculpteurs d’autrefois, horribles ou belles, grimaçantes, souriantes, hommes, femmes, dieux et bêtes regardent de leurs yeux fixes. On dirait un peuple pétrifié qui, dans un rapide et ironique réveil, s’amuse de l’agitation de ces pauvres créatures humaines, fourmis errantes dans le dédale de la pagode gigantesque.
Ils arrivent sur l’autre face du temple, ils dominent la campagne. Loin au sud, ils aperçoivent un lac, miroir immense où se reflète le ciel. Des routes étalent leur ruban jaune au milieu des verdures de la plaine.
– Le Thanle-Sap, le grand lac du Cambodge, dit William Sagger.
Mais Marcel se penche en avant, sans souci du gouffre béant devant lui. À moins d’un kilomètre, sur un chemin, une forme se meut avec rapidité.
– Là bas ! rugit-il, Yvonne, il l’enlève. Courons à son secours.
Si Claude ne l’avait retenu, le sous-officier fut tombé dans le vide. Tous revinrent sur leurs pas, retrouvèrent les zébus là où ils les avaient laissés, et contournant le fourré qui abrite la pagode, galopèrent dans la direction du lac.
Mais Diana ne quittait plus Claude. Elle maintenait sa monture à côté de celle du « Marsouin », et comme celui-ci en paraissait surpris, elle lui dit avec une émotion inexplicable :
– Votre ami doit souffrir beaucoup. La séparation est la plus cruelle souffrance, mieux vaut mourir ensemble que vivre séparés.
Et d’un ton singulier :
– Je ne sais votre pensée, mais moi, je sens ainsi.
Cependant Canetègne – alias Giraud – qu’un effort de son zébu avait porté à la hauteur de Dalvan, se frappait le front.
– À propos, comment avez-vous tué le rhinocéros ?
Le jeune homme ne put se défendre de sourire. Il tira de son fourreau son sabre d’abatis.
– Avec ceci, dit-il.
– Cette lame de trente centimètres ?
– Parfaitement, cette lame enfoncée dans l’œil de la brute m’a sauvé la vie !…
Tristement il acheva :
– Pourquoi ? Puisque je n’ai pas su préserver Yvonne.
Ses genoux se moulèrent dans les flancs du bœuf, et le galop enragé de l’animal s’accéléra encore.

XXX
LE MÉKONG
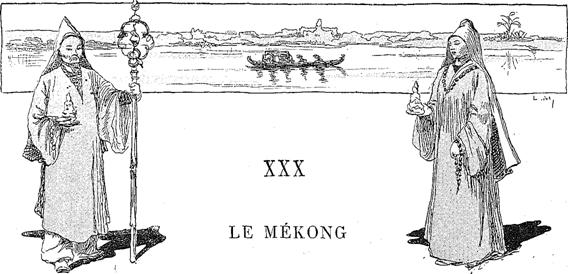
Tandis que Marcel luttait contre le pachyderme unicorne, Nazir, d’abord surpris, avait recouvré son sang-froid. Brusquement, il avait couvert la tête d’Yvonne de sa ceinture de soie et avait emporté la jeune fille. Par un long détour, il avait gagné un fourré où il avait caché son second zébu, et sautant en selle, la prisonnière jetée en travers devant lui, il avait fui à toute vitesse vers le sud.
Suffoquée, Mlle Ribor avait perdu connaissance. En rouvrant les yeux, elle se vit couchée au fond d’une pirogue que des pagayeurs kmers faisaient voler à la surface du grand lac. Elle leva la tête. La rive laissée en arrière commençait à se noyer dans la brume du soir. Il lui sembla apercevoir un mouvement inusité sur la berge, mais la nuit se fit. Elle ne vit plus rien que l’onde noire autour d’elle, et à l’arrière de l’embarcation, la silhouette immobile du Ramousi. Un désespoir aigu s’empara d’elle. Elle avait aperçu Marcel ; elle avait cru à la délivrance prochaine, et maintenant elle était plus captive que jamais.
Elle songea à périr, à mettre fin à la terreur angoissée qui l’étreignait depuis son départ de Bangkok. L’onde, où les rames s’enfonçaient sans bruit, lui parut un lit de repos. Il lui suffisait de se laisser glisser dans cette tombe mobile pour échapper à son ravisseur. Mais au premier mouvement qu’elle essaya, la jeune fille comprit que la mort même lui était interdite. De fines cordelettes enserraient ses poignets et ses chevilles.
Toute la nuit la pirogue fila droit devant elle. Au jour elle rallia la rive, et la prisonnière fut portée dans une baraque, où durant la saison de la pêche – industrie florissante, car les poissons du Thanle-Sap, salés et séchés, sont exportés dans tout l’Orient – les écumeurs du lac se livraient à leurs opérations. Des barils défoncés, des engins de pêche, et surtout une insupportable odeur de saumure avariée en faisaient foi.
Longue fut la journée. Enfin le soleil s’abaissa sur les marais qui bordent le lac, l’obscurité se fit. Aussitôt Yvonne fut extraite de sa prison, reportée dans la pirogue, et la course nocturne recommença. Bientôt la lune se leva et permit à l’infortunée voyageuse d’apercevoir le paysage. La largeur du lac diminuait, diminuait. Le bateau entrait dans le canal qui relie la nappe d’eau au fleuve Mékong ; canal singulier où, suivant les différences de niveau du Thanle-Sap et du cours d’eau indo-chinois, le courant se produit tantôt dans le sens sud-nord, tantôt dans la direction nord-sud.
Le voyage continua ainsi avec une écœurante monotonie. Le jour, Mlle Ribor était claquemurée dans une chaumière quelconque ; la nuit, la pirogue l’emportait toujours plus loin de ses amis.
Le 13 août, vers deux heures du matin, elle entrevit Oudong, avec ses quais bien entretenus, ses palais, ses pagodes ; le 14, Pnom-Peuh, capitale du Cambodge située au point de rencontre du canal du Thanle-Sap et du Mékong. Avec stupeur elle constata que l’embarcation remontait le courant, se dirigeant vers les régions inconnues du Laos explorées par Francis Garnier.
Des forêts épaisses couvraient les rives. Palmiers, cocotiers, sapins, tecks, etc., mêlaient leurs branches. Des bandes de singes saluaient le passage de la barque de grands cris, interrompus parfois par le rauquement redouté des tigres.
Des crocodiles, des tortues énormes, dérangés dans leur repos, plongeaient brusquement, en faisant jaillir l’eau dans un éclaboussement formidable.
Le 15, la journée se passa dans une bonzerie dont les habitants, bonzes et bonzesses, vêtus uniformément d’une robe monacale ornée d’un capuchon, vinrent curieusement considérer la prisonnière. Elle essaya de leur parler, de leur expliquer sa situation. Peines perdues, ils n’entendaient pas le français.
L’eussent-ils compris d’ailleurs que le récit de la jeune fille ne les eût pas émus. Ces prêtres ignorants et cupides, qui sentent une ennemie dans la civilisation, se seraient réjouis du désespoir d’Yvonne. Elle appartenait à la race abhorrée des conquérants.
Le 21, nouvelle désillusion ; la pirogue atteignit les rapides de Khong ou de Khône, défendus par le fortin français établi dans l’île du même nom.
Il y avait là des tirailleurs annamites, coiffés du chapeau conique, sanglés dans la vareuse bleu-marine, le pantalon large flottant sur leurs pieds nus. Mlle Ribor les aperçut de loin, mais de loin seulement, car la pirogue aborda sur la rive droite, rive siamoise, et fut portée à dos par les pagayeurs jusqu’en amont des rapides. Et la navigation recommença.
Pourtant Yvonne ne désespérait pas. Elle était certaine que Simplet était sur ses traces, et une idée lui était venue : aider ses amis à la retrouver. Toutes les fois qu’elle pouvait laisser une trace de son passage, inscription sur un mur, lambeau de sa robe attaché à une branche, elle s’empressait de le faire.
On était dans une région sauvage, inhabitée. Nazir avait cru sans danger de relâcher un peu sa surveillance. Les liens qui immobilisaient les membres d’Yvonne avaient été enlevés. Pourquoi ligotter la prisonnière, mieux gardée par les forêts désertes que par de vigilants geôliers ?
Le 30, la pirogue rencontra une flottille de bateaux de papier qui descendaient le cours du fleuve. Multicolores les légers esquifs glissaient au fil de l’eau. Ils indiquaient, ainsi que l’expliqua le Ramousi, qu’une épidémie sévissait sur les populations riveraines, qui, pour apaiser le fléau, ont coutume de lancer ainsi une escadrille de papier sur le Mékong. Yvonne feignit la curiosité. Elle réussit à capturer deux batelets, et le soir, sur chacun elle écrivit son nom, à l’aide d’un charbon dérobé au foyer, où ses gardes avaient fait cuire le dîner. Puis quand la montée du fleuve fut reprise, elle abandonna les légers bateaux au courant.
Durant vingt et un jours encore continua la course nautique, et puis brusquement, à quelques kilomètres de Luang-Prabang, le Ramousi abandonna pirogue et pagayeurs. Il acheta d’un fermier muong deux petits chevaux du pays, et sa captive étroitement garottée de nouveau, il s’enfonça avec elle dans les terres.
Où la conduisait-il ? Pourquoi ce long et pénible voyage ? Questions énervantes auxquelles Mlle Ribor ne trouvait aucune réponse acceptable. Le découragement la prenait. Ses compagnons avaient dû renoncer à la suivre. Quelle apparence qu’ils eussent effectué le parcours de douze cents kilomètres qui sépare Pnom-Peuh de Luang-Prabang ? Peut-être qu’elle aurait eu plus de confiance si elle avait connu l’âme de Marcel. Mais elle l’ignorait, et c’était une souffrance de plus, une agonie ajoutée à son agonie morale, de songer que, par sa seule faute, elle l’avait éloigné d’elle.
Une semaine se passa. On galopait à travers une contrée montueuse hérissée de fourrés. À chaque instant on rencontrait des torrents écumant dans d’étroits couloirs rocheux. Alors il fallait suivre la berge jusqu’à ce que l’on rencontrât un pont de bambous jeté en travers du courant. De loin en loin, un village composé de misérables paillottes, qui se pressaient autour d’une pagode de bois, à peine aussi vaste que les chalets de la Compagnie des Omnibus de Paris.
Lasse au physique comme au moral, perdant tout espoir à mesure qu’elle s’enfonçait davantage dans le fourré, Yvonne s’abandonnait au trot de sa monture. L’idée de la lutte s’éteignait en elle. Ce n’était point de la résignation, mais l’hébétement de la victime traînée au supplice.
Le 29 septembre, comme elle suivait son guide dans un sentier bordé de cultures, le Ramousi arrêta brusquement les chevaux. À une centaine de mètres, un cavalier avait paru. Il allait croiser les voyageurs. En ce pays, tout homme peut être un ennemi ; l’attitude de l’Hindou était donc justifiée. Mais Nazir se rassura vite :
– C’est un missionnaire, fit-il, rien à craindre.
Seulement il déplia le kachmyr rayé qu’il portait roulé en bandoulière, et le jeta comme un voile sur la tête de sa captive, avec ces sinistres paroles :

– Si tu appelles, jeune fille, je tuerai ce prêtre.
Celui qui approchait ne semblait pas se douter qu’un péril le menaçait ; monté sur un mulet à l’allure douce, il passa près du groupe immobile et leva son casque colonial. Sauf le rabat, son costume, composé d’une blouse et d’un pantalon de toile, n’avait rien d’ecclésiastique. La chaleur torride suffisait à justifier cette modification de l’uniforme sacerdotal.
– Salut, frère, que la route vous soit facile ! Le Ramousi se découvrit :
– Salut, père, je te remercie de ton souhait.
– Vous allez vers la rivière Noire, reprit le missionnaire. Soyez prudents. La tribu des Muongs aux pavillons verts tient la campagne.
Un sourire distendit les lèvres de l’Hindou.
– Je n’ai rien à craindre d’eux, père. Leur chef est un homme de ma caste ; Zourgriva me recevra en ami.
– Zourgriva n’est plus chef des Pavillons Verts.
Et comme le Ramousi esquissait un mouvement de surprise :
– Il a été tué par Songoï, ex-sergent aux tirailleurs annamites, qui lui a succédé. Un brave ce Songoï. Il fait respecter notre mission, mais souvent, sous peine de se rendre impopulaire, il doit permettre les actes de piraterie des siens. Prenez donc garde !
Il étendit les mains dans un mouvement de bénédiction, comme pour éloigner le malheur de ces inconnus dont la route croisait la sienne, puis il poussa sa monture et s’en fut au pas tranquille et lent du mulet habitué sans doute à n’être pas surmené.
Un instant Nazir demeura immobile. Après l’avertissement du missionnaire, il hésitait peut-être à aller plus loin. Mais il haussa les épaules. Lui, Hindou ramousi, bandit révolté contre le joug européen, il n’avait point à redouter les Muongs. Ses talons s’enfoncèrent dans les flancs de son cheval qui prit le galop, entraînant à sa suite le cheval d’Yvonne.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le soir du même jour, cinq voyageurs demandèrent l’hospitalité à la mission voisine, dont le supérieur avait rencontré Nazir. Leurs habits couverts de poussière, la fatigue de leurs chevaux dont la sueur avait moiré la robe, disaient la longue étape parcourue.
C’était Simplet avec ses amis.
Depuis deux mois, ils poursuivaient le ravisseur de Mlle Ribor, découvrant un à un les signes de reconnaissance dont la jeune fille avait jalonné sa route, inscriptions sur les murailles, bandes d’étoffe attachées aux branches, bateaux en papier. En dernier lieu, ils avaient rencontré la pirogue qui retournait au Thanle-Sap, après avoir débarqué ses passagers. Moyennant quelques pièces de monnaie, les pagayeurs avaient désigné l’endroit où l’Hindou avait quitté le fleuve avec sa prisonnière. À leur tour les Européens s’étaient engagés dans la brousse. Claude, qui autrefois avait bataillé au Tonkin, s’était fait l’éclaireur de la caravane. Il avait relevé les traces des fugitifs. La veille, au bord d’un ruisseau, il avait montré à Simplet l’empreinte de deux petits pieds conservée par la terre humide. Sans une parole le sous-officier s’était baissé, et durant de longues minutes, il était resté penché sur ce coin de glaise où Yvonne avait passé.
À la mission, il interrogea les pères. Aux premiers mots, le supérieur, le révérend Eusèbe, l’interrompit. Les voyageurs auxquels il avait parlé répondaient au signalement. Ils allaient vers la rivière Noire, mais lui se faisait fort d’arracher sa proie au voleur hindou. Au jour, il donnerait à Simplet un mot pour le chef Songoï, et à l’aide de ce dernier, Nazir serait bientôt découvert et sa captive rendue à ses amis.
Diana, Claude, sir William, le faux Giraud lui-même se réjouirent de ces déclarations. Le missionnaire indiqua la marche à suivre. Sans armes Simplet partirait de grand matin ; bientôt il serait arrêté par une patrouille muong et se ferait conduire à Songoï. Après, tout marcherait à souhait. Les autres attendraient à l’habitation le retour du jeune homme et de sa sœur de lait.
Tout égayé de pouvoir être utile à ses hôtes, le père Eusèbe voulut leur offrir un verre d’eau-de-vie de riz, distillée à la mission même. Il contait en même temps les luttes quotidiennes pour adoucir les peuplades laotiennes, belliqueuses et méfiantes :
– J’ai soixante élèves actuellement, disait-il, et ce nombre ira sans cesse en augmentant. Du reste, quand ils travaillent bien, je leur donne une récompense à laquelle ils attachent un grand prix. Je vais vous montrer cela.
Et souriant, il ouvrit le tiroir d’un vieux bahut. Les voyageurs ne purent retenir une exclamation étonnée : le tiroir était rempli de boîtes d’allumettes bougies, illustrées en couleur.
– Ces allumettes sont rares, expliqua le père Eusèbe, partant très appréciées. Et même, j’y songe, monsieur Marcel ; mettez-en quelques-unes dans votre poche. Songoï est grand fumeur, il sera sensible à ce léger cadeau !
Bref, il était tard quand chacun gagna sa natte. Tous s’endormirent bientôt bercés par l’espoir d’arracher enfin Yvonne à son ennemi.
Seul Canetègne ne put trouver le sommeil. Mlle Ribor retrouvée, il allait falloir s’occuper d’Antonin, et il tremblait que l’on ne découvrît les mensonges, grâce auxquels il avait voyagé avec ceux dont il complotait la perte.
Comment pourrait-il les entraîner à descendre la rivière Noire, puis le fleuve Rouge, à gagner les territoires où l’administration française agit efficacement, à se jeter enfin dans la « gueule du loup » ? La solution du problème lui parut laborieuse. Ignorant totalement le pays, ses compagnons s’apercevraient vite qu’il les avait trompés, et alors… Les conséquences de sa ruse le faisaient frémir.
Aux clartés pâles de l’aube, l’Avignonnais quitta sa chambre et sortit. Il lui semblait qu’en plein air, ses idées se feraient plus nettes. Dans cette contrée parcourue en tous sens par d’innombrables cours d’eau, les rosées nocturnes sont abondantes. Sous les premiers rayons du soleil, une vaporisation rapide se produisait, et de la terre montaient des vapeurs blanches.
Baigné par ce brouillard odorant, Canetègne-Giraud éprouva une sensation de bien-être. Avec la nuit, le trouble de son cerveau disparaissait. Et marchant à petits pas au milieu des cultures, il combina un plan fort dangereux pour ses adversaires. Il était tout guilleret maintenant. Les mains dans ses poches, le nez au vent, il allait d’une allure conquérante. Il avait trouvé une canaillerie plus forte, plus complète que les précédentes, et une immense satisfaction l’envahissait. Des bouffées d’orgueil – l’orgueil des hommes d’affaires – lui faisaient porter haut la tête et fixer son regard sur le ciel.
Pour avoir marché ainsi, les yeux en l’air, l’astrologue de la fable tomba dans un puits ; Canetègne buta simplement sur une souche qui dépassait le sol et s’étala tout de son long à terre.
Mais ce qui le stupéfia, c’est que soudain un corps opaque s’enroula autour de sa tête, qu’un réseau serré de liens emprisonna ses chevilles et ses poignets ; qu’il fut enlevé, jeté, comme un paquet sur le dos d’un animal qu’à son allure il jugea être un cheval, et enfin, qu’il fut emporté ainsi vers une destination inconnue.
Dans cette position, il s’avoua qu’il était très mal. Décidément l’équitation ne lui réussissait pas. Celui ou ceux qui l’avaient capturé, l’emmenaient à travers la brousse. Des craquements de branches, des contacts pénibles avec des lianes épineuses le lui démontraient surabondamment ; mais qui étaient ceux-là, et vers quel endroit se dirigeaient-ils ?
Voilà ce que le commissionnaire ne put s’expliquer.
Une heure environ il fut ballotté sur son cheval, puis la bête s’arrêta. Un murmure confus parvint aux oreilles de Canetègne, qui fut descendu à terre et débarrassé de la couverture. Le passage brusque de l’obscurité à la lumière l’éblouit. Il ferma les yeux, puis les rouvrit peu à peu. Il était au centre d’une clairière environnée de taillis épais. En face de lui une rivière tumultueuse coulait, coupée de remous qui renvoyaient en gerbes d’éclairs, les rayons de soleil dont ils étaient frappés. Autour de la clairière des Muongs, à la haute coiffure de paille tressée, à la blouse serrée aux flancs par une corde, au pantalon large et court se groupaient de façon pittoresque. De loin en loin, un indigène nu jusqu’à la ceinture, un marteau à la main, demeurait immobile auprès d’un gong attaché à un support recourbé. C’étaient les sentinelles des pirates.

En face du prisonnier, un chef, reconnaissable à l’étendard triangulaire vert qu’un guerrier tenait auprès de lui, considérait Canetègne. Celui-ci se sentit gêné par cet examen. Il détourna les yeux, et soudain son étonnement devint de l’ahurissement. Assis sur un tronc d’arbre renversé, entourés de pirates qui semblaient les garder, le commissionnaire venait de reconnaître Yvonne et le Ramousi Nazir, capturés comme lui-même par une patrouille muong.
Mais presque aussitôt un large rire disjoignit ses lèvres. Ce serait lui, et non Marcel Dalvan, qui tirerait la jeune fille des mains des écumeurs de la brousse. Et s’adressant au chef silencieux :
– Êtes-vous Songoï, demanda-t-il ?
L’indigène eut un geste de surprise, puis se maîtrisant, il fit oui de la tête.
– Bien. Je sors de la mission du père Eusèbe.
Le visage du chef s’adoucit.
– Tu as vu le père ?
– Oui. Et sur son conseil, je venais vers vous, lorsque vos soldats m’ont fait prisonnier.
– Tu venais vers moi. Quel motif te guidait ?
– Quel motif ?
Le négociant hésita un instant. En entendant parler français, Yvonne avait levé la tête ; ses regards s’étaient fixés sur Canetègne, méconnaissable pour elle comme pour ses amis. Alors l’Avignonnais lui adressa un signe de la main et d’une voix forte :
– Je voulais réclamer cette femme, que l’Hindou qui l’accompagne a traîtreusement enlevée.
À ces paroles, Nazir et Mlle Ribor se dressèrent sur leurs pieds ; leurs gardiens firent mine de les saisir ; mais sur un geste de Songoï, ils laissèrent la jeune fille approcher des interlocuteurs.
– Avec mon ami Marcel Dalvan, reprit le pseudo-Giraud, nous les suivons depuis plus de deux mois.
– Tais-toi, ordonna le Muong, laisse-moi rassembler les chefs.
Il poussa une exclamation gutturale, et plusieurs guerriers s’avancèrent vers lui. Leurs armes plus belles, leurs vêtements d’étoffes plus fines indiquaient seuls leur rang. Tous se groupèrent auprès de Songoï. Celui-ci leur dit quelques mots en annamite, et après qu’ils eurent répondu, il se tourna vers l’Avignonnais :
– Tu réclames cette prisonnière. À quel titre ? Est-elle donc ta femme ?
Canetègne et Yvonne se regardèrent. L’intonation du Muong semblait indiquer qu’il était disposé à accéder à la demande de l’Européen.
– Est-elle ta femme ? redit-il encore.
– Oui, firent le négociant et Yvonne en même temps, poussés par la crainte de voir s’évanouir une chance de salut.
– Oui… et elle a été enlevée par l’Hindou qui est là-bas ?
– Parfaitement !
Un court colloque s’engagea entre les chefs, puis tous se mirent à rire et Songoï reprit :
– Tu prétends que ta femme a été enlevée. Or, lorsque mes guerriers l’ont rencontrée, elle était montée sur un cheval, ses mains n’avaient pas d’entraves ; et paisiblement elle suivait l’Hindou. Elle est donc aussi fautive que lui et tu serais obligé de la punir. Nous t’épargnerons cette peine, tu verras comment les Muongs châtient l’épouse fugitive et son complice.
Et comme le négociant stupéfait voulait se récrier, l’ancien tirailleur annamite fit entendre un sifflement strident. Aussitôt des guerriers saisirent Yvonne et Nazir, les garrottèrent étroitement et les couchèrent sur le sol.
– Mais, sapristi ! hurla Canetègne, le père Eusèbe m’a dit…
Songoï ricana.
– Elle sera punie plus cruellement que par toi. Chez nous, on crucifie la femme et celui qu’elle a suivi. Sur un radeau, les pieds et les mains traversés de fortes chevilles, ils sont abandonnés au cours du fleuve. Ceux qui les voient passer les injurient, car ils connaissent la justice du Laos ! D’ailleurs c’est le vœu du conseil des chefs. Garde le silence, car tes protestations entraîneraient peut-être mes amis à te sacrifier. Tu es un blanc, de la race de leurs ennemis. Je n’ai pu encore leur faire comprendre que les Français sont les bienfaiteurs du pays.
Yvonne avait entendu. Elle eut une plainte déchirante, et le négociant terrifié, ne put que bredouiller :
– Mille regrets… je voulais vous sauver… ces gens sont des sauvages.
Il était profondément troublé. Le supplice atroce qui se préparait le remplissait d’épouvante. Certes, il eut ruiné sans scrupule vingt familles, réduit à la misère des femmes, des enfants ; mais de jongler avec le code, à crucifier quelqu’un, il y a un abîme. Un bourreau peut avoir plus de sensibilité vraie, plus de courage qu’un agent d’affaires. Il est moins cruel de faire couler du sang que des larmes ; mais le procédé est plus brutal.
Pourtant une idée le calma. Ces Muongs en somme travaillaient dans son intérêt. Ils supprimaient Yvonne, si dangereuse pour sa tranquillité. Dans ce meurtre il n’était pour rien.
– Morte la bête, murmura-t-il, mort le venin. C’est le hasard qui décide en ma faveur.
Sur cette réflexion, il s’adossa à un arbre, à la limite de la clairière, et regarda les préparatifs du supplice.
Yvonne aussi, d’un œil avide, suivait les mouvements de ceux qui allaient la torturer. Déjà des guerriers avait abattu des arbres de moyenne taille. Ils les ébranchaient, puis les attachaient au moyen de lanières d’écorce. Le radeau qui emporterait les condamnés prenait forme. La jeune fille frissonnait de tout son être. La terreur faisait entrechoquer ses dents. Elle songeait que dans un instant, elle serait couchée sur le grossier esquif, que ses pieds, ses mains seraient déchirés par des clous, et puis le courant de la rivière l’emporterait agonisante, appelant la mort qui, pendant des heures, se ferait attendre.
Et tout à coup, sa pensée retourna à Marcel ; Marcel qui était arrivé à quelques kilomètres d’elle ; Marcel qui s’était acharné à sa délivrance. Il avait donc pour elle autant d’affection qu’elle en ressentait pour lui.
Mais à quel moment affreux lui venait cette idée heureuse ? Elle allait mourir ! À l’heure où la vie lui semblait plus lumineuse, plus exquise, elle allait tomber sous les coups des indigènes, et durant sa longue souffrance, dans l’horreur de ses membres brisés, sous l’ardeur brûlante du soleil, au milieu du vol affamé des moustiques attirés par le sang, elle songeait, ironie amère de la fatalité, qu’elle aurait pu connaître le bonheur !
Son cœur se contractait avec force révolte physique contre le destin ; des larmes roulaient sur ses joues blêmies. Elle avait la sensation d’un brusque effondrement, et dans son crâne résonnaient les coups de maillet des sinistres ouvriers qui préparaient son supplice.
Le bruit cessa. Des guerriers la soulevèrent, la portèrent contre un arbre au tronc duquel ils l’attachèrent. Soutenue seulement par ses liens, paralysée par l’excès même de sa terreur, elle assista comme en rêve, à un effroyable spectacle. Le Ramousi hurlant, écumant, fut jeté sur le radeau placé au bord de la rivière et qu’un faible effort mettrait à flot. Maintenu par les Muongs, les bras en croix, il fut réduit à l’immobilité.
Puis l’écho d’un marteau frappant sur un coin de bois, un rugissement poussé par le patient, puis plus rien. Une main du Ramousi traversée, saignante, était fixée aux poutres du pilori flottant. Trois fois encore les mêmes sons parvinrent aux oreilles de Mlle Ribor. Les bourreaux se relevèrent, démasquant le crucifié, et d’un pas lent marchèrent vers elle.
Son tour était venu. Malgré elle, sa bouche s’ouvrit pour une clameur rauque, éperdue. Ses membres se tordirent pour briser les entraves, ses yeux cherchèrent un défenseur. Elle ne vit que les faces jaunes, diaboliques des Muongs, et à vingt pas d’elle, accroupi à terre, la figure cachée dans ses mains, l’inconnu qui avait tenté de la délivrer. L’un des exécuteurs lui appuya lourdement la main sur l’épaule. Elle eut un soubresaut, et de nouveau, elle lança un cri faussé, déchirant, sinistre, extra humain de bête hurlant à la mort. Cette fois une voix répondit. Dans le taillis vibra un rauquement prolongé. Les Muongs s’écartèrent, la frayeur peinte sur le visage :
– Garou, dirent-ils, garou !
– Le tigre, répondit Songoï.
Plus rapproché le terrible rauquement éclate de nouveau. Évidemment le fauve se hâte. Il a senti la proie assurée. Il accourt. Les pirates s’enfuient, plongent dans le taillis. Le faux Giraud veut les suivre, mais il est loin d’avoir leur agilité. Un ébénier est à sa portée, lançant des branches à portée du sol. Il grimpe, il grimpe toujours plus haut et disparaît dans le feuillage.
Yvonne liée, Nazir râlant sont seuls au milieu de la clairière désertée.
Des craquements éclatent sous bois, et des buissons brusquement éventrés jaillit un tigre royal aux yeux flamboyants, à la gueule formidable. L’animal aperçoit Yvonne. L’immobilité de la jeune fille terrifiée l’inquiète. Il s’arrête. Il se rase et lentement, le ventre contre terre, il rampe vers elle.
Les prunelles dilatées, Mlle Ribor ne perd pas un mouvement du félin. Elle voudrait détourner la tête, elle ne le peut pas. Le fauve la fascine. Elle contemple ses dents meurtrières, ses griffes acérées qui, à chaque pas, égratignent le sol. Le tigre se rapproche. Deux mètres le séparent à peine de sa victime ; il a un ronron terrible et joyeux, auquel la jeune fille répond, sans savoir ce qu’elle dit, par un appel étouffé :
– Simplet ! Simplet !
Elle obéit à cet instinct qui, dans le péril, nous pousse à appeler ceux qui nous ont le plus chéris.
Mais que se passe-t-il ? Est-elle déjà folle ? Il lui semble que, tout près d’elle, les buissons s’abattent brisés pour livrer passage à un homme, et cet homme au visage griffé par les ronces, aux vêtements déchirés, elle croit le reconnaître. C’est celui à qui elle demandait secours. C’est Marcel.
Non, elle ne se trompe pas. Son frère de lait, parti de la mission avec une lettre du père Eusèbe, a entendu ses plaintes. Il a foncé à travers le hallier. Il bondit dans la clairière. Il voit le péril et se jette entre Yvonne et le tigre. Surpris, le féroce animal recule, mais la colère brille en ses yeux, sa queue bat ses flancs.
– Nom d’un chien, murmure le jeune homme, je n’ai pas d’armes. Ce satané père Eusèbe me les a fait laisser à la mission.
– Fuis, ordonne Mlle Ribor qui a entendu, fuis, je ne veux pas que tu meures pour moi. Je ne le mérite pas.
Le tigre a fait un pas en avant. Il se ramasse. Il va bondir, renverser en tempête fauve ses ennemis désarmés.
– Adieu, Simplet, pardonne-moi, gémit Yvonne.
Mais Dalvan a relevé la tête :
– Je n’y pensais pas, c’est pourtant simple, tous les animaux sauvages ont peur du feu.
Tout en parlant il saisit une des boîtes d’allumettes bougies que lui a confiées le père Eusèbe, enflamme d’un coup son contenu et le jette à la face du tigre.
Un hurlement répond à son geste. Les allumettes retenues par les poils, flambent sur le mufle du carnassier. Aveuglé par la flamme, affolé par la brûlure cuisante du phosphore, l’animal tourne en cercle, avec des rauquements plaintifs. Il lance les pattes en avant pour se débarrasser de l’ennemi inconnu qui le torture.
– Vite, reprend Simplet, filons.
En un tour de main il a détaché Mlle Ribor. Il l’emporte dans ses bras.
– Un radeau, s’écrie-t-il, c’est le salut.
D’un vigoureux effort, il pousse dans l’eau l’esquif ou râle l’Hindou crucifié. Il y prend place avec Yvonne, et d’une poussée le lance dans le courant, tandis que son fauve adversaire continue à bondir désespérément et à faire retentir la forêt d’effroyables rugissements.
Saisi par les remous, le radeau s’éloigne en tournoyant. La clairière reste en arrière. Sur chaque rive la forêt élève un mur de verdure. Accroupie au milieu du plancher, Yvonne ne prononce pas une parole. Après tant de secousses, elle est comme hébétée. Une grande lassitude pèse sur elle. Elle ferme les yeux, elle dort. Et pendant ce temps, Marcel dispose à l’arrière une sorte de godille, afin de diriger un peu l’embarcation ; cela fait, il songe au Ramousi qui vient de rendre le dernier soupir ; il ne veut pas qu’au réveil, Mlle Ribor aperçoive le cadavre de son ravisseur ; mais vainement il essaie d’arracher les coins enfoncés dans les pieds et les mains de Nazir. Il faudrait des outils spéciaux pour cette opération. Alors il va s’asseoir à l’arrière, auprès du gouvernail qu’il a improvisé. Les heures passent. Nulle part, il ne voit une berge favorable à un débarquement. La rivière coule entre des rochers couronnés d’épaisses végétations. Il semble même que son lit se resserre, que son courant s’accélère.
– Diable ! se dit le sous-officier, est-ce que nous arriverions à des « rapides ? »
À ce moment, Yvonne rouvre les yeux. Son regard étonné se fixe sur Marcel. Elle lui sourit. Il y a tant de tendresse dans ses prunelles que le jeune homme reste saisi. Lui aussi contemple sa sœur de lait enfin reconquise. Ils demeurent ainsi, sans une parole, sans un geste, abîmés dans la joie de se revoir.
Un choc les rappelle à eux-mêmes. Le radeau s’est engagé dans un étroit couloir rocheux où les eaux s’engouffrent avec violence. Çà et là, au milieu de tourbillons d’écume, des pierres noires parsèment le lit de la rivière. Le plancher flottant file rapide comme une flèche. S’il se heurte contre un rocher, il se brisera.
– Un rapide, murmure Simplet subitement pâli.
Yvonne a compris. La mort les guette au fond des eaux mugissantes. Soudain son visage s’éclaire, elle se traîne auprès de Simplet qui, cramponné à la godille, cherche à gouverner entre les écueils. Elle est près de lui maintenant, elle le regarde avec une larme dans les yeux.
– Simplet, dit-elle d’une voix tremblante.
Il se tourne vers elle :
– Petite sœur ?
– La mort est autour de nous. Il faut que tu me pardonnes mes dédains ridicules, mon injustice. Simplet ! si nous échappons au péril, veux-tu de moi pour femme, pour servante ?
Marcel hésite à répondre. Il se souvient de l’aveu surpris sur la colline Fady, pendant le sommeil de sa compagne. Mais l’attitude de la jeune fille, ses yeux humides implorent.
– Toi, n’as-tu jamais songé à un autre ?
– Moi ?… oh ! le peux-tu penser. Sans savoir, j’ai été éprise par ton courage, ta bonté, ta gaieté. Déjà quand nous fuyions Antananarivo, à Madagascar, ma pensée t’appartenait.
Il ferme les yeux. C’était de lui qu’elle rêvait dans la nuit tiède ; c’était de lui-même qu’il s’était senti jaloux.
Une secousse épouvantable se produit. Le radeau a touché ; les madriers se disloquent. Les jeunes gens roulent dans l’eau bouillonnante, et les lames au panache d’écume s’enroulent autour d’eux ainsi que des linceuls, dans l’assourdissant fracas du rapide.

XXXI
LA REVANCHE DE GIRAUD-CANETÈGNE
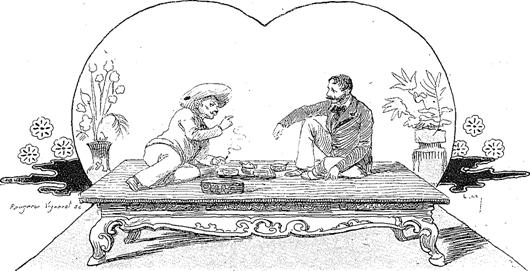
Sur la rive droite du canal de Song-Tam-Bac qui relie le port tonkinois d’Haï-Phong à Hanoï, s’élève, à peu de distance de la mer, un délicieux pavillon, dont chaque étage prolongé en véranda fait aux appartements une ceinture d’ombre. Des rampes de bois, ouvrées avec fantaisie, s’étendent entre les colonnettes qui supportent les balcons. Des cocotiers, des bambous hauts de dix mètres, des manguiers croissent dans le jardin, mêlant leurs panaches, leurs tiges élancées, leurs dômes de verdure.
Dans l’après-midi du 12 octobre, sur le balcon du premier étage, d’où l’on découvre le canal bordé de docks, d’établissements des messageries maritimes et fluviales, de comptoirs d’armateurs, deux hommes étaient assis « à l’annamite », c’est-à-dire sur une grande table carrée aux pieds courts. Devant eux de minuscules tasses de porcelaine et une théière fumante. L’un était M. Corbin, suppléant du résident-maire d’Haï-Phong ; l’autre était M. Canetègne.
– Comme je vous l’expliquais, fit ce dernier continuant une conversation commencée, je désire simplement « frimer une arrestation. ». Prise de peur, Mlle Yvonne Ribor consent à m’épouser, et vous m’avez rendu un immense service.
M. Corbin eut une moue dubitative.
– Est-ce un service vraiment ?
– Certes.
– Pourtant le mariage, surtout avec une femme que l’on contraint, me paraît la plus funeste des expériences.
– Oh ! les jeunes filles, cela ne sait pas.
– Du reste, monsieur Canetègne, je vous suis tout acquis. Ce soir même, ainsi que vous le désirez, cette personne et son compagnon, Marcel Dalvan, n’est-ce pas ? seront arrêtés. Seulement si vous êtes malheureux en ménage, souvenez-vous que vous avez insisté.
– Croyez à ma reconnaissance.
Sur ces mots, le commissionnaire descendit de la table, et après une vigoureuse poignée de mains, prit congé de M. le suppléant du Résident. Il était ravi.
À la mission du père Eusèbe, il avait apporté la nouvelle de la fuite de Marcel et d’Yvonne en radeau. Claude, Sagger et miss Diana avaient aussitôt gagné la rivière Noire, et à trois jours de marche, dans un poste avancé de tirailleurs tonkinois, ils avaient rejoint les jeunes gens miraculeusement tirés du rapide par les petits soldats jaunes.
Moyennant quelques pièces d’or, Canetègne avait décidé un indigène à assurer à ses amis qu’il avait vu Antonin Ribor, et que celui-ci avait descendu le fleuve vers Haï-Phong. Voilà comment tous se trouvaient réunis à l’hôtel français de la ville, attendant l’arrivée du Fortune, au capitaine duquel l’Américaine avait télégraphié à Saïgon. Car le pseudo-Giraud s’était procuré un second faux témoin, lequel avait juré que le frère d’Yvonne avait quitté le Tonkin, se dirigeant vers les possessions françaises du Pacifique. Maintenant, en déguisant quelque peu la vérité, il s’était assuré le concours de M. Corbin, chargé des fonctions de résident, en l’absence du titulaire, et qui croyait tout bonnement faire une action louable.
À l’hôtel, il trouva Yvonne et Simplet en grande conférence avec Sagger. L’intendant leur disait les mœurs tonkinoises, la famille unie, le respect du père, et surtout le culte des ancêtres. Il vantait la douceur, le courage des naturels aux formes frêles et gracieuses, que des voyageurs grincheux ont injustement appelés « bêtes jaunes. »
Aussi souriant que s’il ne venait pas de commettre une trahison, l’Avignonnais se mêla à la conversation, débita un certain nombre de lieux communs sur l’opium, la cuisine, le théâtre, la musique indigènes et finit par s’enquérir de miss Diana.
Elle était sortie avec Claude Bérard. À cette heure, tous deux étaient assis sous un énorme banian, au bord de la rivière Cua-Cam, qui ferme le triangle formé par la côte et le canal Song-Tam-Bac, dans lequel est enfermée la ville. Ils gardaient le silence. Depuis que l’activité du « Marsouin » n’était plus occupée par les dangers sans cesse renaissants, il était triste, et par un phénomène bizarre, sa mélancolie se reflétait sur le visage de sa compagne. Tout à coup, Diana sembla prendre un parti :
– Monsieur Claude, dit-elle.
– Mademoiselle.
Bérard leva la tête. L’Américaine le regardait bien en face, de ses yeux clairs et francs.
– Monsieur Claude, reprit-elle, si je vous ai proposé une promenade, c’est que j’avais à vous dire des choses sérieuses. Ne m’interrompez pas, je ne saurais plus. Mon courage ne demande qu’à s’échapper. Ainsi écoutez-moi, sans parler… Vous répondrez après.
Il fit signe qu’il obéirait.
– Bien. Ne me regardez pas non plus. Mes idées s’embrouillent alors. C’est cela. Je commence. C’est vous qui m’avez appris qu’il existe des gens d’une autre race que les courtisans de l’argent. Ne faites pas de gestes, je vous en prie. C’est vous, je dis. Alors vous m’avez paru un être rare. Je vous ai observé. Je vous ai vu sincère, bon, loyal. Si ! si ! ne protestez pas ; vos amis aussi, du reste. Et je suis devenue votre amie, ou du moins j’ai cru la devenir.
Il eut un mouvement brusque, mais elle l’arrêta :
– Non, non. Je n’ai pas encore fini. Un jour, celui où nous avons visité Chandernagor, j’ai causé avec M. Marcel, et j’ai compris que la fortune, enviée de tant de gens, peut être un obstacle au bonheur.
Et avec un léger tremblement dans la voix, elle poursuivit :
– Oui ; je l’entretenais d’un homme vers qui s’en était allée toute mon affection, et lui me répondit : Faites-lui oublier que vous êtes riche, sans cela il a trop de fierté pour avouer sa tendresse.
Claude s’était penché en avant, les mains crispées sur son visage.
– J’ai essayé, continua l’Américaine, je n’ai pas pu, sans doute. Il m’évite, il semble souffrir de ma présence, et pourtant il est injuste. Dois-je être punie parce que je suis riche ? Est-ce ma faute si mon père a amassé des millions ? J’ai réfléchi, et j’ai pensé qu’un honnête homme ne pourrait me faire un crime de ce que les autres considèrent comme une vertu. Seulement il est fier, il se taira toujours. Alors, comme il ne viendra pas à moi, je me suis déclaré que j’irais à lui. C’est pour cela, monsieur Claude que je vous demande si, vos amis revenus en France avec le papier qu’ils cherchent, vous voudrez de moi pour femme.
Sa voix avait faibli sur ces derniers mots. Évidemment sa provision de courage était épuisée. Lui, avait relevé le front ; il la contemplait, et tout à coup il lui prit la main, la porta à ses lèvres et éclata en sanglots. Le soldat énergique était sans force devant la joie.
Lorsque les promeneurs rentrèrent à l’hôtel, le rayonnement de leurs visages frappa tout le monde. Simplet les considéra avec attention, puis doucement :
– Vous êtes heureux, aussi ?
Ils rougirent sans répondre.
– À la bonne heure donc. Vous le voyez, miss Pretty, c’était bien simple, il suffisait de prouver que vous êtes un ange.
Puis changeant de ton :
– Nous dînons au champagne, n’est-ce pas ? C’est le seul vin qui convienne un jour de fiançailles.
Tandis qu’il allait donner les ordres nécessaires, les jeunes filles se retirèrent à l’écart. Elles causaient à voix basse, mais à leurs yeux brillants, à leurs joues animées d’une buée rose, il était facile de deviner qu’elles échangeaient de gracieuses confidences.
La petite Française oubliait ses soucis, l’Américaine sa misanthropie. Le soleil était sur elles, jetant son poudroiement d’or sur les misères de la vie prosaïque. Un peu craintives encore, elles se disaient la poésie étrange du rêve.
Le dîner fut d’une gaieté intense. Yvonne regardait Simplet, Claude regardait Diana, et tous riaient sans cause, ou plus exactement à cause de leur bonheur intime.
Giraud-Canetègne fit bien parfois la grimace, mais ces marques de mécontentement étaient trop fugitives pour être remarquées.
– Rira bien qui rira le dernier, se déclarait-il à lui-même pour combattre sa méchante humeur, je vous tiens, mes tourtereaux ; que m’importent vos clignements d’yeux attendris et vos vagues sourires.
Le repas touchait à sa fin. On venait de servir une délicieuse gelée d’algues marines, de gélidium spiriforme, plat exquis du pays, quand un bruit d’armes se fit entendre dans le vestibule de l’hôtel. C’étaient des froissements d’acier, des chocs de crosses de fusils sur le plancher. Dans la salle commune, tous les dîneurs tournèrent la tête vers l’entrée, et à leur grande surprise, virent apparaître un employé de la Résidence, accompagné par plusieurs miliciens indigènes, reconnaissables à leur chapeau rond en forme d’assiette et aux parements jaunes de leurs vareuses bleues.
– Que personne ne bouge, ordonna l’employé que suivait la troupe.
Et d’une voix forte :
– Monsieur Marcel Dalvan ; Mademoiselle Yvonne Ribor ; veuillez approcher.
Les jeunes gens obéirent. Aussitôt les miliciens les entourèrent.
– Que signifie cette agression ? commença Simplet tout interloqué…
Mais le commis de la Résidence lui coupa la parole :
– Pas de scandale. Vous vous expliquerez devant le tribunal. À la requête de M. Canetègne et en exécution d’un jugement de la Cour de Lyon (France), je vous arrête.
– Canetègne ! répéta Simplet atterré.
– Canetègne ! gémirent en écho ses amis.
Ce nom abhorré tombant au milieu de leur joie leur enlevait toute énergie, toute présence d’esprit. C’était l’abîme ouvert tout à coup sous leurs pas, c’était la défaite, c’était peut-être la séparation éternelle pour ces êtres aimants et dévoués, qui avaient troqué leurs âmes dans le tourbillonnement des rapides de la rivière Noire.
Et quand ils eurent disparu, entraînés par les miliciens, Claude s’adressant à Diana, à Sagger, au faux Giraud, s’écria :
– Mes amis, il faut que nous trouvions ce Canetègne, pour régler une bonne fois nos comptes avec lui.
Ce à quoi Canetègne répondit comme les autres :
– Oui, il faut à tout prix se débarrasser de ce misérable !
On tint conseil. Giraud-Canetègne eut l’audace ironique de faire la proposition suivante :
– Mes amis, dit-il, votre ennemi vous connaît tous ; moi, il m’ignore. Je vais donc me mettre en faction aux environs de la Résidence. Il y viendra sûrement pour connaître l’effet de ses manœuvres. Il ne se défiera pas de moi, inconnu. Je le suivrai, je découvrirai sa retraite…
– Et nous lui rendrons visite, acheva Claude. Bravo !
– Vous, de votre côté, obtenez la permission de voir les prisonniers. Il est bon de rester en relations avec eux.
Le soir du lendemain le « Marsouin » avait l’autorisation demandée. Quant à Giraud, il rentra naturellement sans avoir aperçu Canetègne. Le négociant s’amusait énormément. Cette intrigue, où il jouait le double rôle d’ami et d’ennemi, lui plaisait. Dans le coquin s’agitait une âme de vaudevilliste.
Le 14, Diana, appuyée au bras de Bérard, se rendit à la prison. On les conduisit dans la cellule d’Yvonne. La jeune fille pleurait. En les reconnaissant, elle se jeta dans leurs bras et d’une voix douloureuse :
– Mes chers et bons amis, je suis perdue !
Et comme ils essayaient de lui rendre le courage :
– Vous ne savez pas, vous. Le directeur de la maison d’arrêt sort d’ici. Il m’a déclaré que l’on surseoirait cinq jours à me livrer à la justice.
– Pourquoi ?
– Pour me laisser le temps de réfléchir.
– Réfléchir. Je ne comprends pas.

Elle se tordit les mains et rougissante, comme honteuse de ses paroles :
– M. Canetègne est obstiné dans ses désirs. Il tient toujours à m’épouser, et le répit que l’on m’accorde est destiné à me permettre d’accepter.
– Oh ! vous refuserez ! fit l’Américaine.
Yvonne courba la tête :
– Je ne sais pas.
Du coup, miss Pretty eut un geste indigné. La prisonnière l’arrêta :
– Certes ! Cela a été ma première pensée, mais en me donnant le temps de la réflexion, notre ennemi savait bien ce qu’il faisait. En refusant, je condamne Marcel ; je le déshonore, lui qui n’a pas hésité à me sacrifier sa vie et sa petite fortune.
Puis avec une résignation, dont ses auditeurs se sentirent profondément émus :
– C’est mon tour de me dévouer. À moi maintenant le sacrifice. Je n’ai pas le droit de me soustraire au devoir. Lui, parmi des voleurs et des criminels. Lui, privé de l’honneur, le seul bien qui lui reste. Non, non, jamais. Au fond de sa pensée, une question funeste se dresserait si j’hésitais : quelle affection égoïste était donc celle d’Yvonne, se dirait-il ? Et il aurait raison. Que mon rêve heureux s’envole, que mon cœur se brise, mais qu’il soit libre, honoré comme il mérite de l’être.
À son tour, Diana courbait le front. Elle restait devant la captive muette, les yeux fixés à terre. Yvonne avait dit vrai ; il était juste qu’elle s’immolât. Mlle Ribor devina ce qui se passait en elle :
– Vous êtes de mon avis, n’est-ce pas ? conclut-elle d’une voix brisée.
– Oui et non, gronda Claude. Il vous reste encore trois jours.
– Trois jours !
– Attendez qu’ils soient écoulés pour prendre une décision. Qui sait si d’ici là, il ne se sera pas produit un miracle.
Yvonne secoua désespérément la tête :
– Simplet n’est pas libre. Aussi je n’espère plus.
Nul ne releva ce que cette réponse pouvait avoir de blessant pour les visiteurs. Ils se rendaient compte de la situation de leur interlocutrice, et ma foi, ils lui donnaient raison. Marcel était l’âme de la troupe. Toujours et partout, il avait trouvé la solution simple, pratique, des complications les plus dangereuses. Au départ, Yvonne le trouvait bien petit garçon ; mais aujourd’hui elle ne comptait que sur lui. Et Claude traduisit l’impression générale.
– C’est positif ! S’il était avec nous, il aurait déjà trouvé un moyen de tout arranger. Enfin, reprenez courage. Il n’est pas possible que les canailles réussissent à mettre les honnêtes gens dans la peine.
Mais en dépit de ces paroles, le « Marsouin », après une rapide visite à Dalvan, quitta la prison sans espoir de sortir de la trame ourdie par l’Avignonnais. Très soucieux, il regagna l’hôtel avec miss Pretty pensive et découragée comme lui. Mais en arrivant, ils se trouvèrent face à face avec le faux Giraud dont le visage était rayonnant :
– Victoire ! leur dit celui-ci, je sais où est le Canetègne ?
Les yeux du « Marsouin » lancèrent des éclairs.
– Allons-y !
– Non.
– Comment non ?
– Asseyez-vous et écoutez-moi, répliqua le commissionnaire.
Ils obéirent, dominés par le ton net dont il avait parlé.
– Ce matin, reprit-il, j’étais en observation devant la Résidence. Soudain j’en vois sortir un « petit lettré » de quinzième classe, à globule de laque. Je le reconnais. C’était le secrétaire du mandarin, gouverneur du bourg de Thuy-Shang, avec lequel j’ai été en relations courtoises, lors d’un voyage précédent, et qui m’a offert le sel et le riz.
– Le sel et le riz ? questionna miss Pretty.
– Oui, c’est ainsi que l’on vous déclare hôte sacré et ami.
– Bien, bien. Continuez.
– L’animal – je parle du secrétaire – est prétentieux en diable. Alors que les grands lettrés portent les ongles de dix centimètres en des étuis de bois, il enferme les siens en des dés d’argent qui n’ont pas moins de deux décimètres.
– Cela doit lui faire de jolies mains ?
– Atroces, mais cela donne droit au respect des illettrés. J’aborde mon homme. J’apprends qu’il est en mission à Haï-Phong pour le compte d’un hôte de son mandarin, auquel il doit rapporter une réponse.
– Ah ! firent les jeunes gens très intéressés par le récit.
– Vous devinez. L’hôte est M. Canetègne.
– Le coquin est à Thuy-Shang !…
Bérard s’était levé.
– Où allez-vous ? demanda Giraud.
– À Thuy-Shang, donc.
– Gardez-vous-en bien. Vous êtes tous signalés. Aucun de vous n’entrerait dans le bourg.
– Jour de Dieu ! gronda le sous-officier, que faire alors ?
– Je vais vous le dire.
Giraud était souriant, ses yeux pétillaient de malice.
– Je vais vous le dire, répéta-t-il. Vous savez que les mariages sont célébrés devant le Résident ou son suppléant, faisant fonctions de maire.
– Oui.
– Ce personnage n’a jamais vu M. Canetègne, puisque le secrétaire, que je vous ai portraicturé, a négocié seul toute l’affaire dont nos amis sont victimes.
– Compris ; allez, allez toujours.
– Donc, le Résident unirait Mlle Ribor à quiconque se présenterait sous le nom de Canetègne. Il suffit de substituer à celui-ci une autre personne. Le mariage est nul, vu la substitution, mais les prisonniers sont libres.
Et comme les jeunes gens esquissaient un geste de surprise :
– Demain, vous irez à la prison. Vous direz à Mlle Yvonne d’accepter. Le secrétaire en sera avisé aussitôt et retournera à Thuy-Shang. Je partirai avec lui. Je ferai en sorte que M. Canetègne ne se rende pas à la cérémonie. Je le remplacerai, si vous y consentez et le tour sera joué.
Claude se mit à rire de bon cœur. Mais Diana restait pensive :
– Êtes-vous certain de retenir ce vilain homme ? demanda-t-elle enfin.
– Absolument. Je veux bien vous dévoiler mon moyen. Il y a dans le pays une plante à larges feuilles que les indigènes nomment l’ara-poutra. On la fait infuser. Quelques gouttes de la liqueur ainsi obtenue, mélangées à la boisson d’un homme, déterminent chez lui une fièvre violente accompagnée d’une éruption cutanée.
Le visage de l’Américaine s’éclaira :
– Il est fâcheux de plaisanter ainsi avec le mariage, déclara-t-elle, mais le but à atteindre est louable, et pour ma part, j’approuve votre plan.
– Moi aussi, s’écria Bérard.
– Alors, à demain l’ouverture des hostilités ; dînons.
Giraud était d’une humeur charmante et pour cause. Ses adversaires se mettaient eux-mêmes à sa merci. Grâce à sa combinaison, il épouserait Yvonne. Une fois le mariage célébré, il n’avait plus rien à craindre. Elle était bien et dûment sa femme. Il avait peine à contenir son envie de rire en songeant à la « tête » que feraient les voyageurs, lorsqu’ils s’apercevraient qu’ils avaient été « roulés à fond ».
Tout se passa comme il avait été convenu. Yvonne, stylée par ses amis, déclara au Directeur de la prison qu’elle consentirait à épouser M. Canetègne ; le mariage lui paraissant préférable à la captivité.
Le Résident fixa au 26 octobre la date de l’hymen, et le soir du 15, le négociant vint prendre congé de miss Pretty et de ses compagnons, sous couleur d’accompagner le secrétaire du mandarin de Thuy-Shang, lequel, on l’a deviné, n’existait que dans son imagination. En réalité, il s’enferma dans une cahute du quartier indigène, attendant l’heure de recueillir le fruit de sa ruse.
Le 16, le Fortune fit son entrée dans la baie d’Along, qui sert de port à Haï-Phong, et Diana donna l’ordre au capitaine Maulde d’être prêt à partir le 26 dès la première heure.
Longues furent les journées qui suivirent. Chaque matin, Claude et miss Pretty, parfois aussi William Sagger, visitaient Yvonne et Marcel. Ceux-ci, d’abord un peu inquiets, s’étaient familiarisés avec l’idée du faux Giraud. Simplet la déclarait excellente. Cette substitution de marié lui semblait une trouvaille. Vaincre Canetègne avec ses propres armes ; trouver la délivrance dans le moyen même qui devait enchaîner ses victimes, n’était-ce pas plaisant et bien propre à exciter la verve gouailleuse du sous-officier.
Enfin, le soleil se leva sur le vingt-sixième jour du mois. Yvonne et Marcel furent extraits de leur prison et conduits à la Résidence, où leurs amis les attendaient déjà. Giraud, en grande tenue, était arrivé bon premier.
Il avait annoncé à Claude que sa ruse avait complètement réussi, et qu’il était venu à Haï-Phong, chargé par Canetègne d’informer le Résident de son indisposition subite.
– Je devais faire reculer le mariage, avait-il ajouté. Je trahis la confiance de ce pauvre homme. Je lui ai subtilisé tous ses papiers.
Sans doute la trahison ne pesait point à sa conscience, car il rayonnait. Claude, croyant à la sincérité de sa joie, lui serra la main avec effusion.
– Monsieur Giraud, nous n’oublierons jamais ce que vous faites aujourd’hui pour nous.
– J’en suis sûr, monsieur Bérard, et c’est ce qui double mon contentement.
Le « Marsouin » ne remarqua pas de quel ton étrange le commissionnaire avait prononcé ces mots, car au même instant, les prisonniers, entourés de gardes civils indigènes, faisaient leur apparition.
Presque aussitôt, le Résident prévenu de leur arrivée pénétra dans la salle. D’un ton monotone, il lut les obligations réciproques des époux, puis d’une voix claire, il demanda :
– M. Canetègne, Isidore, Louis, Fulcrand, consentez-vous à prendre pour épouse Mlle Ribor, Yvonne, ici présente ?
– Oui, répondit le pseudo-Giraud.
– Et vous, Mlle Ribor, consentez-vous à prendre pour époux M. Canetègne, ici présent ?
Avec un vague sourire, la jeune fille murmura :
– Oui.
– Je vous déclare donc unis en légitime mariage. Veuillez signer sur le registre.
Il y eut une minute de brouhaha. Les mariés, leurs témoins : Marcel et Claude pour Yvonne, William Sagger et le capitaine Maulde pour Canetègne, apposèrent leurs griffes sur le registre.
Le mariage était consommé.
L’Avignonnais dut se tenir à quatre pour ne pas crier son triomphe. Yvonne était à lui. Désormais, il se souciait d’Antonin Ribor, comme de sa « première culotte ». Ses adversaires étaient des quantités négligeables.
Séance tenante, tandis que les prisonniers rendus à la liberté quittaient la Résidence avec leurs amis, il se fit délivrer une copie de l’acte de mariage, en même temps que le livret de ménage dont la municipalité d’Haï-Phong a été pourvue. Ce qui, au reste, arracha au négociant cette exclamation :
– Et on prétend que l’Administration ne fait rien pour les colonies.
Muni de ces papiers, il rejoignit la bande joyeuse qui se dirigeait vers le canal du Song-Tam-Bac. Avec tout le monde, il s’embarqua sur un « sampang » que les rameurs tonkinois firent voler sur l’eau. On le plaisantait. Yvonne l’appelait en riant : mon mari. Il laissait dire, s’amusant plus que personne. Comme le chat qui joue avec la souris, il lui plaisait de laisser les jeunes gens dans leur erreur. Il éprouvait un plaisir cruel à les voir gais, confiants, illusionnés de liberté, alors qu’il n’avait qu’à dire une parole pour les désespérer. Il comptait rester muet jusqu’au soir, et à l’issue du dîner, il ménageait un coup de théâtre.
Des gardes civils entreraient dans la salle de l’hôtel où le banquet aurait lieu. Il se démasquerait, et sous bonne escorte, sa femme serait conduite dans l’habitation qu’il avait louée à cet effet. D’avance il s’esbaudissait de la consternation des assistants. À part lui, il murmurait, reprenant pour une minute son accent méridional :

– Té, les pitchouns verront qu’ils ne sont pas de force !
Sa surprise fut vive lorsque le sampang déboucha dans la baie d’Along. À deux encablures se profilait le Fortune, prêt au départ, ses cheminées fumantes.
– Où allons-nous ? demanda-t-il.
– Au Fortune, répondit miss Pretty. Après notre équipée, le mieux est de fuir ce pays. M. Antonin Ribor, d’ailleurs, a pris le chemin des stations françaises du Pacifique, nous le suivrons.
Le négociant ne trouva pas un mot à dire. Il ignorait les disposions prises en son absence.
– Je suis joué, murmura-t-il ?
Puis reprenant son sang-froid.
– Joué…, pour le moment. Sur la première terre Française, je réclame, manu militari, mademoiselle ma femme.
L’embarcation accostait. Se contraignant à faire bon visage à mauvaise fortune, Canetègne monta sur le pont du yacht, et tandis que le sampang, vide de ses passagers, regagnait Haï-Phong, le capitaine Maulde, debout sur la passerelle, faisait entendre le commandement.
– Go ahead !
Le steamer se mit aussitôt en marche. À l’arrière, Yvonne et Simplet regardaient fuir la terre.
– Comme nous avons souffert là, dit-il doucement.
– Oui, mais c’est là, Simplet, que j’ai su ton affection. Aussi j’ai une tristesse à quitter ce pays.
– Chère Yvonne !
À deux pas d’eux, Canetègne, masqué par une caisse, écoutait. Il eut un sourire rageur :
– Flirtez, mes gaillards, gronda-t-il, flirtez. Bientôt vous aurez de mes nouvelles.
La côte disparut peu à peu à l’horizon, et le yacht fendit les flots courts du golfe du Tonkin, emportant à son bord cet étrange ménage composé d’une épouse, ignorante de la réalité de son union, et d’un mari, auquel les circonstances défendaient de prendre son titre.
XXXII
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Après vingt jours de navigation, ayant entrevu les îles Luçon, Bornéo, Nouvelle-Guinée et les groupes français des îles Loyauté et Nouvelles-Hébrides, le Fortune stoppa en dehors de la passe Dumbea qui coupe la chaîne de récifs qui entoure la Nouvelle-Calédonie, en face de Nouméa. Le navire n’entrait pas dans le port. Les événements récents avaient démontré la nécessité de la prudence à ses passagers. Avec une amabilité dont tous lui avaient su gré, Giraud-Canetègne avait fait cette proposition :
– Seul, je ne cours aucun risque. Aussi veuillez mettre le canot électrique à l’eau. Je me rendrai au Gouvernement, chez le directeur du service judiciaire, et je vous rapporterai les renseignements que j’aurai recueillis.
La motion acceptée d’enthousiasme, Sagger avait déclaré que le steamer ne pouvait rester en panne à l’endroit où il se trouvait ; cette manœuvre devant forcément appeler l’attention et… le soupçon. Le mieux, à son avis, était de remonter vers le nord en suivant le récif extérieur, et de gagner la passe du Bourail où l’on attendrait le retour du messager. Celui-ci naviguerait entre la côte et le récif, le faible tirant d’eau de la chaloupe le permettant. Ainsi dit, ainsi fait. Giraud serra la main de ses confiants adversaires, sourit agréablement lorsqu’Yvonne lui dit en riant :
– Monsieur mon mari, vous le voyez, je vous laisse toute liberté, n’en abusez pas !
Et le canot électrique déborda, se dirigeant sur Nouméa, dont la rade, abritée d’un cercle de collines, se découpait dans la côte violacée par l’éloignement.
Alors le vapeur reprit sa route et, durant trois heures, prolongea la ceinture corallifère de l’île. Tantôt les côtes s’éloignaient jusqu’aux confins de l’horizon, tantôt elles se rapprochaient assez pour laisser distinguer les arbres des forêts. Tamanous, hêtres mouchetés, chênes-gomme, kohus, houps, milnéas, gaïacs, kaoris, araucarias, acacias, mêlaient leurs feuillages dans les plaines, et plus haut, sur les hauteurs, les bouquets de niaoulis, dont l’écorce épaisse sert à confectionner des toitures, dressaient vers le ciel leurs troncs massifs.
Puis des plantations succédaient aux futaies : cannes à sucre, caféiers, cocotiers, mûriers, vignes, cotonniers, manioc, blé. Et William Sagger, toujours prêt à monter en chaire, disait les richesses minérales et végétales de l’île, sa salubrité, son importance militaire. Il décrivait les établissements pénitentiaires : l’île des Pins, l’île Nou avec son camp de Montravel, la presqu’île Ducos, Koé-Nemba, Fonwhary, la Foa, Teremba, Bourail, Bacouya.
Si bien que le Fortune s’arrêtant en face du village de Bourail, établi au fond d’une anse, les voyageurs manifestèrent le désir de descendre à terre. Ils étaient loin de Nouméa, centre administratif de la colonie. La baie n’est pas en eau profonde, par conséquent le navire ne faisait pas une chose extraordinaire en mouillant en dehors des récifs ! L’imprudence, si elle existait, était de faible portée. L’intendant lui-même le reconnut.
Marcel et ses amis prirent place dans la chaloupe qui les conduisit à terre. Ravis de n’être plus emprisonnés dans le steamer, de fouler le sol ferme, ils suivaient un sentier serpentant à travers un taillis de tamanous de plaine. Le sous-bois dégageait de subtils parfums qu’ils aspiraient avec délices.
Tout à coup, Marcel qui marchait en avant s’arrêta brusquement. Tous l’imitèrent. Un bruit de voix parvenait jusqu’à eux. Une voix d’homme, rauque, gutturale, menaçait ; une voix de femme semblait implorer.
– Qu’est-ce ? demandèrent Yvonne et Diana prises de crainte.
La question fit cesser l’hésitation de Simplet.
– Nous allons le savoir, dit-il en s’élançant dans la direction du son. Quelques pas lui suffirent à contourner les buissons qui masquaient les personnages inconnus. Une femme, une paysanne de race européenne était étendue sur le sol maintenue à la gorge par un Canaque, demi-nu, au torse couvert de tatouages bleus, aux cheveux ceints d’une lanière, qui brandissait un casse-tête. Sans réfléchir Dalvan bondit, arrache l’arme des mains de l’indigène qu’une poussée jette sur le gazon. Il aide la paysanne épouvantée à se remettre sur ses pieds.
– Ah ! monsieur, bégaie-t-elle, vous m’avez sauvé la vie.
– Que voulait donc cet homme ?
– Je ne sais. Il est ivre probablement, il revient d’une fête, d’un pilou-pilou, comme nous disons ici. Il a prétendu qu’il était insulté parce que je ne m’étais pas cachée à sa vue.
Et la surprise se peignant sur le visage des voyageurs.

– Vous n’êtes pas du pays, sans doute. Apprenez donc que la femme canaque est considérée par les naturels comme un être inférieur, à ce point que si elle rencontre un homme, fut-ce son fils, elle doit se dissimuler derrière un arbre, dans un fossé, jusqu’à ce que le guerrier se soit éloigné.
– C’est exact, appuya l’intendant, mais les Européennes ne sont pas soumises à ce régime.
– Non certes, reprit la femme, c’est ce qui me fait croire que ce sauvage est ivre.
Le Canaque était resté par terre. D’un œil hébété, il considérait ceux qui lui avaient arraché sa victime.
– Il en a bien l’air, observa Marcel. Bah ! laissons-le où il est, et continuons notre route. Je confisque le casse-tête, ce sera sa punition.
Et souriant.
– Vous habitez sans doute Bourail, madame ?
– Je suis la femme d’un colon. On doit même m’attendre à la maison – elle s’attendrit soudain – car mon mari m’aime bien, et j’ai deux amours d’enfants. Dire que sans vous, je ne les aurais pas revus.
Elle saisit les mains de Marcel.
– Vous êtes tout de même un rude brave homme, vous, et pas poltron. Vous lui avez pris son arme comme si c’était un joujou. Faut que vous entriez chez nous, Dupré – c’est mon mari – sera si heureux de vous remercier. Tenez voilà la maison.
Le sentier débouchait d’un taillis et, à cinquante mètres à peine, une petite ferme entourée de grands arbres se montrait.
– Tenez, voilà mon homme et mes crapauds, je vous le disais bien qu’ils devaient être inquiets.
En effet, un homme d’une quarantaine d’années, à la face brune, accourait, précédé par un gamin de dix à douze ans et par une fillette un peu plus jeune. Les enfants se jetèrent au cou de leur mère, tandis que M. Dupré regardait, d’un air défiant, les inconnus qui accompagnaient sa ménagère. Celle-ci le mit au fait et désignant Marcel :
– Va ! tu peux remercier monsieur. Sans lui, la mère Dupré, ni ni, fini !
L’homme tendit la main au sous-officier, mais il la retira vivement :
– Non, dit-il, vous ne me connaissez pas.
– Bah ! riposta le jeune homme, nous ferons connaissance après.
– Avant, monsieur. Après vous regretteriez peut-être.
Dupré baissa la tête. Et comme Dalvan demeurait devant lui, la main tendue, il murmura d’une voix sourde :
– Nous sommes des forçats libérés.
Tous eurent un mouvement, mais Simplet reprit :
– Et vous vous réhabilitez par le travail, donnez-moi la main ?
L’homme hésita encore.
– Forçats libérés, redit-il, des criminels enfin. Si on avait su plus tôt, on serait venu ici comme colons libres. C’était le bonheur ; mais voilà, le peuple ne sait pas. Il a fallu que la justice nous prenne. Pourquoi n’apprend-on pas aux pauvres qu’il y a des terres françaises où la vie est facile et bonne ?
Marcel ne retira pas sa main. Dupré leva sur lui son regard humide :
– Alors, maintenant que je vous ai dit… vous voulez encore ?
– Plus que jamais.
– Merci, monsieur.
Et la main calleuse du libéré serra celle du sous-officier.
– Alors, vous voulez bien entrer à la maison ? fit la femme.
– Oui, répondirent les voyageurs.
Et l’on se mit en marche vers la ferme. Marcel qui allait côte à côte avec Dupré, lui dit alors :
– Vous vous accusez devant vos enfants, c’est peut-être un tort.
– Oh ! non, monsieur. Faut bien leur apprendre ce qu’ils sauraient un jour ou l’autre. Et puis ici, presque tous les colons sont dans notre cas. Le remords des parents, ça donne de l’honnêteté aux petits. Voyez-vous, on déteste la boue en se rendant compte par les autres que c’est ennuyeux d’être éclaboussé.
Cependant on entrait dans l’habitation. Tout était propre, bien rangé : la table de bois de tamanou, les sièges grossiers. Et la mère Dupré s’empressait. Elle offrait « aux belles jeunes dames », ainsi qu’elle appelait Yvonne et Diana, du vin de ses vignes, des cocos frais, du beurre, des fruits savoureux.
En apprenant que les visiteurs étaient des passagers du Fortune, que le soir même ils regagneraient leur navire, Dupré voulut absolument leur offrir à dîner. De peur de mécontenter cet ancien forçat pour qui, malgré eux, ils éprouvaient une pitié sympathique, ils acceptèrent.
Toute la maisonnée fut en joie. Le libéré courut au village, ses poulets n’étant pas assez beaux pour ses hôtes. La ménagère s’excusa et s’enferma dans la cuisine.
– N’est-il pas étonnant, dit miss Pretty assise avec ses amis à l’ombre des arbres qui abritaient la maison, n’est-il pas étonnant que des malfaiteurs fassent souche d’honnêtes gens ?
– Eh non, répliqua Bérard, la somme du bien est toujours plus grande que ne le suppose le scepticisme humain. C’est la peine de votre misanthropie. Après avoir nié l’existence des braves gens, vous êtes condamnée à en rencontrer, même parmi ceux que la société repousse.
– Oh ! maintenant, murmura l’Américaine en baissant les jeux, je crois à tout ce qui est bon, vous le savez bien, monsieur Claude. Et ma sœur Yvonne le sait aussi, elle à qui je confie mes secrets.
Marcel l’interrompit :
– Je les connais, vos secrets.
– Vraiment ! alors vous êtes magicien ?
– Peut-être !
– Faites voir.
– Eh bien ! vous vous déclarez toutes deux qu’il n’est pas surprenant que Claude et moi soyons un peu naïfs. L’humanité nous semble bonne, que dis-je ? meilleure, parce que nous ne voyons que vous.
– Un madrigal, plaisanta Yvonne, encore que sa rougeur décelât le plaisir que lui causait la réflexion de Simplet.
– Un madrigal, oui, et d’aveugle, dit l’Américaine.
– D’aveugle ?
– Sans doute ! puisque ces messieurs prétendent ne voir au monde que deux pauvres petites femmes qu’ils sauveront, l’une d’un coquin, l’autre d’elle-même.
À ce moment le petit garçon des Dupré qui, depuis un instant, était absorbé par la lecture d’un journal froissé, ramassé par lui dans quelque coin, s’approcha des causeurs et demanda :
– Est-ce que vous avez entendu parler de la bataille de Paknam contre les Siamois ?
– Oui bien, répliqua Marcel en riant, nous en avons entendu parler. Nous étions dans le pays.
Le gamin parut prodigieusement intéressé.
– Alors, vous avez peut-être connu Marcel, un héros qui s’est éloigné, sans vouloir faire connaître de lui autre chose que son prénom.
Tous avaient tressailli. Un voile de pourpre avait monté d’un jet aux joues de Mlle Ribor.
– Pourquoi demandes-tu cela, mon enfant ?
– Parce que le journal raconte le combat. Il dit comment Marcel, après avoir averti le commandant Bory, est allé voir le roi Chulalong, à qui il a fait si peur que, lui parti, le souverain a demandé la paix.
Et ses auditeurs demeurant silencieux, l’enfant s’anima :
– Vous ne trouvez pas cela admirable et grand ? L’homme qui brave la mort, qui donne la victoire à son pays… Après tout, vous n’êtes peut-être pas Français ! Mais moi, je suis content du capitaine Bory, il a proposé ce brave pour la médaille militaire. Hein ! comme il doit être fier ? Quand je serai grand je ferai comme lui.
D’un geste brusque, Yvonne avait pris le journal. D’une voix tremblée elle lut :
« Le commandant Bory estime que la médaille militaire seule récompensera dignement ce courageux citoyen. Il a adressé un rapport dans ce sens au ministre de la Marine. M. Marcel a peut-être démérité – le soin qu’il a pris de dissimuler son identité semblerait l’indiquer – mais il a si largement réparé que la France ne saurait lui garder rancune. Un fils prodigue lui revient ; que la médaille des soldats dévoués brille sur sa poitrine. La mère-patrie lui tend les bras. »
La jeune fille leva sur le sous-officier ses yeux suppliants. Il y avait dans son regard une émotion profonde. Dire qu’elle l’avait traité avec légèreté ce « Simplet » qui, tout en lui sacrifiant sa vie, conquérait sans effort apparent, après la légion d’honneur, la médaille militaire.
– Eh bien ! s’écria le petit, est-ce assez beau ! Ah ! que je serais heureux de voir ce M. Marcel, pour lui serrer la main.
Puis avec tristesse :
– Seulement, il ne voudrait peut-être pas… je suis de la Nouvelle, moi.
Brusquement, Dalvan attira le gamin dans ses bras :
– Si, il voudrait, je m’en porte garant pour lui, car tu es un digne enfant, et plus tard, tu seras un honnête homme.
– Je serai soldat, fit crânement le petit garçon.
Soudain un pas précipité retentit sur le chemin conduisant au village. Étreints par un pressentiment, tous se levèrent. Presque aussitôt, Dupré arrivait au milieu d’eux. Le libéré paraissait bouleversé :
– Quel malheur, dit-il haletant, votre navire…
– Mon navire, interrogea Diana ?
– Il vient d’être saisi par un garde-côtes et conduit à Nouméa.
– De quel droit ?
– Je l’ignore. Le directeur de la justice a adressé un télégramme au poste de Bourail, on parle de contrebande. En effet, un vapeur portant pavillon américain ne saurait être saisi pour un autre motif.
– L’inanité de cette accusation tombera d’elle-même. Il suffira au capitaine Maulde de nommer la propriétaire du Fortune.
Un roulement de tambour lointain résonna dans la campagne.
– Le rappel, murmura Dupré après avoir prêté l’oreille. Un forçat en cours de peine se sera évadé. On va organiser une battue. Il faut que je me rende au village.
Marcel lui saisit le bras :
– Ce n’est point un forçat que l’on va poursuivre, c’est nous.
– Vous ?
– Oui. Et si je vous le dis, M. Dupré, c’est tout simplement parce que vous nous sauverez.
– Je ferai mon possible, mais vous n’êtes pas un malfaiteur, vous.
– Ni moi, ni mes amis. La preuve, vous me garderez le secret, est que notre compagne miss Diana Gay Gold Pretty est quinze cents fois millionnaire.
Et devant ses amis surpris, le jeune homme conta brièvement leur histoire. Le libéré levait les bras au ciel.
– Alors, je comprends, on a voulu vous mettre dans l’impossibilité de quitter l’île. Dans trois ou quatre jours, on renverra le navire, avec des excuses, au Consulat américain ; seulement vous serez prisonniers vous et mademoiselle votre sœur de lait.
– Non, si dans quatre jours, nous sommes à bord du Fortune au moment où il recevra l’autorisation de reprendre la mer.
– À Nouméa, exclamèrent tous les assistants.
– Eh ! sans doute. Ce n’est pas là que l’on nous cherchera. C’est donc le salut.
– Mais pour y arriver ?
– Simple comme bonjour.
– Si c’est simple, fit doucement Yvonne, nous sommes sauvés.
– Parbleu !
– Mais enfin ce moyen ?
– Voici.
Le sous-officier regarda Dupré bien en face.
– M. Dupré, il y a pour vous une bonne action et un joli bénéfice à réaliser.
– La bonne action me suffit.
– Sous le hangar, qui est derrière la maison, j’ai aperçu tout à l’heure des caisses et des tonnes portant l’inscription « Nouméa. »
– J’expédie souvent des denrées dans cette ville. Un de mes amis me prête un coin de son magasin pour y déposer mes ballots, jusqu’à ce qu’un navire les charge. Vous concevez, ici la navigation n’existe pas.
– C’est parfait ! Consentirez-vous à faire une expédition demain ?
– J’ai bien peu de chose à envoyer.
– Vous vous trompez. Vous avez mes trois amis et moi.
– Vous dites ?
Marcel se mit à rire :
– Vous allez battre le pays avec les habitants ; nous passerons la nuit chez vous, où bien certainement on ne nous soupçonnera pas. Demain, nous nous installons dans des caisses, vous nous embarquez sur un des petits voiliers qui font le service de Bourail à Nouméa. Étant donnée sa destination, cette expédition n’est pas remarquée. Nous sommes déposés dans le magasin de votre ami qui, grâce à un mot de vous, nous fournit une barque pour gagner de nuit le yacht de miss Pretty. Comme toutes les perquisitions ont été faites, nul ne se doute que nous sommes à bord, et tranquillement nous prenons le large à la barbe de l’autorité.
– Ah bien ! en voici une idée ! je ne l’aurais jamais eue, moi.
– Ni nous non plus, fit doucement Yvonne en regardant Simplet. L’appel du tambour se faisait entendre de nouveau. Dupré s’élança en courant dans la direction du village, tandis que Marcel et ses compagnons s’enfermaient dans l’habitation. Le colon ne rentra qu’au milieu de la nuit. Des patrouilles parcouraient le pays, et sur les hauteurs, des signaux de feux annonçaient aux tribus canaques qu’il y avait une prime à toucher pour l’arrestation d’étrangers. On supposait que les voyageurs s’étaient engagés dans la brousse.
Ces nouvelles ôtèrent toute envie de dormir à ceux qui causaient ce remue-ménage. Ils employèrent les heures qui leur restaient à disposer les caisses où ils s’enfermeraient au moment du départ.
Au jour, tandis que Dupré allait traiter avec un entrepreneur de transport par eau, tous embrassèrent cordialement la mère Dupré et ses enfants, puis chacun, muni de provisions suffisantes, entra dans son emballage que la fermière referma soigneusement. Vers dix heures, les colis humains furent enlevés, portés à bord d’un petit voilier qui fit aussitôt route vers Nouméa, sans que le poste de Bourail eût fait la moindre observation. Qui se serait douté, en effet, que privés de leur navire, les voyageurs dénoncés au directeur de la justice par Giraud-Canetègne, s’évadaient tranquillement par mer, alors qu’on les cherchait dans l’intérieur des terres.
Le 18 novembre, les colis étaient débarqués sans encombre et déposés dans les magasins de M. Boruc, situés auprès du marché qui termine la rue de l’Aima, large artère allant de la rade de Nouméa à la campagne.
M. Boruc, négociant modèle [café et coprah (coco pilé),], avait arrondi à force de travail, sa fortune et sa bedaine. Vers quatre heures du soir, il prit livraison de l’expédition Dupré, surveilla lui-même le placement des caisses dans un angle du hangar en planches qui lui servait de magasin, puis ayant renvoyé son personnel, il s’installa dans une petite cabine, dont il avait fait son bureau, et se remit à sa comptabilité un instant abandonnée.
La nuit venait, il alluma sa lampe et continua à aligner des chiffres. Cette occupation amenait un sourire sur ses lèvres. Bien certainement les affaires étaient bonnes. Soudain il interrompit sa besogne. Sa plume qui calligraphiait un superbe 5 suivi de zéros, s’éloigne du papier. Il lui semble entendre un bruit étrange venant du magasin. Le commerçant hausse les épaules.
– Quelque rat, murmure-t-il.
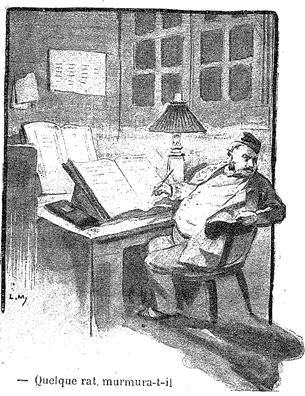
Et tranquillisé, il moule un dernier zéro. Mais le bruit se reproduit. On dirait que des planches grincent sous un effort violent. Boruc pâlit. Est-ce que des voleurs dévaliseraient son magasin ? Cette idée lui donne du courage. Il s’arme d’un revolver établi à demeure dans un de ses tiroirs, et s’éclairant de sa lampe, il rentre dans le magasin.
Il ne voit rien. À part lui, il se plaisante de sa crainte chimérique, et retrouvant tout son courage en l’absence de tout danger, il clame, pour sa satisfaction personnelle :
– Qui va là ? Je suis seul, mais armé, et le père Boruc ne badine pas.
À sa grande terreur, une voix étouffée s’élève.
– M. Boruc, vous êtes seul, alors j’ai une lettre pour vous.
Il tourne la tête de tous côtés. Personne ne se montre et pourtant la voix reprend :
– Une lettre de votre ami Dupré, de Bourail.
Le pauvre homme tremble comme la feuille, son front ruisselle de sueur.
– C’est un esprit, murmure-t-il, puis plus haut : Esprit, qui que tu sois, tu sais que je n’ai rien à me reprocher ; je suis un spirite convaincu et…
Il n’achève pas ; des rires éclatent. Ils partent des caisses expédiées par Dupré.
– Les ballots sont hantés, gémit le commerçant.
Il fait mine de fuir, mais pour gagner la porte, il lui faudra passer près des terribles emballages. Il n’ose pas, et la voix se fait entendre de nouveau.
– Prenez donc votre lettre, elle vous rassurera.
– Où est-elle ?
– Ici, regardez-donc.
Terrifié, Boruc promène autour de lui un regard anxieux, enfin ses yeux tombent sur une caisse. Entre les planches un papier glissé s’agite. Le négociant s’approche, saisit la missive et la parcourt. Alors il éclata de rire, et des rires joyeux lui répondirent. Armé d’un marteau, il décloue les caisses habitées et rend la liberté aux prisonniers.
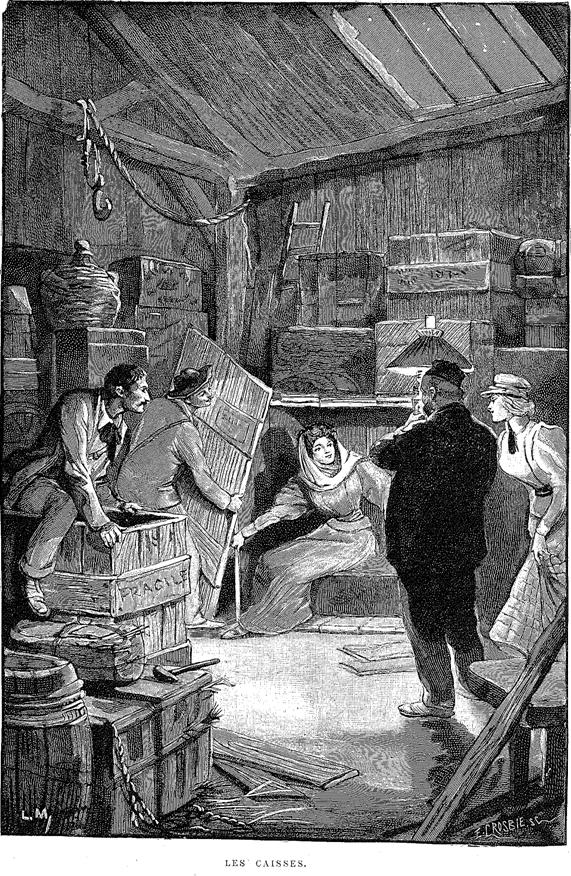
Bientôt Marcel, Claude, Diana et Yvonne sont au mieux avec le marchand. Il les hébergera jusqu’à leur départ. Il les cachera sans peine.
– Je suis veuf, dit-il. J’ai perdu ma femme, une bonne et brave ménagère, mais bavarde. Elle parlait même en dormant. Je suis sûr que depuis son trépas, on ne s’entend plus dans le paradis. Quelle langue… de son vivant, je n’aurais jamais pu vous être utile, mais grâce au ciel, elle n’est plus. Je dis « grâce au ciel » vu la circonstance car pour moi, mes regrets seront éternels.
Tout en installant ses hôtes, il leur conta son histoire, ses travaux, ses espérances. À le voir pérorer ainsi sans permettre à ses auditeurs de placer une parole, on comprenait que ses regrets n’étaient pas simulés. L’âme loquace de son épouse était en lui.
En somme, il apprit aux fugitifs des choses intéressantes. Le capitaine Maulde s’était réclamé du consul américain. On avait perquisitionné à bord du Fortune, et sur le rapport des agents chargés de ce soin, l’accusation de contrebande était tombée à plat.
Le lendemain soir, le négociant informait ses hôtes que le steamer était autorisé à quitter le port, ce qu’il ferait de grand matin. Il avait lui-même amarré son canot à quai, à l’extrémité de la rue de l’Aima, et vers minuit, il conduirait à bord les amis de Dupré.
À l’heure dite, tous quittèrent la demeure du digne homme et parcoururent la rue déserte. De loin en loin, une villa éclairée, des accords de piano, des chants indiquaient que tous les habitants ne dormaient pas. Et les fugitifs frissonnaient, tremblant de faire quelque rencontre fâcheuse.
Cependant ils atteignirent le quai. Devant eux s’étendait la rade, dont les contours étaient marqués par les feux de l’île Nou et de la presqu’île Ducos. À cent mètres, se dessinait sur l’eau indigo la silhouette noire d’un navire.
– Le Fortune, dit Boruc à voix basse.
Le yacht était là. Les cœurs battirent violemment, et sans mot dire, en proie à un trouble délicieux, tous s’assirent dans le canot du négociant. En vingt coups d’aviron, l’embarcation aborda. On se fit reconnaître. Un adieu rapide mais ému à M. Boruc, puis les voyageurs escaladèrent le pont. Ils étaient libres.
Chacun regagna sa cabine. Les incidents des jours derniers avaient brisé les plus robustes. Ils dormirent à ce point qu’ils ne s’aperçurent point que le yacht quittait son mouillage, se glissait entre les écueils de l’île Maître et de Laux-Goëlands, passait au pied du phare à feu fixe de l’îlot Amédée et franchissait le récif de ceinture par les passes de Boulari en évitant les rochers de Tô, le Sournois et Toombo.
Vers onze heures pourtant, tous se retrouvèrent réunis dans le salon d’arrière. Ils se félicitaient de l’heureux succès de leur ruse, quand un domestique parut. Sir William Sagger faisait demander si miss Pretty consentirait à le recevoir. Il s’agissait d’une communication urgente. Sur la réponse affirmative de l’Américaine, l’intendant se présenta et d’une voix grave :
– Cette nuit, je n’ai pas voulu troubler votre repos, mesdemoiselles et messieurs, mais aujourd’hui je dois vous aviser que ce navire emporte un traître et livrer le drôle à votre justice.
– Un traître, répéta Diana, et qui donc ?
– L’homme qui a dénoncé Mlle Ribor au Directeur de la Justice, à Nouméa. Sa mauvaise action accomplie, se croyant sûr de l’impunité, il s’est vanté de son infamie. À tout hasard, je l’ai fait enlever par nos matelots. Il est aux fers.
– Mais quel est cet homme enfin ?
– C’est ce misérable dont vous avez eu pitié à Saïgon, qui vous a suivie depuis ce moment…
– Giraud !
Sagger secoua la tête :
– Giraud est un nom d’emprunt. La variole l’avait rendu méconnaissable, il a déguisé son nom, comme le mal avait déguisé son visage… Il nous a trompés pour mieux nous vaincre. Il s’appelle Canetègne.
– Lui !
Marcel s’était dressé, l’œil étincelant, mais un cri déchirant de sa sœur de lait lui fit tourner la tête. La jeune fille sanglotait, et dans ses larmes, elle disait avec un accent d’épouvante :
– Canetègne ! alors je n’ai plus qu’à mourir.
D’un élan il fut près d’elle :
– Mourir ! que dis-tu ?
Elle le regarda avec un désespoir farouche :
– Tu ne comprends donc pas… Canetègne… je suis mariée à lui… mariée !
– C’est vrai, murmura le sous-officier écrasé par ce nouveau malheur. C’est vrai, tu es sa femme.
Tous, le visage blême, entouraient les fiancés brusquement séparés à jamais.
– Sa femme ! continua Mlle Ribor, je suis madame Canetègne. À jamais je dois traîner ce nom infâme.
– Il y a eu surprise, hasarda Simplet.
– Ai-je seulement le droit de protester. Me vois-tu faire appel à la justice qui me poursuit comme voleuse. Oh ! cet homme ne m’a laissé qu’un moyen de reconquérir ma liberté…
– Un moyen, dis-tu, lequel ?
– Mourir !
Ni Claude, ni Diana ne cherchèrent à consoler leurs amis. Que dire en présence de la douleur brutale qui souffletait leurs espérances.
Ils eurent un même geste étonné lorsque Marcel releva le front en s’écriant :
– Eh bien non, petite sœur, il en est un autre.
– Tu es fou.
– Pas le moins du monde, c’est simple.
– Toujours avec toi ; mais parle.
– C’est de retrouver ton frère. La machination du Canetègne est démontrée. Il est poursuivi, condamné comme faussaire. Et par ce fait seul qu’il subit une peine infamante, ton mariage est nul de plein droit.
Et reprenant toute sa bonne humeur :
– Écoutez, amis. Maintenant nous allons aux îles Wallis, puis au groupe des îles Futuna et Alofi. Il est certain qu’Antonin ne s’est pas arrêté dans ces archipels français peu importants et dépourvus de communications régulières, mais notre visite nous servira. À Ouvéa, nous débarquerons M. Canetègne. Avant plusieurs mois, il ne pourra quitter cette prison gardée par l’océan. Comme les naturels, il se nourrira des tubercules de l’igname, de bananes, de cocos. Il pêchera d’excellents poissons et apprendra la manœuvre des pirogues doubles des Ouvéens. Sa douce captivité nous permettra de continuer notre voyage sans crainte de nouvelles trahisons… Nous retrouverons Antonin.
Et portant à ses lèvres la main d’Yvonne réconfortée par sa confiance :
– Trouvez-vous mon plan bon à suivre, mademoiselle ?
– Oui, Simplet.
– Et vous, mes amis ?
Claude grommela :
– Moi, j’aimerais mieux jeter le Canetègne à l’eau de suite. Ce serait plus sûr. À ta place, il n’hésiterait pas, va.
– C’est ce qui lui sauve la vie. Voyons, mon cher Claude, des soldats n’emploient pas les armes des coquins. Et puis ne faut-il pas qu’un jour il confesse ses mensonges. Il les confessera, je n’en doute pas.
– Pourquoi pas à l’instant. Un papier écrit et signé de sa main.
– Qu’il renierait ensuite, par la raison valable qu’il a été contraint.
– Alors ?
– Cherchons Antonin. Je me vengerai de mon ennemi en me dévouant à sa femme, toujours ma fiancée.

XXXIII
À TRAVERS LE PACIFIQUE

Le 29 novembre, à trois heures de l’après-midi, le Fortune stoppait en la ligne de brisants qui entoure l’île Ouvéa. Un canot était mis à la mer, et Canetègne, blême de colère, y était descendu. Mais avant que l’embarcation se fut éloignée, Simplet avait eu le temps de crier à son ennemi :
– M. Canetègne, nous vous faisons grâce, parce que vous appartenez à la justice française. Ne vous réjouissez donc pas. Songez à la Cour d’assises. Cela charmera vos loisirs.
Une heure après, le misérable était mis à terre. Le canot rejoignit le steamer qui, virant de bord, fit route vers les autres îles du groupe Wallis. Futuna, Alofi, bouquets de cocotiers émergeant des eaux vertes de l’Océan, parurent. Nulle part, Antonin ne s’était présenté. Il fallait chercher ailleurs et le brave navire mit le cap sur Tahiti.
Le 13 décembre, il arrivait en rade de Papeete. Fut-ce la date qui lui porta malheur ? Qui sait ? Toujours est-il qu’en embouquant les passes qui accèdent à la baie, il heurta un banc de corail, et qu’il jeta l’ancre avec son bordage déchiré et sa cale inondée par le fait d’une large voie d’eau. L’accident causa une consternation générale. En jetant Canetègne à la côte, Marcel et ses amis pensaient être débarrassés de lui pendant deux ou trois mois. C’était suffisant pour prendre une avance telle que l’Avignonnais ne pût les rejoindre et entraver leurs recherches. La fatalité se mettait de la partie. Pour radouber le steamer sérieusement endommagé, il allait falloir de longues semaines. Durant ce temps, le commissionnaire pourrait quitter Ouvéa et alors…
– Alors, gronda Bérard, mon conseil était le bon. Jeter notre ennemi à la mer avec un joli boulet aux pieds. Cela donne la vocation aux plus mauvais plongeurs. Et puis nous serions tranquilles.
– Bah ! riposta Diana. Au lieu de récriminer, songeons à sortir de ce mauvais pas. Le Fortune ne peut plus nous porter, passons-nous de lui et cherchons un autre navire.
Sur cette réflexion, tous se rendirent à terre, tandis que le steamer se faisait remorquer à l’est de la rade, où se trouve la cale de Fare-Ute pour la réparation des vaisseaux. Tous erraient dans les rues verdoyantes de la ville, où Pierre Loti évoqua la ravissante image de Rarahu, la tahitienne aux doux yeux, aux cheveux noirs couronnés de fleurs.
Le long des enclos des jardins qui entourent toutes les habitations, passaient des Maoris à l’air grave, contemplatif, ayant sur le visage l’expression d’immobilité sereine empruntée à leur ciel pur, à l’horizon invariable de l’Océan qui enserre leur île.
Parfois des fillettes croisaient les voyageurs. Elles riaient, découvrant ainsi leurs dents blanches. Et Sagger, toujours enclin à professer, disait les mœurs des Maoris. Il contait leur religion bizarre, faite seulement de la crainte des mauvais génies Toupapahous, divinités étranges, aux formes indécises, issues de la nuit et de la tempête. Tout en l’écoutant, les compagnons de miss Pretty s’informaient.
Au gouvernement d’abord. Antonin Ribor y était inconnu. Bien que les courageux explorateurs s’attendissent à cette réponse, ils en éprouvèrent une tristesse. Qu’était donc devenu le frère d’Yvonne ? Sa trace semblait perdue depuis leur départ du Tonkin. Et tout bas, Simplet se demandait si celui qu’il cherchait ne restait pas en arrière, captif d’une peuplade indépendante, alors que lui-même poursuivait sans relâche sa course en avant.
Mais bientôt cette pensée dut faire place à d’autres. En interrogeant un négociant européen, Diana venait d’apprendre que l’archipel de Tahiti est en relation par des services réguliers de vapeurs avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie ; mais qu’il n’existe aucun moyen de communication avec la Guyane, point vers lequel elle pensait se diriger.
Il faudrait gagner l’Amérique par San-Francisco, et encore le départ mensuel pour ce port des États-Unis avait-il eu lieu trois jours auparavant. Les voyageurs furent atterrés par ces renseignements. Allaient-ils être immobilisés pendant un mois ?
Fatigués de leur inutile recherche, découragés en voyant les obstacles s’amonceler devant eux, ils gagnèrent la cale de Fare-Ute, poussés par l’ultime espoir que la réparation du Fortune serait rapidement conduite. Hélas ! une nouvelle désillusion les attendait ! On venait de radouber un bateau anglais qui prenait la mer le lendemain, mais la cale était occupée par la goélette Orohéna, attachée à la station navale de Tahiti, et le vapeur Fortune ne pouvait être mis « en travail » qu’après cette dernière.
– C’est-à-dire dans six semaines ou deux mois, expliqua tranquillement un ouvrier.
Du coup, Claude Bérard se fâcha.
– Chien de pays ! A-t-on jamais vu une île sauvage pareille ! On veut aller à la Guyane, paf ! On vous annonce que le pays n’est en communication qu’avec l’ouest.
– Vo volez rendre vo même à le Guyane ? prononça une voix avec un fort accent anglo-saxon.
Tous regardèrent. À deux pas d’eux se tenait un homme de haute taille, dont le visage rosé, les favoris blonds tout autant que l’accent trahissaient la nationalité.
– Vo volez rendre vo même à le Guyane, répéta l’inconnu ?
Simplet toisa le nouveau venu, et avec un sourire :
– Oui. Vous pouvez peut-être nous y conduire ?
– À le Guyane… oh no !
– Alors ?… commença le sous-officier, désappointé.
– Je suis Robarts… Je commandais le brick Fancy qui venait d’être radoubé et partait demain pour Panama, avec escales dans les îles françaises de Toubouaï, Gambier, Marquises, etc., pour charger du coprah. De Panama, vo prenez le railway pour Colon, où vous trouverez des steamboats pour le Guyane.
Le raisonnement était juste. Tous le comprirent, et cinq minutes après, ils avaient fait prix avec le capitaine du Fancy pour leur transport à Panama.
Dès le soir, ils occuperaient leurs cabines.
William Sagger fut aussitôt dépêché au Fortune, afin de faire transborder sur le Fancy les armes et bagages indispensables aux voyageurs. De plus, il devait donner l’ordre au capitaine Maulde de rallier, aussitôt que possible, le port de Colon sur l’Atlantique.
– Car, avait déclaré Diana, l’important pour nous est de gagner du temps ; à Colon nous nous diviserons. Les uns visiteront les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, Marie Galante, Saint-Thomas, puis Terre-Neuve, Saint-Pierre et Miquelon ; les autres descendront vers Cayenne. Nous nous retrouverons à Colon d’où, si nos recherches ont été infructueuses, mon navire nous emmènera vers la côte africaine.
Simplet, après s’être entendu avec le commandant du Fancy, s’était écarté du groupe formé par ses compagnons. Immobile, les yeux fixes, il semblait hypnotisé par la vue de deux personnages qui, debout sur un quai flottant, discutaient avec animation en désignant l’eau du geste.
L’un était un capitaine de vaisseau ; l’autre un sous-officier d’infanterie de ligne. Ce dernier, un descendant de l’illustre famille des Pomaré, qui fournissait jadis les rois absolus de l’île, avait adopté la tenue dont il était revêtu, lui trouvant je ne sais quelle grâce particulière. Or, la veille il avait laissé tomber son sabre-baïonnette à l’eau. Ne sachant pas nager, il avait conté sa mésaventure à des matelots, leur promettant un bon prix s’ils allaient chercher l’arme. Bref, le matin même, sept ou huit « mathurins » s’étaient livrés à une baignade en règle. Pomaré était rentré en possession de sa baïonnette, mais la natation étant interdite en ce point de la rade, les sauveteurs de la lame d’acier avaient été mis aux fers. Et le sergent par fashion sollicitait leur grâce du chef suprême de la station maritime de Papeete. La vue du pantalon rouge, des sardines dorées sur les manches de la vareuse avait ému Simplet. Il se souvenait que cet uniforme avait été le sien, et peut-être éprouvait-il un chagrin à comparer le temps où il le portait avec insouciance, au moment présent, gros de préoccupations et de menaces. Lentement, sans en avoir conscience, il se rapprochait des causeurs. Ceux-ci maintenant s’étaient accroupis au bord du quai et le prince Maori montrait à l’officier de marine un point dans l’eau, invisible pour Marcel. Soudain le capitaine fit un faux mouvement. Il chancela, étendit les bras, chercha à reprendre son équilibre et finalement tomba en faisant jaillir en pluie les vagues qui berçaient le quai flottant.
Un cri s’échappa de toutes les bouches. Pomaré stupéfait, regardait hébété. Et cependant l’officier ne reparaissait pas. Alors rapide comme la pensée, Marcel bondit en avant, traversa la grève en trois enjambées, le quai en deux et piqua une tête à l’endroit même où s’était englouti le capitaine de vaisseau.
Quinze secondes s’écoulent. Anxieux, Bérard, Sagger vont plonger à leur tour. Inutile, la surface de l’eau s’agite, bouillonne. Une masse noire émerge des profondeurs. La tête de Simplet se montre, puis celle de l’officier que le vaillant garçon soutient de la main gauche.
Tous se précipitent sur le quai, et aident Dalvan à reprendre pied avec celui qu’il vient de sauver.
Ce dernier a perdu connaissance. Les courroies de son sabre, enroulées autour de ses jambes, montrent pourquoi il n’a pu se sauver lui-même. Mais l’immersion a été courte. Bientôt il rouvre les yeux, et à Simplet que tous lui désignent du geste, il tend la main. Puis il se relève, s’excuse en souriant de s’être évanoui comme une femmelette et devenant grave :
– Monsieur, dit-il à Dalvan, nous autres marins sommes reconnaissants. Aussi n’est-ce point à une banale curiosité que j’obéis en vous demandant votre nom ?
Et comme le sous-officier hésite, troublé par la question inattendue, l’officier reprend :
– Moi je me nomme Édouard Barbette, capitaine de vaisseau, votre obligé.
– Et moi, je me nomme Marcel.
– Marcel ?…
– Au fait ! pourquoi ne me confierais-je pas à votre honneur ? Je cache mon nom à tous parce que…
Il a comme une hésitation, mais il se décide :
– Ce nom est actuellement celui d’un homme que cherche la justice française. Je le porterai de nouveau quand j’aurai établi mon innocence et celle des autres.
– Elle est établie pour moi, monsieur.
– J’en suis assuré, commandant. C’est pourquoi je ne crains pas de vous livrer Marcel Dalvan, très heureux d’avoir pu vous être agréable.
– Marcel Dalvan, redit l’officier comme pour graver ces mots dans sa mémoire, Marcel Dalvan. Je vous remercie.
Les deux hommes se serrèrent la main, et le marin s’éloigna suivi piteusement par le descendant de la race royale des Pomaré, cause involontaire de l’incident.
Au soir, les voyageurs étaient réunis sur le pont du brick Fancy, qui allait les emporter vers la côte américaine, quand un canot, venu de terre, accosta. Un marin monta à bord, demanda M. Marcel, et remit au jeune homme une lettre et un petit paquet scellé d’un cachet rouge. Après quoi, il regagna son embarcation qui disparut aussitôt dans la nuit. Très intrigué, Dalvan ouvrit la missive. Elle était ainsi conçue :
Monsieur,
Après une bonne action, le plaisir le plus doux est de s’en souvenir. J’ai donc obtenu du Gouverneur de remplir, à votre nom, le brevet ci-joint vous nommant titulaire d’une médaille de sauvetage. Je suis honoré de la même décoration. Permettez-moi de vous offrir l’emblème que j’ai porté moi-même. Il vous rappellera que vous comptez dans la marine française un ami, qui souhaite ardemment le succès de votre entreprise.
Édouard BARBETTE,
Capitaine de vaisseau.
Le paquet scellé de cire rouge contenait la médaille d’argent au ruban tricolore.
– Tout pour lui, remarqua Bérard en riant. La Légion d’honneur à Madagascar, la médaille militaire à Bangkok, celle de sauvetage à Tahiti. Quel accapareur !
Mais Yvonne avait saisi la main de son frère de lait, et immobile devant lui, les yeux troubles, elle le regardait.
– Qu’as-tu donc, petite sœur ? demanda Marcel.
– J’ai que je suis heureuse de voir que tous te rendent justice. Heureuse… et triste aussi, car seule j’ai été injuste avec toi ; si injuste que je ne me le pardonnerai jamais.
Il lui sourit doucement :
– Veux-tu te pardonner une bonne fois, c’est si simple. Ce que tu appelles ton injustice, a été mon stimulant. Si les récompenses pleuvent sur moi, je les dois à toi seule, à toi seule, entends-tu. Donc en te faisant un reproche, c’est moi que tu désobliges.
Une larme glissa lentement sur la joue de Mlle Ribor. Sa petite main eut pour celle du sous-officier une étreinte plus vigoureuse.
Le lendemain au jour, le Fancy leva l’ancre, et bientôt le port de Papeete, la cale de Fare-Ute devant laquelle se balançait le Fortune, la ville, disparurent à l’horizon. La traversée du Pacifique commençait. Elle fut longue. Durant trois semaines, le brick évolua entre les innombrables îles françaises des archipels de Tahiti, Toubouaï, Gambier, Marquises. Touchant à Eimeo, à Bora-Bora, etc., afin de remplir peu à peu sa cale de coprah destiné à la fabrication de l’huile de coco.
Un peu énervés par les incessantes stations du navire, Marcel et ses amis descendaient chaque fois à terre. Ils faisaient d’intéressantes excursions en ces régions privilégiées dont le sol fertile ne nourrit ni reptiles, ni insectes venimeux.
Le 1er janvier, le Fancy étant en vue de N’zapa-Rahu, les voyageurs qui avaient commencé l’année 1894 par les souhaits les plus affectueux, résolurent de faire une longue promenade.
Le capitaine Robarts leur avait déclaré que son navire ne reprendrait la mer que le lendemain.
N’zapa-Rahu est une île volcanique qui affecte la forme d’un immense cône posé à la surface des flots. De la côte au centre le terrain monte constamment.
Donc la petite troupe gravissait les pentes boisées. Au-dessus d’elle, les eucalyptus, les cocotiers aux palmes légères, les bananiers aux larges feuilles, entrecroisaient leurs branches. Autour du chemin, les buissons nés à l’abri des futaies étaient émaillés de fleurs multicolores, qui distillaient dans l’air leur parfum capiteux. Tous allaient dans la tiédeur du sous-bois silencieux, respirant avec volupté les senteurs dont l’atmosphère était chargée. Soudain, à la forêt ombreuse succéda une zone découverte éclatante de lumière. C’était un plateau herbeux sur lequel le soleil versait ses rayons de feu. Ils traversaient cette prairie, quand la voix de Sagger les arrêta.
– Nous sommes sur un chemin du supplice, dit le géographe.
– Un chemin du supplice ? interrogea miss Pretty.
– Sans doute. Regardez en face de nous. Une ravine étroite s’ouvre dans le rocher. À l’entrée, voyez-vous deux piliers de corail affectant la forme de massues.
– Oui, eh bien ?
– Eh bien ! C’est là ce qui a motivé mon exclamation. Autrefois, les Maoris immolaient des victimes humaines sur des autels formés de blocs de coraux. Ces autels étaient cachés en des endroits inaccessibles, et les sentes, qui y donnaient accès, étaient indiquées aux fidèles par les massues rouges que vous apercevez.
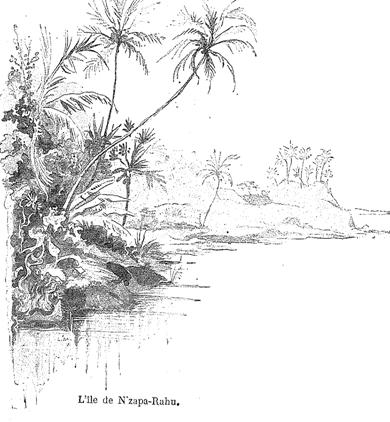
– Alors en suivant ce chemin creux, nous découvririons un autel ?
– Sans aucun doute. Seulement, miss, n’espérez pas assister à un sacrifice. L’annexion française a fait disparaître ces coutumes barbares…, quoique des gens malintentionnés, sans doute, prétendent que parfois les naturels reviennent au culte de leurs aïeux.
Marcel haussa les épaules.
– Pure calomnie, sans doute.
– Je le pense. En tout cas, nous pourrions visiter le temple sanglant des anciens dieux maoris.
La proposition fut adoptée à l’unanimité. Tous s’engagèrent dans le sentier sacré.
C’était une fente déchirant le rocher. Parfois, le chemin s’étranglait à ce point que les promeneurs avaient peine à se glisser entre les murailles de granit. Le sol accusait une pente raide. De loin en loin, une massue de corail, fichée dans la paroi du roc, assurait les touristes qu’ils ne s’étaient pas égarés. Ces sortes de poteaux indicateurs étaient indispensables, car la sente se ramifiait fréquemment, formant ainsi un dédale dans lequel une personne non prévenue eut eu peine à se diriger.
L’ascension dura plus d’une heure.
Essoufflés, exténués, les compagnons de Marcel s’étaient arrêtés un moment.
Alors il leur sembla percevoir comme un chant lointain. Ils prêtèrent l’oreille. Ils ne se trompaient pas. Jusqu’à eux arrivait l’écho affaibli d’une mélodie large et simple, coupée parfois de cris douloureux ou de silences plus douloureux encore.
– Qu’est cela ? murmurèrent-ils.
Sagger écoutait toujours.
– C’est étrange ! fit-il enfin.
– Quoi ! Que supposez-vous ? exclamèrent ses compagnons.
– Je n’ose me prononcer, et pourtant… Tenez, vous savez tous qu’un missionnaire protestant s’est amusé à recueillir les chants de mort de toutes les peuplades océaniennes. Il en a fait un livre qui a été édité avec succès à New-York.
– Soit, mais cela ne nous dit pas…
– Ce livre, je l’ai eu entre les mains. Je crois reconnaître le chant du supplice des Maoris.
Tous s’étaient dressés.
– Le chant du supplice, répéta Marcel. Mais alors les indigènes sacrifieraient encore des victimes humaines ?
– D’aucuns le prétendent, fit paisiblement l’intendant, je vous en ai prévenus.
– Eh bien ! nous allons voir cela !
Déjà le sous-officier remontait le sentier. William l’arrêta :
– Prenez garde, monsieur Dalvan ; si ce que nous croyons est vrai, les Maoris doivent être en nombre. Il est dangereux de les troubler.
– Dangereux, c’est possible ; mais sapristi ! on ne peut laisser massacrer une créature humaine sans essayer de lui porter secours… Et puis, avec un peu d’adresse, c’est bien simple de mettre en fuite des sauvages.
– C’est bien simple, appuya Yvonne en souriant. Cela doit être simple, puisque Marcel l’affirme.
– Sans doute, reprit le jeune homme. Nous allons sortir de ce chemin creux et suivre la crête des talus. Lorsque nous apercevrons les Maoris, nous nous déploierons en tirailleurs de façon à leur faire croire qu’ils sont entourés par une troupe nombreuse. Nos revolvers feront le reste.
L’intendant hasarda une dernière objection :
– Mais Mlles Diana et Yvonne ?…
Il ne put achever. Toutes deux s’écrièrent :
– Nous pensons qu’il faut suivre l’avis de M. Dalvan.
– Alors en route, consentit philosophiquement Sagger. Espérons que je me suis trompé dans mes suppositions.
Une minute plus tard, tous marchaient en file indienne sur la crête du talus de droite. Marcel et Bérard étaient en avant, les jeunes filles les suivaient, roses de plaisir et peut-être aussi de crainte. Enfin William formait l’arrière-garde. Le chant devenait plus distinct. Bientôt on put reconnaître les syllabes sonores du dialecte maori.
– Non, non… grommelait l’intendant tout en suivant ses amis, je ne me suis pas trompé. C’est le chant de mort. Le mieux aurait été de retourner à la côte et de laisser ces sauvages se débrouiller entre eux. Bah ! puisqu’ils veulent tous sauver les victimes, allons-y ! Pourvu que ces demoiselles n’aillent pas récolter quelque blessure.
Il se tut. Marcel s’était arrêté et faisait signe à ses compagnons de le rejoindre. Avec précaution, ceux-ci s’approchèrent de Simplet. Un spectacle étrange s’offrit à leurs yeux.
Les buissons, qui leur servaient d’abri, croissaient à l’extrême bord d’un talus à pic qui se prolongeait à droite et à gauche, formant un cercle et dominant de deux mètres environ un plateau uni. Au centre du rond-point, d’énormes blocs de corail s’entassaient, figurant une sorte de « menhir », assez semblable aux anciens autels des Gaulois, dont la Bretagne conserve encore de nombreux spécimens.
Sur les pierres, un Maori de haute taille, que son manteau de plumes multicolores et sa tiare de coquillages désignaient comme prêtre, se tenait debout dans une attitude pensive, sa large main crispée sur l’épaule d’une jeune fille. La pauvre enfant pleurait. Un tremblement d’épouvante secouait tout son être, et parfois, de sa gorge contractée, s’échappait un cri éperdu.
– La victime, fit tout bas Sagger.
Elle était jolie. Sa peau, de la couleur du lait légèrement teinté de café, était presque celle d’une européenne. Seuls ses yeux noirs, énormes, qu’elle levait parfois vers le ciel, décelaient la fille des Maoris. Autour de l’autel, une vingtaine d’indigènes, portant les sandales et le bouclier de guerre peint en rouge, armés d’arcs, de flèches et de sagaies, chantaient en se balançant sur place d’un mouvement rythmique.
– Pauvre enfant, gémit Diana.
Simplet eut un sourire, et dans un souffle commanda :
– En tirailleurs, et pas de bruit.
Sagger obéit comme les autres. Il ne murmurait plus. La vue de l’innocente victime, vouée au trépas par les fanatiques sectateurs d’une divinité sanglante, l’avait rempli de colère. Prudent tout à l’heure, une indignation généreuse le rendait maintenant capable de toutes les audaces.
Quelques minutes se passèrent. Le chant de mort s’éteignit lentement. Un silence menaçant succéda. D’un mouvement brusque, le sacrificateur saisit la victime par les cheveux et la renversa en arrière, la gorge tendue pour recevoir le coup mortel.
Elle eut un cri suprême, épouvantable ; râle d’agonisante, insulte aux dieux sauvages et sourds, qui la laissaient périr ainsi dans tout l’épanouissement de la jeunesse, et ce fut tout. Le bras du prêtre se leva, brandissant le couteau sacré, recourbé en forme de croissant, mais il n’acheva pas le geste commencé. Un commandement énergique vibra dans l’air, terrifiant les farouches Maoris.
– Feu !
Des détonations sèches crépitèrent, auxquelles répondirent des hurlements de douleur, et comme des fauves surpris par les chasseurs, les indigènes s’enfuirent, laissant deux des leurs se tordant sur le sable.
Surpris, le prêtre avait lâché sa victime, et celle-ci comprenant qu’un secours lui arrivait, s’était laissé glisser de l’autel à terre. Des yeux elle cherchait ses défenseurs, et tout à coup elle bondit dans la direction où une fumée légère, montant à travers les branches, trahissait la cachette des protecteurs mystérieux qui avaient déconfit ses ennemis.
Mais aussi prompt qu’elle, le sacrificateur avait abandonné son piédestal de coraux. Il la poursuivait avec rage, en fanatique prêt à donner sa vie, pour que son dieu sanguinaire ne fût pas frustré de la victime promise. Le gradin rocheux qui enceignait la clairière opposa son obstacle à la fuite de la fillette. Le prêtre l’atteignit, la jeta brutalement sur le sol. Il allait frapper l’enfant de son redoutable couteau, quand William n’y tenant plus, sauta du haut de l’escarpement, et d’une balle en plein front, étendit mort le féroce personnage. Si vite qu’il eut tiré cependant, son adversaire avait eu le temps de lui entailler profondément le bras avec son poignard. Le sang coulait, mais le brave géographe n’en avait cure. Il relevait la fillette meurtrie, la rassurant par de douces paroles. Mais elle lui saisit la main, la posa sur sa tête en signe de soumission et d’une voix musicale, chantante :
– Tu as conservé la vie de Sourimari. La vie de Sourimari t’appartient.
– Elle parle français, exclama Marcel, qui à son tour avait sauté auprès de l’Américaine.
– Oui, dit-elle. J’ai été élevée à Papeete, à l’école des Francs. C’est pour cela qu’ici, ils m’ont choisie pour victime.
Puis la terreur reparaissant sur ses traits :
– Emmenez-moi. Emmenez-moi vite. Ils vont revenir. Ils vous tueront tous.
L’avis avait du bon. Aussi tout en s’efforçant de calmer les transes de Sourimari, la petite troupe reprit le chemin de la côte. On arriva sans encombre au Fancy, où le capitaine Robarts ne fit aucune difficulté pour recevoir la maorie dont le passage lui fut d’ailleurs payé. Une bonne action oblige celui qui l’accomplit. Après l’avoir sauvée, les voyageurs ne pouvaient abandonner Sourimari dans l’île, où elle aurait été sûrement reprise par ceux aux mains desquels ils l’avaient arrachée. Ils avaient ainsi gagné une compagne de plus, « une petite amie » disait William.
Le chargement du Fancy s’était d’ailleurs complété en leur absence. Ils apprirent avec joie que le brick allait enfin s’élancer vers le but de son voyage.
La traversée eut lieu sans incident. Le 16 janvier seulement, William montra à bâbord un îlot escarpé.
– Terre française, dit-il.
Et comme tous se récriaient, il ajouta :
– L’îlot Clipperton, sentinelle avancée des possessions de la République française dans l’océan Pacifique. Pays désert où quelques rares navires viennent récolter le guano, mais qui deviendrait une station importante, le jour où l’isthme de Panama serait traversé par le canal interocéanique.
Trente-six heures plus tard, le Fancy entrait dans le port de Panama. De rapides adieux au capitaine Robarts, et les amis d’Yvonne, suivis de Sourimari, sautèrent dans un train de la ligne d’Aspinvald. Le soir même ils atteignaient Colon, sur l’Atlantique, et descendaient à Isthmus’s hôtel.
Sur le livre des voyageurs, Simplet put constater combien peu se déplacent les français. Le dernier compatriote avait paru à l’hôtel deux années auparavant. Le petit sous-officier lut avec plaisir sa signature hardie :
– Armand Lavarède[5].
Mais le temps n’était pas aux réflexions plus ou moins philosophiques. Il fallait marcher, marcher vite, car tous avaient le pressentiment que déjà Canetègne, leur implacable ennemi, courait sur leurs traces protégé par les lois françaises qui, une fois de plus, n’étaient point au service de la justice.
Donc, le dîner expédié, Marcel déclara à ses amis qu’il allait se mettre en quête d’un navire à destination de la Guyane et les invita à faire route vers la Martinique, ainsi que l’avait proposé naguère miss Pretty.
– Moi, je t’accompagne, interrompit Yvonne.
– Toi, mais songe donc…
– Je songe que près de toi, je suis rassurée. Un malheur vient-il à fondre sur nous, avec toi je n’aurai pas peur. Je me dirai : nous sommes dans l’embarras, mais en sortir doit être simple comme bonjour, Marcel va trouver le moyen. Tandis qu’éloignée de mon défenseur, je ne vivrais pas.
En vain Dalvan voulut combattre l’idée de la jeune fille ; elle ne céda point. Et comme Diana, après un rapide regard à Claude, la soutint, Simplet se trouva avoir tout le monde contre lui. Il consentit à emmener sa sœur de lait, tandis que Bérard, miss Pretty, Sagger et Sourimari visiteraient les Antilles et les établissements français de Terre-Neuve.
Le 20, tous deux s’embarquaient sur l’Eloa, vapeur guatémaltèque qui se rendait de Colon à Bahia, avec de nombreuses escales dont l’une à Cayenne.
Sur le quai, Diana et ses compagnons, qui le soir même devaient quitter la ville, agitaient leurs mouchoirs en signe d’adieu. Simplet et Yvonne, debout sur le pont, répondaient à ces signaux affectueux. Ni les uns, ni les autres n’aperçurent dans la foule un homme au visage couturé, grimaçant, dont les yeux dardaient des flammes.
Cet homme était Canetègne, recueilli, après trois jours de captivité à Ouvéa, par une goélette à destination de la Nouvelle-Calédonie (les méchants ont de ces bonheurs). De Nouméa un courrier à marche rapide avait transporté le commissionnaire à San-Francisco, via Honolulu, et les chemins de fer des United-States et de la République mexicaine, en correspondance avec un bateau du service circulaire de la mer des Antilles, avaient permis à l’odieux personnage d’atteindre Colon, à point nommé pour assister au départ de Mlle Ribor.
– De ma femme, disait-il.
Et il avait raison, de par le contrat en bonne et due forme à lui délivré par l’administration d’Hanoï. Il s’enquit, fit parler les domestiques de Isthmus’s hôtel, et apprit ainsi que Marcel et sa sœur de lait se rendaient à Cayenne.
– À Cayenne, grommela-t-il avec un hideux sourire. Le drôle ne pouvait mieux choisir. Eh ! Eh ! une fois en résidence là-bas, c’est bien le diable s’il se jette encore à la traverse de mes projets.
XXXIV
AU PAYS DES FORÇATS
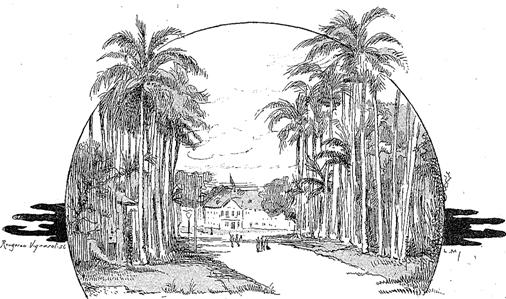
Le voyage dura près d’un mois. L’Eloa faisait escale à tout instant. Affrété pour le petit factage et le service local côtier, il était à un transatlantique ce qu’est à un express un train de marchandises. Colombie, Venezuela, Guyanes anglaise et hollandaise défilèrent sous les yeux des impatients voyageurs.
Enfin ils eurent connaissance de l’embouchure du Maroni, qui limite au nord le territoire de la Guyane française. L’établissement pénitentiaire de Saint-Laurent leur apparut, puis un rideau épais de palétuviers, aux racines énormes, poussant dans la mer même, leur cacha l’intérieur du pays.
Sur une mer dure, coupée de courants rapides qui contrariaient sa marche, l’Eloa avançait lentement. Le 17 février, on eut connaissance des îles du Salut, où sont internés les déportés les plus dangereux et, vers le soir, le navire doubla le rocher de l’Enfant Perdu, surmonté d’un phare, et pénétra dans le port de Cayenne. Marcel et Yvonne se sentaient douloureusement impressionnés à l’approche de cette terre, où la fièvre jaune règne en maîtresse, où tant de braves soldats ont été dévorés par le fléau.
– Une fois dans la ville, leur dit le capitaine, ne buvez que des eaux minérales et vous vous porterez bien. Mais malheur à vous, si vous vous désaltérez à une source ou dans le courant d’un ruisseau !
La recommandation était nécessaire. Des forêts vierges de l’intérieur, les eaux s’écoulent vers l’Océan, charriant les séculaires pourritures d’un sol que la main de l’homme n’a jamais défriché. Elles roulent aussi les paillettes d’or des placers, comme si la nature prévoyante avait voulu mettre le remède auprès du mal. Car c’est le désir du métal précieux qui dirigera tôt ou tard un courant d’émigration vers la Guyane, et apportera à cette riche colonie la main-d’œuvre dont elle a besoin pour devenir florissante.
L’Eloa s’était rangée à quai. Marcel s’approcha du capitaine :
– Señor, lui dit-il, vous repartez demain au jour ?
– En effet.
– Peut-être continuerons-nous le voyage avec vous. Je viens pour affaires, et il n’y aurait rien d’étonnant à ce que je les termine ce soir-même. En ce cas, je ne me soucierais pas de séjourner dans ce pays malsain.
– Ce me sera un plaisir et un honneur de vous conserver à mon bord.
Le jeune homme salua l’aimable officier et rejoignit Yvonne, à qui il répéta la conversation qui précède.
– Pourquoi as-tu fait cela ? questionna Mlle Ribor.
– Pour ne pas séjourner ici. Il nous suffit de nous assurer qu’Antonin n’est pas dans la région. Si, ce que je crains, il n’y est pas venu, nous partons pour Bahia sur l’Eloa. De là, les vapeurs français qui y font escale nous ramèneront vite et confortablement aux Antilles.
Elle baissa la tête, et les yeux humides :
– Mais si nos amis n’ont trouvé de leur côté aucune trace de mon frère ?
– C’est bien simple, nous reviendrons sur nos pas.
– Tu voudrais ?
– Je veux le retrouver, te débarrasser du nom de Canetègne que ce misérable t’a infligé par surprise. Or, mon raisonnement est simple.
– Comme toujours, remarqua la jeune fille en souriant à travers ses larmes.
– Certes. Écoute. Antonin est allé à Madagascar ; les journaux en font foi. Au Tonkin, nous avons eu de ses nouvelles. Depuis, aucun indice. Il doit donc s’être arrêté dans l’une des îles du Pacifique.
Dalvan s’interrompit soudain. Deux hommes, que leurs pantalons de treillis, leurs vareuses et leurs képis bleu-marine à passepoils jaunes, désignaient comme gardiens des pénitenciers, s’approchaient. D’un même mouvement ils firent le salut militaire, et l’un prit la parole :
– Monsieur, mademoiselle, nous sommes chargés de vous conduire à l’hôtel du Gouvernement.
Les voyageurs se regardèrent surpris, vaguement inquiets.
– Êtes-vous sûrs de ce que vous dites ? demanda Marcel.
– Oui, monsieur.
– Vous ne nous connaissez pas, cependant.
– Non, Mais le Gouverneur vous connaît.
Très pâle, car il comprenait qu’un danger menaçait Yvonne, le sous officier promena ses yeux autour de lui. Plusieurs gardes des pénitenciers étaient à peu de distance. Évidemment toute résistance était inutile. Il fallait obéir.
– Conduisez-nous donc, messieurs.
Les hommes s’inclinèrent, et se plaçant à droite et à gauche des jeunes gens, se mirent en marche. Simplet remarqua que les collègues de ceux qui les escortaient suivaient le groupe d’un air indifférent. Son inquiétude augmenta. Mais il n’en fit rien voir à Mlle Ribor. À quoi bon l’effrayer ? Peut-être l’aventure allait-elle se terminer sans encombre.
Cependant, guidés par les gardiens, les jeunes gens s’engageaient dans l’allée des Palmistes, bordée de cocotiers aux troncs élancés, et arrivaient sur la place du Gouvernement. Préoccupés, ils n’eurent pas un regard pour la fontaine monumentale, qui versait en jets bouillonnants une onde claire dans son bassin de pierre. Ils passèrent entre les squares garnis de fleurs, et se trouvèrent devant le pavillon central donnant accès dans l’hôtel du Gouverneur. Leurs compagnons les poussèrent sous le vestibule, échangèrent quelques paroles avec un employé, qui se réveilla à demi pour leur répondre, et pénétrèrent dans une salle située à gauche de l’entrée. Ils avaient fait passer les jeunes gens les premiers, et s’étaient placés devant la porte comme pour leur enlever toute velléité de s’enfuir.
– Eh bien, leur demanda Marcel, que faisons-nous là ?
Ils ricanèrent :
– Vous allez le savoir.
Et soudain, en face d’eux, une autre porte s’ouvrit sans bruit, livrant passage à un homme de figure joviale, complètement vêtu de blanc. C’était le Gouverneur. Derrière lui marchait un individu dont la vue arracha à Mlle Ribor un gémissement :
– Monsieur Canetègne.
Le négociant était là, plus laid, plus hideux que jamais, car une joie méchante brillait dans ses yeux, un rire cruel ridait son visage ravagé par la variole. Sans quitter du regard sa victime, il vint s’asseoir à côté du Gouverneur. Celui-ci fit un effet de manchette, toussa pour éclaircir sa voix, et d’un ton paterne :
– Mademoiselle Yvonne Ribor, reconnaissez-vous M. Canetègne ici présent, votre époux ?
La jeune fille ferma les yeux. Il lui semblait qu’un abîme s’ouvrait sous ses pas et que le vertige l’y entraînait fatalement. Répondre, elle ne le put. De sa gorge contractée aucun son ne s’échappa. Ce fut Dalvan qui parla pour elle :
– En effet, M. Canetègne est le mari de ma sœur de lait.
Sa voix calme rappela Yvonne à elle-même. Elle considéra le sous-officier. Elle le vit blême, les lèvres tremblantes, mais maître de lui.
– Voici un point acquis, reprit le Gouverneur. Or, usant de son droit, M. Canetègne a fait appel à l’autorité pour contraindre sa légitime épouse à réintégrer le domicile conjugal.
– Réintégrer…, interrompit Yvonne.
Mais Dalvan l’arrêta, et doucement, avec un accent étrange dont la jeune fille fut dominée :
– Certainement, petite sœur. Tu n’aimes pas M. Canetègne qui t’a épousée par surprise. Le procédé manque de délicatesse ; seulement ce monsieur est le plus fort, il faut céder.
Et rapidement, il ajouta si bas qu’elle l’entendit à peine :
– Ainsi je n’aurai qu’un ennemi à combattre. Sinon, il nous fait arrêter, et j’ai contre moi toute l’administration de la justice du pays.
Le Gouverneur ne soupçonna pas cette réflexion. Il se frotta les mains d’un air satisfait :
– Vous parlez sagement, monsieur. Et vous, mademoiselle, vous écouterez, j’en suis sûr, les conseils de votre frère. Il nous en coûterait d’user de violence avec vous, et cependant la loi est formelle. Sur la demande de votre mari, nous devons, de gré ou de force, vous reconduire en sa maison.
Yvonne frissonna. Son mari, ce misérable qui se trouvait en face d’elle ! C’était donc vrai ! Elle était en son pouvoir, à sa merci. Elle, innocente, avait été condamnée par les juges. Aujourd’hui l’administration française la livrait sans défense à son ennemi. Elle eut une pensée de révolte. Elle eut envie de mordre, de crier son désespoir, sa honte, son épouvante. Heureusement Simplet suivait sur ses traits mobiles ses diverses impressions. Il arrêta l’éclat qui allait se produire.
– Petite sœur, n’oblige pas M. le Gouverneur à te confier à ses agents. De bon gré, suis M. Canetègne.
Et avec ironie :
– Il n’est ni beau, ni honnête, ni digne. Son visage reflète la beauté de son âme, mais il est ton époux. Suis-le, M. le Gouverneur te permet de lui marcher sur les talons, ce sera ta vengeance.
À force d’énergie, le courageux garçon avait ramené le sourire sur ses lèvres. Il plaisantait, et le Gouverneur, amusé par la scène, opinait du bonnet. Canetègne, qui ne s’amusait pas, se leva et s’inclinant :
– Alors, je puis emmener ma femme ?
– À l’instant.
– Et selon votre promesse, M. le Gouverneur, vous ne rendrez la liberté à ce jeune homme…
– Qu’une demi-heure après votre départ.
Yvonne tourna les yeux vers son frère de lait. Celui-ci demeura impassible.
– Va, petite sœur, ordonna-t-il seulement.
Son calme donna du courage à la jeune fille. Elle eut la force de dire à Canetègne :
– Monsieur, veuillez me montrer le chemin.
Celui-ci, étonné, mais triomphant, ne se fit pas répéter l’invitation. Il salua le Gouverneur et se dirigea vers la sortie, non sans jeter à Marcel un coup d’œil narquois. Alors, Mlle Ribor hésita. Elle fit un pas vers Dalvan, les mains tendues, suppliante et désolée. Il l’écarta du geste et redit d’une voix ferme :
– Va, petite sœur.
Elle courba la tête, et dominée par la volonté du sous-officier, elle sortit lentement, accompagnée par le commissionnaire et les deux agents qui l’avaient amenée. La porte se referma derrière eux.
– Monsieur, fit alors le Gouverneur à Simplet immobile, monsieur, croyez que je regrette d’être mêlé à tout ceci. Mon devoir hélas ! est de veiller à l’application des lois. Tâche ingrate, monsieur. Enfin, vous êtes mon prisonnier pour trente minutes seulement. Laissez-moi vous offrir un grog comme vous n’en trouverez pas dans toute la colonie. Du tafia première marque, du lait de coco frais et de la glace fabriquée chez moi.
L’invitation fut acceptée, et bientôt Dalvan pénétrait avec son hôte dans une autre pièce de l’hôtel, ou des pankas se balançaient automatiquement donnant à l’air une fraîcheur relative.
Le Gouverneur, très aimable homme, présenta son hôte à sa femme qui se trouvait là, étendue sur une chaise à bascule. Celle-ci, créole nonchalante et gracieuse, daigna tendre la main au visiteur. Bien plus, elle consentit à préparer elle-même la boisson promise par son mari. Ses yeux noirs ne quittaient pas le visage de Marcel. Évidemment le sous-officier l’intéressait. Un greffier vint prier le Gouverneur de passer à son bureau pour recevoir un pli du commandant du port. La créole demeura seule avec Dalvan.

Alors son attitude changea. Elle courut à lui.
–… Le temps presse… Mon mari ne me pardonnerait pas s’il savait… mais il le faut. Vous me plaisez, et cette jeune femme aussi. Mariée à un si vilain homme, si vilain que les maraïos – (oiseaux du pays qui se terrent comme les lapins) – en auraient peur. Il est arrivé huit jours avant vous. Il avait pris un bateau direct… Il a emmené la jeune dame à bord d’un cutter à vapeur qu’il a loué. Maintenant il doit être sorti du port, mais il va relâcher le long de la côte, à quelques milles de Cayenne, près de la rivière Tanute. De là, les agents seront ramenés ici par le canot, qui ralliera ensuite le bateau. J’oubliais de vous dire son nom : le Véloce. Puis il s’éloignera pour une destination inconnue.
Et comme le jeune homme voulait remercier la charmante créole :
– Taisez-vous, dit-elle, mon mari revient. Pas un mot. Sauvez votre amie, j’en serai heureuse.
Le gouverneur rentra et trouva sa femme très occupée à mélanger la glace et le lait de coco, opération délicate d’où dépend la saveur du rafraîchissement guyannais.
Souriant, Marcel dégusta le breuvage, puis il prit congé du fonctionnaire qui ne le retint pas, la demi-heure étant écoulée. Seulement, avant de partir, le sous-officier serra doucement la main de la jolie créole qui l’avait renseigné.
– Madame, dit-il, j’ai lu jadis un roman de chevalerie. Un certain Amadis de Gaule était assuré du succès, lorsqu’au début de sa course il rencontrait une bonne fée. Je vous remercie de vous être trouvée sur mon chemin.
– Quel madrigal ! exclama le gouverneur, ma femme, une fée !
– Elle en a les yeux, cher monsieur. Et les yeux, vous le savez, sont des fenêtres où vient respirer l’âme.
Sur ces mots, Dalvan salua derechef la créole, doucement émue et sortit. Le gouverneur éclata de rire, et se rapprochant de sa femme :
– Eh bien ! Luina… tu le vois. Tu avais tort comme toujours, avec tes suppositions romanesques. Quand je t’ai parlé de ces jeunes gens qu’il me fallait séparer, tu as jeté les hauts cris : ils vont être malheureux ! Et pas du tout. Il rit, prend du tafia, et ma parole, il allait engager un flirt avec toi.
La gentille femme eut un sourire énigmatique et répondit :
– Tu as raison comme toujours, toi. Les hommes sont décidément plus clairvoyants que nous autres, pauvres épouses.
Cependant Dalvan avait quitté l’hôtel. Il gagna la rade. Sur le quai, un matelot fumait sa pipe dans l’étroite zone d’ombre d’une pile de ballots. Le sous-officier alla vers lui :
– Il fait chaud, hein ? commença-t-il.
– Un peu. Chômage pour les calfats, monsieur. Le goudron coule comme de l’eau.
– Chômage pour tout le monde. Je regarde autour de moi, tout semble dormir à terre et à bord des navires qui sont sur rade.
– Bien sûr. Et cependant il y a des gens qui font trimer leur équipage malgré cette température de four !
Simplet tressaillit. Le matelot qu’il voulait interroger, venait au devant de ses questions :
– De qui parlez-vous donc ? reprit-il d’un air indifférent.
– D’un satané terrien, soit dit sans vous offenser, qui vient de quitter le mouillage avec son bateau, le Véloce qu’il s’appelle. En voilà un qui ne m’inscrira pas sur son rôle d’équipage.
Le mathurin était lancé. Il aurait continué longtemps sur ce ton, si Dalvan ne l’avait interrompu :
– Est-ce que vous connaissez le pays ?
L’autre sursauta :
– Si je le connais ? Tiens donc, je fais le cabotage. Bien sûr que je le connais !
– Alors vous pourriez m’indiquer le chemin à suivre pour arriver à la rivière Tanute.
– Le chemin, répéta l’homme avec un gros rire, le chemin ? Bien sûr, quoique pour des braves gens, cela ne puisse pas se nommer un chemin.
– Enfin par où dois-je me diriger ?
– Tenez, vous voyez là-bas des maisons entourées d’un mur… à votre droite sur le plateau qui domine la ville ?…
– Oui.
– C’est le pénitencier. Un peu plus loin, il y a d’autres constructions : la briqueterie et les écuries des travaux. Vous passerez entre les deux, et vous arriverez en face du bac qui fait la traversée entre l’île de Cayenne et la terre ferme. Une fois là, plus de route. Faudra marcher parallèlement à la mer, en vous écartant autant que possible des palétuviers qui la bordent ; car ces arbres là, ça pousse dans la vase, et dame, on s’embourbe. La rivière Tanute est à quatre kilomètres.
– Merci, mon ami, j’y vais.
Et laissant le matelot, Marcel se mit en marche. Il longea l’enceinte du pénitencier, trouva le bac, traversa le canal qui isole Cayenne de la terre, et prit pied sur le continent. Le marin ne l’avait pas trompé.
Brusquement toute trace du travail des hommes disparaissait. En quittant les sentiers de l’île bien entretenus, le contraste était frappant. Devant lui, Dalvan apercevait une plaine couverte de hautes herbes, que dominaient quelques arbustes. À sa droite, des palétuviers au feuillage terne, dont la ligne sinueuse indiquait le tracé de la côte. À gauche, la muraille verte de la forêt vierge, qui s’étend du rivage à la cordillère des Andes. Il éprouva un sentiment d’isolement, de tristesse, mais il le domina bientôt :
– Mon chemin est tout tracé. Entre les palétuviers et la forêt, je ne risque pas de m’égarer. C’est simple…
Il s’arrêta au milieu de sa locution favorite pour murmurer :
– Pauvre chère Yvonne !
Et il se mit en route. Tout alla bien d’abord. Le sol rocheux, sur lequel germaient quelques herbes déjà desséchées, se prêtait à l’allure impatiente du jeune homme, mais bientôt, la pierre disparut, faisant place à une terre spongieuse, humide, couverte d’une épaisse végétation herbacée. Le sous-officier dut ralentir sa marche. À chaque pas, il s’enlisait jusqu’à la cheville et il lui fallait un vigoureux effort pour débarrasser son pied de l’étreinte de la gangue boueuse. Puis un marigot, étang bourbeux, lui barra le chemin.
À la surface de l’eau, des formes noires, rigides se montraient. Des alligators, avertis par le bruit de l’approche du voyageur, attendaient la proie possible. Ils décrivaient des cercles, bruns dans l’eau jaunâtre, faisant claquer leurs formidables mâchoires. Des roseaux s’élevait une nuée d’insectes dont le bourdonnement continu agaçait Simplet, d’autant plus que, plusieurs moustiques, plus avisés ou plus affamés que les autres, le piquaient déjà.
Il dut battre en retraite et par un long détour contourner le marigot. Maintenant il suivait la lisière de la forêt, mais là d’autres dangers se montraient à lui.
Tantôt une araignée monstrueuse, au corps velu gros comme une noix de coco, suspendue à son fil, oscillait en travers de la route, cherchant à l’atteindre au passage. Avec horreur, le sous-officier songeait que la piqûre de ces monstres est mortelle, et il pressait le pas, avide d’arriver au but de son voyage.
Plus loin, des bruissements étranges se produisaient dans les buissons et les corps cylindriques de serpents se montraient une seconde entre les branchages.
Durant cinq heures, Dalvan marcha ainsi, environné par la mort, suivant l’énergique expression du poète portugais. Enfin la rivière Tanute se montra. Dans la crique où elle se jetait, le Véloce, affourché sur ses ancres, se balançait mollement. Simplet eut un cri de joie. Il était arrivé. La prison flottante de sa chère Yvonne était sous ses yeux.
Du haut d’une butte rocheuse, parsemée de pierrailles, il regardait, accroupi derrière de maigres buissons. La pente de l’élévation venait mourir dans la vase, où croissaient sur une profondeur de cent mètres les lugubres palétuviers.
Le jour baissait. Bientôt, à la nuit venue, le sous-officier gagnerait le rivage. En quelques brasses, il atteindrait le navire et alors… Alors, un point d’interrogation se posait en son esprit. Que ferait-il ? Emporté par le désir de rejoindre sa fiancée, de l’arracher au monstre qu’une union frelatée avait fait son mari, il était parti sans plan arrêté. Et maintenant il comprenait combien son entreprise était hasardeuse, combien elle avait chance d’échouer.
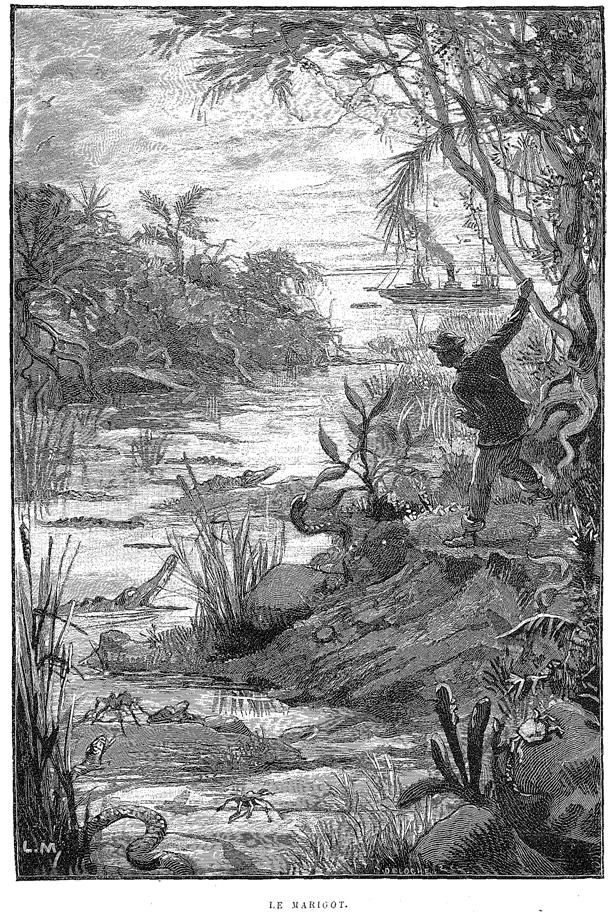
L’ombre s’épaississait avec cette rapidité particulière aux pays intertropicaux. Déjà la crique était invisible, et Dalvan demeurait immobile, cherchant en vain l’idée heureuse qui le conduirait au succès.
Tout à coup son attention fut appelée par un cliquetis bizarre. Il leva la tête. Le bruit continua. Il semblait venir du pied de l’escarpement. C’était comme un fourmillement d’objets métalliques. Le son se renforçait. Quels êtres le produisaient donc ? Le bruit augmentait. Cela approchait. On eut dit que cela gravissait le flanc de l’éminence.
Comme le voyageur inquiet se tenait l’oreille aux aguets, la lune, masquée jusque-là par la cime des arbres de la forêt, se montra, inondant de sa lumière claire la butte et les alentours. À vingt pas au-dessous de lui, le sous-officier aperçut quelque chose de monstrueux et de terrible.
Une armée de crabes bleus montait à l’assaut du rocher. Ils étaient là par milliers, se pressant, se bousculant, enchevêtrant leurs pattes pour atteindre plus tôt la proie, dont leur instinct leur avait annoncé la présence.
Les cheveux de Marcel se hérissèrent sur sa tête. Il se souvenait des histoires de forçats évadés dévorés par les crabes. Il avait ri comme tout le monde à ces récits, mais à cette heure, devant cette légion de pinces ouvertes, de gueules avides, il comprenait la lutte impossible, désespérée, la défaite fatale de l’homme surpris par les redoutables crustacés.
Puis le sourire revint à ses lèvres.
– Bien simple, murmura-il, je vais mettre le feu aux buissons.
Mais il s’arrêta soudain :
– Le feu !… Impossible. On l’apercevrait du Véloce. Ce serait me trahir. Et pourtant, je ne puis me laisser dévorer par ces bêtes immondes.
De nouveau il vint à l’extrémité du plateau. Les crabes s’étaient rapprochés de dix mètres. Dans deux minutes, ils feraient irruption sur le sommet de l’éminence.
Effrayant était le tableau. Tout un côté de la butte était couvert par le flot mouvant, et tout en bas, des vases livides, entre les racines des palétuviers, émergeaient d’autres ennemis.
Marcel était brave, et cependant, durant quelques secondes, il perdit la tête. Le danger qui se présentait à lui n’était pas de ceux auxquels on fait face. Il avait quelque chose de fantastique, de surnaturel. Le sous-officier avait l’impression vague d’être poursuivi par une bête apocalyptique aux pattes innombrables, aux bouches insatiables.
Fébrilement il marchait, les yeux hagards fixés sur les premiers rangs des assiégeants. À cet instant suprême son pied heurta une pierre. Celle-ci, sans doute en équilibre instable, pivota sur elle-même et dévala la pente à droite de la colonne effroyable des crabes.
Ô surprise ! Au lieu de continuer leur ascension en ligne droite, les crustacés obliquent dans la direction du bruit.
Simplet les a vus. Il a compris. Un moyen de salut s’offre à lui. La bande affamée s’étend entre lui et les palétuviers. Il lui faut la détourner de sa route. Et avec ardeur, il ramasse des pierres, les précipite sur le flanc du coteau, toujours plus loin sur la droite, des assiégeants. Comme une armée disciplinée, les crabes bleus font une conversion. Ils courent au son, laissant libre le chemin que doit suivre Dalvan.
Celui-ci ne perd pas de temps. En hâte, il emplit ses poches de cailloux. Qui sait ! il aura peut-être d’autres ennemis à dépister. Dans une course éperdue, il descend l’éminence. Les crabes reviennent vers lui, mais ils ont beau se hâter, le jeune homme les distance. Il va, touchant à peine le sol, et tout à coup, la terre cède sous ses pieds. Il enfonce jusqu’aux genoux dans la vase.
– Bah ! fait-il en riant, un bain de pieds, c’est excellent.
À portée de sa main se recourbe une racine de palétuvier, il la saisit, se hisse sur elle et respire. Pour l’heure, il est en sûreté. Le tronc des arbres singuliers qui lui donnent asile ne touche pas la vase. Il est supporté par d’énormes racines, recourbées ainsi que les pattes d’une araignée géante et s’enchevêtrant en arceaux au-dessus de l’eau.
C’est un pont improvisé par la nature. Avec précaution, Marcel s’y hasarde. Il passe d’une racine à l’autre ; chancelant, se cramponnant aux branches. Sous ses pieds, la vase s’agite, bouillonne. Des têtes hideuses, trouent sa surface jaunâtre, les monstres nés de l’ombre et de la pourriture grouillent, ils semblent indignés de voir un homme dans leur repaire inviolé.
Et Simplet avance toujours, défendu contre les farouches habitants du sous-bois par la hauteur des racines. Il va. Le rideau d’arbres devient moins épais. Entre les tiges rousses des palétuviers, la mer apparaît sur laquelle la lune plaque des taches lumineuses. Un dernier effort ! Le soldat atteint la première rangée d’arbres. Aucun obstacle n’arrête plus sa vue. À dix brasses de lui, le Véloce dessine sa silhouette sombre à la surface des flots.
Le cœur palpitant, il songe qu’Yvonne est là. Il a un irrésistible désir de se laisser glisser dans l’eau et de gagner le navire, mais il songe encore que Canetègne a sous ses ordres un équipage, et que lui, Simplet, est seul. Avant d’agir, il lui faut trouver une idée.
Il cherche, les yeux fixés sur la mer. D’étranges visions troublent ses pensées. Dans le clapotis des vagues, il croit voir passer des formes singulières. On dirait des triangles noirs qui vont, reviennent, décrivent des circonférences. Qu’est cela ? Ah ! il comprend et il frissonne. Les requins pullulent dans les parages de la Guyane. Ce qu’il aperçoit, c’est la nageoire dorsale des monstres, l’aileron comme disent les marins.
Un péril écarté, un autre surgit. Entre le navire, prison d’Yvonne, et lui, une troupe de squales fait sentinelle. Ils attendent une proie : bête, chose ou homme.
Cette fois, une sueur froide perle aux tempes du sous-officier. Ce danger qu’il voit, il va devoir l’affronter. Pour gagner le Véloce, il faut qu’il se mette à la nage, qu’il fasse une trouée au milieu des plus féroces, des plus dangereux des hôtes de l’Océan. C’est vraiment trop tenter la mort.
Le temps vole. Simplet demeure immobile, les yeux fixes, hypnotisé par les circuits incessants de ces ailerons dont il ne peut détacher ses regards. Mais que se passe-t-il donc ? À quelque distance, une masse noire glisse lentement sur l’eau. C’est le canot du Véloce. Il a ramené à Cayenne les gardiens qui ont escorté Mlle Ribor jusqu’à la rivière Tanute, et il rejoint son bord.
Marcel n’a pas le loisir de se demander d’où vient l’embarcation. Un nouvel incident appelle son attention. De la cheminée du Véloce s’échappent des volutes de fumée piquées d’étincelles. Plus de doute, le steamer attendait son canot. Il va lever l’ancre, emporter la prisonnière vers une destination inconnue. À jamais elle sera perdue pour le brave garçon qui lui a dévoué sa vie. Alors, il n’hésite plus. Il va se jeter à l’eau. Non, il s’arrête encore. Pourquoi ?
– Suis-je bête, se dit-il. Je n’y songeais pas. C’est pourtant simple. Les requins ne sont pas plus malins que les crabes.
En hâte, tout en évitant de faire du bruit, il coupe quelques branches de grosseur moyenne, les réunit en un fagot. Comme il finit, le canot accoste. Les marins qui le conduisent, montent à bord, laissant l’embarcation à la remorque. Des tourbillons de fumée noire s’envolent de la cheminée du navire. Il va s’éloigner. Alors Simplet armé de son fagot, quitte son observatoire et se laisse couler dans la mer.
Il nage vigoureusement. Parfois s’appuyant sur les branches qu’il entraîne, il s’élève un moment au-dessus de l’eau. Il regarde autour de lui. Il est arrivé à mi-chemin. Soudain les ailerons des requins se montrent. Eux aussi se dirigent vers le bruit que fait le nageur. La situation est terrible, mais Simplet ne change pas de visage. Il prend un des morceaux de bois et le jette à quelque distance. Aussitôt les squales s’élancent vers l’endroit où l’eau a jailli sous la chute du projectile. Trois fois il répète cette manœuvre et atteint le canot du Véloce. Avec peine il se hisse sur le bordage. Il est sauvé.
– Mâtin, s’avoue-t-il, il était temps. Je ne sais pas si c’était l’émotion qui me paralysait, mais j’étais d’un lourd. Je crois que, sans mon fagot, j’aurais coulé à pic.
Il retient avec peine une exclamation. Il a porté la main à sa poche, et la raison de ce poids, qui le tirait vers le fond, lui est expliquée. Il est chargé des cailloux ramassés sur le rocher pour dépister les crabes bleus.
Un à un il les retire, et les dépose sans bruit dans le bateau. Un mouvement se produit. Il manque tomber. Avec peine il conserve l’équilibre. Le Véloce s’est mis en marche et prolonge la côte, entraînant dans le remous de son hélice, le canot qui porte le défenseur d’Yvonne.
XXXV
PERDUS EN MER

Yvonne, gardée comme une criminelle par deux agents, avait été conduite à bord du Véloce. Enfermée dans sa cabine par l’ordre du misérable qu’elle ne pouvait se résoudre à appeler son mari, elle s’était assise sur sa couchette et était restée dans une immobilité désolée.
Où était Simplet ? Que faisait-il ? Parviendrait-il à la rejoindre ? Voilà ce que la pauvre enfant se demandait avec une épouvante sans cesse croissante. Car, s’il ne réussissait pas, elle demeurerait la propriété de l’Avignonnais, de ce fourbe auquel, de par les lois françaises, elle devait obéissance.
Obéissance !… Le mot était gros de conséquences. Le cœur de la jeune fille se brisait à la pensée que, pour la vie entière, elle était indissolublement liée à ce gredin sans âme et sans scrupules, qui, après avoir ruiné le frère, désespérait la sœur sans défense. Longtemps elle ressassa les mêmes pensers, puis le balancement du navire lui indiqua qu’il se remettait en marche.
Elle en éprouva comme un déchirement. S’il quittait les eaux de la Guyane, son dernier espoir s’évanouissait ; comment Simplet retrouverait-il sa trace sur les vagues mobiles de l’océan.
– Simplet, s’écria-t-elle en fondant en larmes, Simplet. Adieu !
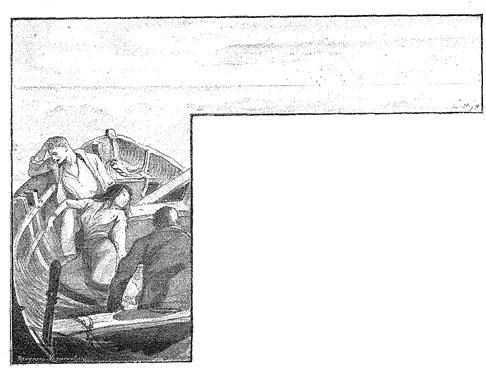
Simplet, ce surnom ironique donné à son ami, alors qu’elle le méconnaissait, elle le redisait aujourd’hui avec une tristesse profonde, un regret douloureux. En vain Simplet s’était dévoué ; en vain il avait bravé la mort pour elle. Il était vaincu par la ruse diabolique de Canetègne. Et son voyage épique, sa fidélité, son attachement, ne lui laisseraient qu’une amère désillusion. Le rêve un instant caressé d’être l’époux d’Yvonne réhabilitée par lui, ne se réaliserait jamais.
Elle porterait ainsi qu’un boulet le nom de Canetègne, et Marcel vivrait seul, découragé, aigri, cherchant dans le ciel noir l’étoile néfaste qui présidait à ses tourments. Elle frissonna en entendant ouvrir la porte de sa cabine. Sur le seuil Canetègne se montra. À sa vue, elle ne put retenir un cri de frayeur :
– Té, ma chère femme, fit l’Avignonnais, n’ayez point de crainte. Je vous ai enfermée un peu pour vous soustraire aux moustiques guyanais, mais à présent, pécaïre, vous êtes libre.
– Libre ! redit-elle amèrement.
– Certainement. À preuve que si vous voulez faire un tour sur le pont…
Elle secoua la tête.
– Non. Tant mieux. Je préfère cela. Comme nous avons à causer.
Tout en parlant, le négociant faisait mine de s’asseoir à côté de Mlle Ribor. Celle-ci se leva vivement.
– Vous m’avez dit que la promenade sur le pont m’est permise.
– Eh oui, donc !
– Alors, nous causerons là-haut, ou plutôt vous causerez, car moi, je n’ai rien à vous dire.
– Nous verrons bien, railla Canetègne en s’effaçant pour laisser sortir la jeune fille.
Sur le pont, Yvonne se sentit plus à l’aise. Il lui semblait que dans le grand enlacement de la brise marine, à l’abri du ciel chamarré d’étoiles-soleils, elle avait moins à redouter son ennemi. Et puis l’espoir lui était revenu. En regardant à bâbord, elle apercevait la ligne noire de la côte. Le Véloce ne gagnait donc pas la pleine mer. Marcel aurait ainsi plus de chances de la rejoindre.
Elle gagna l’arrière du navire, oubliant que l’Avignonnais la suivait. Mais il n’était pas homme à la laisser longtemps à ses réflexions.
– Là, fit-il, je crois que nous sommes bien ici pour nous expliquer.
Elle tressaillit, brusquement ramenée à l’horreur de sa position.
– Tout d’abord, ma chère femme…
Sur un mouvement d’Yvonne, le coquin reprit :
– Ma chère femme, vous l’êtes ; que vous le vouliez ou non. Le plus sage serait d’en prendre votre parti.
– Jamais ! dit-elle nettement.
– Bon ! serments de fillette, on vous rendra raisonnable. Où est-il le bonheur sur la terre ? Dans la fortune, hé ! Vous serez riche, ma mie ; car pour votre bien, je suis un homme pratique. En voulez-vous la démonstration ?
Elle eut un geste vague qui signifiait : cela m’est indifférent. Le rusé négociant feignit de se méprendre sur le sens de la réponse mimée et toujours souriant :
– Oui. C’est gentil. Donc vous êtes venue à Cayenne avec ce galopin qui croyait avoir raison de mon expérience. Qu’avez-vous vu ? Qu’avez-vous fait ? Rien. Moi, j’y suis arrivé il y a huit jours à peine, et j’ai jeté les bases d’une superbe opération, sans risques aucun.
Il passa sa main dans son gilet, geste avantageux emprunté à Napoléon Ier et, baissant la voix :
– Voilà la chose. En attendant que vous oubliiez vos petits rêves de jeune fille, vous êtes mon associée. Il faut donc que vous soyez informée de ce qui intéresse la communauté. Quelles sont les richesses de la Guyane ? Les bois d’ébénisterie et l’or des placers. Les exploiter soi-même, c’est se condamner à des déboires, des fatigues et des dangers sans nombre. Eh bien ! moi malin, je n’exploite pas.
Il respira. Le contentement de lui-même l’essoufflait.
– J’ai signé un traité avec les nègres Bonis, ces hardis bateliers qui s’enfoncent dans l’intérieur des terres en suivant le cours des rivières. Ils formeront des trains de bois, que le Véloce viendra attendre en des points désignés, lorsqu’il nous aura déposés dans le pays, où je compte séjourner jusqu’à ce que vous deveniez raisonnable.
– Quel pays ? ne put s’empêcher de dire Yvonne.
– Peuh ! vous le verrez. Pour en revenir à mes bois flottés, je les prends à la côte presque sans frais, et je les vends ce que je veux. L’ébénisterie manque de matière première. Ce n’est pas tout. J’ai embauché quelques indiens Roucouyennes employés sur les placers. Ceux-ci garderont une portion des pépites qu’ils découvriront et les remettront, contre une somme dérisoire, à un homme que j’ai installé à Cayenne. Pour cent mille francs, j’aurai bon an, mal an, quatre cent mille francs de pépites, et cela sans frais d’exploitation, ce qui tue les entreprises minières.

Il triomphait, incapable de comprendre la malhonnêteté de ses procédés. Il ne vit pas la moue de dégoût par laquelle Mlle Ribor exprima sa pensée. Mais comme elle se taisait, il la crut ébranlée par rémunération de ses fructueuses affaires, et il voulut la gagner tout à fait.
– Maintenant, poursuivit-il d’un ton dégagé, maintenant, vous êtes assurée d’avoir le nécessaire ; laissez-moi aborder la question de sentiment.
– À quoi bon, commença-t-elle…
– À vous montrer que je ne suis pas si mauvais diable que d’aucuns ont essayé de vous le faire croire.
Les sourcils d’Yvonne se froncèrent.
– D’aucuns… répéta-t-elle sèchement, ce sont mes amis, mes défenseurs que vous désignez ainsi. Vous avez tort de les accuser. Je me suis fait une opinion toute seule, et si elle est mauvaise, ne vous en prenez qu’à vous-même.
Le négociant continua de sourire :
– Oui, oui, vous me gardez rancune, je sais, té ! et je comprends cela. Que voulez-vous ? on se défend comme on le peut. Je ne voulais pas que vous retrouviez votre frère… aujourd’hui, je n’ai plus les mêmes raisons et…
– Vous savez où est Antonin ?
Mlle Ribor joignait les mains. À la pensée de revoir son frère, elle oubliait à quelles terribles épreuves l’avait condamnée l’Avignonnais. Celui-ci se dandinait d’un air satisfait de lui-même.
– Faitement ! je le sais.
– Oh ! parlez. Dites-moi où il se tient, et je vous pardonnerai le mal que vous m’avez fait.
– Bon le mal… ça n’est pas du mal, puisque c’était pour votre bien.
– Mais Antonin ?…
– Un peu de patience donc. Vous le reverrez.
– Quand ?
– Dès que vous serez devenue une femme dévouée.
Les joues d’Yvonne prirent des tons de cire.
– Une femme dévouée, redit-elle avec désespoir.
Un instant l’espoir de retrouver le cher absent avait lui. Folle qui avait cru à la générosité de Canetègne. C’était un marché qu’il lui proposait. Une terreur l’envahissait. Si elle refusait, qu’adviendrait-il du jeune voyageur ?
– Mais, continua le négociant ravi de son « effet », comme vous êtes en mon pouvoir, que l’océan vous isole de mes adversaires, rien ne s’oppose à ce que je vous apprenne sous quel ciel respire mon ex-associé. Du même coup, vous verrez que, pour lutter contre moi, il faut être d’une jolie force.
Et après un temps :
– Sachez, ma chère femme – vous ne vous figurez pas combien il m’est doux de vous donner ce nom – sachez donc que j’ai joué vos amis par dessous la jambe. Vous m’en remercierez un jour, je suis tranquille. Antonin n’a jamais mis le pied sur le sol de Madagascar. La note des journaux avait été rédigée par moi.
– Par vous !
– Mais oui, comme je vous le dis.
– Oh ! gémit Yvonne, mais alors nos peines étaient sans but, nous nous démenions pour rien.
– Pour rien, gouailla Canetègne.
– Cependant, reprit la jeune fille, au Tonkin ?
– Pas davantage.
– Cet annamite qui nous a déclaré l’avoir accompagné ?
– Un brave garçon, payé par moi.
Elle se tordit les mains dans un accès de rage impuissante. Le commissionnaire murmura :
– Pas besoin de vous désoler. Ma femme retrouvera ce frère adoré, si elle consent à m’écouter avec calme.
Elle fit oui de la tête, incapable de prononcer une parole. Son cœur battait avec violence, ses yeux voyaient trouble. Instinctivement sa main se crispa sur une « bosse » – agrès qui maintient à l’arrière les bouées de sauvetage. – Elle ressentit une commotion. Il lui sembla que le cordage pendant à l’extérieur du bastingage était brusquement secoué. Surprise, elle se pencha vivement et retint avec effort un cri. Une forme noire suspendue à la bosse se hissait lentement le long de la coque du steamer.
Yvonne regarda l’Avignonnais. Celui-ci ne s’était aperçu de rien. Sans doute, il préparait ses dernières révélations. Elle quitta sa place, et obligeant aussi son ennemi à tourner le dos à la poupe, elle questionna :
– J’écoute. Qu’avez-vous à m’apprendre ?
– Ceci. Antonin, mon beau-frère, est parti de Saint-Louis, au Sénégal. Il a remonté le fleuve, a gagné le Niger, puis Tombouctou.
– Ah !
– Là, les Touaregs l’ont capturé, dépouillé de tout ce qu’il possédait…
– De tout, gémit la jeune fille.
– Oui, même d’une certaine photographie que vous recherchiez, méchante…
– Je suis perdue. C’était la preuve de mon innocence…
– Je vous en ai fourni une autre en vous épousant. Il faudra vous en contenter. Dernièrement Antonin a pu s’échapper, fuir la tribu où il vivait…
Et tirant une lettre froissée de sa poche.
– Voici quelques lignes qui sont arrivées au magasin, à Lyon, et que Mlle Doctrovée, obéissant à un cablogramme que je lui ai envoyé de San Francisco, m’a expédiées à Cayenne.
Mlle Ribor saisit avidement le papier et à la clarté d’une allumette que M. Canetègne fit galamment flamber, elle lut :
« Bref, je leur ai échappé. Je marche vers le lac Tchad et de là, je descendrai vers le Gabon suivant l’itinéraire de nos explorateurs. Sans doute par cette voie, j’éprouverai moins d’hostilité de la part des tribus… »
Il n’y avait pas de doute. C’était bien Antonin qui avait tracé ces mots. Mais le commencement et la fin de l’épître avaient été déchirés ; pourquoi ? La jeune fille ouvrait la bouche pour interroger le négociant, quand ses yeux se portèrent à l’arrière.
Une silhouette d’homme enjambait le bastingage. Plus que ses regards, son cœur reconnut Simplet. C’était lui, lui qui fidèle à sa promesse, venait au milieu de l’océan au secours de sa sœur de lait.
– Eh bien ? fit Canetègne, que pensez-vous des nouvelles que je vous donne ?
Elle eut peur en l’entendant parler. Elle avait oublié sa présence. S’il apercevait Marcel, le sous-officier serait arrêté par l’équipage, mis aux fers, réduit à l’impuissance. Tendant ses nerfs, elle réussit à sourire, et doucement :
– Alors, vous me conduirez vers cette Afrique mystérieuse où mon frère souffre ?
– Bé sans doute ; si vous êtes raisonnable.
– Raisonnable, chuchota une voix à l’oreille du négociant. Voilà un mot grave, monsieur Canetègne, nous allons voir si vous prêchez d’exemple.
Et empoignant l’Avignonnais par le cou, Marcel, car c’était lui, appuya le canon de son revolver sur le front du coquin :
– Si vous criez, je tire.
– Hein ? quoi ? balbutia Canetègne faisant de vains efforts pour se dégager.
– Immobile, ou je vous tue.
À cette recommandation, il cessa de s’agiter, mais ses yeux écarquillés considéraient Marcel avec épouvante. D’où sortait-il ? Comment se trouvait-il là ? Le sous-officier l’entraînait vers l’arrière. Il donnait des ordres à Yvonne :
– Petite sœur. Prends un filin. Bien ! Attache solidement les chevilles de ce bon M. Canetègne. Parfait ! Aux poignets maintenant. Tu as assez de corde ? Fixe-lui les bras le long du corps. Notre homme est transformé en saucisson. À présent, mets-lui ton mouchoir en bâillon sur la bouche. Elle obéissait sans savoir à quoi tendait Dalvan. Canetègne bâillonné et ficelé, le sous-officier l’amarra par le milieu du corps à une des « bosses » et le descendit dans le canot, après ce simple avertissement :
– Si quelqu’un vient à votre secours, je lâche tout.
– Que fais-tu ? demanda la jeune fille.
– Je l’emmène avec nous. Ici, il ne manquerait pas de nous poursuivre, le vapeur rattraperait notre bateau. Tandis qu’en nous imposant sa société, désagréable j’en conviens, nous n’avons rien à craindre de semblable.
– C’est vrai, c’est simple…
Il rit silencieusement :
– Petite sœur. Tu me prends mes mots.
– Non, c’est toi qui me les donnes.
Tout en parlant, il ramenait le cordage et attachait Yvonne qu’il descendit à son tour dans la chaloupe. Pour lui il se laissa glisser le long de la « bosse » avec l’agilité d’un singe, et rejoignit sa compagne et son prisonnier. Sans prendre le temps de respirer, il trancha l’amarre qui reliait le canot au Véloce, et le steamer continua sa route, abandonnant en arrière la frêle embarcation qui, saisie par un courant, dérivait lentement vers le sud.
L’un des bancs, arraché de son alvéole, fut disposé à l’arrière en manière de godille, et le soldat essaya de gagner la terre.
Durant une heure il lutta vainement. Le courant entraînait l’esquif vers la pleine mer, avec une vitesse telle que Simplet ne réussit pas à gagner un mètre. Pour comble de malheur, la lune se voila de nuages. Un manteau opaque d’obscurité s’étendit sur les flots, cachant la terre, enlevant au rameur tout point de direction. Il n’y avait plus qu’à se croiser les bras. Auprès d’Yvonne, Dalvan s’assit.
– Tu es fatigué, fit-elle.
– Un peu.
– Bah ! repose-toi. Au jour nous aborderons.
– Au jour, murmura-t-il avec tristesse. Où serons-nous ?
Canetègne, étendu au fond du canot et débarrassé de son bâillon, supplia son vainqueur de le déficeler. Son vœu exaucé, il se glissa à l’avant et n’en bougea plus. Toute la faconde du méridional s’était évanouie. En se trouvant aux mains de son adversaire, entre ciel et eau, la voix de la couardise s’élevait seule en lui. La peur tenait ses paupières ouvertes.
Pas plus que lui, Marcel ne dormait. Yvonne seule reposait, la tête appuyée sur l’épaule de son frère de lait. Et lui, assombri, songeait que chaque minute les écartait de la terre, les entraînait sans résistance possible vers un but inconnu. Longues furent les heures de la nuit. Le jour vint. Anxieusement Simplet scruta l’horizon. Plus aucune terre en vue.
– Tiens, remarqua Yvonne en se réveillant, on ne voit plus la côte.
Canetègne sursauta. Il promena un œil hagard autour de lui :
– C’est vrai, monsieur Dalvan, ramenez-nous à terre. En pleine mer, dans une barque, je n’aime pas cela. C’est une mauvaise plaisanterie. Vite, mettez le cap sur le rivage, je prendrai l’aviron s’il le faut.
Dalvan ne bougea pas. Mlle Ribor se pencha à son oreille :
– Accepte donc. Ce sera la vengeance de le voir ramer…
Mais elle s’arrêta net. Il avait secoué la tête avec découragement, et comme l’Avignonnais répétait :
– Té… je saisis l’aviron.
– Inutile, répondit-il.
– Inutile ?
– Oui. Nous sommes entraînés par un courant, et à cette heure, je ne sais plus dans quelle direction est le continent.
Ses interlocuteurs furent suffoqués par cette révélation. Canetègne devint très rouge, puis blême, puis vert…
– Entraînés par un courant !
– Est-ce vrai ? murmura Yvonne.
– Trop vrai. Je m’en suis aperçu cette nuit. Emportés vers la haute mer, nous n’avons qu’un espoir : être rencontrés par un navire.
– Pécaïre ! c’est exact, exclama le commissionnaire. Un navire. Eh ! il y en a beaucoup dans ces parages. Surtout des navires français.
Il riait, pensant que sur un steamer à la flamme tricolore il reprendrait l’avantage. Il redevint grave en voyant Marcel se lever, les poings fermés.
– Souhaitez, monsieur Canetègne, que nous ne soyons pas recueillis par un vaisseau français.
– Pourquoi cela ?
– Parce que je ne vous permettrai pas de monter à bord.
– Vous ne permettrez pas ?
– Non, monsieur. Regardez à la surface de l’eau, que voyez-vous ?
– De grands poissons noirs-gris.
– Ce sont des requins.
– Des requins ? Sapristi, mais c’est féroce !
– Certes. Pensez-vous que l’homme qui tomberait à la mer pourrait songer à gagner un navire ?
– Brrr ! vous me faites frémir avec vos suppositions.
– Frémissement salutaire, monsieur Canetègne. Eh bien, si vous voyez les trois couleurs, frémissez encore plus. Car alors vous êtes certain de faire le plongeon.
Le commissionnaire poussa une exclamation désolée :
– Mais ce serait un crime !
– Non, une expiation.
– Cela ne se fait pas. C’est de la sauvagerie. Je proteste.
– À votre aise.
Le ton du sous-officier était si résolu que l’Avignonnais murmura :
– Que voulez-vous que je fasse ?
Simplet haussa les épaules.
– Il est trop tard. Il ne fallait pas vous jeter en travers de notre route. Vous me proposeriez d’écrire le récit de vos infamies que je répondrais : Non, monsieur Canetègne, j’aime mieux les requins.
– Voyons, mon ami, supplia le misérable éperdu.
– Je ne suis pas votre ami.
– Soit… je reconnais qu’en effet… Mais enfin, vous êtes intelligent. Les affaires sont les affaires… Une petite transaction.
– Taisez-vous ! Yvonne, votre victime doit recouvrer la liberté. Il faut que vous disparaissiez, ou que vous preniez, sur les bancs de la Cour d’assises, la place que vous lui destiniez.
– Réfléchissez, ma signature…
– Un nouveau chèque, n’est-ce pas.
L’Avignonnais ne trouva rien à répliquer. Le soldat avait raison. Sa signature non plus que sa parole, n’offrait aucune garantie. Donc si un navire français apparaissait, il était irrémédiablement condamné. Les dents claquant d’effroi, il regardait de côté les squales qui tournaient autour de l’embarcation. Une sueur froide ruisselait sur son épiderme, à la pensée que l’estomac de ces monstres pouvait être sa dernière demeure, et il suppliait les divinités des mers, d’écarter de la voie du canot tout steamer de France. Du reste, Neptune et Thétis semblèrent l’exaucer. La journée s’écoula sans que la moindre voile, la plus minuscule fumée rompissent la monotonie du paysage.
Un soleil de feu versait impitoyablement ses rayons ardents sur les malheureux, faisant bouillir leur sang, desséchant leurs lèvres. La soif commençait à les tourmenter.
À diverses reprises, Yvonne essaya de tromper sa souffrance en portant à sa bouche une gorgée d’eau de mer qu’elle rejetait ensuite. Mais le remède était pire que le mal. Un instant rafraîchie, elle se sentait plus altérée ensuite. La salure du liquide augmentait sa peine.
La nuit mit un terme à cette situation ; mais il restait aux voyageurs une lassitude profonde. La tête lourde, la langue gonflée par la soif, l’estomac vide, ils demeuraient sans mouvement dans le canot, fatalement entraîné vers le Sud-Est. Ils ne dormaient pas. Mais une vague torpeur les engourdissait, brisant leur énergie. Les yeux grands ouverts dans le noir, ils commençaient ce rêve douloureux de ceux que la soif conduit à la mort.
Vers le matin, Yvonne se prit à gémir. Le son de sa voix tira Marcel de sa somnolence. Il s’approcha d’elle. Il la vit très rouge, l’œil parsemé de filaments sanguinolents :
– J’ai soif, dit-elle, soif. À boire.
Le cœur du soldat se prit à battre avec violence. Était-ce l’agonie qui commençait déjà. Et ne pouvoir rien faire !
– À boire, dit-elle encore.
– Attends, petite sœur, je vais te donner ce que tu demandes.
Il tira son couteau, retroussa sa manche et il se préparait à se percer une veine quand Mlle Ribor retint sa main.
– Que fais-tu ?
– Je suis plus fort que toi ; je voulais te donner un peu de mon sang.
– Non, supplia-t-elle, non, pas cela. Voyons nous n’avons pas de vivres, rien, mais ton revolver est chargé. Essaye de tirer l’un des requins qui nous guettent.
Du doigt elle montrait les squales qui rétrécissaient leur cercle autour du canot.
– Allons, dit-elle, essaie.
Il secoua la tête :
– Je ne puis pas, petite sœur.
– Tu ne peux, et pourquoi ?
– Parce que la poudre est mouillée, les cartouches hors de service. Quand je me suis mis à l’eau pour atteindre le Véloce, je n’ai pas songé à protéger l’arme…
Un rugissement de Canetègne l’interrompit :
– Mais alors, à bord, votre revolver était inoffensif ?
– Évidemment.
– Et je me suis tu, alors que d’un cri, je pouvais appeler mon équipage. Té je suis « oun potoflau ! »
Le désespoir comique de l’Avignonnais ne réussit pas à dérider les jeunes gens. L’âpreté de la situation les tenait tout entiers.
– Pécaïre ! continuait le négociant, et par ma faute, j’ai faim, j’ai soif. Non, c’est à se casser la tête contre le bordage.
Il se démenait à ce point qu’il glissa de la banquette et tomba sur les cailloux déposés là par Dalvan, au moment où il atteignait le Véloce. En grommelant il se releva :
– Quoi encore ? Des cailloux, mais c’est l’inquisition, c’est la torture. Il se tut soudain. Sous les premiers rayons du soleil, des paillettes brillantes se montraient sur le silex.
– Té, murmura-t-il, mais c’est de l’or !
Il ramassa une pierre, puis une autre, puis une troisième :
– Eh oui ! ce sont des pépites de toute beauté… Et celle-ci… té, du diamant !
– Du diamant, répéta Simplet, mais alors il y a là une fortune.
Et repoussant l’Avignonnais, il remit dans ses poches le trésor qu’il devait au hasard, La découverte causa une minute de joie aux jeunes gens, mais bientôt la soif les tortura de nouveau.
Vers le zénith uniformément bleu, le soleil montait, embrasant l’atmosphère. De brûlantes buées se formaient à la surface des flots. Trempés de sueur, haletants, la cervelle bouillant dans leurs crânes surchauffés, les passagers s’affalèrent au fond de la chaloupe. Maintenant les requins venaient frôler le bordage, comme s’ils avaient conscience que le drame était près de s’achever.
Tout le jour, les malheureux restèrent ainsi, brisés, anéantis, exhalant parfois une plainte. Puis à l’horizon, le soleil disparut. Personne ne bougea. Étaient-ils déjà morts ? Non. La brise fraîche du soir ranima Marcel. Avec effort, il parvint à s’asseoir, et ses yeux errèrent autour de lui.
À l’avant, Canetègne étendu tout de son long, semblait dormir. À l’arrière, Yvonne conservait la même immobilité. Dalvan voulut se rapprocher d’elle, mais ses jambes refusèrent de le porter. Dans la bouche, la gorge, l’estomac, il éprouvait d’intolérables douleurs. Il lui semblait que les muqueuses desséchées se crevassaient. Pourtant il se raidit et réussit avec peine à se traîner jusqu’à sa sœur de lait.
Celle-ci toute blanche, les yeux ouverts, ne parut pas s’apercevoir de sa présence. Un souffle pénible s’échappait de ses lèvres gercées, accompagné d’une plainte faible, continue, effrayante comme un râle.
– Yvonne, s’écria le sous-officier, Yvonne !
Elle ne répondit pas, ne fit pas un mouvement. Il se pencha sur elle. Les narines de la pauvre enfant se pinçaient, une teinte bleuâtre se répandait sur son visage.
– Mais elle va mourir, gémit-il avec rage !
Et retrouvant une vigueur factice dans l’énergie de son désespoir, il se redressa. D’un regard de fou, il scruta l’horizon. La plaine liquide était déserte. Le canot, point perdu dans l’immensité, suivait toujours le courant, emportant vers la mort les passagers captifs en ses flancs.
– Non, je veux qu’elle vive !
Ce cri eut une résonnance étrange. Il était sec, cassé, déchirant. Marcel reprit son couteau, se piqua le bras, et de la blessure coula lentement un sang épais, presque noir, qu’il fit glisser entre les lèvres de la jeune fille.
Quelques minutes se passèrent. Yvonne poussa un profond soupir. Ses paupières s’abaissèrent et elle murmura :
– C’est bon, merci.
Ranimée par le breuvage sanglant, inconsciente du genre de nourriture qu’elle venait d’absorber, elle s’endormit.
Marcel la considérait avec tendresse. C’était une part de sa vie qu’il avait donnée pour conserver celle de sa compagne. Sa surexcitation tomba subitement. Déjà affaibli, la saignée pratiquée avait épuisé le reste de ses forces. Tout ce qui l’entourait lui parut se mettre en danse ; pris de vertige il chancela, chercha vainement à lutter et s’affaissa aux pieds de la jeune fille.
Un silence de mort planait sur l’océan, dont les longues lames se soulevaient paresseusement. Ainsi qu’un tombeau flottant, le canot berçait mollement son équipage agonisant.
La lune éclairait la scène de sa lumière blafarde. Rien ne remuait. Les lames succédèrent aux lames, les étoiles pâlirent au ciel, et pour la troisième fois le soleil reparut à l’horizon. Sous sa tiède caresse, Yvonne ouvrit les yeux. Reposée, elle se mit sur son séant, mais presque aussitôt elle poussa un cri d’effroi. À ses pieds gisait son frère de lait dont le bras, découvert par la manche relevée, montrait une blessure autour de laquelle s’étalait un caillot de sang.
Se baisser vers lui, l’appeler, essayer de le soulever fut l’affaire d’une seconde. Mais Simplet demeura muet et son corps trop lourd, échappant aux mains débiles de Mlle Ribor, retomba avec un bruit mat au fond de l’embarcation.
Alors l’épouvante prit la pauvre enfant. Avec angoisse ses regards éperdus parcoururent l’horizon. Tout à coup ses yeux devinrent fixes. Sa main s’étendit vers un point imperceptible de l’espace.
– Un navire !… Un navire !… Simplet reviens à toi ! nous sommes sauvés.
À ce cri, comme galvanisés, Dalvan et Canetègne se lèvent. Leurs faces livides interrogent avidement le lointain.
Yvonne ne s’est pas trompée. Un steamer est là-bas. Mais il est à grande distance, verra-il le canot, coquille de noix roulée par le flot ? Anxieux, la poitrine contractée, tous regardent. Le vaisseau approche. On distingue sa coque élancée, les volutes de fumée que vomissent ses cheminées. Désolation ! Sa route croisera celle de la chaloupe, mais il ne passera pas assez prêt pour la remarquer.
Alors, Simplet se dépouille de sa vareuse blanche, il la fixe à la godille improvisée à l’arrière ; il l’agite en l’air. Ses compagnons épuisent leurs forces en cris, sans se rendre compte que du navire on ne peut les entendre.
Une heure se passe, une heure d’angoisse effroyable, et le steamer stoppe. Il met une embarcation à la mer. Les passagers sont sauvés. Le Britannia, vapeur anglais de la ligne de Buenos-Ayres-Antilles-Liverpool, les prend à bord et continue sa route vers la Dominique, sa première escale.
Selon la version imaginée par Simplet, on crut que les Français se faisaient remorquer par un cutter ; que l’amarre du canot s’était brisée à la nuit, et qu’un courant marin avait entraîné le frêle esquif vers la haute mer. En trois jours, ils avaient parcouru quatre cent milles. Le 4 mars, tous débarquaient à la Dominique, et Canetègne s’empressait de quitter ses compagnons en formulant, à part lui, les plus terribles menaces.

Yvonne et Simplet s’enquirent des moyens de rejoindre le port de Colon, où leurs amis les attendaient déjà sans doute. Ils apprirent qu’il n’existe aucune communication directe entre l’île anglaise et le continent. Il leur fallut gagner la Pointe-à-Pitre, chef-lieu de notre colonie de la Guadeloupe, et après un rapide regard au volcan de la Soufrière, aux plantations de cannes à sucre où se cache le serpent fer-de-lance à la dent empoisonnée, ils prirent passage sur un voilier qui, se glissant entre Marie-Galante et les îles des Saintes, dépendances de la Guadeloupe, longea les côtes de la Dominique et transporta les voyageurs à la Martinique. Le 9 mars, ils mettaient le pied sur les quais de Fort-de-France.
Ils y attendirent deux fois quarante-huit heures la venue d’un transatlantique de la ligne du Havre-Colon, sur lequel ils prirent passage, et le 17, à trois heures après midi, ils tombaient dans les bras de Diana, de Claude, de Sagger qui, à leur approche, s’étaient précipités sous le vestibule d’Isthmus’s hôtel. Sourimari elle-même parut joyeuse de les revoir, et elle porta à plusieurs reprises la main d’Yvonne à ses lèvres ; ce qui lui valut de la part de Sagger une approbation, à laquelle elle répondit :
– Tes amis à toi, Sourimari les aime.
Les premiers épanchements passés, on causa.
– Nous n’avons trouvé aucune trace de sir Antonin Ribor, déclara miss Pretty. Nous avons parcouru les Antilles Françaises : la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Nous nous sommes rendus à Terre-Neuve, nous informant dans les îles Saint-Pierre et Miquelon, questionnant les pêcheurs. Nous avons même exploré le French Shore, c’est-à-dire le rivage occidental de l’île de Terre-Neuve, attribué aux pêcheurs de morue Français pour y recueillir « la boëte » ou appât de pêche. Nulle part, le frère de mon amie Yvonne n’a été vu.
Marcel avait laissé parler l’Américaine. Il raconta alors son voyage, les angoisses éprouvées et conclut en répétant la conversation de Canetègne et d’Yvonne sur le tillac du Véloce ; conversation à laquelle il avait assisté invisible, accroché aux bosses des bouées.
– Alors, fit Claude, Antonin est en Afrique ? Il descend du Nord vers le Congo ?
– Oui.
– Allons donc au Congo. Là-bas, les seuls chemins praticables sont les cours d’eau, nous sommes donc certains de le rencontrer.
– Eh bien, s’écrièrent tous les assistants d’une seule voix, partons pour le Continent Noir.
Chez ces dévoués, aucune hésitation. Oublieux des dangers passés, ils allaient courir au devant de périls nouveaux. Et comme Yvonne voulait remercier ses fidèles défenseurs, Diana lui coupa la parole.
– Non, pas de merci. Cela m’amuse énormément.
Elle tendit la main à Claude et se rapprochant de Mlle Ribor :
– Grâce à vous j’ai trouvé le bonheur, je serais ingrate de ne pas travailler au vôtre. À propos, j’oubliais de vous dire : Le Fortune, complètement réparé, est en route pour Colon. Nous l’attendrons, mais nous utiliserons nos loisirs en cherchant un bateau, solide et de faible tonnage, pour remonter le fleuve Congo.
Et afin de l’empêcher d’exprimer sa reconnaissance, elle se lança dans une véritable conférence sur les qualités nécessaires à l’embarcation.
XXXVI
DANS LE BAGHIRMI

– Eh bien ! Monsieur l’Explorateur, avez-vous trouvé le moyen de fausser compagnie à nos geôliers ?
– Hélas non ! Monsieur Simplet. Mais vous-même ?
– Pas davantage. Pourtant quand on s’ennuie dans un endroit, c’est simple comme bonjour, il faut le quitter.
– Il le faudrait doublement. Car sans cela, la mission Allemande, partie du Cameroun, arrivera avant moi à Masena, capitale du sultan du Baghirmi. Si elle signe un traité avec lui, la France africaine est coupée en deux. La rive orientale du lac Tchad occupée par l’Allemagne, le Gabon, l’Oubanghi sont séparés à jamais du Soudan, du Sénégal, du Dahomey et des territoires Algérien et Tunisien !
– Saperlotte de sapristi !
Ces répliques s’échangeaient au milieu d’une vaste cour entourée d’un mur épais et haut. Derrière les causeurs – Marcel Dalvan et un jeune homme brun, à la tête énergique – s’élevaient des constructions étranges, aux ouvertures rares, aux portes en quadrilatère plus large du seuil que de la voûte, offrant en un mot une ressemblance lointaine avec les monuments égyptiens. La demeure tenait à la fois du fort et de la communauté religieuse. Les paroles des causeurs prouvent qu’ils la considéraient comme une prison. C’en était une en effet.
Dalvan et ses amis, partis de Colon, avaient atteint l’embouchure du Congo, à l’aide d’une chaloupe démontable, ils avaient remonté le cours du fleuve. Au passage, ils avaient salué Brazzaville, fondée par l’infatigable et pacifique conquérant de l’immense territoire dénommé Congo Français. Un peu plus loin, sur la rive gauche du fleuve, Stanleypool s’était montré, puis les postes de Galois, d’Ibahu, de Bouza, de Mongo, Molombi, Saint-Louis. Là l’embarcation avait cessé de troubler les eaux du Congo, pour glisser à la surface de celles de l’Oubanghi.
Voyage féerique, peu fatigant en somme, entre les rives couvertes de forêts de caoutchoucs, d’ébéniers, de cèdres rouges, de dattiers, d’avocatiers ou arbres à beurre, de jacquiers ou arbres à pain. Parfois on rencontrait des espaces cultivés plantés de manioc, de bananiers, et puis la forêt se montrait de nouveau.
Tant que le canot fendit le courant du Congo, aucun incident fâcheux ne se produisit. Claude, Marcel, William Sagger chassaient l’hippopotame, le crocodile. Ils tuèrent même un carnassier particulier au Gabon, le Potamogal à la tête de belette plantée sur un corps de loutre terminé par une queue de castor. Miss Pretty, Yvonne et Sourimari applaudissaient aux coups heureux. Mais une fois que l’embarcation fut engagée sur l’Oubanghi, la maorie devint grave. Ses yeux inquiets fouillaient les rives.
– Qu’as-tu donc ? lui demanda Sagger, qui prenait plaisir à causer avec elle.
– J’ai peur, répliqua-t-elle.
– Peur ! et de quoi ?
– Je flaire l’ennemi.
À toutes les questions, elle fit la même réponse. De quel ennemi s’agissait-il ? Elle l’ignorait, mais elle était certaine qu’il était proche. Telle était sa conviction que les voyageuses furent à leur tour gagnées par une crainte vague. Elles exigèrent que l’on tînt compte de son instinct sauvage, et à la nuit, la chaloupe, au lieu d’atterrir comme auparavant, jeta désormais l’ancre à distance de la rive.
Plusieurs fois cette manœuvre avait été répétée. Rien n’avait confirmé les craintes de Sourimari. Mais vers la fin du huitième jour l’inquiétude de la polynésienne s’accentua :
– C’est étrange, dit-elle. Ici le fracas de l’eau me trouble. Si j’étais dans mon pays j’affirmerais que l’ennemi nous suit le long du rivage, sous le fourré.
– Encore l’ennemi, plaisanta Sagger.
– Ne ris pas. Il y a beaucoup d’hommes. Ils se savent forts et négligent les précautions des faibles. Ils brisent les branches sur leur passage. C’est la forêt qui m’avertit.
Tous prêtèrent l’oreille, mais ils n’entendirent rien. Les sens des blancs sont loin d’avoir la délicatesse de ceux des autres races humaines.
– Ils se sont rapprochés, continua la jeune fille. Avant, ils étaient plus loin dans les terres. L’attaque aura lieu bientôt.
Lorsque l’embarcation s’arrêta à la nuit, la maorie vint prendre place à côté de Sagger, de façon à se trouver entre lui et la rive.
Et comme William protestait, à cause du danger auquel elle s’exposait :
– Ma vie t’appartient. Laisse-moi la risquer pour toi. Si la flèche qui t’est destinée me frappe, Sourimari fermera les yeux avec bonheur. Elle sera fière d’aller retrouver les ancêtres au pays lointain que gardent les bleus toupapahous.
Le géographe haussa les épaules, et pour changer les idées assombries de ses compagnons, il se mit à leur conter les explorations françaises à travers le continent noir.
Il évoquait les noms héroïques de Paul de Chaillu, Braouzec, Serval, du docteur Griffon du Bellay, Genoyer, Ayniès, Lastours, Marche, de Compiègne, de Savorgnan de Brazza et de ses hardis compagnons, Ballay, Dibowski, Maistre, CrampeL qui tous concoururent à la reconnaissance du Congo, du Gabon, de l’Oubanghi. Puis il parla du capitaine Trivier, parti du Gabon pour la côte de Mozambique, du lieutenant Mizon qui remonta le Niger jusqu’à Lokodja, gagna Yola, capitale de l’Adamaoua, et redescendant vers le sud, limita l’Interland du Cameroun allemand, afin d’ouvrir à notre colonie congolaise une voie d’expansion vers le nord. Et de l’expédition Marchand, du Gabon à la mer Rouge, qui nous a donné, à nous Français, des provinces d’une superficie égale à trois fois celle de la France, dont l’une, le Ouadai, contient d’immenses gisements d’or.
Sa mémoire imperturbable lui permettait de citer des dates, de rappeler des menus faits, et ses auditeurs oubliaient les prédictions de la maorie. Soudain des sifflements passèrent dans l’air. Sourimari se leva toute droite, et montrant son bras traversé d’une flèche, prononça ce seul mot :
– L’ennemi !
L’énergie de sa race était en elle. Sa voix restait calme, et la douleur ne lui arrachait aucune plainte. En un instant, tous les hommes sautèrent sur leurs armes. Mais le rivage demeura désert. Nulle forme humaine ne se montra entre les grands arbres.
Longtemps on resta sur le qui-vive, attendant une seconde attaque qui ne se produisit pas. Fatigués, les voyageurs s’endormirent sous la protection de deux marins, sentinelles vigilantes chargées de veiller pour tous. Seule, la maorie semblait enchantée ; William avait voulu la panser lui-même. L’honnête géographe éprouvait une reconnaissance émue pour la frêle créature qui, ainsi qu’elle l’avait promis, s’était faite son bouclier vivant. Les jours suivants, des îlots encombrèrent le cours de la rivière. L’embarcation filait sur le lacis de canaux ainsi formé ; on évitait de se rapprocher des rives, car l’ennemi continuait sa poursuite. De temps à autre, un coup de feu retentissait soudain, un projectile tombait près du canot, faisant rejaillir l’eau. Mais les tireurs ne paraissaient point.
Sans cesse harcelés par leurs mystérieux adversaires, les voyageurs avançaient toujours. Ils atteignirent les rapides de Longo, où la navigation cesse d’être possible. Maintenant il fallait se lancer à travers la brousse, en suivant les traces de la mission Crampel, massacrée par les noirs. Personne n’hésita. Dans un village, Marcel et ses amis achetèrent des bêtes de somme, chevaux et mulets, et la marche vers le lac Tchad commença.
Pénible est la route de terre. Le soleil ardent, les émanations pestilentielles des marais, les insectes, les reptiles, les fauves semblent s’allier aux populations fétichistes et sanguinaires pour arrêter l’explorateur audacieux. Chose étrange, les ennemis qui avaient attaqué le canot semblaient s’être dispersés. La petite caravane ne rencontrait pas de sérieux obstacles. Vers la fin de juin, elle arriva sur les bords du Chari, rivière importante quoique souvent à sec, qui finit dans le lac Tchad.
Là, elle rencontra trois hommes, le capitaine Fernet et deux laptots sénégalais, qui avaient suivi le même chemin qu’elle et cherchaient à atteindre au plus vite la ville de Masena, capitale du Baghirmi, afin de traiter avec le sultan et d’empêcher ainsi une mission allemande, en provenance du Cameroun, de couper en deux tronçons l’empire français d’Afrique.
Ce n’est pas sans un vif plaisir que des compatriotes se serrent la main au centre du continent noir. En quelques heures, le capitaine Fernet, Marcel, Claude et leurs compagnons furent amis. Puisque les deux troupes avaient le même objectif, il y aurait profit et satisfaction à voyager ensemble.
Aux questions d’Yvonne, soucieuse de n’avoir trouvé aucun indice du passage de son frère Antonin, l’explorateur affirma que le jeune homme devait être resté dans le nord, car aucun blanc n’avait été signalé dans les postes qu’il venait de franchir. Et fiévreusement la jeune fille pressa la marche de la caravane.
La route était toute tracée ; il suffisait de suivre le lit desséché du Chari. Sur le fond sableux, les chevaux avançaient facilement. Tous songeaient joyeusement que bientôt ils camperaient sur les rives du lac Tchad. Ils se figuraient, nul n’aurait pu dire pourquoi, que c’était là qu’ils retrouveraient Antonin Ribor.
Mais tout à coup, les fléaux africains, qui jusque là avaient épargné les voyageurs, fondirent sur eux. D’abord, durant la traversée des marécages de Toubouri, qui couvrent une étendue considérable de pays, des mouches tsétsé se montrèrent.
Jolie bestiole que la tsétsé, avec son corselet doré, ses ailes vertes, mais terrible pour les bêtes de somme. Sa piqûre détermine chez ces animaux une sorte de vertige qui se termine généralement par la mort.
Plusieurs chevaux périrent ainsi. Trois seulement survécurent. Deux portaient Yvonne et Diana, le troisième était chargé des bagages. Les compagnons des jeunes filles, bien qu’alourdis par la chaleur incessante, durent s’armer de courage et poursuivre la route à pied.
Mais le désastre devait être plus complet. Un matin une nuée de fourmis ailées, les quissondes, s’abattit sur les pauvres quadrupèdes encore vivants. Alors les voyageurs assistèrent à un horrible spectacle. Longues de quatre centimètres, armées de formidables mandibules, les quissondes pendaient par grappes sur le corps des chevaux. Affolés, ceux-ci couraient, ruaient, hennissaient de rage et de douleur, jusqu’au moment où, épuisés, ils tombaient à terre à demi-dépecés déjà.
Les jeunes filles durent marcher désormais. Mais la fatigue les terrassait vite, on n’avançait plus que lentement. Enfin, après deux semaines de souffrances inouïes, on pénétra dans la mission protestante de Bifara. Le capitaine Fernet, heureux de voir ses compatriotes en sûreté, leur annonça qu’il les quitterait le lendemain, les intérêts qu’il représentait ne lui permettant pas de s’attarder davantage.
Projet vain. Lorsqu’il voulut s’éloigner de la mission, les pasteurs, parfaitement armés et escortés d’un bataillon de nègres convertis fort bien disciplinés, le prévinrent sans ménagement qu’il était prisonnier ainsi que ses compagnons. Il ne serait libre que le jour où le détachement allemand du Cameroun aurait signé un traité de commerce avec le sultan du Baghirmi.
Depuis trois fois vingt-quatre heures durait la captivité des européens. Ainsi s’expliquent les paroles échangées dans la cour de la mission entre Simplet et le capitaine Fernet.
– Quand un endroit déplaît, avait dit le sous-officier, c’est bien simple ; il faut s’en aller.
À ce moment deux hommes sortaient du bâtiment principal. L’un grand, blond, germain de type et d’allure ; serré malgré la chaleur dans une longue redingote noire, dont les basques venaient battre ses chevilles ; l’autre, arabe de visage et de costume.
– Mon fils, dit le premier d’un ton onctueux, tu as raison. Il est bon de quitter un endroit qui ne plaît plus. Mon désir est d’accord avec le tien, et je te rendrai la liberté aussitôt qu’il me sera possible de le faire, sans aller à l’encontre des intérêts de la sainte Allemagne.
– Bien obligé, M. le pasteur Wercher.
– J’ai une proposition à te soumettre, continua celui auquel le sous-officier avait donné le titre de pasteur.
– Proposez, je vous en prie.
– Attends un instant. J’ai fait prier ta sœur de lait de nous joindre. Je parlerai devant elle.
– Ah ! murmura Marcel non sans surprise ; mais le sourire reparut sur ses lèvres. Soit ! seulement, je profiterai de ce retard pour protester contre l’atteinte portée par vous à notre liberté.
Le pasteur inclina lentement la tête :
– C’est ton droit, mon fils.
– Mais vous n’avez pas celui de me retenir, de retenir le capitaine Fernet. À son retour en France, il réclamera justice, et le pays exigera qu’elle lui soit rendue pleine, entière.
– Errare humanum est, susurra M. Wercher.
Du coup Dalvan bondit :
– Comment ! je me trompe.
– Absolument, mon fils. Pour réduire à rien la réclamation de celui qu’il te plaît d’appeler capitaine…
– Il ne me plaît pas… je dois l’appeler ainsi.
– Tu le dis.
– Oseriez-vous mettre en doute la qualité de M. Fernet ?
– La logique me le conseille.
– La logique ?
– Sans doute, mon fils. Suis mon raisonnement. Un officier Français est un homme considéré, pour qui l’honneur est tout.
– Eh bien ?
– Eh bien ? Je répondrais à qui m’accuserait d’avoir retenu M. Fernet : Un véritable capitaine ne voyage pas avec Mlle Yvonne Ribor, arrêtée en France comme voleuse, ni avec les malheureux qui l’ont aidée à s’évader !
– Voleuse ! rugit Simplet, mais il s’apaisa soudain. Allons, je vois que M. Canetègne a passé par ici.
– Juste à point pour m’enlever tout remords.
– Oh ! c’est un grand tueur de remords, lui.
– Plaisante, pauvre brebis égarée, plaisante cet homme qui, joué, ridiculisé par toi, cherche pour toute vengeance à assurer le bonheur de ta sœur.
– Le bonheur ! j’en frémis.
– Tes yeux sont fermés à la lumière, tes oreilles sourdes à la vérité.
Ces paroles firent sourire le sous-officier :
– Il me semble, M. le pasteur, que vos oreilles sont dans le même cas. Ne comptez-vous pas déclarer que vous n’avez arrêté le capitaine Fernet que parce que sa suite vous paraissait peu respectable ?
– Si, mais je ne vois pas.
– La vérité là-dedans ? Moi non plus.
– Tu m’accuses de mensonge, présomptueux ?
– À ne vous rien cacher, oui.
– Tu es encore dans l’erreur. Le mensonge exprime une chose qui ne peut être.
– Justement.
– Or moi, j’affirme au contraire une chose qui peut être. Et dès lors, il n’y a plus mensonge, puisque la possibilité de vérité existe.
Le jeune homme allait répondre. Le capitaine lui toucha le bras :
– Ne discutez pas. Nous autres soldats ne sommes pas rompus aux joutes de la casuistique. Au surplus, voici venir Mlle Yvonne.
M. Wercher pâlit légèrement. Ses yeux bleus eurent un éclair. Évidemment la réflexion de l’explorateur l’avait blessé. Mais il ne prononça pas une parole.

Mlle Ribor d’ailleurs arrivait auprès du groupe, et s’adressant au pasteur :
– Vous m’avez fait appeler, monsieur ?
– En effet, mon enfant. J’ai à vous dire des nouvelles graves. Mais avant de commencer, permettez que je vous supplie de rentrer en vous même, de vous isoler des mauvais conseils afin de prendre le chemin tracé par le devoir, sans lequel il n’est pas, sur terre, de bonheur vrai, point d’affection durable, pas d’estime de soi-même.
– Sapristi ! murmura Simplet. Que de préambules. Elle doit être effroyable la proposition de cet Allemand !
M. Wercher reprit après un silence :
– Mon enfant. Je sais qu’égarée par de funestes amis, vous cherchez un frère tendrement aimé, avec l’espoir qu’il rompra une union sérieuse, contre laquelle les rêveries légères de l’adolescence seules pourraient formuler une critique.
Yvonne avait frissonné. Une rougeur ardente montait à ses joues.
– Celui-ci, poursuivit l’Allemand en désignant son compagnon, celui-ci est Ali-ben-Yusuf-Adjer, compagnon et ambassadeur de M. Canetègne.
– Ah ! murmurèrent les Français avec un regard à l’Arabe.
– Avec sa troupe composée de guerriers renommés, il vous a suivis pas à pas depuis votre arrivée en Afrique. Ils étaient les plus nombreux, les plus forts ; ils auraient pu de vive force vous réduire. Ils ne l’ont pas voulu. C’est à ce signe que se reconnaissent les justes. Dulcis est eis misericordia !
Marcel intervint :
– Vous vous égarez, M. Wercher. Il s’agit d’Arabes et non pas de latin.
Et sans faire attention au coup d’œil foudroyant du teuton :
– Que veulent les bandits au nom desquels vous parlez ?
Ce fut à Yvonne que l’interpellé répondit :
– Mon enfant, arrachez-vous aux suggestions fatales ; fermez votre entendement aux avis lancés par les bouches qui soufflent le feu et la guerre. Écoutez la voix conciliatrice qui est en moi. Celui que les lois ont fait votre époux, celui auquel vous devez obéissance a envoyé son serviteur vers vous. Ali-ben-Yusuf-Adjer vous dit ceci : Le seigneur Canetègne fait savoir à sa compagne, qu’à trois jours de marche de la mission Bifara, il a rejoint Antonin Ribor.
– Mon frère, s’écria Yvonne incapable de se contenir.
– Oui, ton frère. Ton frère qui ne possède pas les papiers dont tu as leurré le dévouement de tes défenseurs. Ton frère qui t’ordonne de le rejoindre, afin qu’il te ramène en France au bras de l’époux que tu as librement choisi.
L’Allemand se tut. Personne ne songeait à répliquer. Tous étaient écrasés par cette révélation : Antonin n’a pas la preuve de l’innocence d’Yvonne !
– Eh bien ? jeune fille. Est-tu prête à suivre Ali ?
La question parut rendre sa présence d’esprit à Simplet :
– Elle ne le suivra pas, fit-il. Nous avons reculé devant la lutte, parce que nous espérions triompher autrement. Mais à cette heure, hésiter serait folie et lâcheté.
Avant que le pasteur eût pu deviner sa pensée, il siffla deux fois, puis mettant son revolver à la main :
– Appelez vos soldats, monsieur Wercher ; je viens d’avertir mes amis. Vous allez voir comment des Français courent à l’ennemi.
Déjà à l’extrémité de la cour, Claude, Sagger, le capitaine Maulde et ses matelots se montraient, attirés par le signal de Dalvan. M. Wercher secoua la tête :
– Il n’y aura pas de sang versé inutilement dans cette maison. Ali, retourne auprès de celui qui t’a envoyé. Rapporte-lui ce que tu as vu.
L’Arabe s’inclina et gagna la porte percée dans la muraille de la cour. Les indigènes qui la gardaient le laissèrent passer sur un signe du pasteur Quant il eut disparu, celui-ci se tourna vers Yvonne :
– Il a été fait selon votre bon plaisir, mon enfant. Puissiez-vous ne regretter jamais votre décision.
Et calme, redressant sa haute stature, il rentra dans les bâtiments de la mission. Sans doute, il pensait avoir agi au mieux, car son visage exprimait le contentement de lui-même. À son tour, miss Pretty vint se mêler au groupe. Mise au courant de l’aventure, elle unit ses malédictions à celles que Simplet grommelait à l’adresse de l’Avignonnais.
Mais comme ils restaient là, ébauchant des projets d’évasion aussitôt reconnus inapplicables, une musique étrange se fit entendre. Le bruit venait de l’extérieur de l’enceinte. Des flûtes aux sons criards, les résonnances aiguës de la gaoupa, guitare indigène, se mariaient au bourdonnement monotone du babou, sorte de tambour formé d’un tronc d’arbre creusé et garni à ses extrémités de peaux tendues.
– Qu’est-ce donc ? demanda Marcel.
– Une réjouissance quelconque, répondit Sagger. Peut-être un mariage.
Les hommes de garde à la porte avaient pris les armes. L’un d’eux regardait par le battant entr’ouvert. Le guetteur fit un signe. Aussitôt deux nègres se précipitèrent, firent sauter chaînes et verroux. Les vantaux massifs de la porte tournèrent sur leurs gonds, livrant passage à la plus bizarre procession qui se puisse imaginer.
En tête des griots, musiciens et sorciers des tribus noires, vêtus de manteaux de plumes ; le cou, les poignets, les chevilles surchargés de fétiches, dents d’animaux, coquillages, parcelles de bois, de cailloux. Avec un entrain diabolique, ils soufflaient dans leurs flûtes, grattaient leurs guitares, frappaient leurs tambours, chacun selon un rythme différent, faisant preuve d’une indépendance musicale dont le résultat était une cacophonie assourdissante.
Derrière ces forcenés venaient des Arabes, dont le bournous s’ouvrait sur des vêtements de couleurs vives. Puis une file de mulets dont chacun portait une femme.
– Des Européennes ! murmurèrent les voyageurs.
En effet, encore que les nouvelles venues eussent le visage caché par d’épais voiles de gaze, leur costume ne laissait aucun doute. Elles étaient bel et bien de race blanche. Enfin, un blanc encore, monté sur un cheval bai, précédait un dernier groupe d’Arabes qui fermait la marche.
M. Wercher se montra. Il vint au cavalier européen, lui parla à voix basse et désigna les bâtiments situés à gauche de la cour. L’homme donna aussitôt quelques ordres brefs. Et les amazones, qu’il semblait commander, sautèrent à terre pour gagner sous sa conduite le point de la mission indiqué par le pasteur. Un instant après, elles avaient disparu.
Les voyageurs entouraient William Sagger, le pressant de leur expliquer ce qu’ils venaient de voir. Mais cette fois, la science du géographe se trouvait en défaut. La bizarre cavalcade ne rappelait aucun souvenir à son esprit…
– Bon, s’écria Marcel impatienté, je vais trouver M. Wercher. Pour savoir, il est bon d’interroger même un ennemi.
Sur cette réflexion, il s’approcha d’un pas délibéré du pasteur, qui confiait les Arabes, les griots, les chevaux et les mulets à divers membres de la mission accourus en hâte. Ceux-ci conduisaient les hommes dans la maison, les quadrupèdes aux écuries.
– Ouf ! soupira l’Allemand. Voici toute la caravane casée.
Sa face grasse rayonnait. Il semblait ravi. L’instant était favorable pour Marcel.
– M. Wercher, questionna le sous-officier. Serai-je indiscret en vous demandant quelles sont ces dames qui se font escorter par des Maures et des noirs ?
– Du tout, du tout. Ces dames sont un envoi de la maison Fritz et Fritz, de Genève.
– Un envoi ? répéta Dalvan interloqué.
– Oui. Mais vous paraissez ne pas comprendre. Vous ne connaissez pas la maison Fritz et Fritz ?
– J’avoue mon ignorance. Je ne la connais pas. Le pasteur leva les bras au ciel.
– C’est singulier comme les Français sont peu informés !
Et avec une nuance de pitié :
– Mais la maison Fritz et Fritz est une maison unique au monde. Elle jouit en Allemagne, en Autriche, en Scandinavie, voire même en Angleterre, d’une réputation incontestée. Pas un pasteur ne part en mission en Afrique, sans être porteur d’un certain nombre de feuilles signalétiques comme celle-ci.
D’une poche de son ample redingote, M. Wercher tira un carnet bourré de papiers. Il chercha un instant, puis mettant sous les yeux du sous-officier une feuille de teinte jaune, il lui dit avec un accent de triomphe :
– Voici. Lisez.
Dalvan obéit. Il parcourut d’un œil effaré le tableau dont nous donnons ci-après le fac-similé.
– Bon, lit-il après avoir lu, c’est une agence matrimoniale.
– Non, rectifia M. Wercher. Cette maison honorable est surtout une agence d’émigration. Les fiancées, qu’elle nous envoie, restent en correspondance avec elle. Si bien que, certaine des besoins de telle ou telle contrée, elle peut organiser des convois d’émigrants qui viennent se grouper autour de nos missions.

Simplet approuva de la tête :
– Très ingénieux. Seulement une chose me taquine : un signalement reste toujours un peu vague, et bien certainement il doit y avoir, à l’arrivée d’un lot de fiancées, des déceptions cruelles.
– Vous raisonnez en Gaulois superficiel.
– Vous trouvez ?
– Certes ; nous n’attachons pas tant d’importance aux avantages périssables de nos épouses. Au surplus, MM. Fritz et Fritz poussent la conscience à l’excès, et leurs efforts sont récompensés par l’extension chaque jour plus grande que prennent leurs opérations. Ainsi tenez, ici à la mission, nous sommes vingt-cinq. Cinq étaient déjà nantis d’épouses. Les vingt autres ont décidé de s’adresser à Genève.
– Et vous allez célébrer les vingt mariages.
– Les yeux fermés. Le mot est d’autant plus juste que nul d’entre nous ne verra sa future compagne avant de la conduire à l’autel.
– Toujours le mépris des attraits périssables. Seulement comment reconnaîtrez-vous vos fiancées ?
– À leur brassard.
– Vous dites ?
– Leur brassard. Chacune porte en effet, autour du bras gauche, une bande d’étoffe sur laquelle est brodé le nombre correspondant au folio de l’un de nous.
– Parfait ! Mes compliments, M. Wercher.
– Que pensez-vous de ce que je viens de vous apprendre ?
– Moi ? J’admire, monsieur Wercher, j’admire positivement. En Europe, on se marie déjà en se connaissant à peine, vous réalisez le progrès attendu en vous unissant à des personnes que vous ne connaissez pas du tout.
Et laissant l’Allemand, il rejoignit ses amis, auxquels il fit part de la curieuse découverte qu’il venait de faire. Tous riaient, oubliant pour un instant leur captivité. M. Wercher s’était retiré, avec le chef de la caravane et le représentant de la maison Fritz et Fritz, afin de régler les comptes. Ils devaient en avoir pour longtemps sans doute, car soudain Dalvan aperçut un jeune pasteur qui, une bouteille sous le bras, se glissait vers le bâtiment où se trouvaient les futures. Presqu’aussitôt un autre suivit, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Le sous-officier en compta dix-neuf.
– Ah çà ! murmura-t-il, M. Wercher m’a induit en erreur. Ils vont voir leurs fiancées !
Et curieux, il se glissa derrière les Allemands. La porte du pavillon était entre-bâillée. Le vestibule, sur lequel elle s’ouvrait, désert. Marcel entra. Il traversa deux pièces sans rencontrer âme qui vive, guidé par un murmure de voix assourdies.
Dans la troisième, disposée comme un vaste dortoir, les jeunes Allemandes, qui venaient fonder le ménage et transplanter la choucroute en Afrique, se tenaient par la main, tandis que les époux à qui elles allaient appartenir, assis en face d’elles, leur parlaient à voix basse. Sur une longue table s’alignaient des verres à demi-remplis d’un liquide orangé. Simplet reconnut le Caribo, liqueur spiritueuse extraite d’un arbuste épineux. C’était une politesse des futurs à leurs fiancées.
À un moment tous se levèrent et trinquèrent. Les verres vidés, les Allemands s’apprêtèrent à prendre congé. Ils craignaient d’être surpris par M. Wercher. Dalvan comprit leur intention et s’empressa de s’éloigner. Mais quand il fut auprès de ses amis, ceux-ci s’enquirent des causes de la joie qui pétillait dans ses yeux.
– Tu as trouvé quelque chose ? déclara Yvonne.
– Peuh !
– Si… et cela doit être simple…
– Comme bonjour. Tu as raison, petite sœur. J’ai retrouvé des vers de La Fontaine.
Avec un sourire railleur, il débita :
Deux coqs vivaient en paix, une poule survint
Et voilà la guerre allumée.
– Eh bien, interrogèrent Diana, Mlle Ribor et Claude lui-même ?
– Cela veut dire, continua le sous-officier, qu’il suffit d’une femme pour faire battre deux hommes.
– Et après ?
– Après. Si l’on a vingt femmes, on peut donc faire lutter quarante hommes. Or nos geôliers ne sont que vingt-cinq. J’ai dans l’idée que nous avons quelques chances d’être libres demain.
À toutes les questions il se borna à répondre de cette façon. Quelle idée avait donc germé dans son cerveau inventif ? Le soir, il se retira ainsi que ses compagnons dans la partie de la mission qui leur était affectée. Mais vers le milieu de la nuit, il se glissa doucement dehors, après s’être muni de ciseaux, d’aiguilles, de fil et d’une tige de fer recourbée en crochet.
Parvenu dans la cour obscure, il longea le mur de façade et arriva sans encombre à la porte qui, dans la journée, lui avait livré passage. Elle était fermée. Cependant il ne montra aucun mécontentement. Il introduisit dans la serrure primitive le crochet qu’il portait, et après quelques prudentes pesées fit jouer le pêne.
À pas de loup il entre alors. Une nuit opaque emplit les salles qu’il traverse. Mais il se souvient du chemin parcouru dans l’après-midi. La main frôlant la muraille, il avance. Il atteint l’entrée du dortoir.
Sous des moustiquaires de mousseline dorment les fiancées des Allemands. Leurs vêtements sont rangés sur des chaises grossières, placées auprès de chaque couchette. Au milieu de la table, une lanterne ; sur les faces de laquelle on a collé du papier, figure une veilleuse. Dans sa clarté pâlie bourdonnent des moustiques rouges, des tchékés, des mobés, des n’gias, sanguinaires bestioles pourvues d’aiguillons aigus. Éloignés des dormeuses par le rempart des moustiquaires, les insectes se ruent sur Simplet dès qu’ils l’aperçoivent. Les piqûres se succèdent, mais le jeune homme n’a pas une plainte. Il s’est agenouillé auprès du premier lit qu’il a rencontré, et là, il découd le brassard attaché à la manche de celle qui sommeille. Vingt fois il pratique la même opération, puis il se met à coudre. Il substitue au brassard de chacune des jeunes Allemandes celui d’une de ses compagnes. En une heure tout est terminé. Il a les mains, les joues douloureusement labourées par les aiguillons des moustiques, mais il est radieux. Sans encombre il regagne sa chambre, apaise sa souffrance au moyen d’une lotion d’arnica et s’endort.
Il était environ huit heures du matin, quand Yvonne fut réveillée par des cris tumultueux. On eut dit que la cour de la mission était le théâtre d’une violente querelle. Elle se leva précipitamment, se vêtit, tandis que le tapage augmentait d’instant en instant, puis elle descendit.
À la porte, Sagger, Claude, le capitaine Maulde, ses matelots, miss Pretty et Simplet étaient déjà rassemblés, bientôt rejoints par le capitaine Fernet et ses laptots. Ils paraissaient suivre avec intérêt les mouvements d’une foule bigarrée réunie dans la cour.
Yvonne ne vit rien d’abord. Devant elle, s’agitaient des noirs, des Arabes, des Allemands, des femmes ornées du brassard de la maison Fritz. Tous criaient, gesticulaient, semblaient en proie à une violente colère.
– Que se passe-t-il donc ? demanda-t-elle à son frère de lait.
– Regarde et tu l’apprendras.
À ce moment un grand garçon, pasteur taillé en hercule, domina le tumulte.
– Il ne s’agit pas de tout cela, criait-il. J’ai le folio 10954. Hier le 10954 était une jolie blonde. Aujourd’hui c’est une épouvantable rousse. Il y a tricherie ; on a, durant la nuit, démarqué ces demoiselles. Je réclame le 10954 d’hier.
– Mais moi, répondit un autre, je garde le 10953 d’aujourd’hui, car c’est une gentille épouse blonde que je préfère au laideron roux d’hier.
– Nous verrons bien.
– Ah ! parbleu. Tu es fort, mais je n’ai pas peur de toi. C’est la compagne de toute mon existence que je défends.
La même altercation se produisait en dix endroits différents, et pour porter le vacarme à son comble, les nègres de garde, les domestiques, manifestant leur sympathie pour tel ou tel des blancs, s’invectivaient, se lançaient toutes les injures du vocabulaire noir, le plus riche du monde à cet égard.
M. Wercher écarlate, courait d’un groupe à l’autre. Il s’efforçait de calmer les esprits. Peine perdue. La querelle renaissait derrière lui.
Soudain un coup de feu retentit. Qui l’avait tiré ? Mystère ! Ce fut le signal d’une bataille en règle. Allemands, nègres, griots, Maures, tout le monde se mit de la partie, tandis que les « futures » lançaient dans l’air des cris si aigus qu’ils dominèrent le fracas de la fusillade.
Vivement Simplet fit rentrer ses compagnons, et par la porte entr’ouverte suivit les phases du combat.
Bientôt l’un des partis en présence, plus faible ou moins courageux, perdit du terrain. Le mouvement de retraite s’accentua, devint une déroute. Vainqueurs et vaincus, fugitifs et poursuivants s’engouffrèrent pêle-mêle dans les bâtiments de la mission, laissant dans la cour désertée quelques blessés gémissants et aussi des morts silencieux.
– En route, ordonna Marcel d’une voix brève.
Et comme tous l’interrogeaient du regard :
– Plus tard, je vous expliquerai. Pour l’heure, l’entrée n’est plus gardée. Profitons-en.
Son accent ne souffrait pas de réplique. Sur ses pas, la cour fut traversée, la porte franchie. Les prisonniers étaient libres.
Aussi rapidement que possible, ils gagnèrent les bords de la rivière Chari, peu distante de la mission, et suivant ses rives basses et dénudées, remontèrent vers le nord, dans la direction du lac Tchad. Souvent l’un ou l’autre se retournait, craignant la poursuite des Allemands, et alors Dalvan, souriant, murmurait :
– Pas de danger. Ils ont des blessés à soigner. Le temps de songer à nous leur manque.
Au soir, ils campèrent en face du confluent de la Likota et du Chari, situé à deux jours de marche de Masena, but du voyage du capitaine Fernet. Celui-ci, à qui Marcel avait raconté le stratagème, grâce auquel il avait mis en défaut la vigilance des Allemands, annonça son intention de se séparer de la caravane dès le lendemain. Il avait hâte d’atteindre Masena. Peut-être la mission allemande du Cameroun n’y était-elle pas encore arrivée, et dans ce cas, quelle victoire pour l’expansion française en Afrique ! Ce fut avec une émotion profonde que l’explorateur serra la main du sous-officier.

– Monsieur Dalvan, lui dit-il, si j’accomplis mon œuvre jusqu’au bout, c’est à vous seul que je le devrai. Soyez certain qu’à la direction des colonies, à la Société de Géographie de Paris, on le saura.
Et le jeune homme esquissant un geste d’insouciance :
– C’est mon devoir, conclut M. Fernet, et je le remplirais alors même que mon amour-propre en devrait être blessé.
– Je vous assure que vous allez trop loin. Changer des brassards, c’est tellement simple.
– Qu’au lieu d’un étendard ennemi, c’est peut-être le drapeau français qui flottera sur Masena.
– Grâce à vous, capitaine, qui devancerez vos concurrents…
– Grâce à vous, monsieur Simplet, qui m’avez tiré des mains de leurs amis.
Marcel allait encore protester. Yvonne s’avança :
– Monsieur le capitaine, fit-elle en rougissant, au nom de tous, je tiens à vous souhaiter bonne chance. Tous ceux qui nous écoutent seront heureux de votre succès et moi plus que les autres, parce que…
– Parce que ? interrogea Dalvan.
– Oh ! acheva la jeune fille avec un rire mutin. Je serai la plus satisfaite parce que – c’est bien simple – tu es mon frère de lait !
XXXVII
UN ÉLÉPHANT

Le 3 septembre 1894, vers quatre heures, Marcel et ses compagnons aperçurent le lac Tchad. Dans la chaleur accablante, ils marchaient depuis le matin, Ils avaient fait la sieste au sommet d’une éminence boisée, et tout à coup, en reprenant la route, le lac leur était apparu, à travers une éclaircie de la futaie.
L’immense nappe d’eau s’étendait au loin ainsi qu’une mer. Ses rives vaseuses étaient couvertes de roseaux géants, parmi lesquels se produisaient de brusques ondulations, indiquant le passage des crocodiles qui pullulent dans ces marécages. Mais la terre ferme offrait un riant tableau.
Un village « Nioba » dressait là ses paillottes enfermées dans une palissade de bois. À l’entour les champs de sorgho, de mil, de manise alternaient avec les plantations d’orangers doux, de pommiers acajou, de goyaviers, d’ananas. Plus loin des bananiers se mêlaient aux caféiers. Puis venaient des plants de melons d’aspect étrange avec leur feuillage vert sombre où les fruits dessinaient des sphères d’or.
Pour les voyageurs exténués, un pareil pays semblait une « nouvelle terre promise » ; aussi tous, retrouvant des forces, descendirent la hauteur avec rapidité.
Sans doute ils avaient été signalés, car en débouchant dans la plaine, ils virent venir à eux une troupe nombreuse. C’étaient des guerriers, des femmes, des enfants. Chose étrange ; les hommes étaient couverts de cuirasses de toutes provenances. Le léger bonnet d’acier des Sarrazins se montrait auprès du heaume de l’ancien baron féodal ; la salade du hallebardier avait pour voisine un casque moderne de cuirassier.
Pour le reste il en était de même. Cottes de mailles, armures, brassards, jambières hétéroclites.
Mais malgré cet appareil belliqueux, les indigènes ne manifestèrent aucune intention hostile. Ils se bornèrent à entourer la petite troupe de loin et à la suivre jusqu’au village en chantant :
Kamé té balandri fagaï
Enna Kamé Rab Pharaun
Kamé Mouché ekbé Mohamé
Enta odé liass’gatarbé Issa.
– Ah ! remarqua Sagger dont l’érudition avait décidément son bon côté, c’est un chant de bienvenue. Et à sa forme, je crois pouvoir affirmer que nos hôtes sont des Peuhls ou Foulanis.
– Des Foulanis, interrompit Claude. Mais alors c’est une des peuplades de race blanche signalées par les explorateurs.
– Précisément. On croit que ces tribus Peuhls sont d’anciennes émigrations Égyptiennes dont elles ont le type. Tenez, regardez ces femmes ; grandes, élancées, les membres fuselés et le visage brun mais régulier, n’offrent-elles point une ressemblance parfaite avec les personnages des bas-reliefs de l’antique Égypte.
C’était vrai. Rien chez les indigènes ne rappelait le profil bestial du nègre. D’un rouge foncé, les hommes dont la tête n’était pas cachée par un casque, montraient leurs cheveux lisses, non laineux. Leurs barbes soyeuses étaient tressées en fines cordelettes ainsi que celle des sacrificateurs Isiaques.
Chez les femmes, l’allure Égyptienne était encore plus frappante, grâce à des bandelettes d’étoffe tombant de chaque côté des joues, comme les parures symboliques des Sphinx de la vallée du Nil.
– Mais enfin, reprit miss Diana, qu’a donc de si particulier leur chanson ?
Sagger réfléchit un instant :
– Ceci, miss. Elle nous apprend quelle est la religion de la tribu, et comme elle contient les noms des quatre prophètes reconnus par les Peuhls, je pense que mon assertion est exacte. En effet ils disent à peu près ceci :
Toi qui marches vers nous, tu es le bienvenu.
Au nom du très grand Pharaon
Des prophètes Moïse et Mahomet
Tu es le bienvenu aussi au nom de Jésus.
Tous se récrièrent :
– Quelle salade, dit Claude. Pharaon, Moïse, Mahomet, Jésus.
– Les quatre prophètes Peuhls.
On arrivait au village. Les cases propres, bien entretenues, laissaient entre-elles une large rue dans laquelle les européens s’engagèrent. À l’extrémité une vaste place était ménagée. Une case plus grande que les autres, enceinte d’une forte palissade, en occupait le centre.
À ce moment une partie de la palissade s’abattit, à la façon d’un pont-levis ; au milieu de l’ouverture, droit dans une tunique blanche, le crâne couvert d’un bonnet jaune, un indigène de haute taille apparut. Lentement il s’approcha des européens qui s’étaient arrêtés à sa vue. Il les examina un instant en silence, puis s’adressant à Simplet placé un peu en avant du groupe, dans un idiome bizarre composé de mots anglais, français, ou sabir :
– Toi, réponds à Mokba, interprète et poète du chef Sokloto. Es-tu Doutschi, Ingli ou Franchi ?
Et comme le sous-officier exprimait par sa mimique qu’il ne comprenait pas la question, l’interprète Mokba lui présenta une feuille de parchemin sur laquelle étaient figurés en couleur les drapeaux des trois grandes nations qui se partagent l’Afrique : Allemagne, Angleterre, France.
– Quel étendard est le tien ? fit-il.
Du doigt, Simplet désigna le pavillon tricolore à l’ombre duquel, petit soldat, il avait servi. Aussitôt le visage du Peuhl s’épanouit :
– Franchi. Étais-tu donc de ceux que les Doutschi retenaient prisonniers à leur établissement de Bifara ?
– Comment sais-tu cela, demanda le jeune homme surpris ?
– Comme nous savons tout au pays noir. Les nouvelles se communiquent vite chez nous. Nous savons même que les Doutschi se sont massacrés entre eux.
– C’est à la faveur du combat que nous avons pu nous échapper.
– Ils sont donc tes ennemis ? – et avant que Simplet pût répondre :
– Pardonne la question. Le bruit est venu jusqu’à nous d’une guerre entre ta nation et la leur, où tant de guerriers furent engagés, qu’il semblait que les peuples du monde avaient pris les armes. Oui, il y eut de grandes batailles. Les champs paternels sont fertiles depuis, car ils ont bu le sang généreux des jeunes hommes.
Mokba parlait pour lui seul, oubliant la présence des Européens. Il s’interrompit soudain.
– Fou que je suis. J’improvise le chant de mort des générations disparues, et j’omets de te transmettre les paroles du chef Sokloto. Doutschi, je t’aurais ordonné de quitter notre territoire. Ingli, je t’aurais permis de camper hors du village. Franchi, je t’invite à me suivre avec tes compagnons dans la case de mon maître. Il t’attend.
Cinq minutes plus tard, les voyageurs pénétraient dans la case construite en pisé et recouverte d’un toit de chaume. Le chef Sokloto, beau vieillard drapé majestueusement dans un manteau blanc rayé de bleu, les chevilles serrées par le touba – pantalon flottant – les reçut le sourire sur les lèvres. Il les fit asseoir sur les nattes qui composaient tout l’ameublement. Mais si les sièges faisaient défaut, le chef y suppléa à force d’amabilité.
À son appel des femmes parurent. Les unes apportèrent dans des vases de terre au col allongé, le dolo de bienvenue, boisson fermentée fabriquée avec le miel. D’autres déposèrent devant les voyageurs des calebasses remplies de lac-lalo, sorte de conserves, ou de mafé, ragoût composé de viande, de riz et d’huile d’arachides.
Tout en mangeant avec un appétit réjouissant, Sokloto interrogeait par l’intermédiaire de Mokba. Sa curiosité n’était jamais satisfaite. Il voulait savoir d’où venaient les européens ; où ils allaient ; comment Sourimari, jeune fille d’une race inconnue de lui, se trouvait en leur compagnie.
Et sans se lasser Simplet, devenu l’orateur de la caravane, répondait. Sa complaisance du reste devait être récompensée. Comme il expliquait que ses amis et lui voulaient rejoindre Antonin Ribor, Sokloto poussa une exclamation gutturale.
– Qu’est-ce ? fit le sous-officier.
– Le chef, répliqua Mokba, dit avoir vu celui que tu cherches.
– Vu ! s’écria Yvonne. Mon frère ! où est-il ?
– Vers le Nord, déclara l’interprète. Il a passé ici, il y a cinq jours. Avec lui marchaient des Maures trarzas et un homme de sa nation qui les commandait.
– Canetègne, gémit Mlle Ribor !
– C’est là en effet le nom que lui donnait son ami.
– Son ami ?
– Ne l’est-il pas ? Ils semblaient au mieux ensemble. Ici ils ont loué des pirogues et des rameurs pour traverser le lac Tchad. Leur intention était d’emprunter ensuite la route des caravanes qui font le commerce entre le pays de Bornou et celui de Tripoli.
Tous écoutaient, le cœur serré. L’émissaire, envoyé par Canetègne à la mission de Bifara, avait dit la vérité. L’Avignonnais ramenait en Europe Antonin Ribor, privé de la preuve sur laquelle Yvonne comptait pour confondre son accusateur. La jeune fille devrait consentir à être madame Canetègne, à moins de s’exiler à jamais de ce pays de France où elle avait rêvé d’être heureuse.
Sokloto se taisait, étonné de l’expression désolée répandue sur le visage de ses hôtes. Dans le silence, Simplet murmura :
– C’est bien simple…
Oh ! la bonne parole ! Ce tic qui jadis agaçait Yvonne, rappela les couleurs à ses joues :
– Parle, pria-t-elle. Parle, Marcel, car toi seul es capable de me sauver.
Le sous-officier lui adressa un doux regard :
– Je songeais, petite sœur, que l’affirmation d’Antonin, venant s’ajouter à la tienne, embarrasserait certainement M. Canetègne devant les juges de Lyon. Que dès lors, notre ennemi ne sera pas assez sot pour conduire ton frère en France.
– Alors tu crois ?…
– Je crois que pour déjouer les projets de ce coquin, il faut le rejoindre. Il a traversé le lac, traversons-le. Notre hôte est bien disposé ; proposons-lui de nous louer les pirogues nécessaires.
La motion fut adoptée. Mais Sokloto, à qui Mokba avait transmis la demande des européens, avoua que ses pirogues, au nombre de cinq, avaient été à peine suffisantes pour M. Canetègne et sa suite. Les embarcations, conclut-il, rentreraient sans doute le lendemain. Dès le jour suivant elles seraient à la disposition des voyageurs.
Le chef Peuhl était décidément un brave homme. Voyant le désappointement de ses hôtes, il voulut les consoler de leur inaction forcée. Des hérauts parcoururent le village, enjoignant aux guerriers de se préparer à une chasse à l’éléphant, dont Sokloto donnerait le spectacle à nos voyageurs. Les traces d’un animal de grande taille avaient été relevées aux environs. Et comme le sport annoncé ne les déridait pas assez au gré du Foulani :
– La nature seule apaise les soucis des hommes, modula le poète Mokba. Étrangers, descendons au bord du lac et puisez le calme dans la vue de la terre qui s’endort.
Tous obéirent à cette invitation. L’interprète avait dit vrai. Ils oublièrent leurs angoisses devant l’admirable décor qui se déroula devant leurs yeux.
Sur les rives du lac empourpré par le soleil couchant, de longs troupeaux de bœufs venaient boire, sous la garde de pâtres qui poussaient des cris et lançaient des pierres dans les roseaux pour éloigner les caïmans. Dans les arbres proches du bord de l’eau, des myriades d’oiseaux, de perroquets faisaient entendre leur babil assourdissant, des singes sifflaient tout en exécutant les plus grotesques cabrioles. À la surface du lac, des bandes de pélicans tournoyaient lourdement, préludant ainsi à la pêche nocturne. Et au loin, dans la forêt obscure qui marquait la limite des cultures, des rauquements assourdis annonçaient, qu’après le repos de la journée, les fauves étiraient leurs membres nerveux, prêts à se mettre en quête d’une proie impérieusement réclamée par leur estomac affamé.
Puis le soleil s’enfonça sous l’horizon. Le paysage se noya d’une teinte grise dans laquelle s’agitaient encore de vagues silhouettes. Enfin la nuit se fit complète, impénétrable, dans un formidable concert de rugissements. Les carnassiers saluaient la victoire de l’obscurité, complice bienveillante de leurs sanglantes agapes.
On regagna le village, et malgré leur préoccupation, les compagnons d’Yvonne, comme elle-même, s’endormirent d’un profond sommeil dans les cases que le chef Peuhl leur avait attribuées.
Des hennissements de chevaux, des appels du fando, sorte de trompe faite d’une corne de bœuf, annoncèrent l’aurore. Aussitôt chacun fut debout.
Dans la cour, les chasseurs étaient déjà rassemblés, les uns à pied, les autres montés sur de petits chevaux dont la taille égalait à peine ceux de nos « doubles-poneys ». Sokloto souhaita le bonjour aux européens, auxquels un certain nombre de montures avaient été réservées. Ceux-ci se mirent en selle.
Alors Mokba fit un signe. Les conversations cessèrent, hommes et bêtes devinrent immobiles. Le poète sourit et d’une voix sonore fit entendre les strophes que voici :
« L’Éléphant est fort et puissant – Son large pied fait trembler la terre – Qui craint de s’entrouvrir sous son poids – À son choc, l’arbre se brise.
« L’Éléphant est fort et puissant – Sa trompe est un bras vigoureux – Que lui donnèrent les noirs génies – Les génies noirs de la fatalité.
« L’Éléphant est fort et puissant – Plus que le granit sont dures ses défenses – Et quand il charge un ennemi – Il semble porté sur l’aile du cyclone.
« L’Éléphant est fort et puissant – Mais vaillant est le guerrier Peuhl – Qui d’une main sûre, d’un cœur altier – Jette à terre le colosse expirant. »
Des cris frénétiques accueillirent l’improvisation du poète. Les chasseurs brandissaient leurs armes, clamant à tue-tête :
– Framana ! Framana !
Onomatopée qui correspond au hurrah ! anglais.
Aussitôt les rangs se disloquèrent, les fantassins s’élancèrent au dehors, et se déployant en tirailleurs, marchèrent vers la forêt. Seuls les cavaliers, des chefs pour la plupart, restèrent auprès de Sokloto. Ce dernier frappa dans ses mains. Des femmes accoururent chargées de corbeilles emplies de galettes de manioc. À chacun des assistants elles remirent deux de ces « bagooé. »
– Tiens ! on emporte des provisions, questionna Marcel en enfouissant les galettes dans sa poche’?
Ce fut Sagger qui répondit :
– Le bagooé, croient les peuplades du Soudan, a la propriété de dissiper les influences hostiles. Quand on en est muni, la chasse est toujours bonne.
– C’est une sorte d’amulette en ce cas ?
– Précisément !
À ce moment, les cavaliers indigènes se mettaient en mouvement. D’un temps de galop, ils dépassèrent les piétons et disparurent bientôt sous les arbres de la forêt. Sokloto et Mokba demeuraient seuls avec les européens.
– Nous ne chassons donc pas, maugréa Bérard ?
– Si, fit encore sir William, seulement, tous les rabatteurs partis en avant vont évoluer dans la forêt, de façon à pousser le gibier vers le point où nous l’attendrons. Ayant moins de chemin à faire que les autres, rien ne nous presse.
– Comment savez-vous tout cela ?
– J’ai lu l’exploration du Soudan par le docteur Barth. Je me souviens, voilà tout.
Comme s’il avait compris l’impatience de ses hôtes, Sokloto donna le signal du départ. La petite troupe sortit du village, gagna la rive du lac et se trouva bientôt dans une plaine basse, humide, couverte de hautes herbes et de buissons épineux. Le sol se releva bientôt, et la caravane s’engagea dans un ravin enserré entre deux pentes boisées.
– C’est le chemin de l’éléphant, expliqua Mokba. Durant la saison des pluies une rivière le rend impraticable. Mais à cette époque de l’année, il offre à l’animal poursuivi une route facile, sans obstacles. Aussi est-on sûr d’y voir déboucher le gibier.
La vallée s’élargissait en un cirque à l’autre extrémité duquel apparaissait l’ouverture d’un sentier encaissé.
– Ici, reprit l’interprète, existe un lac lorsque la rivière roule ses eaux vers le lac Tchad. Pour l’instant c’est une prairie nue. La bête traquée, blessée généralement, y épuise ses forces en charges furieuses. Les crêtes du pourtour sont occupées par nos guerriers qui, à l’abri du danger, l’achèvent aisément.
Il parlait d’une voix calme. À l’entendre, on eut dit qu’il s’agissait de forcer, non pas un des animaux les plus redoutables de la création, mais un simple et inoffensif lapin de garenne.
La prairie était presque traversée. Les chasseurs allaient s’engager dans le sentier creux, dont les talus en pente assez douce leur permettraient de gagner les crêtes du cirque, quand un incident sans importance en lui-même les contraignit à s’arrêter.
La selle de miss Diana, mal sanglée sans doute, tournait menaçant de faire glisser l’Américaine. William Sagger se précipita pour réparer le mal. Malheureusement pendant cette opération, le géographe aperçut un dôme de terre de deux mètres de haut qui se trouvait à peu de distance.
– Un nid de termites, fit-il.
– Ne sont-ce pas les fourmis blanches d’Afrique, demanda Diana ?
– Si, précisément. Ce nid placé dans le lit d’une rivière a du être abandonné par ses habitants ; c’est une occasion de l’examiner et si vous le permettez ?…
– Certainement !
Sokloto consulté déclara que ses hôtes étaient les maîtres. L’inspection de la fourmilière réduirait toujours la durée de l’affût. Car la battue commençant à peine, il était probable que l’éléphant ne paraîtrait pas avant plusieurs heures.
En un instant tout le monde mit pied à terre. Les chevaux furent remis à la garde des serviteurs et chacun courut à l’édifice construit par la gent formique.
C’était un cône presque régulier, dont la base mesurait environ six mètres de circonférence. Les parois, battues et tassées par les industrieux insectes, avaient la consistance du ciment. De place en place se voyaient des ouvertures circulaires, entrées des galeries souterraines – toutes défendues par des sortes de chevaux de frise, formés des brindilles de bois, d’épines, d’herbes entrelacées.
William fit remarquer cette particularité à ses compagnons.
– Singulières bestioles, déclara-t-il, qui ont une organisation guerrière et qui, bien avant nos ingénieurs, avaient atteint la perfection dans l’art de la fortification. Si à l’aide de mon couteau, je pratique une coupe d’une galerie, vous constaterez que des barricades sont ébauchées en prévision d’une invasion possible. Bien plus, la galerie elle-même affecte la forme sinueuse d’une tranchée-abri.
Des hennissements épouvantés arrêtèrent net l’orateur. Les chevaux, tenus en main, se cabraient cherchant à s’enfuir. Un danger devait menacer les voyageurs. Vite ! il fallait se remettre en selle. Mais avant que ce projet fût mis à exécution, les quadrupèdes échappant à leurs gardiens, trop faibles pour résister, s’enfuirent au triple galop à travers la plaine, suivis par Sokloto et Mokba qui hurlaient avec épouvante :
– Moussia fardo ! Un éléphant solitaire !
Les européens pâlirent. Un effroyable péril se dressait devant eux. Poursuivi, l’éléphant est toujours un adversaire terrible. Mais le solitaire, c’est-à-dire l’animal qui, pour une raison quelconque, ne vit pas en troupe avec ses congénères, est certainement la rencontre la plus effroyable que puisse redouter le chasseur.
Et devant cet ennemi furieux, rapide comme la foudre, Marcel et ses amis se trouvaient seuls, livrés à eux-mêmes, privés de leurs montures dont le galop leur aurait donné chance de gagner le ravin, d’escalader les pentes raides impraticables pour le pachyderme.
Soudain, du sentier creux, en avant duquel la caravane avait fait halte, surgit une masse énorme, baritant lugubrement de colère et de douleur.
L’éléphant accourait la tête baissée. Une flèche fichée dans l’une de ses jambes de devant expliquait sa fureur. Il était à cinquante pas des européens. Il les aperçut et s’arrêta net, soufflant avec la vigueur d’un ventilateur de forge. Ses petits yeux brillaient de rage. Ses pieds impatients déchiraient le sol.
Pris de panique, tous s’enfuirent, cherchant à atteindre la rampe dont la plaine était bordée. Si le monstrueux quadrupède hésite quelques secondes à poursuivre les fugitifs, ceux-ci sont sauvés.
Espoir vain ! Le colosse lance dans l’air un cri strident ainsi qu’un appel de trompette et fonce droit sur les européens.
Ceux-ci sont éparpillés dans la plaine. Devant Diana, Claude Bérard, le capitaine Maulde, les matelots forment un rempart de leurs corps à l’Américaine. Dalvan couvre la retraite d’Yvonne. Sagger court, précédé par Sourimari. C’est sur le géographe que se tourne la rage de l’éléphant.
Une course éperdue, désespérée commence. L’issue n’en peut être douteuse. Le pachyderme gagne rapidement du terrain. Encore quelques bonds et il rejoindra l’homme, il le piétinera furieusement, faisant de l’aimable intendant une loque sanglante et sans forme.
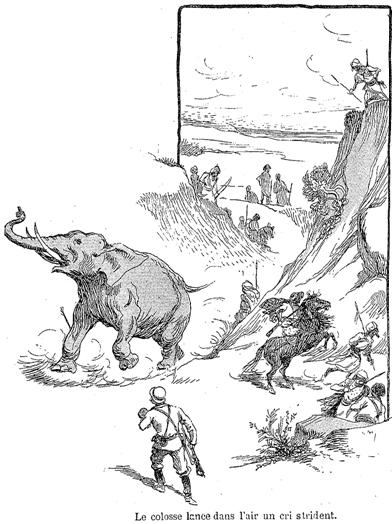
La maorie voit le péril. Ses grands yeux noirs ont un regard désolé pour le ciel, les arbres, la terre, et elle s’arrête, les bras croisés, s’offrant en holocauste à la furie du colosse, afin de sauver celui qui jadis lui conserva la vie. William sent comme un déchirement à la pensée qu’elle va mourir. Lui aussi s’arrête. Il veut entraîner la jeune fille. Trop tard hélas !
Ce temps d’arrêt, la bête farouche l’a mis à profit. Elle est tout près. Le drame va s’accomplir.
– Adieu ! murmurent en même temps l’Américain et la fille des Maoris en se tenant la main.
– Adieu ! Vous êtes fous, fait une voix tranquille à côté d’eux !
Ils regardent. Marcel est là ; Marcel qu’une réflexion a arrêté dans sa fuite.
– Amadouer un éléphant… C’est simple comme bonjour. J’ai vu cela au Jardin des Plantes.
Tranquillement il s’avance vers le pachyderme. Surpris, celui-ci s’arc-boute sur ses jambes. En son crâne épais, il doit se demander ce que signifie l’action de ce frêle ennemi, qu’il briserait d’un coup de trompe. Simplet s’approche toujours. Il tient à la main l’une des galettes de manioc qu’on lui a données au départ. Il la tend à l’animal.
Et alors, les fugitifs terrifiés qui ne songent plus à se sauver assistent à une scène curieuse. L’éléphant a allongé sa trompe vers la galette, il la flaire, il la saisit, la fait disparaître dans sa large bouche. Tandis qu’il la déguste avec une satisfaction évidente, Dalvan se rapproche encore. Il est presque entre les jambes du géant africain. Il lui offre le second bagooé, réclame ceux que portent Sagger et Sourimari, et tandis que le solitaire absorbe en fin gourmet les friandises du panetier improvisé, Simplet s’assure que sa blessure est légère. La flèche a traversé la peau, formant séton. Il arrache l’arme de la plaie. La bête frissonne ; sa trompe se dresse menaçante, mais le sous-officier la flatte de la main. Il appelle ses compagnons. Un des matelots porte une gourde pleine d’eau. Grâce au précieux liquide, la blessure est lavée.
Maintenant le pachyderme semble comprendre. Il le témoigne par des gémissements très doux. On dirait qu’il remercie. Puis il suit Marcel, qui reprend le chemin du village avec ses amis, sans prêter la moindre attention aux rabatteurs foulanis, groupés sur les crêtes dans une attitude de stupéfaction.
XXXVIII
STRUGGLE FOR LIFE
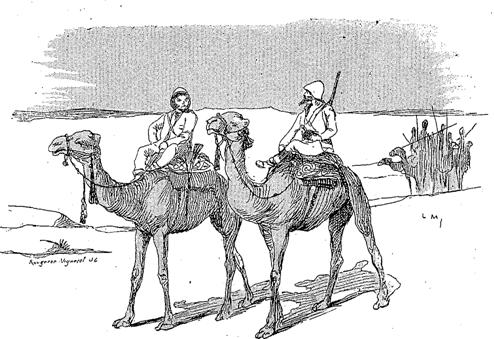
Tandis que ses victimes partaient en chasse, M. Canetègne quittait Nwigmi, bourgade située à l’extrême nord du lac Tchad. Juché sur un méhari, – chameau de course, – il écoutait d’une oreille distraite Antonin Ribor, dont la monture réglait son pas sur celui de la sienne. En arrière une vingtaine de Maures Trarzas, escorte de l’Avignonnais, maintenaient leurs méharis à distance respectueuse de ce dernier.
– Ah ! disait le frère d’Yvonne sans doute dans une minute d’expansion, mon cher M. Canetègne, comment vous remercierai-je jamais, vous qui n’avez pas craint de me venir chercher jusqu’au centre du continent noir. Je suis pénétré de honte en songeant que je vous jugeais si mal autrefois.
– Té, bougonna le commissionnaire. Vous me preniez pour un ogre, pas vrai ?
– Je m’en excuse. Les débuts de nos relations avaient été pénibles. Plus expérimenté, je n’aurais accusé que moi, que mon ignorance des affaires.
– À la bonne heure. Voilà qui est parler sagement.
– Ah dame ! Deux années de Sahara vous forment un homme. Si vous saviez ! Quand je suis arrivé au Sénégal, à Saint-Louis, je pensais que j’allais conquérir le monde. La montée du fleuve fut un enchantement. Je peinai bien un peu dans le trajet pédestre de Bammako, poste du Sénégal, à Ségou sur le Niger. Mais c’était trop peu pour me décourager. Je comptais suivre le Niger, passer à Timbouctou – et non Tombouctou, comme vous dites en France – gagner le golfe de Guinée, pousser une pointe au Dahomey, puis sur la côte d’Ivoire. Ah ! les jolis projets ! En amont de Timbouctou, je fus enlevé par les Touareg, qui, durant deux années, me gardèrent prisonnier. Tout en apprenant leur langue, comme le célèbre caporal Marthe des tirailleurs Sénégalais, qui fut soumis aux mêmes épreuves, j’arrivai à une conception plus exacte des choses. Votre dévouement me prouve qu’ainsi je me rapprochais de la sagesse.
Si endurci qu’il fut, Canetègne était gêné par la gratitude imméritée de son compagnon. D’un mouvement involontaire, il tira sur le licol de son méhari. Celui-ci s’arrêta net, ce qui pensa faire perdre l’équilibre au triste personnage. L’incident changea le cours des idées d’Antonin. Maintenant il parlait des hardis pionniers qui avaient parcouru la portion du continent noir que lui-même connaissait.
– Que de courage dépensé, faisait-il. Compagnon et Rubault explorent la Falémé. Mollien atteint les sources du Niger ; de Beaufort meurt à Bakel des fatigues endurées en reconnaissant la Gambie et le haut Sénégal. René Caillé atteint Timbouctou et meurt désespéré par les dénégations intéressées de rivaux envieux. Puis Anne Raffenel, s’échappant par miracle de Foutobi dans le Kaarta, après une longue captivité, de Mage, Alioun-Sal, Paul Soleillet, Aimé Ollivier, Jacquemart, Piétri, Galliéni et tant d’autres.
Sans s’inquiéter du mutisme du commissionnaire, Antonin continuait, s’émouvant à la pensée de ces éclaireurs de la civilisation. Son visage, qui offrait une ressemblance frappante avec celui d’Yvonne, s’animait, resplendissant de courage, de généreuses idées.
– Il y a d’étranges coïncidences, déclara-t-il tout à coup. Vous savez que le commandant Monteil, parti de Saint-Louis, arriva au lac Tchad par Bakel, Bammako, Ségou, Sikkato, Moni, Sokoto et Kouka, pour remonter ensuite au Nord par Nwigmi, Agadem, Kaouar, Yat, Gatroun, K’otna, Tripoli. Eh bien, au départ, j’ai suivi son itinéraire jusqu’à Ségou, et notre rencontre me ramène vers l’Europe par la voie qu’il a parcourue au retour.
Mais à parler seul, on se fatigue vite. Bientôt le jeune homme se tut et chevaucha silencieusement auprès de son co-associé.
Le soir on campa près d’un ruisseau clair, l’Aoule. Canetègne prétexta la fatigue pour se retirer sous sa tente. Il y fut rejoint presque aussitôt par Ali, le maure qu’il avait envoyé en ambassadeur à la mission de Bifara.
– Salut cheik, dit le Maure.
– Salut Ali, que veux-tu ?
– Te dire que j’ai accompli tes ordres.
– Ah ! explique-toi.
– Ce matin, je me suis rendu chez le chef de Nwigmi. Je lui ai enseigné dans quelle direction nous marchions, afin qu’il en instruise ceux que nous avons laissés à Bifara.
– C’est bien, agis de même partout où nous nous arrêterons.
– Ali t’obéira, cheik.
Sur ces mots, le Trarza se retira. Canetègne resta seul. Mais au lieu de s’endormir, comme il en avait manifesté l’intention, il demeura assis, le visage enfoui dans ses mains. À quoi songeait l’Avignonnais ? Certes ses pensées devaient être moroses à en juger par son attitude. Soudain il releva la tête.
– Pécaïre ! grommela-t-il. Pas moyen d’en sortir autrement !
Et avec une rage concentrée :
– J’ai tout fait pour éviter ce parti extrême, mais les circonstances sont contre moi. Je parviens au Congo. Je recrute vingt bandits, chasseurs d’esclaves, avec l’intention d’enlever de vive force cette petite sotte. Mes Arabes prennent peur en voyant le capitaine Maulde et ses matelots. C’est étonnant comme ces drôles respectent la marine. Tout ce que je puis obtenir, c’est qu’ils tirent de loin. De la poudre aux moineaux, cela ! Du bruit et pas de mal. À Bifara, je pense être plus heureux. Mes adversaires sont prisonniers. Désireux d’arrêter en même temps cet imbécile d’explorateur, le capitaine Fernet, l’excellent M. Wercher les garde. Que faire ? Un coup d’audace. J’envoie Ali réclamer ma femme. S’il la ramène, je suis sauvé. Mais cette canaille de Marcel Dalvan menace, le pasteur tremble. Mon émissaire revient seul.
Le visage grimaçant de colère, le négociant lança un coup de poing dans le vide :
– Patatras ! Antonin, dont j’avais eu la malencontreuse idée d’invoquer le nom, me tombe sur les bras. S’il continue sa marche vers le Sud, il rencontrera sa sœur. Les Africains sont si bavards et les promeneurs européens si rares dans ces parages. Il faut que je l’arrête.
Le scélérat eut un ricanement :
– Heureusement il est bête à manger de l’alfa, comme disent les Maures. Je lui raconte que j’ai entrepris le voyage pour le retrouver. Il me croit, le crétin ! Nous traversons le lac Tchad, nous allons entrer dans le désert. Je dois en sortir seul. Mes Arabes lui procureront le sommeil éternel. Sa bouche ne s’ouvrira plus pour m’accuser.
Canetègne fit une pause :
– Un assassinat, bégaya-t-il en frissonnant. Un assassinat. Je ne croyais pas être contraint d’en arriver là !
Il regarda autour de lui d’un air apeuré. De fait, l’idée du crime le terrifiait. Sans trop d’hésitation il avait autrefois confié au Ramousi Nazir le soin de poignarder Simplet. Mais alors il s’agissait seulement de blesser le sous-officier, de le retarder, tandis qu’aujourd’hui c’était à mort qu’il fallait frapper.
À mort ! Ces deux mots résonnaient sous son crâne avec une vibration d’épouvante. Tuer paraissait effroyable à l’homme d’affaires, expert en fourberies, habitué aux mouvements tournants qui échappent aux articles du Code. Canaille légale, malandrin embusqué dans la marge du droit commun, falsificateur habile des poids de la balance de Thémis, l’Avignonnais manquait de vigueur pour le crime brutal. Conduire son semblable à la ruine, l’écraser sous un faux serment, le condamner au désespoir, à la misère ; rien de mieux. Tout cela, c’est « les affaires ». Mais verser le sang ; oh pouah !
Et cependant, la situation l’acculait à cette dure nécessité. Il ne pouvait plus reculer. Ayant trompé Antonin, lui ayant laissé croire que sa sœur attendait son retour à Lyon, il lui était interdit de ramener le jeune homme en pays civilisé. Fatigué par ces réflexions fâcheuses, M. Canetègne finit par s’endormir.
Au matin, il se leva dispos. Il avait trouvé une raison sensée pour retarder le trépas du jeune explorateur.
– Qu’est-ce que je demande, s’était-il dit ? Simplement de jouir en paix du fruit de mon travail. Eh bien, dans la traversée du désert, il peut se produire un incident qui supprime ce garçon, ou bien mon épouse, sans que j’y sois pour rien. Il sera toujours temps d’aider le destin au dernier moment.
La route fut reprise. Le pays devenait déjà moins fertile. L’approche du Sahara se faisait sentir.
Le 11 septembre, la caravane atteignit Belgadjijari, ksour de deux ou trois cents habitants qui marque la frontière septentrionale du Bornou.
Le 20, elle eut connaissance d’Agadem, où elle apprit la prise de Tombouctou par les troupes françaises du Soudan.
Le 28, elle arrivait à Bilma.
Canetègne s’assombrissait. Que le désert fut composé de dunes, et que le pied des méharis foulât le lit pierreux d’une rivière desséchée, ou que des palmiers se montrassent autour d’un puits, le négociant restait morose.
Les Touaregs du désert, sur lesquels il comptait pour s’épargner un crime, ne paraissaient pas. Sans doute les Hoggars, les Ben-Aïr, les Adzjer, avaient envoyé leurs guerriers à Timbouctou la Sainte, pour combattre les Français.
Cependant Ali, dans chaque ksour – village – se présentait chez le mokhadem, secrétaire du cheik, et lui fournissait des renseignements suffisants pour que Marcel et ses amis, s’ils poursuivaient l’Avignonnais, ne courussent pas le risque de s’égarer.
Dans les premiers jours de novembre, la caravane bivouaqua au ksour de Yala.
Là, les voyageurs apprirent qu’il était impossible de poursuivre leur route vers Tripoli. Des vols de sauterelles s’étaient abattus sur les oasis. Ils n’y trouveraient plus ni aliments, ni fourrages pour leurs montures. Il leur fallait obliquer à l’Ouest et rejoindre les territoires de parcours des tribus Chambaa, naguère visités par le colonel Flatters.
Franchissant des dunes couvertes de drinn – graminée haute de deux mètres, que les chameaux broutent avec plaisir et qui croît sur toute la surface sablonneuse du désert – contournant les sebkas, rares étangs situés à de grandes distances les uns des autres ; tantôt grillés par le soleil du midi, tantôt transis sous les gelées blanches de la nuit, les voyageurs s’arrêtèrent à la fin de décembre, auprès du puits de Bir-el-Gharama. Lieu sinistre que cache un effrayant chaos de roches entassées ! C’est là que, le 16 février 1880, le colonel Flatters et ses compagnons, partis pour reconnaître le tracé du chemin de fer Transsaharien, furent massacrés par les Touareg Hoggar.
Les tentes dressées, les Arabes préparèrent le repas. Assis à l’écart sur un bloc de pierre, Canetègne promenait autour de lui un regard inquiet. Dans cette gorge sauvage, parmi les rochers calcinés par le soleil, ses yeux ne trouvaient à se reposer que sur quelques chétifs gommiers accrochés aux flancs de granit de la montagne.
L’idée de mort le hantait. Il savait – Ali le lui avait conté – le trépas affreux du colonel Flatters, et il considérait avec une sorte d’effroi Antonin Ribor voluptueusement étendu auprès du puits. La vue de celui qu’il avait condamné avivait le souvenir de l’officier mort. Dans l’air semblait planer une vague terreur.
– Cheik, fit une voix assourdie.
Il tressauta. Ali se tenait debout devant lui :
– Qu’est-ce encore ? demanda-t-il d’un ton de mauvaise humeur.
L’Arabe ne s’en émut pas. D’une voix tranquille il reprit :
– Par le nom sacré d’Abdallah, tu as promis cinq cents francs à chacun de nous, le jour où le roumi qui repose là-bas aura exhalé son âme.
Il désignait Antonin. Le négociant frissonna :
– Certainement, je l’ai promis. Pourquoi me rappelles-tu cela ?
– Parce que le moment de gagner la somme est venu.
– Déjà !
L’Avignonnais s’était levé, les mâchoires tremblottantes.
– Nous sommes encore loin des territoires soumis à la France.
– Assez loin aujourd’hui. Tu as raison. Mais demain nous serons trop près.
– Je ne comprends pas.
– Je le vois. Nous allons entrer dans des pays non soumis directement aux Francs, mais dont les populations vont commercer à Ouargla, dont l’agha est dévoué aux gens d’Europe.
– Ouargla ! Ah ça ! tu me trompais ce matin, alors que tu m’affirmais que mille trois cents kilomètres nous séparent encore de ce ksour.
– Non, c’est exact. Mais cette distance représente douze ou quinze jours de voyage au plus pour le Targui monté sur son méhari de course.
– Le Targui ? Qu’appelles-tu ainsi ?
L’Arabe eut un sourire.
– Tu ne connais pas la langue berbère. Targui est le singulier de Touareg. Un Targui, des Touareg. Mais il ne s’agit pas de cela. Ici il faut agir. Dans quelques jours, il sera trop tard. La tombe où dormira le roumi sera découverte par les nomades. Ils porteront la nouvelle à Ouargla, dans l’espérance de recevoir un présent. Nous serons inquiétés.
Canetègne haussa les épaules :
– Allons donc ! Dans le désert, aucune preuve contre nous.
– Tu te trompes encore. Le désert parle à qui sait l’interroger. Les champs de drinn conservent la trace de notre passage. Nos empreintes sont moulées dans le sol humide des Sebkas. Le lit de basalte des rivières desséchées a été égratigné par le sabot de nos méharis. Le jour l’agha d’Ouargla questionnera, la dune, le rocher, le puits ombragé de palmiers témoigneront contre nous.
La tête basse, sentant peser sur lui l’inéluctable fatalité du crime, l’Avignonnais garda le silence.
– Eh bien ? poursuivit le Maure. Que décides-tu ?
Canetègne releva le front. Un instant son regard se riva sur celui de son interlocuteur. Puis d’une voix sourde il murmura :
– Fais ainsi que tu le juges utile.
Lentement le Trarza tourna sur ses talons et d’une allure paisible se dirigea vers l’endroit où Antonin reposait. Étendu sur le sol à dix pas du puits de Bir-el-Gharama, le jeune homme lassé par la rude étape de la journée, se laissait aller aux douceurs de la station horizontale. Les paupières closes, les membres alanguis par un engourdissement délicieux, il rêvait à l’heure prochaine où il rejoindrait Yvonne, sa seule affection au monde. La main d’Ali, en s’appuyant sur son épaule, le rappela brusquement au sentiment de la réalité.
– Te plairait-il d’abattre une gazelle ? demanda cauteleusement le. Maure.
Ribor fut aussitôt sur ses pieds.
– Une gazelle ! je crois bien. Tu as relevé des traces ?
– Oui. Un troupeau est sur le versant de la montagne. J’ai entendu les appels des mères.
– Allons. Si nous faisons bonne chasse, notre ordinaire y gagnera quelque variété.
Un instant après, le jeune homme, son fusil en bandoulière, s’approchait de Canetègne.
– Vous n’êtes pas des nôtres, mon cher Canetègne ?
L’homme d’affaires le considéra d’un air égaré.
– Des vôtres ? Je ne saisis pas.
– Oh ! s’écria Ribor en riant. Quelle figure vous faites ! Je suis sûr que vous songiez à quelque combinaison commerciale.
– En effet… Le commerce, c’est ma marotte. Et quand on a une marotte…
Il bredouillait, mordu au cœur par une émotion lâche devant ce loyal garçon qu’il envoyait à la mort. Mais Antonin était sans défiance :
– Je vous laisse à vos combinaisons. Puisque nos affaires vous préoccupent à ce point, nous tâcherons à vous gâter. Une petite gazelle pour votre dîner, voilà qui vous ouvrira les idées.
Et se retournant :
– Ali est prêt à ce que je vois, je vous quitte.
Le Trarza s’avançait en effet avec quatre Arabes de l’escorte.
– Au revoir, mon cher Canetègne, acheva Ribor en tendant la main au négociant.
Celui-ci y mit la sienne. Il tremblait.
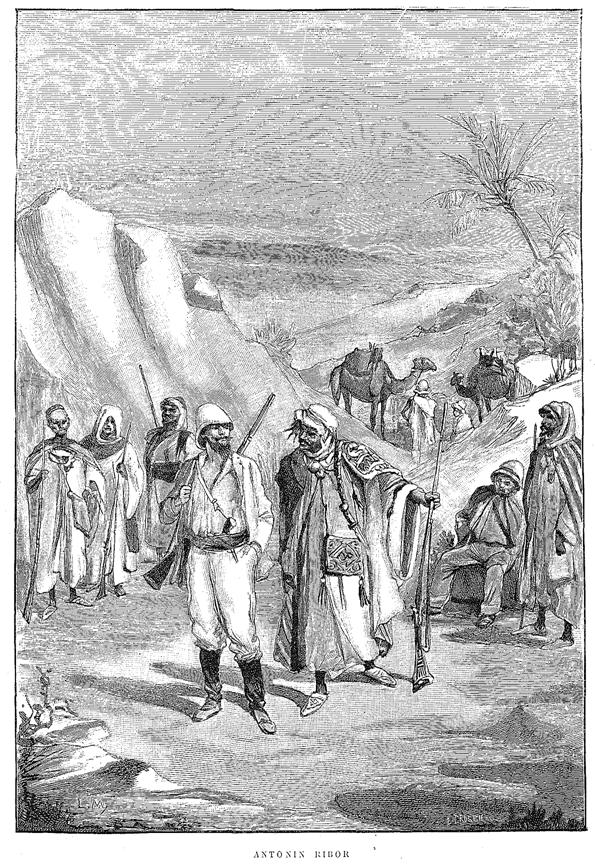
– Souhaitez-moi au moins : bonne chance. Vous êtes vraiment trop absorbé.
Dominant son trouble, Canetègne parvint à articuler :
– Bonne chance !
Comme pétrifié il regarda son ex-associé s’éloigner avec les Maures.
Tous s’engagèrent dans un sentier escarpé serpentant sur la pente de la montagne. Ils s’élevaient lentement, décrivant des zigzags allongés. Ali marchait le premier, se dirigeant avec adresse parmi les blocs rocheux qui barraient la route à chaque instant. L’ascension continuait. À mesure que les chasseurs montaient, ils semblaient rapetisser ; on eut dit maintenant des enfants. Soudain l’Avignonnais ressentit une commotion. Ali, dont il suivait tous les mouvements, venait de s’arrêter. L’Arabe se baissa, parut débarrasser sa chaussure d’un objet gênant : caillou, épine, ronce. Antonin le dépassa. Alors, avec une épouvante folle, Canetègne vit le Trarza se relever, épauler son arme. Il poussa un cri rauque auquel répondit une détonation affaiblie.
Ribor, frappé par derrière, étendit les bras, tomba sur un roc placé en parapet au bord du sentier, bascula sur l’obstacle et roula, masse inerte, le long de la pente.
Les Arabes se mirent en devoir de descendre, mais tout à coup ils demeurèrent immobiles. Puis une discussion s’engagea sans doute entre eux. De leurs bras étendus, ils montraient le sud. Dans le campement, les Trarzas manifestèrent aussitôt une vive inquiétude, et sur un signe de l’assassin de l’explorateur, ils abattirent les tentes, sellèrent les chameaux, comme si une cause impérieuse les forçait à lever le camp.
Ces préparatifs arrachèrent le commissionnaire à sa torpeur. Il interpella le premier Maure qui se trouva à sa portée :
– Ah ça, que faites vous ?
L’indigène répliqua par ce seul mot :
– Touareg !
Et il continua son paquetage. Mais Canetègne avait compris. De leur poste élevé, Ali et ses compagnons dominaient la plaine. Ils avaient aperçu un parti de Touareg. La caravane devait fuir pour n’être pas rançonnée, voire massacrée par les farouches écumeurs du désert.
Comme par enchantement, ses appréhensions vagues disparurent devant le danger réel, imminent. Tout à l’heure il frissonnait à la pensée que l’ombre d’Antonin, nouveau spectre de Banco, viendrait, dans les nuits noires, s’asseoir à son chevet et peupler son insomnie de cauchemars funèbres. À présent, sa victime était oubliée. Seul l’instinct de la conservation criait en lui.
– Sauve qui peut ! Les Touareg sont là !
Pour la première fois depuis le commencement du voyage, il se hissa sans aide sur son méhari. Ali et ses complices accouraient haletants. En quelques secondes chacun fut en selle, et les chameaux, stimulés par leurs conducteurs éperdus, contournèrent de toute la vitesse de leurs jambes le mont sanglant de Bir-el-Gharama, pour gagner les passes difficiles du massif d’Ikerremoïn. Une heure après, cinquante méharistes Hoggar faisaient halte autour du puits abandonné.
Ils avaient des faces hâves. Leurs montures étaient surmenées. Beaucoup de guerriers avaient perdu leurs armes. Tout décelait la défaite, la fuite précipitée. En effet, ces hommes étaient les débris d’une troupe de quatre cents Hoggar. Ils arrivaient de Timbouctou. Après avoir coopéré à l’anéantissement de la colonne Bonnier, ils avaient été surpris à leur tour et écrasés. À cette heure, ils rentraient dans leurs ksours, tremblants d’être razziés par les Français, cherchant comment ils pourraient apaiser les vainqueurs et éviter de terribles représailles.
Cependant Marcel et ses compagnons avaient quitté Sokloto qui, après la capture de l’éléphant, s’était pris pour le sous-officier d’une vénération énorme. Il le considérait comme un grand sorcier. La traversée du lac Tchad s’était effectuée, non sans difficulté ; car le pachyderme, baptisé par les voyageurs du nom de « Galette », en souvenir de l’aventure qui l’avait mis en leur présence – refusait obstinément de se séparer de Dalvan. Bon gré, mal gré, on avait dû longer le rivage ouest, afin que l’affectueux animal put suivre sur la terre ferme.
À Nwigmi, on avait retrouvé les traces de Canetègne. En vain, les indigènes avaient fait observer que l’éléphant ne réussirait pas à traverser le désert. Galette s’était obstiné, avait démoli la case où il était enfermé, et avait rejoint la petite troupe à dix kilomètres de la ville. Le moyen de résister à une amitié aussi vive. On décida que la bonne bête ferait partie de l’expédition, mais afin qu’elle souffrit le moins possible de l’aridité du Sahara, on la chargea d’une centaine de kilogrammes de betna – plante fourragère qui porte des régimes analogues à ceux du maïs – dont les graines contiennent, sous un petit volume, une grande quantité de substance nutritive.
On marchait vite, afin de rattraper la troupe Canetègne. À Yat, les Voyageurs apprirent que le commissionnaire n’avait plus que trois journées d’avance. Stimulés par cette bonne nouvelle, ils forcèrent les étapes et furent en vue du Bir-el-Gharama, quarante-huit heures seulement après le départ de l’Avignonnais.
À leur approche, une bande de Touareg s’enfuit précipitamment. Les pillards étaient terrorisés, non par la troupe européenne elle-même, mais par l’apparition de Galette. Jamais, de mémoire d’homme, un éléphant ne s’était montré dans ces solitudes.
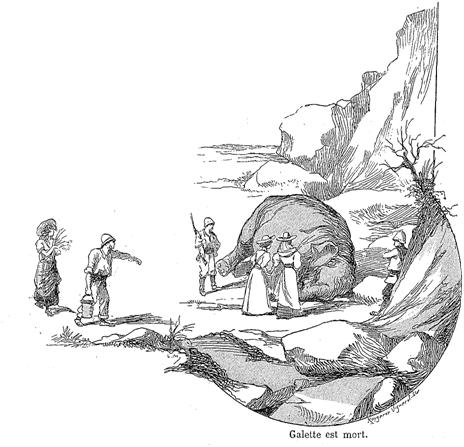
Pourtant la pauvre bête n’était rien moins que menaçante. Habituée aux plaines verdoyantes, largement arrosées du Soudan, elle se traînait péniblement sur le sol calciné du désert, cherchant sans cesse des pointes d’eau trop rares pour ses besoins. Galette n’était plus que l’ombre du « solitaire vigoureux » conquis par Simplet. Sous la caresse brutale du soleil, sa peau se fendillait, se creusait en plis, chaque jour plus marqués, sur ses muscles amollis.
Auprès du puits de Bir-el-Gharama, il s’étendit à terre, sans vouloir paître le drinn qui croissait aux environs. Un accès de fièvre le faisait grelotter. Encore qu’ils fussent pressés de reprendre leur route, les amis d’Yvonne durent perdre une journée entière dans la montagne.
Une inquiétude sourde régnait dans la caravane. Quelle trame nouvelle avait donc ourdie Canetègne, qu’il ne craignît pas de ramener Antonin en Algérie ? Car aucun doute n’était permis à cet égard ; c’était bien vers ce pays qu’il conduisait le frère de Mlle Ribor.
Tandis que Claude, Simplet, Yvonne, miss Pretty se communiquaient leurs attristantes réflexions, William Sagger et Sourimari soignaient Galette. La jeune fille récoltait du drinn, et l’Américain, à l’aide d’une corde et d’un seau de toile, puisait de l’eau dont il arrosait la terre autour du colosse exténué. Chaque jour, du reste, ils se chargeaient de pareille besogne. Sans doute elle les amusait énormément, car l’intendant avait repris l’habitude du sourire, et sa voix avait des inflexions gaies et tendres lorsque, arrivé à l’étape, il disait à la maorie :
– Galette demande ses serviteurs.
– Présent ! répondait la petite. Je vais aux provisions.
– Et moi à la cave.
– Car je suis la cuisinière.
– Comme moi le sommelier.
Après une journée de repos, la poursuite ardente recommença. Le 2 janvier 1895, la caravane quitta le Bir-el-Gharama ; le 12, elle atteignit les salines d’Amadghor ; le 16, elle était à Inziman Tikhsin (eau sous le sable) source située au milieu d’un pays dont la sécheresse et la désolation sont encore augmentées par la présence de nombreux lits de rivières éternellement privées d’eau. Un à un, les voyageurs franchirent les obstacles accumulés en ces régions par la nature ennemie. Le 18, ils passent à l’oasis d’Anguid, où Canetègne a été vu la veille. Le 30, ils traversent le plateau de Tadematt, puis ils s’engagent dans la vallée basaltique de l’Igarghar, fleuve aujourd’hui souterrain, qui jadis avait l’importance du Danube et arrosait une contrée peuplée et prospère. Le sable a bu l’eau, les plantations sont mortes ; les populations se sont dispersées. Il ne reste qu’une large dépression, pavée de basaltes bleuâtres qui prennent, amère ironie, sous la lumière du soleil, l’aspect d’ondes limpides et ruisselantes.
Le 27 février, à dix kilomètres d’Ouargla, Marcel et ses amis durent s’arrêter au bord de l’Oued-Mia, rivière privilégiée qui coule cinq ou six jours tous les trois ans. Actuellement elle était à sec et Galette, à bout de forces, s’était affaissé sur le sable. Le colosse était vaincu par le désert. Il haletait péniblement. Sa trompe raidie exhalait un souffle rauque, grinçant, et sur sa peau racornie passaient, en ondes douloureuses, d’incessants frissons. Quelques gouttes d’eau le sauveraient peut-être, lui permettraient d’atteindre l’oasis d’Ouargla humide et ombreuse, que masquent de hauts djebels de sable ; mais les jeunes gens attristés ont beau gravir les dunes, promener autour d’eux des regards aigus, tout est sec, aride, brûlé.
Le pachyderme pousse un gémissement, un râle. Ses yeux, voilés déjà, cherchent Simplet. Il semble l’appeler. Le sous-officier s’approche de l’animal reconnaissant qui, dans un dernier effort, le flatte de sa trompe et retombe.
Une convulsion rapide secoue le corps du géant, ses pattes énormes se raidissent, puis il demeure immobile, insensible désormais à la terrible morsure du soleil.
Galette est mort.
Une tristesse point tous les cœurs. Il va falloir partir, abandonner le corps de cet ami fidèle aux insultes des grands vautours et des chacals affamés.
– Jamais ! s’écrie Dalvan répondant à la pensée de tous. Par sa présence il a éloigné les pirates du désert. Il serait injuste de le laisser ainsi.
– Que prétends-tu faire ? interroge Yvonne.
– C’est bien simple, petite sœur, lui creuser la tombe à laquelle a droit tout ami dévoué.
C’est un travail considérable, mais le sol n’est point compact. Tout le monde se met à l’œuvre. Le trou se creuse autour du cadavre débarrassé des quelques plants de betna qu’il portait encore. Et soudain un cri de surprise s’échappe de toutes les poitrines. La terre s’est brusquement affaissée entraînant le corps de Galette, et une gerbe d’eau claire jaillit, inondant le lit de l’Oued-Mia. Sous l’effort des travailleurs, la croûte solide, formant voûte au-dessus des eaux souterraines, a cédé. À l’instar de plusieurs ingénieurs qui se consacrent à rendre la vie au désert, les compagnons d’Yvonne viennent de créer un point d’eau.
Au fond de l’excavation circule un courant rapide, tumultueux, qui déjà a entraîné la dépouille de l’éléphant. Pauvre Galette ! Mort de soif, tu dormiras le dernier sommeil dans ces flots limpides. Ta mémoire sera conservée, car le nouveau puits, autour duquel Simplet sème les graines du betna, portera désormais le nom de « Puits de l’Éléphant ».
Les montures s’abreuvent, les hommes aussi. Tout est prêt pour le départ. Un temps de trot et l’on sera en vue d’Ouargla. Mais les dunes qui bordent le fleuve se couvrent de cavaliers arabes au long bournous flottant. Ce sont les goumiers de l’agha d’Ouargla. Plus rapides que le vent, ils fondent sur la petite troupe, s’emparent des méharis, des chevaux, des armes, et ordonnent brutalement aux européens de les suivre à Ouargla. Aux questions des voyageurs, ils se bornent à répondre :
– L’agha le veut ainsi.
La résistance est impossible, Marcel et ses amis se soumettent. Ils marchent comme des malfaiteurs, chacun surveillé par deux hommes du goum.
Durant deux heures on va ainsi. Yvonne, Diana sont lasses, elles se plaignent ; mais après avoir franchi une dune qui masque l’horizon, les premiers palmiers de l’oasis d’Ouargla apparaissent. Peu à peu leur nombre augmente. On chemine à l’abri d’une véritable forêt. Partout des eaux jaillissantes, partout, protégés contre le soleil par le panache des dattiers, des cerisiers, des abricotiers, des grenadiers en fleurs. Au tronc des palmiers s’enroulent des vignes robustes. C’est l’abondance, le pays de cocagne au sortir du Sahara désolé.
Un instant les captifs n’ont plus conscience de leur situation. Ils aspirent à pleins poumons l’air humide chargé de parfums. Mais la haute muraille du ksour se dresse devant eux, les rappelant à la réalité. Ils passent sous la porte Lacroix, voûte obscure que défend une tour, entrevoient le tombeau vénéré du marabout Si-Abder-Rhaman, parcourent avec leurs gardiens les ruelles sinueuses, traversent la place du marché et atteignent enfin la casbah – citadelle – demeure de l’agha, chef suprême de l’oasis d’Ouargla.
Après avoir franchi deux portes gardées par des goumiers et traversé une cour intérieure, les captifs furent poussés par leurs gardiens dans une salle d’une richesse incomparable. Des vitraux de couleur formaient le plafond, laissant filtrer un jour mystérieux. Les murs semblaient de dentelles, tant ils étaient surchargés de ciselures et d’arabesques. Des étoffes précieuses masquaient les portes. Et tout au fond se détachant sur une panoplie d’étendards verts du prophète, l’agha, assis sur un tapis turc recouvrant une estrade élevée de trois marches, se détachait nettement en ses vêtements blancs constellés de broderies.
Le chef de l’escorte s’approcha du puissant arabe et lui parla à voix basse. Alors, scandant bien les syllabes, l’agha prononça en excellent français :
– Serviteur dévoué de la France, je dois en toutes circonstances faire respecter ses lois. Marcel Dalvan, Claude Bérard, Yvonne Ribor approchez.
Les jeunes gens firent un pas en avant. Aussitôt des Arabes les saisirent et leur passèrent les menottes avec une dextérité qu’envierait plus d’un de nos bons gendarmes.
– Vous êtes mes prisonniers, continua l’agha. Dès demain vous serez dirigés vers le Nord, afin d’être remis aux autorités françaises.
Puis s’adressant à miss Diana, qui demeurait là, pétrifiée par ce coup de tonnerre :
– Vous, mademoiselle, vous êtes libre ainsi que vos serviteurs. Excusez mes guerriers s’ils vous ont arrêtée en même temps que les coupables ; c’est qu’ils n’avaient point la faculté de discerner les bons des mauvais. Par mes soins, la diffa – festin – vous sera offerte, et vous quitterez la casbah, chargée de présents destinés à effacer même le souvenir de l’aventure fâcheuse dont vous fûtes victime.
Sur ces mots, l’agha fit un signe. Yvonne et les sous-officiers furent entraînés au dehors, tandis qu’un secrétaire du chef d’Ouargla conduisait respectueusement l’Américaine à la salle du banquet. En traversant la cour, Diana se trouva face à face avec Canetègne. Elle eut un mouvement de répulsion, mais se dominant elle lui demanda :
– Monsieur Canetègne, qu’avez-vous fait d’Antonin Ribor ?
Sous l’horreur de la question, le commissionnaire chancela, ses traits se décomposèrent, et il répondit d’une voix à peine intelligible :
– C’était une ruse de guerre. Je ne l’ai jamais rencontré.
Puis il s’éloigna, la tête basse, le dos courbé, murmurant avec l’obstination des meurtriers à se trouver une excuse :
– Après tout, je n’avais pas le choix. Lui ou moi. J’ai pensé à moi, c’est la lutte pour la vie, c’est le struggle for life.
Indice de son trouble, l’Avignonnais en arrivait à parler anglais.
XXXIX
LA COUR D’ASSISES

La ville de Lyon était en rumeur. Une foule compacte stationnait aux abords du Palais de Justice, huant les privilégiés qui, munis de cartes, pouvaient entrer dans la salle où allait être rendu le jugement sur l’affaire Canetègne-Ribor.
Oh ! cette affaire passionnait la population si indifférente d’ordinaire, aux menus faits procéduriers. La presse s’en était emparée. Les reporters avaient interwievé miss Diana, Sagger, Sourimari, Canetègne. En articles sensationnels, ils avaient raconté ce que les voyageurs leur avaient appris, agrémentant le récit de leur fantaisie personnelle. Par une mixture savante, ils avaient orné les extraits du dictionnaire géographique de Vivien de Saint-Martin de rêveries fantastiques empruntées aux conteurs des Mille et une Nuits.
Puis chacun, selon ses impressions, son tempérament, avait pris parti.
Les uns avaient soutenu M. Canetègne, ce négociant austère et progressiste, en butte aux entreprises de maîtres chanteurs tellement habiles, qu’ils avaient surpris la bonne foi de la richissime Américaine Gay-Gold-Pretty.
D’autres, au contraire, adoptant la version des sous-officiers, promettaient une prime exceptionnelle à qui trouverait trace du chèque photographié.
Les fausses nouvelles se croisaient. Les plaisantins des deux hémisphères confiaient aux télégraphes terrestres ou sous-marins les dépêches les plus contradictoires.
Antonin Ribor avait été vu le même jour à Calcutta, à Buenos-Ayres, au Cap et à Sydney.
L’affaire avait pris les proportions d’un obsédant mystère. Le public s’arrachait les éditions successives des feuilles quotidiennes, commentait les télégrammes, discutait les cablogrammes. Pas une feuille où l’on ne s’entretint de l’issue probable du procès Canetègne contre Ribor. Celui-là éveillant les sympathies des notables, personnages influents, jugeant avec moins de logique que d’autorité du haut de leur « fortune faite ». Ceux-ci défendus par la jeunesse et par le peuple, toujours disposés à accabler le capital. Bref, les cinq cent mille habitants du chef-lieu du Rhône se divisaient en deux fractions – les Canetègnards et les Riboristes – aussi ennemies que les Capulets et les Montaigus. Aussi ennemies n’est pas une exagération, car des Juliettes, filles de Canetègnards, virent leur main inexorablement refusée à des Romeos Riboristes. Des rixes éclataient dans les rues. Pour un peu, les deux camps, dont l’un ignorait tout et dont l’autre ne savait rien, en seraient venus aux mains.
Devant cette effervescence, le tribunal s’était décidé à mettre les bouchées doubles.
L’instruction ancienne de M. Rennard fut reprise, rapidement complétée, et le samedi 18 mai 1895, les prisonniers Yvonne Ribor, Marcel Dalvan et Claude Bérard furent extraits de leur prison et conduits au Palais de Justice.
L’heure de l’expiation avait sonné, ainsi que l’écrivait un publiciste dans l’un des organes les plus importants de la cité.
On juge de l’émotion de la population lyonnaise.
La salle était bondée. Tout ce que la ville comptait de notabilités se trouvait rassemblé dans l’étroit espace mis à la disposition du public. On se pressait, on se bousculait, démontrant ainsi jusqu’à l’étouffement la compressibilité du corps humain. Une rumeur sourde flottait dans l’air. Négociants, fonctionnaires, membres du barreau au grand complet poursuivaient l’irritante discussion, à laquelle le verdict du tribunal allait mettre fin.
Puis un grand silence plana sur l’assemblée.
Escortés de gendarmes, les prévenus venaient s’asseoir sur le banc d’infamie. Tous les regards se fixèrent sur eux avec une avide curiosité.
Yvonne était blême. Sa robe noire, très simple, faisait encore ressortir la pâleur de son teint. Ses yeux rougis indiquaient les larmes versées, les angoisses subies.
Claude aussi semblait abattu. Seul, Simplet conservait son air habituel. Une ride profonde entre les sourcils décelait seule sa préoccupation.
Du regard il fouilla la salle. Au premier rang des spectateurs il reconnut miss Diana Pretty, accompagnée de William Sagger et de la maorie Sourimari. Il leur adressa un sourire et les désigna à ses co-accusés.
Aux heures de désespoir, la plus légère marque d’intérêt acquiert une valeur inestimable. La présence de l’Américaine réconforta Yvonne et Claude. Ils se souvenaient des mille preuves d’affection qu’elle leur avait données tandis que prisonniers, traités ainsi que des malfaiteurs, ils revenaient d’Ouargla en France.
Des goumiers les avaient conduits, par la vallée de l’Oued Rihr et le Chott – lac – Melrirh, à Biskra. Là, ils avaient été remis aux mains des spahis qui sont les gendarmes algériens. À partir de ce point ils avaient été transportés par le chemin de fer. Par Batna, El-Guerrah, le Kroubs, Souk-Ahras, ils avaient atteint Tunis.
À travers les fenêtres du wagon, prison roulante, ils avaient aperçu les montagnes escarpées de l’Aurès, couvertes de forêts de chênes-liège ; sous les feuillées sombres résonnaient les rugissements des lions et des panthères. Plus loin, les plaines qui entourent Constantine étaient apparues un instant, puis la région montueuse du Kroubs, de Souk-Ahras, et enfin le convoi avait filé à toute vapeur au milieu des vallées fertiles de la Tunisie. À chaque halte, à chaque transbordement, miss Pretty était là. Aux prisonniers, elle envoyait des fruits, des fleurs ; plus que cela encore : la parcelle d’âme affectueuse dont les vaincus sont avides.
À Tunis, elle avait visité ses amis dans leur prison. Elle avait pris passage sur le navire qui les emportait vers Marseille. L’embarquement avait eu lieu le matin, et dans l’éblouissement de la rade de la Goulette bordée de villas, de l’ancien port de Carthage qui faillit tuer notre civilisation latine, elle s’était montrée aux sous-officiers, à Yvonne, comme une fée bienfaisante, comme l’image vivante de l’espérance.
À Marseille, les voyageurs malgré eux étaient entrés dans le port du Commerce, le jour même où l’inventeur de génie qui a nom Goubet expérimentait devant une foule enthousiaste son nouveau torpilleur sous-marin. Profitant de l’affluence des spectateurs, Diana avait réussi à joindre les captifs, à leur serrer la main.
Maintenant elle venait parmi le public hostile, en face des juges prévenus, dire à ceux qui allaient être condamnés :
– Je suis là. Dans cette salle d’audience il est quelqu’un qui jamais ne doutera de vous ; quelqu’un qui vous honore et vous aime.
La voix indifférente d’un huissier annonça :
– Messieurs de la Cour.
Les magistrats parurent et prirent place.
Les débats de l’affaire sensationnelle allaient commencer. Le président, M. Lousteyrie, renommé pour son habileté à embrouiller les accusés, procéda rapidement à l’interrogatoire des prévenus. Puis on passa à l’audition des témoins. L’attention redoubla dans la salle. M. Canetègne fut introduit.
Dans une déposition filandreuse, l’Avignonnais parut s’évertuer à innocenter Yvonne. Elle avait volé, c’était vrai, il était bien obligé de l’avouer ; mais il attribuait surtout son crime aux mauvais conseils. Depuis, du reste, il avait épousé la jeune fille à Haïphong. Elle était sa femme. Or, d’après la loi, entre conjoints le vol n’existe pas.
Des murmures approbateurs soulignèrent les principaux passages de ce discours. On savait gré au commissionnaire de plaider les circonstances atténuantes. Aussi la surprise fut-elle vive quand Yvonne se leva et interrompant le témoin :
– Je n’accepte pas la pitié de cet homme. À l’époque où il m’accusa de vol, faussement, je le jure, je n’étais pas sa femme. Mon mariage, conclu par ruse, par surprise, n’était pas célébré encore. Si je dois être punie d’un crime que je n’ai pas commis, je sollicite la rigueur des lois. La prison est moins honteuse à mes yeux que l’existence aux côtés de cet homme qui, maintenant encore, avec une pitié hypocrite, m’accable de son faux témoignage.
Le Président arrêta l’accusée :
– Asseyez-vous, mademoiselle. Songez que si vous repoussez l’indulgence du tribunal, vous frappez du même coup vos complices : deux sous-officiers estimés de leurs chefs, bien notés, qui par une aberration étrange vous ont aidée à échapper à la justice.
– Bah ! murmura Marcel assez haut pour être entendu. On ne peut pas condamner Bérard ; l’instruction a établi qu’il n’avait pris aucune part à l’évasion d’Yvonne.
– Vous dites ? clama M. Lousteyrie furieux de rencontrer des prévenus qui semblaient tenir à obtenir le maximum.
– Je dis, M. le Président, qu’il vaut mieux être n’importe où, qu’auprès d’un être abhorré. Ma sœur de lait sait que l’hymen est annulé si l’un des conjoints est frappé d’une peine afflictive et infamante. Elle préfère la prison à la présence de M. Canetègne. Je lui donne raison. Je ferai même un peu de cellule, pour vous décider à obtempérer à son désir.
Le public riait. Vraiment l’affaire prenait une tournure originale.
De son côté Canetègne, interloqué par la brusque sortie d’Yvonne, regagnait le banc des témoins en grommelant cette phrase à effet :
– Vraiment ! C’est à dégoûter de faire le bien !
– Bah ! M. Canetègne, riposta Simplet. Ce dégoût-là, vous l’aviez de naissance.
Pour couper court à l’incident, le président ordonna de faire entrer le témoin suivant, Mlle Doctrovée, de la maison Canetègne et Cie.
L’anguleuse personne parut. Depuis le départ d’Yvonne, elle semblait encore avoir maigri, réalisant ainsi un tour de force réputé impossible. Son engelure nasale rutilait sous un chapeau d’un bleu tendre. Pour se présenter devant le tribunal, la vieille fille avait soigné sa mise. D’azur vêtue, ses mains osseuses cachées par des gants gris perle, ses oreilles en « plats à barbe » allongées par de lourds pendants, tout en elle trahissait son désir de faire sensation. Elle dut être satisfaite, car un murmure salua son apparition. Il est vrai qu’il était ironique.
Invitée par M. Lousteyrie à dire ce qu’elle savait, Doctrovée paraphrasa de sa voix acide la déposition de l’Avignonnais.
Marcel se pencha vers Mlle Ribor.
– Ils se sont donné le mot, murmura-t-il, il faut la faire changer de ton.
– Tu ne pourras pas. Elle est si fine.
– Mais si. C’est simple comme bonjour. La colère dérange les combinaisons les mieux ourdies.
À ce moment, la sèche créature disait d’un ton emphatique :
– Certes, cette jeune personne a mal reconnu les bontés de M. Canetègne, mais ainsi que ce négociant d’une probité éprouvée, je pense quelle a agi sous l’influence de conseils funestes…
– Mlle Doctrovée, fit Simplet en se levant.
– Asseyez-vous ! rugit le Président.
– Pardon, une simple question au témoin :
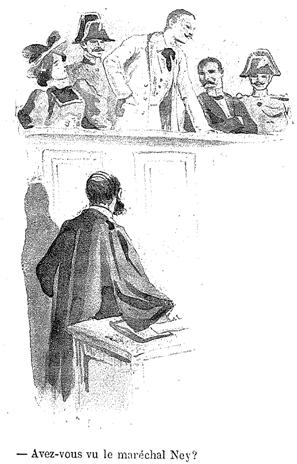
Et rééditant la plaisanterie qui naguère exaspérait le complice du commissionnaire, Marcel, le sourire sur les lèvres, la bouche en cœur, demanda :
– Mademoiselle Doctrovée, avez-vous vu le maréchal Ney ?

Un éclat de rire homérique secoua la salle. Non, jamais on n’avait vu accusés aussi joyeux.
– Eh bien ! continua paisiblement Dalvan, il est avec son ami Pif de la Mirandole. Tous deux s’étonnent qu’une demoiselle qui n’a pas pu trouver d’époux, se donne tant de peine pour river au poignet d’une autre la chaîne du mariage.
Du coup les assistants se pâmèrent. C’en était trop. Mlle Doctrovée passa du blanc au rouge, du rouge au violet ; le bout de son nez prit une teinte incandescente.
Les yeux injectés, la voix sifflante, elle chargea Yvonne.
Certainement M. Canetègne avait bien tort de s’apitoyer sur son ex-caissière. Il était impossible de rencontrer jeune fille plus fausse, plus autoritaire, plus revêche.
– Impossible n’est pas français, souligna Simplet. La preuve en est aisée. Quelqu’un veut-il prêter un miroir au témoin ?
Les rires redoublèrent, et M. Lousteyrie indigné, débordé, clama :
– Je préviens les personnes présentes que je vais faire évacuer la salle.
Et le silence rétabli, le magistrat précipita le défilé des témoins. Les employés de Canetègne qui ignoraient tout, le gendarme Cobjois, qui se souvenait seulement d’avoir dormi deux jours lors de l’évasion de Mlle Ribor, quelques autres comparses aussi peu intéressants, défilèrent devant le tribunal. L’audition de ces personnages terminée, la parole fut donnée au Ministère public.
Ah ! il ne fut pas tendre pour les prévenus. Après avoir fait une peinture émouvante de l’état d’âme de M. Canetègne, ce négociant modèle, portant haut le drapeau commercial de la France jusqu’au fond des colonies les plus éloignées, de ce commissionnaire, orgueil de la cité lyonnaise, si dévoué à Mlle Ribor, qu’il n’avait pas craint de lui donner son nom afin de lui éviter la juste punition de ses fautes, le magistrat conclut par cette éloquente péroraison :
– Il est temps, messieurs, de réagir contre le scepticisme de cette fin de siècle, qui met une coquetterie, un dilettantisme dangereux à railler toutes les institutions sociales. Vous venez d’assister au spectacle profondément décourageant d’accusés narguant la répression légale. Il ne faut pas qu’ils fassent école, ces nouvellistes à la main du crime. Frappez-les sans pitié. En pareil cas, l’indulgence serait plus que de la faiblesse ; elle serait la négation du principe d’autorité, la désorganisation de la magistrature ; elle préluderait à l’agonie d’une société que vous avez la mission glorieuse et ardue de protéger.
Après cette violente apostrophe, l’affaire semblait entendue. Le défenseur des prévenus, désigné d’office par le tribunal, se leva d’un air découragé. Il déclara que l’attitude de ses clients le mettait dans l’impossibilité de plaider en leur faveur.
Les juges, les jurés allaient se retirer pour délibérer, quand un huissier s’approcha de l’avocat et lui remit un papier. À peine le défenseur y eut-il jeté les yeux que son visage s’illumina. Comme mû par un ressort, il se dressa tout d’une pièce et étendant le bras vers les juges qui déjà quittaient leurs sièges :
– Messieurs, dit-il, un mot encore. Monsieur le Président, en vertu de votre pouvoir discrétionnaire, je vous demande d’entendre un témoin qui n’a pas été cité.
Un silence de mort plana aussitôt sur l’assistance. L’huissier porta à M. Lousteyrie le billet reçu à l’instant par la défense. Les traits du magistrat exprimèrent la surprise ; il conféra avec les autres membres du tribunal et enfin prononça ces mots :
– Faites entrer le témoin.
Une minute s’écoula. La porte qui avait successivement livré passage à Canetègne, Doctrovée, Cobjois, s’ouvrit de nouveau, et sur le seuil parut un jeune homme pâle, marchant avec difficulté en s’appuyant au bras d’un robuste guerrier Targui, drapé dans son long burnous blanc.
Deux cris résonnèrent :
– Mon frère !
– Antonin !
Les accusés étaient debout, tendant les bras au témoin. Et presque aussitôt une voix chevrotante, affolée, inconsciente gémit :
– Les morts reviennent !… Le spectre ! chassez le spectre !…
C’était Canetègne éperdu, hagard, qui saisi d’une terreur superstitieuse se trahissait lui même. Antonin l’entendit :
– Oui, monsieur Canetègne. Antonin Ribor, que vous avez fait assassiner au Bir-el-Gharama, a été recueilli par le cheik Hoggar Mokhédem-el-Djebel ici présent. Il arrive à temps pour vous empêcher de déshonorer sa sœur.
Puis d’une voix vibrante dont la salle entière frissonnait, le jeune homme raconta le crime, la découverte de son corps par les Touareg, les soins grâce auxquels il avait pu triompher du mal. Ensuite son retour à Ouargla, sous l’escorte de son sauveur, sa stupeur en apprenant de l’agha l’arrestation d’Yvonne, de Marcel et d’un inconnu du nom de Bérard.
– Assassin, M. Canetègne l’est, fit-il en terminant. Mais il est aussi faussaire, voleur, et il a menti à la justice en accusant ma sœur. Oui, il m’avait souscrit un chèque de soixante-dix-huit mille francs. Oui, je l’ai fait photographier au moment de mon départ. Seulement, arrivé à Marseille, sur le point de m’embarquer, je confiai l’épreuve photographique à un ami chez qui je l’ai reprise au retour. Cette épreuve la voici.
Des applaudissements unanimes éclatèrent. Sur l’ordre de M. Lousteyrie, l’Avignonnais fut arrêté séance tenante, tandis que, sans délibération préalable, les magistrats renvoyaient acquittés Yvonne et ses amis.
Alors Mlle Ribor se jeta dans les bras de son frère enfin retrouvé et Simplet s’écria :
– Si l’un des époux est frappé d’une peine afflictive et infamante, le mariage est déclaré nul de plein droit. C’est simple comme bonjour. Tu es libre, petite sœur.
La jeune fille lui tendit la main et avec un accent impossible à rendre :
– Non, Simplet, j’ai un maître. Il m’a appris le dévouement, le courage, l’abnégation. Aussi je lui confie mon bonheur !
Quelques semaines plus tard, l’Avignonnais était gratifié de vingt années de travaux forcés, et Mlle Doctrovée, sa complice en fuite, condamnée par défaut à huit ans de réclusion. Marcel, avec l’argent qui lui restait et le produit de la vente des pépites et diamants rapportés de la Guyane à bord du Fortune, rachetait la maison de commission qui prenait pour raison sociale A. Ribor, Marcel Dalvan et Cie.
Au bout d’une année, attente légale imposée par le Code, trois mariages furent célébrés le même jour, à Lyon, au milieu d’un immense concours d’amis et de curieux. Claude Bérard épousait Diana guérie de sa misanthropie ; Sagger, consolé du passé fatal, donnait son nom à la maorie Sourimari, charmante en ses vêtements de fiancée. Enfin Simplet devenait le mari d’Yvonne.
À sa boutonnière, on remarquait une brochette composée de toutes les décorations françaises.
En effet, à la Légion d’honneur obtenue à Madagascar, aux médailles militaire et de sauvetage conquises à Paknam et à Papeete, étaient venues se joindre la médaille coloniale et l’ordre du Mérite agricole. La première, sur la proposition du capitaine Fernet, qui, grâce au sous-officier, avait pu devancer les Allemands auprès du sultan du Baghirmi et traiter avec ce souverain ; la seconde, sur un rapport de l’agha d’Ouargla, duquel il résultait que le jeune homme, en semant le betna autour du puits de l’Éléphant avait doté le sud Algérien d’une plante fourragère supérieure à toutes les espèces existantes.
Enfin, utilisant ses loisirs, le voyageur avait mis en ordre ses souvenirs dont ce livre est une adaptation.
Juste récompense de ce labeur littéraire, Simplet était officier d’académie.
